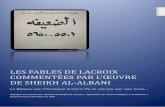Lacroix-Saint-Ouen « Le Prieuré » et « Les Jardins », Un grenier et ses réserves dans leur...
Transcript of Lacroix-Saint-Ouen « Le Prieuré » et « Les Jardins », Un grenier et ses réserves dans leur...
Archéo-logi en S a r r e , Lorraine et Luxembourg A r c h ä o l o g i e im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg Archéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg Sarre, Lorraine et Luxembourg
92014
ArchaeologiaMosellana
Hommage à Jeannot Metzler
Illustration en couverture :Petit cheval stylisé : fragment sommital d’un peigne en bronze celtique.Titelbergn° inv. 1997-120/1
Coordination du tome 9Catherine Gaeng
Centre National de Recherche ArchéologiqueMusée National d’Histoire et d’Art
Luxembourg
Secrétariat d’éditionCatherine Gaeng et Charlotte Félix
Réalisation graphique/Mise en page Charlotte Félix
Publié avec le concours du Ministère de la Culture, Luxembourg
Publié avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communicationde l’Association pour le Développement
de la Recherche Archéologique en Lorraine (ADRAL)
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung des Landesdenkmalamtes im Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes
Imprimé au Luxembourg, Imprimerie Fr. Faber (Mersch)
ISSN 1027-8311 ISBN 978-2-87985-293-5
Archaeologia MosellanaArchéologie en Sarre, Lorraine et Luxembourg
Archäologie im Saarland, in Lothringen und Luxemburg
Tome 9
2014
Centre National de Recherche Archéologique, Luxembourg Musée National d’Histoire et d’Art, Luxembourg
Service Régional de l’Archéologie de LorraineLandesdenkmalamt des Saarlandes
F. Le Brun-Ricalens Avant-propos : Lieber Amicorum ............................................................................................................................ 15
C. Gaeng, L. Homan, N. Gaspar Petit hommage décalé ............................................................................................................................................... 17
H. Löhr Grußwort ................................................................................................................................................................... 23
E. O’Brien Decayed, consumed, dried, cut up, drowned or burnt? An overview of burial practices in Iron Age Britain ............................................................................................................................................................... 25
R. Dupond, M. Landolt, E. Stephan avec la collaboration de C. Berszin et Ch. Drier Une riche inhumation féminine du début du Ve siècle av. J.-C. découverte à Metz (Moselle) ................... 53
B. Lambot Les tombes à char de Champagne, témoins d’une élite villageoise à La Tène ancienne : données récentes .............................................................................................................................................................. 73
A. Haffner Das frühkeltische Prunkgrab „Am Müllenberg“ von Besseringen-Merzig im nördlichen Saarland .......... 81
T. Lejars Le choix des armes dans les pratiques votives des Celtes occidentaux de La Tène moyenne .......................113
E. Glansdorp Das Gräberfeld von Perl-Oberleuken und die Frage der „kollektiven Identität“ am Anfang der Spätlatènezeit im Saar-Mosel-Raum ...........................................................................................................................137
F. Le Brun-Ricalens Du rite au mythe ? Essai d’interprétation de certains silos funéraires protohistoriques d’Europe occidentale à partir des fouilles de Remerschen (G.-D. de Luxembourg) ....................................................................................153
O. Buchsenschutz La serpe d’or et le rempart de fer ..........................................................................................................................209
W.-R. Teegen, D. Lukas, R. Cordie Untersuchungen zur eisenzeitlichen Besiedlung von Wederath/Belginum ..................................................215
St. Fichtl Nouvelles réflexions sur la restitution de la porte Est de Manching (Allemagne) ......................................237
B. Bonnaventure, P. Méniel, M. Pieters et J. Wiethold L’alimentation sur l’oppidum de Boviolles (Meuse). Regards croisés sur la faune, les graines, la vaisselle et l’instrumentum ...............................................................................................................................................................259
D. Vitali La vaisselle céramique ˝celtique˝ des Boïens cisalpins (IVe-IIIe siècle av. J.-C.) : quelques considérations générales ..........................................................................................................................................................................295
P. Méniel Éléments pour une histoire de la charcuterie trévire .............................................................................................315
Sommaire
6
F. Malrain, V. Zech-Matterne La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise) : un grenier et ses réserves dans leur contexte régional ................................................................................................................................................................................................... 325
T. Luginbühl La ˝migration des Cimbres et des Teutons˝, une histoire sans archéologie ? ....................................................343
P. Barral, N. Coquet, St. Izri, M. Joly, P. Nouvel avec la collaboration de P. Blanchard (✝), B. Dupere, S. Février et A. Vaillant Langres et Champigny-les-Langres (Haute-Marne), un exemple de construction de pôle urbain à la fin de l’âge du fer et au début du Haut-Empire ...................................................................................................................361
C. Féliu Les monnaies médiomatriques : réflexions cartographiques préliminaires à l’étude de séries monétaires de l’Est de la Gaule ........................................................................................................................................................385
K. Gruel La stratigraphie des sanctuaires, un piège chronologique pour les monnaies ...............................................399
M. Poux avec la collaboration d’A. Gilles, P. Bernard, B. Clément et L. Guillaume Du vin marseillais pour Staius Regillus : un témoignage du commerce rhodanien et de la colonisation des campagnes entre Lyon et Vienne ..............................................................................................................................405
A. Desbat Lugdunum, colonie de vétérans de la Ve légion Alouette ? ..............................................................................425
J.-P. Legendre L’armée romaine en Lorraine : essai de bilan ........................................................................................................441
J. Kaurin et S. Deffressigne Les phases précoces et classiques de l’augustéen trévire et médiomatrique : quelques éléments de réflexion à partir de contextes aristocratiques ..............................................................................................................................507
A.-M. Adam Mutations techniques, conservatismes et ˝romanisation˝ : à propos de quelques modèles de fibules en bronze d’Italie septentrionale ......................................................................................................................................533
W. Reinhard Der frührömische Friedhof von Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“ im Saarland ................................549
St. Martin-Kilcher Nachbarinnen. Matronen auf einem frühkaiserzeitlichen Grabstein in der Gegend von Ahrweiler .........583
J.-M. Elsen et M. Paulke Zwei römische Dosenschlösser aus dem Vicus von Mamer/Bartringen (Luxemburg) ..................................611
J. Scheid Le monument célébrant la troisième présidence des frères arvales Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus et Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus ........................................................................................................................627
L. Clemens et J. Zimmer Bauforschungen am mittelalterlichen Wohnturm von Tertiveri (Prov. Foggia) in Apulien .......................639J. Zimmer
Sommaire
7
Archäologie und Bauarchäologie an Beispielen der Burgenforschung .............................................................663
Portfolio ..........................................................................................................................................................................705
•
8
Sommaire
Anne-Marie ADAMUniversité de Strasbourg - MISHA5 allée du Général RouvilloisF - 67083 STRASBOURG cé[email protected]
Philippe BARRALUniversité de Franche-ComtéLaboratoire Chrono-environnement UFR SLHS 30-32 rue MégevandF - 25030 BESANÇON [email protected]
Carola BERSZINAnthropologische Dienstleistungen, Wessenbergstr. 22-24, D - 78462 [email protected]
Bertrand BONAVENTUREArcheodunum SAS7 rue LebrunF - 69004 [email protected]
Olivier BUCHSENSCHUTZUMR 8546 - AOROC École Normale Supérieure 45 rue d’Ulm F - 75230 PARIS Cedex [email protected]
Lukas CLEMENSMittelalterliche Geschichte und Historische HilfswissenschaftenA-Gebäude, 216, UniversitätD - 54286 [email protected]
Nicolas COQUETUniversité de Franche-ComtéLaboratoire Chrono-environnement UFR SLHS 30-32 rue MégevandF - 25030 BESANÇON [email protected]
Rosemarie CORDIEArchäologiepark BelginumKeltenstraße 2D - 54497 [email protected]
Sylvie DEFFRESSIGNEInrap95 impasse Henri Becquerel F - 54710 [email protected]
Armand DESBAT Maison de l’Orient et de la Méditerranée7 rue RaulinF - 69365 LYON Cedex [email protected]
Christian DREIER Pôle archéologie préventive de Metz Métropole Harmony Park, 11 boulevard Solidarité, BP 55025,F - 57071 METZ Cedex [email protected]
Renata DUPONDPôle archéologie préventive de Metz Métropole Harmony Park, 11 boulevard Solidarité, BP 55025F - 57071 METZ Cedex [email protected]
Jean-Marie ELSENMusée National d’Histoire et d’ArtRestauration/Ateliers241 rue de LuxembourgL - 8077 [email protected]
Clément FÉLIUInrap Grand-Est Sud10 rue d’AltkirchF - 67100 [email protected]
Stephan FICHTLUniversité François RabelaisUFR d’Art et Sciences humaines3 rue des TanneursF - 37041 TOURS Cedex [email protected]
Coordonnées des auteurs
10
Catherine GAENGCentre National de Recherche Archéologique Service d’Archéologie protohistorique241 rue de LuxembourgL - 8077 [email protected]
Nicolas GASPAR89 rue Pierre MartinL - 4622 [email protected]
Eric GLANSDORPArchäologiebüro und Verlag GlansdorpKantstraße 32D - 66636 [email protected]
Katherine GRUELÉcole Normale Supérieure UMR 8546 - AOROC 45 rue d’Ulm F - 75230 PARIS Cedex [email protected]
Alfred HAFFNERSt. Johannesstraße 24D - 54316 [email protected]
Lydie HOMAN13 rue Robert SchumanL - 4779 PÉ[email protected]
Stéphane IZRIUniversité de Franche-ComtéLaboratoire Chrono-environnement UFR SLHS 30-32 rue MégevandF - 25030 BESANÇON [email protected]
Martine JOLYInstitut d’Art et d’ArchéologieUMR 8167 - Orient et Méditerranée3 rue MicheletF - 75006 [email protected]
Jenny KAURINLe BourgF - 71550 [email protected]
Foni LE BRUN-RICALENSCentre National de Recherche Archéologique Service d’Archéologie préhistorique241 rue de LuxembourgL - 8077 [email protected]
Bernard LAMBOT1 rue des AcaciasF - 60150 MACHEMONT [email protected]
Michaël LANDOLTPôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR)Service Archéologie et Recherches Scientifiques,2 allée Thomas Edison ZA Sud – CIRSUD F - 67600 [email protected]
Jean-Pierre LEGENDREDRAC LorraineService régional de l’Archéologie6, place de ChambreF - 57045 METZ Cedex [email protected]
Thierry LEJARSÉcole Normale Supérieure UMR 8546 - AOROC 45 rue d’UlmF - 75230 PARIS Cedex 5 [email protected]
Hartwig LÖHRAm Kiewelsberg, 8D - 54295 [email protected]
Thierry LUGINBÜHLSection d’Archéologie et des Sciences de l’AntiquitéQuartier UNIL-DorignyBâtiment AnthropôleCH - 1015 [email protected]
11
Coordonnées des auteurs
Dominik LUKASFreie Universität BerlinHittorfstr. 18D - 14195 BERLIN [email protected]
François MALRAIN7 route de Compiègne F - 02600 [email protected]
Stefanie MARTIN-KILCHERUniversität BernInstitut für Archäologische WissenschaftenAbt. Archäologie der Römischen ProvinzenBernastraße 15ACH - 3005 [email protected]
Patrice MÉNIELUniversité de BourgogneUMR 6298 - ARTeHIS6 boulevard GabrielF - 21000 [email protected]
Pierre NOUVELUniversité de Franche-ComtéLaboratoire Chrono-environnementUFR SLHS 30-32 rue MégevandF - 25030 BESANÇON [email protected]
Léonora O’BRIENURS Infrastructure & Environment UK Limited West One, 114 Wellington Street, Leeds GB - LS1 1BA, West [email protected]
Matthias PAULKECentre National de Recherche Archéologique Service d’Archéologie gallo-romaine 241 rue de LuxembourgL - 8077 [email protected]
Maxence PIETERSUniversité de BourgogneUMR 6298 - ARTeHIS6 boulevard GabrielF - 21000 [email protected]
Matthieu POUXMaison de l’Orient et de la Méditerranée7 rue RaulinF - 69007 [email protected]
Walter REINHARDLandesdenkmalamtAm Bergwerk Reden 11D - 66578 [email protected]
John SCHEIDCollège de France11 place Marcelin-BerthelotF - 75005 PARIS [email protected]
Elisabeth STEPHANRegierungspräsidium Stuttgart Landesamt für Denkmalpflege Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 Stromeyersdorfstraße 3 D - 78467 [email protected]
Wolf-Rüdiger TEEGENLudwig-Maximilians-Universität MünchenInstitut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäolo-gie und Provinzialrömische ArchäologieGeschwister-Scholl-Platz 1D - 80539 MÜ[email protected]
Daniele VITALIUniversité de BourgogneUMR 6298 - ARTeHIS6 boulevard GabrielF - 21000 [email protected]
Coordonnées des auteurs
12
Julian WIETHOLDInrap Grand-Est Nord12 rue de Méric - C.S. 80005F - 57063 METZ Cedex [email protected]
Véronique ZECH-MATTERNEMuseum National d’Histoire NaturelleUMR 7209, Archéozoologie-Archéobotanique55 rue Buffon - CP 56F - 75000 [email protected]
John ZIMMER4 rue LargeL - 1917 [email protected]
Coordonnées des auteurs
13
Archaeologia Mosellana 9, 2014 325
Mots-clés : La Tène ancienne, grenier, carpologie, millets, glands, agriculture, datation 14C.
Résumé : Le site Tène ancienne de La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ est localisé en rive gauche de l’Oise. Cette fouille a dégagé plusieurs bâtiments, dont un grenier, contenant des restes végétaux carbonisés, essentiellement millets et glands. Ces productions et les modes d’exploitation dont elles témoignent sont analysés dans leur contexte archéologique régional.
Schlüsselwörter: Frühlatène, Speicherbau, Karpologie, Hirsekörner, Eicheln, Landwirtschaft, C14-Datierung.
Zusammenfassung: Die frühlatènezeitliche Fundplatz von „Le Prieuré“ in La Croix-Saint-Ouen liegt am linken Ufer der Oise. Die Ausgrabung hat mehrere Gebäude erbracht, darunter ein Speicherbau, der karbonisierte Pflanzenreste enthielt, hauptsächlich Hirsekörner und Eicheln. Diese Produkte und die Anbauweisen, von denen sie zeugen, werden in ihrem regionalen archäologischen Kontext untersucht.
1. Introduction
1.1. Localisation, contexte géologique et stratigraphique
L’intervention est localisée dans le département de l’Oise, sur la commune de La Croix-Saint-Ouen (fig. 1). Le gisement du ˝Prieuré˝ se situe en rive gauche de l’Oise, à 700 m de son cours actuel et il est implanté sur la plaine alluviale de la moyenne vallée de l’Oise qui est constituée de cailloutis fluviatiles pléistocènes largement recouverts par des limons tardiglaciaires et holocènes. Les zones latérales les plus basses correspondent, en général, à des paléochenaux du Tardiglaciaire, plus ou moins retouchés à l’Holocène, alors que les parties les plus hautes, qui forment des buttes surbaissées dominant la plaine de quelques mètres, constituent les témoins résiduels d’un remblaiement sableux de la fin-pléistocène. La parcelle diagnostiquée se situe sur l’une de ces légères éminences, dénommées ˝montilles˝, qui ponctuent la plaine alluviale à une altitude comprise entre 31,25 et 32,5 m NGF. Les surfaces concernées sont bordées à l’ouest par le ru ˝des Planchettes˝ qui se jette, en aval, dans l’Oise au lieu-dit ˝La Noue˝. Les surfaces investiguées se trouvent à l’extérieur et légèrement excentrées d’un très large méandre que forme l’Oise à la hauteur de la commune du Meux.
1.2. Contexte archéologique
La découverte de vestiges protohistoriques au lieu-dit ˝Le Prieuré˝ sur la commune de La Croix-Saint-Ouen n’est pas un fait récent. En 1927 une extraction de sable avait permis à M. Hémery, historien local, de suivre l’évolution des travaux d’extraction pendant près de quatre ans et de mettre ainsi en évidence
LA CROIX-SAINT-OUEN ˝LE PRIEURÉ˝ ET ˝LES JARDINS˝ (OISE) UN GRENIER ET SES RÉSERVES DANS LEUR CONTEXTE RÉGIONAL
par François MalrainArchéologue, Inrap, chercheur associé, UMR 8215, Trajectoires, MAE (Nanterre)
et Véronique Zech-MatterneCarpologue, Chargée de recherche, UMR 7209 Archéozoologie et Archéobotanique,
CNRS-MNHN (Paris)
326
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
Fig.1 - Localisation et environnement archéologique des parcelles diagnostiquées à La Croix-Saint-Ouen “Le Prieuré“ (Oise). DAO F. Malrain, © Inrap.
327
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
une occupation du site à la période gauloise (Hémery 1931). Réétudiant ces découvertes dans le cadre de sa thèse, J.-C. Blanchet (1984) démontrait la présence de deux périodes distinctes dans cet ensemble :
− le premier âge du Fer (Hallstatt moyen) représenté par une nécropole à incinération ;
− le deuxième âge du Fer (La Tène finale) illustré par des fosses d’habitat.
Au printemps 1992, l’entreprise Mouret commençait l’exploitation d’une carrière sur une surface de 10 ha jouxtant les parcelles anciennement exploitées. Cette opération entraîna une surveillance archéologique des décapages, effectués en deux temps :
− une première tranche de 4 ha intégralement décapés ;
− des tranchées sur 20 % des 6 ha restants.
Les observations effectuées lors de ces travaux ont permis de repérer des structures attestant une nouvelle fois une occupation pré- et protohistorique du site, s’étendant du Néolithique à l’âge du Fer. Parmi les découvertes remarquables, il faut signaler la présence d’une sépulture collective à incinérations, fouillée en 1994, et d’un petit ensemble Chalcolithique-Bronze ancien (Billand 1992).
Plus largement, l’opération s’inscrit dans un contexte bien connu par l’archéologie. En effet, de 1987 à 2000 ce secteur était compris dans la zone d’étude du programme de surveillance et d’étude des sablières de la moyenne vallée de l’Oise, qui s’étendait de Compiègne à Pont-Sainte-Maxence. Les nombreuses inter-ventions archéologiques menées préalablement aux extractions de sable ont permis de bien documenter cette micro-aire géographique (Malrain, Pinard 2005). Sur la vingtaine de kilomètres de cette vallée, plus de 500 ha ont fait l’objet d’investigations archéologiques révélant une centaine de sites de toutes périodes. Il n’est pas dans notre propos d’en résumer l’intégralité, mais deux sites en partie contemporains ou qui précédent très légèrement celui dont il est question ici, méritent d’être brièvement présentés.
Il s’agit en premier lieu du site du ˝Fond Pernant˝ à Compiègne (Oise), qui a livré une centaine de fosses, des fossés et des concentrations de trous de poteau (Lambot 1988). Quatre zones de structures y sont bien individualisées. Au nord-ouest, des constructions et une palissade longent un fossé bordant un chenal. Elles sont limitées, au nord, par une palissade interrompue qui forme une entrée. Au sud-ouest, deux bâtiments sont entourés de fosses contenant l’essentiel du mobilier détritique ; une fosse-atelier et quelques petits silos témoignent d’activités domestiques et artisanales. Au levant, des batteries de silos et des fosses quadrangulaires avec peu de mobiliers peuvent correspondre à une zone de stockage. Entre ces trois zones, une quatrième, vide de toute structure, peut être assimilée à une zone d’activité non définie (cour, jardin, etc.), ou à un secteur d’habitation. Les constructions de la zone 1 comprennent un bâtiment sur vingt-huit poteaux formant un plan rectangulaire de 10 x 7 m et un second bâtiment rectangulaire sur huit poteaux implanté parallèlement au premier (8,5 x 2,8 m). Un troisième, de même forme, repose sur onze poteaux (9,5 x 8,6 m). À ces constructions s’ajoutent une trentaine de silos, localisés dans la zone orientale, et une vingtaine de fosses quadrangulaires. Les analyses des structures et des mobiliers ont permis de mettre en évidence la vocation à la fois résidentielle, agro-pastorale et artisanale de cette occupation. Sa fréquentation est située entre la fin du VIe et la fin du Ve siècle av. J.-C. et comprend plusieurs phases successives. Sur ce site, la fonction de stockage est, en grande partie, assurée par des silos, à l’inverse du site de La Croix-Saint-Ouen ˝Les Longues Raies˝ (voir infra) où il s’effectuait principalement dans des greniers. Le site du ˝Font Pernant˝ a livré un grenier incendié in situ et le contenu des trous de poteaux a été systématiquement recueilli. Un trou de poteau a livré des céréales en concentration tout à fait excep-tionnelle. Les échantillons provenant des autres trous de pieux sont malheureusement d’un volume trop restreint pour apprécier correctement la densité en restes. Pour C. Bakels qui a réalisé l’étude des restes végétaux, le tamisage s’est révélé inutile compte tenu du nombre de semences et de l’absence de sédiment ; les macrorestes carbonisés constituaient un dépôt pur (Bakels 1984). Le lot de grain se compose à 86 % d’orge vêtue et à 12 % d’épeautre ; l’avoine, le blé amidonnier et le millet sont peu représentés. À ces céréales sont mêlées des espèces sauvages (nielle des blés, armoise, moutarde des champs, brome, margue-
328
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
rite, coquelicot, fléole des prés, faux liseron, oseille…) qui témoignent d’un lieu de culture proche d’une zone humide. L’orge n’est pas encore débarrassée des glumelles qui adhèrent au grain, le blé est pour sa part en grande partie nettoyé, le pourcentage de bases d’épillet demeurant faible (6 %) mais néanmoins significatif du fait de la fragilité de ces composantes au feu. Cette abondance de céréales associée au fait que les lots de grain en présence ne sont qu’en partie traités évoque un stockage. En effet, les récoltes constituées de céréales à grains vêtus sont habituellement entreposées à une étape intermédiaire de leur traitement, sous la forme d’épillets, représentant le stade succédant au premier battage-vannage. Les grains encore vêtus sont ainsi protégés des insectes, de la lumière, de l’humidité et de la poussière. Les enveloppes contribuent à inhiber les processus de germination qui risqueraient de ruiner prématurément la récolte.
Le second gisement archéologique se situe dans l’environnement proche de notre occupation (un peu plus de 100 m) à tel point que la question se pose de savoir s’il s’agit d’un ou de deux sites distincts. Le site ˝Les Longues Raies˝ est implanté sur une petite butte cernée de zones basses et est délimité par un fossé très érodé qui a pu être suivi sur près de 350 m. Il a livré un peu moins de 300 structures dont 70 fosses, 120 trous de poteau qui ont permis de reconstituer le plan de 22 bâtiments, dont 15 x 4 poteaux et 2 x 6 poteaux assimilés à des greniers. Cinq autres bâtiments édifiés sur 4 à 7 poteaux dotés d’une avancée pourraient s’apparenter à des unités domestiques.
Les constructions s’organisent chronologiquement et spatialement. Elles se répartissent selon un axe nord/sud et leur regroupement correspond à deux, voire trois, phases de reconstruction estimées. Les structures ont régulièrement livré du mobilier caractéristique de rejets détritiques d’habitat tels que céramique, faune, torchis, éclats de silex, fragments de meule, etc., mais la présence des nombreuses constructions sur poteaux, de même que leur fonction probable de greniers, suggèrent que cette occupation soit assimilée à un espace dévolu spécifiquement au stockage.
37 structures ont livré des semences, malheureusement en quantités très faibles. L’effectif total du site s’élève à 205 restes, dont 196 de plantes domestiques, pour environ 380 litres de sédiment brut prélevés. Les céréales indéterminées représentent 122 restes, 62 % du total, reflétant la piètre conservation du matériel. Les espèces significativement attestées sont le millet commun, des blés vêtus de type amidonnier et épeautre ainsi que l’orge vêtue. En dépit du faible nombre de restes, une large diversité d’espèces est observée puisqu’aux précédentes s’ajoutent des blés nus, du pois, de l’ers, de la féverole et peut-être de l’avoine. Les sous-produits des récoltes se limitent à trois bases de glumes et quelques semences de mau-vaises herbes, de sorte que la fonction du site n’a pu être confirmée par l’étude carpologique.
Signalons également que deux autres sites moins bien caractérisés, ˝La Basse Queue˝ et ˝La Noue˝, datés également de La Tène ancienne, sont localisés à une distance d’environ 500 m de l’opération. Il n’existe pas de données carpologiques associées à ces deux établissements.
2. Présentation du site
Sur les 17,6 ha diagnostiqués, un seul secteur très limité dans l’espace a fourni des vestiges archéologiques en place, et a donc justifié l’ouverture de trois fenêtres, l’une d’environ 300 m2, l’autre de 500 m2 et la dernière de 400 m2. La première a permis la mise au jour de trois bâtiments (fig. 2). Le premier, dénommé bâtiment 1, est un petit édicule construit à partir de quatre poteaux. D’un diamètre moyen de 0,40 m, ces derniers sont très faiblement inscrits dans le substrat géologique et n’atteignent qu’une profondeur moyenne de 0,20 m. Même si l’érosion a en partie jouée, ce niveau a, semble-t-il, été jugé suffisant par les constructeurs, compte tenu de la faible superficie du bâtiment (2,6 m2) et de la taille importante des éléments porteurs. Le remplissage des trous de poteau se compose de limons bruns homogènes.
Le deuxième bâtiment est localisé au nord du précédent ; il est élaboré à partir de sept poteaux qui forment une surface rectangulaire de 12,6 m2. Les poteaux présentent un diamètre moins important que ceux de
329
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
Fig. 2 - Vue de détail des fenêtres d’ouverture avec les structures de stockage. DAO F. Malrain, © Inrap.
330
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
l’édifice précédent, étant le plus souvent légèrement supérieurs à 0,30 m. Les profondeurs d’enfoncement sont similaires, de l’ordre de 0,20 m en moyenne, et le remplissage est en tous points similaire à celui des structures précédentes (bâtiment 2).
Le troisième bâtiment se situe immédiatement à côté du précédent. Quatre poteaux forment un plan rectangulaire et un cinquième est disposé en abside. Cette forme architecturale a déjà été rencontrée sur des occupations laténiennes dans ce secteur géographique (Malrain, Pinard 2005). Ce cinquième poteau est ici clairement associé au bâtiment, dans la mesure où ce sont les seuls vestiges repérés dans le secteur. La construction offre une surface au sol d’un peu plus de 10 m2. Le diamètre moyen des trous de poteaux est de 0,40 m. Les profondeurs sont, en revanche, plus conséquentes puisqu’elles atteignent et/ou dépassent les 0,30 m, soit une bonne dizaine de centimètres de plus que pour les deux autres bâtiments. La profon-deur du poteau disposé en abside n’est que d’une dizaine de centimètres. Le sédiment de colmatage, du limon brun, reste identique.
Fig. 3 - Plan, coupes et mobilier associé au bâtiment 4. Documents F. Malrain, © Inrap.
331
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
Au nord-ouest, la deuxième fenêtre a livré un bâtiment à neuf poteaux (bâtiment 4, fig. 2, fenêtre 2). L’ossature de cette construction est assez conséquente. Les diamètres des poteaux avoisinent les 0,45 m et les profondeurs sont sans commune mesure avec celles des édifices de la fenêtre 1, puisque qu’elles sont de 0,60 m. On note que la construction a subi un incendie. La taille des poteaux utilisés, d’environ 0,35 m de diamètre, se marque dans le remplissage des trous de creusement par d’abondants charbons de bois, du torchis et des macrorestes végétaux (fig. 3).
Deux des poteaux ont livré des tessons, dont deux bords. Une des pièces est trop petite pour en déterminer le diamètre et son orientation reste incertaine, de même que sa morphologie. Le second bord permet de restituer une céramique de 27 cm de diamètre, dont le profil s’apparente à une jatte. Établir une chrono-logie à partir de ces deux seuls éléments reste aléatoire mais la céramique laténienne, assez bien connue dans ce secteur géographique, permet d’orienter la datation vers La Tène ancienne, et plus précisément vers la fin de cette période, ce que confirme une datation radiocarbone obtenue sur des glands carbonisés associés au bâtiment. Les mesures, effectuées au centre de datation par le radiocarbone de Lyon, donnent un âge calibré de 400 à 264 av. J.-C., avec un maximum de probabilités entre 400 et 360 av. J.C.
La troisième fenêtre (fig. 2, fenêtre 3) a permis la découverte d’un autre bâtiment construit sur quatre poteaux (bâtiment 5), d’un module très petit, puisque sa surface est inférieure à 7 m2. Les poteaux qui le forment sont d’un diamètre qui avoisine les 0,40 m pour une profondeur d’à peine 0,10 m.
3. Résultats carpologiques
Sur site les sédiments ont été testés afin de détecter la présence éventuelle de restes carpologiques et/ou anthracologiques. Seul le sédiment des poteaux du bâtiment 4, fenêtre 2, contenait de tels vestiges. Huit des neuf trous de poteaux ont donc été prélevés, pour un volume total de 72 litres de sédiment brut. Les échantillons ont été tamisés à l’eau sur maille de 0,5 mm. Le tri intégral des refus de tamis a été effectué sous loupe binoculaire et tous les restes végétaux isolés ont été déterminés et décomptés (voir résultats détaillés en annexe). 969 restes carpologiques ont été recueillis, tous carbonisés.
Les carporestes sont moyennement bien conservés ; les céréales de types blés et orge aussi bien que les millets présentent régulièrement le même aspect vacuolaire. Les glands, à chair plus dense, sont générale-ment mieux préservés, bien que très fragmentés. Néanmoins, la détermination des restes a pu être dans la majorité des cas précisée jusqu’à l’espèce et l’on ne décompte que 51 caryopses de céréales indéterminées (en NMI), soit 5 % du nombre total de restes (NTR).
3.1. Espèces en présence et effectifs conservés
Issu d’un bâtiment unique les ensembles de semences, recueillis par trous de poteaux, présentent de fortes disparités, à la fois en termes d’effectifs préservés et de diversité taxinomique.
À l’exception de quatre semences de plantes sauvages, les restes recueillis correspondent à des plantes alimentaires issues de cultures, ou de cueillettes pour les glands et noisettes. Si l’on fait abstraction des céréales indéterminées, peu nombreuses dans les assemblages, deux groupes d’espèces sortent du lot : les millets et les glands, qui représentent respectivement 28 et 62 % des carporestes, soit 270 semences, tous types de millets confondus, et 610 cotylédons et fragments de glands. Plusieurs espèces domestiques ne dépassent pas la vingtaine de restes, notamment des céréales qui pouvaient faire partie de récoltes entreposées dans le grenier, ou de reliquats de stocks. On range dans ce cas de figure des blés à grains nus, froment/blé dur/blé poulard et des blés vêtus de type amidonnier, ainsi que de l’orge vêtue du type à six rangs. Les fruitiers comprennent la vigne, sauvage ou cultivée, sous la forme de deux fragments de pépins de raisin carbonisés, et le noisetier dont quelques fragments de péricarpe (˝coque˝) de noisettes ont
332
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
été recueillis. Deux espèces potentiellement cultivées apparaissent en faible quantités et font davantage figure d’intrusions ou d’adventices d’autres cultures ; il s’agit d’une graine de caméline, un oléagineux de la famille des Brassicacées, et d’une légumineuse de type vesce ou gesse, impossible à déterminer en présence d’un seul cotylédon abîmé.
La présence conjointe de deux types de millet est intéressante car ils ne requièrent pas les mêmes condi-tions de culture et traitements post-culturaux. Leurs modes de consommation diffèrent également. Les deux espèces ont pu être séparées sur la base des critères suivants : la dimension des grains, le rapport éta-bli entre la hauteur du scutellum (support de l’embryon) et la hauteur totale du caryopse en vue dorsale, l’aspect réticulé ou lisse des glumelles. Ces critères sont illustrés ci-dessus.
Fig. 4 - Morphologie des grains de millets. En haut à gauche : millet commun (Panicum miliaceum) ; en haut à droite : détail des glumelles réticulées du millet des oiseaux (Setaria italica) ; en bas : semences de Setaria italica. Dimensions des caryopses : Longueur Panicum : 1,6 mm ; Longueur
scutellum : 0,6 mm ; largeur : 1,5 mm. Longueur Setaria : 1,5 mm ; longueur scutellum : 1,1 mm ; largeur : 1,3 mm. Clichés V. Zech-Matterne.
333
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
Le genre Panicum ou millet commun possède des grains plus grands et plus trapus que ceux de Setaria, le millet des oiseaux. Chez Panicum, le scutellum n’atteint pas la moitié de la hauteur du grain et ses contours dessinent un triangle qui pointe vers l’apex (fig. 4, en haut, à gauche). Les grains de Setaria sont plus élancés et moins épais. Le scutellum est plus long et plus étroit ; il dépasse la moitié de la hauteur du grain et ses bords tendent à être parallèles (fig. 4, en bas, à droite). Lorsqu’elles subsistent, les glumelles recouvrant les caryopses de Setaria confèrent à l’épiderme un motif réticulé. Les glumelles de Panicum sont lisses et ne dessinent aucun motif de surface, une fois soudées au grain sous l’effet de la carbonisation.
3.2. Répartition des taxons à l’emplacement du grenier et densités en restes
Du fait de la destruction par le feu de la structure aérienne du bâtiment, les ensembles de semences ont été fortement bouleversés. Il est toutefois peu vraisemblable que les restes carpologiques retrouvés à l’emplacement des poteaux arrachés ou disparus proviennent de rejets successifs n’ayant rien à voir avec la destruction du grenier. Il s’agit plus vraisemblablement des provisions entreposées dans le bâtiment, qui ont été éparpillées à son pourtour lors de l’effondrement de la plate-forme qui les supportait. Les carpo-restes auraient ensuite été piégés à l’emplacement des poteaux, une fois ceux-ci arrachés pour faire place nette. Cette hypothèse est corroborée par la relative cohérence observée dans la répartition des espèces (fig. 5). Ainsi, les millets ont essentiellement été découverts dans la partie méridionale du plan, tandis que les glands sont plus abondants dans la partie orientale et les céréales du côté occidental. Les densités en restes sont également largement supérieures à ce que l’on rencontre habituellement dans les trous de poteaux, structures souvent stériles en carporestes. Elles peuvent atteindre 50 spécimens par litre brut (pot. 3), ce qui est également largement au dessus de la moyenne des dépotoirs, qui délivrent de un à cinq restes par litre brut. Les carporestes se raréfient fortement dans l’angle nord-ouest du grenier, dessinant un espace apparemment vide.
Cette répartition suggère un stockage séparant les denrées, sans que l’usage de contenants intermédiaires ait pu être mis en évidence. Des modalités similaires ont été constatées pour d’autres greniers laténiens (Zech-Matterne et al. 1996).
Les millets représentent les céréales dominantes et se concentrent surtout au niveau du poteau 1. Les deux types de millets semblent intimement mêlés, alors que leurs chaînes opératoires sont en théorie bien distinctes. Les caryopses de Panicum et de Setaria ne réagissent pas de manière identique au battage et les processus de décorticage des grains sont spécifiques à chaque espèce. Le dépiquage des panicules de Panicum s’effectue généralement par piétinement tandis que les caryopses de Setaria sont décortiqués au pilon dans un mortier. Les modes de consommation impliquent également une préparation séparée, car une espèce a tendance à s’aplatir sous le pilon et l’autre à se concasser (Lundström-Baudais et al. 2002 ; Lundström-Baudais 2010). Il est possible que le mélange résulte de l’incendie. Deux autres exemples de concentrations en mélange sont connus, sans qu’il ait été possible de démontrer l’existence préalable d’une culture ou d’un stockage mixte. Le premier provient du village de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), fouillé sous la direction de F. Lafage (Inrap). ; 1305 caryopses de Panicum et 785 de Setaria ont été découverts dans la fosse 4704 attribuée à l’unité domestique 185, datée du Hallstatt ancien (Lafage à paraître ; Lafage et alii 2007, 2006). Le second mélange associant les deux espèces a été étudié par M. Hopf (1985). Il est daté de l’âge du Bronze final et provient du site d’Ourroux-Marnay (Saône-et-Loire).
Les deux espèces de millets connaissent une montée en puissance au cours de l’âge du Bronze final en France. Le millet commun est particulièrement bien représenté dans le quart nord-est du pays et semble même constituer une spécificité du Bassin parisien. L’importance de l’espèce s’accroît encore au premier âge du Fer et sa répartition s’étend alors au Midi. On enregistre ensuite une décroissance du taxon au cours de la période laténienne. Le millet des oiseaux, espèce peut-être plus thermophile, suit globalement le même schéma, mais son importance est beaucoup moins spectaculaire (Bouby et al. présentation orale1).
334
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
3.3. Préparation des glands pour la consommation
Les glands découverts sur le site de La Croix-Saint-Ouen se présentent sous la forme de cotylédons isolés ou de fragments de cotylédons, tous carbonisés. L’absence des épidermes et des cupules montre que les glands ont été décortiqués, vraisemblablement pour en faciliter la préparation alimentaire. Dès lors, l’identification à l’espèce n’est plus possible, la distinction entre chêne rouvre (Quercus robur) et chêne pédonculé (Quercus petraea) s’effectuant sur les cupules. Avant consommation, les glands doivent être bouillis à plusieurs reprises pour en atténuer l’astringence, car ils contiennent jusqu’à 8 % de tanins. La purée obtenue, mélangée à de la farine de céréale, est cuite en galettes. La torréfaction, ou cuisson à sec, est un procédé qui permet lui aussi d’éliminer en partie les tanins. Les fruits sont pelés et grillés avant d’être réduits en farine au broyon ou à la meule. Il est possible de confectionner du pain en mélangeant farine
Fig. 5 - Répartition des taxons à l’intérieur du bâtiment 4 de la fenêtre 2, interprété comme un grenier sur neuf poteaux. Les données ayant servi à établir les graphes sectoriels sont détaillées
dans l’annexe 2. Les dimensions des “camemberts“ sont proportionnelles aux NMI. On observe la sur-représentation des millets et des glands et la relative cohérence de leur distribution.
DAO F. Malrain, © Inrap.
335
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
de glands et de céréales, celle-ci plus riche en gluten apportant à la pâte élasticité et cohésion (Couplan, Styner 1994).
Les glands contiennent de l’amidon et représentent un substitut valable des céréales. Ils ont été consom-més régulièrement par l’homme du Néolithique jusqu’au début du second âge du Fer, époque à partir de laquelle leurs mentions décroissent très sensiblement. Dans le nord de la France, plusieurs sites des âges des métaux ont livré des glands, associés à des fosses de stockage, des greniers, des aires foyères. En voici quelques exemples :
− pour l’âge du Bronze final : à Changis-sur-Marne, des glands carbonisés ont été retrouvés dans un foyer et dans les trous de poteaux d’un grenier surélevé appartenant à l’unité domestique 151-119 datée du Bronze final IIIb2 (Lafage et alii 2006) ; à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne ; site fouillé par R. Peake, Inrap), des glands garnissaient un petit foyer en cuvette (Matterne 2001) ; à Molvange-Escherange (Moselle ; dirigé par T. Klag) des glands ont été préservés dans les trous de poteaux de deux bâtiments distincts. Des découvertes de glands sont signalées pour la même époque en Lorraine à Frouard, Gondreville et Yutz (de Hingh 2000).
− pour La Tène ancienne : Sur le site de Bussy-Saint-George (Seine-et-Marne), une centaine de cotylédons décortiqués et un broyon ont été extraits d’une petite fosse de stockage (Buchez et al. 2002). De Ceunynck (1991) a publié la découverte d’un stock de glands dans un silo de l’âge du Fer à Evergem-Ralingen en Belgique. Le fond de la structure était tapissé de cotylédons de glands, associés à six céréales et légumineuses cultivées (blé amidonnier, blé épeautre, orge vêtue, millet commun, avoine et féverole). Des glands ont même été trouvés en contexte funéraire gallo-romain dans une incinération du cimetière de Vierzon, dans le Cher (Matterne, à paraître).
Ces quelques trouvailles attestent la consommation régulière des glands par les populations humaines, associée à des espèces cultivées, et peut-être en mélange avec celles-ci, afin d’accroître la quantité de nour-riture disponible. La préparation complexe des glands et leur mode de récolte, qui relève de la cueillette, ont probablement découragé la poursuite régulière de cette pratique, qui tend à disparaître après La Tène ancienne.
3.4. Les denrées végétales du grenier de La Croix-Saint-Ouen dans leur contexte local
Quelques éléments de comparaison nous sont fournis par les données carpologiques issues des sites de Compiègne ˝Le Font Pernant˝, fouillé par B. Lambot et étudié par C. Bakels, et de La Croix-Saint-Ouen ˝Les Longues Rayes˝, dont j’ai réalisé l’étude carpologique (Zech-Matterne, inédit).
Le grenier du ˝Font Pernant˝ a, plus encore que celui de La Croix, révélé des concentrations de graines tassées dans le comblement des trous de poteaux. Les concentrations étaient, dans ce cas précis, à ce point élevées qu’il subsiste peu de doutes sur le fait qu’il faille les assimiler à des résidus de stocks. Cet ensemble nous offre un instantané des productions agricoles, ici dominées par l’orge polystique vêtue, accompagnée du blé épeautre. Nous avons par ailleurs déjà fait référence aux données carpologiques provenant de la batterie de greniers constituant l’essentiel de l’occupation des ˝Longues Rayes˝. Si les effectifs recueillis sont trop faibles pour établir l’importance relative des plantes de culture, ils témoignent néanmoins d’un grand nombre d’espèces exploitées. Cette image concorde bien avec celle d’une agriculture régio-nale s’apparentant à une polyculture, telle que nous pouvons la reconstruire à partir de 21 sites datés du Hallstatt final transition La Tène A, ou de La Tène ancienne, qui ont fait l’objet d’une étude carpologique dans le nord de la France (fig. 6).
Les proportions relatives des principales plantes cultivées ont été établies à l’échelle du site en regroupant les résultats de toutes les structures étudiées. Chaque graphe sectoriel correspond donc à une occupation. On constate l’existence dans les vallées de l’Aisne, de l’Oise et de la Seine de sites associant fréquemment
336
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
de 4 à 7 espèces cultivées, voire davantage, et une importance marquée des millets (en rose). Au nord et à l’ouest de cette zone caractérisée par la diversité, dominent des sites marqués par une forte prédominance de l’orge (en vert) ou de l’amidonnier (en jaune). Dans la mesure où les graphes expriment les résultats combinés de dizaines de contextes, il ne peut s’agir d’occurrences événementielles ; ces situations traduisent des choix de culture qui s’expriment toujours dans le même sens. Cette prédominance d’orge et de blés vêtus est probablement le fait d’agricultures extensives qui font alterner cultures céréalières et jachères travaillées. La diversité observée sur le site de La Croix-Saint-Ouen, et dans les sites alentour, renverraient plutôt à des agricultures privilégiant une mosaïque d’espèces, reflétant des modes de cultures plus intensifs. À partir du IVe siècle av. J.-C., ces polycultures disparaissent et les sites où prédomine l’orge se généralisent.
3.5. Un aperçu des agricultures de La Tène ancienne à l’échelle régionale
Afin d’analyser l’ensemble des données, une analyse factorielle des correspondances-AFC a été réalisée sur les 21 établissements disponibles et 15 variables correspondant à des espèces ou regroupements d’espèces (fig. 7). Deux sites ont été laissés à part car ils ˝tiraient˝ les résultats du fait de la prédominance quasi exclusive d’une espèce dans leurs assemblages. Il s’agit d’un ensemble de Mosles (Calvados), dominé par le pois, et des assemblages de Bure (Meuse), ˝écrasés˝ par l’ers.
L’axe 1 semble départager les sites où prédomine l’orge vêtue des sites où l’amidonnier tient la première place, ces deux espèces représentant les deux céréales principalement cultivées durant la Protohistoire dans le nord de la France.
Fig. 6 - Détail et importance relative des principales plantes cultivées durant La Tène ancienne dans le nord de la France. Chaque graphe sectoriel représente un site et les pourcentages de chaque
taxon au sein du site équivalent à la moyenne de leurs NMI pour l’ensemble des contextes étudiés. On remarque un regroupement des sites présentant une large diversité dans les vallées de l’Aisne, de l’Oise et de la Seine et à leur périphérie, des établissements plus spécifiquement dominés par
l’orge (en vert), l’amidonnier (en jaune) ou des légumineuses (ers ou pois). Fond de carte Géoatlas. Données et DAO V. Zech-Matterne.
337
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
L’axe 2 distingue les sites riches en millets des autres composantes et notamment des glands, raison pour laquelle le site de La Croix-Saint-Ouen se retrouve isolé. Nous avons cependant vu grâce à la projection sur carte des résultats carpologiques relatifs à La Tène ancienne que les résultats du site sont cohérents avec ceux d’autres établissements, au niveau local, et qu’ils s’inscrivent au sein d’une tendance bien visible, notamment du fait de l’importance des millets. Dans le cas présent, c’est donc bien la présence du lot de glands qui singularise la découverte de La Croix. Sans nier cette originalité, il faut relativiser sa portée car une seule structure a pu être étudiée pour le site et les découvertes de glands demeurent malgré tout assez ponctuelles à l’échelle du nord de la Gaule. Cette espèce de cueillette représente une denrée alimentaire complémentaire et ne fait pas partie des plantes produites afin d’assurer la subsistance des occupants de la vallée.
4. Conclusion
L’intervention conduite à La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ a été limitée du fait des destructions occasionnées par une ancienne carrière. Seule une petite surface a permis la découverte de
Fig. 7 - Analyse factorielle des correspondances-AFC, réalisée sur 21 sites et 15 variables (taxons). L’axe 1 départage les sites dominés par l’orge des sites dominés par l’amidonnier et l’axe 2 fait intervenir l’importance des millets dans la projection du “nuage“ de points. Le site de Lacroix se
trouve isolé du fait de l’importance des glands dans ses assemblages. Document V. Zech-Matterne.
338
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
structures et il n’a pas été jugé bon d’engager une fouille suite à cette opération de diagnostic. Toutefois, le développement du site semble limité, car à l’est, la parcelle a été anciennement détruite et à l’ouest se développent les niveaux de berges. La multiplication des tranchées dans le secteur des greniers a, semble-t-il, bien permis de délimiter la faible emprise qu’occupent ces structures. L’ouverture de fenêtres occasionna la découverte de cinq bâtiments dont le mode architectural et la superficie évoquent un usage comme grenier. Néanmoins, un seul a livré des restes carpologiques qui attestent bien une fonction de stockage. L’étude de réserves alimentaires constitue une opportunité rare en archéobotanique. Les paléosemences associées à ce grenier offrent un aperçu direct des ressources utilisées par les populations locales pour se nourrir. La découverte de ces espèces végétales complète les données déjà collectées dans ce secteur de vallée pour les greniers du ˝Fond Pernant˝ à Compiègne et des ˝Longues Raies˝ à La Croix-Saint-Ouen. Elle témoigne de la consommation de blé amidonnier et épeautre, blés nus, orge, millets et légumineuses diverses durant La Tène ancienne. L’extension des observations à l’ensemble des données carpologiques disponibles montre des pratiques agricoles privilégiant une polyculture intensive, à l’échelle des vallées de l’Aisne, de l’Oise et de la Seine. Le stockage et la consommation de glands constituent des pratiques qui tendent à se raréfier à partir du Ve siècle, en dehors de circonstances de disette ou de restriction alimentaire ; le site de La Croix nous en livre un des derniers témoignages pour la France septentrionale. La mention de la vigne, même si la distinction entre espèces cultivée et/ou sauvage n’a pu être faite, constitue une autre particularité du site.
Sur cette rive de l’Oise, durant La Tène ancienne, le stockage devait prendre une place importante car trois sites (˝Le Fond Pernant˝, ˝Les Longues Raies˝ et ˝Le Prieuré˝) ont livré des concentrations de struc-tures de stockage et des indices sur les produits stockés. Cette micro-aire géographique semble donc être fortement mise à contribution comme espace de stockage. La présence de petites buttes exondées crée, peut-être, des conditions favorables à cette fonction, d’autant que les denrées stockées pouvaient facile-ment être acheminées et/ou convoyées vers d’autres sites grâce à la présence du réseau hydrographique à proximité immédiate.
Bien qu’il ne s’agisse que d’un diagnostic, les résultats obtenus documentent, même s’ils peuvent paraître anecdotiques et partiels, les agricultures en vigueur à la période laténienne et démontrent une fois de plus une hétérogénéité des pratiques agricoles qui ne connaissent pas toutes les mêmes processus d’évolution, ni les mêmes rythmes, selon les espaces géographiques considérés.
Note
1. Bouby L., Zech-Matterne V., Bouchette A., Cabanis M., Derreumaux M., Dietsch-Sellami M.-F., Durand F., Figueiral I., Marinval Ph., Pradat B., Rousselet O., Rovira N., Schaal C., Toulemonde F. et Wiethold J. : ˝Ressources et économie agricole en France à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer. État des données carpologiques dans le cadre de la restitution de l’enquête nationale˝ : L’habitat et l’occupation du sol à l’âge du Bronze et au début du premier âge du Fer, PAS Inrap, sous la dir. de Carozza L., Marcigny C. et Talon M., Bayeux, 29 et 30 novembre 2011.
•
339
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
Annexe 1 - Résultats carpologiques détaillés du site de Lacroix-Saint-Ouen (Oise). Document V. Zech-Matterne.
Annexe 2 - Détail des restes de plantes alimentaires décomptés dans le grenier 4, fenêtre 2, en NMI et pourcentages relatifs des principaux taxons. Le NMI a été établi en additionnant le nombre
de fragments divisé par deux au nombre de restes entiers. Document V. Zech-Matterne.
•
340
François Malrain, Véronique Zech-Matterne
Bibliographie
Bakels 1984 : BAKELS (C.) — Carbonized seeds from Northern France, Analecta Prehistorica Leidensia, 17, 1984, pp. 1-27.
Billand 1992 : BILLAND (G.) — La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ (Oise). Bilan des fouilles de 1992, In : Programme de Surveillance et d’étude des sablières de la moyenne vallée de l’Oise, Rapport d’activité, 1992, pp. 109-120.
Blanchet 1984 : BLANCHET ( J.-C.) — Les premiers métallurgistes en Picardie et dans le Nord de la France. Mémoires de la Société Préhistorique Française, tome 17, 1984.
Buchez et alii 2002 : BUCHEZ (N.), GRANSAR (F.), MATTERNE (V.), PERNAUD (J.-M.), YVINEC (J.-H.) — L’habitat de La Tène ancienne sur la ZAC, Centre-ville de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), 2ème partie, Revue Archéologique du Centre de la France, 41, 2002, pp. 35-55.
De Ceunynck 1991 : de CEUNYNCK (R.) — A find of charred acorns in Evergem-Rallingen near Ghent (Belgian Iron Age), In : RENFREW (C.) dir. — New light on early farming, Edinburgh University Press, 1991, pp. 289-294.
De Hingh 2000 : de HINGH (A.) — Food production and food procurement in the Bronze age and Early Iron age (2000-500 BC). The organisation of a diversified ad intensified agra-rian system in the Meuse-Demer-Scheldt region (The Netherlands and Belgium) and the region of the river Moselle (Luxemburg and France), Archaeological Studies Leiden University 7, Leiden, Faculty of Archaeolog y, Leiden University, 2000, 235 p.
Hémery 1931 : HEMERY (M.) — Un cam-pement gaulois à La Croix-Saint-Ouen (Oise), Bulletin de la Société Historique de Compiègne, 1931.
Hopf 1985 : HOPF (M.) — Bronzezeitlichen Sämereien aus Ouroux-Marnay. Dép. Sâone-et-Loire, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 32, 1985, pp. 255-264.
Lambot 1988 : LAMBOT (B.) — L’habitat pro-tohistorique du ˝Fond Pernant˝ à Compiègne.
In : Architecture des âges des métaux, Fouilles récentes, Paris, Errance, 1988, pp. 23-37 (Dossier de Protohistoire ; 2).
Lafage et alii 2006 : LAFAGE (F.), AUXIETTE (G.) , B RU N ET (P.) , M A RT I A L (E .) , MATTERNE (V.), avec la collaboration de PRAUD (Y.), LAPLANTINE (N.) — Premières tentatives d’interprétation spatiale d’un site rural du Bronze final à Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), Bulletin de la Société Préhistorique Française, 103 (2), 2006, pp. 1-55.
Lafage et alii 2007 : LAFAGE (F.), AUXIETTE (G.), BRUNET (P.), DELATTRE (V.), LE JEUNE (Y.), MARTIAL (E.), MATTERNE (V.), avec la collaboration de PRAUD (I .) — Changis-sur-Marne ˝Les Pétreaux˝ : trois siècles d’évolution d’établissements ruraux de la fin du Bronze final au début du premier âge du Fer, Bulletin de la Société Préhistorique Française, 104-2, 2007, pp. 307-341.
Lundström-Baudais et alii 2002 : LUNDSTRÖM-BAUDAIS (K.), RACHOUD-SCHNEIDER (A.-M.), BAUDAIS (D.), POISSONNIER (B.) — Le broyage dans la chaîne de transformation du millet (Panicum miliaceum) : outils, gestes et écofacts. In : PROCOPIOU (H.), TREUIL (R.) dir. — Moudre et broyer. L’interprétation fonc-tionnelle de l’outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l’Antiquité, vol. 1 - Méthodes. Pétrographie, chimie, tracéologie, expérimentation, ethnoarchéologie, Paris, éditions du CTHS, 2002, pp. 181-211.
Lundström-Baudais 2010 : LUNDSTRÖM-BAUDAIS (K.) — Ciurā et muri : le traitement en forme de flocons et de gruaux de quatre céréales dans le nord-ouest du Népal, In : FRANCONIE (H.), CHASTANET (M.), SIGAUT (F.) dir. — Couscous, boulgour et polenta. Transformer et consommer les céréales dans le monde, Paris, éditions Karthala, 2010, pp. 261-316.
Malrain, Pinard 2005 : MALRAIN (F.), PINARD (E.) dir. — Les sites laténiens de la moyenne vallée de l’Oise : contribution à l’Histoire de la société gauloise, Compiègne, 2005, 272 p., 2 CD (Revue Archéologique de Picardie, numéro spécial 23).
341
La Croix-Saint-Ouen ˝Le Prieuré˝ et ˝Les Jardins˝ (Oise)
Matterne-Zech 1996 : MATTERNE-ZECH (V.) — A study of the carbonized seeds from a la Tene D1 rural settlement, ˝Le Camp du Roi˝excavation at Jaux (Oise), France, Vegetation History and Achaeobotany, 5, 1996, pp. 99-104.
Matterne 2001 : M AT T ER N E ( V.) — Agriculture et alimentation végétale durant l’âge du Fer et l’époque gallo-romaine en France septen-trionale, Montagnac, éditions Monique Mergoil, 2001, 310 p. (Archéologie des Plantes et des Animaux ; 1).
•