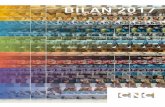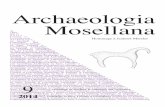LES INCITATIONS A L’INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL EN TUNISIE : UNE ÉVALUATION
Bilan scientifique régional de Guyane 2006
Transcript of Bilan scientifique régional de Guyane 2006
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
SERVICE RÉGIONAL DE L'ARCHÉOLOGIE
Toukouchipan © Daniel Saint-Jean
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
SOUS-DIRECTION DE l'ARCHÉOLOGIE
2012
1
Direction régionale des affaires culturelles
Service régional de l’archéologie
95 avenue De Gaulle
97300 Cayenne
Téléphone: 05 94 30 83 35
Télécopie: 05 94 30 83 41
Ce bilan scientifique a été conçu pour diffuser les résultats des travaux archéologiques de terrain quiont eu lieu en 2006.
Il s’adresse aux élus, aux aménageurs, aux collègues, aux étudiants et à toute personne intéresséepar l’archéologie de sa région. Il est aussi utile pour les instances du service central del’archéologie, qui dans le cadre de la déconcentration doivent être informées des opérationsréalisées en régions, ainsi qu’aux membres des instances chargées du contrôle scientifique desopérations.
Couverture:
Mise en page: Françoise Armanville, Caroline Carlon-Tabariès
Relecture: Françoise Armanville, Caroline Carlon-Tabariès, Gérald Migeon
Carte: Jérôme Maillet
ISBN 1249-3422 © 2012
Ministère de la Culture et de la Communication
Les textes publiés ont été écrits par les responsables des opérations et les avis exprimés, ainsi queles interprétations n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Les photos sont des auteurs, sauf mention contraire.
2
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Table des matières
Avant-propos 4 - 6
Bilan et orientations de la recherche archéologique 6 – 10
Tableau de présentation générale des opérations autorisées 12 - 13
Carte des opérations autorisées 14 - 15
Travaux et recherches archéologiques de terrain
•Cayenne: Montabo Sud (Gérald Migeon) 16 - 23
•Iracoubo : Parcelle AM43 (Martijn van den Bel) 24
•Macouria : ZAC de Soula (Mickaël Mestre) 25
•Mana : Abri Arca, inselberg de la Trinité (Gérald Migeon) 25 - 28
•Maripasoula : Borne 1 (Gérald Migeon) 29 - 33
•Rémire-Montjoly : Lotissement Prévôt (Pierre Texier) 33
•Rémire-Montjoly : Forge de Loyola (Pierre Fluck) 34 - 36
•Rémire-Montjoly : Quincy (Réginald Auger) 36 - 40
•Saint-Georges de l’Oyapock : Liaison entre le bourg et le futur pont (Mickaël Mestre) 41 - 42
•Saint-Laurent du Maroni : Plateau des Mines (Mickaël Mestre) 42 - 43
•Saint-Laurent du Maroni : Saut Saillat (Matthieu Hildebrand) 43 - 44
•Saint-Laurent du Maroni et Apatou : Crique Sparouine (Martijn Van den Bel) 44 - 45
•Saül : Prospection-Inventaire - Quartz ouverts au feu, 2006-2007 (Pierre Rostan) 45 - 49
Liste des auteurs 50
Abréviations utilisées dans le texte et la bibliographie 51
Abréviations utilisées dans les tableaux 52 – 53
Personnel du Service régional de l'Archéologie 54
3
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Bilan et orientation de et du Service Régional de l'Archélogie et de larecherche archéologique régionale.
Avant -propos
Si il n’est pas inutile de rappeler rapidement quelques éléments du contexte guyanais de larecherche archéologique, un bilan des faiblesses et des forces et une courte réflexion sur lesproblèmes de datation s’avèrent néanmoins indispensables.
Faiblesses
Institutionnelles et historiques- L’archéologie «moderne» n’a commencé réellement que depuis une trentaine d’années; lesarchéologues ont toujours été peu nombreux en rapport à l’énorme surface -(84000km2) duterritoire guyanais.- Le service de l’archéologie a été entre 1986 et 1992 géré depuis la Martinique, puis a été doté detrop peu d’agents (trois au maximum, deux seulement parfois).- L’archéologie préventive a été active de manière très intermittente jusqu’en 2004, même si debelles opérations ont pu être réalisées avant cette date.- Aucun enseignement n’existe dans les universités françaises sur la Guyane. Seul le CRA assure,depuis 2005, à des non-spécialistes, un cours en licence pluridisciplinaire de 24 heures sur les«Civilisations Amérindiennes du Plateau des Guyanes» à l’UAG-IESG de Cayenne.– Un seul chercheur, Stéphen Rostain, CR1, entré au CNRS en 2001, est impliqué en Guyane
mais travaille aussi en Équateur.
Sociétales et culturelles- La mauvaise réputation de la Guyane (enfer vert, bagnes, orpailleurs dangereux…) relayée par desreportages télévisuels sensationnalistes ne nous aide pas en général et n’attire pas les étudiants.- Le relatif désintérêt des élus et des populations locales (pas ou peu d’étudiants guyanais enarchéologie précolombienne, trois associations actives avec seulement deux ou trois membreschacune).- Les destructions sont nombreuses (orpaillage à l’intérieur, abattis, déforestations, métauxrécupérés…), et en très nette accélération ces dernières années.
Liées au contexte géographique au sens large- L’isolement des archéologues professionnels de Guyane des autres archéologues des pays voisinset des autres continents est patent, mais les échanges par internet, les congrès de l’AIAC et d’autresrencontres institutionnelles ou informelles permettent un peu de pallier ces carences. - Le contexte de travail de terrain est difficile (pluies et humidité constante, sites peu accessibles parles routes ou les pistes, coût élevé de tous les produits et services en Guyane…).- L’exécrable conservation des vestiges (humidité quasi-constante, acidité des sols, vestigessuperficiels, sites amérindiens volatiles – semi-nomadisme…),
4
Forces
- La présence d’équipes de recherche (CNRS, IRD, CIRAD, ENGREF, sur la biodiversité, dans lessciences de la nature, les sciences des matériaux (bois, fer, molécules de la forêt), la télédétection…très favorable en Guyane, permet de partager des outils de travail (SIG, Scan 25) et d’échanger desdonnées sur le terrain et en laboratoire.- La présence de chercheurs, jeunes ou expérimentés, très motivés (SRA, INRAP), d’une équiped’archéologues professionnels (certains bénévoles) en archéologie coloniale.- Malgré quelques opérations d’envergure, un territoire très peu connu et au potentiel riche.- Un outil: le dépôt central non saturé du SRA qui rassemble l’essentiel des collectionsarchéologiques mises au jour lors des fouilles des vingt dernières années.- Des prospections pédestres et des sondages mécaniques possibles presque partout, à des coûtsrelativement abordables.–Des fonds européens mobilisables, mais avec une très grosse perte d’énergie et de temps.
Problèmes de datation
Les causes sont diverses:- Les contaminations par les paléo incendies, et autres phénomènes naturels sont nombreuses, demême que la dissémination et la contamination des charbons par les pluies tropicales, lesglissements de terrain, les organismes fouisseurs… - La conservation des ossements due à l’acidité des sols et à la dissolution des carbonates estdifficile.-Lles contextes archéologiques des prélèvements n’ont pas toujours été bien contrôlés. En effet, denombreuses datations ont été réalisées sans prendre en compte, par manque d’expériences endomaine intertropical, les relations ou associations complexes, dans la terra preta ou dans d’autressédiments, entre échantillons de charbons et vestiges, céramiques ou osseux en particulier. Les problèmes de définition (temporelle, technique, stylistique…) des cultures archéologiquesprécolombiennes guyanaises demeurent, malgré les 200 datations par C14, en majorité par laméthode traditionnelle, qui ont été effectuées en Guyane. Depuis ces dernières années, les datationspar AMS ont apporté une précision supplémentaire, mais des problèmes subsistent.En conclusion, peu de relations claires ont été établies entre les types et les dates 14C quand celaétait possible. En général, les typologies sont fondées sur des éléments décoratifs, qui nereprésentent qu’une faible partie du matériel. Beaucoup de matériel a été retrouvé hors contexte etest donc difficilement datable, sauf par thermoluminescence (céramique à dégraissant de quartz oude feldspath, quartz taillés brûlés…). Enfin, les insuffisances, pour divers motifs (humains, financiers…) des classements typologiquesdes collections céramiques de sites déjà fouillés, amènent certaines limitations. Pour les fouilles préventives réalisées dans l’emprise du barrage de Petit-Saut à Sinnamary, seuls22000 tessons sur 185000 ont été classés et uniquement par forme et non par type, d’oùl’impossibilité de réaliser une sériation. De même, pour le Grand Mont Matoury, 45000 tessons ontété récoltés, mais non sériés.
ConclusionLe renforcement de l’équipe du SRA Guyane, qui compte trois agents seulement, est souhaitable.Ce nombre est à comparer par exemple, avec celui des SRA des départements des Antilles, qui ontquatre agents, pour des territoires beaucoup moins étendus (c’est un euphémisme).L’appui du CNRA et de la SDARCHETIS, ainsi que celui de la DRAC et de la préfecture auxprogrammes de recherche pourrait permettre de faire avancer considérablement les connaissancessur les civilisations amérindiennes anciennes du Plateau des Guyanes.
5
Bilan d'activités et orientations de la recherche archéologique
L’activité a été très intense en 2006 et je dois remercier Éric Gassies (et aussi Georges Lemaire partifin février) qui a assuré avec le CRA une masse de travail importante pendant plus de six mois avantl’arrivée début octobre de Guy Dauphin, ingénieur d’études, venu du DRASSM, qui s’initie àl’humide archéologie guyano-amazonienne.
1 - Activités de conservation-protection
1-1 - Carte archéologique, PLU, SCOT…L’intégration des données documentaires dans la base Patriarche et la réalisation des cartesarchéologiques communales pour pouvoir renseigner correctement le «portés à connaissance» desPLU, SCOT… sont toujours en cours. Éric Gassies, responsable de la Carte archéologique est entrain de résorber peu à peu le passif accumulé depuis plusieurs années.
1-2 - Archéologie préventive, INRAPDepuis mai 2004, notre politique a été de privilégier les opérations en archéologie préventivesituées sur la côte, pour des raisons évidentes de coût et d’efficacité scientifique, mais avec lenombre sans cesse accru de demandes d’études (PER) et de permis miniers (AEX, PEX,concessions), l’INRAP a commencé à réaliser des opérations à l’intérieur de la Guyane, pour preuvel’étude en cours sur le PER de Yaou, Maripasoula, sur une superficie de 52km2.Pour les AEX, PEX et Concessions minières qui s’étendent sur plusieurs km2, seules desprescriptions ont été émises sur les surfaces les plus importantes (plus de 15 km2); mais ce sont autotal plus de 1500 km2 que l’INRAP doit traiter... (prospections pédestres, sondages mécaniques oumanuels après repérage des sites…). Une méthode de travail originale est de train de se mettre enplace sur ces grandes surfaces.De plus, pour éviter des diagnostics inutiles, avant toute prescription, nous avons décidé d’effectuerune pré-prospection systématique des terrains pour éviter des désagréments (terrains déjà déboisésou défoncés, terrains remaniés antérieurement…). Le travail de terrain (visites, prospections,ramassages de matériel…) des agents du SRA est donc permanent. Ainsi, 141 dossiers de demandesd’urbanisme (50) ou d’infrastructures diverses (91) ont été traités par le SRA.Les fouilles des trois sites de la future route Apatou-Saint-Laurent du Maroni ont été réalisées etterminées; les rapports sont en cours. Le dernier site à fouiller, celui de Crique Hermina est enattente du tracé définitif de la route.Huit diagnostics ont été effectués en 2006, quatre (PC des Sables Blancs-AM43 à Iracoubo, Pont deSaint-Georges de l’Oyapock, ZAC de Macouria, et Lotissement Prévôt à Cayenne) devraient donnerlieu à des fouilles (examen des dossiers en commission du CNRA), quatre sont sans suite (CarrièreNancibo à Roura, Lotissement Sainte Agathe à Macouria, Barrage de Saut Maman Valentin à Mana,Lotissement Le Mahury à Rémire-Montjoly). Quinze prescriptions de diagnostics et une de fouilles ont été émises en 2006, à un rythme«supportable» pour l’INRAP, la preuve en est qu’aucune prescription de diagnostic émise par leSRA n’est restée «en souffrance» (hors dossiers miniers, mais c’est largement compréhensible) etaucun retard n’est à déplorer.
En 2006, l’essentiel des opérations liées aux aménagements ou aux infrastructures a encore eu lieusur la frange côtière, mais 2007 sera peut-être une année-tournant.
6
1-3 - Stage d’initiation à la conservation-restauration des objets archéologiques (aspectspratiques) Il a été assuré par Marie-Pierre Lambert du Laboratoire d’Archéologie des métaux de Jarville les 1er
et 2 juin au SRA. Une dizaine de participants (Musée des cultures Guyanaises, Centre d’expositionPagaret, Laboratoire des matériaux du CNRS-UAG, Conseiller à l’ethnologie de la DRAC et SRA)ont assisté à la deuxième partie de cette formation (la première, théorique, avait été donnée enseptembre 2004).
1-4 - Dépôt archéologique de Rebard, CayenneDepuis septembre 2004, le CRA gère le dépôt. Un nettoyage complet a été réalisé et un contratd’entretien permet une préservation correcte du matériel, l’alarme du dépôt a été remise en état,deux bacs de lavage pour le matériel et une douche pour les agents du SRA ont été installés. Puis,deux déshumidificateurs ont été mis en place dans la réserve de matériel métallique sur les conseilsde Marie-Pierre Lambert, restauratrice du LAM de Jarville. Un tri du matériel par matériau et unmeilleur conditionnement ont été effectués.Une partie du matériel métallique colonial valorisable auprès du grand public a été envoyé au LAMpour consolidation et un programme d’études et de consolidation a été «monté» sur des créditsFEDER (M.O: LAM).
1-5 - BSR 2000-2005La réalisation du BSR 2000-2005 a été menée à bien par le SRA. Il nous a semblé plus opportun derassembler dans deux BSR (2000-2003 et 2004-2005) les résultats des opérations réalisées entre2000 et 2005, au vu du petit nombre d’opérations réalisées en 2000, 2001 et 2003, par exemple(voir liste des opérations en annexe).
2 - Activités de recherche
2-1 - Petites opérations de prospections et de sondagesIl faut aussi signaler cinq petites opérations de prospection et de sondages qui ont apporté desdonnées intéressantes et inédites sur l’exploitation du quartz aurifère par le feu, commune de Saül(Pierre Rostan), sur le site ancien des Jésuites de Loyola à Rémire-Montjoly, site nommé Quincyoccupé vers 1680-1690 (Réginald Auger), sur un site amérindien de cordon sableux, contigu auxsites déjà connus de Thémire et de Katoury, à Cayenne (Gérald Migeon), et sur l’occupationamérindienne ancienne de deux inselbergs (celui de la Trinité, commune de Mana et celui de laBorne1, commune de Maripasoula (Gérald Migeon).
2-2 - ACR «Préhistoire de la côte occidentale de Guyane» L'ACR dirigée par Stéphen Rostain, du CNRS, a fonctionné un peu plus activement que l’annéeprécédente, avec la dotation 2005 arrivée fin 2005 au CNRS.
2-3 - Étude des collections du dépôt et datations de matériel amérindien Le SRA a pu procéder à quelques sondages ou ramassages sur des sites (Montabo sud à Cayenne,Abris de la borne 1 et Abri Arca à Maripasoula, Sables blancs à Iracoubo) et avec les créditsd’analyses alloués pour 2006, nous avons pu aussi dater les occupations de ces sites ainsi quequelques autres sites inédits de Guyane, reconnus en 2004 et 2005. - Site de cordon sableux de Montabo sud, et des sables blancs à Iracoubo- Abri Arca, Montagne de la Trinité à Mana, Monts d’Arawa, Sommets du Mitaraka Toukouchipan)et Abri Daniel, Borne 1, montagne couronnée de Yaou à Maripasoula- Grotte Tortue, Site 2 de la Grotte de Kaw et Crique Solitaire à Roura
7
En conclusion, l’activité «recherche» du SRA a été développée tant en archéologie coloniale, avecquatre opérations, qu’en archéologie amérindienne, dans ce cas grâce à une implication directe duSRA. Des résultats intéressants (datations en particulier) ont ainsi pu être obtenus.
2-4 – Université des Antilles-GuyaneLe CRA a aussi participé activement à l’élaboration du PRES guyanais dans lequel il a été ledéfenseur acharné du thème intitulé «Dynamiques des sociétés amazoniennes dans leurenvironnement», ce qui entretient une lueur d’espoir pour l’avenir.
2-5 - Convention UMR 8096 du CNRS et MCCElle a été signée en janvier 2006. La première conséquence est que depuis un an, deux agents duSRA (Éric Gassies. et Gérald Migeon) sont chercheurs à part entière de l’UMR 8096 «Archéologiedes Amériques», Nanterre.
2-6 - Archéologie colonialeElle constitue le secteur fort de la recherche avec trois programmes de grande qualité.- Le programme de consolidation, d’études physico-chimiques et archéologiques du matérielmétallique colonial, qui a débuté en 2005 grâce à des crédits FEDER sous la maîtrise d’ouvrage duLaboratoire d’archéologie des Métaux de Jarville (LAM), continue. En urgence, une partie du matériel métallique colonial issu des fouilles coloniales antérieures etvalorisable auprès du grand public avait déjà été envoyé au LAM. Le reste (scories, outils cassés,incomplets, autres objets…) a été étudié par deux étudiants sous la direction des chercheurspaléométallurgistes du LAM, de Pierre Fluck, professeur de patrimoine industriel à l’Université deHaute-Alsace) et de Marie-Pierre Lambert, restauratrice au LAM.- Ces quatre chercheurs venus en mission entre avril et juin, pour essayer d’en apprendre plus sur lamétallurgie aux «Amériques» au XVIIIe siècle. Ils ont procédé à des sondages dans la forge quiavait été en partie fouillée précédemment à la recherche d’éléments manquants dans la chaîneopératoire d’un atelier de forge. Leur rapport sera examiné lors de la séance de la commission.- La deuxième année de la fouille annuelle triennale (2005-2007), du site colonial du Moulin à Vent,annexe du site jésuite de Loyola, sous la responsabilité de Nathalie Cazelles a apporté des donnéesinédites. Le rapport des fouilles programmées tri-annuelles a été envoyé pour examen. Desétudiants des universités parisiennes et canadiennes sont venus aider les professionnels, ainsi quequelques passionnés guyanais.
2-7 - Échanges internationauxNous les avons développés depuis trois ans et les échanges sont de plus en plus fructueux, avec leBrésil en particulier.- Le conservateur s'est rendu début février 2006, au Brésil, a rendu visite à André Prous, professeurde l’Université fédérale de Belo Horizonte, qui avait participé au colloque franco-brésilien deKourou en mai 2005, puis à Marcos Galindo, de l’Université fédérale du Pernambuco à Recife.Avec ces collègues, nous avons échangé publications et idées, en pensant bien activer encore noscollaborations soit par des séminaires ou tables-rondes communes, soit par des échanges dechercheurs ou d’étudiants. - En octobre, le conservateur a été invité en tant qu’enseignant à l’UAG, à un échange entrel’Université de Brasilia et le PUG, qui s’est tenue à Brasilia. Des axes de coopération ont été défini,particulièrement dans le groupe «Interactions territoires-sociétés».- En octobre, Mariana Cabral et Joao Saldanha, collègues brésiliens de l’IEPA (centre de recherchesde l'État d’Amapa) à Macapa, ont invité le conservateur pour des échanges d’informations etd’expériences. Ils ont été invités à la IIIe Journée archéologique de Guyane où ils ont présenté lesrésultats de la première année du service d’archéologie de l’Amapa.
8
3 - Activités de diffusion et de valorisation
3-1 - Valorisation destinée au grand publicLe SRA a participé activement à la mise en place de cinq visites de sites pour les JEP. Le suivi de lamise en valeur progressive de ces sites, est une priorité.Kourou: Roches Gravées de la Carapa: Visite guidée par l’association APROCAResp. M. Henri SECRoura / Cacao: Habitation Eléonore : Visite guidée par l’association Le Planeur BleuResp. M.Philippe SOLER .Rémire-Montjoly: Les fouilles archéologiques du Moulin à Vent : Visite guidée par l’associationAPPAAG Resp. Melle Nathalie CAZELLES et M.Yannick LE ROUX.Roura: Habitation La Caroline: Visite guidée par des animateurs du PNR.Cayenne: Circuit des Roches gravées: Visite guidée par les deux agents du SRA
La mise en place d’un stand sur le «choc microbien de la Conquête» par le SRA lors des «Journéesde la Science» a été très appréciée (14 au 18 novembre).
La IIe Journée archéologique de Guyane, organisée par le SRA à Rémire-Montjoly le 20 janvier2007 a permis de présenter les résultats de l'année 2006.
Une valise pédagogique sur l’archéologie amérindienne préparée, par le SRA (Gérald Migeon) encollaboration avec le Musée des cultures guyanaises et le Rectorat a été présentée lors de cetteJournée.
Un itinéraire du Patrimoine «Les fortifications de Cayenne» a été réalisé par Éric Gassies (SRA) etVirginie Plusse (GRID) et présenté aussi le 20 janvier dernier.
3-2 - Participation aux colloques scientifiques et publications
● Colloques
Eric Gassies et Gérald Migeon ont participé à un séminaire de travail UNESCO organisé enGuadeloupe en vue d’un classement au patrimoine mondial des roches gravées des Caraïbes. Le sitede la Carapa à Kourou a été proposé, par le SRA Guyane et le dossier suit son cours.
● Publications
Éric Gassies- «Pour une archéologie de l’espace guyanais: l’apport de la cartographie ancienne à l’étude del’occupation humaine» in Histoire de la Guyane. Des amérindiens à nos jours. Éditions Ibis Rouge,2006- Communication sur L’art rupestre de la Guyane française à l’Université Antilles-Guyane (février2006) à la faculté de Saint-Denis à Cayenne.- Présentation de L'art rupestre en Guyane, dans le cadre de la 1ère réunion d'experts en Art rupestredans les Caraïbes et Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour une possible nominationtransnationale de l'Art rupestre amérindien au Patrimoine mondial. Basse Terre (Guadeloupe) 3-6mai 2006 (Actes à paraître, 2007)- Les Fortifications de l'Ile de Cayenne (Guyane). Itinéraire du Patrimoine, octobre 2006.
9
Gérald Migeon- «Apports de la datation par thermoluminescence à la connaissance des cultures précolombiennesde Guyane». Actes du XXIe colloque de l’AIAC, University of West Indies, Trinidad, 2006 (souspresse).- «La secuencia ocupacional y cerámica del Cerro Barajas, Guanajuato y sus relaciones con elCentro, el Occidente y el Norte de México». In Dinámicas culturales entre el Occidente, el Centro-Norte y la Cuenca de México del Preclásico al Epiclásico: trabajos recientes Brigitte Faugère(coord.). A paraître au CEMCA en 2006. (avec G. Pereira).- Colloque “Mobilités, immobilismes. Imitation, transfert et refus d’emprunt” (8 et 9 juin),Nanterre, 2006.- Communication: Le plateau des Guyanes du début de notre ère au XVIII e siècle: qui circule?hommes, techniques, objets, concepts, symboles. (en cours de publication).
3-3 - Formation Deux formations d’une journée des étudiants de l’IUFM et des étudiants de la licenceEnvironnement , intitulées «Initiation à l’archéologie et aux civilisations de Guyane», ont étémenées à bien par Éric Gassies et Gérald Migeon.Un cours en licence à l’UAG (24h), sur les «Civilisations amérindiennes du plateau des Guyanes»,a été assuré par Gérald Migeon au premier semestre (septembre-décembre 2006).
10
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Tableau des opérations
Numéro de site Commune RO Nature Époque Notice
973020082 Cayenne - LycéeMelkior Garré
Mickaël Mestre Diag Non
973020032Cayenne - MontaboSud
Gérald Migeon PI-Sondages PCC Oui
973030061Iracoubo - ParcelleAM43
Martijn Van den Bel Diag PCC Oui
973050043
973050043
Macouria
ZAC de Soula
Mickaël Mestre Diag PCC Oui
973060062Mana - Inselberg de laTrinité
Gérald Migeon PI-Sondages PCC Oui
973530018 Maripasoula - Borne 1 Gérald Migeon PI-Sondages PCC Oui
973090113Rémire-Montjoly - LTPrévôt
Pierre Texier Diag PCC Oui
973090004Rémire-Montjoly -Forge de Loyola
Pierre Fluck Sondages MOD Oui
12
973090004Rémire-Montjoly -Quincy
Réginald Auger PI-Sondages MOD Oui
973090008Rémire-Montjoly _Moulin à Vent
Nathalie Cazelles FP MOD Oui (voir en 2009)
97306Mana - Lycée -Parcelle AS7
Matthieu Hildebrand Diag - RO Non
973080002
Saint-Georges de
l’Oyapock
Site de Pointe Morne:liaison du Pont del’Oyapock
Mickaël Mestre Diag PCC Oui
973110102Saint-Laurent duMaroni - Plateau desMines
Mickaël Mestre Fouilles préventives PCC Oui
973110103
973110104
Saint-Laurent duMaroni -Saut Saillat
Matthieu Hildebrand Fouilles préventives PCC Oui
973110110 973110111Saint-Laurent duMaron et Apatou-Crique Sparouine
Martijn Van den Bel Fouilles préventives PCC Oui
13
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Légende de la carte des opérations
•1 - Cayenne: Montabo Sud (Gérald Migeon)
•2 - Iracoubo : Parcelle AM43 (Martijn van den Bel)
•3 - Macouria : ZAC de Soula (Mickaël Mestre)
•4 - Mana : Abri Arca, inselberg de la Trinité (Gérald Migeon)
•5 - Maripasoula : Borne 1 (Gérald Migeon)
•6 - Rémire-Montjoly : Lotissement Prévôt (Pierre Texier)
•7 - Rémire-Montjoly : Forge de Loyola (Pierre Fluck)
•8 - Rémire-Montjoly : Quincy (Réginald Auger)
•9 - Saint-Georges de l’Oyapock : Liaison entre le bourg et le futur pont (Mickaël Mestre)
•10 - Saint-Laurent du Maroni : Plateau des Mines (Mickaël Mestre)
•11 - Saint-Laurent du Maroni : Saut Saillat (Matthieu Hildebrand)
•12 - Saint-Laurent du Maroni et Apatou : Crique Sparouine (Martijn Van den Bel)
BILAN
14
GUYANE SCIENTIFIQUE___________________________________________________
2006Carte des opérations autorisées
15
CAYENNE
Montabo Sud
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Travaux et recherches archéologiques de terrain
Précolombien
Après le diagnostic réalisé en 2005, parFabrice Casagrande (INRAP), sur le terraindénommé Montabo Sud, la fouille préventiveprescrite a été abrogée par Monsieur le Préfetpour des raisons de délai et de coût; ce qui amotivé l’intervention directe du SRA pourréaliser une opération de «sauvetage». Celle-cia consisté en un ramassage ordonné pargrandes unités stratigraphiques du matériel misau jour par la pelleteuse mise à disposition parl’aménageur, M. Bernard, que nous remercionsici.
● Contexte géomorphologique etarchéologique
Localisation du site de Montabo sud (Coutet, 2008).
Montabo Sud est situé dans la partie médianede l’Anse de Montabo, sur la bande côtière del’île de Cayenne; plus précisément sur ledernier cordon pré littoral avant la plageactuelle (Casagrande, 2005). La zone trèsurbanisée (Ensemble culturel régional, Lycée
Melkior Garré), a révélé de nombreux vestigesarchéologiques : les sites de Thémire et deKatoury sont localisés quelques centaines demètres à l’arrière du site sur un autre cordon.D’autres sondages ont été effectués dans cettezone, mais leur positionnement en marge de ladépression qui sépare les deux cordons n’étaitpas favorable à l’installation humaine.Néanmoins, dans les deux cas, des tracesd’occupation avec une céramique proche decelle de Katoury (Delpech, 2005; Hildebrand,2007) ont été retrouvées.
Schéma de répartition des cheniers de l’anse de Montabo sud (parMickaël Mestre et Martijn Van den Bel, in Mestre 2005).
16
Montabo Sud a donc fait l’objet en premierlieu, d’un diagnostic INRAP (Institut Nationalpour les Recherches ArchéologiquesPréventives) sous forme de cinq tranchéesmettant au jour trois zones riches en matérielarchéologique situées sur les parties les plusélevées du cordon sableux. L’INRAP aégalement réalisé un transectgéomorphologique du site identifiant cinqensembles (Casagrande, 2005) comprenant,notamment, de la latérite sous forme denodules de fer plus ou moins dégradés et desargiles bleues de la série Démérara quiconstituent le substrat du site.
Dans la zone la plus élevée et la plus riche envestiges, l’intervention du Service Régional del’Archéologie a permis de collecter par unitésstratigraphiques (figure 4) un importantmatériel céramique, étudié par Claude Coutet.
Le lotissement a été divisé en 6 secteurs.
Localisation du lotissement de Montabo sud et de la zone desramassages.
Le secteur 1 correspond aux ramassageseffectués dans la coupe jouxtant le terrain deMme Rullier, situé au nord-ouest dulotissement. Le matériel provenant de cesecteur (US 24) ne sera pas traité dans cerapport, mais l’a été dans le cadre du chantierdes collections 2009-2011 du CCE Rebard(rapport consultable au service d’archéologie).Le secteur 2 correspond au sommet du site quia été décapé, puis échantillonné, et qui aconstitué l’essentiel de l’opérationarchéologique. Les secteurs 2, 3, 4, 5 et 6(1200 m2) ont été ensuite divisés en unitésstratigraphiques.
Plan des US (unités stratigraphiques) du site.
Après un ramassage de surface général (US1,2 et 3 = niveau 1), le décapage par passesmécaniques fines, par 4 mètres de large, a étéréalisé par unités stratigraphiques ouUS.Commençons par le secteur 4 (4mX40),situé au nord du cordon, dans sa partiedescendante bordée au nord par un criquot.Les unités stratigraphiques 4 (à l’est) 5 et 6 (aucentre) et 9 (à l’ouest) ont été constituées. Lesecteur 3 (4mX40) est constitué par unelongue bande, localisée entre le sommet ducordon au sud (secteur 6) et le secteur 4 aunord. Il comprend les US 7 (à l’est), 8 (aucentre) et 20 (à l’ouest). Le secteur 6 constituele cœur du site; c’est le sommet du cordon,dans lequel les artefacts sont les plusabondants (US 11 à 19 et 21 à 23). Nous avonsréalisé plusieurs passes, le matériel étant trèscertainement beaucoup «bougé» depuis dessiècles. En effet, le décapage total de la zonede 1200 m2 a permis de nous rendre compteque ce site est en fait constitué de matériel trèscertainement hors contexte qui a dû être brassépar divers phénomènes liés à la dynamiquecôtière (érosion, déplacement du lit de lacrique attenante…) ou à des transformationsviolentes du littoral sous l’effet conjugué desfortes marées d’équinoxe et de la houlepouvant provoquer la destruction de cordonssableux (Prost, 1992). L’intérêt principal decette opération consiste donc enl’identification des céramiques dans un secteurcrucial pour la définition du complexe de l’îlede Cayenne, renommé Thémire par Rostain en1994.
17
● Analyse technologique de lacéramique (Claude Coutet)
Les tessons céramiques collectés lors de cesopérations peuvent être classés dans lecomplexe Thémire de la traditionArauquinoïde défini par Rostain (1994). Il estégalement très semblable à celui du site deKatoury qui, selon Hildebrand (dans Mestre2005), forme un complexe à part entière.
Après un échantillonnage des tessons decéramique du site (sélectionnés d’après leursuperficie et leur état de surface), la procédurede l’analyse technologique de la céramique,mise en place par V. Roux et M.-A. Courty,passe par des tris successifs. Notreéchantillonnage est constitué de 899 tessonsissus des fouilles effectuées par le SRA. Cestessons son classés par unité stratigraphique,mais en regard du bouleversement subi par lesite, ces US n’ont pas une grande signification.Le premier tri est une classification techniquequi permet, à travers la reconnaissance desopérations de façonnage et de finition,l’identification des chaînes opératoires misesen œuvre pour produire la vaisselle (Roux etCourty, 2007). Il s’agit d’observer, sur lesfaces internes et externes des tessons, lesmacro traces diagnostiques des techniques etméthodes de façonnage et de finition. Lestessons sont classés selon ces différentesmacro traces. Ainsi «la récurrence des gestesde façonnage et/ou de finition mise en œuvrepour une technique et méthode donnée indiquela tradition apprise au sein d’un groupesocioculturel» (Roux et Courty, 2007 : 158).La tradition équivaut à une entité technique àlaquelle peuvent se rattacher plusieurs groupestechniques. Ces derniers sont reconnaissables àpartir de variantes à la tradition : ils ont lamême chaîne opératoire, mais les valeurs decertains paramètres diffèrent. On observe alorsdes épaisseurs d’engobe différentes, unpolissage ou un raclage plus ou moinssoigné…etc. Ces variantes, en fonction de lataille des groupes techniques, vont révéler ungroupe socioculturel distinct ou desidiosyncrasies c’est à dire des particularitéspropres à un individu.
Le second tri est une classification
pétrographique. Chaque groupe technique estexaminé selon des critères pétrographiquesafin de déterminer des sources d’argile(lorsqu’un échantillonnage de ces sourcesexiste) et de caractériser les techniques depréparation de la pâte ainsi que les modes decuisson. Les groupes techno-pétrographiquesainsi obtenus sont significatifs d’unités deproduction car ils témoignent d’une chaîneopératoire depuis le lieu d’extraction desmatières premières jusqu’à la cuisson.
Le dernier tri est une classification morpho-stylistique intervenant au sein de chaquegroupe techno-pétrographique. On obtientainsi le dernier maillon de la chaîne : lesgroupes technomorphologiques.
Cette analyse permet de déterminer les formesde poterie obtenues selon les diverses chaînesopératoires et donc «d’apprécier si lavariabilité des chaînes opératoires est liée àdes facteurs d’ordre fonctionnel ou culturel»(Roux et Courty, 2007 : 158). Si on établit unecorrélation entre une forme spécifique et unechaîne opératoire propre, cette productionpourra s’expliquer en termes fonctionnels. Si,en revanche, plusieurs catégories de récipientssont produites selon de mêmes chaînesopératoires, cela se justifiera en termesculturels.
Identification des groupes pétrographiques
La technique d’ébauchage repérée surl’ensemble du matériel est le montage aucolombin sur une plaque modeléeprobablement à partir d’une boule d’argile.Une base façonnée selon la méthode ducolombin en spirale fait exception. Nous avonspu observer divers modes d’adjonction descolombins (jonctions concaves/convexes,plates ou en pointe), mais ceux-ci apparaissantparfois sur un même tesson ne peuvent êtreconsidérés comme marqueurs d’une traditiontechnique différente. En ce qui concerne lesméthodes de montage, rien, dans la limiteactuelle de nos observations (macroscopiques),ne nous permet d’envisager un montagedifférent du colombin en anneau. Les fractureset fissures ainsi que les formes mêmes desvases n’indiquent pas de montage en spirale.Seuls deux tessons de corps très épais (1,4
19
cm), de forme rectangulaire et de superficierelativement importante (environ 30 cm2),pourraient indiquer un montage par segmentspour de grands récipients.
Ainsi, considérant l’uniformité des méthodeset techniques de façonnage, nous avons établi,sur les conseils de Valentine Roux, nos entitéstechniques à partir des différents traitementsde surface. Trois entités principales ont étédéfinies : «Poli sans engobe», «Engobe» et«Lissé». Les deux premières se divisent endivers groupes techniques se distinguantd’abord selon les faces internes et externespuis suivant différentes valeurs telles que ledegré de soin apporté à la finition ou lescouleurs d’engobe. Le troisième groupe ne sesubdivise pas avant le classement techno-pétrographique.
Observations sur l’origine et la préparationdes pâtes
Il n’existe pas d’échantillonnage des argilessur le littoral de Guyane, à ce jour. On peutnéanmoins souligner que, les argiles utilisées àMontabo Sud sont des argiles typiques del’intérieur des terres (ce qui n’a rien étonnantcar, d’un point de vue géologique, l’île deCayenne a un profil à la fois littoral etintérieur) : ce sont des argiles d’altérationissues de latérites et qui, en conséquence,changent très fréquemment de composition.
Les pâtes de Montabo Sud sont donc pour laplupart préparées à partir d’argileséluvionnaires (altérées sur place), récupéréesen bordure de criques où les gîtes peuvent être,à la fois, très proches et très différents. Ellessont riches en minéraux divers : séricite(muscovite pulvérisée), muscovite, quartz,minéraux lourds, feldspath…etc, et en noduleslatéritiques.
L’étude géomorphologique entreprise auxabords du site a montré la présence d’argilessédimentaires de la série Démérara.L’hypothèse de l’utilisation de cette argilecomme matière première avait été émise.Cependant, cela est peu probable car commenous l’avons dit plus haut, les argiles deMontabo Sud proviennent plus certainementde gîtes d’argiles éluvionnaires à la
composition très variable, contenant denombreuses inclusions plus ou moinsgrossières (D. Bernard de Sanchez, comm.Pers.).
Le site étant aujourd’hui totalement loti, nousn’avons pas pu faire de prélèvement sur place.Il nous est donc impossible d’en dire plusquant à l’origine de l’argile de la productioncéramique de Montabo Sud.
Concernant la préparation des pâtes, plusieurscritères rentrent en compte. La nature desinclusions non plastiques (volontaires ou non),leur abondance et leur grosseur nousrenseignent sur les tris et les ajouts effectués.Une observation de la macroporosité nousindique la qualité du malaxage de la pâtevisant à homogénéiser la pâte et à en ôter l’air.
Les groupes anecdotiques introduisant de tropnombreux critères pour un petit nombred’individus ne sont pas pris en compte dans lesobservations suivantes.
De façon générale, on observe un tri plus oumoins grossier des éléments non plastiques,parfois les pâtes les plus fines contiennentencore des inclusions allant jusqu’à plusieursmillimètres, notamment des quartz et desnodules latéritiques. Après cette opérationd’épuration, la majorité des pâtes de notreéchantillonnage est dégraissée avec unechamotte, également, plus ou moins grossière.La macroporosité, rarement faible, indique lesoin tout relatif du malaxage de la pâte. Nousavons donc affaire à une majorité de pâtes dontla préparation est de qualité moyenne.
Les types de récipients
Nous avons étudié les bords de chaque groupetechno-pétrographique. Certains bords sont deséléments uniques, d’autres ont pu être classésen 11 types différents avec des sous-groupes aet b en cas variantes mineures (dimensions,évasement).
–Type I a : grands récipients (de 34 à 45 cm dediamètre et d’épaisseur comprise entre 0,6 et0,8 cm) ouverts à bord évasé légèrementconvexe. Les lèvres de ces vases sontdiverses : aplaties, arrondies, amincies ou enléger biseau externe. La majeure partie des
20
bords de ce type est incisée (traits obliques,verticaux ou quadrillage en treille). Ces bordssont à associer à des bases plates (parfoislargement évasées).
–Type I b : moyens à grands récipients (de 25 à46 cm de diamètre et d’épaisseur compriseentre 0,6 et 0,8 cm) ouverts à bord évasé àlèvre amincie. Ces deux types représententdeux catégories de bassins légèrementdifférentes : les parois du type I a sont plusévasées que celles du types I b.
–Type II a : récipients de taille moyenne (entre20 et 33 cm de diamètre, 0,6 à 0,7 cmd’épaisseur), ouverts, à bord convexe et à lèvrearrondie et épaissie sur la face interne.
–Type II b : petits récipients (diamètred’environ 15 cm, 0,5 à 0,6 cm d’épaisseur)ouverts à bord convexe, à lèvre en pointe etépaissie sur la face interne. Selon Balfet et al.(1989), ces récipients peuvent êtreréciproquement rapprochés des jattes et desbols.
–Type III : récipients petits à moyens (11 à 21cm de diamètre, 0,5 à 0,6 cm d’épaisseur)fermés à bord convergent et à lèvre aplatie ouamincie.
–Type IV a : récipients de taille moyenne àgrande (22 à 44 cm de diamètre environ, 0,9cm d’épaisseur), fermés, à col évasé ouconcave (ouverture large) et lèvre arrondie ouamincie.
–Type IV b : récipients de taille petite àmoyenne (15 à 20 cm de diamètre environ, 0,5à 0,6 cm d’épaisseur), fermés, à col évasé ouconcave (ouverture large) et lèvre arrondie ouamincie.
–Type V : récipients de taille moyenne et àouverture ovale (épaisseur 0,6 à 0,7 cm), àbord convexe, épaissi sur la face externe etlèvre aplatie ou arrondie.
–Type VI : récipients de taille moyenne àgrande (11 à 12 cm de diamètre, 0,8 à 1 cmd’épaisseur) fermés, à col concave ou évasé, etlèvre arrondie avec plusieurs variantes.
–Type VII : grands à très grands récipients (31à 62 cm de diamètre, 0,8 à 1,4 cm d’épaisseur)
fermés, à col faiblement évasé et lèvre aplatieou en léger biseau externe.
–Type VIII : moyens à grands récipients (entre20 et 40 cm de diamètre, 0,9 à 1 cmd’épaisseur) fermés, à bord évasé, et lèvrearrondie.
–Type IX : petits récipients (diamètres comprisentre 9 et 12 cm, 0,3 et 0,8 cm d’épaisseur),fermés, à col évasé et lèvre amincie ouarrondie. La base du col est toujours peinte enrouge et le bord porte un décor incisé souventinhabituel.
–Type X a : grands récipients (30 cm dediamètre environ, 0,6 à 0,8 cm d’épaisseur),ouverts, à lèvre arrondie ou amincie, caréné ounon.
–Type X b: récipients de taille moyenne (entre20 et 30 cm de diamètre, 0,6 à 0,8 cmd’épaisseur), ouverts, à lèvre amincie (avecplusieurs variantes).
–Type XI a : grands à très grands récipients (de24 à 60 cm de diamètre, 0,7 à 1,1 cmd’épaisseur), ouverts, à bord très évasé, à lèvreamincie avec plusieurs variantes.
–Type XI b : récipients de taille petite àmoyenne (entre 16 et 23 cm de diamètre, 0,5cm d’épaisseur), ouverts, à bord très évasé etlèvre amincie ou arrondie.
Conclusion de l’étude céramique
Selon le modèle établi par V. Roux (Roux etCourty, 2007), la céramique de Montabo Sudconstitue un assemblage de type homogènecomplexe composé d’identités majoritairesavec divers groupes techniques. Ces groupessont caractérisés par des groupespétrographiques homogènes (même pâte)présentant néanmoins une variabilité techniquerelativement forte (par exemple, les groupes Cet E). L’homogénéité des groupespétrographiques indique l’utilisation desources d’argiles qui, même multiples,proviennent d’une microrégion, c’est à dire duvoisinage du site. La variabilité technique,quant à elle, est le reflet «d’unités deproduction distinctes» (Roux et Courty, 2007 :159). Dans notre cas, en regard des donnéesethnographiques et ethnohistoriques, il peut
21
s’agir de potières différentes ou d’ateliers(probablement d’ordre familial) différents.
Concernant les groupes secondaires, plusanecdotiques, (comme le Lissé interne/externe- Sable), nous pouvons supposer une origineexogène, mais, au plus, à échelle de lamésorégion: décors rares (mais similaires),formes distinctes, pâte différente avec unefaçon de faire identique.
Dans l’ensemble, l’assemblage de MontaboSud montre une production céramique denature domestique (figure 10). Les formesfabriquées sont des bassins (59 bords), desassiettes (20 bords) des petits pots à bordconvergents (11 bords), des plats (8 bords), desécuelles, des bols, des jattes, des jarres. Lenombre de bords de bassins est considérablepar rapport aux autres formes : l’utilisation decette forme pour des fonctions diverses et trèscommune (cuisson, service).Est-ce la seuleexplication? La comparaison avec lesassemblages d’autres sites nous apporterapeut-être d’autres réponses.
A l’exception du groupe F caractérisé par desrécipients largement ouverts, la majorité desgroupes techno-pétrographiques présente unediversité de formes. Seul l’entité «Engobe»montre des spécificités. Les groupes techno-pétrographiques de cette entité n’ontgénéralement pas pu faire l’objet d’une
classification typologique à cause de leurgrande variabilité et du même coup de leurtrop faible représentativité. Deux hypothèses,au moins, sont possibles : soit, la vaisselleengobée ne représentait pas une grande part dela production soit, c’était une productiondédiée à l’exportation. La seconde hypothèseest difficile a démontré, néanmoins, ellesemble peu plausible. La vaisselle engobée deMontabo Sud ne présentant pas un degré despécialisation particulier, chaque potière desenvirons devaient tout à fait être capable defabriquer les mêmes récipients. Cependant, cesvases demandent un investissement plusgrand : préparation des engobes, temps deséchage, nouveau polissage, décorationspolychromes.
Tableau de synthèse des groupes techno-morphologiques.
Enfin, certains récipients dénotent un grandsoin dans le façonnage et la finition. Cesquelques données nous amènent à penser quecette entité – présentant, par ailleurs, deuxtypes remarquables (récipients naviformes etbouteilles à col rouge et bord incisé) – pourraitêtre consacrée à un domaine d’activité autreque domestique : prestige? Cérémonie?
22
Il est évident que les résultats obtenus à partirde ce corpus et les hypothèses que nousémettons ici demandent à être mis enperspective avec le matériel céramiqued’autres sites de la région. La comparaisonavec les sites voisins de Thémire et de Katourynous fournira de nouvelles données quant à laproduction et à l’usage de la céramique intra-site ainsi que sur les relations entre les siteseux-mêmes : a-t-on affaire à des sites de mêmeculture? Sont-ils contemporains (nousattendons les datations), voire, constituent-ilsun seul et même site.
● Conclusions générales
L’ensemble des trois sites, Montabo sud,Thémire et Katoury, dont les datationscoïncident ou se chevauchent, formaitprobablement une entité à l’époqueprécolombienne. Les vestiges épars de cetétablissement, détruit par les intempéries et lepassage des Hommes depuis l’époquecoloniale ont encore beaucoup à révéler.
Le matériel archéologique est disponible auSRA pour des études approfondies, que nemanqueront pas de réaliser les chercheursintéressés par ce débat passionnant autour duou des complexes culturels de l’île deCayenne.
Gérald MIGEON
Balfet, Fauvet-Berthelot et Monzon 1989: BALFET(H.), FAUVET-BERTHELOT (M.F.), MONZON (S.) -Lexique et typologie des poteries, pour la normalisationde la description de la poterie. CNRS, Paris.
Casagrande, Kayamaré 2005: CASAGRANDE (F.),KAYAMARE (S.) - Cayenne «Montabo Sud», Rapportde diagnostic. Institut National de RecherchesArchéologiques Préventives, Cayenne, non publié.
Delpech 2005: DELPECH (S.) - Anse de Montabo,Rapport de diagnostic. Institut National de RecherchesArchéologiques Préventives, Cayenne, non publié.
Hildebrand 2007: HILDEBRAND (M.) - LycéeMelkior Garré, Cayenne, rapport de diagnostic. InstitutNational de Recherches Archéologiques Préventives,Cayenne, non publié.
Martineau & Pétrequin 2000: MARTINEAU (R.),PETREQUIN (R.) - «La cuisson des poteriesnéolithiques de Chalain (Jura), approche expérimentaleet analyse archéologique». In Arts du feu et productionsartisanales, XXe rencontres Internationalesd’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, sous la directionde P. Pétrequin, P. Fluzin, J. Thiriot, P. Benoit, EditionsAPDCA, Antibes.
Mestre 2005: MESTRE (M.) - Katoury, rapport finalde fouille. Institut National de RecherchesArchéologiques Préventives, Cayenne, non publié.
Prost 1992: PROST (M.T.) - «Sédimentation côtière etformation de cheniers en Guyane : la zone de Cayenne».In Évolution des littoraux de Guyane et de la zoneCaraïbe méridionale pendant le Quaternaire,Symposium PICG 274/ORSTOM (du 9 au 14 novembre1990), Collection Colloques et Séminaires, Editions del’ORSTOM, Paris.
Rostain 1994: ROSTAIN (S.) - L’occupationamérindienne du littoral de Guyane. ORSTOM,Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.
Roux & Courty 1998: ROUX (V.) & COURTY (M.A.)- «Identification of wheel-fashionning methods :technological analysis of 4th-3rd Millenium BC orientalceramics». Journal of Archaeological Science 25 : 747-763.
2007 - «Analyse techno-pétrographique céramique etinterprétation fonctionnelle des sites : un exempled’application dans le Levant Sud chalcolithique». In Lamesure du passé : contributions à la recherche enarchéométrie (2000-2006), A. Bain, J. Chabot, M.Moussette (eds), BAR International Séries 1700,Québec.
23
IRACOUBO
Parcelle AM 43Précolombien
Un site amérindien (daté du XIIe et XIVe sièclede notre ère) avec une vocation d’espacefunéraire a été découvert sur le terrain cadastréAM 43, nommé Sable Blanc Est. Undiagnostic préventif réalisé par l’Inrap a étéeffectué sur une partie de la parcelle. Troissondages dans la zone centrale de la parcelleont clairement montré une distribution spatialede deux ensembles archéologiques deplusieurs vases funéraires. Les deux ensemblesforment une zone de cimetière isolée etlocalisée sur un affleurement naturel. Unensemble (ou tous) a été probablement couvertpar un tertre artificiel. Chaque ensemblecontient environ une vingtaine de fosses. Cesdernières contiennent des vases entiers et desconcentrations de fragments de poterie qui fontpartie du rituel funéraire. Les céramiques nesont pas décorées et évoquent une utilisationquotidienne. Une datation AMS (KIA 33862)sur charbon provenant du sédiment d’un vaseentier, a livré une première indication del’utilisation de ce site : 1000 ± 35 BP, soit 973- 1059 AD (64,2% de probabilité).
Ce site est pour l’instant le seul site funéraire(nécropole) à l’ouest de Cayenne. On peutensuite distinguer trois traditions funéraires enGuyane française. La première tradition estcelle des cimetières d’urnes en grotte deculture Aristé, à l’est de la Guyane française.Ces urnes étaient rassemblées dans des grottesavec des offrandes de céramique, de pierre, etparfois des artefacts de verre et de métaleuropéens. La seconde tradition, à laquelle
appartient celle de Sable Blanc Est, estcaractérisée par une nécropole composée deplusieurs concentrations de sépultures de typesvariés : inhumations secondaires en urne nondécorée ou couverte par un récipient ou ungrand fragment de céramique, sépultureprimaire en coffre fait de platines et de grandstessons de vase. Certains dépôts présentent desoffrandes de céramique ou de pierre.
La troisième tradition, plus diffuse, correspondà des inhumations primaires ou secondairesdans des fosses ovoïdes localisées sur le sited’habitation même. Une ou plusieurs poteriesentières sont parfois déposées en offrande. Desdépôts de céramique, des fragments de poterieentassée, ou des inhumations secondaires enurne peuvent accompagner les tombesprimaires. Ce type de sépulture apparaît dansl’Ile de Cayenne et dans l’intérieur (voirCrique Sparouine dans ce BSR).
En général on peut donc assumer que les deuxpremières traditions semblent partager despratiques funéraires similaires. Les nécropolesoccupent un lieu spécifique dédié à unefonction funéraire, elles sont séparées duvillage. La dernière tradition, que l’onrencontre dans des sites divers, se distinguedes autres par la localisation de la sépulturedans l’espace résidentiel, du moins, dans uneaire non dévolue à des fins funéraires.
Martijn VAN DEN BEL
24
MACOURIA
ZAC de Soula
MANA
Abri Arca – inselberg de la Trinité
Précolombien
L'Établissement Public d’Aménagement enGuyane (EPAG) est en phase de création d’uneZAC sur la commune de Macouria au lieu ditSoula. L’ensemble du projet couvre unesurface totale de 338 000 m² ou 338 ha, dontseulement 180 ha sont aménageables, le restedes terrains étant situé sous la côte des 3 mNGG. Au total, trois zones archéologiques ontété circonscrites dans le périmètre de la ZACdont deux avaient déjà été signalées dans lesannées 1980 (Petitjean-Roget, 1985; Cornette,1988). La céramique amérindienne découvertesur les sites de la ZAC de Soula présente des
similitudes tant au niveau des décors que despâtes. Selon toute hypothèse, il est possibleque l’on soit en présence de mêmes groupes depopulations installés dans des contextesgéomorphologiques sensiblement différents.Les décors incisés sont dominants et plusieurséléments permettent d’ores et déjà de rattacherla production céramique de la ZAC de Soula àd’autres sites déjà référencés sur la région del’Ile de Cayenne. En revanche, aucun vestigecolonial majeur n’a été retrouvé dans lepérimètre de la ZAC.
Mickaël MESTRE
Précolombien
Le site de l’Abri Arca, connu depuis le débutdes années 1990 grâce à l’ARCA (Associationpour la Recherche de la CultureAmérindienne), a été revisité en 1991 parquelques archéologues de l’AFAN quitravaillaient alors sur la zone du futur barragede Petit-Saut. Il est protégé comme monumenthistorique depuis 1992.
Une mission de l’ONF était programmée en2006 et nous avons profité de cette opportunitépour nous joindre à l’équipe emmenée parMaël de Winter, conservateur de la Réserve dela Trinité, pour réaliser quelques petitesopérations archéologiques ayant pour but dedater l’occupation de l’inselberg et de localiserd'éventuels autres sites.
● Contexte géomorphologique,géologique et environnemental
La «Roche Bénitier» fait partie de l’Inselbergde la Trinité, qui fait lui-même partie desMontagnes de la Trinité. Cet inselberg est situéà une centaine de kilomètres de la côté(Kourou, Sinnamary, Mana) dans le bassinversant du Sinnamary.
Autour de l’inselberg, on retrouve denombreuses criques: Eau Claire et PetitLeblond au nord, Cocorico au nord-ouest, Molà l’ouest, Eau Forte et Baboune au sud-ouest.Au nord-est, les criques Leblond et Loutre sontsituées au-delà des Montagnes de la Trinité. LaMana coule à 25 km à l’ouest, le Courcibo à35 km et le Sinnamary à 50 km à l’est.
Le massif granitique caraïbe de la RocheBénitier culmine à 430 mètres. Desaffleurements de roches métamorphiquesanciennes, comme les quartzites, amphibolites,migmatiques sont à remarquer. Les paroisabruptes, quasiment verticales, sont vierges de
25
végétation et coupées de stries ou rigolescreusées par l’érosion pluviale. La pente plusdouce à l’ouest permet d’atteindre le sommetpar un layon qui passe par une petite criquequi paraît permanente (environ deux centmètres avant le sommet). Le sommet del’inselberg est relativement plat. La végétationest composée de forêt et de savanes-roches.
Savanes-roches
● Historique des recherches
En 1990, Cornette avait réalisé du 18 au 21septembre la mission Saub, une prospectionpartielle de l’inselberg. Il avait surtout biendécrit l’abri sous roche formé par un chaos deblocs granitiques. Nous corroborons sesprincipales observations. Quatre gros (de 2 à 3mètres) blocs inclinés et alignés constituent lecôté nord. Un énorme bloc incliné reposant surdeux des quatre blocs précités constitue lavoûte de la partie sud, labri ouvrant vers lesud-ouest. La hauteur de l’entrée est d’environ10 mètres, la profondeur de l’abri est de 15mètres, le fond étant constitué de blocs pluspetits. De nombreux petits couloirs etdiverticules, remplis d’éboulis de pierres et deterre, amènent à de petites salles qui ouvrentvers l’extérieur (le sud-ouest) ou à la surfacede l’inselberg. Le sol de l’abri est en penteassez forte du fond vers l’entrée.
Vue de l’entre de l’abri prise du sud-ouest.
Cornette avait ramassé 45 tessons dont deuxfragments de bords rectilignes (un avecperforation). L’épaisseur des tessons variaitentre 7 et 11 mm. Les sondages S1, S2 et S3n’avaient donné aucun matériel. Entre le 4 etle 6 novembre 1991, Nowacki-Breczwiski etPuaux réalisent rapidement un sondage et unramassage. Le ramassage a fourni 8 tessons.
Dans la couche 1, il a été trouvé un fragmentde base peint en brun et en rouge, avec desmotifs géométriques en négatif, des tessonsavec des lèvres en biseau et deux bords droits.Les bords évasés et droits ont un rayon moyende 20 cm de diamètre. Les dégraissants sont lequartz, le kaolin, les charbons et le mica. Deuxtessons avaient une épaisseur de 15.5 et 16mm, cinq entre 5 et 7.5 mm. Les bords ont undiamètre compris entre 27 et 57 cm, avecgénéralement des lèvres en biseau. Les formessont ouvertes ou légèrement rentrantes.
Pour les auteurs, un niveau d’occupation de 40cm d’épaisseur a été trouvé, contenant desfragments de céramique et de charbons. Ladatation obtenue par Archéolabs 2560-1690cal. BC a ensuite été rejetée par les auteurs(Sylvie Jérémie, communication personnelle).
● Prospection et sondages de la missiond’août 2006
Les 20 et 21 août, lors d’un premier«ramassage-raclage» situé dans la partie sudde l’abri, entre les S1 et S2 de Cornette (US1),18 tessons très érodés à pâte sableuse etdégraissant au quartz, dont trois bords sub-droits, un fond et trois épais (mais pas deplatine) et un quartz, probablement travaillé,
26
sont collectés. Dans la partie nord, un tesson àpâte sableuse et un fragment de quartz (US2)et deux tessons dont un bord rentrant (US11)ont été ramassés.
Plan de localisation des ramassages et du sondage de l’Abri Arca.
Comme l’avait déjà noté Cornette, les tessonsles plus petits se concentrent par gravimétriedans la partie sud et les rares tessons un peuplus gros ont été ramassés dans le fond del’abri. Il en tirant la conclusion que lescéramiques provenaient de «niveauxsupérieurs, voire de la surface située 15 mètresplus haut» (Cornette, 1990: 34). Je pensequ’une autre explication est possible: lescéramiques ont pu être déposées sur les grosblocs au fond de la grotte, puis après avoir étébrisées par des animaux, des coulées de terres,voire des hommes, les fragments se sontéparpillés sur le sol comme décrit auparavant.Ce phénomène a été observé dans d’autresgrottes ou abris.
Puis un sondage de 1 m x 1 m (S4) est effectuéau sud du sondage S3 de Cornette et au nordde S1 de Cornette dans l’entrée, à la limite dela ligne de gouttière.
US 12: Niveau 1 (0 à 30 cm): une couchehumifère café moyen, sableuse (désagrégationdu granite) avec des racines, 17 tessons.
US 13: Niveau 2 (-30 à 50 cm): couche ocreclair, désagrégation du granite, avec desracines. 2 tessons.
La prospection réalisée au-dessus de l’abri etdans ses alentours n’a permis de collecterqu’un tesson épais, mais qui n’est pas unfragment de platine (US 14), dans un
deuxième abri situé au nord-ouest de l’AbriArca.
● Polissoirs de la Crique Aya (973 306036) et sondages sur berges
Le site de la crique Aya a été relevé parNowacki-Breczewski et Puaux (1991), mais lerapport complet n’est plus présent au SRAGuyane. 95 polissoirs ont été découverts encontrebas de la cascade sur des dalles degranite.
Cascade de la crique Aya.
Nous joignons donc une série dephotographies prises par Magali Chevelot deces polissoirs qui sont de deux types:
–en fuseau
–ovaloïdes
27
Le 19 août, en rive gauche, sur une berge de 3mètres de haut non inondable sur un petitplateau en pente douce, nous implantons lesondage S1 (1 m x 1 m).
US 4 (0 à -35/-40 cm): couche de terre ocre-clair argilo-sableuse avec racines: sansmatériel.
US 5 (-35 et -40 cm): 22 éclats de quartz et desfragments de charbons
US 7 : couche ocre-clair argilo-sableuse, avecbeaucoup de quartz non taillés
Le ramassage (US 6) autour des polissoirs dela dalle 4 a apporté un quartz ocreprobablement travaillé, 2 fragments de schistegris-vert (aiguisoirs?) et nous avons ramasséplusieurs échantillons de pierres.
● Étude préliminaire du matériel
Lithique
Le quartz apparaît comme la seule matièrelithique employée par les occupants de l’AbriArca. Il est impossible avec seulement deuxéclats de tirer une quelconque conclusion.
Pour la Crique Aya, en revanche, les quartzsont plus nombreux, une quarantaine. Sont-ilsnaturels ou anthropiques? Un deuxièmematériau y est présent, le schiste gris-vert, quiest la matière des trois supposés aiguisoirsretrouvés à proximité des nombreux polissoirs.
Céramique
La céramique retrouvée dans le sondage (19tessons) et collectée dans les ramassage del’Abri Arca (22 tessons) apparaît fruste. Elleest très érodée avec principalement du quartzet du mica comme dégraissants. Les raresformes sont celles de bords sub-droits, un seulbord est rentrant. Quelques tessons sont plusépais (plus d’un centimètre d’épaisseur).Aucun ne paraît érodé.
Autres
Des charbons ont été découverts dans lesondage de la Crique Aya et pourraient êtreenvoyés pour datation au radiocarbone, avecles deux tessons retrouvé près du site àpolissoirs non daté.
● Conclusion
De quand date l’occupation?
Une datation par thermoluminescence a étéréalisée en 2006 par Archéoloabs sur un tessonprovenant du sondage 4 de l’Abri Arca. Ladate de dernier chauffage du tesson a donné1500 ± 70 AD (2 σ) et ne paraît pas aberrante.D’autres tessons devraient être datés parthermoluminescence pour corroborer cettedatation.
Quelle est la fonction de l’abri?
Nowacki-Breczewski et Puaux (1991: 72)pensaient pouvoir discerner deux fonctionsdans l’abri en distinguant «les fragmentscéramique venus des écoulements et ceuxprovenant du sondage». Les premiers seraientfunéraires, les seconds liés à l’habitat. Nousavons retrouvé aussi des tessons dans ce quipourrait être une couche d’occupation (S4).Cornette n’en avait pas retrouvé dans ses troissondages. Cela nous laisse un peu perplexes.Mais quoi qu’il en soit, l’occupationamérindienne est réelle même si elle est ténue,et la fonction funéraire peut être avancée étantdonné les arguments fournis: taphonomie desvestiges retrouvés, gros tessons en fond d’abri,la pense de l’abri vers la sortie produisant uneffet de tri différentiel; contexte connu d’abrisfunéraires pour différentes périodesprécolombiennes en Guyane.
Il n’est pas évident de caractériser lesoccupations de ce type d’abris qui ont puservir de refuges occasionnels à ne nombreuxautres groupes amérindiens postérieurs à laConquête. La rareté et la mauvaiseconservation du matériel céramique ne nouspermettent pas non plus d’attribuer à uneculture archéologique connue (Koriabo parexemple) le matériel trouvé. La datationfournie constitue peut-être un élémentintéressant dans une optique régionale, puisquel’on sait qu’à la même période d’autres abrisont été occupés en forêt profonde.
Gérald MIGEON
28
MARIPASOULA
Borne 1Précolombien
● État sommaire des connaissancesgénérales sur l’occupation del’intérieur de la Guyane
Mazière et Mazière (1997: 33-43) présententdans un article de synthèse, les sites del'intérieur où une occupation amérindienne aété attestée : le site à fossé de Yaou (déjàcommenté), l'Abri Arca (voir notice dans BSR2006), l'inselberg des Nouragues, la savane-roche des monts d'Arawa (sites dont nousreparlerons plus loin), la savane-roche deYawapa sur le haut Oyapock, et l'inselbergSuski (Mamilihpann).
Profitons de la mention de ce site, pour citerles opérations de prospections thématiques(polissoirs et art rupestre), réalisées le long desfleuves dans les années 1992-1996, parMarlène Mazière seule (1994, 1995a, 1995b,1995c, 1995d, 1995e, 1996a, 1996b) et avecGuy Mazière (1992, 1993a, 1993b, 1994a,1994b, 1996), qui ont fourni des recensementsde polissoirs et d’autres sites, et de nombreuxrelevés de sites d’art rupestre, en particulierceux du Marouini et de la Mamilihpann, situéssur le ban de la commune de Maripasoula.
Malheureusement, pour cet art amérindien deGuyane, aucune datation précise n’a pu et nepeut actuellement être avancée. L’ensembledes données recueilli sur l'art rupestre a étéprésenté dans une publication récente (MazièreMarlène, 2008). Tous les sites d'art rupestre,ateliers lithiques et autres témoignent de laprésence des communautés amérindiennesanciennes dont les sites d'habitat demeurentencore, en très grande majorité, inconnus desarchéologues.
L'occupation de plusieurs inselbergs et autressites localisés sur les inselbergs de l’intérieurde la Guyane a été reconnue lors de différentespetites opérations que nous avons effectuéesentre 2004 et 2006 (Migeon, 2005, 2006a,).
Pour les abris de l’inselberg des Nouragues lesestimations et datations sont le témoin del’occupation presque continue, ou en tout étatde cause importante, de la région del’inselberg, peut-être dès le Ve siècle de notreère et ce jusqu’au début du XVIIIe siècle,occupation tardive corroborée par les textesethnohistoriques (Migeon, 2006b : 42-43). Lessites sont occupés principalement aux XIe-XII e
siècles, selon les datations par radiocarbone etentre le XVe et le XVIIIe siècle, si l’on se fieaux estimations d’ancienneté parthermoluminescence.
L'Abri Arca est situé au sommet de l'inselbergde la Trinité, avec une occupation datée de2560-1690 BC cal, rejetée par les auteurs(Nowacki-Breczewski et Puaux, 1991 et1991b), car il s’agissait probablement d’uncharbon d’un paléoincendie. Une estimationd'ancienneté par TL a donné 1500+/-70 AD(Migeon, 2006a) et une datation 14C réaliséeen 2008, sur un fragment d'écorce brûlée: 1215à 1278 AD cal.
Nous exposons ici simplement ces données,sans tirer de conclusions, mais nous pouvonsretenir qu’une occupation amérindienneancienne est clairement attestée au XIIIe sièclepour cet abri.
De nombreuses datations par radiocarbone etestimations d'ancienneté parthermoluminescence ont été faites :18 pour lesabris de l’inselberg des Nouragues, situé sur lacommune de Régina; 2 pour l'Abri Arca,Inselberg de la Trinité, commune de Mana, 5pour le site à fossé de Yaou, 5 pour un site deplein air localisé sur les Monts d'Arawa parDaniel Sabatier (que je remercie iciamicalement), et dans le cadre de cettemission, 6 pour trois abris du Mitaraka : 6 pourl'Abri Daniel de la Borne 1, une pour un abrisitué sur le Pic Coudreau, tous ces derniers
29
situés sur le ban de la commune deMaripasoula.
Abri Sylvain
Au total, c'est donc plus d'une quarantaine dedatations ou estimations d'ancienneté que nousnous appuyons. La méthode parthermoluminescence a été testée en 2005 et2006 avec le laboratoire Archéolabs, pouressayer de pallier à l'absence de charbons danscertains sondages et d'estimer directementl'ancienneté du matériel céramique issu desramassages de surface. Une conclusioncritique sur ces tentatives d'estimationsd'ancienneté sera faite plus loin, comme sur lesdatations par radiocarbone, car sigénéralement, les archéologues attribuent plusde validité aux datations par radiocarbonequ'aux estimations d'ancienneté réalisées parthermoluminescence, il ne faut pas oublierqu'il a déjà été démontré de nombreuses foisen Guyane (et ailleurs) que certains charbonsqualifiés d'anthropiques étaient en réalité lefruit d'incendies naturels ou étaientcontaminés, mélangés à des occupationsanthropiques antérieures ou postérieures (cf.par exemple, pour la Guyane, Tardy, 1998).
Sur le site à fossé de Yaou à côté de
Maripasoula, cinq tessons de céramiques issusde ramassages de surface sélectifs (ce quicorrespondrait donc à l’horizon A de Mazière),dans l’enceinte du site de la «montagnecouronnée», ont été estimés récemment parTL, entre 1385 et 1835 AD (Migeon, 2006b).Rappelons que deux datations antérieures parradiocarbone sur des charbons avaient donnéune date plus ancienne, entre 50 BC et 50 AD,pour le fossé. Ces estimations d'ancienneté del’occupation ne sont, dans l’état actuel de larecherche, pas compatibles avec celle avancéepar Guy Mazière; les échantillons ontsûrement été contaminés par des incendiescontemporains ou sub-contemporains, lematériel analysé provenant de ramassages desuperficie. Il ne faut donc pas les retenir.
Une opération de diagnostic menée parMickaël Mestre a eu lieu en 2007, dessondages profonds ont permis de récolter descharbons qui apporteront d’autres élémentsplus tangibles sur la chronologie del’occupation de ce site.
Dans les Monts d'Arawa, une expéditionmenée par Daniel Sabatier, botaniste de l'IRD,a permis d'estimer l'ancienneté par TL, de cinqtessons du même site, entre 970 et 1485 AD,une fourchette compatible avec les hypothèsesactuelles d’ancienneté du peuplement du sudde la Guyane (Sabatier, 2005). Une prochainemission de prospection et de sondages devraitpermettre de recueillir du matériel à dater pourcorroborer ou non ces estimationsd’ancienneté.Il ne faut pas oublier non plus, les prospectionsinventaires qui ont été menées entre 1997 et2002, par les archéologues de la Cartearchéologique de Guyane et/ou de l’AFAN, enparticulier pour notre propos, pour lescommunes de Camopi, Maripasoula, et Saül.Ces opérations ont essentiellement consisté endes études documentaires (archivistiques,cartographiques, historiques…), utiles pour laprotection patrimoniale des sites repérés, maiscomme aucun matériel n’a été ramassé, aucunedatation des sites n’a malheureusement étépossible. Ces études ont clairement mis enévidence la présence de sites amérindiens danstous les environnements : forêt monumentale,
30
rives de fleuves et de criques, savanes roches,inselbergs, cambrouzes...
Forêt sommitale
● La mission de la Borne 1 en 2006
Dans le cadre d’une mission d’étudespluridisciplinaires, nous avons réalisé uneprospection sur et autour de plusieursinselbergs situés à la frontière sud entre laGuyane et le Brésil. Onze abris situés sur laface nord de l'inselberg de la Borne 1, ont étérepérés; huit ont révélé des vestigesanthropiques.
L'Abri du Pic Coudreau, Maripasoula a fourniune datation 14C cal 424 à 567 AD pour unéchantillon d'écorce brûlée d'une céramiqueretrouvée dans un des abris de l'inselberg.
Dans l'Abri Daniel, très riche en matérielcéramique, de nombreux fragments d’unegrande platine décorée ont été retrouvés, ainsiqu’une lame de hache en pierre verte et deséclats de quartz. Les cinq tessons de la couched’occupation ancienne de l’Abri Daniel ont«une date moyenne de dernière cuisson centréesur 440 ± 300 BC».Une occupation ancienneautour de 400 ± 500 BC, a été aussi datée pardeux tessons retrouvés dans l’abri 2 du T0selon les rapports de datation parthermoluminescence d’Archéolabs (Migeon,2006 b).
Céramique du Pic Coudreau
Mais l’unique datation AMS effectuée sur descharbons provenant de la couche d’occupationancienne (1262-1294 AD cal.) ne correspondpas aux dates de dernières cuissons des sixéchantillons de céramique datés par TL (un de990 AD et les cinq autres entre 360 et 580BC).
Comment expliquer ces différencesd’ancienneté?
Le fragment de la platine décorée d’incisionsretrouvée dans trois abris (Rémi, Samuel etDaniel) est donc daté de 990 AD; il est assezévident, que les fragments ont coulé de l’abriRémi situé le plus haut au-dessus des deuxautres, et de là dans l’abri Samuel, puis dansl’abri Daniel.
Abri Daniel
Toukouchipan. Photo Daniel Saint-Jean
31
Enfin, la date de la platine située autour de l’anMil est à mettre en relation: avec les cinq datesTL des tessons des abris 1, 2 et 3 des sitesproches du Toukouchipan, situées autour de830 ± 120 AD, - avec les quatre des tessons dusite du sommet T1, autour de 970 ±120 AD, etles trois des tessons de l’abri 2 du TO autourde 870 ±150 AD.
Les tessons des abris du Toukouchipan, du T0et du T1 ont été collectés en 2004 par RenzoDuin, archéologue de l’expédition Kailawa,que je remercie ici (Duin, 2005). Quepouvons-nous en conclure?
Il pourrait s'agir d'occupations correspondant àdifférentes périodes si les estimationsd’ancienneté par TL sont validées, sinon ilfaudra rejeter les estimations d'ancienneté.
Dans les abris du Mitaraka, et l' Abri Daniel dela Borne 1, l’occupation ancienne est doncpeut-être antérieure de 4 ou 5 siècles au débutavant notre ère; elle paraît plus sûrementattestée autour des IX-XIIIe siècles.
● Conclusion
Dans le sud de la Guyane, des indicesanthropiques sont attestés lors du premiermillénaire de notre ère, avec une présenceimportante autour des IXe-XII e siècles, puisdes occupations plus ou moins importantes duXIVe jusqu’au début du XVIIIe siècle.
Cette conclusion est à mettre en relation avecle fait que, selon Rostain (1994 : 498),«d'importants bouleversements ont touché lelittoral des Guyanes vers 1100 - 1300 de notreère». En particulier, «les communautésKoriabo, qui ont quitté l'intérieur du Plateaudes Guyanes, descendent et occupent lesfleuves...». Le complexe Koriabo a étéreconnu en Guyane, par Rostain (dont nousrésumons ici les conclusions), sur des sitesfluviaux du Bas-Approuague et du HautMaroni, mais aussi sur des sites côtiers(Rostain, 1994: 455). Pour Rostain (1994:498), des «changements climatiques ont, enoutre, probablement provoqué des migrations,comme celles des populations Koriabo». Ilnote que «de 600 à 1100 après J.-C., un climat
extrêmement pluvieux et orageux sévissait enAmazonie, qui provoqua l'inondation desbasses terres tropicales».
Les occupations que nous avons repérées dansl'intérieur de la Guyane pourraient donc êtreliées à ce phénomène, les populations seréfugiant dans des zones moins touchées parles inondations, pour recréer de nouvellescommunautés qui développèrent de manièrepréférentielle des villages localisés sur lesberges des fleuves, ce qui en permettait lecontrôle.
Gérald MIGEON
BSR : Bilan scientifique régional, DRAC-SRA,Cayenne.
Duin 2005: DUIN (R.) - Ethno-archaeologicalreconnaissance in Wayana homeland; Report of theKailawa expedition in southwestern French Guyana.Rapport non publié. DRAC-SRA Guyane, Cayenne.
Mazière et Mazière 1992 : MAZIERE (G.) etMAZIERE (M.) - Maripasoula. Montagne couronnéede Yaou. BSR: 21-23.
1993a - Maripasoula. Saut Sonnelle. BSR: 21.
1993b - Lawa-Tampok. BSR 45-46.
1994a - Camopi-Trois Sauts. BSR: 15-17.
1994b - L’archéologie amérindienne en Guyane. Étatactuel de la recherche. BSPF 91 (4-5) : 333-341.
1996 - «L’archéologie amérindienne en Guyane. Étatactuel de la recherche». Pagara 1: 7-38.
1997 - «La recherche archéologique en Guyane». InMAZIERE (G.) et alii, L'archéologie en Guyane: 25-54.Editions APPAAG, Cayenne.
Mazière 1997: MAZIERE (G.) et alii, 1997,L'archéologie en Guyane. Editions APPAAG, Cayenne.
Mazière 1994: MAZIERE (M.) - Maripasoula. Lehaut-Marouini. BSR: 26-28.
1995a - Camopi. Roche Touatou. BSR : 13.
1995b - Camopi. Crique Inipi. BSR 14-15.
1995c - Maripasoula. Le Marouini. BSR: 17-20.
1995d - Maripasoula. Massif du Mitaraka. Borne 1.BSR: 21-24.
1995e - Prospection thématique. Les roches gravées.BSR: 59-62.
1996a - Maripasoula. La roche peinte de laMamilihpann. BSR: 15-16.
1996b - Maripasoula. Les roches gravées du Marouini.
32
REMIRE-MONTJOLY
Lotissement Prévôt
BSR: 17.
2008 - Art rupestre amérindien en Guyane française.Ibis Rouge Editions.
Migeon 2005: MIGEON (G.) - Rapport de sondages.Nouragues, Régina. DRAC-SRA Guyane, Cayenne.
2006a - Rapport de sondages. Abri Arca, Inselberg dela Trinité, Mana. DRAC-SRA Guyane, Cayenne.
2006b - L’occupation amérindienne ancienne de laGuyane, de l’holocène à la Conquête: état de la questionet données nouvelles. In L’histoire de la Guyane.Depuis les civilisations amérindiennes: 31-86. Actes duPremier Colloque Guyane: «Histoire et Mémoire»organisé par l’UAG, Cayenne (Guyane Française), 16-18 novembre 2005.
Nowacki-Breczewski et Puaux 1991a: NOVACKI-BRECZEWSKI (Ph.) et PUAUX (O.) - Sinnamary. La
montagne de la Trinité. BSR: 48-49.
1991b - «Crique Coeur Maroni (Guyane française)».Journal de la Société des Américanistes 77 : 173-176.
Rostain1994: ROSTAIN (S.) - L'occupationamérindienne ancienne du littoral de Guyane.Collection TDM 129, Editions de l'ORSTOM, Paris. 2vols. 948 p.
Sabatier 2005: SABATIER (D.) - Note concernant ladécouverte d’un site dans une cambrouze, Montsd’Arawa, commune de Maripasoula. SRA-DRACGuyane, Cayenne.
Tardy 1998: TARDY (Ch.) - Paléoincendies naturels,feux anthropiques et environnements forestiers deGuyane française du tardiglaciaire à l'holocène récent.Approches chronologique et anthracologique. Thèse dedoctorat, Montpellier II. 343 pages + annexes.
Précolombien/Colonial
Située sur la route des plages à Rémire-Montjoly, la zone à diagnostiquer est de 269404 m2 localisés dans un environnement richeen sites archéologiques. Le terrain se trouveplacé sur une zone intermédiaire, de formepiedmont, entre la mer et de fortes pentesmontagneuses. Une grande partie de la surfacese trouve en zone protégée par le conservatoiredu littoral et une autre partie du terrain estconstituée de zones constamment saturées eneau. Seule une surface de 110 000 m2 étaitaccessible, sur laquelle certains travauxd’aménagement avaient déjà commencé. Uneautre partie était occupée par des culturesmaraîchères «illégales». Face à cette situation,un total de 54 tranchées a pourtant été réaliséen 15 jours ouvrés. Deux zones évidentesd’occupation amérindienne avec fosses,matériel et trous de poteaux ont été mises aujour. Les tranchées voisines, négatives, ontmontré la faible étendue de ces indices. Une
troisième zone a révélé les restes d’unbâtiment du XVIIIe siècle interprété à ce jourcomme une «indigoterie». Sur cette dernièrezone, riche en vestiges, un fort potentielpatrimonial existe. Il s’agit de la premièreindigoterie découverte en Guyane.
Il apparaît que les sites amérindiens sont desoccupations très réduites, à la fois en surface eten quantité de matériel. Le site que l’onpouvait atteindre dans la zone du terrain desport, au abord du site 97 309 010 et de celuid’une occupation amérindienne avérée del’autre côté de la route qui longe l’actuelterrain de football ne s’est pas montré aussiprometteur que prévu. Néanmoins, le site del’indigoterie fait l’objet de fouilles, notammentpar Nathalie Cazelles et a généré denombreuses découvertes archéologiques ethistoriques.
Pierre TEXIER
33
REMIRE-MONTJOLY
Forge de LoyolaColonial
Cette opération concerne la fouille de la forgeprésumée de l’habitation jésuite de Loyola, quifut une exploitation de canne à sucre, puis decacao pendant près d’un siècle. Le site ad’ailleurs très vite attiré l’attention desarchéologues puisqu’il s’agit de la plus grandehabitation de Guyane: elle aurait en effetcompté jusqu’à 400 esclaves.
Suite aux fouille qui ont permis de mettre aujour un ensemble de bâtiments et de structures(maison de maître, chapelle, cimetière,magasin), ainsi qu’une collection d’élémentsde nature mobilière (céramique coloniale,tuiles, nombreux objets métalliques), uneapproche détaillées du mobilier métallique dusecteur de la forge doit nous conduire d’unepart à une meilleure connaissance destechniques de forge, de l’autre à évaluer lesbesoins d’une exploitation de canne à sucre duXVIII e siècle en outils et ustensiles divers.
Le sondage du bâtiment dit «ateliers» s’intègredans cette démarche mais surtout la précède.Dans un premier temps, il convenait deconfirmer que le diagnostic de forges’applique bien à ce bâtiment. Pour ce faire, ilnous a fallu tout d’abord identifier, parmi leszones non fouillées de l’espace intérieur, cellequi nous laisserait le plus de chances de mettreau jour des éléments attestant cette fonction.Ces «matériaux-guides» sont d’abord lesbattitures, petites parcelles de fer ou d’oxydede fer, que projette au sol, autour de l’enclume,le battage du fer effectué par le forgeron.Viennent ensuite les restes de combustibles(prélèvements de charbon pour anthracologie),ainsi que d’éventuelles traces de rubéfactiondu sol. Enfin, on peut espérer avoir la chancede recouper des infrastructures comme le bâtidu foyer.
En fouillant les zones découvertes parA.Chouinard en 1997, et particulièrement meradier de pierres, adossé au parement nord dumur de réfends du bâtiment, nous avons émis
l’hypothèse que le foyer pourrait se trouver del’autre côté dudit mur. Dans cetteconfiguration, la tuyère, qui fait la liaison entrele soufflet et le foyer passerait à travers le mur.
Plan des structures de la forge présumée. A.Chouinard, 1997.
Suite au défrichement de cette zone, nousavons trouvé trois murs extérieurs visiblesainsi que le mur central de refends qui ledivise en deux pièces. La pièce nord mesure9m de long sur 6m de large, et la pièce surmesure 7m de long sur 6m de large. Les solsde ces deux pièces présentent une différencede niveau de 0.70m environ, la pièce sud étantla plus basse.
Les murs, sud, épais de 0.65m pour unehauteur conservée allant jusqu’à 1m40 secomposent à 90% de grison. Le mur ouest estun peu plus épais (0.70m) et de mêmecomposition. Le mur de réfends est plusmince, 0.55m et se compose à 100% de grison,en blocs de 10 à 40 cm. Appuyé au murgouttereau oriental, il est interrompu au boutde 4m par la porte de communication entre lesdeux pièces.Nous avons aussi redégagé lastructure du radier de pierres le long du mur derefends dans la pièce nord afin d’y effectuerdes prélèvements. Ce radier mesure 2.30m delong pour 1.25m de large. Il se compose depierres plus ou moins arrondies, de 10 à 45cm, très grossièrement ajustées dans un liantterreux. Deux plages terreuses, à l’est et àl’ouest, pourraient correspondre à des ancrages
34
de structures en bois, mais on n’y remarquepas de pierres de calages particulières. Oncomprend mal pour cette structure unefonction de support du soufflet: celui-ci devraitse trouver orienté dans le sens de la longueurdu radier. Le radier ne s’explique pas non pluscomme foyer de forge, on n’y observe ni tracesde combustion ou de rubéfaction, ni de restesde combustible.
Une sole rubéfiée a été découverte dans lapièce sud de l’autre côté du mur de réfends.Une grande partie du mobilier métallique etcéramique reposait sur cette sole. L’hypothèsed’un foyer très surbaissé, peu au dessus du solde la pièce, non délimité par un carré depierres, peut être émise.
Plan des structures de la forge présumée. A.Chouinard, 1997.
Le sondage a fait apparaître une quantité assezimportante d’objets métalliques, retrouvés engrande majorité dans l’unité stratigraphiquesituée juste au dessus de la couched’occupation et de la sole rubéfiée. La plupartsont en fer, quelques-uns en plomb ou encuivre. Il s’agit d’objets finis (comme unrâteau), de chute de forge et d’objets semi-finis. A ce stade, il est difficile de faire desdéterminations plus précises, sachant qu’unepartie de ces objets va bénéficier d’unerestauration.
Dans l’emprise du sondage sont aussi apparuesdeux céramiques relativement entières, ainsique divers tessons isolés. La premièrecéramique est un pot d’assez grande dimensionsur lequel on peut remarquer des traces debrûlures. Il s’agit d’une céramique tournée àpâte rouge, vernissée au plomb, à dégraissantfait de grains de quartz. C’est une pièce
d’importation, sans doute en provenance deVallauris. La deuxième céramique est unepoterie amérindienne du XVIIIe siècle. Onremarque l’utilisation d’un dégraissant végétal,de la cendre mélangée à la terre lors dufaçonnage qui donne sa couleur noire à lacéramique et permet une meilleure tenue lorsdu séchage et de la cuisson. Le façonnage a étéréalisé au colombin.
Les décapages ont aussi livré des éléments debriques, mais celles-ci se sont trouvéesparticulièrement concentrées au-dessus de lasole rubéfiée. Nous partons donc del’hypothèse que ces briques représentent lesvestiges de la cheminée de la forge. Des tuilesont aussi été trouvées, sous la forme defragments plus ou moins grands. Nous avonspu identifier une tuile canal, ainsi qu’une tuileplate et rectangulaire.
Détail du mobilier dans les carrés 1M4 et 1M7.
Ainsi, cette opération a permis de clarifiercertaines hypothèses et de poser de nouvellesquestions. Le modèle pourtant attractif duradier comme support de soufflet peutdifficilement être consolidé: il n’est pas orientédans le bon sens, et le trou de la tuyère àtravers le mur n’a pas été révélé, même par unexamen détaillé des deux côtés de lamaçonnerie. La sole adossée contre le mur deréfends, dans la pièce adjacente, se trouve au
35
REMIRE-MONTJOLY
Quincy
moins 20 centimètres plus bas. Un souffletplacé dans le sens de la longueur du radier,animé par un ouvrier qui se tiendrait derrière,soutenu par des ancrages à l’emplacement desdeux «trous» repérés, et dirigé vers l’ouest,paraît tout aussi difficile à imaginer car lefoyer empièterait alors au-dessus des la«marche» de 70 cm qui sépare les deux pièces.Un autre modèle est donc de considérer, sousréserve, la sole rubéfiée comme un foyer deforge très fortement surbaissé, 55 cm
seulement au-dessus du sol de la pièce. Onnote aussi la présence d’un dépotoir contenantde nombreuses ferrures à une vingtaine demètres de ce bâtiment. En tout état de causecependant, ces diverses observationsconstituent de très forts arguments pourattribuer globalement à cette pièce sud lediagnostic de local d’une forge.
Pierre FLUCK
Colonial
L’habitation Loyola est située dans lacommune de Rémire-Montjoly en Guyanefrançaise. Elle a fait l’objet de fouillesarchéologiques programmées pendant plus dedix années. Parallèlement à ces travaux, denombreuses recherches ont été effectuées enarchives afin d’apporter des complémentsd’information aux découvertes de terrain. Auterme de nombreuses opérations, on constateque les résultats archéologiques obtenusrévèlent une chronologie constante: XVIIIe -XIX e siècles, alors que nous savons que lesjésuites se sont implantés en Guyane dès ladeuxième moitié du XVIIe siècle et qu’ils ontinvesti des terrains déjà mis en valeur par descolons français et hollandais qui les ontprécédés depuis 1654 au moins. Nous avonsdonc décidé de mener une opérationexploratoire sur les 1000 hectares de terrainsde Loyola pour tenter de retrouver des tracesde cette première période coloniale tout encomplétant l’inventaire des vestiges repérablesen surface
La carte de Dessingy, réalisée en 1771, montreLoyola peu après son abandon. Elle présenteun réseau de circulation très détaillé ainsi queles constructions de l’établissement avec sonquartier des esclaves, la poterie et enfin un«vieux moulin» sur la colline située en face del’habitation. Cette carte, très précise, coïncideà peu de choses près, avec les vestiges quenous avons retrouvés au cours de nosrecherches archéologiques. Pour les périodesantérieures, excepté les relevés d’arpentageremontant à 1740, nous ne disposons que dementions très vagues sur l’aspect de Loyola.Les fouilles, menées jusqu’à présent, n’avaienttoujours pas livré de matériel datant de la
36
deuxième moitié du XVIIe siècle. Cette lacunenous a incité à proposer plusieurs hypothèsescomme celle d’un autre emplacement pour lasucrerie et même pour la maison de maître.Plusieurs hypothèses restent ouvertes enl’absence de plans anciens comme celle d’unepremière sucrerie, construite ailleurs, sur lamontagne de Rémire en un lieu qui reste àrepérer. Si l’on emprunte le raisonnement deViviane Bigot qu’elle présente dans sonmémoire de maîtrise déposé en 2003-2004, ilse pourrait que la partie ancienne del’Habitation Loyola se trouve juste encontrebas du secteur principal que nousfouillons depuis 1994. Le terrain étudié a subid’importants aménagements résidentiels etagricoles au cours des cinquante dernièresannées et on peut conjecturer que bien desvestiges de Loyola ont été à jamais détruits.
Deux objectifs se dégageaient de laproblématique énoncée pour l’intervention de2006. Nous voulions tout d’abord localiser lapartie ancienne de l’Habitation et confirmer, àpartir de sondages limités, la présence demobilier permettant d’esquisser une datation.Puisque la méthode employée pour localiserces vestiges repose sur l’arpentage etl’implantation de layons dans unenvironnement de forêt secondaire, notredeuxième objectif était de localiser l’ancienréseau de circulation qui permettait de sedéplacer et de transporter les marchandises àpartir de l’habitation jusqu’à l’ancienneparoisse de Rémire sur la côte.
À partir de la problématique que nous venonsd’exposer nous nous sommes fixé les objectifssuivants:
–Localiser sur le terrain ce qui est indiqué surle plan-terrier de 1743 comme étant l’ancienemplacement des Révérends Pères Jésuites
–Compléter les relevés topographiques dusecteur de l’habitation situé en à l’intérieur descollines de Rémire afin de produire une cartegénérale de l’habitation
–Retracer le sentier ancien qui monte du côtéouest de l’habitation
–Localiser le dégrad utilisé pour le
transbordement des marchandises del’habitation
–Effectuer une reconnaissance du quartier desesclaves
–Explorer le secteur de l’anse de Rémire pourretrouver les anciennes limites de Loyola etrepérer l’indigoterie.
–Effectuer des reconnaissances de l’habitationde Beauregard (ancienne dépendance deLoyola) étant donné les menaces urbanistiquesqui affectent son site.
● Le nouveau site de Quincy
Nous avons découvert un grand mur, construitavec de gros blocs de roches, long d’unetrentaine de mètres et haut d’environ un mètre.Nous avons identifié ce vestige comme étantcelui du soubassement d’une terrasse.Effectivement, la partie sommitale du terraincontenue par le mur est plane et sembleconvenir à l’implantation de bâtiments.
Trois sondages de 1 x 1 m et un autre de 1 x 2m ont été effectués à différents endroits situésau pieds du mur de la terrasse. Du sud vers lenord, les sondages ont été numérotés de 1 à 4.Leur implantation a été décidée en fonctiond’indices de surface, essentiellement laprésence de tessons. Le couvert humique de lasurface a été enlevé jusqu’à un sol argileux quisemble correspondre à un niveau naturel. Lessondages ont été exécutés à la truelle et lessols n’ont pas été tamisés. Étant donné laminceur du dépôt et la grande activitébiologique dans cet environnement, le matérielrécolté a été enregistré dans un seul lot. Nousavons essentiellement faits des photos de nossondages car la stratigraphie des puits desondage ne recelait aucune information ayantpu être transmise par son relevé au dessin. Des relevés topographiques ont été faits pourrattacher sur un plan général ce secteur avec lapartie principale de l’habitation.
La partie basse du principal sentier empierréde Loyola, indiquait la direction d’un secteurque nous n’avions pas exploré jusqu’à présent.En suivant cette orientation nous avonstraversé un petit cours d’eau temporaire et
37
nous avons débouché, quelques dizaines demètres plus loin, sur un important alignementde grosses pierres formant un mur desoubassement de terrasse. Il est parallèle à unezone marécageuse.
Quincy : mur de soubassement de terrasse.
Ce mur de terrasse est constitué de très grosblocs dont certains font plus d’un mètre delongueur Deux à trois rangées de ces blocs endolérite sont empilées pour former unsoutènement d’environ 1m de hauteur. À sonextrémité ouest le mur tourne vers la colline etse prolonge sur une distance d’environ 17m,alors que du côté est, le mur se termineabruptement à un endroit où il nous semblequ’une rampe d’accès ait été aménagée. Il estvraisemblable que cette modificationanthropique pourrait très bien avoir eu pourfonction de recevoir un bâtiment.
Le ratissage de la surface se trouvant en bas dela terrasse a permis de découvrir deuxconcentrations de poterie sucrière avec dumobilier fort abondant gisant à la surface dusite. Trois sondages ont alors été ouverts; lepremier sondage mesurant 1x1m est situé entreles deux concentrations d céramiques, ledeuxième de la même dimension que lepremier est situé à deux mètres en bas du murde soutènement de la terrasse et enfin, untroisième plus à l’ouest mesure 1x2m. Unquatrième sondage, en bordure de la zonemarécageuse a été interrompu parce qu’ilsemblait stérile et trop affecté par la remontéedes eaux du marécage.
Ces sondages ont livré un total de 2 463fragments de céramiques. Ces tessons seretrouvaient surtout dans le sondage 1 et laplupart servaient à la production sucrière(formes à sucre et pots de raffineurs).Quelques objets décorés ont été trouvés lors de
la fouille ainsi qu’une pipe d’esclave.
Tous ces objets sont caractéristiques desproductions guyanaises de l’Ancien Régimecolonial et aucune production européenne n’aété trouvée dans cet espace de l’habitationLoyola. Cette courte description du matérieltrouvé lors de la reconnaissance du site Quincynous permet de poser quelques hypothèsesquant à la fonction de ce site. La grandequantité d’objets associés à la productionsucrière nous incite à penser que cet endroitpourrait avoir été un dépotoir associé soit àl’habitation Quincy ou à celle de Loyola. Eneffet, il est possible que le haut de la terrasse,au pied de laquelle les sondages ont étéeffectués, ait abrité les bâtiments associés àl’habitation de Quincy et que ces fragmentssoient des rebuts liés à la production de sucre.Par contre, il est aussi possible que ce dépotoirait été utilisé par les habitants de Loyola pourdisposer des rebuts de céramiques sucrières carces deux endroits sont assez près l’un del’autre. Ces fragments de poterie sont utilisésdans la maçonnerie des murs mais aussicomme matériaux de consolidation deschemins en terre. Ainsi, il est difficile detrancher entre ces deux hypothèses car lematériel ne présente pas de caractéristiques
38
diagnostiques permettant de le dater.
D’un autre côté, nous ne devons pas écarter lefait que ce site ait pu être le dépotoir d’unatelier de poterie à cause de la présence desbonnettes de cuisson. En effet, il est plutôtsurprenant de trouver ces objets à proximitéd’un site de production sucrière et non prèsd’un atelier de poterie. Il est probable que desfouilles plus extensives pourraient permettrede vérifier ces hypothèses. Seule la fouille dusommet de la terrasse du site de Quincypermettrait d’attester la présence de bâtiments.
● Relevés topographiques
Notre objectif était de compléter les relevéstopographiques du secteur de l’habitation situéà l’intérieur des collines de Rémire afin deréaliser une carte générale, la plus complètepossible de l’habitation et de ses dépendances.
Cet objectif a été en grande partie atteint et ilen résulte une carte qui permet maintenant dejoindre le secteur principal de l’habitationjusqu’au marécage qui sépare le quartier desesclaves. L’encombrement du sous-bois nous aempêché de couvrir l’Habitation Loyola aucomplet mais nous avons maintenant un lienentre le secteur principal et ce qui pourrait êtrela première maison des jésuites.
● Réseau de circulation
Malgré les indications d’une voie decirculation qui apparaissent sur le plan de1730, aucun effort n’avait été investi à ce jourpour retracer cette voie de circulation passantpar le col situé entre la Montagne à Colin et laMontagne des Jésuites et qui devait sans douteservir aux déplacements des marchandises etdes personnes jusqu’à la côte où se trouvait laparoisse de Rémire. Nous sommes partis de lamaison de maître pour suivre ce chemin creuxqui est encore très visible en maints endroits.Lorsque son tracé avait été effacé, ce qui est lecas sur des tronçons de quelques dizaines demètres, nous recherchions l’endroit qui noussemblait le plus adapté au passage descharrettes. Pour le relevé topographique de cesentier nous avons ouvert un layon de 3 m de
largeur au minimum. Les indices au sol étaientparfois très diffus, mais à certains endroits despierres semblaient avoir été déplacées.
● Le dégrad du Morne Coco
L’objectif de localiser le dégrad (débarcadère)utilisé pour le transport des denrées del’habitation avait pour but de retrouver,éventuellement, des traces de cetaménagement. Un dégrad est dans la plupartdes cas une simple berge défrichée maisparfois il peut être une sorte de quai construit.La poterie des jésuites n’avait pas un accèsdirect à un cours d’eau ayant suffisamment deprofondeur pour le transport de sa production.Le matériel devait être apporté comme toutesles denrées de l’habitation, jusqu’à la rivièreCabassou à un dégrad situé au bout d’unsentier figurant sur la carte de Dessingy(1771). Nous avons effectué unereconnaissance de la rive sud de partie hautede la rivière Cabassou, Nous avionsl’indication précieuse que ce dégrad se trouvaitau pied du Morne du Courbaril, aujourd’huiMorne Coco.
Malheureusement, les nombreuxbouleversements du terrain causés par laconstruction de la route du Morne Coco ainsique les travaux effectués il y a quelquesannées pour la construction des bassins derétention de l’usine de traitement des eauxusées ont profondément modifié voire détruitla plupart des indices auxquels nous aurions punous attendre. La reconnaissance de ce secteurde l’habitation des jésuites fut suspendue aprèsune journée de travail faute de découvrir desindices probants.
● Le quartier des esclaves
Notre objectif était de faire unereconnaissance, la plus complète possible duquartier des esclaves de Loyola, situé enbordure de la route de Rémire
Reconnu depuis 1994, ce site n’avait jamaisfait l’objet de reconnaissances systématiquesde notre part. Ce secteur a été en grande partieremanié par des engins de terrassement pour
39
les travaux de la route et un projet delotissement; il est malheureusement utilisécomme décharge sauvage depuis de trèsnombreuses années. Selon les analyses de lacartographie ancienne de l’habitation parGeorges Lemaire (comm. pers. 15 juillet2006), le quartier des esclaves se situerait dansla zone légèrement surélevé au nord la zonemarécageuse située au pied de la pente doucequi descend du secteur principal del’habitation et en partie sous la route que nousutilisons pour nous rendre de Rémire àMontjoly. Cette hypothèse s’appuie nonseulement sur la cartographie disponible pourl’habitation mais aussi à partir decomparaisons que nous faisons avec desgravures d’habitations contemporaines dansles Îles et au Brésil. Le quartier des esclaves sesitue toujours en contrebas de la maison demaître et bien à sa vue. On peut supposer quele secteur à l’étude devait non seulementrecevoir les cases mais aussi de petits lopins deterre cultivés par les esclaves.
Nos reconnaissances visuelles aidées de layonsà travers une forêt secondaire encombrée debambous ont permis de repérer des grossespierres plus ou moins taillées mais dans tousles cas rapportées sur ce terrain qui est unancien chenier (dune de sable consolidée).Nous pensons que ces grosses roches servaientde soubassement à des cases en bois mais nousn’avons pas été en mesure d’identifier desstructures. Seul un débroussaillage intense duterrain suivi d’un décapage superficiel et lerelevé systématique de toutes les pierrespermettrait sans doute de distinguer uneorganisation de ces indices. Ce travail, commela fouille de ce quartier reste à faire.
● Les ruisseaux de Quennevautet de Rémire
Notre objectif était la reconnaissance visuellede l’anse de Rémire pour retrouver des indicesd’aménagements et les limites de l’habitationLoyola côté mer.
Le secteur de la Route des plages a fait l’objetde reconnaissances visuelles ayant pour but delocaliser des vestiges associés à l’habitation
des jésuites. La reconnaissance de l’indigoteriede Loyola figurait au premier plan de nospréoccupations Elle est documentée par lestextes et figure sur la carte annexée au dossierde Billy (1753). Éloignée de l’établissementprincipal à cause des mauvaises odeurs quecette activité engendrait, les bassins à indigoétaient placés sur la rive gauche du ruisseau deRémire. Les broussailles ne nous ont paspermis de parcourir le site concerné par noshypothèses. Il ne sera découvert que quelquesmois plus tard grâce au défrichement duterrain pour la construction d’un lotissement.Malgré des bouleversements majeurs dus à laconstruction de la route actuelle et laconstruction de demeures en bordure de lamer, nous avons eu la satisfaction d’identifierles repères topographiques que nousrecherchions. Les ruisseaux de Quennevaut etla rivière Rémire sont encore bien visiblesmais les tracés de ces cours d’eau semblentavoir été grandement influencés tant par desactions anthropiques que par le changementnaturel de la ligne de rivage. L’embouchure duruisseau de Quennevaut a été très clairementlocalisée sur la plage de l’anse de Rémire.Cette découverte nous permet d’établir avecsûreté la limite nord de Loyola. Ce petit coursd’eau occupe une grande place dans les débutsde l’histoire coloniale de ce secteur (1652-1667). C’est en effet au bord de ce ruisseauque se sont installés les premiers colons deRémire.
Nous avons également retrouvé lesaffleurements rocheux, aujourd’hui recouvertsà marée haute, qui supportaient le forthollandais de 1654 (fort des Juifs ou desFlamands)
● L’habitation de Beauregard
Notre objectif était d’effectuer unereconnaissance de l’habitation de Beauregard,ancienne dépendance de Loyola, affectée parle développement résidentiel de ce secteur. Cetobjectif n’a pu être atteint faute de temps pournégocier un accès aux terrains.
Réginald AUGER
40
SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK
Liaison entre le bourg et le futur pont Précolombien
La Direction Départementale de l'Équipementde la Guyane est en phase de préparation d’unprojet routier entre la commune de SaintGeorges de l’Oyapock et la Pointe Morne.Cette dernière zone, doit servir de pointd’encrage et d’appui lors de la constructiond’un pont international entre la GuyaneFrançaise et le Brésil. Le choix du tracédéfinitif de la route n’est pas encoredéfinitivement arrêté dans sa partie inférieure.Trois projets ou «variantes», sont actuellementen cours d’étude dans un secteur qui va de StGeorges à la Pointe Blondin. Les sites connussont nombreux si l’on se réfère aux données dela carte archéologique du Service Régional del’Archéologie Guyane. Au total entre 1989 et1997, 14 sites ont été enregistrés entre SaintGeorges et la Pointe Morne dans la zone quinous intéresse. Cette opération de 2006 aurasurtout mis en évidence dans la zoneprospectée la prédominance des sitesamérindiens sur les sites coloniaux oumodernes. La cartographie ancienne et lesprécédentes opérations, montraient a priori uneimplantation préférentielle des occupationscoloniales, et dans une moindre mesureamérindiennes, sur les berges basses noninondables. La prospection 2006 quant à elle,traduit une concentration des sites amérindienssur les berges hautes jouxtant directementl’Oyapock. Au total trois sites amérindiens deplein air, dont deux présentant des fossés, ontété localisés sur le tracé direct de la pisteforestière. Une quatrième occupation a étédécouverte sur une hauteur en berge du fleuveOyapock. Deux indices coloniaux oumodernes ont aussi été découverts à proximitédu layon piéton. Le premier site à fossépériphérique (97308 224), est localisé sur lesommet du morne de la Pointe Blondin. Lesommet culmine à près de 60 mètresd’altitude. Il s’agit du point le plus haut que
l’on peut observer depuis le fleuve, entre SaintGeorges et la Pointe Morne. Le fossé suit enpartie le tracé naturel d’une courbe de niveauet se referme à l’ouest sur une partie plane duplateau. Il délimite ainsi une enceinte ovalaired’une surface de près de deux hectares. Lefossé apparaît peu marqué dans le paysagemais précède systématiquement un talusinterne constitué par un remblai issu ducreusement. La position élevée, et le largechamp de vision sur les méandres du fleuve,donne au site un avantage stratégiqueindéniable. Depuis l’extrémité sud-ouest dusite, il est possible d’observer en enfilade laPointe Morne et la ville brésilienned’Oyapoque. Le site à fossé 97.308.229s’intercale entre deux plateaux où s’implantentdeux occupations amérindiennesdiachroniques. Il s’agit d’une structurerectiligne de 8 m de large pour 25 m de long,encore très nettement marquée dans lepaysage. Le mobilier céramique du site97.308.230 de la Pointe Morne, présente lescaractéristiques du complexe culturel Koriabo,qui a été reconnu en 1960 au Guyana par C.Evans et B. Meggers, et identifié pour lapremière fois en Guyane Française en 1976par F. Bubberman. Le site 97.308.228 présentepeu d’éléments discriminants, un bord présenteun appliqué anthropo-zoomorphe pouvantsymboliser un batracien aux membres écartés.Ces éléments peuvent être présents dans lecomplexe culturel Koriabo mais sont surtoutreprésentés dans le complexe culturel Aristéreconnu en 1957 par B. Meggers et C. Evansdans l’état d’Amapà au Brésil. Lesimplantations humaines anciennes découverteslors de cette opération semblent doncs’appuyer principalement sur le relief etl’hydrographie. Ce critère semble être unedonnée particulièrement importante dans lechoix d’implantation des deux sites à fossés.
41
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Plateau des Mines
Cette prospection pédestre puis mécanique,même si elle a du se limiter à certaines zonessuite à des contraintes mentionnées parl’aménageur très tardivement au cours del’opération de terrain, a permis de mettre enévidence des sites pour lesquels nombre dequestion restent en suspend quand à leur
chronologie, leur finalité, leur extension, leurdispersion spatiale. Les résultats obtenus sonttrès prometteurs et suggèrent une bonneconservation des sites.
Mickaël MESTRE
Précolombien
Cette opération fait suite à un diagnosticarchéologique réalisé sur la liaison routièreentre Saint-Laurent du Maroni et Apatou(Inrap 2004). Le plateau des Mines se trouve àenviron 12 km au sud de St-Laurent du Maronidans le nord-ouest de la Guyane française. Lessols sont composés par des sables grossiers detype «podzols géants» qui comptent parmi lesplus spectaculaires podzols tropicaux dumonde. Le site archéologique quant à lui estcaractérisé par une occupation composéeuniquement d’objets lithiques mais aussid’amas de galets de quartz constitués depierres chauffées et de charbons de boisdisposés sur un même niveau homogène. Ils’agit d’une occupation précéramique (lapremière mise au jour en Guyane) situéechronologiquement à 5200 BC par une série dedatations par AMS replaçant ainsi ce siteparmi les plus anciens connus à ce jour sur lePlateau des Guyanes. Les vestiges sont enfouisentre 80 et 110 cm de profondeur sur labordure du plateau à la jonction des sables«jaunes» et «blancs». L’observationstratigraphique ne permet pas de distinguerune couche archéologique. La découverte deplusieurs indices dispersés sur l’aire du plateausemble montrer une occupation intensive de latotalité des bords méridionaux de celui-ci. Ilest probable que des occupationsdiachroniques ou synchroniques, du mêmetype, restent encore à localiser dans ce vasteensemble. Le site présente de nombreusesstructures de galets associées à du débitage etdes outils. Une association évidente entre ces
trois unités [amas / débitage / outils] a étéétablie sans que des zones d’activitéspréférentielles aient été démontrées. Seules desalternances d’espaces avec ou sans mobilier(et/ou amas) ont été repérées, à l’intérieur de lazone de fouille comme entre les sondages. Lacomparaison de l’organisation spatiale dumobilier de deux sondages réalisés lors de lafouille et du diagnostic (Tr 1, PdM1 ; Tr 10,PdM2), semble confirmer la connexion entredeux des trois opérations réaliséessuccessivement sur le Plateau des Mines(PdM1 et PdM2). On a pu aussi observer uneprédominance des activités de débitage, étantdonné le nombre très inférieur d’outils parrapport aux éclats, cassons et nucléus trouvéslors de la fouille. L’exploitation quasiexclusive du quartz et la très faiblereprésentativité des autres matières premièress’expliquent sans doute par la proximité defilons dans les collines et criques avoisinantes.On notera que l’exploitation préférentielled’un type de matière première est communeaux trois occupations du Plateau. En ce quiconcerne les structures, une nouvelle typologiea été proposée, avec l’apparition deconcentrations à «effet de paroi», de grandesdimensions et très fragmentées qui sedistinguent des grands amas circulaires de laCarrière des Ananas ou des petits amasirréguliers de PdM1. La seule étudetypologique du mobilier ou des structures duPlateau des Mines apporte son lot d’élémentsde compréhension mais n’est pas en mesure derépondre à toutes les questions posées par le
42
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Saut Saillat
site archéologique replacé à l’échellechronologique régionale. Les résultatsmontrent que les populations amérindiennesont surtout fait preuve d’opportunisme dansleur industrie lithique et les différents outilstémoignent de fait d’une exploitation intensivedu milieu et des ressources. Selon toutehypothèse, la période dite «archaïque» enAmazonie semble voir l’éclosion d’une sériede changements comportementaux despopulations qui pourraient être induits par lamise en place de différents écosystèmes à lafaveur d’incidents climatiques. La difficultéréside surtout dans l’approche spatiale du siteet l’interprétation de la dispersion des amas enrelation avec cette industrie lithique. Plusieursaires d’activités semblent s’organiser sans que
l’on puisse pour autant établir une chronologierelative entre ces divers aménagements endehors des datations absolues. D’après nosobservations nous ne sommes pas en mesurede dire si ces structures sont interdépendantesles unes des autres. Ceci dit, il nous sembleque certains facteurs inhérents au site doiventêtre impérativement réexaminés par le biais dedisciplines connexes (tracéologie, pédologie,géomorphologie, anthracologie…) avantd’aller plus loin dans l’interprétation desvestiges. Les opérations futures sur ce type desite ne peuvent être envisagées que par le biaisd’études pluridisciplinaires qui permettront deprogresser dans la connaissance etl’interprétation de ces implantations.
Mickaël MESTRE
Précolombien
Le site de Saut Saillat, localisé au premier sautde la crique Serpent, a été découvert en 2003lors d’une opération de diagnosticarchéologique menée sur le tracé de la routedevant désenclaver la commune d’Apatou etles villages installés le long du bas Maroni.L’existence d’un atelier de polissage surl’émergence rocheuse du saut, connue etrépertoriée sur la carte archéologique de lacommune de Saint-Laurent-du-Maroni,permettait toutefois de présumer de l’ancienneoccupation de ce secteur.
L’opération de diagnostic a porté sur les deuxrives de la cirque Serpent. La rive droiteprésentait en surface les rejets récents d’unancien campement militaire s’étendant surenviron 700m2, les deux tranchéesexploratoires réalisées à cet emplacementn’ayant livré que les vestiges de cetteoccupation récente. En rive gauche, ledéboisement d’une petite zone à hauteur dusaut favorisa la localisation d’un gisement enprospection pédestre, la présence en surface de
matériel contemporain et amérindien laissantprésager d’une occupation multiple etdiachronique. Au regard du potentielarchéologique, une fouille a été prescrite par leService Régional d’Archéologie (Arrêté deprescription n°160 du 2 février 2005). Elle aété réalisée entre août et septembre 2006 sur lapartie du site située en bordure de route etmenacée par l’aménagement d’une aire destationnement.
La fouille a permis de mieux circonscrire cesdeux installations bien que les vestiges,notamment architecturaux, soient restésrelativement fugaces et disparates.L’occupation contemporaine du site,positionnées juste au-dessus du saut enbordure de rivière, n’a laissé que très peu detraces. Le faible enfouissement desinfrastructures architecturales ne laissait parailleurs apparaître aucune volonté de réaliserune structure pérenne et on peut dès lorssupposer que la structure d’habitation édifiéesur le site était relativement sommaire et n’aété occupée que sur une courte durée, la
43
SAINT-LAURENT-DU-MARONI
et APATOU
Crique Sparouine
modicité des rejets mis au jour sur le siteplaidant aussi en ce sens. Cette occupationpourrait éventuellement être reliée à uneactivité d’orpaillage, qui n’a d’ailleurs puconsister qu’en une simple évaluation de lateneur en or des sédiments au niveau dupremier saut de la crique par quelquesbricoleurs. Il est impossible de déterminer trèsprécisément la période durant laquelle le site aété occupé, mais l’on peut estimer, d’après lestémoins matériels retrouvés lors de la fouille,qu’elle correspond à un laps de temps moinslong, sis entre 1900 et 1915.
La répartition des infrastructures attribuées à lapériode précolombienne n’a fournit que trèspeu de données sur l’occupation spatiale ducite, l’emprise de la fouille étant trèsclairement localisée à la périphérie nord de lazone d’implantation précolombienne initiale.Les rares infrastructures architecturales misesau jour ne permettent pas de dresser encore deplan d’habitation, ni encore moins detypologie bien définie des structures. On nepeut que constater la proximité entre un espacedomestique et un espace de rejet assez peuétendu, qui fonctionnaient de pair commepeuvent en témoigner les datationsradiocarbones obtenues sur le site. Lesmarqueurs matériels étaient plus pertinents etl’analyse de la céramique a permis de
reconstituer un registre typologique singulier.L’examen de routine du mobilier lors de lafouille n’avait retenu que quelques élémentsremarquables pour affilier cet assemblage à laproduction de l’horizon Koriabo. Mais lesdivergences morphologiques, la très faiblereprésentation des composantes décoratives lesplus prégnantes de cet ensemble archéologiqueet la composition très homogène de la pâteapportent un éclairage un peu différent. Ilapparaît, en effet, que la production potière dusite, même si elle semble dériver de celle del’horizon Koriabo, possède descaractéristiques propres, qui la différencie entous cas des séries céramiques collectées surles sites ayant fait l’objet de fouillesarchéologiques concrètes (BPS 230,Sparouine). Les datations obtenues sontégalement assez récentes puisqu’elles sont à lamarge supérieure de la période de pré-contact,l’occupation la plus probable de Saut Saillatpouvant être circonscrite entre 1445 et 1510.On peut dès lors supposer que la productioncéramique Koriabo observée à Saut Saillatcorrespond à une phase locale que l’on ne peutencore ni expliquer, ni clairement circonscrireen l’absence d’autres références du mêmetype.
Matthieu HILDEBRAND
Précolombien
Le site de Crique Sparouine a été découvert en2003 lors d’une prospection pédestre sur lefutur tracé de la RN3 allant de Saint-Laurentdu Maroni à Apatou. Le site se localise sur unméplat rectangulaire qui culmine à 40 m NGGavec une surface sommitale d’environ 7000m².La cuirasse latéritique affleure au sommet etelle est couverte d’une petite «cambrouse». Undécapage de 2 002m² a été réalisé en secteursde 8 x 20 m, tout en respectant un carroyage
de ramassage de 4 x 4 m. La couchearchéologique, d’environ 20 cm d’épaisseur, alivré du mobilier céramique et lithique ainsique des dépôts céramiques en place. Deuxzones de dépotoirs (mobilier lithique etcéramique) ont été observées : un dépotoirprincipal au nord du décapage archéologiqueet un deuxième dans la zone sud.
Un total de plus de 300 structures en creux a
44
SAÜL
Quartz ouverts au feu
été mis au jour, dont 177 trous de poteauxconstituant probablement trois zones d’habitat,23 fosses dont 11 avec de la céramique envrac, et 12 avec des vases entiers. Cesdernières structures sont interprétées pourl’instant comme des sépultures : il s’agit dehuit fosses ovoïdes (à inhumation?) avec un oudeux vases entiers, de deux petites fosses avecdes vases en dépôt, et de deux grandes fossescontenant chacune une grande jatte encéramique enterrée avec d’autres vasescomplets à l’intérieur. La répartition desstructures et des dépotoirs indique clairementun site d’habitat. Quatre datations AMS surdes charbons provenant des structures ontmontré que l’occupation de ce site s’étale de lafin du Xe siècle à la fin du XIVe siècle de notreère.
Le mobilier céramique le plus caractéristiqueest attribué au complexe Koriabo. Lacéramique décorée est définie par des jattesflorales à lèvre polylobée avec un engobeblanc à l’intérieur, ainsi que des pots toriques
avec des incisions ou des raclagesgéométriques et curvilignes. D’autres élémentsdéterminants concernent les jattes simplesouvertes à bord sinueux et les naviformes avecde l’engobe rouge uniforme à l’intérieur. Cesderniers éléments ne sont pas encore attribuésà un cadre chrono culturel.
La fouille préventive du site Crique Sparouinea permis d’observer une répartition spatiale destructures en creux avec des dépôts de poteriesentières. Ces données sont récurrentes pour lessites amérindiens en Guyane française.Cependant une telle répartition spatiale destructures sur un petit méplat permet de poserde nouvelles questions sur l’installation depopulations dans ce type de contexte surl’intérieur du territoire dès le Xe siècle. Deplus, une partie du corpus céramique a étéattribué au complexe Koriabo et ouvre denouvelles pistes de recherche concernant lesorigines de cette culture céramique guyanaise.
Martijn VAN DEN BEL
Précolombien
L'utilisation jusqu'à des dates récentes de latechnique de creusement au feu, déjà mise enévidence par ailleurs dans les îles des Antillesces dernières années pour des terrassementsprivés, publics ou agricoles, a également étérencontrée en Guyane centrale dans la régionisolée de Saül dans le secteur de la Montagnede Boeuf Mort, pour l'exploitation de l'or natifen place dans le quartz filonien.
La technique a été pratiquée par les orpailleurscréoles de façon artisanale jusque dans lesannées 90 mais également très récemmentdans quelques sites d'extraction semi-industriels de la Haute Mana pour réduire lataille des «boulders» de quartz afin depermettre leur passage au concasseur.Elle est encore pratiquée à l'heure actuelle par
les nombreux mineurs clandestins brésiliensprésents dans ces secteurs. La démarche a été amorcée en 2006 avec lamise en évidence de cette survivance récente,des rencontres avec les derniers acteurs créolesde la technique, la recherche des sitesd'extraction et la réalisation de feuxexpérimentaux sur ces sites mêmes.
Les techniques de conduite des feux ont étédétaillées et consistent pour l'essentiel dans lamise en place de bûchers sur des blocs isolésou des massifs quartzeux qui seront souventabandonnés durant leur combustion jusqu'aulendemain, avec ou sans aspersion d'eau selonles habitudes des mineurs mais aussi selon laplus ou moins grande proximité de laressource en eau.
45
Des dispositifs de collecte de l'eau de pluie pardes bâches et des bidons auraient existé sur lessites et de l'eau était parfois amenée à dosd'homme sur le site.Les bûchers sont composés de bois vert abattusur place avec allumage à «l'encens» ou bienparfois au pétrole.Dans les exploitations semi-industrielles, lesblocs de quartz extraits à la pelle mécaniquesont accumulés dans une fosse et couvert debois, sans aspersion d'eau afin d'éviterl'accumulation de boue dans la fosse, puis avecune combustion de plusieurs heures.
Le traitement minéralurgique du quartzaurifère des chantiers créoles s'effectuait leplus souvent après retour au carbet avecbroyage par percussion centrale dans des«pilons» individuels coniques creusés dans lesol à l'aide d'un «manche» métallique engénéral de récupération, puis traitementclassique à la batée avec amalgamation. Lenettoyage soigneux du sable aurifère ainsibroyé et son lavage dans une crique voisineconduisent à l'absence complète de traces deminerai sur le site de traitement du minerai quipourrait paraître paradoxale dans une premièreapproche.
«Pilon» de broyage du quartz aurifère abattu au feu à Saül.
De nouveaux feux expérimentaux ont étéréalisés sur les filons ou les blocs isolés du sitede Boeuf Mort, afin d'améliorer laconnaissance de la technique et des problèmesque sa pratique pouvait poser, d'analyser lesconditions physiques qui permettent d'obtenir
l'éclatement de la roche et de continuer àpréciser l'allure des surfaces laissées par letravail au feu comme celle des produits abattusà l'issue de l'emploi de cette technique.
Feu expérimental sur un bloc de quartz isolé, montagne de BoeufMort, Saül.
En particulier, une première approche del'impact de l'aspersion d'eau sur les feux a étéréalisée.
Produits abattus par le feu sur le bloc de la figure ci-dessus.
La difficulté de réaliser des feux en saison despluies a été mise en évidence et il est alorsapparu que si nécessaire les feux recevaientune couverture pour les protéger de la pluie,avec la mise en place de bâches ou bien detôles, notamment pour éviter que le bois ne
46
soit trop mouillé ou que le feu ait du mal àdémarrer. La température des foyers s'établitentre 300 et 400 °C pour leur partie centralemais arrive rapidement à 500°C pour la partiesupérieure des flammes; il a pu être établi queles éclatements de la roche («étonnements»des auteurs miniers) interviennent au dessus de350° C environ et qu'un écart de températurede 100° C au moins existe entre la surfacechauffée et le plan de fracture induit par lachauffe.
Feu expérimental sur un massif de quartz, montagne de Boeuf Mort,Saül.
Le mécanisme est reconsidéré en terme dedilatation du matériau et en fonction despossibilités mécaniques et spatiales quipermettent à cette dilatation de s'exercer.On observe ainsi très rapidement la productiond'éclats de quartz très plats, dés que lesflammes lèchent la paroi de quartz, et quicommencent à apparaître à la partie supérieuredu feu. Ces éclats se produisent ensuite plus enprofondeur dans le feu mais ne constituent pasglobalement un très fort pourcentage pondéraldans les produits abattus, car il ne seproduisent que rarement de façon superposéesur la surface brûlée. Ce type d'éclat trèscaractéristique par son très fort coefficientd'aplatissement ne peut être produit par desphénomènes naturels; il est interprété commele produit d'une dilatation rapide de la massede quartz avec apparition d'une fracturelorsque une différence de température de 100°C est atteinte rapidement entre la surface dubloc et la surface de propagation du front dechaleur dans le quartz.
Éclatement d'un panneau de quartz pendant le feu de la figure ci-contre.
D'autres fractures apparaissent plus tard aucours de la combustion, avec la progressionlente du front de chaleur; ces fractures peuventconduire à des panneaux de quartz de plusforte taille complètement désolidarisés du blocou nécessitant, après refroidissement, l'emploid'une masse pour achever de les détacher.L'emploi de la masse ne parvient pas ici àcréer des fractures nouvelles vu le caractèrecompact du matériau mais permet de profiterdes fractures provoquées par le feu. Ceséléments, moins spectaculaires, constituent leplus fort pourcentage pondéral et consistent endes blocs de taille variable (de quelquescentaines de grammes à plus de 20 kg); ce typed'éclats, dans l'ensemble allongés et nettementplus épais que les éclats de la première phase,comporte de façon systématique une section entriangle aigu également tout à faitcaractéristique.
La question de l'aspersion d'eau des feux et deson efficacité commence à être examinée;évidente pour de nombreux opérateurs, ellesemble en laisser d'autres perplexes, mais lesentiment général est celui d'une meilleurerentabilité des feux avec une aspersion d'eau,telle que nous l'avons déjà mis en évidencepour des opérations de terrassement rocheuxdans les Petites Antilles.Il a ainsi pu être produit expérimentalement,par aspersion avec de faibles quantités d'eaupour le moment, des éclats aplatis identiques àceux de la première phase.
47
Enfin, le quartz apparaît comme un matériautrès sensible à la rubéfaction sous l'effet du feuavec apparition d'une couleur rougeâtred'allure réticulée qui matérialise desdiscontinuités du quartz qui n'étaient pasvisible avant la chauffe; cette rubéfactionn'apparaît que sur les éclats de la premièrephase et très peu sur ceux de la seconde phase.Il semble qu'elle ne soit pas présente sur éclatsobtenus par aspersion d'eau.
Ainsi, il apparaît que le fonctionnement desfeux présente deux phases, avec une phase deproduction d'éclats plats immédiate très peuintéressante sur le plan du volume de quartzabattu, puis un travail plus long, qui nécessitela propagation en profondeur du front dechaleur et conduit à l'apparition de fracturesdans la masse du quartz avec productiond'éclats plus importants et de blocs.Ainsi, l'étude des surfaces laissées par letravail au feu dans le quartz et la conduite desfeux expérimentaux menés sur placepermettent de préciser l'allure des fronts dequartz massif soumis à l'action du feu enfonction de la géométrie du milieu (bloc isolé,tas de blocs, front vertical ou horizontal,milieu ouvert ou confiné, etc.), celle desproduits obtenus et du diaclasagecaractéristique induit par la fracturationthermique.
Bloc de quartz brûlé au feu (actuel).
Le travail au feu se traduit ainsi par desmorphologies arrondies convexes sur les blocsde quartz isolés correspondant aux éclats de lapremière phase, puis par l'apparition d'unefracturation en «Y» typique, qui correspond àla production des éclats de section triangulaire.
Sur des blocs de quartz isolés, il apparaîtd'abord une morphologie arrondie résultant del'écaillage de la première phase, puis unerupture totale ou partielle du bloc par lesfissures en «Y».
Bloc de quartz brûlé au feu (actuel) ; noter la fracturation thermiqueen «Y».
Sur des fronts de quartz massif, cettefracturation conduit à l'apparition de figures enmarches d'escalier inversées caractéristiques(dièdres successifs d'axes sub-horizontaux);enfin, avec l'enfoncement des travaux dans lesol apparaissent des amorces de galeries avecdes figures arrondies concaves telles que nousles connaissons de façon classique dans lestravaux miniers souterrains européens. Lesproduits abattus consistent principalement endes écailles au très fort coefficientd'aplatissement et en de petits blocs avec unesection en triangle aigu.
L'ensemble de ces travaux permet à présent deproposer des clés d'identification de la surfaced'un massif rocheux ou de la morphologie deséléments rocheux d'un remblai pour permettrede préciser si il s'agit d'un site ayant été lesiège d'un travail par le feu, ces donnéesprésentant un caractère a priori indépendant del'époque où ce creusement a pu être réalisé.Ainsi, la technique du feu apparaît encoreaujourd'hui comme une technique compétitiveà une échelle artisanale dans les conditionsd'isolement de la forêt amazonienne, en évitantnotamment, outre un long travail de forationnon mécanique, la dispersion des produitsabattus, en permettant la fragmentation duquartz massif à des efforts moindres que la
48
percussion à la masse ou au travail à l'explosif,ou encore en permettant une réductionéconomique de la granulométrie des produitsobtenus lors de l'extraction.De plus, la question de sa possible applicationpour un éventuel emploi dans la productiondes préformes de haches amérindiennes àpartir de roches tenaces doit être à présent
examinée.Pierre ROSTAN
Rostan, 2007: ROSTAN (P.) - Exploitationcontemporaine du quartz aurifère par le feu à Saül,Guyane française. Actes du Colloque Agricola,Annaberg (Allemagne) pp.311-325.
49
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Liste des auteurs
AUGER Réginald, Université de Laval, Québec
FLUCK Pierre , professeur, Université de Haute-Alsace
GASSIES Éric, ingénieur d'études, SRA Guyane
HILDEBRAND Matthieu , INRAP Guyane
MESTRE Mickaël , INRAP Guyane
MIGEON Gérald , conservateur régional d'archéologie, SRA Guyane
ROSTAN Pierre, géologue, bureau d'études géologiques Téthys, Alpes-de-Haute-Provence
TEXIER Pierre , INRAP
VAN DEN BEL Martijn , INRAP Guyane
50
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Abréviations utilisées dans le texte et la bibliogr aphie
AEX : Autorisation d'exploitation (minière)AGAE : Association guyanaise d’archéologie et d’ethnologieAFAN : Association pour les fouilles archéologiques nationalesARUAG : Agence régionale d’urbanisme et d’aménagement de la GuyaneBRGM : Bureau des recherches géologiques et minièresBSR : Bilan scientifique régionalCNRA :Conseil national de la recherche archéologiqueCNRS : Centre national de la recherche scientifiqueDAF : Direction de l’agriculture et de la forêtDFS : Document final de synthèseDIREN : Direction régionale de l’environnementDMF : Direction des musées de FranceDRAC : Direction régionale des affaires culturellesDRACAR : « Direction Régionale des Affaires Culturelles et d’ARchéologie », la base de donnéesnationale pour l’inventaire des sites archéologiques et leur gestionDRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnementENGREF : École nationale du génie rural des eaux et des forêtsEPAG : Établissement public d’aménagement de la GuyaneIGN : Institut géographique nationalIRD : Institut de recherche et de développement (ex Orstom)LAIOS : Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales (CNRS)MNHN : Muséum national d’histoire naturelleONE : Office national des forêtsPATRIARCHE : « PATrimoine ARCHEologique » la dernière version informatisée de cartearchéologique nationale de la France livré en 2002PER : Permis d'exploration (minierPEX : permis d'exploitation (minier)PLU : Plan local d'urbanismePRES : Pôle de recherche et d'enseignement supérieurSCOT : Schéma de cohérence territorialeSRA : Service régional de l’archéologieSDA : Sous-direction de l’archéologieSIG : Système d’information géographiqueUMR : Unité mixte de recherche (CNRS)UPR : Unité propre de recherche (CNRS)
51
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Abréviations utilisées dans les tableaux
Rattachement
AFA : AFAN
ASS : autre association
AUT: autre
BEN : bénévole
CNR : CNRS
COL : collectivité territoriale
INRAP : institut national de recherches archéologiques préventives
SDA : sous-direction de l’archéologie
SUP : enseignement supérieur
Chronologie
PCA : pré-contact européen, a-céramique
PCC : pré-contact européen, avec céramique
MO : époque moderne (XVe - XVIII e s.)
MOA : époque moderne sans mobilier européen
CON : époque contemporaine (XIXe-XX e s.)
IND : époque indéterminée
TTE : toutes époques
Nature de l’opération
FP : fouille programmée (fouille répondant à une problématique scientifique seulement, hors notiond’urgence)
FPA : fouille programmée bénéficiant d’une autorisation annuelle
FPP : fouille programmée bénéficiant d’une autorisation pluriannuelle
SP : fouille préventive (fouille archéologique préventive sur des sites dont l’intégrité estpartiellement ou totalement menacée, quelle que soit la nature de la menace)
EV : fouille d’évaluation archéologique (toutes opérations d’archéologie préventive réalisées lorsde la phase d’étude préalable et, de façon plus générale, toutes opérations permettant aux SRAd’évaluer le potentiel archéologique d’un gisement ou d’un ensemble de gisements, et de préparer lecahier des charges de l’opération qui sera réalisée préalablement à sa destruction)
52
SU : fouille nécessitée par l’urgence absolue (fouille archéologique préventive dont l’autorisationest limitée à 1 mois et la prolongation soumise à l’avis du CNRA)SD : sondage (fouille de superficie et de durée limitées, nécessitée par un besoin de vérificationponctuelle, soit pour confirmer l’existence et l’état de conservation d’un site, soit pour préciser unpoint d’une problématique scientifique plus vaste)PT : prospection thématique (elle concerne un thème scientifique particulier rattaché à laprogrammation nationale ; les prospections diachroniques, quand elles relèvent d’un programme derecherche spécifique [sur l’occupation du sol par exemple] entrent dans ce cadre)
PTA : prospection thématique bénéficiant d’une autorisation annuelle
PTP : prospection thématique bénéficiant d’une autorisation pluriannuelle
PI : prospection-inventaire (elle se déroule sur un territoire limité, avec pour but l’inventairearchéologique de tous les sites quelle que soit leur datation)
RE : prospection avec relevé d’art rupestre (relevé d’art rupestre sans fouille associée)
PCR : projet collectif de recherche (programme de recherche archéologique mis en œuvre par uneou plusieurs équipes d’archéologues)
53
BILANGUYANE SCIENTIFIQUE
___________________________________________________ 2006
Organigramme du service régional d'archéologie
Tel. Général : 05 94 30 83 35 ou 36 ou 38
Agent Fonction Responsabilités
Eric GASSIES
Tel : 0594 30 83 36
Fax: 0594 30 83 41
Ingénieur d’études Archéologie préventive: suivi administratif, technique et scientifique des dossiers dediagnostics et de fouilles préventives en archéologie amérindienne et coloniale (PC et LT surCayenne, RM, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Roura, Macouria) avec le troisième agent
Carte archéologique: mise à jour, intégration des données des rapports et des archives defouilles, réalisation des cartes communales, Atlas du patrimoine (Culture), Atlas desPaysages…
Aide du CRA et de la chargée de communication et de documentation de la DAC àl’organisation des manifestations nationales (JEP, FDS…) et régionales (colloques, journéesarchéologiques…)
Aide du CRA et de l’agent recenseur-documentaliste à la constitution des dossiers deprotection (archéologiques) pour la CRPS, le cas échéant
Recherche, Formation et valorisation
ld MIGEON
Tel : 0594 30 83 35
Fax : 0594 30 83 41
Conservateurrégional,coordinationgénérale
Gestion administrative, scientifique et financière générale et coordinationRelations avec les administrations et les partenaires : MCC, DAPA, SDARCHETIS,Préfecture, SDAP-CRMH, DRIRE, DDE, DDAF, ONF, ENGREF, CNRS (UMR, ACR),INRAP, IRD, BRGM, Musées, Parcs, Universités, stagiaires et étudiants, associationsculturelles, aménageurs, bureaux d’études, architectes, Conseil régional, Conseil général,CCOG, CCCL, CCEG, maires …Relations avec les institutions patrimoniales et de recherchedu Plateau des Guyanes, de l’aire circumcaraïbe et de l’Amazonie.
Dépôt : rangement pratique, gestion informatique et entretien de l’ensemble du dépôt
Archéologie préventive : suivi administratif, technique et scientifique des dossiers dediagnostics et de fouilles préventives en archéologie amérindienne et coloniale (PC et LT surCommunes du Fleuve Oyapock, + Saül, Saint-Elie, Régina, Kourou, Sinnamary, Iracoubo,Miniers, Carrières, grandes études d’impact…)
Formation et valorisation : interventions et cours en milieu universitaire, à l’IUFM, auRectorat…
Fouilles programmées et dossiers de valorisation des sites: Archéologie amérindienne etcoloniale: suivi administratif, technique et financier des dossiers
Recherche : publications en archéologie américaniste, colloques, fouilles annuelles ou étudesen laboratoire au Mexique (1 mois) avec l’UMR 8096 « Archéologie des Amériques » ;études de sites en Guyane
Guy Dauphin, ( depuisoctobre 2006)
Ingénieur outechnicien d’études
-Gestion et entretien du matériel de terrain (y compris photographique et topographique)
Archéologie préventive : suivi administratif, technique et scientifique des dossiers dediagnostics et de fouilles préventives en archéologie amérindienne et colonial
54