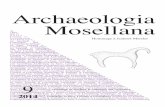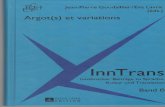De la pagode chinoise à l'araucaria du Chili. Apports étrangers dans l'art des jardins bruxellois...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of De la pagode chinoise à l'araucaria du Chili. Apports étrangers dans l'art des jardins bruxellois...
De
s i
nfl
ue
nc
es
étr
an
gè
res
da
ns
l’a
rch
ite
ctu
re b
ruxe
llo
ise
9 6
Bois de la Cambre(photo A. de Ville de Goet,
Direction des Monuments
et des Sites de la Région
de Bruxelles-Capitale).
9 7
Odile De Bruyn& Benoît Fondu
DE LA PAGODE CHINOISE À L’ARAUCARIA DU CHILI. APPORTS ÉTRANGERS DANS L’ART DES JARDINS BRUXELLOIS(XVIIIE-XXE SIÈCLE)
Si l’art des jardins bruxellois a certes connu des apports extérieurs
dès le Moyen Âge et à l’époque moderne, c’est indéniablement à partir de la fi n
du XVIIIe, et encore davantage au XIXe siècle, que les infl uences étrangères se
fi rent surtout sentir dans ce domaine. Outre les effets de mode, deux facteurs
furent à cet égard déterminants : tout d’abord, le développement assez
spectaculaire de l’horticulture en Belgique au XIXe siècle ; ensuite, l’action
et les ambitions impérialistes de Léopold II, qui entendait faire de Bruxelles
« une ville hors ligne » et « la capitale, le centre de l’Empire belge » (1).
Par suite du blocus continental déclaré en 1806 par Napoléon et
interdisant tout commerce avec les îles Britanniques, bon nombre de graines
et d’échantillons d’espèces d’arbres et arbustes exotiques nouvellement
découverts dans les colonies et commercialisés par les pépiniéristes anglais
transitèrent clandestinement par la Belgique française pour rejoindre le
continent et notamment la Malmaison où, depuis 1799, Joséphine Bonaparte,
passionnée de plantes rares, se constituait un jardin de collection.
Ce phénomène politico-commercial fut à l’origine de l’essor de
l’horticulture belge, qui eut à son tour des retombées signifi catives sur l’art
des jardins en Belgique et à Bruxelles. Les pépiniéristes des grands centres
horticoles d’Enghien, de la région gantoise et de Kalmthout pouvaient en
effet fournir les créateurs de jardins en plantes exotiques. De surcroît,
plusieurs architectes paysagistes étrangers furent attirés par la réputation de
l’horticulture en Belgique et visitèrent ses pépinières ou, pour certains d’entre
eux, décidèrent d’y exercer leur métier et de s’y établir défi nitivement.
Un autre facteur contribua à l’apport de savoir-faire et d’éléments
constitutifs étrangers à l’art des jardins bruxellois : le désir de Léopold II de
faire de Bruxelles la capitale d’un empire colonial belge et une ville digne de
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
9 8
Bois de La Cambre
(Jean-Pierre
Barillet-Deschamps).
Projet, 1861(coll. Archives de
la Ville de Bruxelles).
rivaliser avec Londres et Paris. Le souverain fut impressionné par les grands
travaux de réaménagement de cette dernière métropole entrepris à l’initiative
de Napoléon III et fi t, dès lors, appel à des architectes paysagistes français.
D’autre part, après la création de l’État indépendant du Congo, il encouragea
l’importation et la culture à Bruxelles de plantes coloniales.
L’approche choisie ici ne sera ni exhaustive ni chronologique, mais
bien plutôt thématique ; elle s’attachera à trois aspects différents du sujet :
les architectes paysagistes venus d’ailleurs ; les motifs décoratifs venus
d’ailleurs ; enfi n, les plantes venues d’ailleurs (2).
1 / Des architectes paysagistes venus d’ailleurs
L’appropriation du bois de La Cambre en promenade publique
En 1861, quatre projets d’aménagement en promenade publique
du bois de La Cambre, avancée vers Bruxelles de la forêt de Soignes, furent
présentés à la Ville de Bruxelles, devenue concessionnaire de ce domaine
forestier appartenant à l’État. Trois de ces plans avaient été conçus et dessinés
par des architectes paysagistes d’origine étrangère : les Allemands Louis
Fuchs et Edouard Keilig et le Français Jean-Pierre Barillet-Deschamps.
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
9 9
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u
Des participants étrangers au concours pour le bois de La Cambre
Né en 1818 à Barmen (aujourd’hui Wuppertal) et formé auprès de l’architecte de jardins Maximilian Weyhe, cousin germain du célèbre Peter Joseph Lenné, le créateur du Jardin zoologique de Berlin, Louis Fuchs, installé en Belgique depuis 1843, avait déjà une importante carrière à son actif, au moment de la présentation de son projet pour le bois de La Cambre : il avait entre autres collaboré avec l’architecte belge Alphonse Balat à l’aménagement du Jardin zoologique de Bruxelles (futur parc Léopold) ; il avait été nommé, en 1860, professeur d’architecture de jardins à l’École d’Horticulture de l’État à Vilvorde et, l’année suivante, inspecteur des plantations de la Ville de Bruxelles (3).
Jean-Pierre Barillet-Deschamps, né en 1824, était en passe de devenir, au début des années 1860, l’un des plus célèbres architectes de jardins de France. L’établissement horticole qu’il avait fondé à Bordeaux, toujours à la pointe du progrès, avait contribué à sa notoriété et au développement d’un important réseau de relations, au nombre desquelles fi guraient plusieurs horticulteurs belges (auxquels il avait rendu visite au cours d’un « voyage horticole » effectué en 1852), mais aussi Georges-Eugène Haussmann et Adolphe Alphand. Après la nomination de ceux-ci, l’un comme préfet de la Seine et l’autre comme ingénieur en chef du service des promenades et plantations de la Ville de Paris, il avait été recruté par eux comme jardinier en chef du bois de Boulogne et était devenu l’un des principaux responsables de l’aménagement des promenades publiques (bois suburbains, parcs, squares, avenues plantées) parisiennes, dans le cadre du programme de remodelage de la capitale voulu par Napoléon III (4).
Le plus jeune des trois auteurs étrangers, Edouard Keilig, né en Saxe en 1827 et formé à l’école de Peter Joseph Lenné, n’était pas non plus un inconnu des milieux horticoles belges au début des années 1860. En effet, fi xé en Belgique depuis 1853, il avait travaillé pour l’établissement horticole de Jean Linden, à Bruxelles ; en 1856, le duc de Brabant (futur Léopold II) l’avait chargé de l’embellissement du domaine de Tervueren ; la même année, l’architecte paysagiste avait exposé ses conceptions artistiques dans une série de Lettres
sur l’architecture des jardins publiées dans le Journal d’Anvers ; enfi n, en 1857, il avait participé – sans succès – au concours de projets pour l’aménagement de l’avenue Louise (5).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 0
Contre toute attente, c’est le plan du plus jeune et du moins renommé
de ces concurrents, à savoir Edouard Keilig, qui fut retenu. Dès 1862, celui-ci
put donc entamer les travaux d’adaptation du bois de La Cambre. Si les deux
projets allemands offraient de nombreuses similitudes et ne s’opposaient que
sur des points de détail – l’emplacement et la taille du lac ou le traitement
du « ravin » –, en revanche, celui de Barillet-Deschamps, bien que de style
paysager à l’anglaise comme les deux autres, avait été conçu dans un esprit
radicalement différent (6).
Au cours de son exil en Angleterre, le futur Napoléon III eut l’occasion
d’admirer les réalisations de ce pays en matière de parcs et jardins. Devenu
empereur des Français, il entreprit, avec l’aide de Haussmann et de ses
acolytes, de grands travaux de réaménagement de la ville de Paris sur le plan
urbanistique et paysager. Pour les espaces verts, il recommanda l’emploi du
style pittoresque anglais, qu’il affectionnait tout particulièrement, bien que
celui-ci correspondît moins bien que le style régulier du jardin à la française
à ses préoccupations de sécurité et de maintien de l’ordre. La ligne courbe
fut donc adoptée par les architectes paysagistes qui travaillèrent pour lui,
au premier rang desquels fi gurait Barillet-Deschamps. Un style original de
jardin paysager à l’anglaise, mieux adapté au tempérament rationnel des
Français et aux exigences de leur nouveau régime politique, vit le jour sous
Bois de La Cambre
(Edouard Keilig).
Projet, 1861(coll. Service des Espaces
Verts de la Ville
de Bruxelles).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 1
Bois de La Cambre.
Carte postale ancienne(coll. Dexia Banque, Bruxelles).
le Second Empire. Adolphe Alphand, le théoricien de ce style, considérait le
jardin comme une œuvre d’art et non comme une copie de la nature simple,
selon la formule anglaise traditionnelle. Dans cet esprit, Barillet-Deschamps,
qui privilégiait l’équilibre de la composition, remplaça les sentiers sinueux
– caractéristiques des jardins à l’anglaise depuis plus d’un siècle –, qui
fragmentaient exagérément le terrain, par des allées au dessin simple, en
courbes et contre-courbes d’une large envolée, et délimitant des espaces aux
formes nettes et clairement défi nies, ellipses, ovales et triangles curvilignes.
Il attacha également une grande importance au modelage du sol, en creux
dans les axes principaux des pelouses et se relevant sur les côtés pour appuyer
les massifs et les groupes d’arbres (7).
Si le plan de Barillet-Deschamps pour le bois de La Cambre
s’inscrivait pleinement dans cette esthétique qui faisait la part belle à l’art –
recherche formelle dans le tracé des voies carrossables et des chemins pour
piétons, unité d’ensemble de la composition, réduction drastique de la futaie
d’origine au profi t de pelouses parsemées de groupes d’arbres –, en revanche,
l’ambition d’Edouard Keilig était de donner à son projet « le caractère de
la simplicité et du grandiose », en essayant de tirer le meilleur parti de ce
que la nature offrait, de la confi guration existante du terrain et de l’aspect
naturellement pittoresque du paysage.
L’architecte paysagiste allemand s’est exprimé à ce sujet dans le
mémoire de décembre 1861 accompagnant le plan d’aménagement présenté
à la Ville de Bruxelles : « L’idée dominante de mon projet, la voici : le nouveau
parc doit conserver le caractère imposant et majestueux de la vieille forêt qui
couvre le terrain accidenté d’une magnifi que futaie sur un taillis très fourré.
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 2
Abris de cavaliers
du bois de La Cambre
(ALPHAND, A.,
Les promenades
de Paris, Paris,
1867-1873) (© Bibliothèque René
Pechère, Bruxelles –
www.bvrp.net).
Dans ce but, je déboise avec beaucoup de réserve (…). Je ne touche nulle part
au bois sans but sérieusement motivé. J’évite également de le découper en un
grand nombre de petits massifs qui ressemblent les uns aux autres, comme
cela se pratique d’ordinaire, mais je laisse subsister de grandes masses à
contours vigoureux. » (8)
Dans cette dernière phrase,
il faut sans doute voir une
allusion voilée à la « ma-
nière » de Barillet-Des-
champs. Keilig n’appréciait
guère, semble-t-il, le style
paysager du Second Empi-
re. Lorsque parut, en 1867,
le premier volume des
Promenades de Paris
d’Adolphe Alphand, qui
présentait les réalisations de l’équipe de Haussmann en matière d’espaces
verts, le créateur du bois de La Cambre ne fi gurait pas dans la liste des sous-
cripteurs de l’ouvrage, au contraire de Léopold II, de Jules Anspach, bourg-
mestre de la Ville de Bruxelles, de Funck, directeur du Jardin zoologique de
Bruxelles, et de Louis Fuchs. En 1878, Keilig dut cependant se résigner, au
moment où il dessina un projet d’abris de cavaliers pour le bois de La Cambre, à
prendre pour modèles ceux du bois de Boulogne décrits et représentés dans le
livre d’Alphand (9) : en effet, Léopold II avait vivement recommandé l’adoption
de ceux-ci, comme en témoigne une lettre du 27 septembre 1877 adressée
par le chef de cabinet du roi au bourgmestre de Bruxelles et accompagnée
d’une reproduction sur calque des abris des Promenades de Paris (10).
Le plan de Barillet-Deschamps, conçu selon une vision de remodelage
urbanistique et d’après une esthétique proche de celle des ingénieurs des
Ponts et Chaussées, faisait du bois de La Cambre une extension aérée de la
ville, tandis que le projet de Keilig, fi dèle au caractère « naturel » du jardin à
l’anglaise classique et à la voie tracée par Lenné et ses disciples, l’envisageait
comme une avancée aménagée de la forêt de Soignes et un espace de
transition de celle-ci vers la ville.
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 3
Domaine royal
et le parc public
de Laeken
(Edouard Keilig).
Projet, 1868(coll. Archives du Palais royal,
Bruxelles).
L’aménagement des environs du domaine royal de Laeken
La concurrence entre les écoles allemande et française d’architecture
du paysage se manifesta une nouvelle fois dans le cadre du réaménagement du
domaine royal de Laeken et de la création, dans le prolongement de celui-ci, d’un
parc public destiné à accueillir un monument à ériger à la mémoire de Léopold
Ier, mort en 1865. Dans une lettre du 7 mai 1869 adressée à Adrien Goffi net,
gestionnaire de la fortune privée du roi, Léopold II fi t part de ses souhaits à propos
de Laeken, qui rejoignaient les conceptions socio-urbanistiques de Napoléon III
et de Haussmann : « Je désire faire de mes environs un petit Paradis pour
le peuple qui viendra jouir de ma campagne et de mes travaux. » (11)
À l’instar de l’empereur des Français, Léopold II, par ailleurs cousin
germain de la reine Victoria, favorisa, tout au moins dans les premières
années de son règne, l’emploi du style paysager à l’anglaise dans les parcs.
En 1866, au moment où l’appropriation du bois de La Cambre en promenade
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 4
Domaine royal
et le parc public
de Laeken
(Grégoire).
Projet, 1876(coll. Archives du Palais
royal, Bruxelles).
publique, achevée pour l’essentiel, suscitait l’admiration générale, le nouveau
souverain s’adressa à Edouard Keilig afi n que celui-ci établisse un avant-
projet pour le parc public de Laeken (12), dont la création serait approuvée
l’année suivante par les administrations concernées et décrétée par arrêté
royal du 15 mars 1868. Si Keilig jouissait d’une réputation grandissante,
Jean-Pierre Barillet-Deschamps, quant à lui, était à l’époque au faîte de sa
carrière : l’aménagement du parc de l’Exposition universelle de Paris en 1867,
l’inauguration, à cette occasion, du parc des Buttes-Chaumont, l’une de ses
œuvres majeures, et la publication des Promenades de Paris contribuèrent
grandement à faire connaître son travail en dehors des frontières françaises.
En 1868, Léopold II fi t appel à l’architecte de jardins français et lui demanda
de dessiner un plan d’aménagement paysager pour le parc de Laeken (13).
La même année, Edouard Keilig produisit un plan général d’aménagement du
domaine royal et du parc public de Laeken. La mort de Barillet-Deschamps en
1873 ne mit pas un terme à la concurrence à Bruxelles entre les représentants
des styles anglo-allemand et anglo-français de l’art des jardins paysagers.
En effet, Léopold II eut recours aux services d’un autre Français gravitant dans
l’orbite d’Adolphe Alphand, un « ingénieur en chef des Ponts et Chaussées »
du nom de Grégoire, qui dessina en 1876 un plan pour le domaine royal et le
parc public de Laeken (14).
Comme pour le bois de La Cambre, la différence de style entre les deux
projets, le second de Keilig et celui de Grégoire, se manifestait clairement :
les parties réservées aux pelouses étaient moins étendues chez l’Allemand,
qui privilégia les espaces arborés et les plans d’eau aux contours irréguliers ;
d’autre part, l’axe reliant le château royal au monument à ériger en l’honneur
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 5
Mémorial de Léopold Ier
à Bruxelles-Laeken.
Carte postale ancienne(coll. Dexia Banque, Bruxelles).
de Léopold Ier était davantage souligné dans le projet du Français – alors
que ce dernier prévoyait une avenue droite en direction du mémorial, Keilig
proposait une route ovale – ; ce même axe faisait l’objet d’un aménagement
plus sophistiqué chez Grégoire (parterres, statues et bassins de formes
régulières) ; enfi n, le réseau de chemins piétonniers était conçu de manière
plus formelle sur le plan de l’ingénieur français, qui suivait en cela l’exemple
de Barillet-Deschamps. Alors que le projet de Keilig restait très fi dèle à
l’esprit du jardin paysager à l’anglaise, et ce malgré l’introduction de quelques
données régulières voulues par la présence d’éléments architecturaux sur le
site, celui de Grégoire recourait davantage à une certaine mixité de style.
Dans l’introduction aux Promenades de Paris, ouvrage auquel
Grégoire avait souscrit, Adolphe Alphand, partant de l’exemple des jardins de la
« Maison dorée » de l’empereur Néron à Rome, tels que décrits par l’historien
Tacite (15), fi t une réfl exion très pertinente à propos du style irrégulier de
l’art des jardins qui, selon lui, ne pouvait s’accorder avec le luxe des palais
impériaux romains et n’était pas apte à exprimer l’omnipotence impériale,
dont le besoin de pompe et de richesse apparente était mieux assouvi par des
avenues ornées de statues, des arcs de triomphe, des bassins de marbre et
des vases précieux que par des beaux ombrages et des fl eurs. Grégoire s’est
probablement souvenu de cette leçon en réalisant son plan d’aménagement
du domaine royal de Laeken et de ses environs en y mettant spécialement
en évidence l’axe, à forte connotation symbolique, unissant le château au
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 6
mémorial du premier roi des Belges. Le projet de l’ingénieur français était,
plus que celui de l’architecte paysagiste allemand, marqué par une esthétique
de l’apparat et par des intentions idéologiques fortes. Cette caractéristique
a très vraisemblablement dû peser de tout son poids dans la décision qui
fut fi nalement prise d’utiliser, moyennant adaptations, le plan de Grégoire
comme base pour l’aménagement, sur un terrain de seize hectares cédé
par le souverain à l’État en vertu d’un accord conclu en 1876, du parc public
de Laeken (16). Grégoire réalisa encore, en 1878 et 1880, deux plans pour le
jardin attenant au château royal : dans ces projets, jamais exécutés, les styles
irrégulier et formel se côtoyaient également (17). À partir de 1890, Léopold II
s’adjoignit, pour l’arrangement de son domaine de Laeken, les services de
l’architecte paysagiste français Émile Lainé, dont l’esthétique très classique
s’apparentait au style Beaux-Arts (18).
À la fi n de son règne, le monarque fi t appel à Jules
Vacherot, qui avait été formé à l’école de Barillet-
Deschamps et avait été chargé de la réalisation du
parc de l’Exposition universelle de Paris en 1900 (19).
À l’instar du célèbre architecte de jardins français
Édouard André, qui avait dessiné en 1873 un « projet
de restauration » du Jardin botanique de Bruxelles,
récemment acquis par l’État (20), Jules Vacherot
était un adepte du style mixte ou composite. Il établit
un plan de transformation d’une partie du parc royal
de Laeken, qui prévoyait la création d’une grande
roseraie, et fournit en 1908 un premier projet pour le
square du 21 juillet, lequel serait exécuté, moyennant
certains ajustements et simplifi cations, en 1910.
Le programme à réaliser pour ce petit espace vert
était de créer, sur un terrain vague situé à proximité
de l’église de Laeken, un agrandissement du domaine
royal qui, tout en lui servant d’entrée secondaire,
pourrait être, à des jours déterminés, isolé de la
propriété par une grille et livré comme square au
public. Le projet de 1908 présentait un équilibre parfait
entre les styles paysager et régulier : il comprenait des
pelouses, des groupes d’arbres et des allées courbes,
mais aussi des parterres de broderie, un théâtre de
verdure et des terrasses, bassins et fontaines, dans
le plus pur esprit classique français (21). À Bruxelles,
Square du 21 juillet
à Laeken
(Jules Vacherot).
Projet, 1908
(VACHEROT, J.,
Parcs et jardins.
Album d’études,
Paris, 1925,
planche 88) (© Bibliothèque
René Pechère, Bruxelles –
www.bvrp.net).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 7
Jules Vacherot créerait encore, en 1909-1910, le square du Mont des Arts,
aux « dispositions régulières dans l’axe longitudinal avec marges latérales en
style Paysager moderne » (22), les jardins de la Ville de Paris et de la section
française à l’Exposition universelle de Bruxelles 1910, également de style
mixte, avec « au centre, un jardin régulier, d’allure décorative et calme, et sur
les côtés, comme transition avec l’extérieur, un jardin paysager » (23).
2 / Des motifs décoratifs venus d’ailleurs
De la pagode chinoise du parc de Schoonenberg
à la Tour japonaise de Laeken
L’Extrême-Orient a toujours été au cœur des préoccupations
impérialistes de Léopold II et a suscité son intérêt pour des raisons d’ordre
économique, politique et culturel. Le duc de Brabant s’est exprimé à ce
sujet dès 1861, dans le journal de voyage qu’il a rédigé au cours d’un séjour
en Allemagne : « Ballotté entre ces pensées, ces désirs et ces rêves, je ne
parviens, quoique fatigué, que diffi cilement à me reposer quelques instants.
Comment, en effet, l’homme qui songe à la grandeur de sa patrie pourrait-il,
oubliant sa passion, en éteindre subitement la fl amme ? Il faut qu’un jour le
drapeau Belge fl otte dans les cinq parties du monde. La Belgique doit devenir
la capitale de l’Empire Belge, qui se composera, Dieu aidant, des îles du
Pacifi que, de Bornéo, de quelques points de l’Afrique et de l’Amérique, et enfi n
de portions de la Chine et du Japon. Voilà mon but. » (24)
La fondation de l’État indépendant du Congo en 1885 n’éteignit
pas la fl amme expansionniste du souverain qui, tout au long de son règne,
eut l’ambition de « faire de notre petite Belgique la capitale d’un immense
empire » et rêva de lui obtenir un morceau de la Chine (25), alors en « période
de décomposition » (26).
Après une visite du panorama dit Le tour du monde à l’Exposition
universelle de Paris en 1900, Léopold II s’adressa à l’architecte parisien
Alexandre Marcel, le concepteur de cette curiosité, et lui demanda d’édifi er, à
la lisière du parc royal de Laeken, une tour japonaise similaire à celle située
à l’un des angles du bâtiment de l’attraction. Cette fabrique en bois, haute
de 40 mètres et surmontée de cinq étages, fut réalisée entre 1901 et 1904,
en vis-à-vis d’une autre construction exotique, le Pavillon chinois, commandée
en 1901 par le roi au même architecte, connu pour ses créations orientalisantes,
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 8
Tour japonaise
de Laeken
(Alexandre Marcel).
Projet, 1901(coll. Archives du Palais
royal, Bruxelles).
Pagode chinoise
et orangerie du parc
de Schoonenberg
(François Le Febvre).
Gouache, vers 1787 (© Albertina, Vienne).
non seulement dans le domaine de l’architecture, mais également dans celui
de l’art des jardins, où il s’était distingué par l’aménagement, à partir de 1899,
d’un « paysage japonais » à Maulévrier, près de Cholet en France (27).
Il est intéressant de remarquer que l’emplacement choisi pour la
Tour japonaise correspondait à peu de chose près à celui occupé autrefois par
une pagode chinoise, élevée en 1786 à l’initiative de l’archiduchesse Marie-
Christine d’Autriche, sœur de Marie-Antoinette, et de son époux, le duc Albert
de Saxe-Teschen, gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens, dans le
parc de Schoonenberg, où ils venaient de se faire édifi er une résidence de
campagne (28). Démolie en 1803, sous l’occupation française, la tour chinoise
de Laeken était une réplique de la pagode des jardins de Kew (29), près de
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 0 9
Londres, construite en 1761-1762 pour la princesse douairière de Galles par
l’architecte William Chambers. Après avoir voyagé en Chine, celui-ci publia
plusieurs ouvrages sur l’architecture, les arts décoratifs et les jardins de
ce pays, qui furent à l’origine de la mode du jardin dit « anglo-chinois » en
Europe, dont l’un des grands principes était d’introduire de la variété dans les
paysages, entre autres en les parsemant de constructions exotiques.
L’un des adeptes de cette mode fut sans conteste Charles-Joseph de
Ligne, qui fi t élever, dans le jardin de l’une de ses propriétés située à Baudour,
un « belvédère chinois ». En 1786, le prince « hortomane » fi t mention, dans
son Coup d’œil sur Beloeil et sur une grande partie des jardins de l’Europe,
de la pagode chinoise de Laeken, qu’il avait visitée alors qu’elle était à peine
achevée : « À droite et à gauche de la pelouse [située à proximité du château],
il y a des promenades fort agréables, dans des plans [plants] d’arbustes
précieux, où de grands arbres cachent quelquefois tout à fait les environs
ornés de la capitale. (…) la superbe pagode chinoise, l’orangerie, et d’autres
objets de promenade, sérieux, ou agréables, jettent de la variété sur cette
charmante habitation. » (30)
Quelques années plus tard, le naturaliste allemand Jean George
Adam Forster visita lui aussi le parc du château de Schoonenberg et en donna
une description détaillée dans son Voyage philosophique et pittoresque,
sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande,
l’Angleterre, la France, etc. fait en 1790 : « On trouve aussi dans ce jardin une
foule d’arbres et de plantes exotiques très rares, également dignes de fi xer
l’attention des botanistes et des curieux. L’orangerie, les plates-bandes de
fl eurs, les offi ces, la ménagerie, la tour chinoise sont disposés avec goût ;
chacun de ces bâtiments est construit dans le stil [sic] qui lui est propre.
La tour a onze étages ; on y monte par cent trente un degrés. Son élévation
est de cent vingt pieds [environ 39 mètres]. Au sommet de cette tour la vue est
incommensurable, et n’a d’autres bornes que celles du possible. Nous avons
distingué le clocher de Saint-Romuald [Saint-Rombaut] à Malines, quoique le
temps fût couvert. Lorsque l’horizon est pur, on découvre Anvers. Les beautés
de détail que renferme ce séjour enchanté attestent et le goût des maîtres, et
cet impérieux besoin auquel les rois, les princes, tous les grands de la terre ne
sauraient échapper, celui de rendre hommage à la nature, de rentrer en eux-
mêmes, et d’aller quelquefois loin du bruit des cours savourer les douceurs
de la vie champêtre, et de cette presque solitude, aliment des âmes fortes, ou
palliatif bienfaisant pour les cœurs malades. » (31)
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 0
L’exotisme des « grands de la terre » du siècle des Lumières
répondait sans aucun doute à des besoins différents de ceux éprouvés par
Léopold II : il était en effet motivé davantage par un goût du changement, du
« bizarre », et par un désir d’évasion d’un mode de vie artifi ciel que par des
rêves impérialistes.
Les motifs des châles de cachemire comme source
d’inspiration pour le tracé du parc de Laeken
Sous le Second Empire, époque au cours de laquelle la mode féminine
parisienne connut son plein épanouissement, les infl uences réciproques des
arts du tissu et des jardins se fi rent nettement sentir. Ainsi Barillet-Deschamps
s’inspira-t-il, pour le tracé des allées et le modelage du sol en courbes et
en contre-courbes de ses parcs, des motifs des châles de cachemire (32),
alors particulièrement en vogue grâce notamment aux créations, souvent
présentées aux expositions universelles, du dessinateur de châles Antony
Berrus. Celui-ci fut à l’origine d’un véritable style cachemire français, qui
reproduisait l’allure orientale des châles de l’Inde et en utilisait, entre autres,
les motifs de palmes ondoyantes empruntés à la végétation exotique, tout en
l’adaptant au goût européen (33).
Châle
à présenter à
l’Exposition
universelle de Paris
en 1867
(Antony Berrus).
Projet – crayons
graphiste et Conté,
rehauts de blanc
sur papier bis)(photo Les Arts décoratifs,
Paris/Jean Thoulance,
tous droits réservés).
Parc de Montsouris
(Adolphe Alphand).
Gravure
(ALPHAND, A.,
Les promenades de
Paris, Paris,
1867-1873) (© Bibliothèque
René Pechère, Bruxelles –
www.bvrp.net).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 1
Jardin congolais
de l’Exposition
universelle de 1958
(René Pechère). Plan
(PECHÈRE, R., Jardins
dessinés. Grammaire
des jardins, Bruxelles,
1987, p. 113)(© Bibliothèque René Pechère,
Bruxelles – www.bvrp.net).
En 1869 s’ouvrit à la rue Neuve, à Bruxelles, le « magasin de
nouveautés » Hirsch & Cie, dont une des spécialités était la vente des châles
de cachemire. Grégoire, le dessinateur du parc public de Laeken, recourut
manifestement, à l’instar de Barillet-Deschamps, aux motifs exubérants des
châles exotiques.
Les velours du Kasaï et les vanneries rwandaises
comme sources d’inspiration pour la composition
du Jardin congolais de l’Exposition universelle de 1958
Au printemps de l’année 1955, René Pechère, architecte paysagiste
bruxellois né en 1908, professeur à l’École nationale supérieure d’Architecture
et des Arts décoratifs de La Cambre, reçut pour mission de créer le jardin
de la section coloniale de la future Exposition universelle de Bruxelles 1958.
Le défi était de taille, puisqu’il s’agissait ni plus ni moins d’inventer un nouveau
style de l’art des jardins, le jardin « à la congolaise », qui n’existait ni chez les
autochtones, ceux-ci n’ayant pas de jardins, ni chez les coloniaux, dont les
jardins, qu’ils fussent privés ou publics, étaient souvent de piètres adaptations
de modèles en vogue dans l’Europe du XIXe siècle, mais fortement démodés
à l’époque. Afi n de se familiariser avec l’art dit « nègre » dont il comptait
s’inspirer et avec la végétation tropicale, l’architecte de jardins effectua, entre
janvier et mars 1956, en tant que chargé de mission du Ministère des Colonies,
un voyage de reconnaissance de sept semaines au Congo et au Ruanda-Urundi.
De même que les créateurs des premiers parterres de broderie (34) en France
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 2
Jardin congolais
de l’Exposition
universelle
de 1958
(René Pechère).
Le grand parterre
inspiré des velours
du Kasaï et le bassin
en spirale inspiré
d’une vannerie
rwandaise (dessins)(© Bibliothèque René
Pechère – www.bvrp.net).
à la fi n du XVIe siècle – l’architecte Etienne Dupérac et le jardinier Claude
Mollet – s’étaient inspirés des motifs des tissus de broderie de l’époque, René
Pechère imita, pour réaliser au Heysel le « grand parterre », de 32 mètres de
diamètre, du Jardin congolais de l’Exposition de 1958, les dessins triangulaires
des velours du Kasaï. Comme il l’explique dans ses souvenirs de voyage en
Afrique, il songea à Catherine de Médicis, qui avait mis son jardinier en rapport
avec son tailleur, afi n qu’il fût enrichi d’exemples d’entrelacs : « J’ai vu toutes
les broderies, tout l’art nègre, qui m’a permis, comme Catherine de Médicis,
d’inventer un rapport avec ses jardiniers [sic] (35) ; pour que les broderies
de buis soient inspirées des broderies des costumes ; et j’ai dit « je vais faire
un jardin inspiré des broderies noires, je vais faire comme Catherine, je vais
mettre les broderies des tapis dans le jardin » ; et ce voyage reste un des plus
beaux souvenirs de ma vie (…). Et j’ai fait le seul jardin congolais qui existe ; j’ai
taillé toutes mes haies en zigzag ; comme faisaient les nègres ; les escaliers
avaient des marches qui ressemblaient aux sabres rwandais ; en zigzag ; tout
venait de l’origine nègre que j’ai sentie là-bas. » (36)
Outre le « grand parterre », l’architecte paysagiste bruxellois créa
également des dallages, escaliers, haies, bassins et jeux d’eau inspirés
des formes, des motifs et des mouvements de vanneries, de fourreaux
d’épée, de boucliers, d’étoffes et de danses « nègres » . Enfi n, il parsema le
« potopot », coin d’herbes folles et en grand désordre, partie du jardin aux
allures pittoresques, de « fabriques » d’un genre inédit : des termitières
artifi cielles, imitées de celles du Katanga, et dont le réalisme effraya
quelques visiteurs congolais ! C’est l’écrivaine Marie Gevers, rencontrée
alors qu’elle était en séjour chez sa fi lle à Astrida (Butare), au Ruanda,
qui lui avait suggéré d’introduire dans son Jardin congolais ces éléments
typiques du paysage tropical (37).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 3
Termitière
du Jardin congolais
de l’Exposition
universelle de 1958(photo Sado (© Bibliothèque
René Pechère, Bruxelles –
www.bvrp.net).
Le Jardin congolais de l’Exposition de 1958, qui s’inscrivait dans la
logique du regard colonial propre à l’époque, mais qui fut néanmoins une œuvre
originale et moderne, eut un caractère éphémère et subit malheureusement
le sort de la plupart des constructions réalisées dans le cadre de ce type de
manifestations : celui de la destruction (38).
3 / Des plantes venues d’ailleurs
Les plantes coloniales des serres
Lorsqu’en 1885, Léopold II devint roi-souverain de l’État indépendant
du Congo, son intérêt pour la botanique, spécialement pour la fl ore exotique,
s’accrut considérablement. Dès 1886, il confi a à l’« architecte royal »
Alphonse Balat la mission de construire, dans son domaine de Laeken, à côté
du grand Jardin d’Hiver édifi é une dizaine d’années plus tôt, une nouvelle
serre destinée à abriter des plantes de l’Afrique centrale. Inspirée comme
le Jardin d’Hiver du Palm House des Royal Botanic Gardens de Kew (1844-
1848) et surmontée d’une étoile, symbole de l’État du Congo, la Serre du
Congo devait notamment servir de salle des fêtes. Les essais de plantation
d’espèces provenant de la colonie s’avérèrent peu concluants, le caractère
touffu, démesuré et désordonné de la fl ore congolaise ne permettant pas de
donner à leur groupement l’allure ornementale et pittoresque qui convenait à
une serre de réception et d’apparat. D’autres plantes exotiques, originaires de
régions tropicales non équatoriales, comme des caoutchoucs, des palmiers
et des fougères d’Inde ou d’Australie, y furent dès lors placées (39). Pour
un souverain dont l’ambition était d’implanter la civilisation occidentale en
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 4
Serre du Congo
(Alphonse Balat).
Projet, 1886(coll. Archives du Palais
royal, Bruxelles).
Afrique centrale, l’aspect indomptable de la végétation équatoriale, malgré
la fascination que celle-ci ne manquait pas d’exercer sur lui, avait quelque
chose d’inquiétant, voire de dérangeant.
Si Henri Carton de Wiart a dit de Léopold II que « les fl eurs furent
sa poésie, et comme sa revanche contre les exigences de la réalité » (40), la
passion de ce dernier pour la botanique et l’art des jardins fut loin d’être aussi
désintéressée qu’il peut sembler à première vue. La relation du souverain
avec le monde végétal, en particulier celui des régions tropicales, comportait,
outre d’indéniables aspects de curiosité scientifi que, la claire conscience des
enjeux économiques, mais aussi culturels et politiques de la connaissance et
de la culture des plantes. C’est ce qu’a exprimé en 1951 Gaston Denys Périer,
ancien fonctionnaire au Ministère des Colonies, dans un article du Bulletin
de l’Union des Femmes coloniales : « À l’égal de Louis XIV, qui conduisait
délibérément les ambassadeurs étrangers dans les jardins dessinés par
Le Nôtre, pour leur imposer le refl et aéré de sa magnifi cence et, un peu, pour
gagner leur conscience éblouie, l’auguste Souverain du Congo savait pourquoi
il invitait ses hôtes (de préférence les moins souples) à visiter ses serres de
Laeken. Qui dira si l’amour des arbres et des fl eurs n’avait point préparé le
Bâtisseur à son entreprise coloniale ? Culture et colonisation, ne sont-ce
point tendances à ordonner la sauvage nature ? » (41)
La section coloniale établie à Tervueren de l’Exposition internationale
de Bruxelles 1897 comportait une collection de plantes vivantes congolaises,
présentées dans une serre spécialement construite à cet effet dans le
jardin du Palais des Colonies et rassemblées par Émile Laurent, botaniste-
explorateur ayant effectué plusieurs missions au Congo et professeur
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 5
Jardin colonial
à Bruxelles-Laeken(photo A. de Ville de Goyet,
Direction des Monuments et
des Sites de la Région de
Bruxelles-Capitale).
à l’Institut agricole de Gembloux. C’est à cette occasion que le grand public
put découvrir pour la première fois les plantes de la colonie. À partir de ce
moment, de nombreux efforts furent accomplis pour encourager la culture en
Belgique de plantes utiles (caféiers…) et surtout ornementales (sansevières,
hæmanthus…) provenant du Congo, ainsi que pour propager et expédier des
plantes économiques des régions tropicales américaines et indiennes dont
la culture pouvait être tentée au Congo. C’est afi n de répondre à ce double
objectif que furent créés, respectivement en 1899 par Lucien Linden, fi ls du
célèbre botaniste-explorateur Jean Linden, et en 1900 par décret du roi-
souverain de l’État indépendant du Congo, la Société anonyme L’Horticole
coloniale, dont les serres étaient situées à Linthout, et le Jardin colonial,
installé d’abord dans deux serres des forceries fl euristes et fruitières du
domaine royal du Stuyvenberg, ensuite dans six serres nouvelles, établies près
de la Villa Vander Borght, au Heysel, enfi n, à partir de 1906, dans ces mêmes
serres transférées sur un terrain acquis précédemment par Léopold II, situé
le long de l’avenue Jean Sobieski à Laeken, dans la proximité immédiate du
Stuyvenberg. Dans chacune des serres étaient entretenus, de jour comme de
nuit, hiver comme été, une température et un degré d’humidité convenant
pour le genre de plantes qui y étaient cultivées. Outre ses fonctions d’ordre
pratique, le Jardin colonial de Laeken avait également une portée didactique
importante : il permettait en effet à des étudiants, professeurs et chercheurs
en botanique, ainsi qu’à des horticulteurs et amateurs de plantes, d’observer,
de connaître et d’admirer la fl ore congolaise. En 1951, les plantes exotiques du
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 6
Jardin colonial de Laeken, en manque d’espace, rejoignirent les collections du
Jardin botanique de l’État, nouvellement installé dans le domaine de Bouchout,
à Meise. Les serres furent utilisées une dernière fois par les jardiniers de
l’Exposition universelle de 1958, avant d’être démontées en 1964, au moment
où le jardin fut transformé en parc public (42).
Pour créer le Jardin congolais de l’Exposition de 1958, René Pechère
fut confronté à une question épineuse. En effet, il pouvait diffi cilement utiliser
les plantes congolaises, peu adaptées au climat tempéré de la Belgique.
Au cours de son voyage au Congo, il rendit visite au Père Hubert Callens,
directeur du célèbre jardin botanique de Kisantu, fondé en 1898 par le Frère
Justin Gillet. Féru de botanique, le Jésuite le conseilla dans le choix de plantes
européennes permettant d’évoquer par leur similitude d’aspect la végétation
des forêts tropicales. Sur la route le conduisant à Kisantu, l’architecte
paysagiste songea aux moyens de résoudre son problème : « Je cherche à
me raccrocher à la végétation [de] chez nous, et si je devais créer une forêt
indigène, je cherche à voir avec des plantes de Belgique comment donner
cet aspect. En somme, j’ai l’impression que les massifs sont composés de
chênes et d’acacias avec quelques catalpas ou grands lilas. Naturellement les
éternels caoutchoucs à feuilles larges, de grandes herbes et des fougères et
surtout d’énormes euphorbes – la même forme et la même physionomie que
l’euphorbe de chez nous, mais de 3, 4 et même 5 mètres de haut. J’ajouterais
des cerisiers de Virginie et toujours, à ne jamais oublier, des arbres morts
et des palmes mortes tombant des palmiers. Car partout ici, on rencontre
d’admirables squelettes d’arbres qui complètent le paysage ; l’architecture
des branches est très intéressante (…). » (43)
Le gigantisme de certaines espèces tropicales ne facilita pas la tâche de
René Pechère et de son équipe. Comme il l’a raconté dans ses Souvenirs, il avait
le projet d’établir un enclos de palmiers de grande taille. Lorsqu’on lui signala
qu’il pouvait s’en procurer chez des horticulteurs gantois, il fi t remarquer, à juste
titre, que les palmiers de Gand avaient quatre mètres de haut, tandis que ceux
du Congo en comptaient vingt. Il fi t donc préparer, au Congo même, quelques
troncs de borassus, qui furent sciés en sections de quatre mètres, numérotés
et expédiés. Afi n de permettre leur élévation, les pièces de bois furent évidées
dans une usine à canon, serrées par un câble et remplies de béton armé.
Des feuilles en plastique, de 2,80 mètres de long, furent fabriquées par une fi rme
belge, avant d’être attachées aux troncs ; de minces ressorts leur permettaient
de se mouvoir. Ces trois borassus artifi ciels frappèrent l’imagination des visiteurs
de l’Exposition, qui n’y virent que du feu (44) !
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 7
Borassus
et grand parterre
du Jardin congolais de
l’Exposition universelle
de 1958(photo Willy Kessels /
coll. Bibliothèque René Pechère,
Bruxelles – www.bvrp.net;
photographe Kessels :
© Sofam, 2009).
Jardin intérieur
du pavillon brésilien de
l’Exposition universelle
de 1958(coll. Vakgroep Architectuur
& Stedenbouw, UGent).
À l’instar de Léopold II, René Pechère considérait que la végétation
équatoriale devait être dominée par l’homme au moyen de l’art et éprouvait
une certaine crainte « devant l’insondable mystère de cette nature grouillante
et riche gonfl ée de sa verdure vert foncé servant de couverture à tous les
mystères de la nature, à ce monde grouillant qu’on sent dans les sous-bois,
mais qu’on ne voit guère, toute cette nature qui est prête à se venger dès que
l’homme s’abandonne. » (45)
Contrairement à René Pechère, qui a créé à Bruxelles un jardin
extérieur au moyen de plantes évoquant ou imitant par l’artifi ce la végétation
équatoriale, Roberto Burle Marx a réalisé, pour le pavillon brésilien de
l’Exposition de 1958, œuvre de l’architecte moderniste Sérgio Bernardes,
un jardin intérieur entièrement intégré aux structures architectoniques du
bâtiment et exclusivement composé de plantes tropicales sud-américaines.
Très sensible à l’écologie et à l’adéquation de la fl ore aux conditions
climatiques, le célèbre architecte paysagiste brésilien, de même qu’il ne voulait
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 8
« pas voir de bananiers ou de cocotiers à Paris », était partisan de l’utilisation
de plantes indigènes dans les jardins de son pays, où la bourgeoisie locale,
les jugeant trop exubérantes, écrasantes, grasses et voraces, leur préférait la
végétation d’origine européenne. À la différence de certaines de ses créations
sur le continent européen, comme le jardin de l’Organisation Mondiale pour
la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève (1979), dans lesquelles, soucieux
du respect de l’identité biologique locale, Roberto Burle Marx privilégia
les espèces végétales indigènes, le jardin intérieur du pavillon brésilien,
réalisation jugée peu signifi cative au regard de l’impressionnante production
du paysagiste, était un compromis entre ses idéaux écologiques et son souci
de faire connaître au public européen, dans le cadre d’une manifestation
temporaire, un échantillon authentique de la fl ore de son pays (46).
Les arbres et arbustes exotiques des parcs
Quiconque quitte le bois de La Cambre et s’engage dans l’avenue
Louise en direction de la ville ne peut manquer d’être frappé par la
présence d’un massif d’araucarias du Chili, conifères d’un genre très
particulier appelés « désespoirs des singes » en raison de leur feuillage
en écailles, rigide et tranchant. Planté en 1865, ce groupe d’arbres, bien
que d’allure un peu rachitique, est un symbole et l’un des rares vestiges de
l’introduction d’essences exotiques à Bruxelles au XIXe siècle. L’Araucaria
araucana pénétra pour la première fois en Europe à la fi n du XVIIIe siècle,
via l’Angleterre et le jardin de Kew, et fut très à la mode dans la société
victorienne et celle du Second Empire : l’habitude était alors de le planter,
dans les jardins privés, à un endroit où il pût être vu depuis les pièces de
réception de l’habitation.
L’origine de la mode des arbres exotiques en Belgique se situe dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle. À l’époque, c’était l’Amérique du Nord
qui fournissait la plupart de ces essences rares : à côté des chênes rouges
d’Amérique (Quercus rubra), plusieurs espèces de sapins, d’épicéas et de
pins vinrent embellir les parcs d’agrément. Toutefois, c’est au XIXe siècle,
spécialement dans sa seconde moitié, que cet engouement atteignit des
sommets jusqu’alors inégalés. Si l’on compare les listes d’arbres et arbustes
présentées dans divers manuels de botanique de la fi n du XVIIIe siècle relatifs
à nos régions avec les résultats du Rapport sur l’introduction des essences
exotiques en Belgique, publié à Bruxelles en 1909 par Amédée Visart de
Bocarmé et Charles Bommer, on ne peut qu’être surpris par l’augmentation
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 1 9
Araucarias,
avenue Louise
à Bruxelles-Extensions(photo Direction des Monuments
et des Sites de la Région de
Bruxelles-Capitale).
impressionnante du nombre d’espèces, dont beaucoup sont
d’ailleurs aujourd’hui complètement tombées dans l’oubli.
Charles Bommer fut professeur de botanique à l’Université
libre de Bruxelles et conservateur du Musée forestier du Jardin
botanique de l’État à Bruxelles ; en tant que spécialiste de
la sylviculture et de la dendrologie, il conçut, à partir de 1902,
le pendant extra muros de ce musée, l’Arboretum géographique
de Tervueren (47).
Il est intéressant de remarquer que les araucarias de
l’avenue Louise sont représentés sur l’une des six planches
illustrant le Rapport : c’est dire s’ils frappèrent les imaginations
à l’époque. Pourquoi ces arbres ont-ils suscité au XIXe siècle,
et suscitent-ils encore actuellement, un tel sentiment de curiosité (mêlé
aujourd’hui d’un certain dédain), alors que les marronniers d’Inde les jouxtant
n’ont guère retenu l’attention ? Contrairement à ce que son nom vernaculaire
laisse penser, le marronnier d’Inde (Æsculus hippocastanum) est originaire
des Balkans et d’Asie Mineure. Son introduction dans nos régions est très
ancienne : elle remonte en effet à la fi n du XVIe et au début du XVIIe siècle.
Cette essence s’est si bien acclimatée qu’on la considère aujourd’hui comme
indigène. L’exotisme et la rareté furent sans aucun doute des facteurs
d’attraction majeurs dans le choix des végétaux ornant les jardins privés et les
parcs publics bruxellois au XIXe siècle. Ils ne furent cependant pas les seuls :
en effet, le port de l’arbre ou sa silhouette, de même que sa ou ses couleurs,
furent également au nombre des critères recherchés. Dans son Traité général
de la composition des parcs et jardins, daté de 1879, l’architecte paysagiste
Édouard André, disciple de Barillet-Deschamps et qui fut également un
botaniste distingué, a montré que la forme de l’arbre ou de l’arbuste des
jardins constituait – que celui-ci fût planté en solitaire ou en masse – un
élément important dans la conception des paysages et que les nombreuses
introductions d’espèces nouvelles permettaient de créer des harmonies plus
recherchées qu’auparavant (48).
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 2 0
Des formes et des couleurs des végétaux exotiques
Bien que présentant de belles nuances de vert, ainsi que d’élégantes
panachures, et offrant l’avantage, surtout appréciable en hiver, de leur
feuillage persistant, les résineux exotiques furent surtout choisis pour leur
port caractéristique, souvent conique ou cylindrique, dans la composition
des parcs et jardins bruxellois. L’exemple le plus frappant du point de vue de
la silhouette est indéniablement l’araucaria déjà mentionné, mais d’autres
espèces de conifère sont remarquables sur ce plan et furent plantées à
Bruxelles : le Tsuga sieboldii, par exemple, que l’on trouve dans le parc
public de Laeken, est un arbre originaire du Japon et fut introduit en Europe
en 1861 ; de même, le sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii), qui est
mentionné sur les bons d’achats de plantes de Delabarrière, le collaborateur
de Grégoire pour les projets d’aménagement du domaine royal de Laeken
et de ses environs, fut introduit en Europe en 1827, d’Amérique du Nord via
l’Angleterre ; ou encore le wellingtonia (Sequoiadendron giganteum), qui
fi gure sur les mêmes bons d’achat, est originaire de Californie et connut
un grand succès en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Les couleurs des feuillages et des fl eurs des arbres et arbustes exotiques
furent également très prisées et jouèrent un rôle croissant, au XIXe siècle,
dans l’aménagement des parcs et des jardins. Ainsi les listes de Delabarrière
mentionnent-elles le paulownia (Paulownia tomentosa ou imperialis),
arbre aux fl eurs violettes tachetées de jaune, originaire de Chine et dont la
première introduction en Europe, au Jardin des Plantes de Paris, remonte
à 1834. Il y a quelques années, un Paulownia tomentosa subspontané (qui
s’est ressemé) a été découvert dans le parc Léopold, à Bruxelles. Au parc
public de Laeken et à l’Arboretum de Tervueren se trouvent de très beaux
magnolias à feuilles acuminées (Magnolia acuminata), arbres provenant
d’Amérique du Nord, aux fl eurs de couleur jaune-verdâtre et au feuillage
apprécié pour ses coloris automnaux. Dans l’assortiment des couleurs des
végétaux exotiques, les modes et les goûts ont considérablement changé
au cours du temps. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on portait un
intérêt particulier aux panachures des feuillages et des fl eurs et l’on
appréciait les contrastes vifs. Louis Fuchs, le créateur du parc Léopold,
se plaisait à planter de fl amboyants lilas à fl eurs doubles violet purpurin,
avec à leurs pieds des aucubas du Japon panachés, composition qui serait
inimaginable actuellement !
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u
Des formes et des couleurs des végétaux exotiques
Bien que présentant de belles nuances de vert, ainsi que d’élégantes
panachures, et offrant l’avantage, surtout appréciable en hiver, de leur
feuillage persistant, les résineux exotiques furent surtout choisis pour leur
port caractéristique, souvent conique ou cylindrique, dans la composition
des parcs et jardins bruxellois. L’exemple le plus frappant du point de vue de
la silhouette est indéniablement l’araucaria déjà mentionné, mais d’autres
espèces de conifère sont remarquables sur ce plan et furent plantées à
Bruxelles : le Tsuga sieboldii, par exemple, que l’on trouve dans le parc
public de Laeken, est un arbre originaire du Japon et fut introduit en Europe
en 1861 ; de même, le sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii), qui est
mentionné sur les bons d’achats de plantes de Delabarrière, le collaborateur
de Grégoire pour les projets d’aménagement du domaine royal de Laeken
et de ses environs, fut introduit en Europe en 1827, d’Amérique du Nord via
l’Angleterre ; ou encore le wellingtonia (Sequoiadendron giganteum), qui
fi gure sur les mêmes bons d’achat, est originaire de Californie et connut
un grand succès en Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Les couleurs des feuillages et des fl eurs des arbres et arbustes exotiques
furent également très prisées et jouèrent un rôle croissant, au XIXe siècle,
dans l’aménagement des parcs et des jardins. Ainsi les listes de Delabarrière
mentionnent-elles le paulownia (Paulownia tomentosa ou imperialis),
arbre aux fl eurs violettes tachetées de jaune, originaire de Chine et dont la
première introduction en Europe, au Jardin des Plantes de Paris, remonte
à 1834. Il y a quelques années, un Paulownia tomentosa subspontané (qui
s’est ressemé) a été découvert dans le parc Léopold, à Bruxelles. Au parc
public de Laeken et à l’Arboretum de Tervueren se trouvent de très beaux
magnolias à feuilles acuminées (Magnolia acuminata), arbres provenant
d’Amérique du Nord, aux fl eurs de couleur jaune-verdâtre et au feuillage
apprécié pour ses coloris automnaux. Dans l’assortiment des couleurs des
végétaux exotiques, les modes et les goûts ont considérablement changé
au cours du temps. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on portait un
intérêt particulier aux panachures des feuillages et des fl eurs et l’on
appréciait les contrastes vifs. Louis Fuchs, le créateur du parc Léopold,
se plaisait à planter de fl amboyants lilas à fl eurs doubles violet purpurin,
avec à leurs pieds des aucubas du Japon panachés, composition qui serait
inimaginable actuellement !
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 2 1
Les plantes exotiques ont aujourd’hui leurs défenseurs comme leurs
détracteurs. Outre leurs qualités esthétiques parfois discutées, les problèmes
d’acclimatation que certaines d’entre elles connaissent constituent l’un de
leurs défauts majeurs : beaucoup d’essences rustiques sous des climats plus
chauds ne résistent pas aux gelées de nos hivers ; d’autre part, de nombreuses
plantes au feuillage panaché n’ont pas une bonne croissance dans nos parcs
et jardins. Au nombre de leurs qualités, il faut mentionner leur rôle primordial
dans la scénographie du paysage : elles dirigent en effet la vue, limitent les
environs, cachent l’indésirable et créent des jeux d’ombre et de lumière, ainsi
que des contrastes de couleurs (49). Quoi qu’il en soit, ces plantes sont des
signes et des témoins historiques de la mentalité d’une époque, celle où art
des jardins et impérialisme faisaient bon ménage.
Notes
(1) JANSSENS, G. et STENGERS, J. (dir.), Nouveaux regards sur Léopold Ier & Léopold II. Fonds
d’Archives Goffi net, Bruxelles, 1997, p. 221, n° 9.
(2) Nous tenons à exprimer ici notre gratitude à Mme Marie-Françoise Degembe, qui nous a apporté
ses conseils et ses encouragements dans la réalisation de ce travail.
(3) BRAUMAN, A. et DEMANET, M., Le parc Léopold 1850-1950. Le zoo, la cité scientifi que et la
ville, Bruxelles, 1985, pp. 161-162 ; DUQUENNE, X., Fuchs, Ludwig, in : Saur Allgemeines Künstler-
Lexikon, 46, Munich-Leipzig, 2005, pp. 61-62.
(4) LIMIDO, L., Un paysagiste français d’envergure internationale : Jean-Pierre Barillet-Deschamps,
maître d’Édouard André, in : ANDRÉ, F. et COURTOIS (de), S. (dir.), Édouard André (1840-1911) un
paysagiste botaniste sur les chemins du monde, Besançon-Paris, 2001, pp. 55-66 ; LIMIDO, L., Jean-
Pierre Barillet-Deschamps, 1824-1873, in : RACINE, M. (dir.), Créateurs de jardins et de paysages en
France de la Renaissance au XXIe siècle, II, Arles, 2002, pp. 43-46.
(5) DUQUENNE, X., Keilig, Frédéric, Edouard, in : Nouvelle biographie nationale, 3, Bruxelles, 1994,
pp. 207-208 ; LOMBAERDE, P., Keilig, Frederik Edward, in : Nationaal biografi sch Woordenboek, 16,
Bruxelles, 2002, col. 503-507.
(6) DUQUENNE, X., Le bois de La Cambre, Bruxelles, 1989, pp. 15-21.
(7) MAUMENÉ, A., en collaboration avec ANDRÉ, R. É. et GIBAULT, G., Deux siècles de jardins à
l’anglaise, La vie à la campagne, IX, 108, 1911, pp. 182-187 ; LIMIDO, L., L’art des jardins sous le
Second Empire. Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873), Seyssel, 2002, pp. 232-245 ; MONCAN
(de), P., Les jardins du baron Haussmann, Paris, 2009.
(8) Archives de la Ville de Bruxelles, Travaux publics, 26915, mémoire de Keilig de décembre 1861 ;
cité dans son entièreté dans DUQUENNE, X., Le bois de La Cambre, pp. 132-136.
(9) ALPHAND, A., Les promenades de Paris, I, Paris, 1867-1873, pp. 80-82, fi g. 93-94.
(10) Archives de la Ville de Bruxelles, Travaux publics, 26914 ; cf. DUQUENNE, X., Le bois de La
Cambre, pp. 99-100, 150, n° 294.
(11) Archives du Palais royal (Bruxelles), Fonds Goffi net ; cité dans CAPRON, V., Le petit Laeken
– non loin du Donderberg. Contribution à Laca, le cercle d’histoire locale de Laeken (manuscrit
dactylographié), Bruxelles, 1992, p. 143.
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 2 2
(12) CAPRON, V., Le petit Laeken – non loin du Donderberg, pp. 37, 44, 51, 56, 60.
(13) KERCHOVE de DENTERGHEM (de), O., Pierre Barillet, Revue de l’horticulture belge et étrangère,
II, 1876, pp. 105-107 ; DEBRUYN, M., Het publieke park van Laken, voor het volk, naar Parijs model
maar Engels geïnspireerd, Laca Tijdingen, XX, 2, 2008-2009, pp. 26-28. Les avant-projets établis par
Keilig en 1866 et par Barillet-Deschamps en 1868 n’ont malheureusement pas été conservés.
(14) DEBRUYN, M., Het publieke park van Laken, pp. 29-31.
Ce plan, conservé, comme celui de Keilig, dans les collections des Archives du Palais royal, à
Bruxelles, n’est ni daté ni signé, mais le témoignage de documents d’archives permet de l’attribuer
à Grégoire et de le rapporter à l’année 1876.
(15) Tacite, Annales, XV, 42, 1 ; ALPHAND, A., Les promenades de Paris, I, p. VIII.
(16) Une carte topographique militaire de 1892 montre clairement la correspondance du tracé du
parc public de Laeken avec le projet de Grégoire ; cf. DEBRUYN, M., Het publieke park van Laken,
p. 37.
(17) RANIERI, L., Léopold II urbaniste, Bruxelles, 1973, pp. 47-48 ; RANIERI, L., Léopold II. Ses
conceptions urbanistiques, ses constructions monumentales, in : BALTHAZAR, H. et STENGERS,
J. (dir.), La dynastie et la culture en Belgique, Anvers, 1990, pp. 180-182 ; LOMBAERDE, P., en
collaboration avec GOBYN, R., Léopold II roi-bâtisseur, Gand, 1995, pp. 71-74.
(18) Le « style Beaux-Arts de l’art des jardins » se défi nit par trois caractéristiques : une homogénéité
des critères de conception et de composition des espaces urbains, bâtiments et espaces ouverts ou
naturels ; un éclectisme du langage formel fondé sur une connaissance de l’histoire des jardins
depuis l’Antiquité ; une recherche d’équilibre, une attitude syncrétique face à l’antagonisme
traditionnel entre le jardin géométrique et le jardin paysager. Cf. SOLA-MORALES (de), I., Le jardin
Beaux-Arts, in : MOSSER, M. et TEYSSOT, G. (dir.), Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours,
Paris, 1991, pp. 395-404.
(19) RACINE, M., en collaboration avec COURTOIS (de), S., Jules Vacherot, 1862-1925, in : RACINE,
M. (dir.), Créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance au XXIe siècle, II, Arles,
2002, pp. 150-153.
(20) Ce projet non exécuté est aujourd’hui conservé dans les archives du Jardin botanique national
de Belgique à Meise ; cf. DIAGRE-VANDERPELEN, D., What shaped the Brussels Botanical Garden
(1826-1912) ? Botany and its numerous competitors duetting or duelling ?, Studies in the History of
Gardens & Designed Landscapes, XXVIII, 3-4, 2008, pp. 405-406.
(21) Annales des Travaux Publics de Belgique, 2e sér., XV, 1910, p. 1111 ; VACHEROT, J., Parcs et
jardins. Album d’études, Paris, 1925.
(22) MAUMENÉ, A., en collaboration avec ANDRÉ, R. É. et GIBAULT, G., Deux siècles de jardins à
l’anglaise, p. 193.
(23) JANLET, J., Jardins de style à l’Exposition, in : ROSSEL, E. (dir.), L’Exposition de Bruxelles.
Organe offi ciel de l’Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1910, II, Bruxelles, 1910,
p. 432.
(24) Archives du Palais royal (Bruxelles), Fonds Goffi net; cité dans JANSSENS, G. et STENGERS, J. (dir.),
Nouveaux regards sur Léopold Ier & Léopold II…, p. 264, n° 10.
(25) STENGERS, J., L’agrandissement de la Belgique : rêves et réalités, in : JANSSENS, G. et
STENGERS, J. (dir.), Nouveaux regards sur Léopold Ier & Léopold II…, pp. 237-286 ; STENGERS, J.,
« Je voudrais faire de notre petite Belgique la capitale d’un immense empire », in : DAELEMANS,
F. et VANRIE, A. (dir.), Bruxelles et la vie urbaine. Archives – art – histoire. Recueil d’articles dédiés
à la mémoire d’Arlette Smolar-Meynart (1938-2000), II, Bruxelles, 2001, pp. 869-887 (Archives et
bibliothèques de Belgique, numéro spécial 64).
(26) Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’empire du Milieu, considérablement affaibli sur le
plan militaire, était en proie à des tensions intérieures et était particulièrement convoité par les
pays occidentaux.
(27) RANIERI, L., Léopold II urbaniste, pp. 199-202 ; GOEDLEVEN, E., en collaboration avec
SMAGGHE, D., Les Serres Royales de Laeken, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1988, pp. 70-72 ;
RANIERI, L., Léopold II. Ses conceptions urbanistiques, ses constructions monumentales, pp.
De
la
pa
go
de
ch
ino
ise
à l
’ara
uc
ari
a d
u C
hil
i
1 2 3
204-205 ; LOMBAERDE, P., en collaboration avec GOBYN, R., Léopold II roi-bâtisseur, pp. 73-76 ; ;
KOZYREFF, Ch., Songes d’Extrême-Asie. La Tour japonaise et le Pavillon chinois à Laeken, Anvers,
2001, pp. 40-61.
(28) Le futur château royal de Laeken. Voir à ce sujet DUQUENNE, X., Le château de Laeken au XVIIIe
siècle, BNB. Revue du personnel de la Banque Nationale de Belgique, XXXII, 9, 1976, pp. 24-31 ; van
YPERSELE de STRIHOU, A. et P., Laeken. Un château de l’Europe des Lumières, Paris-Louvain-la-
Neuve, 1991, pp. 38, 152-155.
(29) Les futurs Royal Botanic Gardens.
(30) LIGNE (de), Ch.-J., Coup d’œil sur Belœil et sur une grande partie des jardins de l’Europe.
Lecture de COUVREUR, M., Bruxelles, 2003, p. 90.
(31) FORSTER, G., Voyage philosophique et pittoresque, sur les rives du Rhin, à Liége, dans la
Flandre, le Brabant, la Hollande, l’Angleterre, la France, etc. fait en 1790. Traduit de l’allemand par
POUGENS, Ch., 2e éd., II, Paris, l’an VIII, pp. 133-140.
(32) Le cachemire était tissé avec les poils de la chèvre originaire de la région de l’Inde portant le
même nom.
(33) LÉVI-STRAUSS, M., Cachemires. L’art et l’histoire des châles en France au XIXe siècle, Paris,
1987.
(34) Les parterres de broderie sont des parterres contenant des fi gures faites avec du buis et
présentant des enlacements de fl eurons et de rinceaux, à l’imitation des tissus de broderie.
(35) Par cette phrase peu claire, René Pechère voulait sans doute dire que, comme Catherine de
Médicis, il était à l’origine de l’introduction de nouveaux motifs dans l’art des jardins, empruntés au
registre des tissus et de la mode.
(36) Bibliothèque René Pechère (Bruxelles), Souvenirs, manuscrit dactylographié de René Pechère,
pp. 56, 59.
(37) Bibliothèque René Pechère (Bruxelles), Mission au Congo belge en 1956, manuscrit
dactylographié de René Pechère, chargé de mission du Ministère des Colonies pour l’Exposition
universelle et internationale de Bruxelles 1958, p. 60.
(38) PECHÈRE, R., Jardins dessinés. Grammaire des jardins, Bruxelles, 1987, pp. 112-117.
(39) BOSSCHERE (de), Ch., Les serres royales de Laeken, Bruxelles-Paris, 1920, pp. 34-38 ; RANIERI,
L., Léopold II urbaniste, p. 185 ; GOEDLEVEN, E., en collaboration avec SMAGGHE, D., Les Serres
Royales de Laeken, pp. 209-211 ; RANIERI, L., Léopold II. Ses conceptions urbanistiques, ses
constructions monumentales, p. 203 ; LOMBAERDE, P., en collaboration avec GOBYN, R., Léopold
II roi-bâtisseur, pp. 41-43 ; SMETS, I., Les Serres royales de Laeken, Gand-Amsterdam, 2001, pp.
26-29.
(40) BOSSCHERE (de), Ch., Les serres royales de Laeken, préface (1914), p. XI.
(41) PÉRIER, G. D., Les jardins congolais et le velours du Kasaï, Bulletin de l’Union des Femmes
coloniales, XXII, 133, 1951, p. 10.
(42) PYNAERT, L., La récolte d’éléments de propagation de plantes congolaises au profi t du Jardin
Colonial de Laeken, Bulletin de l’Union des Femmes Coloniales, XIV, 81, 1937, pp. 1-4 ; PYNAERT, L.,
Les origines du Jardin colonial de Laeken et sa contribution au développement agricole du Congo,
Bulletin Agricole du Congo Belge, XXXVI, 1-4, 1945, pp. 57-78.
(43) Bibliothèque René Pechère (Bruxelles), Mission au Congo belge en 1956, p. 14.
(44) Bibliothèque René Pechère (Bruxelles), Souvenirs, pp. 58-59.
(45) Bibliothèque René Pechère (Bruxelles), Mission au Congo belge en 1956, p. 120.
(46) DE KOONING, M., Un théâtre de « la vie désemmurée, tangible, à ciel ouvert ». Le pavillon
brésilien, in : DEVOS, R. et DE KOONING, M. (dir.), L’architecture moderne à l’Expo 58. « Pour un
monde plus humain », Bruxelles, 2006, pp. 214-229.
(47) DIAGRE-VANDERPELEN, D., What shaped the Brussels Botanical Garden (1826-1912) ?, pp.
408-409.
(48) ANDRÉ, E., Traité général de la composition des parcs et jardins, Paris, 1879, pp. 525-526.
(49) BAUDOUIN, J. C. et SPOELBERCH (de), P., Arbres de Belgique. Inventaire dendrologique 1987-
1992, s. l., 1992 ; ALLAIN, Y.-M. et HOCQUARD, J., Nos arbres venus d’ailleurs, Paris, 2008.