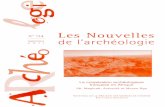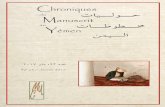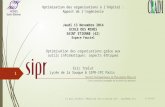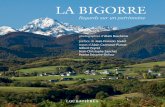Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture
Transcript of Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture
1
« Rafles et internement des étrangers : les nouvelles guerres de capture » Douce France. Rafles, rétentions, expulsions, (O. Le Cour Grandmaison dir.), Paris, Seuil, pp. 45-711,
Marc Bernardot, Université du Havre, CIRTAI, TERRA
« Vous avez totalement carte blanche. Agissez comme bon vous semble. Après tout, vous
avez l’expérience de ces gens-là… Le dispositif de sécurité passe directement sous vos ordres.
A vous de jouer. »
Sidi Ben Barbès
Jean-Charles Fauque
Gallimard, 1978
La politique actuelle, qui réprime les étrangers dits en situation irrégulière et plus
largement les citoyens en pointillé des démocraties occidentales, est-elle nouvelle ou bien
constitue-t-elle une nouvelle forme de gestion des groupes altérisés? Les discours, les
dispositifs et les pratiques qui visent de nos jours les étrangers illégalisés en Europe, et plus
particulièrement en France, puisent leurs références et leurs cadres cognitifs dans l’histoire
coloniale et métropolitaine à la fois. Utilisé comme technique de contrôle et de mise en
valeur, le camp d’internement a trouvé ses premières applications dans le monde colonial.
Dans les métropoles, les premiers sites d’internement pour mettre à l’écart des populations
jugées indésirables se sont développés durant la première guerre mondiale en agrégeant
diverses cultures répressives au terme d’une gestation durant le XIX eme siècle. Le maillage
1 Cet article est dédié à la mémoire de Bruno Etienne, décédé en mars 2009.
2
répressif, à l’intersection des deux cultures coloniale et de police intérieure s’est étendu,
spécialisé et perfectionné durant l’entre-deux-guerres puis durant la seconde guerre mondiale
et ensuite à l’occasion des conflits politiques post-coloniaux, avant d’être adapté à la gestion
des migrations en provenance des pays du Sud. On peut parler en cela d’une continuité
historique dans les procédés de contrôle des étrangers, des migrants et des déviants. Pourtant
les pratiques institutionnelles ont été caractérisées pendant l’essentiel du siècle passé par leurs
formes latentes ou secrètes, à tout le moins non officielles. C’est une différence essentielle
avec la politique qui se déploie et se précise depuis une quarantaine d’années et qui permet de
parler de hiatus historique. Car, depuis la fin des décolonisations, les pratiques policières
répressives à l’égard des étrangers se sont progressivement institutionnalisées en entrant dans
la loi et en devenant un aspect central et hégémonique de l’action et du discours de l’Etat.
L’officialisation des techniques de chasse aux étrangers illégalisés et la pérennisation des
centres de rétention et de déportation à l’échelle nationale et continentale constituent un
changement de paradigme de l’action publique. Il se manifeste par un durcissement
potentiellement sans limite, par la diffusion et la légitimation de cette hostilité à l’ensemble de
la société. L’enrôlement de différentes catégories et secteurs professionnels dans ce
mouvement de répulsion à l’égard de groupes, présentés comme en surnombre et construits en
tant que menace intime, n’est pas l’aspect le moins inquiétant de cette mutation qui s’étend à
d’autres catégories populaires. Je chercherai à comprendre cette évolution et ses possibles
conséquences en trois temps. Je rappellerai tout d’abord les principales étapes du processus
d’institutionnalisation du camp d’internement avant d’évoquer le développement concomitant
des techniques d’arrestations groupées, appelées aussi rafles qui alimentent l’institution de la
rétention et d’expulsion et enfin de proposer une interprétation de cette nouvelle politique en
termes de mutations des principes de la souveraineté d’Etat.
3
L’internement : de procédures latentes à l’institutionnalisation
A partir de la fin du XIXème siècle, le recours à l’internement administratif s’est
généralisé dans le monde colonial comme dans les pays occidentaux. Longtemps resté une
institution latente ou invisible parce lointaine se manifestant à l’occasion de crises, le camp,
en tant que lieu d’application de l’internement, est progressivement devenu une forme sociale
et politique centrale, notamment dans le cadre du contrôle des migrations. L’internement le
distingue fondamentalement de la détention de par son caractère non judiciaire, collectif,
préventif ou rétroactif, et sans durée préétablie. Aussi pose-t-il un problème fondamental aux
systèmes politiques dits libéraux.
La double origine coloniale et métropolitaine de l’internement
Différents formes d’enfermement et de mise à l’écart peuvent être qualifiées de pré-
internementales, telles la léproserie, le ghetto italien, la moreira espagnole, «l’ensarrement »
des pauvres ou encore le bagne français. Certaines institutions de la Révolution industrielle,
comme la Workhouse anglais, présentaient aussi des caractéristiques qui annonçaient la
forme-camp. Celle-ci constitue en fait le chaînon faisant le lien entre les régimes
disciplinaires du XVIII eme siècle, les organisations biopolitiques du XIX eme siècle et les
actuelles sociétés de contrôle. Si les origines de l’internement administratif sont multiples
(lettres de cachet de l’Ancien régime, lois révolutionnaires sur les suspects, archipel répressif
impérial) on peut cependant les regrouper selon deux modèles principaux, l’un dans l’espace
4
colonial comme technique de maintien de l’ordre et de mise en valeur1, l’autre dans le monde
européen comme procédé de police politique et de gestion des populations indésirables2.
Dans le cadre colonial, l’internement et sa matérialisation avec l’espace du camp ont
assuré des fonctions politiques et stratégiques lors de conflits armés. Ils visaient aussi des
objectifs économiques pour la mise en valeur des territoires (Afrique du Sud, Philippines,
Cuba, Congo belge). Les camps étaient un moyen de quadriller et de contrôler les contrées
conquises mais aussi de déplacer et d’exploiter les populations comme forces de travail
contraintes. Les colonies fournissaient par ailleurs des espaces de relégation pour les déportés
et les convicts. Les camps représentaient enfin un instrument d’épuration raciale dans le cadre
de la substitution des colons européens aux autochtones des territoires de conquête selon des
modalités déjà utilisées de manière sommaire dès la Première colonisation pour cantonner et
« resserrer » les indigènes afin de récupérer leurs terres. Le camp a pu aussi à l’occasion
assurer la protection des autochtones (des reducciones et des ségrégations jésuites en
Amérique du Sud au XVII eme siècle aux villages de regroupement au Vietnam et en Algérie
dans les années 1950-1960) ou servir de base à la colonisation de territoires par des groupes
d’indésirables expulsés de la métropole (colonies agricoles ou pénitentiaires) par exemple
dans les empires russe, britannique et français3.
En Europe, après une période de gestation et d’applications limitées dans des
domaines spécifiques, en psychiatrie notamment, à partir des années 1830, c’est lors de la
première guerre mondiale, conflit total, où les civils ont été systématiquement visés en tant
que tels, que l’internement a trouvé sa première application globale. Le camp s’est généralisé
pour l’enfermement des civils ennemis (ressortissants des pays belligérants) et des otages
(élites locales internées), le regroupement dans une perspective militaire des réfugiés et des
1 Pour plus de détails voir mon article « Les camps d’étrangers, dispositif colonial au service des sociétés de contrôle. », in Projet, n° 309, 2009. 2 P. Legendre, Trésor historique de l’Etat en France. L’administration classique, Paris, Fayard, 1992. 3 A.-L. Stoler, Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense, Princeton, Princeton University Press, 2009. Voir notamment “The Carceral Archipelago of Empire”, pp. 131 et suiv.
5
expulsés, le casernement séparé des indigènes coloniaux transplantés, la surveillance des
groupes mobiles comme les nomades, les forains et les « indignes » (vagabonds,
prostituées…) et la mise hors d’état de nuire des ennemis politiques. La plupart des pays
occidentaux (USA, Canada, Australie, Grande-Bretagne…) ont mis en place de tels espaces
répressifs et de containment, visant soit des civils étrangers potentiellement dangereux mais
aussi des nationaux suspects du fait de leur double nationalité ou de leur origine1.
A partir de ce moment inaugural la mise en camps d’étrangers va se généraliser
durant l’entre-deux-guerres en devenant le modèle de la prise en charge des réfugiés en
Europe et au Proche-Orient. Dans le cas de la France on peut citer les réfugiés arméniens,
juifs ou espagnols notamment, pour lesquels la Troisième République va constituer un réseau
de centres d’hébergement doublé de camps répressifs de surveillance des militants étrangers
et français vers la fin des années 1930. Puis lors de la seconde guerre mondiale les camps vont
devenir l’un de ses symboles avec la destruction des Juifs d’Europe, même si la Shoah s’est
aussi déroulée ailleurs. Dans sa gestation comme institution, la forme-camp a fait fond sur
différentes expériences du confinement et de l’éloignement, de la mise au secret et de la mise
au travail, de la discipline et du châtiment. En cela il a agrégé des éléments des cultures
militaires, cénobitiques, carcérales et industrielles2 et aussi des expériences de la quarantaine,
de la déportation, de la traite et de la plantation3. De cette variété constitutive l’internement en
camp a tiré une plasticité qui en a fait sa force essentielle c’est-à-dire une capacité à être
adapté et modulé selon les circonstances et des objectifs changeants depuis la répression
jusqu’à la protection en passant par la sélection, tout en conservant une certaine simplicité
minimaliste qui lui a conféré sa longévité.
1 M. Stibbe, ‘The Internment of Civilians Belligerent States during the First World War’, in Journal of Contemporary History, 41, 2006. 2 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975. Voir en particulier le dernier chapitre, « Le carcéral », pp. 300 et suiv. 3 S. W. Mintz, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New York, Viking, 1985.
6
L’institutionnalisation de l’internement des étrangers et des déviants
Après son apparition au XIX eme siècle le camp a fonctionné pendant près d’un siècle
comme une institution latente fortement présente et visible durant certaines périodes de crises
puis continuant à fonctionner à bas bruit sous des aspects divers entre deux circonstances
d’exception. Différences phases se sont ainsi succédées donnant lieu à la spécialisation des
cadres d’application, la circulation des savoir-faire et une sédimentation réglementaire. Des
autorités, différentes selon les pays, ont progressivement investi ce domaine d’intervention.
Cela leur a permis d’étendre leur champ de compétences, de former leur personnel, de
produire des catégories de déviants – le camp fonctionnant comme un laboratoire alternant
universalisation et différenciation- et, c’est sans doute un aspect primordial, de se renforcer
dans la guerre pour et par le contrôle de l’espace1. Dans le cas français par exemple, le
ministère de l’intérieur, chargé de suppléer l’armée dans la prise en charge des réfugiés et des
ennemis politiques au cours de la première guerre mondiale, a progressivement intégré les
savoir-faire d’autres ministères ou organisations, économiques notamment et a
professionnalisé ce mode d’intervention. La gestion politique et technique des centres
d’internement s’est transformée depuis les premiers camps de concentration de 1914
jusqu’aux centres d’assignation à résidence surveillés (CARS) de la guerre d’Algérie entre
1957 et 1962 en passant par les centres de séjour surveillé (CSS) de Vichy et de l’Epuration,
dans un mouvement discontinu de perfectionnement et une alternance de périodes
d’amalgame des traditions et de modèles d’organisation, des règlements et des personnels
d’internement puis de diffusion à d’autres secteurs. Le ministère de l’intérieur s’est ainsi
1 Z. Bauman, Le coût humain de la mondialisation, Paris, Hachette, 1999.
7
positionné comme un acteur clé des politiques de gestion des flux de populations
(immigration, logement social et asile) en faisant circuler des compétences d’un secteur à
l’autre et passant de la surveillance des indigents et des indigènes en métropole dans la
première partie du XX eme siècle à celle des exclus et des étrangers dans la seconde. Ailleurs
en Europe ou plus loin, les techniciens de l’internement ont combiné des traditions différentes
selon les histoires institutionnelles, politiques et sociales1.
Dans ce processus de longue durée on peut identifier plusieurs moments de ruptures et
de recompositions, dans les modalités d’application comme dans les objectifs des autorités
(gestion de guerre civile, transit, sortie de crise…), en fonction des contextes et des variations
de réactions collectives au recours à l’arbitraire. Le moment déterminant dans l’évolution
contemporaine de l’internement correspond au bascule, au cours des années 1960, des
politiques de gestion des indigènes coloniaux en métropole à celles de contrôle des flux
migratoires des migrants postcoloniaux et plus largement de la surveillance du territoire2. En
effet, en 1964, peu de temps après la fin de la guerre d’Algérie et la fermeture des centres
d’assignation des Algériens, la police nationale ouvre en secret à Marseille -à Arenc- le
premier centre de rétention contemporain sur la base d’un règlement des années 1930, destiné
à faciliter le renvoi d’étrangers. S’ouvre alors une nouvelle ère de l’internement qui joue
aujourd’hui un rôle central dans le dispositif global de contrôle des frontières internes et
externes de la société française. Il en va de même pour les autres pays européens avec des
variations relatives la fois aux traditions institutionnelles nationales, par aux recompositions
des fonctions policières depuis la chute du mur de Berlin, du fait notamment de leurs
privatisations et des évolutions des technologies de surveillance, et enfin par le mouvement
continu d’intégration européenne, concernant les questions de circulations migratoires.
1 Sur tous ces points je renvoie à mon ouvrage Camps d’étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Editons du Croquant, 2008. 2 M. Rigouste, L’Ennemi intérieur postcolonial. De la guerre coloniale au contrôle sécuritaire (1954-2007), Paris, La Découverte, 2008.
8
Ainsi, en plusieurs étapes, la rétention administrative des étrangers est passée du stade
de l’usage secret par la police à une utilisation massive par les politiques d’immigration dans
la plupart des pays européens1. En France la rétention des étrangers dans des centres (CRA)
en vue de leur expulsion a été officialisée, entre la fin des années 1970 et le début des années
1980, dans le cadre de l’ordonnance de 1945 sur les conditions d’entrée et de séjour sur le
territoire. Selon un processus identique allant d’une relative clandestinité vers l’officialisation,
d’autres formes de confinement sont venues s’ajouter au dispositif comme les zones d’attente
des personnes en instance (ZAPI) ainsi que des techniques d’éloignements groupés. Cette
évolution vers l’institutionnalisation n’empêche pas la perpétuation et le développement,
parallèlement aux installations officielles, de formes ad hoc, comme les locaux de rétention
administrative (LRA) qui peuvent fonctionner n’importe où, quasiment en dehors de tout
contrôle et sur la simple décision d’un haut fonctionnaire préfectoral. Cette combinaison de
dispositifs légaux et illégaux n’est d’ailleurs pas pour rien dans la contamination du système
libéral par l’arbitraire et fonctionne comme un piège tactique tendu aux défenseurs des
libertés individuelles. En effet chaque remise en cause de l’internement ou appel à la décence
des conditions d’enfermement à l’occasion d’une mobilisation de soutien ou d’une
dénonciation publique débouche à terme non pas sur une régularisation des exilés mais sur
celle du dispositif clandestin.
Depuis le début des années 2000, la rétention ne ressort plus du simple domaine
administratif et réglementaire mais de la loi. Elle sort renforcée de la course à l’harmonisation
européenne en matière de gestion de l’immigration. Dorénavant plus de vingt-cinq centres de
rétention administrative et plus d’une centaine de locaux de rétention fonctionnent en France,
par lesquels plus de 40 000 personnes transitent chaque année dont les trois-quarts sont
effectivement « éloignées » du territoire. De nouveaux centres sont construits et les pouvoirs
1 C. Kobelinski, C. Makaremi (dir.), Enfermés dehors. Enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges, Editions du croquant, 2009.
9
publics fixent par la loi des objectifs chiffrés toujours plus élevés d’arrestations et
d’expulsions à l’institution policière. Ce qui était auparavant difficilement reconnu par les
autorités, par exemple pendant la guerre d’Algérie, est maintenant un argument politique
décisif et la démonstration tangible de la capacité de l’Etat de corriger une situation
d’illégalité qu’il a lui-même provoquée en durcissant les conditions légales d’entrée et de
séjour des résidents étrangers.
Ainsi légalisés et assumés par les pouvoirs publics, le système du camp et la culture
d’internement se propagent dans l’espace social et politique selon deux axes. Le premier axe
de propagation consiste à systématiser la réclusion administrative comme une option
corrective des décisions de justice ; lorsqu’elles sont considérées comme insuffisantes pour le
maintien de l’ordre public, avec le placement en centres fermés des mineurs récidivistes et des
délinquants sexuels en rétention de sécurité. Le second axe prolonge la rétention par un
continuum d’espaces de confinement qui communiquent entre eux et à l’intérieur duquel
circulent, sous contrainte, des populations jugées indésirables. C’est le cas de la prison qui
complète le dispositif (près de 20 % des détenus en France sont étrangers dont la moitié pour
infraction à la législation sur l’entrée et le séjour) et qui fait de certaines maisons d’arrêt des
centres de rétention bis. Il en va de même pour d’autres espaces relevant du sous-habitat
social que j’appelle le logement contraint (foyers d’étrangers, centres d’hébergement de
demandeurs d’asile, aires d’accueil de nomades, zones et places de stabilisation de sans abris,
villages d’insertion de Rroms, etc.) tout comme pour des lieux de regroupement momentanés
(habitats auto-construit, jardins publics, squats, jungles…). Ces zones peuvent, de manière
plus ou moins systématique, faire l’objet d’un contrôle policier et d’arrestations groupées
aussi dénommées rafles.
Rafles d’étrangers : des pratiques anciennes devenues routinières
10
Cette intégration de l’internement administratif dans les politiques d’immigration
suppose une extension et une systématisation de techniques d’arrestation des étrangers
illégalisés. Les rafles qui étaient jusqu’alors une modalité exceptionnelle ou officieuse
d’intervention de la police dans sa gestion de groupes sociaux jugés déviants sont
progressivement devenues un élément essentiel du dispositif étatique de contrôle de la
mobilité et de la pauvreté.
Ancienneté des pratiques policières de la rafle
Pour s’interroger sur la question de la continuité des pratiques policières et
institutionnelles d’appréhension (aux deux sens de prendre par corps et d’intellection) des
étrangers en situation irrégulière, il faut les replacer, tout comme le camp et l’internement,
dans une histoire à la fois métropolitaine et coloniale. Les ouvriers, notamment dans les zones
d’habitat spécifiques, tels les meublés, les garnis et les hôtels pour célibataires, ont été l’objet
d’une vigilance spécifique depuis le milieu du XIX eme siècle dont on retrouve la trace dans le
vocabulaire avec l’expression Hôtel de préfecture. Ces catégories populaires, souvent des
célibataires, parfois étrangers, changeant d’emploi et se déplaçant sur le territoire, étaient à la
fois surveillées, fichées (livret ouvrier) et d’autant plus facilement contrôlées qu’elles
logeaient dans des établissements spécialisés.
De même, des modalités particulières d’encadrement et de surveillance pour les
indigènes en provenance des empires coloniaux ont été mises en œuvre à partir de la fin du
XIX eme siècle. Il n’était alors pas question pour les autorités de laisser se déplacer librement
ces Africains ou ces Chinois, le plus souvent travailleurs requis, sur le territoire métropolitain.
Soit ils étaient pris en charge séparément par les entreprises (par exemple des casernements
11
séparés pour les Kabyles dans la sidérurgie, les Malgaches ou les Chinois dans les
poudreries). Dans ce cas, la surveillance policière venait compléter le contrôle strict exercé
par l’employeur industriel. Soit, par exemple à l’occasion de la démobilisation de tirailleurs
coloniaux, les pouvoirs publics cherchaient à surveiller et à contrôler les déplacements de ces
sujets impériaux avant un éventuel rapatriement collectif. Des services spécialisés de type
Brigade des affaires indigènes, associant surveillance policière et recensement sanitaire et
social, ont été mis en place à partir des années 1920 pour contrôler les ouvriers coloniaux, à
Paris notamment. Ils ont joué un rôle important, à l’instar des directions chargées de
l’internement administratif, dans la structuration de la politique de contrôle des migrants.
L’euphémisation du lexique public en matière de pratiques étatiques violentes
participe de cette difficulté à désigner des faits concrets. Ainsi si l’emploi du terme de rafle à
propos des sans papiers fait polémique, tout comme celui de camp –, c’est surtout parce qu’il
s’agit d’une technique classique d’intervention policière qui pose problème dans un cadre
démocratique par son caractère préventif et collectif, et fonctionnant à partir de l’effet de
surprise sur un mode spectaculaire1. Dans le contexte français les mots de déportation, de
rafle ou de camp sont associés au traitement des juifs en France pendant la seconde guerre
mondiale. Les historiens français de cette période considèrent que leur emploi dans un cadre
scientifique ou même militant est problématique sinon impossible – alors que l’usage du
terme de deportation s’est banalisé en anglais. Pourtant la technique des rafles a aussi été
systématiquement utilisée à Paris (et a fortiori à Alger) durant la guerre d’Algérie avec près
de 40 000 arrestations et 14 000 internements administratifs2. Dans le premier cas ce type
d’arrestation de masse est un préalable à la déportation et à l’élimination physique dans le
système concentrationnaire. Dans le second la rafle expose potentiellement à l’internement, à
1 J’utilise ici le terme dans sa définition ordinaire remontant à 1867 d’ « arrestation massive opérée à l’improviste par la police dans un quartier ou un établissement suspect », Dictionnaire Le Robert, Paris, 1989. 2 J. Delarue, « La police en paravent et au rempart », in La guerre d’Algérie et les Français, J.P. Rioux (dir.), Paris, Fayard, 1990.
12
la torture et à l’exécution. On peut aussi rattacher cette tradition à des techniques coloniales
souvent très brutales, comme la chasse aux esclaves marrons ou les encerclements pour
affamer ou enfumer des groupes humains en rébellion, déployés par les autorités, policières
ou militaires, mais aussi par des milices de colons et des propriétaires de plantation. La chasse
aux sorcières de l’histoire moderne constitue aussi un possible, même si lointain, précédent.
Par ailleurs ces techniques doivent être pensées en relation avec des procédés de prise en
charge collective destinés à contrôler, identifier ou réprimer des groupes supposés menaçant.
Les modes d’appréhension policière et d’arrestations coordonnées des groupes présentés
comme déviants - homosexuels jusque dans les années 1970, prostituées, pédophiles- ou issus
des milieux politiques révolutionnaires ou d’extrême gauche sont comparables aux modalités
de traitement des étrangers post-coloniaux 1.
Le lexique de la chasse est très présent dans le discours et dans l’imaginaire policiers.
Il relève principalement les images animalières et du gibier. Les termes de souricière, de
nasse, de planque, de coup de filet renvoient à la cynégétique et sont articulés à une
représentation essentialisée des groupes ainsi gérés, participant ainsi d’une application de
principes biopolitiques. Ils sont décrits comme des milieux constitués d’éléments
indifférenciés dans une perspective écologique qui est cohérente avec la présentation
zoologique des espèces nuisibles ou invasives. Cette théorie du milieu doit se comprendre en
lien avec des territoires précis, qu’ils soient fixes ou de passage : couloirs maritimes de transit,
espaces frontaliers, zones résidentielles ou commerçantes de centralité immigrée, stations de
métro ou gares, foyers de travailleurs, lieux de travail ou d’embauche, tels les chantiers, les
agences d’intérim et les entrées de ville. La rafle peut servir à mettre hors d’état de nuire tout
un groupe, présenté comme en surnombre ou menaçant, mais peut aussi être un moyen
d’arrêter quelques individus spécialement recherchés pris en même temps que la masse ou
1 Ces groupes se recoupent parfois, notamment en ce qui concerne les étrangers, les prostitué(e)s et les militants révolutionnaires.
13
encore viser à perturber le fonctionnement habituel d’une communauté. Elle ne peut, sauf
exception, se faire sur un territoire étendu et viser une population dispersée. La concentration
spatiale du groupe ciblé est décisive pour l’application de cette technique de prise. Les
stratégies policières et urbaines d’endiguement et de fixation trouvent ici l’une de leurs
justifications. Au delà de ces quartiers réservés la police doit s’en remettre à la technique du
contrôle au faciès considérée par les autorités comme un procédé normal et efficace à défaut
d’être légitime.
Vers la systématisation de la traque des étrangers illégalisés
A la manière d’Hippocrate à propos des chirurgiens et de la guerre on peut dire que la
chasse aux sans-papiers est la meilleure école de la police. Tout comme l’internement, les
arrestations groupées systématiques participent d’un renouvellement de ses méthodes
d’action. Si les techniques policières de surveillance, de contrôle et de rafle sont anciennes et
ancrées dans les cadres cognitifs de la profession, elles sont dorénavant intégrées à un
dispositif plus large de sécurité maximale et de xénophobie institutionnelle. Ce qui était un
procédé de maintien de l’ordre public visant occasionnellement tel ou tel groupe, est
progressivement devenu durant ces dernières décennies, au terme d’une radicalisation à la fois
discursive et légale à l’encontre des étrangers du Sud, un procédé systématique d’arrestation.
Il participe d’une politique d’intimidation et d’exfiltration d’une catégorie de résidents en vue
de leur expulsion du territoire. Ce qui était une solution ponctuelle à la disposition de la police
pour intervenir dans une situation d’urgence prend dorénavant place à la fois dans un
diagramme institutionnel explicitement hostile aux étrangers et dans un dispositif pratique
officiel de harcèlement et de répulsion. Les arrestations groupées participent d’un ensemble
de modalités de contrôle du territoire et d’opérations dans lesquelles interviennent plusieurs
14
services policiers souvent coordonnés (police nationale ou municipale, CRS, douanes ou
police des frontières, sociétés de sécurité privées, etc.). La pression mise sur ceux-ci par les
discours publics et la frénésie législative en matière de répression de l’immigration facilite la
généralisation du recours à des pièges pour arrêter les étrangers. Les exemples ne manquent
pas. Les associations de soutien et de défense des étrangers mentionnent de fausses
convocations administratives, des arrestations d’enfants à l’école pour contraindre les parents
ou les proches, des interventions au-delà de la légalité dans des centres de demandeurs d’asile
pour interpeller des réfugiés déboutés, des descentes dans les foyers pour des motifs autres
que les objectifs réels de contrôle des sans-papiers, qui rapprochent ces méthodes du
kidnapping et de la séquestration crapuleuses mais sous une forme légale et qui sont parfois
consécutives à des dénonciations par des personnels des institutions de santé ou éducatives,
des sociétés de transports, etc.
S’y ajoutent d’autres modes d’intervention qui complètent l’arrestation groupée. Les
policiers peuvent faire murer des squats ou détruire des zones d’habitats autoconstruits et des
caravanes utilisées par des familles Rroms en Ile-de-France. Ils peuvent rendre inhabitables
des blockhaus, brûler des taillis abritant des migrants sur les plages dans les environs de
Calais, écrouler les installations provisoires dans un jardin public ou ruiner des campements
urbains. Les arguments mobilisés, lorsque les pouvoirs en prennent encore la peine, sont très
proches de ceux, moraux ou politiques, utilisés dans les politiques de rénovation urbaine
(illégalité, insalubrité, insécurité, risques de sinistre, ordre public…) qui se soldent le plus
souvent par l’expulsion des usagers ainsi délogés. La temporalité de ces interventions peut
varier. Une brigade CRS peut aléatoirement interpeller, harceler ou gazer des migrants sur le
trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou bien lorsqu’ils se dirigent vers un lieu
d’accueil ou de soutien. Une opération de nettoyage d’un quartier ou d’un secteur occupé peut
être programmée à l’occasion d’une visite officielle et d’une couverture médiatique annoncée.
15
Ce type d’intervention rapproche nettement les techniques visant les sans-papiers de celles
traitant les sans-abri. Les publics cibles sont alors appréhendés mais l’objectif est d’abord leur
éloignement momentanée et leur dispersion et consiste parfois à les déplacer vers un point
isolé du territoire pour ralentir leur retour. Dans un cas comme dans l’autre, quels que soient
les contextes, il s’agit d’insécuriser voire d’empêcher toute installation collective qui rendrait
visible les sans et possible le développement d’une aide associative ou d’une solidarité de
riverains, qui sont aussi de plus en plus ciblés, en établissant un rapport de force avec les
autorités. La récurrence et la brutalité des modes d’intervention varient aussi selon les lieux
et les périodes. Des rafles et des battues menées par des unités de police et des civils sont
évoquées à Mayotte contre des Comoriens ou à la Guyane à l’encontre des Surinamiens. Les
arrestations peuvent s’intensifier à certaines occasions, durant des périodes électorales ou
pour satisfaire aux exigences de résultats et atteindre les quotas fixés par les autorités et
dorénavant chiffrés par la loi. Cette technique ancienne1 des forces de l’ordre qui consiste à
faciliter le déplacement et le regroupement de certains groupes cibles est maintenant une
procédure intégrée dans un arsenal banalisé. Elle converge par ailleurs avec une tendance
ancienne à la surarrestation et à la surincarcération des migrants post-coloniaux et des jeunes
perçus comme étant d’origine étrangère2.
La multiplication des occasions du recours à la force débouche sur une brutalisation et
une banalisation de la violence dans la prise en charge de ces publics. A partir de la violence
de la loi, ses représentants sont incités à un devoir d’inhumanité à la fois en amont de la
rétention, dans les techniques d’arrestation, et dans le cadre même de la rétention - notamment
pour éviter la rébellion des internés, et en aval dans les modalités d’éloignement. Cet usage
extensif de la violence contamine les rapports sociaux à partir du camp d’étrangers par
l’enrôlement d’autres acteurs institutionnels dans la dénonciation et l’arrestation des individus
1 F. Jobard, « Le banni et l'ennemi. D'une technique policière de maintien de la tranquillité et de l'ordre publics », in Cultures & Conflits, 43, 2001. 2 L. Wacquant, Punir les pauvres, Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Marseille, Agone, 2004.
16
illégalisés mais aussi par l’intimidation et la criminalisation des témoins ou des opposants à
cette férocité revendiquée1.
Cette extension contemporaine des modalités d’internement et de confinement ainsi
que des pratiques d’arrestations et d’expulsions groupées doit être comprise dans le cadre plus
général d’une militarisation de la question sociale et d’une tentative de restriction globale des
mobilités et des libertés. Ces dispositifs s’intègrent en effet à un ensemble de techniques et de
procédés à la fois fixes, avec l’érection de murs frontaliers ou urbains, mobiles, par
l’installation de checkpoints2, et dématérialisés ou miniaturisés par la diffusion de nouveaux
moyens de détection et plus largement de technologies furtives3. Cette mutation concomitante
des discours et des manifestations d’hostilité vis-à-vis des étrangers est la conséquence d’un
changement idéologique et politique global qui touche l’exercice de la souveraineté des Etat-
Nations.
La gestion de l’étranger au centre d’une nouvelle configuration politique
La systématisation du recours à ces techniques policières et administratives de la rafle
et de l’internement des étrangers illégalisés est une conséquence de l’installation de la
question des migrations non seulement dans les discours mais aussi dans l’agenda et
l’organigramme politiques des pays démocratiques. Les causes de cette évolution qui marque
une rupture dans l’histoire du modèle politique libéral sont à chercher d’abord dans
l’émergence d’un néo-racisme institutionnel. Plus fondamentalement les relations
qu’entretiennent les Etats contemporains avec les migrations annoncent une souveraineté
postcoloniale qui articule de manière renouvelée un mode de production néo-libéral avec un
1 A ce propos voir mon article « Une tempête sous un CRA. Violences et protestations dans les centres de rétention administrative français en 2008. », in Multitudes, 35, 2009. 2 E. Ritaine, « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l’asymétrie », in Cultures et conflits, 73, 2009. 3 A. Brossat, « L'espace-camp et l'exception furtive », in Lignes, 26, 2008.
17
mode de destruction1 comparable aux guerres de capture étudiées par Claude Meillassoux
dans l’ancien Dahomey2. En prolongeant la célèbre phrase de Charles Tilly on peut dire
aujourd'hui que la guerre aux migrants fait l’Etat et que l’Etat fait la guerre aux migrants.
L’émergence d’un néo-racisme institutionnel
Il faut maintenant s’interroger sur les conditions générales qui ont favorisé le
développement de cette nouvelle configuration du traitement de l’étranger du Sud autour de
l’arrestation de masse, de l’internement et de l’expulsion. La question est particulièrement
complexe du fait de la combinaison, plutôt de l’intrication, d’une radicalisation concrète des
frontières et d’une promotion discursive de la diversité comme deux faces d’une même carte.
On peut d’abord évoquer, au moins pour le cas français, l’émergence continue ces dernières
décennies d’une administration de l’immigration au centre de l’Etat. Si le cheminement de la
gestion publique de l’immigration court sur plus d’un siècle, la structuration de ce secteur
s’est fortement accélérée depuis le milieu des années 1960. Longtemps du domaine des
institutions ad hoc et du bricolage réglementaire, le pilotage public s’est progressivement doté
d’une administration centralisée3. La constitution en 2007 d’un ministère spécialisé dans la
gestion l’immigration est le résultat d’une fusion sous une autorité unique de compétences
auparavant réparties entre plusieurs ministères dont les Affaires sociales, l’Equipement et les
Affaires étrangères. Le ministère de l’intérieur a été le grand ordonnateur de cette
centralisation. La dissolution en 2007 de la direction de la population et des migrations
(DPM) dont les services sont passés sous le contrôle du ministère de l’immigration en est un
des moments les plus significatifs. Cette direction centrale créée en 1966 était peu à peu
1 D. Colas, Sociologie politique, Paris, PUF, 1994. 2 C. Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, Paris, PUF, 1986. 3 P. Weil, La France et ses étrangers. L’aventure d’une politique de l’immigration de 1938 à nos jours, Paris, Gallimard, 2004 ; V. Viet, La France immigrée. Construction d’une politique, 1914-1997, Paris, Fayard, 1998.
18
devenue le pivot de la politique d’immigration et d’intégration pilotant à la fois les entrées sur
le territoire, l’accès à la citoyenneté et les actions publiques en matière de politiques sociale et
culturelle d’insertion. D’un point de vue institutionnel le passage de ces fonctions sous l’égide
du ministère de l’immigration marque la défaite historique du ministère des affaires sociales
dans la gestion des migrations et de l’intégration face à l’action hégémonique de l’Intérieur
dont les hauts fonctionnaires occupent les postes clés dans la nouvelle structure. Les
premières conséquences de ce mouvement de concentration sans précédant sont de deux
ordres ; d’une part l’essentiel des procédures de gestion de l’immigration et de l’intégration
(la seconde devenant une politique publique de second ordre par rapport à la première), sont
déconcentrées vers les préfectures et perdent leur caractère national (en particulier la
naturalisation) ; d’autre part les institutions spécialisées qui s’étaient développées depuis les
années 1960 en matière de politiques sociale et culturelle notamment (Fonds d’action sociale,
Agence pour le développement des relations interculturelles, Service social d’aide aux
émigrants…) ont été dissoutes ou absorbées par d’autres. Les pouvoirs publics ont clairement
décidés d’inverser le rapport entre l’intégration et les migrants. Ces derniers doivent
dorénavant faire la preuve de leur intégration et de leur adhésion aux principes républicains
avant de pouvoir obtenir des droits au séjour et bénéficier éventuellement d’actions de
soutien.
Le deuxième point, qui sert d’arrière-plan idéologique et culturel au premier, est la
généralisation d’un discours présentant l’immigration comme une menace pour les pays
occidentaux notamment en matière d’identité nationale dont le concept a connu un renouveau
ces dernières années. La politisation de la question migratoire depuis les années 1970 est en
fait la conséquence d’une transformation de l’attitude des élites politiques et culturelles vis-à-
vis de l’altérité postcoloniale, entamée dès les années 1960 à l’occasion des décolonisations.
Dans ce qui peut apparaître comme un paradoxe, au moins à première lecture, ces élites qui
19
participent et profitent pleinement du processus de globalisation, se sont dans le même temps
converties à l’idée qu’il y avait un risque d’invasion migratoire par les populations du Sud
trouvant là une menace de substitution au communisme soviétique. C’est vrai pour la haute
fonction publique en France en particulier qui peut ainsi continuer à affirmer la souveraineté
de l’Etat qui peine à s’exprimer ailleurs, dans le domaine économique notamment. C’est le
cas aussi dans le domaine scientifique où l’on peut constater la réémergence d’un
nationalisme culturel. Le révisionnisme et le renouveau nationaliste à l’œuvre sur l’histoire de
France et de son empire colonial en sont un autre exemple.
La réapparition électorale d’une extrême droite régénérée après le passage à vide des
années d’après-guerre a aussi contribué à la structuration du discours présentant l’étranger
post-colonial comme une menace, fournissant au modèle libéral des arguments justifiant ce
que A. Appadurai appelle « la peur des petits nombres »1. La guerre d’Algérie et le
détournement des théories structuralistes ont eu une importance cruciale pour la
reconfiguration des théories racistes, inégalitaires et différentialistes par la Nouvelle Droite en
France et en Europe2. Ailleurs les théoriciens néo-conservateurs ont utilisé la sociobiologie ou
le behaviorisme, entre autres, pour remodeler l’expression du racisme scientifique et en rendre
acceptable sa promotion dans le cadre d’un nouveau darwinisme social. Dans le cas français
les idées racistes ont occupé une place déterminante chez les concepteurs et les animateurs
des politiques de gestion de l’immigration. Des fonctionnaires coloniaux ont été réincorporés
dans les services publics métropolitains au niveau national et local, dans les domaines de
l’aménagement urbain et de la gestion sociale3 rapatriant les schémas raciaux du monde
colonial.
1 A. Appadurai, Géographie de la colère. La violence à l’âge de la globalisation, Paris, Payot, 2007. 2 C. Guillaumin, L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Gallimard, 2002, P.-A. Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1987. 3 Voir à ce sujet mon ouvrage Loger les immigrés. La Sonacotra 1956-2006, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, 2008.
20
Les années 1960-1970 ont été une période clé en la matière. Les stratégies d’entrisme
d’intellectuels et de leaders d’extrême droite dans la presse et les partis de gouvernement ont
ensuite été favorisées par la politisation de la thématique liant l’angoisse sécuritaire et la
supposée invasion migratoire et par la surenchère ininterrompue en la matière depuis lors à
chaque occasion électorale. Face à cette revitalisation théorique débouchant sur le néo-
racisme contemporain1 et ses traductions tant dans les relations internationales (Clash of
Civilisations et War Against Terror par exemple) que dans les champs politiques nationaux,
les soutiens traditionnels des étrangers dans les partis de gauche et dans la société civile ont
perdu la bataille idéologique. Souffrant certes des ambiguïtés des Lumières et de l’idée
républicaine2, la gauche a capitulé peu à peu ces dernières années sur la question de
l’immigration, participant même à l’occasion à la pérennisation et au développement des
dispositifs anti-migratoires, depuis l’échelle internationale jusqu’au niveau local. Tout en se
convertissant simultanément à l’idéologie sécuritaire et à celle du marché, la gauche française
a continué à accroire dans la capacité des politiques publiques à résoudre la question de
l’intégration, alors même que la société civile et les migrants s’en étaient chargés et que le
principal responsable et inspirateur de la ségrégation spatiale, des discriminations systémiques
dans l’emploi et de l’arbitraire policier légalisé à l’encontre des nouveaux venus et des
populations perçues comme issues de l’immigration était précisément l’Etat. L’idéologie
sécuritaire et du contrôle a par ailleurs fournit le cadre de la constitution de dispositifs
communs de lutte contre le terrorisme, l’immigration et la criminalité organisée à l’échelle
nationale et supranationale. La combinaison de ces facteurs a permis la généralisation des
1 E. Balibar, I. Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1997. 2 C. Reynaud Paligot, La République raciale. Paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930), Paris, PUF, 2006 ; O. Le Cour Grandmaison, La République impériale. Politique et racisme d’Etat, Paris, Fayad, 2009.
21
techniques de surveillance et la diffusion de la culture du contrôle dans l’ensemble de la
société contemporaine1.
Etats vs migrations : une nouvelle souveraineté postcoloniale
Cette transformation du rapport aux mobilités et aux étrangers est d’une telle ampleur
qu’elle oblige à se poser la question d’une mutation du fonctionnement de l’Etat-Nation, de sa
souveraineté et des bases de la domination politique. Il est possible que soit en train
d’apparaître un nouveau régime de déportation2 que j’appelle aussi le Grand éloignement en
écho à M. Foucault. Le fait que les autorités aient identifié les migrations comme remettant en
cause leurs capacités à défendre l’intégrité physique du territoire et l’identité nationale a
provoqué la généralisation de procédés exceptionnels utilisables en cas de catastrophe et de
l’application de principes de prise en charge militaire à des populations civiles, dont nous
avons rappelé l’existence latente depuis la première guerre mondiale. Les discours régaliens
réaffirment sans cesse la légitimité souveraine de l’Etat de contrôler ses frontières et
d’accepter ou non la présence de résidents étrangers sur son sol. La présentation récurrente
depuis les années 1960 des migrations postcoloniales comme une menace d’invasion et de
subversion à la fois politique –terrorisme islamiste, culturelle – non respect du way of life
occidental, et économique – refus du « fardeau » des migrants -, justifie la désignation des
migrants comme des ennemis, dans un perspective schmidtienne3.
Les principes qui ont prévalu pour la mise en place d’organismes de gestion de
l’immigration postcoloniale qui visaient à empêcher ou retarder en l’installation (ségrégation
professionnelle et isolement résidentiel notamment) ont été dépassés par la capacité de
1 J.-C. Paye, La fin de l’Etat de droit. La Lutte antiterroriste de l’exception à la dictature, Paris, La Dispute, 2004. 2 N. de Genova, N. Peutz., The Deportation Regime: Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Durham, Duke University Press, 2009. 3 C. Meillassoux, op. cit.
22
mobilité et d’intégration dont ont fait preuve la société civile et les migrants. La radicalisation
des pouvoirs publics en matière d’immigration est une réponse à cette évolution vers le
multiculturalisme antinomique avec les principes ethniques de la constitution historique de
l’Etat1 et une manière concrète de montrer la permanence de son autorité remise en cause par
ailleurs par la globalisation des échanges. Incapable de s’opposer efficacement à la circulation
des idées et des marchandises, l’Etat pense en revanche pouvoir s’affirmer dans le contrôle
des mobilités individuelles par les frontières extérieures et intérieures de l’espace national,
alors même qu’il a été constaté un peu partout une tendance lourde à la privatisation de ces
fonctions régaliennes (police, prison, guerre…) avec des conséquences d’émiettement de la
souveraineté. Cette tentation peut être comprise comme une volonté de restructuration de la
société par un mode de destruction, ou encore de désintégration, d’un nouveau type qui agit
sur les modes de production et de communication. La désignation des étrangers et des
citoyens en pointillés (par exemple des binationaux ou descendants de migrants postcoloniaux
ou présentés comme tels, suspects d’une insuffisante loyauté vis-à-vis de leur nation
d’adoption) comme des dangers pour la société passe par la réorientation des institutions
spécialisées et l’enrôlement d’autres institutions centrales de socialisation et de redistribution
dans la guerre qui leur est faite. Ce mode de destruction, qui est comparable aux guerres de
capture d’esclaves, acquiert un rôle croissant dans la gestion du modèle économique néo-
libéral en contribuant à la régulation policière des tensions accumulées dans les marchés du
travail et du logement, segmentés et hiérarchisés, dans lesquels les travailleurs illégalisés
occupent une place déterminante – bien qu’occultée par leur invisibilité. Le mode de
destruction s’applique aussi à la détermination du clivage entre inclusion et exclusion de la
citoyenneté, qui fait de cette dernière un privilège réservé, et des rapports sociaux influencés
1 A. Appadurai, op. cit.
23
par la généralisation des procédures de détection et d’authentification qui dénote d’une culture
de la suspicion.
La politique contre l’immigration clandestine est une action de gestion et de régulation
d’une catégorie de main d’œuvre dévalorisée mais centrale dans le mode de vie urbain et post-
industriel. J’ai insisté ailleurs sur le caractère domestique de la présence des sans-papiers qui
oeuvrent en grande partie dans des secteurs qui fournissent des services de conforts aux
citoyens protégés (travaux éprouvants ou dégradants, alimentation et restauration, prêt-à-
porter, garde d’enfants et de vieillards, nettoyage et entretien à domicile…)1. La guerre aux
migrants, devenue une instance économique répondant aux besoins du système néo-libéral en
constituant une réserve de travailleurs sans droits, révèle une double hégémonie à l’œuvre.
L’une, interne, est le fait d’institutions de sécurité renforcée qui développent une industrie de
la rétention et accroissent leur emprise et leur capacité d’intrusion dans la société civile.
L’autre, externe, est conduite par les Etats qui trouvent là une nouvelle opportunité d’imposer
leur puissance aux pays du Sud à leurs frontières. Connectées à la perpétuation des liens de
domination et d’exploitation des anciens pays colonisés, les politiques d’enrôlement dans la
gestion migratoire des pays frontaliers par le biais des injonctions à intégrer les principes de la
lutte contre les migrants esquissent une tendance à la recolonisation (externalisation des
camps et du traitement des demandes d’asile, accords de réadmission et transfert de normes et
de technologies de surveillance). Cette guerre contre les mobilités et l’altérité postcoloniales
est bien devenue un mode de production économique à part entière. Les pays frontaliers des
forteresses continentales servent à la fois d’espace de délocalisation des activités économiques
réclamant une main d’œuvre peu qualifiée dans l’industrie et les services, de force d’appoint
pour les activités non encore délocalisables, comme l’agriculture intensive par exemple, et de
limes protecteur contre les migrations. A l’intérieur se développent aussi de nouvelles
1 Voir mon article « Nos compagnons secrets. La grève de sans papiers du printemps 2008 dans la restauration », Mouvements, 2008.
24
frontières politiques, sociales et spatiales. Les dispositifs répressifs à l’encontre des migrants
illégalisés ne sont en fait que le prolongement des politiques publiques ségrégatives, bien que
présentées depuis le Welfare comme intégratives et dont il faut sans doute repenser le
paradigme dominant, dans les domaines de la justice, de l’éducation, de l’accès au marché du
travail et du droit à la ville et à l’espace1. Sous l’injonction des autorités en charge du
maintien de l’ordre, dont on a rappelé plus haut l’influence croissante en matière
d’aménagement urbain et du territoire et de la gestion des populations présentées comme « à
risque », d’autres institutions sont enrôlées dans ce mode de destruction et de désintégration et
aggravent les inégalités et les discriminations.
L’institutionnalisation de l’internement des étrangers et des dispositifs d’arrestations
groupées est caractéristique d’une mutation de l’Etat qui doit s’interpréter sur la longue durée.
Elle confirme en premier lieu la simultanéité entre processus de pacification de l’espace
public et brutalisation potentielle de certaines catégories de populations civiles. Elle montre
aussi l’importance de la place de la police dans la phase de repli sur ses fondamentaux
régaliens que connaît l’Etat2. Dans ce cadre le camp apparaît comme matrice civilisationnelle,
une face retournée de la globalisation que l’on peut observer dans le développement des
résidences sécurisées ou les quartiers de tourisme sexuels, typique d’une société assiègée3.
1 D. Harvey, Géographie de la domination, Paris, Les prairies ordinaires, 2008 2 S. Palidda, Polizia postmoderna. Ethnografia del nuovo controllo sociale, Milan, Feltrinelli Editore, 2000. 3 B. Diken, C.B. Laustsen, The Culture of Exception. Sociology facing the Camp, London, Routledge, 2006.