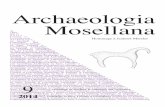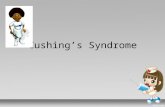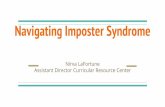Le syndrome douloureux régional complexe
Transcript of Le syndrome douloureux régional complexe
Revue g�en�erale
Le syndrome douloureux r�egional complexe
Raneem Albazaz, Yew Toh Wong, Shervanthi Homer-Vanniasinkam, Leeds, Royaume-Uni
Le syndrome douloureux r�egional complexe (SDRC), anciennement connu sous le nom de ‘‘dys-trophie sympathique r�eflexe’’ est un trouble neurologique chronique caract�eris�e par des douleursinvalidantes, un œdeme, une instabilit�e h�emodynamique, des anomalies sudo-motrices et desperturbations de la fonction motrice. Il apparaıt habituellement apres un traumatisme ou une chi-rurgie mineure. Aucun test diagnostic sp�ecifique n’est disponible et le diagnostic est donc bas�eprincipalement sur les ant�ec�edents, l’examen clinique et certains examens de laboratoire. Cetterevue g�en�erale donne un synopsis du SDRC et discute le principe de son traitement d’apres lalitt�erature limit�ee dont on dispose sur le sujet. Une recherche de la litt�erature a �et�e r�ealis�ee enutilisant les banques de donn�ees bibliographiques �electroniques (Medline, Embase, Pubmed,CENTRAL) de 1970 a 2006. Les mots-cl�es syndrome douloureux r�egional complexe, dystrophiesympathique r�eflexe, douleur neuropathique et causalgie ont �et�e utilis�es pour la recherche. Lesarticles en rapport relev�es dans la liste de r�ef�erences des articles examin�es ont �egalement �et�e�etudi�es. Il y a eu 3.771 articles publi�es sur le sujet. Soixante-seize �etudes control�ees rando-mis�ees ont �et�e identifi�ees. La plupart concernaient le role du blocage sympathique dans le trai-tement du SDRC (n¼ 13). Le role de la sympathectomie n’est pas clair, certaines �etudesmontrant un b�en�efice transitoire et d’autres ne montrant aucun effet b�en�efique, la plupart des�etudes ne comportant qu’un petit nombre de malades. Neuf �etudes concernaient les bisphos-phonates ou la calcitonine. Les �etudes concernant les bisphosphonates montraient un b�en�efice,mais les �etudes concernant la calcitonine ne montraient aucun b�en�efice pr�ecis. Quatre �etudesconcernaient le traitement comportemental, la physioth�erapie, ou le traitement occupationnel etchacune a d�emontr�e un effet b�en�efique potentiel. Trois �etudes concernant la stimulationm�edullaire et deux �etudes chacunes concernant l’acupuncture, la vitamine C et les st�ero€ıdes onttoutes montr�e un effet b�en�efique potentiel pour la diminution des douleurs. Les autres �etudesconcernaient des traitements divers ou des combinaisons de traitement, rendant difficile touteconclusion sur les effets du traitement. Il y a tres peu de preuves solides dans la litt�erature pourguider le traitement du SDRC. Un diagnostic pr�ecoce et une approche multidisciplinaire dutraitement semblent importants pour obtenir un bon r�esultat. Les traitements destin�es a diminuerles douleurs et a r�ehabiliter la fonction du membre sont les �el�ements th�erapeutiques principaux.Les comorbidit�es, telles que la d�epression et l’anxi�et�e, doivent etre trait�ees simultan�ement.
Le syndrome douloureux r�egional complexe
(SDRC), anciennement connu sous le nom de
DOI of original article: 10.1016/j.avsg.2007.10.006.
Leeds Vascular Institute, The General Infirmary at Leeds, Leeds,United Kingdom.
Correspondance : Raneem Albazaz, Vascular Surgical Unit, TheGeneral Infirmary at Leeds, Great George Street, Leeds LS1 3EX, UnitedKingdom, E-mail: [email protected]
Ann Vasc Surg 2008; 22: 297-306DOI: 10.1016/j.acvfr.2008.06.004� Annals of Vascular Surgery Inc.�Edit�e par ELSEVIER MASSON SAS
322
‘‘dystrophie sympathique r�eflexe’’ est un trouble
neurologique chronique entraınant des troubles
significatifs. Les aspects cliniques comportent des
douleurs spontan�ees, une hyperalgie, un œdeme,
une instabilit�e vasomotrice, des perturbations des
fonctions motrices et des anomalies autonomes.1 Il
peut etre divis�e en deux types. Dans le SDRC de type
I, qui survient typiquement apres un traumatisme
minime ou une fracture, aucune l�esion nerveuse�evidente n’est d�ecelable. Dans le type II, le SDRC
(causalgie), un traumatisme nerveux identifiable est
pr�esent.2 Bien qu’il y ait eu au cours de ces dernieres
ann�ees des progres significatifs dans notre
Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 323
compr�ehension du SDRC, il reste une affection de
physiopathologie incertaine, d’�evolution clinique
impr�evisible et de traitement peu clair, le rendant
m�econnu par la communaut�e m�edicale. Dans ce
travail, nous soulignons la pr�esentation clinique, les
examens compl�ementaires et les principes du trai-
tement du SDRC.
TERMINOLOGIE
Le SDRC a de nombreux synonymes (tableau I), le
plus souvent utilis�e �etant celui de dystrophie sym-
pathique r�eflexe (DSR). Le terme DSR sugg�erait
l’implication d’un arc r�eflexe pathologique main-
tenu par le systeme sympathique dans l’initiation et
la perp�etuation de la douleur. Cependant, des �etudes
ont montr�e que le systeme nerveux sympathique
n’est pas impliqu�e dans tous les cas et l’arc r�eflexe
propos�e n’a jamais �et�e d�emontr�e.3 En 1993, une
conf�erence de consensus de l’International Asso-
ciation for the Study of Pain (IASP) a sugg�er�e un
nouveau nom, syndrome douloureux r�egional
complexe, qui �evite de sugg�erer l’implication du
systeme nerveux sympathique dans l’�etiologie et
comporte des malades ayant des douleurs non
m�edi�ees par le systeme sympathique.4 En 1998,
l’IASP a propos�e des criteres pour am�eliorer le diag-
nostic de SDRC (tableau II).5 Cependant, ces criteres
ne faisaient pas de distinction entre les signes et les
symptomes vasomoteurs et sudomoteurs et
excluaient les modifications motrices et trophiques.6
Une r�evision des criteres IASP de 1998 dans un but
de recherches, fournissant des d�efinitions plus
pr�ecises, avec inclusion des signes et des symptomes
moteurs et trophiques, a �et�e propos�ee par Harden et
coll en 1999 (tableau II).6 Malgr�e plusieurs modifi-
cations, il reste aux criteres diagnostiques de SDRC a
incorporer les problemes psycho-sociaux, qui sont
souvent associ�es au syndrome et n�ecessitent un
traitement particulier.
INCIDENCE
Le SDRC est une condition mal connue. Des �etudes
prospectives ont sugg�er�e qu’une forme mineure de
SDRC survient apres 30 a 40% des fractures et des
traumatismes chirurgicaux, lorsque le diagnostic
est recherch�e de facon active.7,8 Cependant, le
SDRC chronique s�evere est rare, avec une pr�eva-
lence faible inf�erieure a 2% dans la plupart des s�eries
r�etrospectives.9 Le SDRC peut affecter des personnes
de tous ages. Il a �et�e rapport�e chez des enfants aussi
jeunes que deux ans. Il est plus fr�equent chez la
femme que chez l’homme, avec un ratio de deux a
trois pour un.10 Les membres sup�erieurs sont
davantage impliqu�es que les membres inf�erieurs.11
Le SDRC est le plus souvent associ�e avec une
intervention chirurgicale int�eressant les membres,
telle que le traitement d’un syndrome du canal
carpien,12,13 le traitement d’une maladie de
Dupuytren,14 la chirurgie du genou,15 une ampu-
tation,16 une arthroplastie de hanche17 ou une
arthroscopie.18 Il existe �egalement une association
avec un platre trop serr�e.19 Rarement, le SDRC peut
se d�evelopper apres un traumatisme visc�eral, tel
Tableau I. Synonymes du syndrome douloureux
r�egional complexe
Dystrophie sympathique r�eflexe
Atrophie de Sudeck
Causalgie
Causalgie mineure
Mimo-causalgie
Algodystrophie
Algoneurodystrophie
Syndrome douloureux post-traumatique
Dystrophie douloureuse post-traumatique
Ost�eoporose douloureuse post-traumatique
Ost�eoporose migratoire transitoire
Tableau II. Criteres diagnostique du syndrome
douloureux r�egional complexe (SDRC) propos�es
par l’International Association for the Study of
Pain (IASP) et r�ecemment r�evis�es
Criteres diagnostique du SDRC (1998)
Le type I est un syndrome qui apparaıt apres un
�ev�enement douloureux initial qui peut ou non avoir
�et�e traumatique, alors que le type II apparaıt apres une
l�esion nerveuse identifiable
Douleur continue, allodynie ou hyperalg�esie, la dou-
leur �etant disproportionn�ee avec l’�ev�enement causal
Pr�esence a un moment donn�e d’oedeme, d’anomalies
de la vascularisation cutan�ee ou d’anomalies sud-
omotrices dans la zone douloureuse
Pas d’autre affection associ�ee expliquant la douleur
Criteres diagnostiques de recherche modifi�es propos�es
pour le SDRC (Harden, 1999)
Douleur continue disproportionn�ee a l’�ev�enement
d�eclenchant
Les malades doivent avoir au moins un symptome dans
chacune des cat�egories suivantes et un signe dans deux
cat�egories ou plus :
Sensorielles (hyperalg�esie, allodynie, hyperesth�esie)
Vasomoteur (anomalies thermiques ou cutan�ees)
Sudomoteur (oedeme ou anomalies de la sudation)
Moteur/trophique (diminution des mouvements,
faiblesse, tremblement ou n�egligence, modifications
des cheveux, des ongles ou de la peau)
324 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire
qu’un accident vasculaire c�er�ebral20 ou un infarctus
du myocarde.10 Le SDRC a �egalement �et�e associ�eavec une ost�eog�en�esis imperfecta,21 un cancer
(poumon, sein, systeme nerveux central et ovaire)10
et meme une grossesse.22
ASPECTS CLINIQUES
Classiquement, le SDRC est subdivis�e en trois stades
successifs : une phase chaude ‘‘aigue’’, une phase
interm�ediaire ‘‘dystrophique’’, avec instabilit�e vaso-
motrice, et une phase terminale froide ‘‘atro-
phique’’. En fait, une progression nette d’un stade
au suivant est rarement observ�ee et pour cette rai-
son ces stades ont �et�e largement �elimin�es.23
Les aspects principaux du SDRC sont la douleur
spontan�ee, l’hyperalgie (r�eponse douloureuse
augment�ee de facon dysproportionn�ee pour un sti-
mulus nociceptif faible), allodynie (r�eponse doulou-
reuse augment�ee de facon dysproportionn�ee a un
stimulus non douloureux), une activit�e vasomotrice
anormale et une activit�e sudomotrice anormale. Des
troubles psychologiques se d�eveloppent habituelle-
ment au cours du SDRC.
Douleurs
Les malades souffrant d’un SDRC peuvent d�ecrire
des douleurs a type de brulures, de douleurs pulsati-
les, de compression, d’endolorissement ou de dou-
leurs fulgurantes localis�ees dans la profondeur des
tissus somatiques.10 La douleur s’�etend habituelle-
ment au-dela de la zone du traumatisme initial et
dans les formes les plus s�everes peut int�eresser le
membre dans son entier voire rarement le membre
controlat�eral.24 La douleur peut etre m�edi�ee par le
sympathique (gu�erie par le blocage sympathique)
ou non. Les deux types de douleur coexistent
fr�equemment et la douleur initialement maintenue
par le sympathique peut se convertir en une douleur
ind�ependante du sympathique au cours de
l’�evolution de l’affection.3 Les douleurs persistantes
isol�ees, purement sympathiques, sont rares. Une
allodynie s�evere est pr�esente dans un tiers des
malades ayant un SDRC, avec une incidence plus
importante dans les phases chroniques et est con-
sid�er�ee comme �etant due a une sensibilisation
nociceptive centrale.25 Les malades souffrant
d’allodynie adoptent souvent une posture protec-
trice pour prot�eger le membre.
Dysfonction sympathique
Une instabilit�e vasomotrice et/ou sudomotrice
repr�esente un symptome de dysfonction sympa-
thique. Dans la pr�esentation classique, le membre
est initialement sec, chaud et rose mais devient rapi-
dement bleu, froid et hyperhydrotique.26 Typique-
ment, la diff�erence de temp�erature cutan�ee entre le
membre affect�e et les membres non affect�es excede
1�c.27 Un œdeme important peut se d�evelopper en
association avec la dysfonction sympathique.
L’œdeme et la douleur qui en r�esultent entraınent la
perte fonctionnelle du membre.
Troubles trophiques
Dans les cas chroniques, l’instabilit�e vasomotrice
r�egresse souvent, l’œdeme disparaıt et les troubles
trophiques s’installent. Les ongles peuvent etre
hypertrophiques ou atrophiques, la croissance et la
texture du cheveu peuvent etre augment�ees ou
diminu�ees et le membre peut devenir atrophique
du fait de son absence d’utilisation. La peau devient
fine et les plis de flexion et la graisse sous-cutan�ee
disparaissent. Les gaines des tendons et les capsules
articulaires deviennent adh�erentes aux tendons et
aux muscles sous-jacents. Les muscles se contrac-
tent et les ligaments raccourcissent et s’�epaississent,
entraınant une contracture articulaire.28
Perturbations motrices
Des symptomes moteurs tels qu’une raideur, des
mouvements dystoniques, une pose des mouve-
ments myocloniques, un tremblement et une fai-
blesse peuvent se d�evelopper au cours du SDRC.
Environ 45% des malades ont �egalement des
r�eflexes tendineux exag�er�es du cot�e impliqu�e. On
pense que cela fait partie du m�ecanisme de facilita-
tion de la douleur en l’absence d’autre anomalie
neurologique.29
Complications
Des complications telles qu’une infection, des ulce-
res et un œdeme chronique peuvent se d�evelopper
au niveau des membres dystrophiques et non
utilis�es. Dans une �etude r�etrospective de 1.000 cas
de SDRC, ces complications �etaient survenues dans
7% des cas.30 De plus, il y a souvent des complica-
tions psycho-sociales significatives associ�ees telles
qu’une d�epression.31 Cela n’est pas toujours
reconnu, de sorte qu’une attention insuffisante est
donn�ee a cette composante importante du SDRC.
Une nouvelle d�efinition du SDRC incluant les
complications psycho-sociales soulignerait l’impor-
tance d’un traitement associ�e de ces troubles.
Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 325
DIAGNOSTIC
Le diagnostic diff�erentiel de SDRC inclut une grande
vari�et�e de conditions dont des d�esordres inflamma-
toires, des l�esions nerveuses et des troubles vasculai-
res (tableau III). Il n’y a pas de test diagnostic
sp�ecifique pour le SDRC. Le diagnostic est bas�e sur
les ant�ec�edents, l’examen clinique et les examens de
laboratoire. Les examens de laboratoire standard
comportant une num�eration sanguine complete, le
dosage de la c-r�eactive prot�ein, une vitesse de
s�edimentation et un dosage des auto-anticorps
s�eriques aident a �eliminer une infection ou un
probleme rhumatologique. L’�etude des conductions
nerveuses peut aider a �eliminer les l�esions nerveuses
sp�ecifiques. Lorsqu’il existe des signes et des symp-
tomes vasomoteurs, les examens vasculaires non
invasifs tels que l’�echographie-Doppler doivent etre
r�ealis�es pour exclure une �etiologie vasculaire. Les
investigations qui permettent de poser le diagnostic
positif de SDRC sont discut�ees ci-dessous.
Thermographie
L’utilisation de la thermographie est bas�ee sur la
pr�esence de perturbations vasomotrices unilat�erales
entraınant des diff�erences de temp�erature significa-
tives entre les membres.1 Il est rapport�e que la
t�el�ethermographie par infrarouge a une sensibilit�ede 93% et une sp�ecificit�e de 89% pour le diagnostic
de l’affection.32 Une thermom�etrie infrarouge
(pr�ecision de ± 0,1 �C) est utilis�ee pour mesurer
plusieurs points sym�etriques au niveau du membre
affect�e et du membre controlat�eral. En g�en�eral, dans
un environnement thermique neutre (22 �C), une
diff�erence d’1 �C est consid�er�ee comme significative
et la valeur diagnostique du test augmente avec le
degr�e d’asym�etrie.27,32 N�eanmoins, une thermo-
graphie normale et sym�etrique n’exclue pas le
diagnostic de SDRC. Ce test n’est pas largement
disponible et donc n’est pas souvent utiils�e pour le
diagnostic de SDRC.
Test a la sueur
Des mesures quantitatives de l’activit�e sudomotrice
peuvent montrer une production anormale de
sueur au niveau du membre atteint aux stades
aigu et chronique de l’affection.33 Le d�ebit de
sueur au repos peut etre mesur�e grace a un dispositif
informatis�e commercialement disponible, tel que le
Q-Sweat� (WR Medical Electronics, Stillwater,
Minnesota, USA). La mesure doit etre r�ealis�ee de
facon bilat�erale et simultan�ee a quatre endroits
sym�etriques au cours d’une p�eriode de 5 minutes. Le
test du r�eflexe axonique sudomoteur quantitatif est
un test de provocation qui d�etermine le d�ebit de
sueur en r�eponse a une stimulation cholinergique,
telle que l’ac�etylcholine. Ces tests sont rarement
utilis�es en pratique.
Examens Radiologiques
Des anomalies osseuses sont constantes chez
l’adulte (mais pas chez l’enfant) souffrant d’un
SDRC.34,35 Les radiographies standards montrent
typiquement une d�emin�eralisation par plages avec
ost�eoporose sous-chondrale ou sous-p�eriost�ee du
cot�e affect�e apres deux a 8 semaines, peut etre en
raison de l’insuffisance d’utilisation ou apres des
alt�erations des neuromodulateurs locaux et du d�ebit
sanguin osseux.36 Au fur et a mesure de la pro-
gression du SDRC, les structures osseuses peuvent
avoir un acces en verre de montre et des �erosions
corticales peuvent devenir �evidentes.37 Malgr�el’ost�eoporose, les fractures sont rares.
Un scanner osseux du membre int�eress�e a l’aide
de bisphonate de technetium marqu�e au Tc 99 m a�et�e rapport�e comme d�ecelant les modifications
osseuses plus tot que la radiographie simple, avec
une sensibilit�e et une sp�ecificit�e de 80%.38 Les
constatations classiques comportent une hyper-
fixation p�eri-articulaire aux trois phases, indiquant
une augmentation du m�etabolisme osseux.
La densitom�etrie osseuse reflete souvent une
densit�e min�erale osseuse et un contenu min�eral
osseux plus faibles au niveau des membres
affect�es.39 Ces indices s’am�eliorent souvent chez
les malades trait�es et peuvent etre utilis�es pour
appr�ecier l’efficacit�e du traitement. Une scinti-
graphie osseuse normale et l’absence d’ost�eoporose
sur les radiographies simples ou sans pr�eparation�eliminent virtuellement un SDRC.
L’imagerie par r�esonance magn�etique peut�egalement montrer de nombreux aspects y compris
un oedeme de la moelle p�eri-articulaire, un oedeme
des parties molles, un �epanchement articulaire et,
Tableau III. Diagnostic diff�erentiels du SDRC
Thrombose veineuse profonde
Thrombophl�ebite
Cellulite
Lymphoedeme
Insuffisance art�erielle
Syndrome de la travers�ee thoraco-brachiale
Problemes neurologiques
Neuropathie diab�etique
Neuropathie p�eriph�erique
Compression extrinseque
Syndrome du canal carpien
326 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire
au stade tardif, une atrophie et une fibrose des struc-
tures p�eri-articulaires.40 Ces constatations ne sont
pas sp�ecifiques du SDRC. Des constations sembla-
bles peuvent etre observ�ees dans les arthrites septi-
ques et la polyarthrite rhumato€ıde a un stade
pr�ecoce, parmi d’autres affections.
Blocage sympathique
Le blocage des nerfs sympathiques a vis�ee diagnos-
tique a l’aide d’une anesth�esie locale permet de
reconnaıtre une douleur li�ee au systeme sympa-
thique dans un sous-groupe de malades ayant un
SDRC.41 La proc�edure doit etre envisag�ee pour les
malades ayant des signes cliniques de dysfonction
vasomotrice ou sudomotrice et des douleurs
importantes. Un bloc sympathique para-vert�ebral
lombaire est r�ealis�e pour les symptomes du membre
inf�erieur et un bloc cervico-thoracique (du ganglion
stellaire) ou un bloc sympathique thoracique haut
est r�ealis�e pour les symptomes du membre
sup�erieur. Un bloc est consid�er�e comme un succes
s’il existe une diminution sup�erieure a 50% de la
douleur quantifi�ee par une �echelle analogique
visuelle.41
Si le bloc sympathique entraıne une am�elioration
significative de la douleur, un blocage sympathique
permanent peut etre r�ealis�e d’une facon percutan�ee
avec du ph�enol ou une ablation par radio-
fr�equence.42,43 Les m�ethodes plus invasives de blo-
cage incluent l’ablation de la chaıne sympathique
par voie chirurgicale ou endoscopique.44
PRINCIPES DE TRAITEMENT
La prise en charge optimale du SDRC implique le
plus souvent une �equipe multidisciplinaire, dans la
mesure ou ce trouble entraıne des difficult�es a la
fois physique et psychologique.5 La diminution de
la douleur, la pr�eservation de la fonction du membre
et le retour au travail sont les objectifs principaux du
traitement. La s�election des modalit�es de traitement
de la douleur est guid�ee par la s�ev�erit�e de celle-ci et
la pr�esence ou l’absence d’une dysfonction sympa-
thique (Figure 1). Les comorbidit�es telles que la
d�epression, les troubles du sommeil, l’anxi�et�e et le
d�econditionnement physique g�en�eral doivent etre
trait�es de facon simultan�ee.
Traitement symptomatique
Antid�epresseurs. Les antid�epresseurs tricycliques
(ATC) sont les m�edicaments les plus souvent utilis�es
en cas de douleurs neuropathiques. Leur effet
b�en�efique a �et�e d�emontr�e, en particulier dans la
neuropathie diab�etique et la n�evralgie post-
herp�etique, mais pas de facon sp�ecifique dans le
SDRC.45 L’effet analg�esique des ATC est bas�e sur
l’inhibition de la fixation de s�erotonine et de
noradr�enaline a l’�echelon central et sur le blocage
des r�ecepteurs de la N-m�ethyl-D-aspartate au
niveau des neurones de la corne dorsale de la moelle�epiniere.5 De plus, ils entraınent le blocage des
canaux sodiques des axones l�es�es.5 L’amitriptyline
reste un m�edicament le plus souvent utilis�e dans
cette classe. Le dosage d�ebute a 10 mg par jour,
graduellement augment�e jusqu’a 75 mg par jour si
n�ecessaire. En plus de leur effet analg�esique, les ATC
am�eliorent les symptomes de d�epression et les
troubles du sommeil par leur effet s�edatif l�eger. Les
plus r�ecents inhibiteurs de la s�erotonine sont moins
efficaces que l’amitryptyline dans le traitement de la
douleur des SDRC.45
Anti�epileptiques. La Gabapentine est un anti-
convulsivant ayant des propri�et�es analg�esiques et
son efficacit�e dans le traitement des neuropathies
diab�etiques douloureuses et des n�evralgies
herp�etiques a �et�e �etablie.46 Cependant, l’efficacit�een tant qu’analg�esique dans le SDRC n’a pas �et�eprouv�ee.47 Une seule �etude randomis�ee en double
aveugle, avec controle contre placebo du traitement
par Gabapentine de SDRC a �et�e rapport�ee.48 Qua-
rante-huit malades ayant un SDRC de type I ont �et�erandomis�es entre Gabapentine et placebo pour des
p�eriodes de traitement de trois semaines, s�epar�ees
par une p�eriode de ‘‘washout’’ puis suivie par trois
autres semaines d’un traitement crois�e. Les malades
ont rapport�e un soulagement significatif des dou-
leurs en faveur de la Gabapentine au cours de la
premiere p�eriode de traitement mais l’effet th�era-
peutique �etait moindre au cours de la seconde.
Lorsqu’on combinait les effets de la premiere et de la
seconde p�eriode, aucun effet b�en�efique significatif
n’�etait d�emontr�e. L’effet b�en�efique observ�e au cours
de la premiere p�eriode �etait au moins partiellement
en rapport avec un effet placebo. Dans une autre�etude randomis�ee en double aveugle concernant
307 malades ayant des syndromes douloureux
neuropathiques divers (incluant 85 malades ayant
un SDRC de type I ou II), les malades trait�es par
Gabapentine ont eu une diminution significative-
ment plus importante des scores de douleur que les
malades recevant le placebo.49 Globalement, il n’y
avait pas de preuve satisfaisante pour son utilisation
dans le SDRC, mais il pourrait b�en�eficier a quelques
malades et il est donc logique de l’essayer si le trai-
tement m�edical de premiere ligne a �et�e un �echec. Le
m�ecanisme de soulagement de la douleur par la
Gabapentine n’a pas �et�e d�etermin�e. Le dosage
d�ebute a 300 mg par jour, augment�e graduellement
Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 327
Diagnostic de SDRC
Contrôle de la douleur + physiothérapie• Tricyclique ± gabapentine• Opiacés• Capsaïcine locale
Amélioration douleur & fonction
Poursuite traitementconservateur
Réponse non satisfaisante
Bloc sympathique diagnostque
Réponse favorable Non réponse
3-6 blocs sympathiques+ physiothérapie
Blocs somatiques +physiothérapie
amélioration douleur& fonction
Sympathectomie précoce
Amélioration douleur& fonction
Poursuite traitementconservateur
Persistance douleur sévère
Evaluation psychosociale + physiothérapie• relaxation techniques de+• Biofeedback
Poursuite traitementconservateur
Persistance douleur sévère
Envisager• Neuromodulation• Baclofène intrathécal (pour dystonie)
Amélioration douleur & fonction
Figure 1. Algorithme du traite-
ment du SDRC.
a 1.200 mg par jour si n�ecessaire. Il n’y avait pas de
donn�ees convaincantes pour d’autres drogues anti-�epileptiques que la pr�egabaline, la ph�enytoine et la
carbamaz�epine.50
Cortico€ıdes. Il a �et�e rapport�e que la pr�ednisolone�etait utile chez les malades ayant un SDRC dans
deux �etudes randomis�ees.51,52 Contre placebo, non
aveugl�e, 31 sur 36 malades h�emipl�egiques qui
avaient d�evelopp�e un syndrome �epaule-main
(forme clinique du SDRC) sont devenus pratique-
ment asymptomatiques apres 10 jours de traitement
par des faibles doses de cortico€ıdes par voie orale.51
Dans le second essai, 23 malades ayant un SDRC ont�et�e randomis�es entre traitement par prednisolone
par voie orale ou placebo. Le traitement a �et�e con-
tinu�e jusqu’a la r�emission clinique (maximum 12
semaines). Chacun des 13 malades dans le groupe
trait�e par prednisolone a eu une am�elioration cli-
nique sup�erieure a 75% au cours de la p�eriode de 12
semaines. Chez les 10 malades recevant le placebo,
seuls deux ont rapport�e une am�elioration.52 Bien
que ces essais n’aient pas �et�e r�ealis�es en double
aveugle, l’am�elioration symptomatique rapport�ee�etait importante, rendant ainsi les r�esultats proba-
blement vrais. Les st�ero€ıdes ont des effets multiples :
ils inhibent la production de m�ediateurs de
l’inflammation, diminuent le taux de transcription
dans les cellules ganglionnaires des racines dorsales
(r�eduisant ainsi le contenu en neuropeptides des
neurones sensitifs) et facilitent la d�egradation des
neuropeptides. Il en r�esulte que le d�eveloppement
d’inflammations neurologenes et de douleurs neu-
ropathiques peut etre �evit�e. Le dosage typique est de
30 mg par jour pendant trois semaines, avec une
diminution progressive au cours d’un mois. D’une
facon g�en�erale, l’utilisation a long terme des corti-
co€ıdes au-dela de trois mois n’est pas recommand�ee.
Analg�esiques locaux. L’utilisation locale de patch
transdermiques de capsaicine et de lidocaine a �et�emontr�e dans des essais cliniques control�es comme
ayant un effet analg�esique dans quelques types de
douleurs neuropathiques et dans le SDRC.53-55 Le
328 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire
blocage par capsaicine bloque la production et
inhibe la d�elivrance de substance P, r�eduisant ainsi
la douleur. Cependant, les malades ayant un SDRC
sont souvent incapables de tol�erer l’application de
capsaicine locale en raison des sensations associ�ees
de brulure et de l’hyperalgie rapport�ees dans envi-
ron 10% des cas.50
Opiac�es. Les opiac�es n’ont qu’un succes mod�er�edans le traitement des douleurs neuropathiques.56
Leur utilisation est indiqu�ee lorsque la douleur n’est
pas control�ee par d’autres traitements oraux ou
locaux. L’hydrocodone ou l’oxycodone sont habi-
tuellement utilis�ees. Les autres opiac�es, y compris la
morphine, sont parfois n�ecessaires. Le dosage doit
etre individualis�e suivant la r�eponse et des drogues
adjuvantes doivent etre employ�ees.
Bisphosphonates. Les bisphosphonates sont des
agents qui influencent le turnover osseux. L’alen-
dronate par voie orale, la pamidronate par voie
intra-veineuse et la clodronate par voie intra-vei-
neuse se sont av�er�ees am�eliorer de facon significa-
tive les symptomes de SDRC dans des �etudes
cliniques randomis�ees.57-59 Des effets positifs sont
rapport�es notamment dans les SDRC r�ecents (dur�ee
de l’affection inf�erieure a 8 mois). Des effets secon-
daires tels qu’une fievre et une hypocalc�emie
asymptomatique ont �et�e observ�es fr�equemment
mais disparaissent rapidement. En diminuant
l’acc�el�eration locale du remodelage osseux, les bis-
phosphonates peuvent diminuer la douleur en
agissant sur les aff�erences nociceptives primaires au
niveau de l’os.58 Il a �et�e montr�e que la calcitonine,
bien que semblable aux bisphosphonates dans ses
effets sur l’os, avait des effets contradictoires en ce
qui concerne l’efficacit�e dans le SDRC.60,61
Tueurs de radicaux libres. Aux Pays-Bas, des
tueurs de radicaux libres tels que la dim�ethylsulfo-
xide (DMSO) et la N-ac�etylcyst�eine (NAC) ont �et�elargement utilis�es pour le traitement des SDRC.62
Cela repose sur le fait que le SDRC est induit par une
r�eponse inflammatoire exag�er�ee aux l�esions tissu-
laires, m�edi�ee par une production excessive de
radicaux toxiques d’oxygene. Trois �etudes con-
trol�ees randomis�ees en double aveugle ont montr�edes r�esultats positifs de l’application locale de DMSO
a 50% par rapport au placebo dans le traitement du
SDRC.63-65 Un essai clinique control�e randomis�er�ecent comparant les effets d’une creme topique de
DMSO a 50% et de NAC par voie orale pour traite-
ment des SDRC n’a pas trouv�e de diff�erence signi-
ficative entre ces deux tueurs de radicaux libres,
bien qu’il ait �et�e trouv�e que le DMSO �etait plus
efficace en terme de cout.62 La vitamine C a haute
dose a �egalement �et�e utilis�ee pour ses propri�et�es
antioxydantes afin de de pr�evenir la survenue d’un
SDRC apres fracture du poignet.66 Cette �etude a
indiqu�e une fr�equence du SDRC de 7% chez les
malades ayant une fracture du poignet lorsqu’on
leur administrait une dose quotidienne de 500 mg
de vitamine C contre 22% des malades ayant recu
un placebo. Malgr�e ces r�esultats prometteurs, les
tueurs de radicaux libres ne sont pas largement
utilis�es dans le traitement des SDRC.
Physioth�erapie
La physioth�erapie, comportant le renforcement
isom�etrique et les exercices range-of-motion, sont
largement recommand�es comme traitement initial
du SDRC.5 Un r�ecent essai clinique control�erandomis�e examinant l’efficacit�e de la phy-
sioth�erapie a montr�e une diminution significative
de la s�ev�erit�e de la gene fonctionnelle, de la dimi-
nution de la mobilit�e et des douleurs.67 En pratique,
l’entreprise est souvent gen�ee par la douleur elle-
meme et les mesures de controles de la douleur sont
essentielles pour permettre une participation effi-
cace du malade.
Techniques d’anesth�esie r�egionale
Les malades ayant des douleurs mod�er�ees a s�everes
ne r�epondant pas au traitement m�edical et a la phy-
sioth�erapie, les malades ayant des signes et des
symptomes de dysfonction sympathique s�evere et
les malades ayant eu une am�elioration marqu�ee
apres un blocage sympathique a vis�ee diagnostique
sont des candidats au blocage anesth�esique r�egional.
Le but est de fournir une analg�esie tout en �evitant
d’alt�erer la fonction motrice, pour faciliter le traite-
ment et la r�e�education. Les deux grands types de
technique r�egionale, le blocage sympathique et le
blocage combin�e somatique et sympathique.
Blocage sympathique. L’anesth�esie locale avec et
sans blocage sympathique par des cortico€ıdes a �et�eutilis�ee pour traiter le SDRC. Malheureusement,
peu d’essais correctement control�es sont disponi-
bles. Une m�eta-analyse des essais control�es
randomis�es, des series r�etrospectives et prospectives
et des essais control�es comportant 1.144 malades
ont montr�e que les b�en�efices du blocage sympa-
thique par un anesth�esique local n’�etaient pas
diff�erents de ceux d’un placebo.68 Malgr�e l’absence
de donn�ees en faveur, le blocage du sympathique a�et�e utilis�e depuis de nombreuses ann�ees pour traiter
le SDRC. Le blocage sympathique est sans doute plus
efficace s’il est appliqu�e pr�ecocement dans le SDRC
avant que des circuits douloureux centraux se
d�eveloppent.69 Le blocage sympathique a long
terme peut etre r�ealis�e par une sympathectomie.
Celle-ci peut etre r�ealis�ee chirurgicalement ou par
Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 329
des techniques chimiques ou d’ablation par
radiofr�equence.42,70,71
Sympathectomie (chimique, chirurgicale ou parradiofr�equence). La sympathectomie peut etre utile
chez les malades ayant des douleurs d’origine sympa-
thique et des symptomes invalidants ne r�epondant
pas aux autres m�ethodes th�erapeutiques.72 Les
malades doivent avoir au moins un blocage sympa-
thique diagnostique positif avant que soit envisag�ee
une sympathectomie. Les sympathectomies chimi-
ques utilisent l’alcool ou le ph�enol pour d�etruire la
chaıne sympathique.71 La sympatholyse par radio-
fr�equence ne semble pas offrir le moindre avantage
sur les techniques au ph�enol.73 L’ablation chirurgi-
cale de la chaıne sympathique peut �egalement etre
r�ealis�ee par chirurgie conventionnelle ou technique
mini-invasive. La diminution de la douleur a long
terme (plus d’un an) a �et�e rapport�ee chez jusqu’a
75% des malades dans quelques s�eries de sympa-
thectomies chirurgicales.74 L’efficacit�e est la meme
pour les SDRC affectant aussi bien les membres
sup�erieurs qu’inf�erieurs et une sympathectomie
pr�ecoce est associ�ee a un meilleur r�esultat.69 Des
s�equelles significatives ont �et�e rapport�ees dans 7%
des cas, telles qu’une hyperhydrose compensatrice,
un syndrome de Claude Bernard Horner, une�ejaculation r�etrograde, des l�esions ur�et�erales et des
l�esions vasculaires. Le d�eveloppement d’un ‘‘nou-
veau SDRC’’ a �egalement �et�e rapport�e, probablement
du a une r�eg�en�eration de la chaıne sympathique.74
Blocage somatique. Le blocage somatique du plexus
brachial ou lombaire peut etre r�ealis�e chez les mala-
des ayant des douleurs invalidantes chez lesquels le
blocage du ganglion sympathique est inefficace.75
Le but du blocage somatique est de fournir un
controle suffisant de la douleur sans blocage moteur
de sorte que le malade peut participer a la phy-
sioth�erapie. Cela peut etre r�ealis�e quotidiennement
en s�erie ou un cath�eter peut etre mis en place au
long cours pour des injections fr�equentes.
Neuromodulation
La neuromodulation est la manipulation des voies
centrales de la douleur par d�elivrance d’un courant�electrique ou d’un produit chimique dans l’axe ner-
veux central. Les proc�edures de stimulation
comportent l’acupuncture, la stimulation nerveuse�electrique transcutan�ee (SNET) et la stimulation
m�edullaire et des nerfs p�eriph�eriques.5,76,77
La SNET est une technique non invasive qui
d�elivre une stimulation �electrique par des �electrodes
attach�ees a la peau, soit au niveau de la douleur, soit
au niveau du tronc nerveux. Dans une petite s�erie
de malades ayant un SDRC, la SNET a �et�e trouv�ee
efficace dans la majorit�e des cas.78 En raison des
paresth�esies qui accompagnent la stimulation, il est
impossible de r�ealiser des �etudes cliniques rando-
mis�ees a l’aveugle.
La stimulation m�edullaire (SM) est une forme de
traitement utilis�e pour traiter certains types de
douleurs chroniques. Le m�ecanisme exact d’action
de cette technique est mal compris mais elle
implique un g�en�erateur �electrique qui d�elivre des
impulsions a une zone cible de moelle �epiniere.
Deux revues syst�ematiques r�ecentes de la SM79,80
n’ont trouv�e qu’une �etude control�ee randomis�ee
de cette technique chez des malades ayant un
SDRC.76 Cet essai a trouv�e que la physioth�erapie
associ�ee a la SM, compar�ee a la physioth�erapie
seule, avait un effet statistiquement significatif
mais cliniquement modeste a 6 et 12 mois pour
traiter la douleur chez les malades ayant un
SDRC.76 De meme, 6 autres �etudes de qualit�em�ethodologique moindre suggerent une am�eliora-
tion l�egere a mod�er�ee de la douleur avec la SM.79,80
Les auteurs concluaient qu’il y avait quelques
preuves de l’efficacit�e de cette technique dans le
traitement du SDRC. De plus, la SM est couteuse et
a un taux de complications compris entre 25% et
75% (infection, fracture et migration d’�electrode,�echec de l’appareil).76,80 Une p�eriode d’essai de
stimulation doit obligatoirement etre r�ealis�ee avant
le d�ebut du traitement.
La stimulation nerveuse p�eriph�erique utilise une
technique semblable a la SM et pourrait avoir un
m�ecanisme d’action semblable. Actuellement, seule
une �etude prospective de la stimulation nerveuse
p�eriph�erique pour SDRC a �et�e rapport�ee.81 Plus de
la moiti�e des malades dans cette �etude rapportaient
une diminution a long terme des douleurs d’au
moins 25%.
PRONOSTIC
A condition d’un diagnostic pr�ecoce et d’un traite-
ment rapide, le pronostic du SDRC est bon. Les
erreurs diagnostiques prolong�ees et l’absence de trai-
tement entraınent des perturbations chroniques. La
r�ecidive est observ�ee dans 4% a 10% des cas trois
mois a 20 ans apres l’�episode initial. Une �etude a 5
ans de malades ayant un SDRC du membre
sup�erieur a montr�e que les malades continuent a
avoir des perturbations a long terme de leur activit�equotidienne. Vingt-six pour cent des malades ont du
changer de travail et presque 30% ont du arreter leur
travail pendant plus d’un an. Ainsi, on estime que
seulement un malade sur 5 est capable de reprendre
un niveau normal de fonctionnement.82
330 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire
CONCLUSIONS
Les aspects caract�eristiques du SDRC sont faciles a
reconnaıtre mais les connaissances concernant son
histoire naturelle et sa physiologie restent tres
limit�ees. Les options th�erapeutiques efficaces ne
sont pas claires, en raison du petit nombre d’�etudes
bien organis�ees et des difficult�es pour recruter des
nombres suffisants de malades ayant cette affection.
Une collaboration multicentrique dans des essais
control�es randomis�es bien organis�es aidera a
r�esoudre ces problemes. A notre connaissance, il
n’y a pas de telles �etudes actuellement en cours. Le
SDRC est probablement sous-diagnostiqu�e dans la
mesure ou la connaissance de cette affection parmi
les cliniciens n’est pas tres fr�equente. Cette affection
est associ�ee a des morbidit�es physiques et psycholo-
giques significatives et a une fonctionnalit�e tres
diminu�ee des individus affect�es. En l’absence de
preuve d’un traitement efficace, un diagnostic
pr�ecoce et une approche multidisciplinaire du traite-
ment sont essentiels pour permettre une �evolution
optimale.
REFERENCES
1. Veldman PH, et coll. Signs and symptoms of reflex sympa-
thetic dystrophy: prospective study of 829 patients. Lancet
1993;342:1012-1016.
2. Stanton-Hicks M, et coll. Reflex sympathetic dystrophy:
changing concepts and taxonomy. Pain 1995;63:127-133.
3. Drummond PD. Involvement of the sympathetic nervous
system in complex regional pain syndrome. Int J Low
Extrem Wounds 2004;3:35-42.
4. Bruehl S, et coll. External validation of IASP diagnostic
criteria for complex regional pain syndrome and proposed
research diagnostic criteria. International Association for the
Study of Pain. Pain 1999;81:147-154.
5. Stanton-Hicks M, et coll. Complex regional pain syndromes:
guidelines for therapy. Clin J Pain 1998;14:155-166.
6. Harden RN, et coll. Complex regional pain syndrome: are
the IASP diagnostic criteria valid and sufficiently compre-
hensive? Pain 1999;83:211-219.
7. Bickerstaff DR, Kanis JA. Algodystrophy: an under-reco-
gnized complication of minor trauma. Br J Rheumatol
1994;33:240-248.
8. Atkins RM, Duckworth T, Kanis JA. Features of algodystrophy
after Colles’ fracture. J Bone Joint Surg Br 1990;72:105-110.
9. Atkins RM. Complex regional pain syndrome. J Bone Joint
Surg Br 2003;85:1100-1106.
10. Raja SN, Grabow TS. Complex regional pain syndrome I
(reflex sympathetic dystrophy). Anesthesiology 2002;96:
1254-1260.
11. Littlejohn GO. Reflex sympathetic dystrophy in adolescents:
lessons for adults. Arthritis Rheum 2004;51:151-153.
12. Shinya K, Lanzetta M, Conolly WB. Risk and complications
in endoscopic carpal tunnel release. J Hand Surg [Br]
1995;20:222-227.
13. Waegeneers S, Haentjens P, Wylock P. Operative treatment of
carpal tunnel syndrome. Acta Orthop Belg 1993;59:367-370.
14. Prosser R, Conolly WB. Complications following surgical
treatment for Dupuytren’s contracture. J Hand Ther 1996;9:
344-348.
15. Katz MM, et coll. Reflex sympathetic dystrophy as a cause of
poor results after total knee arthroplasty. J Arthroplasty
1986;1:117-124.
16. Isakov E, Susak Z, Korzets A. Reflex sympathetic dystrophy of
the stump inbelow-kneeamputees. Clin JPain1992;8:270-275.
17. Mittal R, et coll. The role of Tc-99m bone imaging in the
management of pain after complicated total hip replace-
ment. Clin Nucl Med 1997;22:593-595.
18. Leitha T, Staudenherz A, Fialka V. Reflex sympathetic dys-
trophy after arthroscopy. Clin Nucl Med 2000;25:
1028-1029.
19. Field J, Protheroe DL, Atkins RM. Algodystrophy after Colles
fractures is associated with secondary tightness of casts. J
Bone Joint Surg Br 1994;76:901-905.
20. Petchkrua W, Weiss DJ, Patel RR. Reassessment of the
incidence of complex regional pain syndrome type 1 fol-
lowing stroke. Neurorehabil Neural Repair 2000;14:59-63.
21. Karras D, et coll. Reflex sympathetic dystrophy syndrome
and osteogenesis imperfecta. A report and review of the
literature. J Rheumatol 1993;20:162-164.
22. Poncelet C, et coll. Reflex sympathetic dystrophy in pre-
gnancy: nine cases and a review of the literature. Eur J
Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;86:55-63.
23. Bruehl S, et coll. Complex regional pain syndrome: are there
distinct subtypes and sequential stages of the syndrome?
Pain 2002;95:119-124.
24. Karacan I, Aydin T, Ozaras N. Bone loss in the contralateral
asymptomatic hand in patients with complex regional pain
syndrome type 1. J Bone Miner Metab 2004;22:44-47.
25. Birklein F, et coll. Neurological findings in complex regional
pain syndromes : analysis of 145 cases. Acta Neurol Scand
2000;101:262-269.
26. Birklein F, et coll. Sympathetic vasoconstrictor reflex pat-
tern in patients with complex regional pain syndrome. Pain
1998;75:93-100.
27. Wasner G, et coll. Vascular abnormalities in reflex sympa-
thetic dystrophy (CRPS I): mechanisms and diagnostic
value. Brain 2001;124:587-599.
28. Livingstone JA, Field J. Algodystrophy and its association
with Dupuytren’s disease. J Hand Surg [Br] 1999;24:199-202.
29. Birklein F, Handwerker HO. Complex regional pain syn-
drome: how to resolve the complexity? Pain 2001;94:1-6.
30. van der Laan L, Veldman PH, Goris RJ. Severe complications
of reflex sympathetic dystrophy: infection, ulcers, chronic
edema, dystonia, and myoclonus. Arch Phys Med Rehabil
1998;79:424-429.
31. Bruehl S, Carlson CR. Predisposing psychological factors in
the development of reflex sympathetic dystrophy. A review
of the empirical evidence. Clin J Pain 1992;8:287-299.
32. Gulevich SJ, et coll. Stress infrared telethermography is
useful in the diagnosis of complex regional pain syndrome,
type I (formerly reflex sympathetic dystrophy). Clin J Pain
1997;13:50-59.
33. Birklein F, et coll. Sudomotor function in sympathetic reflex
dystrophy. Pain 1997;69:49-54.
34. Atkins RM, et coll. Quantitative bone scintigraphy in reflex
sympathetic dystrophy. Br J Rheumatol 1993;32:41-45.
35. Wilder RT, et coll. Reflex sympathetic dystrophy in children.
Clinical characteristics and follow-up of seventy patients. J
Bone Joint Surg Am 1992;74:910-919.
36. Schott GD. Reflex sympathetic dystrophy. J Neurol Neuro-
surg Psychiatry 2001;71:291-295.
Vol. 22, No. 2, 2008 Le syndrome douloureux r�egional complexe 331
37. Kozin F, et coll. The reflex sympathetic dystrophy syn-
drome. II. Roentgenographic and scintigraphic evidence of
bilaterality and of periarticular accentuation. Am J Med
1976;60:332-338.
38. Zyluk A. The usefulness of quantitative evaluation of three-
phase scintigraphy in the diagnosis of post-traumatic reflex
sympathetic dystrophy. J Hand Surg [Br] 1999;24:16-21.
39. Kumar V, et coll. A study of bone densitometry in patients
with complex regional pain syndrome after stroke. Postgrad
Med J 2001;77:519-522.
40. Sintzoff S, et coll. Imaging in reflex sympathetic dystrophy.
Hand Clin 1997;13:431-442.
41. Price DD, et coll. Analysis of peak magnitude and duration
of analgesia produced by local anesthetics injected into
sympathetic ganglia of complex regional pain syndrome
patients. Clin J Pain 1998;14:216-226.
42. Manchikanti L. The role of radiofrequency in the manage-
ment of complex regional pain syndrome. Curr Rev Pain
2000;4:437-444.
43. Furlan AD, Lui PW, Mailis A. Chemical sympathectomy for
neuropathic pain: does it work? Case report and systematic
literature review. Clin J Pain 2001;17:327-336.
44. Bosco Vieira Duarte J, Kux P, Duarte DF. Endoscopic
thoracic sympathicotomy for the treatment of complex
regional pain syndrome. Clin Auton Res 2003;13(Suppl
1):I58-I62.
45. Rowbotham MC. Pharmacologic management of complex
regional pain syndrome. Clin J Pain 2006;22:425-429.
46. Backonja MM. Anticonvulsants (antineuropathics) for neuro-
pathic pain syndromes. Clin J Pain 2000;16(2 Suppl):S67-S72.
47. Backonja MM, Serra J. Pharmacologic management part 2:
lesser-studied neuropathic pain diseases. Pain Med
2004;5(Suppl 1):S48-S59.
48. van de Vusse AC, et coll. Randomised controlled trial of
gabapentin in complex regional pain syndrome type 1. BMC
Neurol 2004;4:13 [ISRCTN84121379].
49. Serpell MG. Gabapentin in neuropathic pain syndromes: a
randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Pain
2002;99:557-566.
50. Rho RH, et coll. Complex regional pain syndrome. Mayo
Clin Proc 2002;77:174-180.
51. Braus DF, Krauss JK, Strobel J. The shoulder-hand syn-
drome after stroke: a prospective clinical trial. Ann Neurol
1994;36:728-733.
52. Christensen K, Jensen EM, Noer I. The reflex dystrophy
syndrome response to treatment with systemic corticoste-
roids. Acta Chir Scand 1982;148. 653e635.
53. Robbins WR, et coll. Treatment of intractable pain with
topical large-dose capsaicin: preliminary report. Anesth
Analg 1998;86:579-583.
54. Watson CP, et coll. A randomized vehicle-controlled trial of
topical capsaicin in the treatment of postherpetic neuralgia.
Clin Ther 1993;15:510-526.
55. Rowbotham MC, et coll. Lidocaine patch: double-blind
controlled study of a new treatment method for post-her-
petic neuralgia. Pain 1996;65:39-44.
56. Dellemijn PL, et coll. The interpretation of pain relief and
sensory changes following sympathetic blockade. Brain
1994;117(Pt 6):1475-1487.
57. Manicourt DH, et coll. Role of alendronate in therapy for
posttraumatic complex regional pain syndrome type I of the
lower extremity. Arthritis Rheum 2004;50:3690-3697.
58. Robinson JN, Sandom J, Chapman PT. Efficacy of pami-
dronate in complex regional pain syndrome type I. Pain Med
2004;5:276-280.
59. Varenna M, et coll. Intravenous clodronate in the treatment
of reflex sympathetic dystrophy syndrome. A randomized,
double blind, placebo controlled study. J Rheumatol
2000;27:1477-1483.
60. Sahin F, et coll. Efficacy of salmon calcitonin in complex
regional pain syndrome (type 1) in addition to physical
therapy. Clin Rheumatol 2006;25:143-148.
61. Perez RS, et coll. Treatment of reflex sympathetic dys-
trophy (CRPS type 1): a research synthesis of 21 rando-
mized clinical trials. J Pain Symptom Manage 2001;21:
511-526.
62. Perez RS, et coll. The treatment of complex regional pain
syndrome type I with free radical scavengers: a randomized
controlled study. Pain 2003;102:297-307.
63. Zuurmond WW, et coll. Treatment of acute reflex sympa-
thetic dystrophy with DMSO 50% in a fatty cream. Acta
Anaesthesiol Scand 1996;40:364-367.
64. Goris RJ, Dongen LM, Winters HA. Are toxic oxygen radicals
involved in the pathogenesis of reflex sympathetic dys-
trophy? Free Radic Res Commun 1987;3:13-18.
65. Langendijk PN, et coll. Good results of treatment of reflex
sympathetic dystrophy with a 50% dimethylsulfoxide
cream. Ned Tijdschr Geneeskd 1993;137:500-503 [in
Dutch].
66. Zollinger PE, et coll. Effect of vitamin C on frequency of
reflex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomi-
sed trial. Lancet 1999;354:2025-2028.
67. Oerlemans HM, et coll. Pain and reduced mobility in
complex regional pain syndrome I: outcome of a pros-
pective randomised controlled clinical trial of adjuvant
physical therapy versus occupational therapy. Pain
1999;83:77-83.
68. Schott GD. Interrupting the sympathetic outflow in cau-
salgia and reflex sympathetic dystrophy. BMJ 1998;316:
792-793.
69. AbuRahma AF, et coll. Sympathectomie pour algodys-
trophie r�eflexe : facteurs pr�edictifs du r�esultat. Ann Chir
Vasc 1994;8:372-379.
70. Singh B, et coll. Sympathectomy for complex regional pain
syndrome. J Vasc Surg 2003;37:508-511.
71. Nelson DV, Stacey BR. Interventional therapies in the
management of complex regional pain syndrome. Clin J
Pain 2006;22:438-442.
72. Mockus MB, et coll. Sympathectomy for causalgia. Patient
selection and long-term results. Arch Surg 1987;122:
668-672.
73. Haynsworth RF, Jr, Noe CE. Percutaneous lumbar sym-
pathectomy: a comparison of radiofrequency denervation
versus phenol neurolysis. Anesthesiology 1991;74:
459-463.
74. Bandyk DF, et coll. Surgical sympathectomy for reflex
sympathetic dystrophy syndromes. J Vasc Surg 2002;35:
269-277.
75. Kingery WS. A critical review of controlled clinical trials for
peripheral neuropathic pain and complex regional pain
syndromes. Pain 1997;73:123-139.
76. Kemler MA, et coll. Spinal cord stimulation in patients with
chronic reflex sympathetic dystrophy. N Engl J Med
2000;343:618-624.
77. Lee KJ, Kirchner JS. Complex regional pain syndrome and
chronic pain management in the lower extremity. Foot
Ankle Clin 2002;7:409-419.
78. RobainaFJ, et coll. Transcutaneouselectricalnerve stimulation
and spinal cord stimulation for pain relief in reflex sympathetic
dystrophy. Stereotact Funct Neurosurg 1989;52:53-62.
332 Albazaz et al. Annales de chirurgie vasculaire
79. Turner JA, et coll. Spinal cord stimulation for patients with
failed back surgery syndrome or complex regional pain
syndrome: a systematic review of effectiveness and compli-
cations. Pain 2004;108:137-147.
80. Mailis-Gagnon A, et coll. Spinal cord stimulation for
chronic pain. Cochrane Database Syst Rev 2004. CD00
3783.
81. Hassenbusch SJ, et coll. Long-term results of peripheral
nerve stimulation for reflex sympathetic dystrophy. J Neu-
rosurg 1996;84:415-423.
82. Subbarao J, Stillwell GK. Reflex sympathetic dystrophy syn-
drome of the upper extremity: analysis of total outcome of
management of 125 cases. Arch Phys Med Rehabil 1981;62:
549-554.