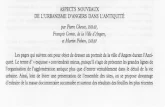"Abandonner ou restaurer: la peur des ruines dans l'Antiquité tardive" dans K. Kaderka (éd.), Les...
-
Upload
univ-avignon -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of "Abandonner ou restaurer: la peur des ruines dans l'Antiquité tardive" dans K. Kaderka (éd.), Les...
Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur le phénomène de la ruine, as-socié à la décadence matérielle de la cité antique de laquelle émergera la villemédiévale. Ces profondes modifications s’inscrivent dans le paysage urbain,en particulier de Rome et des grandes villes, en raison de la crise politique quel’Empire traverse pendant plusieurs siècles et de la rétractation des surfacesurbaines. Les ruines s’accumulent du fait du manque d’entretien, des inva-sions successives – qui peuvent se conjuguer avec des catastrophes naturelles –dans les cités comme dans les campagnes. La mutation religieuse et letriomphe du christianisme ont rendu toute une série de bâtiments inutiles. Lesédifices désaffectés qui tombent en décrépitude ont alors fait partie pendantde nombreux siècles du quotidien des populations. Sans céder à la tentationdu catastrophisme, on peut esquisser de la perception de ruines un tableautrès contrasté de la manière dont les constructions en décadence ont été res-senties, entre sources textuelles qui parfois amplifient le phénomène et tracesarchéologiques, difficiles d’interprétation. Dans la période troublée de la finde l’Antiquité, le manque de ressources financières a souvent poussé les empe-reurs et leurs représentants à parer au plus pressé, sans pouvoir toujours tenircompte des considérations esthétiques qui avaient prévalu durant les premierssiècles de l’Empire. La vision à court terme a souvent gagné chez les particu-liers, confrontés à des difficultés croissantes d’entretien. De nombreux édificesde culte païen, abandonnés, vont servir de carrière de matériau, puis, dans lecourant du Ve siècle, ce sont les édifices de loisirs et de spectacle, ainsi que lesmonuments funéraires 1. L’habitude des spolia se répand 2. La ruine appelle laréutilisation, le détournement, le remploi : nombre d’espaces religieux ou pro-fanes désaffectés sont squattés ; certains sont transformés en église, bien quecela ne soit pas systématique 3. Des bâtiments en ruines disparaissent rapide-ment, d’autres au contraire, par leur masse inépuisable, « s’éternisent » – ausens propre du terme – et marquent l’imaginaire des habitants, entourés de lé-gendes sur leur antique fonction 4. La cité romaine n’en finit pas de mourirdans un lent recyclage de matériaux qui dure plusieurs siècles et s’achève avecla Renaissance. La vitesse de dégradation des grands édifices publics de Rome,mais aussi de l’architecture privée fut donc très variable. Les contemporainstentèrent de ralentir le processus, conscients des pertes irrémédiables qu’il en-traînerait dans leur confort de vie. Plusieurs études ont déjà fait le point sur
Abandonner ou restaurer :la peur des ruines dans l’Antiquité tardive
Éric Morvillez
Rome en ruines a certainement eu plus d’influence sur l’architecture qu’elle n’en aurait eu neuve : ce qu’on ne voit pas, on peut l’imaginer
Peter Greenaway, Le ventre de l’architecte, !"#$
Cam
pisa
no E
dito
reLe
s Ru
ines
Ent
re d
estr
uctio
n et
con
stru
ctio
nde
l’A
ntiq
uité
à n
os jo
urs
Kar
olin
a K
ader
ka
�€ !",""
Aucune époque n’échappe aux ruines et toutes les ruines ont unehistoire. Elles sont vouées à perdurer ou disparaître, fasciner oudéranger. L’intérêt pour les ruines s’explique de façon naturelle parleur omniprésence et ne date pas d’aujourd’hui : différentes époques et cultures témoignent de leur façon propre de les appréhender. Si le goût des ruines antiques émerge en Europe avec la Renaissance et suscite un véritable culte au siècle des Lumières, toutes les époquesde l’histoire sont amenées à affronter des ruines de genres divers,parfois conceptualisées mentalement. Au cours du siècle dernier, dansun contexte où surgissent de nouvelles formes de destructions, massives et violentes, se font jour une nouvelle sensibilité aux ruines et un désird’étudier, de manière plus complexe, leur impact et leur significationpour les sociétés : celles auxquelles elles appartenaient à l’origine,comme celles auxquelles elles seront confrontées par la suite.S’inscrivant dans la continuité des recherches actuelles sur le sujet, ce volume interdisciplinaire souhaite présenter et discuter l’existence et la perception de ruines en Europe, dans des contextes culturels et historiques variés, qu’elles soient considérées in situ, représentées ou ressenties, qu’elles soient décrites ou abordées par d’autres moyensque les mots. Des archéologues, historiens, historiens de l’art et del’architecture, esthéticiens, spécialistes des langues, de la littérature et des nouvelles technologies de conservation des traces du passé,croisent leurs regards dans des études qui portent sur les constructionsdétruites, tout comme sur les destructions construites, en montrantdiverses façons de les concevoir depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.
HAUTES ETUDEShistoire de l’art/storia dell’arte
comité scientifiqueSabine FrommelFrançois QueyrelJean-Michel Leniaud
Volumes en préparationdans la même collection :
Architektur- und Ornamentgraphik der Frühen Neuzeit:Migrationsprozesse in Europa / Gravures d’architecture et d’ornement au début de l’époque moderne: processus de migration en Europe,a cura di Sabine Frommel et Eckhard Leuschner
Volumes publiés :
Les sciences humaines et leurs langages. Artifices et adoptions,sous la dir. de Sabine Frommel et Gernot Kamecke
L’idée du style dans l’historiographie artistique.Variantes nationales et transmissions,sous la dir. de Sabine Frommel et Antonio Brucculeri
Les Ruines. Entre destruction et construction de l’Antiquité à nos jours, sous la dir. de Karolina Kaderka
Karolina Kaderka est archéologue et historienne de l’art antique.Chercheuse associée dans l’équipe d’accueil Histara (EA !##$) del’École pratique des hautes études (EPHE Paris) et lauréate du prix« Jeune chercheur » de la Fondation des Treilles pour %"#&, elle estactuellement post-doctorante Fernand Braudel-IFER à l’Université de Constance. Après des études universitaires à l’Université Charlesde Prague et à l’Université Louis-et-Maximilien de Munich, elle aobtenu en %"#% un doctorat (co-tutelle EPHE Paris/Université deDresde), avec une thèse consacrée au décor tympanal des temples deRome. Ses travaux portent notamment sur la sculpture romaine, surl’art romain dans son contexte (spatial, socioculturel et historique,avec un intérêt particulier pour les programmes décoratifs), sur lestransferts culturels entre la Grèce, le monde étrusco-italique et Romeet sur la photographie archéologique. Dernièrement elle a collaboréau catalogue d’exposition Éclats d’antiques. Sculptures etphotographies : Gustave Mendel à Constantinople (Paris, %"#&).
édité parKarolina Kaderka
préface de François Queyrel
Les RuinesEntre destruction et construction de l’Antiquité à nos jours
Campisano
HA
UT
ES
ET
UD
ES
hist
oire
de
l’art
/sto
ria d
ell’a
rte
%& ÉRIC MORVILLEZ
les lois concernant la démolition comme la conservation des édifices du patri-moine urbain antique 5. Mais la perception des ruines et le sentiment qu’ellesprovoquent dans l’Antiquité tardive sur les contemporains n’ont été que plusrécemment pris en compte. Relativement peu de textes littéraires évoquaientles ruines au Haut-Empire : le sujet tant littéraire qu’artistique restait rare etpointu et tourné vers une réflexion historique 6. Avec la prise de conscience del’essoufflement de la civilisation romaine et de son possible effondrement, lethème prend une tonalité plus existentielle et dramatique. Teinté du pessimis-me ambiant d’un paganisme sur la défensive, le sujet va prendre une nouvellesignification à travers le prisme de la pensée chrétienne.
Je me propose donc ici aborder le sujet non seulement du point de vue desbâtiments publics mais aussi de celui, plus rarement traité, des constructionsprivées, pour montrer quelles inquiétudes pouvaient susciter les ruines dans lepaysage urbain et rural 7. On verra que le souci primordial est qu’il fautd’abord « éviter la ruine » et que, durant toute l’Antiquité tardive, le besoinprioritaire est d’entretenir les édifices et de les maintenir en fonctionnement.Mais avec les répétitions des vagues d’invasions, villes et campagnes ont subides dégâts irréparables. À partir du Ve siècle, le discours évolue : dans lessources, la perception des ruines change. Celles-ci deviennent l’un des signesles plus visibles des difficultés de l’époque, associés à la volonté divine. Avec lanouvelle appréciation du temps par les Chrétiens, un discours plus moralisant,différent de celui qu’elles avaient suscité jusqu’alors, apparaît : restaurer et fai-re disparaître les ruines devient comme l’une des solutions pour aller vers larenaissance, sortir de la crise et faire renaître l’espérance.
Éviter les ruines
La forme et la beauté sont au centre des préoccupations des bâtisseurs etdes évergètes. La cité antique célèbre le brillant et l’harmonie des construc-tions. On le lit encore dans l’inscription des derniers grands bains publics édi-fiés à Rome sous la Tétrarchie, les thermes de Dioclétien que les empereurs« dédièrent à leurs chers Romains » qu’ils ont « somptueusement achevés danstous ses détails » 8. L’apparence et la beauté des lieux publics sont essentiellesaux yeux des magistrats. L’emphase de la littérature et des textes épigra-phiques insistent sur les splendissimes civitates 9. Les nombreuses lois descodes théodosien et justinien en font foi : il faut dégager les monuments desconstructions parasites 10. On doit également conserver aux villes tous leurs or-nements, héritage du passé et preuve de noblesse et d’ancienneté :
Nul ne doit s’imaginer que des cités puissent être dépouillées des ornements quileur sont propres : car assurément il n’est pas juste qu’une cité perde la parure reçuedes aïeux comme si celle-ci était transférable aux monuments d’une autre ville 11.
Pour éviter que les édifices antérieurs ne finissent ruinés faute d’entretien, leslois sont multipliées pour ne pas entreprendre de bâtiment neuf si un chantiercommencé n’est pas terminé :
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE %$
Il Nous a été proposé, et Nous avons sanctionné, une loi qui, par son énoncé et sonautorité, empêche tous les magistrats, y compris les gouverneurs de province de s’atta-quer à quelque ouvrage que ce soit avant d’avoir réparé ceux qui se seraient lézardéssous l’effet de la vétusté. Ce que Nous avons cru devoir rappeler par les présentes 12.
Après le sac de Rome de '!(, la parure monumentale continuera de recevoirdes soins, toujours semble-t-il insuffisants. En témoignent par exemple les res-taurations des thermes de l’Aventin, effectuées en '!' par le préfet de la villeCaecina Decius Aginatius Albinus qui « a consolidé par un double renfortd’arcades, érigées depuis les fondations, la salle des bains tièdes (cella tepida-ria) dont les murs penchaient dangereusement et dont dépendaient l’écroule-ment des autres salles » 13. Les thermes de Constantin sont, eux, réparés unpeu avant ''), toujours par le préfet de la ville :
(...) grâce à une petite subvention accordée par l’ordre très ample dans la mesure oùle permettaient les difficultés publiques, a sauvé d’une ruine extrême et rendu dansleur aspect et leur splendeur antérieurs, par son intervention très libérale, les thermesde Constantin, délabrés fortement par une longue incurie (...) au point qu’on ne les re-connaissait plus en leurs diverses parties et que tous désespéraient de leur réparation 14.
Les grands établissements de bains nécessitaient par principe des soinsconstants en raison de l’humidité permanente. Les traces de restaurations ysont nombreuses durant les IVe et Ve siècles, mais leur déclin s’accélère au Ve
siècle : ainsi à Ostie, comme l’a bien montré Grégoire Poccardi 15. Les chiffresparlent d’eux-mêmes pour les théâtres en Italie : d’après Violaine Malineau, oncomptait, au temps d’Auguste, '(( cités dans la péninsule dont la moitié possé-dait un théâtre. Au IVe siècle, selon l’enquête de l’auteur – difficile, car il est dé-licat de dire quand un bâtiment cesse son activité originelle – sur la quarantainesur laquelle on possède des renseignements, une douzaine seulement est encoreen activité (travaux ou jeux attestés). Les bâtiments ont dû rapidement êtresquattés ou tomber en ruine et servir de carrière de matériaux 16. Les restaura-tions successives du Colisée, monument emblématique de la puissance romai-ne, revêtent d’ailleurs une signification toute particulière car l’édifice conservelongtemps un statut de lieu de communication symbolique entre le pouvoir etle peuple de Rome, à travers des jeux qui se maintiennent très longtemps 17.
Cette préoccupation de l’entretien du patrimoine ne touche pas que lasphère publique. On la retrouve aussi pour les constructions domestiques pri-vées dont l’étendue et la somptuosité n’avaient rien à envier à l’architecturepublique. Nous avons la chance de posséder pour la fin de l’Antiquité la cor-respondance de Symmaque, païen représentatif des préoccupations de sonmilieu, conscient de l’héritage de ce passé glorieux. D’un côté, ses lettres nousdonnent l’image lissée d’une vie rythmée entre Rome et ses nombreuses villé-giatures des environs de Rome ou du bord de mer 18. De l’autre côté, dans cer-tains passages, on entraperçoit le poids de la vétusté de demeures troplourdes à entretenir, d’un patrimoine certainement brillant, mais surdimen-sionné dans une période de crise, malgré l’immensité des fortunes associées.Des passages, même s’ils sont tournés dans un mode mondain et distancié, dé-
%# ÉRIC MORVILLEZ
noncent les soucis d’entretien que leurs domus et villas innombrables procu-rent aux potentiores :
C’est donc ma destinée que partout où je pose le pied, se présente quelque occasionde bâtir ! Ainsi en ce moment, la reconstruction de ma villa de Capoue m’oblige à delourdes dépenses. Une partie se lézarde faute d’entretien, l’autre qu’autrefois on a ré-paré à la hâte, n’offre qu’un abri sans solidité. Si nous ne nous soucions pas d’y remé-dier rapidement, ou s’accumuleront les frais d’argent, ou s’amoncelleront les ruines,car dans les travaux de ce genre, à remettre on perd définitivement. J’ai donc l’inten-tion de débarrasser cet édifice de sa vétusté. C’est pourquoi nous avons sacrifié un re-pos que nous désirions ardemment à une entreprise dispendieuse 19.
Comme on le lit dans le vocabulaire choisi par Symmaque, ne pas entrete-nir, c’est se rendre coupable de paresse, d’absence de prévoyance et manquerà son rang : les habituels termes d’otium et de negotium sont ici bien opposés.C’est donc aussi déchoir à ses yeux et ceux des autres 20. Dans une société où leparaître dans son privé a un rôle essentiel, entretenir son patrimoine est vitalalors que l’état du bâti, résidentiel ou d’exploitation, entre autant en ligne decompte que l’étendue de la terre dans le calcul des revenus.
L’activité de bâtir reste donc un privilège, mais aussi une des servitudes dela fortune. Le phénomène se poursuit durant tout le IVe et le Ve siècle. Entre-tenir les domaines dont on a hérité et y faire des améliorations fait partie del’affichage du statut social des grands propriétaires. Repousser les travaux,compte tenu du nombre de propriétés en jeu, fait courir un risque pécuniaireà des propriétaires fragilisés par des revenus moins réguliers, avec les difficul-tés du temps.
Une autre lettre de Symmaque complète la vision que l’on peut avoir de cet-te conception de l’entretien des édifices. Il s’y inquiète avec Flavianus, son voi-sin, de la construction d’un portique dans une nouvelle maison en Campanie,sur un terrain concédé par celui-ci :
J’avais désiré, pour y bâtir une nouvelle maison, du terrain libre, près de Naples,qui vous appartient en bordure de chez moi. Or vous partagez avec moi des ouvragesdignes de Lucullus et pour que ma pudeur ne récuse pas votre don, vous dites quevous ne pensez pas avoir des droits sur ce que pourtant je déclare vous avoir apparte-nu. Souffrez qu’au moins je vous doive de la reconnaissance (...). Vous ajoutez de sur-croît des incitations qui irritent ma démangeaison de construire (Morbus fabricatoris) :le portique à double arcade, d’un ouvrage impeccable et solide, se développe sur unebonne longueur de pas ; ce que je construis est à côté et l’intervalle peut être combléau prix d’un petit travail de maçonnerie. Pourquoi vous échinez-vous contre ma mo-destie ? Mais moi aussi je fais ce que vous refusez : je vous remercie de votre générosi-té. Toutefois, comme la dépense va croissant, tandis qu’avec du neuf nous cherchons àégaler l’ancien, je crains bien de m’apercevoir que vous voulez me concéder plus queje ne puis réparer 21.
De cet assaut de politesse alambiqué, on peut retirer plusieurs conclusionssignificatives : la dernière phrase semble indiquer une pointe de dépit, mêléed’un sentiment d’impuissance de ne pouvoir rivaliser avec les constructions dupassé, dont toute la côte de Naples montrera encore très longtemps des traces
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE %"
exceptionnelles. La référence aux fastes de Lucullus, grand constructeur devillas extravagantes, donne l’échelle des domaines en question et des travauxen cours, même s’il peut y avoir une exagération littéraire dans ce rappel 22.
Au-delà du simple topos littéraire et des mondanités d’usage, on sent uneréelle pression due à un patrimoine ébranlé par l’âge qui, comme nos monu-ments historiques aujourd’hui, a pesé sur les épaules de l’aristocratie de l’Anti-quité. Véritable sentiment d’impuissance qui peut expliquer en partie la fuitedes responsabilités vers des préoccupations plus spirituelles de la part de cer-taines grandes familles devenus chrétiennes – comme on peut la lire au Ve
siècle à travers la vie de sainte Mélanie et son époux Pinien. Les lois répétées du Code théodosien nous laissent deviner que l’embellisse-
ment recherché par les uns génère aussi la ruine d’autres constructions. No-tons que le phénomène ne concerne pas seulement les réparations d’édificespublics ou la création de basiliques chrétiennes.
On a beaucoup souligné les remplois systématiques de portiques entiers, dechapiteaux ou d’architraves pour les constructions d’églises. Nul doute queces éléments arrachés – souvent porteurs – devaient signer la fin prochainedes édifices ciblés pour la récupération et l’écroulement programmé à courtou moyen terme 23. À Rome même, dont la parure monumentale est excep-tionnelle, il est nécessaire de surveiller qu’on n’endommage pas le patrimoineurbain existant :
Aucun des préfets de la Ville ou des autres magistrats que le pouvoir place en unrang élevé ne doit construire d’ouvrage neuf dans l’illustre ville de Rome, mais s’appli-quer au nécessaire entretien des anciens.
Qui voudra construire tout ouvrage neuf dans la ville devra s’en acquitter à ses fraiset par ses soins, sans porter atteinte aux vieux monuments, sans affouiller les fonda-tions des ouvrages nobles, sans remployer les pierres de taille du domaine public, sansarracher des fragments de marbre, ce qui dégraderait les édifices ainsi dépouillés 24.
Pour les provinces, le souci des empereurs est identique pour empêcher quetrop d’édifices publics ne tombent en ruine, alors que les magistrats rivalisentde constructions neuves pour se faire bien voir de leurs concitoyens :
Un gouverneur qui serait affecté à une province devra, pour deux tiers, ramener àleur splendeur première les ouvrages détériorés soit par incurie, soit par vétusté (velincuria vel vetustate conlabsas ad statum pristinum nitoris adducat), et pour un derniertiers construire à neuf, si du moins il désire pourvoir à sa réputation et à ses propreslouanges 25.
Dès le milieu du IVe siècle, les empereurs doivent réfréner les abus de récu-pération. Ainsi Valentinien et Valens envoient un texte à Mamertin, préfet duprétoire d’Italie, pour empêcher le dépouillement de la parure de petites citésau profit des plus grandes :
Nous interdisons dorénavant la hardiesse des gouverneurs qui, au prix de la des-truction de bourgades écartées se donnent l’air d’orner les métropoles ou les plusbrillantes cités, en recherchant pour matériaux des statues, des marbres ou des co-lonnes à transférer (Abditorum oppidorum metropoles vel splendissimas civitates ornare
&( ÉRIC MORVILLEZ
se fingunt transferandorum signorum vel marmorum vel columnarum materiam re-quientes). Chose qu’il ne sera plus possible de commettre impunément après la pro-mulgation de notre loi, d’autant que Nous avions ordonné qu’on n’édifiât pas deconstruction nouvelle avant que les vieilles ne fussent remises en état 26.
Même les particuliers n’hésitent pas à se servir jusque sur les édifices funé-raires pour leurs constructions privées et « certains même arrachent destombes des ornements pour leurs triclinia ou leurs portiques » 27. Ils risquentalors de très fortes amendes et condamnation :
Si une quelconque personne, donc, emportait d’une tombe des pierres, du marbreou des colonnes dans l’intention de bâtir ou s’il fait cela pour vendre ces matériaux, ilserait contraint de payer dix livres d’or au fisc 28.
Quoi qu’il en soit, à la fin du IVe siècle, on note peut-être une inflexion de laloi qui, selon nous, indique qu’un certain nombre d’édifices, en ruine complè-te, sont sacrifiés pour faire place nette et éviter ainsi que d’autres ne subissentle même sort. Ainsi Arcadius et Honorius promulguent une loi de plus depuisConstantinople, en décembre )"#, au préfet du prétoire d’Orient : « S’il arriveque surgissent des solliciteurs d’ouvrages publics, on ne doit attribuer à cessolliciteurs que ceux qui seraient en ruine et détruits de fond en comble, etceux qui seraient de trop peu d’utilité pour les cités » 29.
La succession de lois et leur répétition ont été interprétées de manièrecontradictoire : certains y ont vu l’inefficacité de celles-ci et nous ne sommespas loin de les suivre. Considérer que ces lois se sont multipliées en réponse àdes cas spécifiques nuance la quantité des dommages, mais n’enlève en rien deleur gravité et de leur habitude. De plus, on peut imaginer la difficulté pourles populations de certaines provinces de suivre ces lois : certains pouvaient seservir dans les ruines impunément et d’autres pas. Les fortes sanctions indi-quent probablement des abus fréquents. D’où des punitions exemplaires pouréviter des effets d’entraînement : la ruine générait la ruine.
Pour la Capitale, l’avancée des dégâts s’amplifie durant tout le Ve siècle, ac-centuée sans doute par les sièges et pillages successifs, sans compter les effetsdes causes naturelles, de tremblements de terre, des inondations et de couver-tures qui n’étaient plus étanches 30. A joué aussi le recul définitif des forcespaïennes et, de ce fait, beaucoup de temples ont perdu toute utilité : la formeet la dimension de la plupart ne s’adaptaient pas en effet aux exigences du cul-te chrétien. Les bâtiments de spectacles, de moins en moins fréquentés, pei-nent à se maintenir, tandis que les grands thermes rentrent progressivementdans une décadence irrémédiable, faute notamment d’adduction d’eau etd’entretien des systèmes de chauffage. La nouvelle de Majorien, datée du!! juillet '%#, montre combien le processus engagé s’est accéléré à Rome, mal-gré toutes les mesures législatives :
Les empereurs Léon et Majorien, à Emilianus, préfet de la Ville : Dans Notre conduite de l’État, Nous voulons voir corriger ce fait, depuis long-
temps objet de Notre exécration, qu’on soit admis à altérer l’aspect d’une Ville véné-rable. Car il est manifeste en effet que les édifices publics, en lesquels consistait toute
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE &!
la parure de la cité de Rome, sont un peu partout détruits sur la punissable suggestiondes Bureaux de la Ville. Sous le fallacieux prétexte d’un besoin pressant de pierre detaille pour un ouvrage public, on met en pièce l’admirable structure des édifices an-tiques, et pour restaurer tel ou tel petit bâtiment on en détruit de grands. Il en résultedéjà l’occasion, pour le premier venu qui construit un édifice privé, et par la grâce desmagistrats en poste dans la Ville, de ne pas hésiter lui non plus à prélever sur les lo-caux publics les matériaux nécessaires, et à les transporter ailleurs, alors qu’ils appar-tiennent à la splendeur des villes et qu’on doit donc les préserver par sentiment ci-vique même en cas de réparation 31.
La pénalité est forte pour les contrevenants : %( livres d’or, le supplice dela bastonnade, voire plus drastique, l’amputation des mains « avec lesquellesils profanent les monuments des aïeux qu’il faut protéger ». La violence deschâtiments encourus est sans doute proportionnelle à l’impuissance et lacomplicité vraisemblable des autorités contraintes par la perte de leursmoyens financiers. La dégradation qui porte atteinte au décor urbain restedonc pen dant tout le IVe et le Ve siècle une préoccupation légitime de l’aris-tocratie et des empereurs 32.
Vivre au milieu des ruines : le décor des malheurs du temps
Un sentiment constant traverse la période : la ruine défigure le paysage etrend visible les difficultés contemporaines. On a bien sûr droit aux excès rhé-toriques 33. Mais porter atteinte au patrimoine bâti est vécu au IVe siècle com-me un recul de civilisation et de la tolérance. En )#&, dans un célèbre plai-doyer, son discours Pour les temples, Libanios envoie une supplique à l’empe-reur Théodose : il s’en prend aux moines, manipulés par le préfet du prétoireCynegius, qui mettent en pièces les temples dans les campagnes syriennes 34 :
Et cependant, ces hommes vêtus de noir [les moines] (...) au mépris de la loi quireste toujours en vigueur, courent vers les temples, portant des morceaux de bois, despierres et du fer ; quelques-uns même se contentent de leurs mains, de leurs pieds.Alors butin des Mysiens ! Les toits sont abattus, les murs sapés, les statues renversées,les autels détruits de fond en comble. (...) Lorsqu’un premier temple gît par terre, oncourt à un second, puis à un troisième et les trophées s’ajoutent aux trophées contrai-rement à la loi.
Ces exploits sont perpétrés même dans les villes, mais surtout dans les campagnes.(...) Ils s’avancent donc (...) comme des torrents et les ravagent par le fait même qu’ilsruinent les temples ; car toute la campagne dont ils ont détruit les temples est unecampagne dont ils ont arraché les yeux, qu’ils ont abattue, qu’ils ont tuée. En effet, ôempereur, les temples sont l’âme des campagnes. Ce sont les premiers édifices bâtisdans les champs et ils sont arrivés jusqu’à nous à travers bien des générations 35.
La propagande contre les formes les plus visibles du paganisme a dû peserbeaucoup dans la disparition de nombreux sanctuaires, rendus inutiles et quioccupaient par leur masse le cœur des villes, mais aussi des espaces bien envue dans les campagnes. Les édifices vont alors constituer de pratiques car-rières de bonnes pierres et de matériaux de construction, souvent directement
&* ÉRIC MORVILLEZ
sur place 36. C’est par exemple la réponse qu’auront les empereurs, Arcadius etHonorius pour faire face aux travaux publics urgents :
Puisque vous avez signalé qu’il faut fournir des subventions pour les ponts etchaussées sur lesquels s’effectuent de très fréquents trajets ainsi que pour les aqueducset, de surcroît, les remparts, Nous décidons que la totalité des matériaux qu’on Nousdit devoir provenir de la démolition des temples soit affectée aux besoins susdits, pourque tous ces ouvrages atteignent leur complet achèvement 37.
La ruine devient pourvoyeuse de matériaux. Et c’est le pragmatisme quil’emporte 38. Logiquement, on s’est focalisé sur les aspects encore visibles au-jourd’hui, en particulier les pierres et éléments sculptés remployés. Mais com-me l’a souligné Jean-François Bernard, c’est d’abord la récupération du métal,en particulier des crampons, qui a conduit bon nombre d’édifices antiques à ladécadence 39. Les signes de ces démantèlements sont encore visibles sur lesruines qui sont parvenues jusqu’à nous. Cependant, on possède encore peu defouilles ayant permis de suivre le processus de dépeçage des structures.L’exemple étudié par Jean-Marc Mignon en Vaucluse a permis d’en suivretoutes les étapes 40. La spoliation d’un imposant mausolée romain de Fourches-Vieilles, à Orange, a pu montrer qu’après un épisode d’inondation – sans dou-te postérieur au IIIe siècle – l’édifice avait été fragilisé. On était passé alors parune deuxième phase de pillage, celle du métal, puis une troisième, de la pierrede taille. Ensuite, après un basculement de l’édifice, vînt la récupération de cequi restait de maçonnerie et du mortier. L’estimation du volume de pierre degrand appareil travaillé extrait de la ruine est impressionnante : à raison deblocs de !,!# m de long sur &( cm de haut et ') cm d’épaisseur, sur au moinsneuf rangées, ce n’est pas moins de )(( m3 de pierre qui auraient été récupé-rés sur l’édifice. Dans ce débitage systématique, seules sont restées sur place,rejetées, certaines parties sculptées non utilisables. Il faut donc envisager la ré-cupération de la ruine comme un grand chantier de « recyclage » progressif dematière première, à moindre coût.
Après un IVe siècle pour lequel on avait pu chanter une renovatio temporum,une renaissance, le tournant du suivant prend très vite des accords drama-tiques. Le sac de Rome en '!( est resté dans les mémoires un signal très fort,même si les destructions des troupes d’Alaric restent limitées, puis celui duVandale Genséric en '%%, sans incendie ni massacre, mais où la ville est mise aupillage, et enfin celui de Ricimer en '$*. Si l’on répare les dégâts, les maisonsde l’aristocratie ont subi de graves dommages. La domus des Valerii, sur le Celius, sans doute l’une des plus splendides de Rome à l’époque, en donne unexcellent exemple. Leurs propriétaires, Mélanie et Pinien, voulaient s’en sépa-rer comme de tous leurs biens terrestres, pour se consacrer à leur foi :
Étant donné que personne parmi les sénateurs de Rome n’était en mesure d’acheterla maison au bienheureux Pinien, ils le font savoir à l’impératrice par de saintsévêques afin qu’elle l’achète. Mais elle, ne voulant pas le faire, de dire aux intermé-diaires : “moi, je ne crois pas pouvoir le faire à sa juste valeur”. Ils la prièrent alorsd’accepter au moins des marbres très précieux qui en venaient en souvenir des saints.
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE &)
(...) Quant à la maison, les bienheureux ne purent la vendre ; après le passage des bar-bares, c’était une maison brûlée, qu’ils cédèrent pour moins que rien 41.
On voit comment le décor intérieur – ici une collection de prestigieuses sta-tues ornementales – est transféré, appauvrissant du même coup la résidence.Mais celle-ci est tellement vaste et luxueuse qu’impossible à vendre 42. Après sadestruction par incendie, elle devient un simple xenodochium, tourné vers lacharité et peut-être l’accueil des pèlerins. Signe de sa monumentalité, on peutd’après Beat Brenk encore repérer la silhouette de ses ruines sur un plan deRome de Leonardo Bufalini, datant de !%%! 43.
Dans un autre secteur de l’Empire, la situation tragique de la Gaule au dé-but du Ve siècle fournit une série d’exemples de la multiplication des ruinesdans le paysage quotidien. Le poète Paulin, peut-être évêque de Béziers, faittémoigner Salmon, son personnage, des malheurs de la province depuis le dé-but du Ve siècle :
Il est vrai que, pour la première fois, le Barbare, violant le traité d’alliance jus-qu’alors intact, s’est jeté sur les champs et les fortunes des habitants et qu’il harcèle lescolons de ce pays. Elles ne servent plus maintenant à prolonger le temps de la vie, cesvillas construites toutes de marbre 44.
Dans un autre poème anonyme, Sur la providence, les dégâts sont encoreplus détaillés :
Plus de bétail et plus de semences ; plus un coin de terre pour les vignes et les oli-viers. La violence du feu s’est abattue sur les demeures des domaines et les a consu-mées ; celles qui restent debout sont encore plus tristes à voir dans leur abandon 45.
Plus loin, l’auteur continue sur un ton plus moral : Mais vous qui pleurez sur vos champs en friche, sur vos maisons désertes, sur vos
villas incendiées et leurs terrasses détruites, n’auriez-vous pas plutôt à verser deslarmes sur des pertes plus personnelles, si vous jetiez les yeux sur les dévastations quise sont produites au fond de votre cœur, sur les souillures qui en altèrent la beauté,sur les ennemis qui se sont installés dans la citadelle de votre âme captive 46.
Nous possédons un autre témoignage de la présence des ruines dans le pay-sage antique grâce à Rutilius Namatianus et à son poème sur son retour danssa patrie : le De reditu suo. Ce passage célèbre est d’ailleurs l’un des plus com-mentés pour la sensibilité des ruines 47. Aristocrate romain, il a occupé dehautes fonctions à Rome, dont celle de préfet du prétoire en '!', et en décrit lasplendeur bien vivante des édifices, dans toute la tradition de l’éloge.Contraint par les événements, il retourne en Gaule en '!$, après les invasionsqui ont dévasté sa patrie, à partir de '(& :
Mais ma fortune m’arrache à ces rivages aimés [d’Italie] et, enfant de la Gaule, lescampagnes gauloises me rappellent. Elles sont, certes, fort enlaidies par de longuesguerres, mais moins elles sont avenantes, plus elles sont à plaindre. (...) C’est sur placeque nous devons pleurer les maisons de nos aïeux ; utile est l’effort qu’a souvent éclai-ré la souffrance. Il n’est pas permis d’ignorer plus longtemps la longue série des
&' ÉRIC MORVILLEZ
ruines, multipliées par les délais et l’ajournement des secours. Il est bien temps, quandnos terres sont ravagées par l’incendie implacable, de rebâtir ne fût-ce que des ca-banes de berger 48.
C’est depuis le bateau qu’il décrit d’abord la côte de Toscane, évoquantdans le paysage qui défile les silhouettes des ruines de villes anciennes, cer-taines complètement abandonnées, d’autres bien rétractées 49.
Nous longeons la terre d’Alsium et laissons derrière nous Pyrgi, aujourd’hui gran -des maisons de campagne, petites villes autrefois (nunc villae grandes, oppida paruaprius). Bientôt le pilote nous montre le territoire de Caeré : le cours des âges a faitperdre son nom à la vieille Agylla. Puis nous serrons de près Castrum, ruiné 50 à la foispar les flots et le temps : une vieille porte signale la localité à moitié détruite 51.
(...) Puis nous apercevons Graviscae (Graviscarum fastigia rara) avec ses toits clair-semés, lieu qu’en été infecte souvent l’odeur des marais. Mais les alentours boisés ver-doient sous d’épaisses forêts et l’ombre des pins ondoie à la bordure des flots. Nousdistinguons d’antiques ruines que personne ne garde et les murailles délabrées de Cosa déserte 52.
La ruine, reflet de la décomposition intérieure des hommes
Dans le courant du IVe siècle, avec la christianisation, tout un discours surl’opposition entre monde temporel et monde éternel se met en place, avec :
une approche pessimiste de la temporalité. (...) S’il faut croire à l’action de la Provi-dence divine dans le temps et en la réalité de l’espérance, il faut reconnaître que cemonde temporel n’est qu’une “ vie de misère ”, de “vanité et d’illusions” 53.
Conséquences des vices et de l’absence de réforme des hommes, la dévastationet ses ruines omniprésentes sont le signe le plus visible de la colère divine. Dansson traité du Gouvernement de Dieu, Salvien écrit dans les années ''( que lesdéfaites et destructions répétées de la Gaule sont une réponse de Dieu aux pé-chés des fidèles. La Gaule, dont « les propriétaires et les maîtres de cette terresemblaient posséder moins une portion de ce sol que l’image du Paradis », estjonchée de ruines aussi grandes que le désordre des habitants. Les cités sont« ruinées et détruites ». Salvien prend l’exemple de Trèves et de sa région :
Les hommes de famille noble, de rang éminent, bien que déjà dépouillés et ruinés,furent moins dépouillés dans leurs biens que dans leurs mœurs ; car bien qu’ils aientdéjà subi les dévastations et le pillage, il leur restait quelque chose de leur terre, maisrien de leur principe de vie. L’ennemi était plus largement en eux-mêmes que dansl’ennemi extérieur : bien qu’ils eussent été ruinés déjà par les Barbares, ils étaientnéanmoins plus ruinés encore par eux-mêmes 54.
Sidoine Apollinaire écrivant à l’évêque Basilius d’Aix-en-Provence, au prin-temps '$%, cherche à l’alerter « de la maladie encore cachée de la communautécatholique » en dressant un portait alarmiste de la Gaule chrétienne décrépite.La disparition des évêques, guides des communautés, plonge les esprits dansle désespoir. La ruine intellectuelle et spirituelle a pour corrélation l’effondre-ment et la désaffectation des édifices de culte :
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE &%
Laissez moi promptement vous instruire de la maladie encore cachée de la commu-nauté catholique, pour que vous puissiez en toute hâte y appliquer ouvertement un re-mède. Bordeaux, Périgueux, Rodez, Limoges, Javols, Eauze, Bazas, Saint-Bertrand-de-Comminges, Auch – et ce sera bientôt le cas dans un nombre beaucoup plus grand en-core de cités – amputées par la mort de leur suprême pontife (...), toutes ces villes ontvu s’élargir le domaine des ruines spirituelles. Il est clair que, presque chaque jour, parla disparition des pontifes qui meurent, ces ruines font de tels progrès qu’elles au-raient pu émouvoir (sans parler des hérétiques du temps présent) même les héré-siarques des premiers temps : tant l’interruption des cérémonies religieuses plongedans un amer désespoir les populations privées de leurs évêques par la mort ! 55.
Il esquisse ensuite un tableau très explicite des ruines matérielles des basi-liques :
Dans les églises – chacun peut le constater – ou bien les toits délabrés se sontécroulés ou bien l’entrée des basiliques, dont les portes ont été arrachées de leursgonds, est obstruée par les fourrés de buissons épineux. On peut voir, ô douleur, lestroupeaux eux-mêmes non seulement couchés dans les entrées demi-ouvertes, maispaissant l’herbe qui verdit sur le côté des autels 56.
Cette image de la ruralisation des ruines, devenues agrestes, de mieux enmieux perçue et analysée par les archéologues 57, se retrouve par exemple pourRome de la grande surface du disabitato dans l’ancienne enceinte d’Aurélien 58.
On note que plusieurs leitmotive sont employés que l’on retrouvera chezd’autres auteurs. C’est d’abord les toitures, ouvertes, effondrées et sans entre-tien, mais aussi les huisseries arrachées (portes et fenêtres brisées), enfin lesautels profanés. C’est également l’indifférence aux enceintes sacrées : les trou-peaux, images symboliques des fidèles sans pasteur, ne respectent plus leslieux saints. La nature reprend ses droits : c’est le retour du sauvage, lecontraire de la civilisation. La ronce et ses épines, dont l’envahissement per-met de mesurer le temps et le degré d’abandon, regagnent du terrain 59. Et lesanimaux féroces ne tarderont pas à reconquérir ces territoires, comme on leverra plus loin avec les loups qui dévorent les hommes, sur celui des villas. Onest frappé de trouver déjà au détour de ces lignes des accents surprenants de« poésie des ruines » que n’aurait pas reniés le pré-romantisme !
Face à ces épreuves, seuls des actes de restauration offerts à Dieu, et donc laréparation de ses sanctuaires, peuvent ramener le pasteur et les fidèles versleur salut. Surmonter les ruines c’est donc en priorité les faire disparaître, soiten réparant les édifices, soit en construisant ex novo. La plupart des textes desVe et VIe siècles évoquant des constructions, prolongent le style emphatiquedes inscriptions des époques précédentes. Ils insistent sur la disparition desruines, qu’il s’agisse de sanctuaires édifiés pour les saints ou même deconstructions profanes. Restaurer c’est redonner aux bâtiments leur beautéinitiale. C’est aussi rétablir l’ordre et donc la confiance dans l’avenir et semontrer à la hauteur de la situation et de sa charge, temporelle ou spirituelle.Sidoine, alors évêque de Clermont, est invité à l’inauguration d’un baptistèrerural près de Rodez. Dans sa lettre datée de '$& ou '$$, il loue le propriétairedu domaine de dépenser dans des temps troubles : « C’est en effet de votre
&& ÉRIC MORVILLEZ
part un acte exemplaire que de construire de nouveaux bâtiments d’église enun temps où d’autres oseraient à peine réparer les anciens » 60.
Dans ce registre, Venance Fortunat est sans doute l’auteur le plus représen-tatif de ce discours sur la rénovation qui prend des allures symboliques.À propos des différentes constructions entreprises par l’évêque de BordeauxLéonce, il insiste sur les villas restaurées par ce dernier. C’est le cas du domai-ne de Besson :
Le bâtiment avait été abattu au sol par l’âge, entraîné par la décrépitude. La belleforme avait perdu son visage. Les soins de Léonce la remettent dans une voie meilleu-re. Grâce à son action tutélaire, aucune ruine ne menace la demeure. Maintenant, c’estun palais englouti qui ressuscite, plus éclatant et qui applaudit à celui qui lui a rendula vie. (...) Ici, à ce que l’on raconte, les habitants de ces lieux déserts fournirent unepâture aux loups. Léonce a introduit les hommes là d’où il a chassé les fauves 61.
Dans le poème suivant, il loue une autre propriété, la villa Vérégine : « Cet-te demeure doit sa rénovation aux soins du pape Léonce, qu’ainsi restaurée,elle espère avoir longtemps pour maître » 62. Fortunat célèbre également le tra-vail de restauration de Léonce sur les édifices de cultes ruinés ou endomma-gés. Ainsi de la basilique Saint-Eutrope à Saintes :
Combien vous devez être cher au Seigneur, ô Léonce ! Voici que les saints eux-mêmes vous invitent à relever leurs temples. La basilique du vénérable Eutrope s’étaitécroulée, vaincue par les ans. Ses murs troués laissaient voir à nu sa charpente ; ilsavaient cédé, non sous le poids de la toiture, mais sous l’effort des eaux du ciel. (...)Aujourd’hui, l’antique édifice, plus brillant que jamais, a retrouvé une seconde jeunes-se. Le voilà debout dans tout l’éclat du premier jour. Les années lui ont rendu sa pre-mière fraîcheur ; bien loin de le vieillir, elles l’ont rajeuni (...), les murs disparaissentsous les figures créées par les artistes ; hier, il n’y avait point de toit pour les abriter,aujourd’hui, ils sont couverts de peinture 63.
Sur le même ton, il fait l’éloge également de Nizier (Nicetius), évêque deTrèves : « Vous rendez à leur antique splendeur les temples de Dieu qui ontsouffert des atteintes du temps, et avec vos réparations, l’église la plus ancien-ne retrouve la jeunesse » 64. La ruine sert donc de support de réflexion morale,sur l’âme et la conscience de soi : elle est l’occasion de réfléchir sur la condi-tion humaine de pêcheur devant l’Éternel et de modifier son comportement.La reprise du cours des choses et le retour à la vie « normale » n’empêchera pasla corruption des âmes. Comme le souligne Gaëlle Viard, chez Fortunat, la res-tauration des monuments devient comme une allégorie de la foi chrétienne 65.
En conclusion, au terme de cette enquête, on peut faire plusieurs remarquessur le sens que prennent les ruines pour les populations de l’Antiquité tardive.Elles montrent d’un point de vue pratique la conscience de la fragilité des bâ-timents, des coûts d’entretien. Cependant, la position des autorités comme desparticuliers face aux ruines a été extrêmement variable d’une ville à l’autre,d’une province à l’autre. Mais comme l’explique Gesa Alföldi, en restaurant lacité et en continuant le plus longtemps possible à éviter la ruine, les fonction-
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE &$
naires romains ont eu le sentiment de faire leur devoir, dans le plus pur espritde la tradition 66. Mais on sent que malgré ces efforts, à partir du IVe siècle, lesruines s’inscrivent durablement dans le paysage des villes comme des cam-pagnes, pour ne plus les quitter pendant plusieurs siècles. Les sources cher-chent plutôt à en éviter la description et nous n’avons pas de passage évoquantclairement le processus de dégradation puis de « recyclage » des ruines.
Avec le Ve siècle, les surfaces et les volumes de ruines furent sans doute pro-gressivement impossible à absorber. Les ruines répétées par les vagues d’inva-sions, changent de statut et endossent une connotation éthique : elles assu-ment la fonction de topos littéraire sur les malheurs du temps. Se développeautour une réflexion morale sur la condition humaine, la culpabilité indivi-duelle et le rapport à Dieu, dans un monde entièrement christianisé.
Enfin, elles servent surtout de repoussoir, engendrant des sursauts face audécouragement ambiant, pour célébrer les restaurateurs. Mais la volonté derénovation se tourne désormais vers les bâtiments chrétiens, même si quelquesédifices privés sont associés. On s’achemine vers une vision plus optimiste dela ville à l’époque carolingienne : la restauration redonne sa place aux modèlesromains antiques où les spolia rentrent en bonne part 67. Mais la majorité desruines ne reste pas longtemps debout dans les paysages : elles sont squattéesou absorbées.
Alors qu’au Haut-Empire, la ruine informe, pourrie et non identifiable avaitété synonyme de l’oubli et de la décadence de la gloire, les ruines romaines quiont survécu à l’Antiquité tardive, par leur masse ou leur beauté stupéfiante,vont devenir progressivement, à partir du haut Moyen Âge, le symbole mêmede Rome, de sa civilisation et de son éternité (fig. !(). C’est le rôle que va en-dosser le Colisée avec la fameuse prophétie de Bède le Vénérable 68. La ruinequ’on s’était acharné à faire disparaître, va in extremis changer de statut et de-venir un symbole de pérennité. On commence à la respecter : ce sera le casemblématique de la colonne Trajane, protégée en !!&*, en devenant ainsi undes premiers patrimoines archéologiques de Rome 69.
NOTES
1 A. Carandini, « L’ultima civiltà sepolta o del massimo ogetto desueto secondo un archeologo »,dans A. Carandini, L. Cracco-Ruggini, A. Giardina (dir.), Storia di Roma, III, I luoghi e le culture, Turin, Einaudi, 1993, p. 11-38 ; D. Manacorda, « Roma. I monumenti cadono in rovina », dans ibid.,p. 93-104 ; P. Delogu, « Le passage de l’Antiquité au Moyen Âge », dans A. Vauchez (dir.), Rome auMoyen Âge, Paris, Riveneuve, 2010, p. 39-45 (trad. de Roma medievale, Rome, Laterza, 2006).
2 Sur les spolia, cf. la riche synthèse de J.-Fr. Bernard, Ph. Bernardi, D. Esposito (dir.), Il reimpiegoin architettura: recupero, trasformatione, uso, Rome, École française de Rome/Università degli studiLa Sapienza, coll. « BEFAR », n° 418, 2008 ; dans ce volume voir la communication de VladimirAgrigoroaei, p. 73-83.
3 Pour l’Afrique du Nord, voir les travaux de N. Duval, « Église et temple/église et thermes enAfrique du Nord », Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 7, 1971[1973], p. 277-290 ; I. Gui, N. Duval et J.-P. Caillet, Basiliques chrétiennes d’Afrique du Nord, I, In-ventaire de l’Algérie, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1992 (par exemple, petits thermes deMadaure, ou temple de Tipasa) ; J.-P. Caillet, « La transformation en église d’édifices publics et detemples à la fin de l’Antiquité », dans Cl. Lepelley (dir.), La fin de la cité antique et le début de la cité
&# ÉRIC MORVILLEZ
médiévale, de la fin du IIIe siècle à l’avènement de Charlemagne, actes du colloque (Paris X-Nanterre,1-3 avril 1993), Bari, Edipuglia, 1996, p. 191-211 ; sur l’Afrique, Cl. Lepelley, Les cités de l’Afrique ro-maine au Bas-Empire, t. I, La permanence d’une civilisation municipale, Paris, Institut d’Études Augus-tiniennes, 1979, p. 343-355. En Orient, J.-M. Spieser, « La christianisation des sanctuaires païens enGrèce », dans U. Jantzen (dir.), Neue Forschungen in griechischen Heiligtümern, Tübingen, E. Was-muth, 1976, p. 309-320 ; H. Hellenkemper, « Die Kirche im Tempel, Zeustempel und Paulusbasilikain Seleukia am Kalykadnos », dans Orbis Romanus Christanusque, travaux sur l’Antiquité tardive ras-semblés autour des recherches de N. Duval, Paris, De Boccard, 1995, p. 191-203 ; Ch. Goddard, « TheEvolution of Pagan Sanctuaries in Late Antiquity (Fourth-Sixth Centuries A. D.) : A New Adminis-trative and Legal Framework », dans M. Ghilardi, Ch. Goddard, P. Porena (dir.), Les cités de l’Italietardo-antique (IVe-VIe siècle) : institutions, économie, société, culture et religion, Rome, École françaisede Rome, coll. « BEFAR », n° 369, 2006, p. 281-308 (avec bibliographie p. 286, n. 44) ; cf. aussiS. A. Curini, « Uso dell’antico dal tardo impero al Medioevo. Alcuni esempli fra Oriente e Occiden-te », dans J.-Fr. Bernard, Ph. Bernardi, D. Esposito (dir.), op. cit. (note 2), p. 286-292.
4 Le rythme de transformation des ruines antiques a été progressif dans l’Antiquité tardive, mais ex-trêmement variable, entre le haut Moyen Âge et la Renaissance, cf. R. Krautheimer, Rome, portrait d’uneville 312-1308 (trad. par F. Monfrin), Paris, Librairie générale française, 1999, p. 99-102, particulière-ment 172-173 ; sur cette « obsession des vestiges à Rome à partir de la Renaissance qui de toutes partsassiègent [les Romains] », cf. A. Schnapp, La conquête du passé. Aux origines de l’archéologie, Paris, Li-brairie générale française, 1993 (2e éd.), p. 144-155. Voir aussi S. Forero Mendoza, Le temps des ruines.Le goût des ruines et les formes de la conscience historique à la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, 2002.
5 Y. Janvier, La législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics, Aix-en-Provence, Pressesuniversitaires de Provence, coll. « Annales de la Faculté des Lettres », 1969 ; E. J. Philips, « The Ro-man Law on the Demolition », Latomus, 32, 1973, p. 86-95 ; Cl. Lepelley, op. cit. (note 3), p. 61-67 ;voir aussi C. Kunderewicz, « La protection des monuments d’architecture antique dans le code Théo-dosien », dans Studi in onore de E. Volterra, 4, Milan, A. Giuffre, 1971, p. 137-153 ; A. Geyer, « Neruinis urbs deformetur..., Ästhetische Kriterien in der spätantiken Baugeseztung », Boreas, 16, 1993,p. 63-77 ; Plus récemment, A. Anguissola, « Note alla legislazione su spoglio e reimpiego di materialida costruzione ed arredi architettonici, I sec. a. C.-VI sec d. C. », dans W. Cupperi (dir.), Senso dellerovine e riuso dell’antico, Pise, Scuola normale superiore di Pisa, coll. « Annali della Scuola normalesuperiore di Pisa », 2002, p. 13-29 et P. Cattani, « La distruzione delle vestigia pagane nella legislazio-ne imperiale tra IV e V secolo », dans ibid., p. 31-44.
6 S. Azzarà, « Osservazioni sul senso delle rovine nella cultura antica », dans W. Cupperi (dir.), op.cit. (note 5), p. 1-12, avec bibliographie. Voir la synthèse d’Isabella Colpo, Ruinae... et putres roboretrunci. Paesaggi di rovine e rovine nell paesaggio nella pittura romana (I secolo a. C.-I secolo d. C.), Rome, Quasar, 2010, à propos de la peinture campanienne et ses réflexions sur Lucain et les ruines deTroie. Voir aussi sa communication dans ce volume, p. 45-53.
7 Ce sujet avait déjà fait l’objet d’une première approche dans ma thèse de doctorat (« Forme etévolution des salles de réception des grandes demeures tardives du Bassin méditerranéen occidental[IVe-VIe siècle »], soutenue en 1993 à l’Université Paris IV-Sorbonne sous la dir. de N. Duval). Je l’airepris ici et enrichi de nouveaux exemples dans le domaine des édifices religieux. Je remercie Karoli-na Kaderka de m’avoir permis d’ajouter cette contribution à ce volume, dédié à un sujet qui avait déjàsuscité mon intérêt. Je remercie aussi mes deux collègues Sabine Frommel et Philippe Plagnieux dem’avoir mis en relation avec elle. Je m’appuierai pour l’essentiel sur des exemples occidentaux, essen-tiellement italiens et gaulois, sans m’interdire des exemples africains ou des références à l’Orient oùles problématiques sur le sujet sont différentes, en raison de l’abandon parfois définitif de trèsgrandes cités, non réoccupées. Pour ne pas alourdir les notes, je renvoie à des livres et articles de syn-thèse, avec bibliographie antérieure, en ayant conscience d’avoir dû me limiter, compte tenu de la ma-tière très abondante.
8 Édifiés entre 298 et 306 : « (...) pro tantis operis magnitudine omni cultu perfectas Romanis suisdedicaverunt » (Corpus Inscriptionum Latinarum [CIL], VI, 1, Berlin, G. Reimer, 1876, 1130). Latranscription a d’ailleurs été conservée par le fameux Itinerarium de l’Anonyme d’Einsiedeln.
9 Quodv., Sermo II, de tempore barbarico, V, 4 : Quodvultdeus, Opera tributa, éd. par R. Braun,Turnhout, Brepols, coll. « CSSL », n° 60, 1976, p. 476-477.
10 Par exemple, Cod. Th., XV, 1, 25, Rome, 17 juillet 389 : « C’est une honte que la magnificencedu décor public (publici splendori ornatum) soit altérée par l’adjonction de maisons privées, et que cequ’on a élevé, tant à notre époque que dans un siècle antérieur, pour la parure d’une remarquable ville soit associé à l’amour du lucre », Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin àThéodose II (312-438), vol. II, Code théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions sirmondiennes, Paris, Éditions du Cerf, 2009.
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE &"
11 Cod. Th., XV, 1, 1, de Constance II à Flavianus, proconsul d’Afrique, 357 : d’après Y. Janvier,op. cit. (note 5), p. 117.
12 Cod. Th., XV, 1, 15, Milan, le 16 février 365 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 147.13 CIL, VI, 1703 (trad. par A. Chastagnol). 14 CIL, VI, 1750.15 Cf. G. Poccardi, « Les bains de la ville d’Ostie à l’époque tardo-antique (fin du IIIe-début du VIe
siècle) », dans M. Ghilardi, Ch. Goddard, P. Porena (dir.), op. cit. (note 3), p. 167-186, en particulierp. 185 : « l’étude des monuments de la ville, et en particulier des bains, montre que l’on ne peut par-ler pour l’époque tardive d’une période homogène. Notre documentation épigraphique, peu impor-tante soit-elle, montre clairement que l’activité des édifices de bains s’est maintenue à Ostie pendanttout le IVe siècle, mais que celle-ci a fortement décliné au Ve siècle, avec peut-être une timide repriseau début du VIe siècle. En effet la dernière attestation de travaux de restauration d’un complexe bal-néaire (thermes de la Marciana) est datée du règne ostrogothique de Théodoric (493-526). Or, il s’agità l’exception d’églises signalées par le Liber Pontificalis... de la dernière attestation d’une restaurationd’un monument public “classique” à Ostie ».
16 V. Malineau, « Le théâtre dans les cités de l’Italie tardo-antique », dans M. Ghilardi, Ch. Goddard,P. Porena (dir.), op. cit. (note 3), p. 197-203, en particulier 199 : « Au Ve siècle, nous ne connaissonsplus de cas de restaurations de théâtres en dehors de Rome et peut-être Catane – dont la fonction ludique n’est plus démontrable – et les jeux scéniques ne sont plus attestés qu’à Rome, Ravenne etpeut-être Aquilée où Procope les associe au cirque. Dans la continuité du phénomène amorcé auIVe siècle, de nombreux édifices furent abandonnés, envahis de structures parasites (principalementdes tombes et des structures domestiques) et utilisés comme carrière de pierre ».
17 Sur les inscriptions du Colisée, cf. A. Chastagnol, Le Sénat romain sous le règne d’Odoacre : re-cherche sur l’épigraphie du Colisée au Ve siècle, Bonn, R. Habelt, 1966 ; plus récemment, S. Orlandi,« Il Colosseo nel V secolo », dans W. V. Harris (dir.), The Transformation of Urbs Roma in Late Anti-quity, Portsmouth RI, Journal of Roman Archaeology, 1999, p. 249-263.
18 D’après ses lettres Symmaque possède trois domus à Rome, trois villas suburbaines et une dou-zaine de domaines cités dans sa correspondance. La Campanie reste sa destination favorite. Sur cetaspect : D. Vera, « Simmaco e le sue proprietà: struttura e funzionamento di un patrimonio aristocra-tico del quarto secolo », dans G. W. Bowersock, F. Paschoud, G. Fry et al. (dir.), Colloque genevoissur Symmaque (Genève, 4-7 juin 1984), Paris, Les Belles Lettres, 1986, p. 231-276, notes 234-235.
19 Symm., Ep., I, X, datée de 375 : « Hanccine mihi esse fortunam ut quoquo modo uersum pedemgradumque contulero, exaedificandum aliquid offeratur !Velut me nunc Capuani praetorii instauratioin graues cogit expansas, cuius pars fatiscit incuria, pars neglegenti dudum celeritate reparata inbecil-lum praestat habitaculum. His nisi properata cura subvenerit, aut penuciae postea dispendium cumu-labitur aut ruinae. Nam quisquis haec opera intermittit, amittit. Quare animus est amolari aedium se-nectutem. Ita desiderato et expetito otio ad negotium concessimus sumptuosum », Symmaque,Lettres, t. I, l. I-II, texte établ. et trad. par J.-P. Callu, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 1972.
20 La question des propriétés est au cœur des conversations mondaines depuis le Haut-Empirecomme le suggère un passage d’Horace (Sat., II, 6, 70-72) à propos d’un dîner entre amis, loin del’étiquette : « Donc, la conversation s’engage ; on ne s’y occupe pas des villas et des maisons d’autrui(de villis domibusve alienis), ni de savoir si Lepos danse bien ou mal (...) », Horace, Satires, texte établ. et trad. par F. Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 1969 (8e éd. revue etcorrigée).
21 Symm., Ep., II, LX, datée d’avant 395. 22 La comparaison avec les fastes du « Xerxès en toge » se retrouve dans d’autres passages de
Symmaque (Ep., VI, 70, et VII, 36) : Symmaque, Lettres, t. II, l. III-V, texte établ. et trad. par J.-P.Callu, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 2003 ; d’ailleurs, c’est dans la villa de Naples de Lucul-lus – recouverte par l’actuel Castel dell’Ovo – que le dernier empereur romain d’Occident, RomulusAugustule, fut assigné à résidence.
23 Outre le démontage systématique, on a du mal à se représenter par exemple les plaies et lesécroulements qui furent la conséquence des prélèvements effectués par Constantin pour son arc detriomphe à Rome, sur le forum de Trajan.
24 Cod. Th., XV, 1, 19, lu au Sénat le 1er janvier 376 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 179.25 Cod. Th., XV, 1, 20, Thessalonique, le 20 mars 380 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 181.
Cf. aussi Cod. Th., XV, 1, 21. 26 Cod. Th., XV, 1, 14, fait à Milan, le 1er janvier 365 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 143. 27 Cod. Th., IX, 17, 5 (loi du 12 février 363) : « sed et onamenta quidam tricliniis aut porticibus
auferunt de sepulchris ».28 Cod. Th., IX, 17, 4 (loi du 13 juin 357), cf. aussi Libanios, Or., XVIII, 126 : Libanii opera,
$( ÉRIC MORVILLEZ
vol. II, Orationes XII-XXV, éd. par R. Förster, Leipzig, Teubner, 1904, qui rappelle qu’avant le tempsde Julien, déjà des particuliers arrachaient aux temples des ornements ou des colonnes.
29 Cod. Th., XV, 1, 40 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 237.30 Sur ce sujet, voir par exemple l’évolution du paysage urbain du quartier de la Crypta Balbi à
Rome et l’implantation des fours à chaux : D. Manacorda, Crypta Balbi, archeologia e storia di unpaesaggio urbano, Milan, Electa, 2001, p. 44-54, fig. 54, 56-57. Sur les inondations, tremblements deterre et l’évolution à partir du haut Moyen Âge, p. 55-56, fig. 55.
31 Novel.-Major., IV, De aedificiis publicis : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 291. 32 Cf. Symm., Rel., 21, avant le 11 décembre 384 à Valentinien : « si, à l’occasion de l’enquête justi-
fiée par laquelle Vous m’ordonniez de rechercher la trace des ornements dont les édifices avaient étédépouillés (cultum spoliatorum moenium) », Symmaque, Discours, rapports, texte établ. et trad. parJ. Callu, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 2009. Prétextat, préfet de la ville, avait fait suppri-mer des édifices abusivement accolés à des temples (aedes sacra) – Amm., XVII, 9-10 : Ammien Mar-cellin, Histoires, texte établ. et trad. par G. Sabbah, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 2002. Surdes statues récupérées par Prétextat cf. Symm., Ep., I, 46.
33 Sur l’image de la crise de la ville, cf. G. P. Brogiolo, « Ideas of the Town in Italy during the Tran-sition Period », dans G. P. Brogiolo, B. Ward-Perkins (dir.), The Idea and Ideal of the Town betweenLate Antiquity and the Early Middle Ages, Leyde/Boston/Cologne, Brill, 1999, p. 101-105.
34 P. Chuvin, Chronique des derniers païens, Paris, Les Belles Lettres, 2009 (3e éd.), p. 80-81 ;M. Siebeck, Für Religionsfreiheit, Recht und Toleranz: Libanios’ Rede für den Erhalt der heidnischenTempel, Tubingue, Mohr Siebeck, 2011.
35 Traduction de R. Van Roy, « Le Pro Templis de Libanius », Byzantion, 8, 1933, p. 7-39.36 Sur ce rôle déterminant de la propagande anti-païenne cf. P. Cattani, art. cit. (note 5), p. 32-36.37 Cod. Th., XV, 1, 36, 1er novembre 397 : d’après Y. Janvier, op. cit. (note 5), p. 231. 38 Sur ce pragmatisme, cf. B. Ward-Perkins, « Re-using: The Architectural Legacy of the Past, entre
idéologie et pragmatisme », dans G. P. Brogiolo, B. Ward-Perkins (dir.), op. cit. (note 33), p. 226-244.Sur les remplois de blocs récupérés pour les constructions d’enceintes, N. Gauthier, « La topographiechrétienne entre idéologie et pragmatisme », dans ibid., p. 195-210, qui rappelle, en p. 196, que « (...)les constructeurs des remparts ont empilé dans les fondations des blocs sculptés arrachés aux édificespublics anciens, thermes, édifices de spectacles et même temples, ce qui témoigne à leur égard d’unecurieuse indifférence ».
39 « la présence de métal dans les constructions a causé directement ou indirectement la destruc-tion de bien des monuments. Certains ont été démontés, d’autres débarrassés de leur couverture, ontvu leur fin s’accélérer, un plus grand nombre, privés de scellement métalliques, criblés de cavités danslesquelles la végétation prenait racines, furent suffisamment fragilisés pour s’écrouler d’eux-mêmesou sous le coup de phénomènes naturels, tremblements de terre et inondations qui offraient ainsi uneprécieuse contribution au commerce du remploi » (dans J.-Fr. Bernard, Ph. Bernardi, D. Esposito[dir.], op. cit. [note 2], p. 46).
40 J.-M. Mignon, « Destruction et pillage des mausolées antiques de Fourches-Vieilles à Orange(Vaucluse) », dans J.-Fr. Bernard, Ph. Bernardi, D. Esposito (dir.), op. cit. (note 2), p. 273-283.
41 Vie de sainte Mélanie, trad. par D. Gorce, Paris, Éditions du Cerf, 1962.42 Sur la maison, cf. notice de F. Guidobaldi, « Edilizia abitativa unofamiliare nella roma tardoanti-
ca », dans A. Giardina (dir.), Roma, politica, economica, paesaggio urbano, Sociétà romane impero tar-doantico, Rome, Laterza, 1986, p. 186-188 ; B. Brenk, « La cristianizzazione della domus dei Valeriisul Celio », dans W. V. Harris (dir.), op. cit. (note 7), p. 69-73, not. plan. fig. 4 p. 71.
43 B. Brenk, art. cit. (note 42), fig. 6, p. 74. 44 Paul., Épigr., v. 8-9 : d’après A. Chastagnol, La fin du monde antique, de Stilicon à Justinien : Ve
siècle et début VIe : recueil de textes, Paris, Nouvelles éditions latines, 1996.45 Carmen de Providentia, attribué à Prosper d’Aquitaine ; traduction reprise d’E. Griffe, La Gaule
chrétienne à l’époque romaine, II, L’Église des Gaules au Ve siècle, 1, L’Église et les Barbares. L’organi-sation ecclésiastique et la hiérarchie, Paris, Picard, 1957. La version latine est conservée dans J.-P. Mi -gne, Patrologia Latina, vol. LI, Paris, [s. n.], 1861.
46 Ibid., v. 908-909.47 Il est l’auteur latin le plus utilisé avec Lucain pour l’étude de la naissance du « sentiment des
ruines » (cf. les travaux d’I. Colpo cités supra) ; R. Mortier, La poétique des ruines en France, ses ori-gines, ses variations, de la Renaissance à Victor Hugo, Genève, Droz, 1974, p. 16-17.
48 Rutil., I, v. 19-34 : Rutilius Namatianus, Sur son retour, texte établ. et trad. par É. Wolff, Paris,Les Belles Lettres, coll. « CUF », 2007.
49 Déjà Ambroise de Milan utilise dans une célèbre lettre de consolation à son ami Faustinus lesymbole de villes en partie détruites : « tot igitur semirutarum urbium cadavera », Sancti Ambosii
ABANDONNER OU RESTAURER : LA PEUR DES RUINES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE $!
Opera, pars X, éd. par O. Faller, Vienne, Hoelder-Pichler-Tempsky, 1968, cf. G. P. Brogiolo, art. cit.(note 33), p. 101-102.
50 [hinc afflictum] : le passage du texte est ici corrompu, mais le sens est sûr. 51 Rutil., I, v. 223-228.52 « cernimus antiquas nullo custode ruinas / et desolatae moenia foeda Cosae », ibid., v. 281-286.53 S. Forero Mendoza, op. cit. (note 4), p. 27-28, sur ce qu’elle appelle « l’économie providentiel-
le ». Sur le sens de l’histoire de Rome pour les Chrétiens, cf. H. Inglebert, Les Romains chrétiens faceà l’histoire de Rome. Histoire, christianisme et romanité en Occident dans l’Antiquité tardive (IIIe-Ve s.),Paris, Institut d’Études Augustiniennes, coll. « Études Augustiniennes », n° 145, 1996 ; Fr. Lecocq,« Rome, de la ruine de Troie à la ruine de soi », dans S. Fabrizio Costa (dir.), Entre trace(s) etsigne(s) : quelques approches herméneutiques de la ruine, Berne/Berlin/Bruxelles, Peter Lang, 2005,p. 69-104. Comme elle le souligne, dès la fin du IVe siècle pointe le pressentiment de la ruine univer-selle de l’Empire, comme chez Jérôme (Ép., LX, 16-18) : « C’est avec horreur que mon esprit pour-suit le tableau des ruines de notre époque. (...) L’univers romain s’écroule (...) O ! si nous pouvonsmonter sur un observatoire assez élevé pour que de cet endroit nous voyons, dans sa totalité la terres’étalant sous nos pieds ! Alors, je te montrerais les ruines du monde entier, les nations s’entrecho-quant avec les nations », Saint Jérôme, Lettre LX, 16-18, t. III, texte établ. et trad. par J. Labourt, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 1953. Sur la perpétuation du thème, A. Schnapp, « Lesentiment des ruines, de l’Orient ancien aux Lumières : continuités et transformations », dansPh. Boissinot (dir.), L’archéologie comme discipline, Paris, Seuil, 2011, p. 171-198.
54 Salv., Gub, VI, 8, 39-40 : d’après G. Larrigue, Sources chrétiennes, Paris, Éditions du Cerf, 1975.55 Sidon., Ep., VI, 6 : Sidoine Apollinaire, Lettre VI, t. III, trad. par A. Loyen, Paris, Les Belles
Lettres, coll. « CUF », 1970.56 Ibid. 57 Pour une belle illustration de ce phénomène, voir l’évolution du paysage dans les vues cavalières
du quartier du théâtre de Balbus, entre l’Antiquité tardive et le Moyen Âge, dans D. Manacorda, op.cit. (note 30), p. 47, 71, 74. C’est cette image d’une campagne qui rentre dans la ville qui va s’imposer,comme par exemple dans le cas d’Aquilée (dévastée par Attila en 452), décrite dans un poème médié-val : « Toi qui était jadis cité d’hommes nobles, te voilà hélas, devenu le repaire d’hommes agrestes :tu étais ville de rois, tu n’es plus que la cabane des pauvres / Toi jadis pleine de maisons élevées, or-nées de marbres merveilleusement blancs, tu produis aujourd’hui des fruits et tu es mesurée au cor-deau des paysans » (F. Mortier, op. cit. [note 47], p. 26).
58 « Le contraste entre ce qu’on appelle au XVIe siècle l’abitato et le disabitato était désormais nette-ment marqué à partir du Ve siècle et il n’a fait que s’accentuer pour subsister jusqu’au XIXe siècle : do-rénavant, il y a un petit noyau de fort peuplement, qui est environné d’une vaste étendue comprenantdes vignes, des champs et des ruines, parsemée de petits îlots de peuplement et de quelques fermes »(R. Krautheimer, op. cit. [note 4], p. 177) ; de ce mélange de vestiges et de végétation naîtra le thèmede la ruine dans le paysage en peinture, cf. N. Dacos, Roma quanta fuit, Tre pittori fiamminghi nellaDomus Aurea, Rome, Donzelli, 1995 ; sur Pétrarque, F. Mortier, op. cit. (note 47), p. 27-32 et S. ForeroMendoza, op. cit. (note 4), p. 39-47 ; sur le sentiment des ruines chez du Bellay, cf. F. Mortier, op. cit.(note 47), p. 62-68 et A. Vauchez, A. Giardina (dir.), Rome, l’idée et le mythe. Du Moyen Âge à nosjours, Rome, Fayard, 2000, p. 60-61.
59 Sur l’envahissement par les ronces, thème récurrent, on comparera aux termes employés parQuodvultdeus, à la même période, pour décrire l’abandon du grand temple de Caelestis à Carthage,fermé en 399, que les Chrétiens veulent récupérer en 407-408 et qui finit par être rasé sur l’ordred’Ursus en 421 (Quodv., III, 38 [44]) : « il était fermé depuis assez longtemps et envahi en cet aban-don par une haie de broussailles épineuses quand le peuple chrétien voulu l’affecter au service de lavraie religion ; mais le peuple païen vociférait que là-dedans se trouvaient des dragons et des serpentschargés de protéger le temple : ce qui ne fit qu’enflammer le zèle des chrétiens : ils débroussaillèrentsans subir le moindre mal (...) », Quodvultdeus, Livre des promesses et des prédictions de Dieu, texteétabl. et trad. par R. Braun, Paris, Éditions du Cerf, 1964.
60 Sidon., Ep., IV, 15, 1 (trad. A. Loyen, op. cit. [note 55]).61 Fort., Carm., I, 18, 9-14 : Venance Fortunat, Poèmes, t. I, l. I-IV, texte établ. et trad. par M. Rey-
dellet, Paris, Les Belles Lettres, coll. « CUF », 1994.62 Ibid., I, 19, 15-16.63 Fort., Opera omnia miscellanea, trad. par Ch. Nisard, Paris, Firmin-Didot, 1887. Sur d’autres
restaurations d’édifices de culte, cf. Poèmes, I, VII, 8 ; I, X, 10-12 (trad. A. Loyen, op. cit. [note 55]).64 Fort., Carm., III, 11.65 Sur les descriptions d’édifices, voir les différents travaux de G. Viard, en particulier « Venance
Fortunat et la représentation littéraire du décor des villas après Sidoine Apollinaire », dans
$* ÉRIC MORVILLEZ
C. Balmelle, H. Eristov, F. Monier (dir.), Décor et architecture en Gaule entre l’Antiquité et le hautMoyen Âge : mosaïque, peinture, stuc, actes du colloque international (Toulouse, Université ToulouseII-le Mirail, 9-12 octobre 2008), Bordeaux, Éditions de la Fédération Aquitania, 2011, p. 391-401 ;ead., « Venance Fortunat et l’esthétique de l’ekphrasis dans les Carmina : l’exemple de la villa deLéonce à Bordeaux », Revue des Études Latines, 88, 2010 [2011], p. 218-237.
66 G. Alföldi, « Difficillima tempora: Urban Life, Inscriptions and Mentality in Late Antiquity »,dans Th. S. Burns, J. W. Eadie (dir.), Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity, East Lan-sing, Michigan State University Press, 2001, p. 3-24, en particulier p. 13 : « The inscriptions revealthe idea mentioned before in a very clear manner. Everything done by senatorial magistrates execu-ting their tasks did seem to be well done. Reading their inscriptions, the people should be convincedthat these men would resolve all problems and difficulties of urban life ; that they would always beable to defend and to renew the traditional order of Rome ; that their activities would convert every-thing, to use the language of the epigraphic documents, in pristinam faciem splendoremque ».
67 P. Riché, « La représentation de la ville dans les textes littéraires du Ve au IXe siècle », dansCl. Lepelley (dir.), op. cit. (note 4), p. 181-190.
68 Bède le Vénérable, Collectanea, I, 3 : « Quandiu Stat Colisaeus, stat et Roma ; et quando caedetColisaeus, cadet et Roma ; quando cadet Roma, cadet et mundus », J. P. Migne, op. cit. (note 45),p. 94, 543.
69 J.-Cl. Maire Vigueur, L’autre Rome, une histoire des Romains à l’époque communale (XIIe-XIVe s.),Paris, Tallandier, 2010, p. 460-461. Rappelons aussi que la colonne avait eu, parmi ses fonctions, cellede rendre lisible dans le paysage urbain l’abaissement de la colline, lors des gigantesques travaux duforum de Trajan.
Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation de l’éditeur.
Nessuna parte di questo libropuò essere riprodotta o trasmessain qualsiasi forma o con qualsiasimezzo elettronico, meccanicoo altro senza l’autorizzazionescritta dei proprietari dei dirittie dell’editore.
Progetto grafico di Gianni Trozzi
© copyright !"#$ byCampisano Editore Srl""#%% Roma, viale Battista Bardanzellu, %$Tel +$& "' ("'''#( - Fax +$& "' ("'$!%#[email protected] &)*-**-&*!!&-#!-$
En couverture :Giovanni Paolo Panini (#'&#-#)'%) et atelier, RomanRuins and Figures, huile sur toile, #!#,% ! #(!,% cm, Cultra - Holywood, Ulster Museum, n° cat.BELUM.U##) © National Museums Northern Ireland
Actes de la journée d’études de l’équipe d’accueil Histara, Paris, Institut national d’histoire de l’art, #( octobre !"##
École Pratique des Hautes Études
HAUTES ETUDEShistoire de l’art/storia dell’arte
comité scientifiqueSabine FrommelFrançois QueyrelJean-Michel Leniaud
Ouvrage publié avec le concours de l’École pratique des hautes études, équipe d’accueil Histara (EA (##%)
!". Matthijs Bril, Le temple de Minerve au forum de Nerva, entre !#$! et !#$%, plume et encre brune sur papier, musée du Louvre, Paris, Cabinet des dessins (d’après S. Forero Mendoza, Le Temps des ruines. Le goût des ruines et les formes de la conscience historique à la Renaissance, Seyssel, Champ Vallon, &""&, p. !!', fig. %")