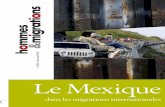Le rôle de facilitateur d’un syndicat professionnel dans un réseau interorganisationnel innovant...
Transcript of Le rôle de facilitateur d’un syndicat professionnel dans un réseau interorganisationnel innovant...
UNIVERSITE de CAEN BASSE-NORMANDIE
INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
ECOLE DOCTORALE ECONOMIE GESTION NORMANDIE
Mémoire de recherche
présenté le 17 juin 2015 par
Melle LAMBERT Charlène
Sous la direction du Professeur Tellier
en vue de l'obtention du Master recherche et conseil
Spécialité : Sciences de Gestion
Le rôle de facilitateur d’un syndicat professionnel dans un réseau inter-
organisationnel innovant artisanal : le cas de l’UNEP dans la filière
paysage.
Membres du jury : Professeur LOILIER Thomas
Professeur TELLIER Albéric
"
"
L’innovation dans nos métiers est extrêmement maigre, surtout qu’on a
une tendance à se sous-estimer en disant : « Mais qu’est-ce qu’on va
innover dans nos métiers ? Il n’y a rien à innover, l’innovation c’est la
haute technologie, le high-tech »… Mais l’innovation, c’est pour tout le
monde !
Philippe Feugère1, vice-président du bureau de l’UNEP délégué à
l’innovation, et président fondateur de l’entreprise de paysage Plaine
Environnement.
1 Idées exprimées à l’occasion du débat : « L’innovation, l’avenir de la filière paysage ? » du 24 avril 2015, au forum ITIAPE (Lille).
REMERCIEMENTS
Cette année de Master recherche et conseil est une année charnière dans mon parcours
professionnel et se traduit aujourd’hui par ce mémoire de recherche qui concrétise la
rencontre de deux mondes distincts : celui du paysage et celui des sciences de gestion. Loin
d’être contraires, ces différentes facettes se nourrissent mutuellement au sein de ce mémoire
de recherche.
Tout d’abord, je souhaiterais remercier le Professeur Joffre et le Professeur Damart pour
m’avoir permis d’intégrer le Master recherche et conseil, et de réaliser aujourd’hui cette
connexion entre ces domaines que rien ne rapprochait jusqu’alors.
Je remercie tout particulièrement le Professeur Tellier, mon directeur de mémoire, pour ses
conseils bienveillants et constructifs, mais également pour sa disponibilité et sa réactivité qui
m’ont permis de mener à bien ce mémoire de recherche dans les délais impartis.
Mes remerciements se tournent également vers Jean-François Quesson pour son immense
soutien au cours de l’année : j’ai vraiment apprécié travailler et partager avec lui, et j’espère
que les occasions de travailler ensemble se renouvelleront dans le cadre de mes recherches.
Je remercie Bénédicte de Gorostarzu et Stéfanie Nave pour m’avoir ouvert les portes de
l’UNEP, et avoir partagé avec moi de nombreuses sources d’informations précieuses pour ma
recherche. J’espère que mes travaux seront à la hauteur de ce qu’attend la profession et que
nous pourrons poursuivre ce travail ensemble, dans le cadre d’un contrat CIFRE.
Je remercie l’ensemble de mes répondants ayant eu la gentillesse de m’accorder leur temps
que je sais précieux, dans les entreprises et à Plante et Cité. Je remercie Philippe Feugère pour
m’avoir fait confiance et m’avoir permis de réaliser une étude de cas sur son innovation.
Enfin, je ne peux achever ces remerciements sans exprimer ma gratitude envers mes proches.
Mes parents et mes grands-parents, qui m’ont toujours soutenu, et dont la fierté m’a toujours
donné la force d’aller plus loin. Mes amis, Matthieu, Bérénice, Jean-Baptiste, Sophie et
Kenza, qui m’apportent leur joie de vivre et l’énergie qui me ressourcent. Mon compagnon,
Anthony, qui m’a donné le goût de la recherche (et des nuits courtes), et pour son indéfectible
soutien affectif.
SOMMAIRE
Introduction _______________________________________________________________ 1
I. Revue de la littérature ___________________________________________________ 3
1) Hétérogénéité et complémentarité de la structure des RIOI _____________________ 4
2) Un fonctionnement appelant à la coopération et une gouvernance _______________ 10
3) Question de recherche _________________________________________________ 19
II. Méthodologie de la recherche ____________________________________________ 20
1) Méthodologie générale et posture épistémologique __________________________ 20
2) Méthode d’exploration ________________________________________________ 25
3) Méthode de l’étude de cas ______________________________________________ 31
III. Résultats _____________________________________________________________ 35
1) Entretiens exploratoires ________________________________________________ 35
2) Etude de cas De Natura ________________________________________________ 43
IV. Discussion __________________________________________________________ 60
1) Portée de résultats ____________________________________________________ 60
2) Contributions, limites et voies de recherche ________________________________ 60
Conclusion _______________________________________________________________ 66
Bibliographie ______________________________________________________________ I
Table des figures et des tableaux _____________________________________________ VII
Annexes ________________________________________________________________ VIII
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
1
INTRODUCTION
D’après la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’artisanat occupe une place importante
dans l’économie française : en 2013, il a généré près de 15% du PIB du pays et a fait travailler
plus de 3 millions d’actifs. Les entreprises artisanales sont nombreuses, de petites tailles et
implantées sur tout le territoire, y compris en milieu rural. Alors que certains métiers de
l’artisanat sont à la pointe de l’innovation (micro-électronique, génie climatique…), d’autres
métiers sont plus traditionnels (boucherie, maçonnerie…). Les caractéristiques des entreprises
artisanales traditionnelles, petites et ancrées culturellement et historiquement, ne sont pas
toujours favorables à l’émergence d’approches innovantes, alors même que les contextes
économique, règlementaire, environnemental, social, …, imposent des mutations.
La filière paysage est une filière agricole traditionnelle composée par une majorité
d’artisans et par de nombreuses entreprises familiales, mais son questionnement récent sur
une stratégie d’innovation collective en fait un terrain d’étude remarquable. En effet, depuis
2013, et sous l’impulsion d’un de ses syndicats professionnels (Union Nationale des
Entreprises de Paysage), les entreprises de paysage, les écoles et les centres de recherche
cherchent à travailler ensemble au sein de réseaux d’innovation. Un premier exemple de ces
réseaux d’innovation a permis de mener à bien un processus d’innovation complet en 2014 :
De Natura, premier fond de dotation dans le monde du paysage.
Nous proposons en premier lieu une synthèse de la littérature relative au Réseaux Inter-
Organisationnels Innovants (RIOI). Nous présenterons ensuite notre méthodologie de
recherche. Après une analyse globale de la perception de l’innovation par notre terrain de
recherche, l’étude du cas De Natura mettra en lumière la façon dont s’est structuré et a
fonctionné un RIOI au sein d’un secteur artisanal traditionnel.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
2
Figure 1: Design de la recherche
4. Discussion
3. Résultats
L'innovation dans la filière paysage L'innovation De Natura
2. Méthodologie de la recherche
Entretiens exploratoires Etude de cas
1. Revue de la littérature
Les Réseaux Inter-Organisationnels Innovants
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
3
I. REVUE DE LA LITTERATURE
Pour Alter (2010a), l’innovation est l’aboutissement d’une démarche qui commence par une
invention, c’est-à-dire une idée créative, et se termine par l’assimilation sociale de la
nouveauté. Nous optons pour une approche globale de la notion d’innovation qui englobe tous
les types d’innovation (marchand, processuel, social…), et ce, dès lors qu’un degré de
nouveauté est perçu dans l’organisation, ou à l’extérieur par le marché-cible de l’innovation.
Le développement d’un projet d’innovation nécessite des ressources et des compétences qui
sont rarement détenues intégralement par des organisations de petite taille (Gardet & Mothe,
2010). Ainsi, les organisations désirant innover doivent constituer des réseaux avec d’autres
organisations pour acquérir les compétences difficiles à développer en interne et minimiser les
coûts de R&D en partageant les actifs nécessaires (Gardet & Mothe, 2010). Ces réseaux inter-
organisationnels innovants sont définis comme des « ensembles coordonnés
d’acteurs hétérogènes (laboratoires privés ou publics, entreprises, clients, fournisseurs,
organismes financiers...), qui participent activement et collectivement à la conception, à
l’élaboration, à la fabrication et à la diffusion d’une innovation » (Maillat, 1996, p. 84).
Notre revue de littérature s’attachera au concept de réseau inter-organisationnel innovant par
une approche structurelle (1.) qui identifiera les composantes requises à l’existence de ces
réseaux, compétences (a.) et ressources (b.) ; suivie d’une approche fonctionnelle (2.), qui se
concentrera sur la coopération des acteurs (a.) et la gouvernance du réseau (b.).
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
4
1) HETEROGENEITE ET COMPLEMENTARITE DE LA STRUCTURE DES RIOI
Nous décrirons la structure de ces réseaux d’innovation sous l’angle des deux composantes
qui justifient leur existence. En effet, le réseau permet de mobiliser un ensemble de
compétences détenues par différents types d’organisations (a), et de partager un ensemble
d’actifs complémentaires (b).
a) HETEROGENEITE DES ORGANISATIONS ET DE LEURS
COMPETENCES
Le réseau inter-organisationnel se compose de différentes organisations apportant des
compétences différentes au sein du réseau auquel elles appartiennent. Parmi ces compétences,
il est possible de distinguer des « compétences métier », des « ressources managériales » et
des « facilitateurs institutionnels » (Laban, et al., 1995). Les travaux de Bernasconi, Dibiaggio
et Ferrary (2004) sur la Silicon Valley, identifient différentes fonctions des acteurs d’un
réseau inter-organisationnel : les expertises pédagogique, de recherche et technologique qui se
rattachent aux « compétences métier » des travaux de Laban et al. (1995) ; les compétences
comptable, juridique, de médiatisation et de gestion des capitaux qui font référence aux
« ressources managériales » ; des facilitateurs, mais également des financeurs, qui apportent
une ressource financière a contrario des autres fonctions qui correspondent davantage à
l’apport de compétences.
Plus les organisations présentes au sein du réseau sont hétérogènes, plus grande est la
diversité des compétences détenues au sein du réseau. Fulconis et Joubert (2009) proposent
une hétérogénéité à deux niveaux. L’hétérogénéité de premier ordre s’intéresse au type
d’organisation selon la classification en triple hélice : entreprises, recherche et formation.
Pour que cette hétérogénéité de premier ordre soit respectée, il faut que des organisations de
chacune de ces trois hélices soient représentées au sein du réseau. Cette hétérogénéité de
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
5
premier ordre peut se doubler d’une hétérogénéité de second ordre à l’intérieur même de ces
domaines de la triple hélice. Ainsi, Jolly (2001) distingue les firmes concurrentes du même
secteur, les firmes d'autres secteurs et les firmes clientes au sein-même de l’hélice
« entreprise ».
Dans le cas particulier des réseaux d’innovation, il existe une forte incertitude quant au
résultat final du projet, et il est parfois impossible d’en évaluer la nature et la valeur au début
de l’engagement dans le projet. Cela rend incertaines l’évolution de la configuration du
réseau, et l’anticipation des questionnements et problèmes qui seront à résoudre au cours du
processus particulièrement difficile. Le réseau ne peut donc fonctionner qu’en mobilisant une
grande variété d’acteurs (Loilier & Tellier, 2013): ces auteurs sont donc favorables, eux-aussi,
à l’hétérogénéité des organisations du réseau.
Toutefois, certains auteurs (Le Roy, et al., 2013) ont montré que la coopération des
entreprises avec les universités était très positive pour l’innovation, ce qui va dans le sens de
l’hétérogénéité de premier ordre présentée dans les travaux de Fulconis et Joubert (2009) ,
mais qu’en revanche, une coopération entre les entreprises et leurs fournisseurs, c’est-à-dire
entre firmes clientes dans la classification de Jolly (2001), avait un effet nul voire même
négatif. Une possibilité émise par les auteurs (Le Roy, et al., 2013) est que l’effort collectif
permettant d’aboutir à l’innovation va, certes, permettre à l’organisation d’accéder à de
nouveaux inputs, mais c’est le fournisseur qui s’approprie la valeur créée par la coopération et
qui améliore sa capacité d’innovation. Ce dernier résultat va donc à l’encontre de la recherche
d’hétérogénéité à toute fin. Fulconis et Joubert (2009) admettent qu’une trop grande
hétérogénéité du réseau augmente le risque d’isolement et diminue la coopération. Ces
recherches s’accordent donc sur l’importance d’une hétérogénéité optimale, et non maximale,
des organisations intégrées dans les réseaux inter-organisationnels.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
6
Mais, l’hétérogénéité des organisations engendre une hétérogénéité des objectifs. Les
organisations peuvent avoir, en plus de l’objectif commun, une attente individuelle à
participer au réseau qui peut être différente des attentes des autres, Selon Das et Teng
(1998b), cette divergence d’objectifs n’empêche pas une coopération au sein du réseau. Ce
n’est pas le seul partage de compétences hétérogènes qui apporte sa plus-value au réseau
inter-organisationnel. En effet, les compétences partagées et la collaboration des organisations
sur un projet d’innovation permettent également la co-création de nouvelles compétences, au
sein desquelles chaque organisation pourra y trouver un bénéfice. La valeur ajoutée du réseau
est que les compétences développées par les membres sont censées être supérieures à la
somme des compétences de chaque membre (Gardet & Mothe, 2010).
Outre les compétences détenues par les organisations du réseau et celles générées par
l’interaction de ces organisations, c’est aussi le partage d’actifs qui justifie la mise en place
d’une telle structure stratégique.
b) COMPLEMENTARITE DES ACTIFS
L’ensemble des ressources que l’entreprise peut mobiliser au sein du réseau sans toutefois les
posséder en interne sont des actifs complémentaires (Teece, 1987). Ces actifs regroupent
l’ensemble des moyens indispensables à la réalisation du processus d’innovation et rendent
dépendantes les unes aux autres les organisations impliquées dans le réseau. En effet, aucune
organisation n’est censée détenir seule l’ensemble des ressources (Gardet & Mothe, 2010), ce
qui rend le réseau nécessaire. Selon la théorie de la dépendance des ressources, la dépendance
des entreprises entre-elles dépend de la spécificité des actifs engagés (Williamson, 1985) et de
la phase du processus d’innovation (Gardet & Mothe, 2010). Cependant, Boissin (1999)
distingue l'actif spécifique préexistant sur lequel l’analyse de Williamson repose, et l'actif
spécifique construit, ou actif endogène, résultant du travail coopératif des organisations. Mais
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
7
pour Brousseau (2000, p. 4), « même si la spécificité des actifs n'est pas extrêmement forte,
une certaine dépendance bilatérale existe. ».
Afin de mener à bien le projet d’innovation, le réseau doit disposer de l’ensemble des actifs
nécessaires à la réalisation de l’ensemble de son processus. Les ressources nécessaires à
l’achèvement complet de ce processus d’innovation ne sont pas seulement des ressources
financières. Das et Teng (1998a) distinguent en effet trois autres types de ressources. Les
ressources technologiques, qui regroupent toutes les ressources corrélées à l’expertise du
produit, comprenant les connaissances enregistrées et les brevets ; les ressources physiques,
qui regroupent les ressources en infrastructure et matériel ; et les ressources managériales, qui
se réfèrent davantage à des compétences spécifiques en planification, marketing et ressources
humaines. La complémentarité qualitative du réseau dépend de l’hétérogénéité des
organisations qui le composent : plus les organisations sont hétérogènes, plus les actifs
apportés sont différenciés et complémentaires (Jolly , 2003).
Tous les types de ressources doivent donc être détenus par le réseau, mais il faut également
que la quantité de ces ressources soit suffisante pour répondre aux besoins du processus
d’innovation. Ainsi, l’hétérogénéité du réseau n’est pas toujours recherchée. En effet, plus les
organisations se ressemblent, plus les actifs apportés seront semblables. Dès lors, ce n’est plus
la complémentarité des actifs qui est recherchée, mais un effet de taille, quantitatif. Ce type de
réseau permet de répondre à des recherches d’économie d’échelle (Halliday, et al., 1987)
(Jolly , 2003), de partage des risques (Jolly , 2003), d’accroissement des investissements et
d’accélération du processus d’innovation (Journal Officiel de l'Union Européenne, 2011).
Ainsi, Jolly (2003) distingue deux types d’alliances inter-entreprises : les alliances endogames
dans lesquelles le partage de ressources similaires conduit à un effet de taille, et les alliances
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
8
exogames dans lesquelles le partage de ressources différenciées conduit à un effet de
complémentarité ou symbiotique.
Figure 2 : Deux types d'alliance selon les ressources mises en commun (Jolly , 2003, p. 21)
c) CONCLUSION SUR LA STRUCTURE DES RESEAUX
Un réseau inter-organisationnel innovant se constitue d’un ensemble de ressources et de
compétences partagées entre les organisations du réseau pour mener à bien un projet
d’innovation. Ces composantes sont apportées par différentes organisations qui deviennent
interdépendantes. Mais cette dépendance s’atténue dès lors que les composantes sont acquises
par le réseau lui-même au cours du processus d’innovation.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
9
Figure 3 : Schéma de bilan de la revue de la littérature sur
les composantes des réseaux inter-organisationnels
d’après (1) Laban et al., 1995 ; (2) Bernasconi, Dibiaggio et Ferrary, 2004 ;
(3) Das et Teng, 1998 ; (4) Gardet et Mothe, 2010 ; (5) Boissin, 1999 et Fulconis et Joubert, 2009 (6).
Le partage de composantes, aussi complémentaires soient elles, ne garantit pas seul le bon
fonctionnement du réseau : la coopération (II.1.) est essentielle. Cette coopération peut
s’obtenir grâce à une orchestration du collectif par un mode de gouvernance (II.2.) adapté au
réseau envisagé.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
10
2) UN FONCTIONNEMENT APPELANT A LA COOPERATION ET UNE
GOUVERNANCE
Les partenaires qui s’engagent dans un réseau innovant participent à un processus incertain
par nature, puisqu’il est impossible de décrire à l’avance l’investissement global nécessaire et
le résultat final de ce travail collaboratif, ni d’en évaluer la valeur économique future qui
dépendra du marché (Brousseau, 2000). Face à cette incertitude, la coordination des
organisations est nécessaire.
La coordination dans le réseau est l’établissement d’une harmonisation entre les différentes
organisations autonomes juridiquement, et selon le CNRTL2, il s’agit du fait d’« ordonner,
organiser, combiner harmonieusement l'action de plusieurs services, afin de leur donner le
maximum d'efficacité dans l'accomplissement d'une tâche définie ».
Mais, dans ces réseaux où les organisations disposent d’une certaine autonomie, « les choix
de coordination des activités et des transactions économiques et industrielles ne se posent pas
en termes d’alternative entre marché et hiérarchie mais par référence à trois solutions de base :
marché, hiérarchie et coopération entre firmes » (Desreumaux, 1996, p. 89). La coordination
dans les réseaux ne s’apparente ni à une coordination hiérarchique, ni à une coordination de
marché, mais à un mode de coordination qui peut être qualifié d’intermédiaire, et que l’on
désigne par la coopération (Brousseau, 2000).
D’après Loilier et Tellier (2013), la confiance, le contrôle et la coopétition sont les trois
modes de coordination permettant de faire face à l’incertitude du réseau inter-organisationnel
innovant. La coordination par la coopération reposerait donc sur ces trois concepts.
2 Accessible sur : http://www.cnrtl.fr/definition/coordonner, consulté le 09/04/2015
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
11
Afin que cette coopération puisse exister et perdurer, il est nécessaire pour le réseau d’avoir
une gouvernance, c’est-à-dire un pilotage. Nous envisagerons ainsi la gouvernance interne,
qu’elle soit communautaire ou centralisée (Assens, 2003), puis la gouvernance externe, c’est-
à-dire par un tiers (Provan & Kenis, 2008).
a) LA COOPERATION DES ORGANISATIONS
• La confiance
La confiance est au cœur de la coopération inter-organisationnelle (Das & Teng, 1998b). En
effet, les comportements des autres membres du réseau sont incertains et c’est grâce à la
confiance qu’une « action coopérative » (Alter, 2010b, p. 62) peut toutefois se mettre en
place. Le sociologue Zucker définit la confiance comme un « ensemble d’attentes partagées
par tous ceux qui sont impliqués dans un échange » (1986, p. 2).
Plus spécifiquement, les individus accordent leur confiance aux partenaires avec lesquels ils
coopèrent lorsqu’ils savent que les normes du milieu professionnel seront respectées (Alter,
2010b). Afin de s’assurer du respect de ces normes, il faut que le partenaire partage ces
mêmes normes, et/ou il faut avoir déjà eu la preuve de ce respect lors d’une relation passée,
et/ou il faut des garanties institutionnelles (Zucker, 1986).
Tout d’abord, les attentes permettant de générer de la confiance sont contextuelles et
dépendent du secteur. En effet, un même comportement dans une banque ou une église
n’inspirera pas le même niveau de confiance. Ainsi, dans chaque secteur, il y a des références
à connaître qui ne sont pas explicites. La confiance dans l’individu repose sur des
caractéristiques sociales d’appartenance à un même système culturel (nationalité, sexe,
contexte familial…) ou sous-culturel (association professionnelle, certification
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
12
professionnelle …). Cette appartenance commune signale le partage de « règles du jeu »
spécifiques (Zucker, 1986, p. 16), c’est-à-dire, un cadre de compréhension commun.
Ensuite, la confiance n’est pas toujours innée et peut se construire au cours d’un processus
relationnel. Les relations passées donnent confiance dans les relations futures et la confiance
réside ainsi dans les modes « normaux » de fonctionnement des acteurs entre-eux, qui sont
amenés à agir "comme d'habitude " (Zucker, 1986, p. 6).
Enfin, la confiance peut reposer sur des garanties institutionnelles (Zucker, 1986).
Mangematin (1998) spécifie que la confiance institutionnelle repose sur la « délégation » qui
fait autorité et qui « garantit » le comportement des autres. C’est une confiance exogène qui
repose sur un tiers, une structure formelle, qui peut être un code d'éthique, des contrats, des
normes ou des lois.
Pour Zucker (1986), le contrat peut donc aider à instaurer la confiance entre les membres du
réseau, tandis qu’Alter réfute cette possibilité en opposant confiance et contractualisation :
« la confiance peut se substituer au contrat » (2010b, p. 62). Pour lui, c’est parce que les
acteurs n’ont pas confiance qu’ils ont le besoin de recourir au contrat. La confiance repose sur
un engagement moral.
Globalement, qu’elles soient formalisées ou non, la coopération repose sur des normes et la
confiance s’attache au respect de celles-ci. Alter (2010b) a tenté d’identifier ces normes qui
protègent le réseau de son environnement et des organisations qui le composent elles-mêmes.
Tout d’abord, ce qui se passe dans le réseau ne concerne que le réseau et il ne faut pas trahir
ce secret en divulguant des informations du réseau à l’extérieur de celui-ci. Ensuite, les
acteurs ne doivent pas se montrer individualistes, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas
s’approprier les actifs complémentaires du réseau pour leur propre intérêt. Enfin, les
organisations du réseau doivent participer à la générosité en apportant quelque chose au
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
13
réseau. Trahir la confiance du réseau, c’est-à-dire ne pas respecter une de ces normes,
conduirait à une exclusion du réseau, accompagnée d’une dégradation de la réputation.
Mais, même si la confiance est nécessaire à la coopération, trop de confiance peut être
nuisible, notamment du point de vue de l’innovation. Si les organisations du réseau se font
trop confiance, c’est à ce moment-là que des comportements opportunistes peuvent apparaître
(Paniccia, 1998).
• Le contrôle
Williamson (1985) affirme que les individus, dans leurs relations sociales, économiques et
commerciales, présentent une propension naturellement élevée à développer des
comportements opportunistes. La notion de réseau inter-organisationnel n’a de réalité que
parce qu’il existe une autonomie juridique entre les organisations du réseau (Fulconis &
Joubert, 2009), ce qui peut apparenter ces organisations à des individus autonomes, capables
donc d’associer autonomie et individualisme, et de se fourvoyer dans des comportements
opportunistes. Le contrôle peut être vu comme un moyen de sécuriser les échanges et est
défini par Woolthuis et al. (2005) comme l'ensemble des moyens de dissuasion de ces
comportements opportunistes.
Comme le montrent Christ et al. (2008), les modalités de contrôle trop formelles peuvent
inhiber l’innovation. Tout d’abord, le contrôle rigoureux et attentif des comportements peut
être perçu comme une violation de la confiance et, dans ce cas, le contrôle freine la confiance.
Ensuite, les contrôles formels peuvent constituer une intrusion dans le processus d’innovation
poursuivi par l’organisation et interférer avec lui en ralentissant son développement. Enfin, la
spécification trop précise des comportements à adopter limite l’autonomie.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
14
Parallèlement à ce contrôle formel, il existe des modes de contrôle informels et exempts de
système hiérarchique. La régulation des comportements peut se faire naturellement grâce aux
normes sociales qui gouvernent les relations interpersonnelles (Horwitz, 1990), mais
également grâce à des « otages » de l’organisation détenus par le réseau. Fréry (1997, p. 6), en
s’inspirant de la théorie des jeux, montre que la mise en jeu d’un otage « dont la perte doit
être supérieure au gain récolté à l’occasion d’une trahison » empêche les comportements
opportunistes et permet de contourner un contrôle trop intrusif. Ainsi, Fréry (1997) propose
trois types d’intégration des organisations dans le réseau et pouvant se combiner : intégration
logistique, médiatique et culturelle. L’idée est de créer et prendre en otage certaines
spécificités du réseau à forte valeur dont les organisations bénéficient. Ainsi, toute
organisation qui se montrerait opportuniste perdrait cette spécificité à forte valeur et aurait
finalement plus à perdre qu’à gagner. Ces pertes sont la sortie d’un système logistique pour
l’intégration logistique, la perte d’une image de marque pour l’intégration médiatique et
l’exclusion d’une communauté (famille, religion, pairs…) pour l’intégration culturelle.
Figure 4 : Les trois types d'intégration proposés par Fréry (1997)
Comme nous venons de le montrer, confiance et contrôle sont deux modes de coordination
complémentaires. Mais dans le cas d’une coopération avec ses concurrents, un troisième
mode de coordination intervient : il s’agit de la coopétition.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
15
• La coopétition
Tandis que la confiance et le contrôle concernent tout type de réseau, la coopétition n’agit
qu’en cas de concurrence entre les organisations du réseau. Cet état de concurrence ne
concerne que les réseaux avec coopération horizontale, c’est-à-dire entre organisations se
situant au même niveau de la chaîne de production ou de distribution. Les relations entre les
organisations d’un réseau de coopération horizontale sont un mélange entre coopération et
compétition, d’où le néologisme « coopétition » popularisé en 1996 par Brandenburger et
Nalebuff (Brandenburger & Nalebuff, 2011). Mais toutes les coopérations horizontales ne
mettent pas non plus en jeu la coopétition. Les organisations peuvent ne pas être
concurrentes : c’est le cas, par exemple, des organisations opérant sur les mêmes marchés
mais pas sur le même secteur géographique (Journal Officiel de l'Union Européenne, 2011).
La coopétition n’est pas toujours naturelle car coopérer avec ses concurrents représente un
risque (Le Roy, et al., 2013) et la confiance est alors plus difficile à instaurer (Whitley, 2002).
Ce risque se rapporte essentiellement à la connaissance et aux informations partagées dans le
cadre de la collaboration. En effet, en situation de coopétition, les organisations opèrent à une
sélection de ce qu’elles sont prêtes à partager et de ce qu’elles veulent garder pour elles afin
de conserver leurs avantages concurrentiels. Dans la mesure où la coopération repose sur le
don contre don (Alter, 2010b), une rétention trop forte de la part des organisations nuit
gravement au réseau. Cette rétention semble se renforcer avec la proximité géographique.
Ainsi, Le Roy et al. (2013) ont montré que la coopétition avec des organisations
géographiquement proches était peu efficace. Pour les organisations, l’équilibre entre
protection des connaissances et partage, c’est-à-dire don générateur de « contre don », peut
s’avérer un vrai dilemme. Powell et al. (1996) soulignent l'importance de spécifier
explicitement la connaissance à partager.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
16
Mais d’autres auteurs montrent que la coopétition est un type de coopération à rechercher.
Koenig (2004) explique que la relation stratégique entre des partenaires est une combinaison
de trois forces ; coopération, évitement et affrontement. Si l’une d’entre elles l’emporte sur les
autres, il en résulte une situation extrême. Une trop grande coopération amène ainsi à une
relation trop fusionnelle entre les organisations. Dans une coopération purement
communautaire, c’est-à-dire fusionnelle au sens de Koenig (2004), le réseau concentre ses
efforts sur la coopération en négligeant d’appréhender l’environnement. Cela peut entraîner la
coopération vers une myopie stratégique et rendre inefficace la coopération (Paniccia, 1998).
Pour le sociologue Simmel (1999), la coopération entre pairs est souhaitable car elle permet
une montée en compétence sans égal. Hamel (1991) ajoute que plus un concurrent est
dangereux, plus il est un partenaire intéressant.
b) LA GOUVERNANCE DU RESEAU
La gouvernance d’un réseau inter-organisationnel peut être interne ou externe au réseau, mais
également centralisée ou décentralisée (Assens, 2003) (Ehlinger, et al., 2007). Ainsi, Provan
et Kenis (2008) distinguent les réseaux à pilotage centralisé et décentralisé en interne, des
réseaux pilotés en externe.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
17
• La gouvernance interne
- La gouvernance par un pivot
La gouvernance à l’intérieur même du réseau peut être assurée par un pivot. Le pivot est une
organisation du réseau, porteuse de projets, qui pilote le réseau et y occupe une place centrale
(Gardet & Mothe, 2010). Il y détient un rôle de facilitateur et de régulateur du réseau (Provan
& Kenis, 2008). Le pivot « remplit globalement le même rôle que la direction d’une
entreprise intégrée classique vis-à-vis de ses fonctions opérationnelles, à la différence que
celles-ci sont dévolues à des entreprises financièrement autonomes. » (Fréry, 1997, p. 3).
Il s’agit donc d’une gouvernance individuelle et centralisée. La plupart des chercheurs
s’entendent sur la nécessité de ce pivot, ou firme focale, ou broker (Miles & Snow, 1986)
pour la gouvernance du réseau.
- La gouvernance par les participants
Les réseaux inter-organisationnels peuvent être pilotés collectivement par les organisations du
réseau elles-mêmes : la gouvernance y est donc décentralisée. Ces réseaux sont pilotés par les
participants de façon équilibrée entre les organisations du réseau (Provan & Kenis, 2008).
• La gouvernance externe
La gouvernance du réseau peut s’appuyer sur une entité extérieure au réseau, chargée de son
administration et de son pilotage. Cette entité est souvent gouvernementale ou associative
(Provan & Kenis, 2008) peuvent appartenir aux « facilitateurs institutionnels » de Laban et al.
(1995).
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
18
Certains auteurs ont montré les avantages de ce mode de gouvernance qui permet le pilotage
de réseaux de plus grande taille (Provan & Kenis, 2008) et facilite la résolution des conflits
(Brousseau, 2000). En effet, il est difficile pour les membres d’un réseau de se sanctionner
mutuellement et l’intervention d’un tiers permet de simplifier les résolutions de conflits,
quelle que soit la taille du réseau.
Brousseau (2000) distingue les institutions publiques sur lesquelles le réseau ne peut pas agir,
des institutions privées « plus manipulables ». Parmi ces institutions privées, il est possible de
répertorier les syndicats et associations professionnels, et les instances de normalisation.
Geindre (2005), en étudiant l’action du syndicat professionnel des Lunetiers du Jura,
décompose l’action des tiers dans la construction de réseaux inter-organisationnels en trois
rôles. Tout d’abord, il initie la relation entre les entreprises en construisant un « intérêt
collectif » qui amènera les organisations à coopérer. Ensuite, il joue un rôle de facilitateur
dans l’échange entre les organisations. Enfin, il garantit la qualité des relations en se plaçant
comme un tiers de confiance grâce à sa capacité à mettre en place des règles du jeu et à les
garantir. Ces règles du jeu font l’objet d’une convention de coopération qui permet de donner
une signification précise aux « pratiques acceptables » ou d' « usage » au sein du réseau,
simplifiant la contractualisation et les accords tacites (Bessy & Brousseau, 1997).
c) CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU
INTER-ORGANISATIONNEL
La gouvernance des réseaux inter-organisationnels permet la coopération entre les
organisations en dissuadant les comportements opportunistes. Elle passe par la confiance, le
contrôle et la coopétition.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
19
Figure 5 : Bilan du fonctionnement d'un réseau inter-organisationnel
(1) Provan et Kenis, 2007 ; (2) Zucker, 1986 ; (3) Williamson, 1985,
(4) Horwitz, 1990 et Fréry, 1997 ; (5) Le Roy, Robert et Lasch, 2013
Chacun de ces trois types de coopération peut avoir des modalités distinctes en fonction du
style de gouvernance déployé. Un contrôle formel semble antinomique avec une gouvernance
collective interne, la confiance institutionnelle nécessite la gouvernance par un tiers…
3) QUESTION DE RECHERCHE
Grâce à cette revue de la littérature, nous avons pu voir que les réseaux inter-organisationnels
innovants possédaient des caractéristiques de structure et de fonctionnement variables en
fonction de la visée du réseau et de ses organisations membres.
Les entreprises de paysage, par leur petite taille, se voient confrontées à la nécessité de
coopérer ensemble pour générer de l’innovation. Quelle structure et quel fonctionnement ces
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
20
entreprises peuvent-elles choisir ? Dit autrement ; comment choisir ses partenaires pour
former un réseau d’innovation performant et comment le piloter ?
Face à ces questions, les entreprises de paysage peuvent s’appuyer sur leur syndicat
professionnel. C’est alors qu’émerge notre question de recherche :
Comment un syndicat professionnel peut-il jouer un rôle de facilitateur dans un réseau
inter-organisationnel innovant ?
II. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
1) METHODOLOGIE GENERALE ET POSTURE EPISTEMOLOGIQUE
a) RECHERCHE A CARACTERE EXPLORATOIRE
L’ambition de cette recherche est de comprendre quel peut être le rôle d’un syndicat
professionnel pour faciliter l’innovation au sein de réseaux inter-organisationnels de sa
profession. Aussi, le processus de production des connaissances peut être qualifié
d’exploratoire. Dans cette recherche, nous faisons appel plus particulièrement à l’exploration
hybride, au sens de Charreire Petit et Durieux (2014), consistant à mener un processus de
recherche opérant par allers-retours entre des observations empiriques et des connaissances
théoriques. Ce type d’exploration conduit à un raisonnement abductif et permet d’enrichir les
connaissances antérieures.
Notre mode d’exploration consiste à approcher la réalité par la compréhension et
l’interprétation. Ainsi, cette recherche sera qualitative, avec une posture épistémologique
interprétative.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
21
• Recherche qualitative
La visée compréhensive de la recherche inscrit celle-ci dans une perspective qualitative. Elle
s’appuie, en effet, sur un complexe de méthodes exploitant des données primaires (entretiens
semi-directifs) et secondaires (mémoires d’ingénieurs, documentation et presse spécialisées).
Denzin et Lincoln parlent de « bricolage » méthodologique (2012).
• Epistémologie interprétative
Dans la posture épistémologique interprétative, le chercheur s’immerge dans le phénomène
étudié pour le comprendre et s’expose à une double subjectivité : la sienne et celle des acteurs.
Ainsi, le chercheur ne nie pas la dépendance à son objet d’étude et ne cherche pas la neutralité
vis-à-vis du phénomène qu’il étudie, « il doit alors tirer les conséquences de sa position
au sein même du cercle herméneutique : il fait inéluctablement partie de la réalité qu’il se
propose d’étudier et ne peut se situer en dehors du processus interprétatif » (de La Ville, 2000,
p. 90). Dans cette posture, il est d’autant plus important pour le chercheur d’être conscient des
biais auxquels il s’expose pour pouvoir les gérer.
b) PRECAUTIONS METHODOLOGIQUES
Dans cette recherche, la dépendance à notre objet d’étude est très forte. En effet, le terrain
choisi pour ce travail de recherche, loin de nous être étranger, a été le contexte privilégié de
nombreuses expériences professionnelles longues de plusieurs années. Ces expériences
permettent une connaissance approfondie du terrain et un lien étroit avec les acteurs. Partager
le même langage est un facilitateur indéniable pour entrer en contact avec les acteurs et avoir
l’empathie nécessaire propre au chercheur interprétativiste (Giordiano, 2003). Mais, notre
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
22
point de vue ne peut être neutre, et cela implique de justifier les précautions que nous
mettrons en œuvre pour garder le recul nécessaire à un travail scientifiquement valide.
• Prévenir les risques liés à la proximité avec le terrain d’étude
D’après la typologie de Mitchell (1993), par notre implication affective élevée et notre
connaissance du terrain forte, nous nous exposons aux risques du chercheur « allié ».
Figure 6 : Perception du chercheur en fonction de son implication affective et de sa connaissance du
terrain, inspirée de Mitchell (Thiétart, 2014, p. 289).
Il nous faudra donc nous prémunir :
- du paradoxe de l’intimité,
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
23
L’intimité créée avec les acteurs permet au chercheur de recueillir des témoignages plus
riches, mais, cette confiance réciproque peut entraîner inconsciemment le chercheur à adopter
la même prise de position que les acteurs qu’il interroge (Mitchell, 1993). Nous pensons que
les itérations entre le terrain et la littérature permettent de limiter la prise de position du
chercheur. En effet, la littérature permet d’élargir le prisme de compréhension des données
empiriques et de recadrer la récolte de données. Ainsi, nous pensons pouvoir nous prémunir
du paradoxe de l’intimité en adoptant un raisonnement abductif.
- de la contamination des sources,
Les sources de données dépendantes du terrain peuvent être soumises à une sélection de la
part des acteurs et déformer la réalité. Afin de s’assurer de la fiabilité des données rendues
disponibles au chercheur, mais également afin de nous assurer que leur sélection abusive
n’affecte pas la compréhension du phénomène étudié, nous nous efforcerons d’effectuer une
triangulation des méthodes de recherche. Le caractère qualitatif de notre recherche permet une
triangulation aisée, les sources de données utilisées étant nombreuses (entretiens, mémoires
d’ingénieur, documentation UNEP…).
- et des jeux politiques (donnant-donnant).
Etant donné notre implication sur le terrain, les différents acteurs interrogés nous ont demandé
un retour sur les résultats de la recherche, et, dans le cas des entreprises privées, la
confidentialité en échange des informations mises à notre disposition. Cette tension donnant-
donnant, peu contraignante à ce stade, ne nuit pas à la scientificité de la recherche car elle
n’impacte pas sur l’autonomie du chercheur.
Nous venons d’exposer les précautions prises au regard de la proximité entretenue avec ce
terrain. Cela n’est cependant pas suffisant pour légitimer et valider la démarche de recherche.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
24
• Légitimer la scientificité de la recherche conduite
Il reste indispensable d’apporter une traçabilité des « mécanismes génératifs » de
connaissance (de La Ville, 2000) grâce à la clarification des mesures prises pour assurer la
scientificité de la recherche. Selon Lincoln et Guba (1985), il existe quatre critères de
scientificité :
- Véracité : Comment s’assure-t-on de l’exactitude des résultats ?
La véracité des résultats dans les recherches qualitatives s’apparente à leur crédibilité
(Lincoln & Guba, 1985). En effet, la posture interprétative ne cherche pas à comprendre la
réalité mais la perception de cette réalité au travers des acteurs interrogés. Ainsi, la crédibilité
des résultats obtenus passe nécessairement par la validation de ceux-ci par les acteurs eux-
mêmes. Pour garantir la crédibilité de notre recherche, nous exposerons donc nos résultats aux
répondants afin de les soumettre à leurs critiques.
- Applicabilité : Peut-on généraliser les résultats obtenus sur une étude
particulière ?
La visée compréhensive d’un terrain de recherche spécifique n’a pas vocation à produire des
résultats généralisables. Les résultats attendus sont d’ordre idiographique. Cependant, nous
nous attacherons à décrire précisément les caractéristiques de ce terrain afin de permettre une
éventuelle confrontation a posteriori de la conceptualisation produite à des « contextes
parents » (Passeron, 2006), c’est-à-dire, dont la typologie est proche du contexte étudié.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
25
- Consistance : Peut-on obtenir des résultats analogues en reproduisant le
processus d’investigation ?
En recherche qualitative, la consistance relève de la fiabilité des résultats obtenus (Lincoln &
Guba, 1985), c’est-à-dire que les mêmes résultats pourraient être obtenus par un autre
chercheur dans les mêmes conditions. Il nous apparaît donc primordial d’identifier avec
exactitude les caractéristiques des organisations interrogées et l’historique des répondants au
sein de ses organisations.
- Neutralité : Les résultats sont-ils exempts de biais ?
Nous avons précédemment éclairci la façon dont nous envisagions de nous prémunir des biais
liés à notre proximité avec le terrain. Les mesures particulières mises en place sont la
triangulation des données par diverses méthodes et l’adoption d’un raisonnement abductif.
2) METHODE D’EXPLORATION
Nous avons réalisé une étude exploratoire afin de comprendre la vision des acteurs de la
filière paysage concernant l’innovation ; comprendre en particulier ce que représente
l’innovation pour eux, s’ils innovent ou ce qui les freine dans cette démarche.
Après avoir décrit brièvement la filière pour apporter au lecteur toutes les clés de
compréhension, nous présenterons l’exploration de notre terrain de recherche qui s’est
réalisée en deux temps. Dans un premier temps, une immersion dans la filière paysage, puis
une série d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs variés de cette filière.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
26
a) BREVE DESCRIPTION DE LA FILIERE
La filière paysage est une filière du monde agricole relativement jeune. En effet, elle est née
après la seconde guerre mondiale, au cours des trente glorieuses en réponse à une vague de
projets d’habitation à une grande échelle (Blanchon-Caillot, 2007).
Les métiers du paysage représentent le dernier maillon de la filière agricole des végétaux de
pépinière (Foucart, 2008).
L’architecte paysagiste, à la manière de l’architecte en bâtiment, conçoit des plans
d’aménagement d’espaces verts (Donadieu, 2007), puis, l’entreprise de paysage réalise les
travaux selon ces plans. Dans certaines collectivités, des
services techniques espaces verts peuvent se substituer à
l’entreprise de paysage pour certains travaux sur l’emprise
de la collectivité.
Le maître d’ouvrage est le client, qui peut être une
collectivité publique ou un office HLM ; un particulier ; ou
une entreprise privée telle que des promoteurs immobiliers
ou des industriels.
Mais limiter le paysage à la filière des végétaux de pépinière équivaudrait à limiter les
activités du paysage à la plantation de végétaux. Les
activités des entreprises de paysage sont bien plus larges et
recouvrent l’ensemble des « travaux de création, restauration
et entretien des parcs et jardins », y compris, depuis octobre 2014, « les travaux de
maçonnerie paysagère »3. Cet ensemble comprend par exemple la mise en place de terrains de
3 Article L722-2 du Code rural et de la pêche maritime
Figure 7 : La filière paysage au
sein de la filière des végétaux de
pépinière
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
27
sports (végétalisés ou non), l’installation d’arrosage et d’éclairage automatique, la création de
piscines et de bassins, les travaux d’entretien tels que le traitement phytosanitaire,
l’élagage…4. Ainsi, le réseau de fourniture et de distribution de matières premières et
matériels est plus large que la simple filière des végétaux de pépinière.
Enfin, les acteurs jouant un rôle dans la filière ne se limitent pas aux acteurs de la chaîne de
production. La filière est accompagnée de nombreux acteurs connexes dont les principaux
sont les écoles d’architecture paysagères et d’ingénierie, l’institut technique Plante et cité et
les syndicats professionnels.
Figure 8 : Filière paysage étendue
b) IMMERSION DANS LA FILIERE
Dans un premier temps, nous avons participé à différents évènements (Voir Tableau 1.
Evènement et immersion vécue au cours de l’année) portant sur l’innovation dans la filière
4 Disponible sur : http://www.entreprisesdupaysage.org/les-entreprises-du-paysage/les-activites, consulté le 03/02/2015
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
28
paysage et nous nous sommes immergés pendant trois semaines au sein du bureau national de
l’UNEP, où notre mission était de faire émerger des pistes de réflexion pour la commission
innovation de l’UNEP.
Tableau 1 : Evènements et immersion vécus au cours de l’année
Nom de l'évènement Type Date Organisateur Intervenants
"Innover dans la gestion des espaces publics sans pesticides"
Conférence 26/11/2014
Plante & Cité
- Madame AMESTOY (Adjointe au maire de Courdimanche), - Madame GUTLEBEN (Directrice de Plante & Cité), - Madame ORDAS (Adjointe au maire de Versailles), - Madame GALLOUET (Chef du bureau ressources naturelles et agriculture à la direction de l’Eau et de la Biodiversité, Ministère de l’Ecologie).
Réunion de programmation budgétaire 2015
Réunion 12/03/2015
Conseil Stratégique Interprofessionnel de l’Innovation (Val'hor)
Différents représentants des organisations et institutions : - Val’hor, - Unep, - FNPHP, - France Agrimer.
Immersion au sein du syndicat professionnel
Stage
02/03/2015 21/03/2015
UNEP
- Madame DE GOROSTARZU (Déléguée Générale Adjointe à l’UNEP), - Madame NAVE (Conseillère technique et Innovation à l'UNEP), - Monsieur QUESSON (Responsable du Pôle Paysage ISA).
"L’innovation, l’avenir de la filière paysage ?"
Débat 24/04/2015
ISA pôle paysage
- Monsieur BILLON (Président de la société Solyev), - Monsieur FEUGERE (Président de la société Plaine Environnement).
Ces évènements sont apparus comme autant d’occasions de rencontrer des acteurs importants
de la filière, d’emmagasiner un certain nombre de données contextuelles qui ont été des clés
de compréhension des entretiens exploratoires décrits ci-après, mais surtout, de nourrir notre
réflexion. Ainsi, nous ne présenterons pas, ici, des résultats des données collectées
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
29
(enregistrements et documentation variée), mais ces données viendront en appui de notre
analyse des entretiens semi-directifs.
c) ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS
Cette seconde phase d’exploration a été réalisée à partir d’entretiens semi-directifs d’acteurs
divers de la filière (marqués d’un × dans la figure de présentation de la « filière paysage
étendue ») afin de cerner le plus intégralement possible le phénomène.
Tableau 2 : Tableau des répondants
(Les astérisques signalent les dénominations des organisations ayant été anonymées)
Type d'organisation Dénomination des organisations
Fonction du répondant
Nombre de salariés (2013)
Entreprise de paysage Honorine Paysage*
Secrétaire générale 198
Entreprise de paysage – Bureau de l’UNEP
Plaine environnement
Dirigeant 37
Entreprise de paysage Guislain Paysage* Dirigeant 10
Entreprise de paysage Urielle Paysage* Dirigeant 5
Distributeur (gazon synthétique et aires de jeux)
Cautry Distribution*
Distributrice
Fournisseur (produits phytosanitaires, bois d’extérieur)
Adèle Fournitures*
Commercial
Ecole d’ingénieur – Architecte paysagiste
Ingécole* Directeur
Institut technique Plante et cité Directrice
Institut technique Plante et cité Chargée d'études
Les organisations interrogées sont des organisations françaises ou s’étant établies en France.
Pour les entreprises de paysage, les critères de sélection sont l’adhésion à l’UNEP et une
variété quant à la taille de ces entreprises afin de toucher les différents segments établis par
l’UNEP. La sélection a ensuite été aléatoire.
Pour toutes les organisations, les coordonnées ont été communiquées par bouche à oreille par
effet « boule de neige », soit tiré directement de l’annuaire UNEP. La prise de contact s’est
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
30
faite directement par téléphone et/ou par mail. Parmi les organisations contactées, toutes ont
accepté l’entretien, hormis une entreprise de paysage unipersonnelle qui n’a jamais donné
suite à nos messages.
Les entretiens ont été réalisés entre octobre 2014 et avril 2015 au sein des bureaux des
différentes organisations.
Aucune grille d’entretien n’a été réalisée au préalable, le seul objectif poursuivi étant de
comprendre comment les organisations percevaient l’innovation dans la filière paysage et de
clarifier le contexte.
Les entretiens ont eu une durée comprise entre 45 et 60 minutes et ont été enregistré à l’aide
d’un dictaphone et intégralement retranscrits par la suite.
L’ensemble des entretiens exploratoires représentent un total d’environ 8h d’entretien, soit 50
pages de retranscription en Times New Roman, 11, intervalle simple.
Afin d’analyser les données obtenues, les entretiens ont tous été codés par codage a priori,
c’est-à-dire sans cadre conceptuel préconçu. D’après Miles et Huberman (2003) le codage
comme une réduction des données via un processus de sélection, de simplification, et
d’abstraction.
73 unités de codages ont ainsi été retenues dans 15 codes distincts (Voir Annexe 1.
Arborescence hiérarchique du codage exploratoire). Ces codes sont répartis en trois
catégories : l’objectif de l’innovation, les organisations concernées par l’innovation et les
limites rencontrées par l’innovation. Cette catégorisation sera donc le support de nos résultats
exploratoires.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
31
3) METHODE DE L’ETUDE DE CAS
L’innovation collaborative dans la filière paysage est un phénomène rare, et peu étudié. C’est
la raison pour laquelle nous avons opté pour la méthode de l’étude de cas qu’Eisenhardt
(1989) préconise dans ce type de situation.
Pour des questions de faisabilité en termes de temps de réalisation du mémoire, nous nous
contenterons d’une étude de cas unique. Ce choix est arbitraire et ne répond pas à une logique
méthodologique. En effet, comme nous l’avons décrit précédemment dans la revue de la
littérature, les réseaux inter-organisationnels sont la combinaison de nombreux paramètres
(types d’organisations, type de coopération, type de gouvernance…) et il nous aurait semblé
pertinent d’explorer des cas de réseaux variés, comme Rispal (2002) le préconise pour
l'échantillonnage théorique des cas.
L’étude du cas unique qui sera choisi s’appuie sur la littérature, ce qui nous conduit à adopter
une démarche déductive. L’utilisation déductive de l’étude de cas consiste en une logique de
“pattern matching” (Yin, 2013), c’est-à-dire qu’il s’agit de confronter la vision théorique du
phénomène, apportée par la littérature, à la réalité exprimée au travers du cas.
a) CHOIX DU CAS UNIQUE
• Critères de sélection
Notre objectif étant de comprendre comment l’UNEP peut agir dans un processus
d’innovation au sein d’un réseau inter-organisationnel, le cas à choisir doit répondre à deux
conditions. Il doit, d’une part, s’agir d’une innovation, c’est-à-dire que le processus de
conception, de développement et de diffusion doit être achevé. D’autre part, l’innovation doit
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
32
s’être développée dans un réseau inter-organisationnel au sein duquel intervient au moins une
entreprise de paysage.
Selon Yin (2013), « L’étude de cas est une enquête empirique qui examine un phénomène
contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre phénomène et contexte
ne sont pas clairement évidentes et pour laquelle de multiples sources de données sont
utilisées. ».
Ainsi, l’ « enquête empirique » nécessite de choisir un cas de processus d’innovation s’étant
finalisé récemment, d’autant plus que le phénomène doit être « contemporain », mais
également un cas pour lequel l’information sera disponible, sans problème de confidentialité
par exemple, pour permettre un accès aux données de terrain.
Tableau 3 : Critères de sélection du cas d'innovation
Processus d’innovation finalisé Processus s’étant déroulé dans un réseau inter-organisationnel comprenant au moins une entreprise de paysage Cas récent Données sur le cas accessibles
• Sélection du cas
Afin de trouver des cas répondant à ces critères, nous nous sommes tournés vers l’UNEP, afin
qu’elle nous fasse part des cas d’innovation récents portés à sa connaissance.
Le premier concours innovation des entreprises de paysage, lancé par l’UNEP, s’est déroulé
entre août et octobre 2014. L’UNEP nous a communiqué le dossier regroupant les
candidatures présélectionnées, c’est-à-dire, l’ensemble des candidatures émises par des
entreprises de paysage. Ce dossier comprend donc des présentations d’innovations finalisées,
récentes et émises par des entreprises de paysage. Nous devions donc sélectionner, à
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
33
l’intérieur de cette liste, un cas qui aurait fait intervenir un réseau et dont les données seraient
accessibles.
Ainsi, nous avons réalisé un tableau comparatif des candidatures précisant l’origine
individuelle ou collective de la démarche, ainsi que les acteurs extérieurs à l’entreprise
candidate qui auraient apporté des ressources financières, des compétences techniques et/ou
managériales. Sur les 13 candidatures présentes dans le dossier, 7 ont été écartées
immédiatement (Voir Annexe 2. Tableau des candidatures au concours innovation des
entreprises du paysage). En effet, celles-ci ne faisaient intervenir qu’une seule entreprise, et
rejetaient donc la notion de réseau.
Après cette première sélection, deux types de groupement d’innovation se sont distingués :
- Des innovations à l’initiative individuelle, mais au développement collectif. Il s’agit
de réseaux inter-organisationnels aux acteurs hétérogènes et gouvernés par l’entreprise
de paysage candidate qui joue le rôle de firme pivot,
- Une innovation à l’initiative et au développement collectifs. Il s’agit d’un réseau inter-
organisationnel aux acteurs homogènes et hétérogènes, et à la gouvernance interne
décentralisée.
Cette dernière innovation, caractérisée par un réseau constitué de plusieurs entreprises de
paysage, nous est apparue particulièrement intéressante car elle peut mettre en jeu des
relations de coopétition. Notre choix s’est donc porté sur l’innovation « De Natura ».
Par chance, les entreprises impliquées dans ce réseau sont des membres particulièrement
investis au sein de l’UNEP et s’inscrivant dans une dynamique de partage. Ainsi, nous avons
eu rapidement confirmation que l’accès aux données de ce cas serait possible.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
34
b) RECOLTE DES DONNEES
Selon Yin, il est important d’utiliser plusieurs sources de données, parmi des documents, des
archives, des entrevues, l’observation directe, l’observation participante et des objets
physiques (Yin, 2013) pour s’assurer d’une bonne triangulation du cas étudié.
Nous avons choisi d’utiliser deux sources de données différentes : un entretien semi-directif
avec l’un des dirigeants d’entreprise ayant développé De Natura et des sources secondaires.
• Entretien
- L’interlocuteur
Monsieur Feugère est vice-président au bureau de l’UNEP, et délégué à l’innovation. Il est le
président de l’entreprise Plaine Environnement, l’une des quatre entreprises impliquées dans
l’innovation De Natura.
Plaine environnement est la plus petite des quatre entreprises de paysage investie dans De
Natura. Disposant d’une quarantaine de salariés, elle réalise un chiffre d’affaires de près de 4
millions d’euros par an. Cette entreprise a été créée par Monsieur Feugère en 2005, et siège en
région parisienne. L’entreprise a toujours été tournée vers la gestion durable des espaces verts,
et s’est spécialisée au fil des années vers la gestion différenciée et a été précurseur en France
en matière d’écopastoralisme, c’est-à-dire dans l’emploi d’animaux pour l’entretien des
espaces verts.
- La grille d’entretien
En s’appuyant sur la revue de la littérature, nous avons pu construire une grille d’entretien
préalablement à l’entretien (Voir Annexe 3. Grille d'entretien pour l'étude de cas De Natura).
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
35
Celle-ci permet de poser des questions pertinentes qui permettront le “pattern matching”
(Yin, 2013).
L’entretien de Monsieur Feugère est disponible en Annexe 4. du présent mémoire de
recherche.
• Sources secondaires
Des sources secondaires ont également permis de croiser les informations apportées par
l’entretien et de les étayer :
- La plaquette d’information et publicitaire De Natura (Annexe 5.),
- Un article paru dans la revue Les potins d’Angèle du 15 avril 2015, intitulé « De
Natura : des moutons au fonds de dotation » (Annexe 6.),
- Des documents internes : le dossier de candidature au concours de l’innovation pour
les entreprises du paysage 2014 et un appel à mécénat centré sur le recyclage de la laine de la
race Solognot.
III. RESULTATS
1) ENTRETIENS EXPLORATOIRES
a) L’ OBJECTIF VISE PAR LES ORGANISATIONS QUI
INNOVENT
Le secteur du paysage est très concurrentiel. Les entreprises de paysage, bien que
majoritairement de petites tailles, sont très nombreuses, et le marché devient de plus en plus
difficile : les enveloppes budgétaires des organismes publics subissent les restrictions
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
36
budgétaires de l’Etat et les projets de promotion immobilière n’ont de cesse de décroître
depuis la crise.
Pour survivre dans ce contexte et obtenir des chantiers, certaines entreprises cherchent à se
démarquer en proposant des innovations qu’elles peuvent notamment trouver chez des
fournisseurs.
« Il y a les entreprises qui m’intéressent plus, ce sont les entreprises moyennes, qui sont
tournées vers la création de jardin. Elles ont envie de se démarquer, d’être meilleures,
donc dans les créations, ils veulent tous proposer des projets en 3D, ils veulent monter
en puissance, monter en gamme leur service, pour pouvoir se démarquer aussi de leurs
petits camarades qui font ça aussi, donc ça je le ressens bien. » Adèle Fournitures.
L’intervention de Monsieur Billon lors du débat à l’ISA enrichit cette idée : les entreprises de
paysage, aussi petites soient-elles (son entreprise Solyev compte 35 salariés), peuvent se
démarquer en développant leurs propres innovations : « Nous, dans le Rhône, on est mille
paysagistes, alors s’il n’est pas rouge l’océan5 là… Si on joue au jeu du paysagiste le plus
idiot qui va vendre avec le prix le plus bas, je suis perdant car ma structure ne me le permet
pas. Donc pour pouvoir apporter de la plus-value au marché, j’ai des bons électroniques, j’ai
de la traçabilité… C’est l’outil que j’ai développé qui me permet ça6 ».
Les innovations leur permettent également de répondre à certaines de leurs problématiques
internes. Les métiers du paysage recouvrant un spectre large d’activités, les problématiques
internes peuvent être très variées. Par exemple, elles peuvent concerner la technicité de
certaines tâches, comme dans cet exemple de sol de sécurité pour aires de jeux pour enfants :
5 En référence à la stratégie de l’Océan bleue développée par W. Chan Kim et Renée Mauborgne en 1997 selon laquelle il faut innover pour sortir d’un environnement concurrentiel saturé : l’ « océan rouge ». 6 L’innovation développée par Solyev est Altagem, une solution web utilisable sur smartphones et tablettes pour organiser le travail des équipes sur les chantiers.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
37
« Les paysagistes ont été très intéressés par cette nouveauté, parce que ça leur permet
de pouvoir faire la mise en œuvre par eux-mêmes compte tenu que pour les sols coulés
en place, il faut une technicité qu’ils n’ont pas. » Cautry Distribution.
Enfin, l’innovation peut être un moyen d’étendre son offre aux clients, soit pour lui proposer
plus de choix, soit pour répondre à sa demande spécifique.
« Je ne sais pas si on a été précurseur mais, là aussi, il faut le dire, c’était une
demande client, mais par exemple le matériel électrique pour le marché de S., on a
acheté du matériel, qui est quand même une innovation, une avancée technologique
dans le matériel.. » Honorine Paysage, 198 salariés.
b) LES ORGANISATIONS DE LA FILIERE PAYSAGE QUI
INNOVENT
Principalement, l’innovation de la filière paysage se développe au sein de collectifs
d’organisations : entreprises de paysage-écoles, entreprises de paysage-architectes
paysagistes-collectivités, entreprises-collectivité-institut technique, ou encore entreprise-
institut technique, comme cela est mis en avant dans ce verbatim :
« Plante et Cité n'a jamais déposé de brevet, par contre, des partenaires oui […] Je
pense par exemple sur le biocontrôle, les entreprises qui avaient contribué
financièrement dans le projet ont eu un retour sur investissement avec le brevet.
Clairement, s’il n'y avait pas eu les projets qu'on a monté, ils n'auraient pas pu déposer
de brevet. » Plante et cité.
Individuellement, certaines collectivités territoriales, en répondant à des problématiques
locales, apportent des solutions innovantes au sein de leur territoire.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
38
« Les collectivités territoriales aussi sont à l'origine de l'innovation. On voit bien,
régulièrement, que Plante et Cité s'appuie sur des travaux pionniers faits par de
grandes collectivités territoriales, qui ne demandent qu'à diffuser, et qui, pour l'instant,
ont traité des sujets en réponse à une problématique qui était propre à leur territoire
mais qui, en réalité, se retrouve aussi sur d'autres territoires. » Plante et Cité.
De même, l‘institut technique Plante et Cité, même s’il ne participe pas à l’intégralité du
processus d’innovation, contribue activement à la recherche et à la diffusion d’innovations
dans la filière.
« Je pense que de l'innovation, on en apporte effectivement, activement dans certains de
nos programmes, et par notre mission de diffusion, on est aussi facteur de l'innovation à
différentes échelles, j'aime à le croire en tout cas. » Plante et Cité.
A contrario, les entreprises de paysage sont rarement à l’origine d’innovation, en particulier
les petites structures qui représentent la majorité des entreprises du secteur. Les motifs
évoqués sont la résistance au changement et la perception de haute-technologie que véhicule
l’innovation et qui n’a pas de sens pour des artisans paysagistes.
« Pour les entreprises, vu le mal qu’ils ont eu à l’UNEP, d’après ce que j’ai entendu
dire, pour pousser les gens à faire de l’innovation, ce n’était pas un monde prêt à voir
ce que peut apporter l’innovation, ils ne sont pas tous comme ça. Alors les grosses
entreprises, qui ont plus de contact avec les gros donneurs d’ordres, certainement
qu’elles y voient un intérêt. » Ingécole.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
39
c) LES LIMITES AU DEVELOPPEMENT DE L’ INNOVATION
DANS LA FILIERE PAYSAGE
Le premier frein à l’innovation dans la filière est une mauvaise connaissance de l’innovation
et un manque de définitions partagées.
« Autour de la table dans le jury [du concours innovation des entreprises du paysage],
il y avait, pour certains, des professionnels de la filière, et qui, eux-mêmes étant déjà
dans des entreprises déjà à la pointe de leur activité, étaient parfois un peu sévères sur
ce qui était proposé en disant : « Tout le monde fait déjà ça, ce n'est pas innovant ».
Alors ça repose encore une fois cette question : qu'est-ce que l'innovation ? Sur quelle
échelle on se place ? Et est-ce qu'un projet proposé n'est peut-être pas innovant
mondial ou national mais peut-être au niveau régional en proposant cette façon de
faire, ou en développant leurs propres solutions pour répondre à une nouvelle
demande ? » Plante et Cité.
Lors de la réunion budgétaire au sein de Val’hor, un pépiniériste représentant le syndicat
professionnel des producteurs de pépinière (FNPHP) exprimait cette idée en réaction à la
présentation d’un appel à projet d’innovations7 : «Pour le CGI, l’innovation va avoir une
définition précise, et nous, notre vision en tant que producteur, c’est beaucoup plus large, ça
peut aller sur l’expérimentation de technologies qu’il y a à l’étranger en France… ».
Au-delà du manque de définition, la résistance au changement est une limite à l’innovation
évoquée dans la filière. Les entreprises de paysage, tout comme certaines petites collectivités,
rencontrent des difficultés à sortir de ce dont elles ont l’habitude. Les entreprises de paysage
7 Appel à projet de FranceAgriMer et du CGI : P3A « Innovation et compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires ».
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
40
sont peu proactives, et l’adoption d’innovations se fait généralement en réaction à une
pression externe forte (client, législation, problématique insoluble…).
« Dès lors qu’on propose quelque chose dont ils n’ont pas l’habitude de se servir, il faut
que le point de non-retour soit atteint pour qu’ils pensent à chercher autre chose, et là,
ils repensent à ce qu’on a pu se dire et ils reviennent pour qu’on leur propose autre
chose. » Cautry Distribution.
Lors de la conférence sur l’innovation en matière d’entretien des espaces verts sans
substances chimiques, les témoignages de collectivités de tailles distinctes (respectivement
6 000 habitants à Courdimanche, et 85 000 à Versailles) renforcent cette idée d’innovation
sous contrainte. En effet, suite à la règlementation sur l’interdiction de l’emploi de produits
phytosanitaires, ces collectivités ont dû changer leurs habitudes et redoubler d’inventivité
pour répondre aux problématiques de leur territoire en matière d’entretien.
Mais une pression externe trop forte peut également annihiler toute initiative d’innovation.
Dans ce verbatim, notre interlocuteur nous explique comment les renforcements
règlementaires démotivent les collectivités publiques à trouver de nouvelles solutions sur leur
territoire :
« Il faut que les décideurs soient acculés, qu’ils disent « on ne sait plus comment
faire ? », que ce soit sur des grosses villes ou des moyennes villes. Parce que tout est
règlementé, on n’a plus le droit de dépasser 1cm derrière la clôture parce que là on est
en zone protégée. On ne sait pas protégée de quoi, mais elle est protégée ! Du coup, on
ne fait rien. Ce sont des broutilles règlementaires qui annihilent toute l’innovation qu’il
pourrait y avoir au niveau du paysage. » Ingécole.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
41
Les entreprises qui n’adoptent pas ou peu d’innovations invoquent des causes diverses de
manques, internes à leur structure : manque de compétences, de ressources financières ou de
temps.
Le manque de certaines compétences semble freiner la diffusion d’innovations. Dans cet
exemple, un chef d’entreprise d’une cinquantaine d’années, peu à l’aise avec l’utilisation de
l’outil informatique, n’investit pas dans un logiciel qui pourrait pourtant résoudre certaines de
ces problématiques :
« Avec les équipes, on a encore la communication papier, mais ça va venir un jour, ils
auront leur tablette. Les gars ils remplissent tous les jours une feuille, après on
enregistre dans le logiciel. Mon souhait, ça serait qu’ils rentrent ça directement dans
l’ordinateur. On n’en n’est pas là pour nous, mais ça existe déjà. L’évolution viendra
dans les entreprises, car la nouvelle génération est très à l’aise avec ça. » Guislain
Paysage, 10 salariés.
Par ailleurs, l’innovation est perçue comme très coûteuse financièrement, et les éventuels
retours sur investissement ne sont pas toujours envisagés. Le manque de ressources
financières est un argument fréquent des entreprises de paysage de toute taille pour expliquer
leur rejet de l’innovation.
« J’ai pensé à intégrer cette innovation dans mon entreprise, mais je suis trop petit pour
me payer ça, donc pour l’instant je fais ça à l’ancienne. » Urielle paysage, 5 salariés.
Enfin, le manque de temps est également une lacune avancée par les entreprises de paysage
qui n’innovent pas.
« On n’est pas intéressé par le concours innovation, pour le moment en tout cas. J’ai vu
qu’il y avait une petite dizaine d’innovations qui avait été sélectionnées, reconnues,
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
42
mais voilà, on n’en a pas parlé. On n’a pas eu un échange sur ce sujet-là, parce qu’on a
trop régulièrement le nez dans le guidon et donc on ne prend parfois peut-être pas assez
de hauteur non plus sur ce genre de choses. » Honorine paysage, 198 salariés.
Afin de pallier ces manques, l’institut technique Plante et Cité est capable d’aider les
entreprises à innover sur certains sujets. Mais les craintes liées à la concurrence empêchent les
entreprises de s’investir entièrement dans ces démarches collaboratives.
« Dans les entreprises, on sent qu'il y a aussi des choses, on a plusieurs fois fait des
enquêtes, mais c'est plus difficile pour une entreprise de lâcher un petit peu son savoir
parce que c'est ce qui lui apporte un avantage concurrentiel, donc ça on le comprend
parfaitement. Que chacun garde sa part d'infos confidentielles, ce n'est pas antinomique
avec une recherche collective sur un sujet. » Plante et cité.
d) CONCLUSIONS
Cette étude exploratoire met en lumière une difficulté pour les entreprises de paysage à
innover. En effet, d’un côté, elles rencontrent un certain nombre de lacunes à innover seules,
et d’un autre, les craintes de la concurrence et les difficultés à s’accorder sur une définition
partagée de l’innovation freinent l’innovation collective.
La plupart des entreprises de paysage sont de petites entreprises artisanales (95% des
entreprises de paysage se composent de moins de 10 salariés8). Dans ces entreprises, Foucard
(2008, p. 399) considère que l’innovation ne peut « être développée par des entreprises
isolées, ne pesant pas suffisamment lourd pour solutionner les problèmes techniques et assurer
la promotion du produit ». Ainsi, l’entreprise isolée aura rarement le temps, les moyens et les
compétences pour assurer seule le développement et la diffusion d’une innovation. De plus,
8 Chiffres UNEP 2013
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
43
les entreprises de paysage souhaitant innover sont des PME qui n’ont pas le réseau des
grosses entreprises. L’innovation individuelle se heurte à de nombreux handicaps que le
collectif peut surmonter. Ainsi, nous focaliserons notre étude sur l’innovation collective dans
les entreprises de paysage à travers l’étude du cas De Natura et tenterons de mettre en lumière
le rôle que le syndicat professionnel a joué dans cette innovation.
2) ETUDE DE CAS DE NATURA
a) PRESENTATION DE L’ INNOVATION
De Natura est « le premier fonds de dotation dans le métier du paysage ». Ce fonds de
dotation est destiné à promouvoir la biodiversité en soutenant la protection des espèces
végétales et animales menacées.
Le fonds de dotations est une structure apparue en France en 2008 se situant à la frontière
entre l’association et la fondation. Le fonds de dotations permettant de recueillir des fonds à
des fins d’intérêt général, soit en accomplissant une mission ou en finançant un autre
organisme d’intérêt général. Les premiers projets de De Natura s’orientent vers un
financement d’autres organisations (Géode, l’association CRBA et l’institut Vavilov) et vers
l’animation autour du feutrage de la laine.
b) STRUCTURE DU RESEAU DE NATURA
La constitution du réseau d’innovation De Natura a débuté à partir de l’idée de Monsieur
Feugère, dirigeant de Plaine Environnement qui souhaitait sensibiliser à l’extinction de la race
de brebis Solognot, particulièrement rustique et adaptée à la gestion pastorale des espaces
verts. Considérant qu’il aurait du mal à y parvenir seul, il décide de s’associer avec d’autres
entreprises de paysage sensibles à la question.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
44
« Je me suis dit qu’on pouvait faire de belles choses, mais que seul, ça allait être
compliqué, donc il fallait que je trouve éventuellement quelques confrères qui avaient
une démarche plus ou moins identique à la nôtre pour développer un peu ce
pastoralisme dans nos entreprises au niveau national. »
• Combinaison d’homogénéité et d’hétérogénéité des compétences
- L’UNEP, facilitateur dans le réseau De Natura
Les entreprises à l’origine de De Natura sont des entreprises de paysage assez homogènes : ce
sont des PME spécialisées dans l’éco-pastoralisme. Impliquées au bureau de l’UNEP, c’est là
qu’elles ont appris à se connaître et à développer ensemble un intérêt commun pour l’éco-
pastoralisme.
« Ceux qui ont cru le plus en moi, c’étaient mes collègues avec qui, à l’époque, j’étais
au bureau national de l’UNEP, qui eux, croyaient réellement au fait que cette activité
était certainement une des possibilités d’avenir et de mise en marche dans la
profession.[…] L’intérêt de s’investir dans l’UNEP, même si souvent on se dit qu’on a
pas trop de temps et qu’on a parfois l’impression de perdre son temps, c’est de prendre
le temps de dialoguer avec ses collègues, ça permet de prendre le recul et de grandir. »
Leur rapprochement a été d’autant plus fort que leur démarche était unique dans le contexte
de la filière paysage française, et que l’acceptation de cette activité par les autres entreprises
de paysage était médiocre.
« Après, ce qu’il faut savoir, c’est que par rapport au commun des mortels de la
profession, c’était plutôt une activité qui n’était pas très bien accueillie parce que le
chef d’entreprise lambda considérait que ce n’était pas notre métier en fait. »
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
45
- Les compétences métiers de différentes filières
Il apparaît que le réseau se fonde sur des entreprises qui ont un intérêt commun autour de la
compétence métier qu’elles partagent. Les compétences métier détenues par ces entreprises
sont donc similaires et concernent l’éco-pastoralisme.
« Alors en fait, avec les collègues avec qui on a cherché à travailler ensemble sur le
sujet, on était sur des marchés identiques. C’est-à-dire qu’on est tous AFAQ 26000, on
est tous « Experts jardins9 » bien évidemment, et on a tous une sensibilité sur le fait de
dire qu’on devait être garant de la biodiversité. »
Mais les compétences métier nécessaires à l’aboutissement de la démarche d’innovation
devaient être complétées par des compétences en génétique ovine et en botanique. Ainsi, bien
que ne pouvant pas s’intégrer directement au fonds de dotation, le concours de Géode s’est
avéré nécessaire. La coopération avec ces organisations est donc effective, mais tacite.
« *Pourquoi avoir choisi de coopérer avec d’autres entreprises de paysage ? Pourquoi
pas avec d’autres entreprises plus tournées vers l’animal ?
Bah si en fait, à la base de notre démarche, notre coopérative de génétique était partie
prenante. Mais cette coopérative de génétique, dans notre démarche, est un outil dont
on peut avoir besoin, et le problème qu’on avait c’est que si elle devenait
administrateur, elle ne pouvait plus donner de fonds, donc on se coupait de pouvoir
amener des races pour les organiser en termes de génétique ».
Ainsi, le réseau De Natura intègre des partenaires de différentes parties de la triple hélice :
l’hélice entreprise, avec les entreprises de paysage ; et l’hélice recherche avec l’institut
Géode.
9 Marque créé par l’UNEP permettant aux maîtres d’ouvrages d’identifier les professionnels du paysage
formés et respectueux des règles de l’art de la profession.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
46
- Les compétences managériales
Puis, de nouvelles compétences managériales ont été requises au fil du processus
d’innovation, et l’intégration d’un spécialiste en droit de l’environnement s’est avérée
nécessaire.
« On a intégré un cinquième larron10, un ami de notre collègue de Lyon, qu’on appelle
« notre avocat », qui est spécialisé en droit de l’environnement. C’est lui qui nous a bâti
le projet, et du coup, on lui avait demandé à l’époque s’il ne voulait pas entrer en tant
qu’administrateur, ce qu’il a accepté. »
Pour finir, le réseau a dû recourir à Bang communication, une entreprise de communication,
pour réaliser la publicité et le site internet pour De Natura. Cette entreprise est intégrée au
réseau par un lien de marché, tout comme l’Atelier de la bruyère, qui réalise des mascottes
miniatures. Comme nous le verrons dans la suite, cet atelier a également permis de
développer de nouvelles compétences au sein du réseau
Tableau 4 : Bilan de la composition et relations entre les membres du réseau.
CF : Coopération Formalisée, CT : Coopération Tacite, M : lien de Marché
Ainsi, sans appartenir au réseau d’innovation directement, l’UNEP a toutefois permis la
diffusion de l’innovation grâce à la communication réalisée autour de l’évènement
10 Ici, larron n’est pas utilisé dans son sens premier du voleur ou du brigand, mais fait en effet référence à l’expression « s’entendre comme larrons en foire », c’est-à-dire s’entendre à merveille.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
47
« Concours innovation des entreprises de paysage » sur le site internet11, dans des flyers et par
le biais de la revue de l’UNEP « En vert et avec vous » (n°3).
• Accumulation des actifs
Le réseau De Natura visait dès l’origine un effet de taille, c’est-à-dire que c’est
l’accumulation d’actifs, et non leur complémentarité, qui était recherchée.
- Ressources financières et temporelles
Tout d’abord, la première ressource indispensable à la concrétisation du projet était
financière. Les fonds ont été apportés par les entreprises de paysage de façon équitable.
Aucun autre apporteur de fond n’a été intégré au projet.
« On a dû mettre 5 000€ chacun au départ, ça fait 20 000€ à 4, si j’avais été seul il
aurait fallu mettre 20 000€ au départ, donc voilà c’est la répartition des coûts. »
De plus, la ressource temps semble être une ressource à part entière dans ce réseau, et, là
encore, c’est l’effet cumulatif qui intéressait ses membres.
« Déjà qu’à 4 ce n’est pas facile, donc seul, ça aurait été encore plus compliqué.
Comme je le disais, dans nos entreprises, on est tous multitâches, en plus c’est vrai avec
tout ce qu’on doit faire aujourd’hui, c’est quand même un peu plus complexe qu’il y a
plusieurs années, on passe plus de temps dans nos affaires, donc en effet, créer ce fonds
de dotation ça donnait envie, mais seul, même avec l’aide avec les collaborateurs ici12
qui sont déjà largement occupés, ça aurait été en effet compliqué. On s’en rend bien
11 Disponible à l’adresse : http://www.concours-innovation-paysage.com/les-nomin%C3%A9s/ Consulté le 04/12/2014. 12 Désigne les salariés de l’entreprise Plaine Environnement.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
48
compte, même en étant 4 entreprises qui s’entendent bien et qui sont prêtes à donner du
temps, on se rend compte déjà que ce n’est pas simple, donc seul… »
Ces deux premiers types de ressources sont indispensables pour le déroulement du processus
d’innovation et leur absence ont agi comme un frein. Les ressources financières et temporelles
se sont comportées comme des facteurs limitants dans le développement de De Natura.
« On n’a pas de reproches à se faire, on a fait avec les moyens qu’on avait. Si on avait
la chance d’avoir plus de moyens, on irait plus vite mais on le fait avec nos moyens et
ça n’avance pas si mal. Même les gros groupes ont du mal à croire qu’on a pu créer ce
fonds avec 4 petites PME, ça veut dire qu’on n’est pas si mauvais que ça [rire]. »
- Ressources relationnelles
La particularité de ce réseau innovant est la répartition de ses membres sur le territoire
français. En effet, la plupart des études portant sur les réseaux d’innovation se concentre sur
des clusters ou des pôles de compétitivité, ce qui n’est pas le cas ici.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
49
Figure 9 : Répartition des entreprises de paysage membres du réseau De Natura sur le territoire
Français
Cette particularité est un atout pour le réseau. En effet, chaque zone géographique est un
réservoir de connaissances et de contacts que possède l’entreprise qui l’occupe, et ce sont
autant de relations potentielles avec De Natura.
« Tout le monde a en effet œuvré dans le même sens mais chacun à sa façon, dans sa
région, avec ses relations. »
Cette présence sur le territoire permet, une fois de plus, un effet cumulatif amplifiant la
diffusion de l’innovation.
« Pour que notre action pèse, il fallait déjà qu’elle ait une couverture nationale sur le
territoire, ce qui nous a donné la force là de l’avoir puisqu’en se regroupant à 4, ça
nous permet pratiquement de couvrir les ¾ du territoire national, alors que si j’avais
été seul, à part couvrir l’Ile-de-France, je n’aurais pas été plus loin. »
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
50
- Ressources physiques
Cette répartition des entreprises sur le territoire français n’est pas sans conséquence sur
l’organisation du travail. Bien que capables de travailler à distance, les entreprises ont besoin
de se retrouver physiquement régulièrement. La ville la plus adéquate pour cela est Paris,
accessible facilement par tous en transports en commun. Les locaux sont donc mis à
disposition par l’avocat, qui possède un cabinet à Paris.
« On a une réunion téléphonique par mois et on a une réunion physique par mois sur
Paris. Du coup on se réunit…. Notre avocat a un cabinet à Lyon et un cabinet à Paris,
donc on se réunit une fois par mois à son cabinet à Paris, dans le centre de Paris. »
• Acquisition d’actifs et de compétences
L’apparition de difficultés a permis le développement de compétences au sein du réseau. Ces
difficultés agissent comme des contraintes motrices : les limites imposées par le statut
juridique du fonds de dotation ont permis aux entreprises de redoubler d’imagination pour
trouver des solutions permettant de contourner ces limites.
« En fait, ce qu’il faut savoir, c’est que tout est permis globalement dans un fonds de
dotation, sauf qu’une collectivité ne peut pas alimenter directement un fonds de
dotation,, c’est la seule interdiction qu’on ait. Alors après, il y a des moyens dérivés j’ai
envie de dire. On a fait des miniatures, la collectivité va en acheter, on est en train de
regarder mais a priori elle peut acheter directement à De Natura, mais elle ne peut pas
faire de dons directement. »
Grâce à des moutons miniatures, l’entreprise dispose d’un moyen de communication
singulier, mais ceux-ci permettent avant tout de contourner les difficultés rencontrées.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
51
Mais la compétence acquise va bien au-delà de la co-construction d’idées créatives. En
associant cette idée à un autre problème rencontré dans leurs entreprises, les membres du
réseau ont pu réellement développer un nouveau savoir-faire avec l’aide d’un partenaire
extérieur : Les Ateliers de la Bruyère.
« On savait qu’il y avait quelque chose à faire avec la laine, mais on ne savait pas quoi.
Voilà ce qu’on peut faire13, ça par exemple, c’est une idée d’un de mes collègues de
Lyon. Ces animaux qui sont des races en voie de disparition et « soit disant » ne valent
rien. Finalement, on se rend compte que cette race de brebis a une qualité de laine qui
est bonne, voire très bonne. On s’est rendu compte qu’il fallait revaloriser chaque
chose sur ces animaux et montrer que malgré qu’ils soient en voie de disparition, il y a
plein de choses à faire avec. »
La laine des brebis est passée de statut de déchet à ressource : elle est un actif endogène. C’est
la laine récupérée dans les entreprises qui est la matière première des miniatures fabriquées.
Par ailleurs, l’acquisition de compétences requiert l’acquisition de nouvelles ressources qui
auraient été inutiles au début du processus d’innovation.
« Les gens ne savent pas ce que c’est que la feutrine et ne savent pas que la masse de la
matière première est de la laine. On a une fileuse ici, on va développer avec l’entreprise
qui nous fabrique les miniatures, de l’animation. Aujourd’hui, moi j’ai été chercher une
fileuse qu’on va mettre à disposition des entreprises si elles ont besoin… enfin voilà, on
va développer d’autres choses. »
13 A ce moment-là, Monsieur Feugère nous tend un petit mouton en laine
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
52
• Conclusion sur la structure du réseau De Natura
Figure 10 : Schéma de bilan sur les composantes du réseau inter-organisationnel.
En noir : hélice entreprise ; en bleu : hélice recherche.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
53
c) FONCTIONNEMENT DU RESEAU INTER-
ORGANISATIONNEL INNOVANT
• La coopération des organisations
- La confiance
Les relations entre les membres du réseau De Natura sont clairement amicales, en témoigne le
vocabulaire utilisé : « larron », « ami », « s’entend bien », « un plaisir ». De plus, ils
partagent un certain nombre d’intérêts et de valeurs qui renforcent cette relation : « démarche
identique », « on a tous une sensibilité », « même activité » ; d’autant plus qu’ils semblent être
marginaux au sein de la filière paysage, ce qui les rend semblables dans leur différence : « en
marge », « extraterrestre », démarche ne s’avérant « pas très bien accueillie par le chef
d’entreprise lambda ».
La confiance au sein du réseau inter-organisationnel étudié est très développée et centrée sur
les personnes individuelles qui se connaissent et s’apprécient. Nous nous trouvons face à un
exemple de confiance personnelle.
Mais, ce type de confiance n’est peut-être pas exclusif. En effet, non seulement il ne s’agit pas
de la première relation de coopération entre les membres du réseau : ils se sont déjà « prêté
des bêtes » et « donné du temps », leur confiance peut également être construite par des
relations antérieures.
Mais en plus, toutes les entreprises sont des membres actifs de l’UNEP. Le syndicat peut
jouer un rôle de tiers de confiance inspirant une confiance institutionnelle, mais peut
également être à l’origine d’une intégration culturelle garantissant la confiance entre les
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
54
membres du réseau. En effet, si l’un d’entre eux se montrait opportuniste, ce dernier perdrait
beaucoup : des amis, sa réputation au sein de l’UNEP…
La confiance ressentie peut-être, inconsciemment, une combinaison entre les trois types de
confiance : personnelle, relationnelle et institutionnelle.
- Le contrôle
Même si le fonds de dotation impose un minimum de contractualisation entre les membres
constitutifs, l’entretien met en exergue que le contrôle contre l’opportunisme est informel et
s’appuie davantage sur des normes sociales liées aux relations interpersonnelles, et tient
même de valeurs partagées.
« Ça a pris 6 mois à peu près. […] Ce qui étonne [les autres entreprises], c’est qu’on
puisse s’être regroupé à 4, et après, ce qui les étonne, c’est la vitesse avec laquelle on a
mis ça en place : « nous ça fait des années qu’on essaye de mettre ça en place mais on y
arrive pas », bah oui mais s’ils n’y arrivent pas c’est parce qu’il y en a toujours un qui
est plus malin que son voisin et qui veut s’accaparer le sujet. On en revient toujours à
ce problème-là d’individualisme. Quand on veut tout ramener à soi, on voit bien, on ne
s’en sort pas. »
Ce type de contrôle est largement facilité par le caractère non marchand de l’innovation et la
confiance personnelle très forte entre les entreprises.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
55
- La coopétition
Distance géographique et concurrence
La coopétition intervient lorsque des entreprises entrant en concurrence coopèrent. De prime
abord, même si les entreprises travaillent sur le même marché avec la même activité, elles
n’apparaissent pas concurrentes de par leur éloignement géographique.
« La partie innovante de notre projet c’est de démontrer que 4 entreprises d’une même
activité peuvent se regrouper et que l’aspect concurrentiel à un moment il faut le laisser
de côté. Alors même si là on est éloigné par les distances, il y a quand même une idée
commune qui valorise nos entreprises et, en effet, on pourrait se dire que c’est mieux de
le faire seul qu’à plusieurs. Mais je pense que seul, ça n’aurait pas le même impact et la
même qualité que ce qu’on peut lui apporter aujourd’hui. »
Mais depuis peu, suite au rachat de l’entreprise Tarvel par un gros groupe d’aménagement
urbain (SEGEX), les zones de chalandise de deux partenaires se chevauchent. Le concept de
coopétition pourrait donc être mobilisé, mais pourtant, cette situation n’est pas envisagée
comme telle au sein de ces entreprises qui travaillent également ensemble dans le cadre de
leur activité marchande.
« *Auriez-vous développé De Natura avec d’autres entreprises installées sur la même
zone de chalandise que vous ?
Bah oui, parce qu’aujourd’hui, Tarvel a été vendu au groupe SEGEX et on développe le
pastoralisme en Ile de France avec SEGEX. Enfin, je ne sais pas, c’est pareil, à partir
du moment où on maîtrise son savoir-faire, moi j’ai envie de dire que la concurrence ne
me fait pas peur à partir de là. »
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
56
Une confiance aveugle mais pas aveuglante
La compétition, à l’intérieur même du réseau, semble complètement absente. Remarquons que
le caractère non marchand de l’innovation joue sans doute en faveur de cette attitude.
« Personne ne cherche à savoir qui a eu l’idée en premier, et c’est ce qui est
intéressant. La plus belle idée c’est d’avoir mis ça en commun et de l’avoir fait évoluer
comme on l’a fait évoluer. »
Dans le cas de De Natura, l’absence de compétition et la confiance excessive qui existe entre
les entreprises de paysage n’annoncent pas pour autant des risques de myopie stratégique. En
effet, d’autres partenaires, moins proches et aux compétences distinctes, permettent de réguler
cette relation et de mettre en exergue les problèmes avant qu’ils n’apparaissent.
« A la base de notre démarche, notre coopérative de génétique était partie prenante,
[…] mais on a abandonné, grâce à notre avocat qui nous a dit « Si vous intégrez Géode
dedans en tant qu’administrateur, le fond de dotation ne pourra pas alimenter Géode
pour la mise en place de structuration de génétique, donc il ne faut pas le faire ». »
• La gouvernance du réseau
La structuration du fonds de dotation nécessite une gouvernance interne via l’élection d’un
président.
« Il y a un président qui est Benoît Lambray, de chez Tarvel, et puis après il y a un
trésorier, un secrétaire, ça c’est moi. »
Pourtant, le discours semble plutôt se diriger en faveur d’une gouvernance décentralisée. Tout
est mutualisé : les idées, les décisions… Il ne semble pas y avoir de chef, et les difficultés sont
discutées ensemble, sans conflit.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
57
« Avec mes partenaires directs, nous n’avons eu aucun conflit. Au contraire, c’est plus
un plaisir de pouvoir faire voir le jour à ce projet tous ensemble. »
Cela est rendu possible grâce, d’une part, à un réseau dans lequel les acteurs sont peu
nombreux et se connaissent bien, et, d’autre part, car il n’y a pas de rapport de force entre les
membres : tout est équitable et juste. Les entreprises ont apporté la même ressource financière
au départ, le travail est réparti de façon équilibrée, toutes les idées sont prises en compte et
chacun est libre de travailler comme il l’entend dans sa région.
« Finalement, chacun dans sa région a plus ou moins la même charge de travail
puisque si on veut que ça avance, chacun doit, sur sa région, développer à sa façon, y’a
pas de méthode […]. Quand on a des idées, on les met au milieu de la table, et chacun,
quand il rentre chez lui, voit… Il y a un de mes collègues qui m’a envoyé un mail hier
pour me dire : « tiens, on pourrait faire une émission sur TF1, est-ce que ça te branche.
-Pas de problèmes, on y va ! ». »
• Conclusion sur le fonctionnement du réseau inter-organisationnel
Le fonctionnement du réseau de De Natura est régi par l’ambiance amicale et de confiance qui
règne dans le groupe. La confiance est majoritairement interpersonnelle et le contrôle tacite.
Le contrôle tacite ne créé pas de défiance qui pourrait altérer la confiance.
La contractualisation entre les membres existe et n’est pas remise en question puisqu’il s’agit
de l’organisation même d’un fonds de dotation, mais la présence de partenaires solides hors
de cette contractualisation tend à montrer qu’elle ne joue pas de rôle dans la confiance ou
dans le contrôle.
Enfin, la compétition entre les membres est absente du réseau, et plusieurs raisons
apparaissent à cela : l’éloignement géographique, la confiance personnelle (ou intuitu
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
58
personae), le contrôle tacite, et ce que Monsieur Feugère appelle « un esprit ouvert », c’est-à-
dire un état d’esprit contraire à l’individualisme et une forte conviction qu’« ensemble, on est
plus fort que tout seul ». L’absence de coopétition est également facilitée par le caractère non-
concurrentiel de l’innovation.
Dans ce fonctionnement, l’UNEP n’a joué aucun rôle particulier, mais l’adhésion et
l’implication de l’ensemble des membres principaux n’a fait que renforcer la confiance.
Figure 11 : Bilan du fonctionnement du réseau inter-organisationnel De Natura
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
59
d) CONCLUSION DE L’ ETUDE DE CAS
• Le rôle de l’UNEP dans le processus d’innovation de De Natura
L’UNEP, sans avoir été impliquée directement dans le processus d’innovation de De Natura a
joué un rôle de facilitateur à plusieurs niveaux : lors de la structuration et dans la coopération.
Tout d’abord, elle a permis aux entreprises de paysage de régions variées de se rencontrer, de
s’apprécier et de partager un certain nombre d’intérêts communs. Cela a été créé grâce à une
implication commune au bureau national, mais également par le congrès national annuel et le
salon Paysalia, qui permettent de perfectionner leurs connaissances techniques, mais
également de participer à des évènements socialisants (soirées, activités…).
Ensuite, elle a permis de renforcer la confiance entre les membres, tous adhérents, par le
partage de valeurs communes qu’elle véhicule. En effet, l’adhésion des entreprises n’est pas
obligatoire et n’est pas automatique : elle est à l’initiative de l’entreprise qui renouvelle
chaque année son adhésion. L’adhésion est payante et est fonction du chiffre d’affaires des
entreprises. L’aspect financier de l’adhésion amène donc les entreprises ne partageant pas les
valeurs véhiculées par l’UNEP à ne pas renouveler leur adhésion.
L’UNEP a aussi été un vecteur médiatique important puisque l’innovation a participé et a été
nominée au concours innovation des entreprises de paysage. L’innovation a donc été
présentée lors du congrès national en octobre 2014 et dans différentes documentations
publiées par l’UNEP (flyers, site internet…).
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
60
IV. DISCUSSION
1) PORTEE DE RESULTATS
D’un point du vue du contexte, les entreprises de paysage sont en grande majorité de petites
PME artisanales et souvent familiales. Elles sont représentées et défendues par le syndicat
professionnel des entreprises du paysage, l’UNEP. Les résultats et contributions apparaissent
transposables à des « contextes parents » (Passeron, 2006), c’est-à-dire, dont la typologie est
proche du contexte étudié. Nos résultats semblent donc applicables à d’autres secteurs
artisanaux traditionnels.
Concernant l’innovation De Natura en particulier, sa nature rend les résultats idiosyncratiques,
sans visée de généralisation. En effet, De Natura est l’application d’un procédé existant dans
un nouveau domaine, ce qui en fait une innovation incrémentale. Mais de plus, il s’agit d’une
innovation organisationnelle sans rapport de concurrence, ni avec les membres du réseau
inter-organisationnel dans lequel elle est née, ni avec d’autres organisations : la visée d’un
fonds de dotation étant l’intérêt général et non individuel.
Ces spécificités rendent les résultats obtenus peu généralisables mais toutefois valides et
intéressants dans le cadre de notre question de recherche : Comment un syndicat professionnel
peut-il jouer un rôle de facilitateur dans un réseau inter-organisationnel innovant ?
2) CONTRIBUTIONS, LIMITES ET VOIES DE RECHERCHE
a) LE SYNDICAT PROFESSIONNEL COMME ACTEUR TIERS
Les partenaires ne sont pas tous intégrés au réseau inter-organisationnel de façon formelle.
C’est le cas, par exemple de l’UNEP, qui est resté en dehors du processus d’innovation De
Natura, mais qui y a pourtant joué un rôle : l’UNEP a tenu le rôle d’acteur tiers. Pour Geindre
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
61
(2005), le syndicat professionnel, en tant qu’acteur tiers, doit intervenir à trois niveaux dans
les réseaux stratégiques : (1) il initie la relation, (2) inspire confiance en apportant des
garanties et (3) il facilite le déroulement du processus de mise en place des relations des
organisations membres du réseau. Dans le cas de De Natura, l’UNEP a permis (1) la mise en
relation des membres. De plus, en étant (2) un tiers de confiance, il a apporté une confiance
institutionnelle (Zucker, 1986) et une intégration culturelle (Fréry, 1997). Mais (3) il n’a pas
participé aux échanges entre les membres pendant le processus de De Natura. En revanche, il
a eu ainsi un rôle de médiatisation, que Geindre (2005) n’a pas soulevé, en diffusant
l’information concernant l’innovation dans la profession.
Cela nous amène donc à considérer quatre actions distinctes :
- Initiation de la relation entre les membres
Dans des filières et secteurs d’activités artisanaux, les entreprises peuvent se regrouper au sein
d’un syndicat professionnel afin de ne pas se sentir isolées. Le syndicat professionnel est un
moyen de rencontrer ses confrères et de partager des intérêts pour des questions communes.
Cette mise en contact est nécessaire dans la structuration d’un réseau d’innovation. La
connaissance personnelle des adhérents peut passer par le partage d’évènements festifs. Cette
connaissance des membres est importante pour s’entourer des « bons » partenaires, c’est-à-
dire, des partenaires qui auront les compétences et les ressources nécessaires au processus
innovant.
Ce rôle semble bien poursuivi par l’UNEP, en témoigne l’expérience des membres du réseau
De Natura.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
62
- Média dynamisant au sein de la profession
Le syndicat peut être un moteur de l’initiative d’innovation en valorisant les démarches
innovantes de ses adhérents par voie médiatique : concours innovation, articles de presse,
colloques, tables rondes…
L’UNEP a commencé à développer ce rôle dès 2013 par l’intermédiaire de la Commission
Innovation et Expérimentation, et en lançant des actions telles que le concours innovation des
entreprises du paysage et la publication du guide pratique de l’innovation.
L’innovation De Natura a profité de cette médiatisation pour faire sa promotion, mais le
processus d’innovation n’a pas été directement la conséquence d’une telle communication.
Les retours étant peu nombreux, il pourrait être intéressant de mesurer l’impact de telles
campagnes de médiatisation sur le dynamisme d’une profession artisanale traditionnelle en
matière d’innovation.
- Garant de confiance
Le syndicat professionnel est également un tiers de confiance facilitant la coopération : les
adhérents sont soumis à un certain nombre de normes professionnelles, formalisées ou tacites,
qui instaurent le respect entre eux.
Les organisations membres du réseau-inter-organisationnel De Natura sont des membres
« extraterrestres » pour reprendre leur expression, c’est-à-dire extraordinaires parmi les
entreprises de paysage, et se caractérisent par une forte implication dans l’UNEP qui a conduit
à un lien amical fort. Ce cas est, par conséquent, particulier, et si la filière paysage entend
innover davantage, les organisations s’investissant dans l’innovation devront être plus
nombreuses, et plus communes. Il est possible d’envisager que pour des entreprises qui
seraient moins investies à l’UNEP, la confiance et l’intégration culturelle apportée par ce
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
63
syndicat professionnel seraient bien moindres, voire inexistantes. Par ailleurs, toutes les
entreprises de paysage ne sont pas adhérentes à l’UNEP. Celles-ci doivent-elles pour autant
être écartées des réseaux inter-organisationnels à même de se former ?
Notre étude ne permet pas de comprendre précisément les causes qui ont rendu les membres
de De Natura particulièrement concernés par l’UNEP. Par conséquent, étudier les facteurs
impactant le degré de prise en compte du syndicat professionnel comme tierce partie, et ainsi
en comprendre les leviers, pourrait être une voie de recherche intéressante pour l’avenir.
- Facilitateur relationnel pendant le processus d’innovation
Cette fonction n’a pas du tout été assurée par l’UNEP dans le cas De Natura mais pourrait être
une voie de développement future. Pour Geindre (2005), ce rôle regroupe trois actions :
renégocier systématiquement les objectifs pour assurer la motivation des parties prenantes
pendant la durée du processus, établir des liens avec le réseau à divers niveaux des
organisations membres et éviter les coopérations sur les points jugés trop concurrentiels.
Concrètement, les actions à envisager par les syndicats professionnels au cours de processus
d’innovation au sein de réseaux inter-organisationnels de sa profession peuvent être :
� Organiser et participer à des comités de pilotage du processus d’innovation,
� Proposer des rencontres entre les salariés des différentes organisations membres du
réseau : conférence ou réunion d’informations suivie d’un cocktail par exemple,
� Orienter les projets vers des thématiques non concurrentielles.
Le syndicat professionnel peut être acteur tiers, comme nous venons de le décrire et comme
l’exemple de l’UNEP l’a montré. Mais le syndicat professionnel pourrait également être partie
prenante du réseau inter-organisationnel en s’impliquant directement dans le processus
d’innovation.
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
64
b) LE SYNDICAT PROFESSIONNEL COMME PARTIE PRENANTE
IMPLIQUEE DANS LE PROCESSUS D’ INNOVATION
Das et Teng (1998a) identifiaient quatre types de ressources critiques que le partenaire
apporte à l’alliance : technologique, managériale, physique et financière. Mais les entreprises
de paysage qui innovent requièrent, non seulement ces quatre types de ressources, mais
également d’importantes ressources temporelles et relationnelles. Le cas De Natura nous a
permis de montrer l’importance de ces ressources et de renforcer les premiers résultats
émergeant de nos entretiens exploratoires. Ces ressources, bien que peu spécifiques
(Williamson, 1985), rendent interdépendantes les entreprises qui s’allient au sein de réseaux
inter-organisationnels (Brousseau, 2000).
Notre étude ne permet pas de définir la pertinence d’une généralisation de la criticité des
ressources temporelles et relationnelles au sein d’un réseau d’innovation. En effet, les
entreprises de paysage artisanales montrent des caractéristiques particulières : elles sont de
petites tailles et multitâches. Dans ces conditions, le temps est une ressource rare pour ces
entreprises qui n’ont pas toujours le temps d’accroître leurs champs de relations
professionnelles. Malheureusement, notre étude ne permet pas non plus d’établir un lien direct
entre la recherche de ressources temporelles et relationnelles au sein d’un réseau d’innovation,
et la taille de l’entreprise ou la diversité de ses tâches. Ainsi, il pourrait être intéressant
d’affiner cette question en cherchant à savoir ce que recherchent les entreprises qui s’allient
au sein de réseaux inter-organisationnels innovants en fonction de leur taille et de la diversité
de leur tâches, et tenter ainsi d’établir si la recherche de partage de temps et de relation est
aussi critique que dans notre étude.
Pour les syndicats professionnels, l’identification des ressources identifiées ci-avant comme
autant de besoins pour les réseaux inter-organisationnels de leur profession pourrait être le
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
65
point de départ d’actions concrètes. Dans le cas de l’UNEP en particulier, les actions
pourraient viser à compléter les apports des organisations en ressources dans des réseaux
inter-organisationnels innovants déjà structurés.
Ressource manquante Type de service que pourrait développer l’UNEP pour des réseaux inter-organisationnels déjà développés
Technologique • Aide à la protection intellectuelle des innovations développées sur des sujets concurrentiels,
• Mise en relation avec des partenaires de recherche et développement du paysage (Plante et Cité, ISA, fournisseurs…) et d’autres secteurs d’activités…
Managériale • Gouvernance du réseau. Physique • Prêt de locaux,
• Aide à la recherche de matériel/matériaux spécifiques… Financière • Aide à la recherche de financements publics et privés,
• Appels à mécénat, parrainage et sponsoring, • Veille et aide à la réponse d’appels à projets, • Garant auprès de banques…
Temporelle • Aide dans les démarches administratives. Relationnelle • Mise en relation avec d’autres acteurs de la filière
(maître d’œuvre, maître d’ouvrage…) mais également d’autres secteurs, ou à l’étranger.
Tableau 5 : Actions possibles de l'UNEP sur les ressources des réseaux inter-organisationnels innovants
Mémoire de recherche Charlène LAMBERT - Juin 2015
66
CONCLUSION
Notre étude cherchait à comprendre quel pouvait être le rôle d’un syndicat professionnel dans
un réseau inter-organisationnel innovant artisanal, à travers l’étude du syndicat professionnel
des entreprises de paysage, l’UNEP. Nous avons établi que les principales fonctions
facilitatrices d’un syndicat souhaitant dynamiser sa profession en termes d’innovation étaient
liées à son existence en tant que tiers aux réseaux d’innovations, comme dans le cas de De
Natura, que nous avons approfondi. Pourtant, nous avons aussi mis en lumière que les rôles
du syndicat professionnel pouvaient être plus prégnants si celui-ci s’associait au réseau
comme partie prenante.
Finalement, on peut distinguer deux niveaux de réseaux inter-organisationnels impliquant un
syndicat professionnel. Des réseaux « macro »
dans lesquels le syndicat professionnel est une
organisation partie prenante du réseau, et des
réseaux « micro », dans lesquels le syndicat
professionnel reste tiers du processus
d’innovation, et où ce sont ses adhérents qui
s’allient directement avec d’autres types
d’organisations : centre de recherche, écoles,
fournisseurs...
La place d’un syndicat professionnel souhaitant
faciliter l’innovation au sein de réseaux inter-organisationnels de sa profession a-t-il plus de
poids en restant un tiers à ce réseau ou en en étant véritable partie prenante ?
Figure 12 : Exemples de réseaux initiés
par l'UNEP aux deux échelles "micro" et
"macro"
I
BIBLIOGRAPHIE Alter, N., 2010a. L’innovation ordinaire. s.l.:Presses Universitaires de France.
Alter, N., 2010b. Donner et Prendre : la coopération en entreprise. s.l.:La découverte.
Assens, C., 2003. Le réseau d'entreprises : vers une synthèse des connaissances. Management
international, 7(4), pp. 49-59.
Bernasconi, M., Di Biaggio, L. & Ferrary , M., 2004. Silicon Valley et Sophia Antipolis : les
enseignements d'une étude comparative de clusters de haute technologie. Dans: Management
local et réseaux d'entreprises. s.l.:Economica, pp. 63-89.
Bessy, C. & Brousseau, E., 1997. Brevet, protection et diffusion des connaissances : une
relecture néo intitutionnelle des propriétés de la règle de droit. Revue d'Economie Industrielle,
Issue 79, pp. 233-254.
Blanchon-Caillot, B., 2007. Pratiques et compétences paysagistes dans les grands ensembles
d'habitation. Strates, Issue 13, pp. 2-21.
Boissin, O., 1999. La construction des actifs spécifiques : une analyse critique de la théorie
des coûts de transaction. Revue d'économie industrielle, Issue 90, pp. 7-24.
Brandenburger, A. M. & Nalebuff, B. J., 2011. Co-opétition. New York: Doubleday.
Brousseau, E., 2000. La gouvernance des processus de coopération. [En ligne]
Available at: http://brousseau.info/pdf/EBGovCoop.pdf
[Accès le 06 avril 2015].
Charreire-Petit, S. & Durieux, F., 2014. Explorer et tester. Dans: Méthodes de recherche en
management. Paris: Dunod, pp. 57-80.
Christ, M. H., Sedatole, K. . L., Towry, K. L. & Thomas, . M. A., 2008. When formal controls
undermine trust and cooperation. Strategic finance, 89(7), pp. 38-44.
Das, T. K. & Teng, B.-S., 1998a. Resource and Risk Management in the Strategic Alliance
Making Process. Journal of Management, 24(1), pp. 21-42.
Das, T. K. & Teng, B.-S., 1998b. Between Trust and Control: Developing Confidence in
Partner Cooperation in Alliances. Academy of Management Review, 23(3), pp. 491-512.
II
de La Ville, V.-I., 2000. La recherche idiographique en management stratégique : une
pratique en quête de méthode ?. Finance contrôle stratégie, 3(3), pp. 73-99.
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S., 2012. Collecting an Interpreting Qualitative materials.
London: SAGE.
Desreumaux, A., 1996. Nouvelles formes d'organisation et évolution de l'entreprise. Revue
Française de Gestion, Volume 107, pp. 86-108.
Donadieu, P., 2007. Le paysage, les paysagistes et le développement durable : quelles
perspectives ?. Economie rurale, Volume 297-298, pp. 10-22.
Ehlinger, S., Perret, V. & Chabaud, D., 2007. Quelle gouvernance pour les réseaux
territorialisés d'organisations ?. Revue Française de Gestion, 33(170), pp. 155-171.
Eisenhardt, K. M., 1989. Building theories from case study research. Academy of
Management review, 14(4), pp. 532-550.
Foucart, J.-C., 2008. Filière Pépinière de la production à la plantation. Tec et doc éd. Paris:
Lavoisier.
Fréry, F., 1997. Le contrôle des réseaux d'entreprises : pour une extension du concept
d'entreprise intégrée. Montréal, Actes de Conférence AIMS.
Fulconis, F. & Joubert, J., 2009. Management des pôles de compétitivité et structures en
réseau d'innovation : une analyse de la filière agroalimentaire. Management & Avenir, Issue 5,
pp. 184-206.
Gardet, E. & Mothe, C., 2010. Le rôle des ressources dans la dépendance du pivor au sein de
réseaux d'innovation. Revue Française de Gestion, Issue 5, pp. 171-186.
Geindre, S., 2005. Le rôle de l'acteur tiers dans la construction d'un réseau stratégique. Revue
Française de Gestion, Issue 1, pp. 75-91.
Giordiano, Y., 2003. Conduire un projet de recherche : une perspective qualitative. EMS
Management et Société éd. s.l.:s.n.
Halliday, T. C., Powell, . M. J. & Granfors, M. W., 1987. Minimalist organization : vital
events in state Bar Association. American Sociological Review, Issue 52, pp. 456-471.
III
Hamel, G., 1991. Competition for competence and interpartner learning within International
Strategic Alliances. Strategic management journal, 12(1), pp. 83-104.
Horwitz, A. V., 1990. The logic of Social Control. s.l.:Springer Science & Business Media.
Jolly , D., 2003. Les alliances interentreprises. Dans: L'entreprise élargie : de nouvelles
formes d'organisations. s.l.:Insep Consulting Editions, pp. 59-64.
Jolly, D., 2001. Alliances interentreprises : entre concurrence et coopération. Paris: Vuibert.
Journal Officiel de l'Union Européenne, 2011. Lignes directives sur l'applicabilité de l'article
101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux accords de coopération
horizontale. [En ligne]
Available at: http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26062_fr.htm
[Accès le 16 avril 2015].
Koenig, G., 2004. Management stratégique. Projets, interactions et contextes. s.l.:Dunod.
Laban, J., Giovanelli, D. & Le Huchet, A.-S., 1995. Le réseau dynamique d'innovation,
Puyricard: Etudes et Documents, série Recherche, IAE d'Aix Marseille.
Le Roy, F., Robert, M. & Lasch, F., 2013. Coopérer avec ses amis ou avec ses ennemis.
Revue française de gestion, 39(232), pp. 81-100.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G., 1985. Naturalistic inquiry. s.l.:SAGE oublications.
Loilier, T. & Tellier, A., 2013. Gestion de l'innovation : comprendre le processus
d'innovation pour mieux le piloter. Management et Société éd. s.l.:EMS.
Maillat, D., 1996. Système territoriaux de production et milieux innovateurs. Edition de
l'OCDE, pp. 75-90.
Mangematin, V., 1998. La confiance : un mode de coordination dont l'utilisation dépend de
ses conditions de production, s.l.: hal-00424495.
Miles, M. B. & Huberman, A. . M., 2003. Analyse des données qualitatives. s.l.:De Boek
superieur.
Miles, R. E. & Snow, C. C., 1986. Network organizations : new concepts for new form.
California Management Review, Volume 28, pp. 62-73.
IV
Mitchell, . R. G., 1993. Secrecy and fieldwork. SAGE Publications éd. s.l.:s.n.
Paniccia, I., 1998. One, a hundred, thousands of industrial districts. Organizational Variety in,
19(4), pp. 667-699.
Passeron, J.-C., 2006. Le raisonnement sociologique : un espace non poppérien de
l'argumentation. Albin Michel éd. s.l.:s.n.
Powell, W. . W., Kenneth, W. K. & Smith-Doerr, L., 1996. Interorganizational collaboration
and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative science
quarterly, Volume 41, pp. 116-145.
Provan, K. G. & Kenis, P., 2008. Modes of network governance : structure, managment and
effectiveness. Journal of public administration research and theory, 18(2), pp. 229-252.
Rispal, M. H., 2002. La méthode des cas : application à la recherche en gestion. De Boeck
Supérieur éd. s.l.:s.n.
Simmel, G., 1999. Etude sur les formes de la socialisation. Paris: PUF.
Teece, D. J., 1987. Profiting from technological innovation. Research policy, 15(6), pp. 285-
305.
Thiétart, R.-A., 2014. Méthode de recherche en Management. s.l.:Dunod.
Whitley, R., 2002. Developing Innovative Competence : the role of institutional frameworks.
Industrial and Corporate Change, 11(3), pp. 497-528.
Williamson, O. E., 1985. The economic institution of capitalism. Dans: The Political
Economy Reader: Markets as Institutions. New York: Free Press.
Woolthuis, . R. K., Hillebrand, B. & Nooteboom, B., 2005. Trust, Contract and Relationship
Development. Organization studies, 26(6), pp. 813-840.
Yin, R. K., 2013. Case study research. s.l.:SAGE publications.
Zucker, L. . G., 1986. Production of trust : institutional sources of economic structure.
Research in organizational behavior, Volume 8, pp. 53-111.
V
TABLE DES MATIERES
Remerciements .............................................................................................................................
Sommaire .....................................................................................................................................
Introduction ............................................................................................................................... 1
I. Revue de la littérature ....................................................................................................... 3
1) Hétérogénéité et complémentarité de la structure des RIOI .................................... 4
a) Hétérogénéité des organisations et de leurs compétences .......................................... 4
b) Complémentarité des actifs ........................................................................................ 6
c) Conclusion sur la structure des réseaux ..................................................................... 8
2) Un fonctionnement appelant à la coopération et une gouvernance ....................... 10
a) La coopération des organisations ............................................................................. 11
b) La gouvernance du réseau ........................................................................................ 16
c) Conclusion sur le fonctionnement d’un réseau inter-organisationnel ...................... 18
3) Question de recherche ................................................................................................ 19
II. Méthodologie de la recherche ......................................................................................... 20
1) Méthodologie générale et posture épistémologique ................................................. 20
a) Recherche à caractère exploratoire........................................................................... 20
b) Précautions méthodologiques ................................................................................... 21
2) Méthode d’exploration ............................................................................................... 25
a) Brève description de la filière .................................................................................. 26
b) Immersion dans la filière .......................................................................................... 27
c) Entretiens semi-directifs ........................................................................................... 28
3) Méthode de l’étude de cas .......................................................................................... 31
a) Choix du cas unique ................................................................................................. 31
b) Récolte des données ................................................................................................. 34
III. Résultats ........................................................................................................................... 35
1) Entretiens exploratoires ............................................................................................. 35
a) L’objectif visé par les organisations qui innovent ................................................... 35
b) Les organisations de la filière paysage qui innovent ................................................ 37
VI
c) Les limites au développement de l’innovation dans la filière paysage .................... 39
d) Conclusions .............................................................................................................. 42
2) Etude de cas De Natura ............................................................................................. 43
a) Présentation de l’innovation ..................................................................................... 43
b) Structure du réseau De Natura ................................................................................. 43
c) Fonctionnement du réseau inter-organisationnel innovant ...................................... 53
d) Conclusion de l’étude de cas .................................................................................... 59
IV. Discussion .................................................................................................................... 60
1) Portée de résultats ...................................................................................................... 60
2) Contributions, limites et voies de recherche ............................................................ 60
a) Le syndicat professionnel comme acteur tiers ......................................................... 60
b) Le syndicat professionnel comme partie prenante impliquée dans le processus
d’innovation ..................................................................................................................... 64
Conclusion ............................................................................................................................... 66
Bibliographie .............................................................................................................................. I
Table des figures et des tableaux .......................................................................................... VII
Annexes ................................................................................................................................. VIII
Annexe 1. Arborescence hiérarchique du codage exploratoire ......................................... VIII
Annexe 2. Tableau des candidatures au concours innovation des entreprises du paysage
(Octobre 2014) ..................................................................................................................... IX
Annexe 3. Grille d'entretien pour l'étude de cas De Natura .................................................. X
Annexe 4 : Entretien de Monsieur Feugère .......................................................................... XI
Annexe 5 : Plaquette d’information De Natura ................................................................. XXI
Annexe 6 : Article dans Les potins d’Angèle (Extrait) ................................................. XXVII
VII
TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX
Figure 1: Design de la recherche ................................................................................................ 2
Figure 2 : Deux types d'alliance selon les ressources mises en commun (Jolly , 2003, p. 21) .. 8
Figure 3 : Schéma de bilan de la revue de la littérature sur ....................................................... 9
Figure 4 : Les trois types d'intégration proposés par Fréry (1997) .......................................... 14
Figure 5 : Bilan du fonctionnement d'un réseau inter-organisationnel .................................... 19
Figure 6 : Perception du chercheur en fonction de son implication affective et de sa
connaissance du terrain, inspirée de Mitchell (Thiétart, 2014, p. 289). ................................... 22
Figure 7 : La filière paysage au sein de la filière des végétaux de pépinière ........................... 26
Figure 8 : Filière paysage étendue ............................................................................................ 27
Figure 9 : Répartitions des entreprises de paysage membre du réseau De Natura sur le
territoire Français ..................................................................................................................... 49
Figure 10 : Schéma de bilan sur les composantes du réseau inter-organisationnel. ................ 52
Figure 11 : Bilan du fonctionnement du réseau inter-organisationnel De Natura.................... 58
Figure 12 : Exemples de réseaux initiés par l'UNEP aux deux échelles "micro" et "macro" .. 66
Tableau 1 : Evènements et immersion vécus au cours de l’année ........................................... 28
Tableau 2 : Tableau des répondants ......................................................................................... 29
Tableau 3 : Critères de sélection du cas d'innovation .............................................................. 32
Tableau 4 : Bilan de la composition et relations entre les membres du réseau. ....................... 46
Tableau 5 : Actions possibles de l'UNEP sur les ressources des réseaux inter-organisationnels
innovants .................................................................................................................................. 65
IX
ANNEXE 2. TABLEAU DES CANDIDATURES AU CONCOURS INNOVATION
DES ENTREPRISES DU PAYSAGE (OCTOBRE 2014)
Dénomination de
l'innovation
Démarche
individuelle ou
collective
Ressources
financières
Compéten-
ces métier
Compétences
managériales
ALTAGEM Individuelle
Région Rhône-Alpes et ADEME
BACS GROASIS Individuelle
CRÉATION DE BASSINS Individuelle
ORNEMENTATION DES SOLS EXTÉRIEURS
Individuelle
Angers Technopole et Conseil Régional des Pays de la Loire
Synervia incubateur d'entreprises innovantes
DE NATURA Collective
CRBA, Vavilov, Géode
ENGAZONNEMENT FAIBLE POUSSE
Individuelle
Institut Paysage Environnement
Conseil Général du département
GABIONS VÉGÉTALISÉS Individuelle
MAISON DU PAYSAGE Individuelle
AQUATIRIS Individuelle
MUR VÉGÉTAL ACOUSTIQUE
Individuelle ADEME ADEME ADEME
PROTECBUSE Individuelle
SÉPULTURE PAYSAGÈRE Individuelle
SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR UNE NOUVELLE GESTION DES ESPACES VERTS
Individuelle
Association de botanistes
La Myriade, le Conseil Régional de Basse-Normandie et la Fredon
X
ANNEXE 3. GRILLE D'ENTRETIEN POUR L'ETUDE DE CAS DE NATURA
CONSTITUTION ET COMPETENCES
Comment avez-vous choisi vos partenaires ?
Avez-vous externalisé certaines activités ?
ACTIFS
Comment avez-vous financé le développement de votre innovation ?
Dans quel lieu travailliez-vous ensemble ?
COOPERATION
Pourquoi avez-vous décidé de coopérer avec d'autres entreprises de paysage pour ce projet ?
Qu'est ce qui a favorisé la confiance entre vous ?
Vos partenaires sont-ils des concurrents habituellement ?
Avez-vous contractualisé votre démarche entre les différentes entreprises ?
GOUVERNANCE
Y'a-t-il eu un leader ?
Comment a été divisé le travail ?
Y'a-t-il eu des conflits au cours du développement de l'innovation ?
UNEP
L'UNEP a-t-il joué un rôle dans l'histoire de cette innovation ?
XI
ANNEXE 4 : ENTRETIEN DE MONSIEUR FEUGERE
(Monsieur Feugère, le 7 avril 2015, à son bureau, 62 minutes)
*Pour commencer, pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Phillipe Feugère, je suis président de Plaine environnement depuis 10 ans. En fait la base de notre activité c’est l’entretien et la création d’espaces verts, avec une clientèle publique et privée, en sachant qu’on ne fait pas les particuliers. Nous sommes environ une quarantaine, et on fait entre 3.5 et 4 millions de chiffre d’affaires. Donc Plaine environnement vient d’avoir 10 ans et se porte pas trop mal on va dire. Donc en 10 ans, les choses ont pas mal évoluées, enfin, le marché a évolué. On sent que depuis 2008, la commande publique a bien diminué. Nous on avait déjà commencé à orienter notre clientèle vers une clientèle un peu plus privée, ce qui fait qu’aujourd’hui, on a une tendance, que ce soit entretien ou travaux, on a un partage de la commande entre 50% publique et 50% privé. Et puis l’évolution de notre métier, ciblé au travers du développement durable et la biodiversité…
Il y a une légère évolution du métier, dans un premier temps vers la gestion différenciée, ce vers quoi on avait tendu dès la création de Plaine Environnement, et qu’à un moment on a été appelé, au travers de cette gestion différenciée, à entretenir un site classé Natura 2000, avec des animaux. C’était une friche de plus de 20 ans et que le muséum d’histoire naturel et la LPO d’Ile de France avaient conseillé le client de faire un entretien avec des animaux plutôt qu’avec des machines et tout, donc ce qui fait qu’on a été amené rapidement à mettre en place des animaux pour la gestion de ce parc.
*C’était il y a combien de temps ?
Ça fait 8 ans. Donc évidemment, le client souhaitait entretenir avec des animaux mais ne pensait pas que Plaine Environnement le ferait de son plein grès, et surtout sans sous-traitance, et pourtant, c’est ce qu’on a fait, on a travaillé pendant un an pour faire toute une recherche sur les raisons qui menaient à entretenir avec les animaux, ensuite, adapter les animaux au travail qu’on leur demandait, et puis donc ça s’est mis en place au bout d’une année. Donc on a commencé avec 2 vaches Highland, 2 brebis et puis 2 ânes. Donc on a démarré gentiment, et puis rapidement, il a fallu faire évoluer les effectifs d’animaux. On a essayé d’aller jusqu’au bout d’une démarche.
Dire qu’on fait travailler des animaux, et qu’à partir du moment où on fait travailler les animaux on fait du développement durable, ça me paraissait un peu simpliste, donc le but était de mener une action de A à Z. En fait, en regardant ça de près, vite, on s’est rendu compte que les animaux qui convenaient à notre demande étaient des animaux de race rustique, puisqu’on les fait travailler sur des surfaces qui sont un peu rude, de plus, qui dit race rustique, dit que ce sont des races à petits effectifs, comme par hasard, voire en voie de disparition, et donc en effet, il était important de faire travailler ces animaux parce qu’ils étaient en voie de disparition ou en conservation, et de là, on s’est dit, au-delà de les faire travailler parce qu’ils étaient en voie de disparition et en conservation, il fallait peut-être aussi les faire se reproduire, et voire peut-être aller au-delà de les faire se reproduire. En fait, dans notre activité, qui n’était pas celle d’engraisser pour faire de la viande, on pouvait avoir une mission qui était de faire de la sélection de race, chose qu’on a faite. On s’est décidé avec la coopérative de génétique de se mettre en relation pour faire de la reproduction, de la sélection de race et être adhérent de la coopérative de génétique, qui était gérée par Géode, et qui gérait les Solognots. Donc très rapidement on est rentré dans cette démarche, au-delà de cette démarche, on est rentré et on est devenu les représentants de la race au salon de l’agriculture. Et ce qui démontre aussi, au passage, que globalement on fait du bon boulot, parce qu’on ne risque pas d’aller présenter nos animaux si on ne fait pas du bon boulot. Donc voilà un peu le chemin qui nous a amené à cette démarche et tout ce qu’on en a fait au sein de l’entreprise, parce que ce n’est quand même pas une activité toute neuve, parce qu’ici, personne n’était formé, si ce n’est plus ou moins moi, à l’animal, donc on n’avait pas spécialement repéré le personnel qui était capable de s’en occuper. Après c’est marrant parce qu’à partir du moment où on a eu nos animaux, on a découvert qu’on avait des salariés qui depuis leur plus jeune âge avaient été au contact
XII
avec les animaux, qui encore dans leur pays respectifs étaient propriétaires de grosses troupes d’animaux, et en fait on a notre berger principal aujourd’hui qui est un malien, il a 150 têtes bovines au Mali, et 150 têtes ovines aussi au Mali, donc on avait des pros finalement, sans le savoir. Donc ça, ça a un intérêt, par rapport à ce qu’on dit aujourd’hui, c’est que pour les salariés c’est un espèce d’ascenseur social qui fait que ça peut permettre à certains salariés de se mettre en marge par rapport à certains de leurs collègues par rapport aujourd’hui à cette activité. Donc voilà en gros ce qui nous a amené à ça.
Et puis, bien évidemment, comme on était toujours en recherche de savoir comment on allait faire évoluer le sujet, on a travaillé après sur le fait de communiquer encore plus sur ces races en conservation et en voie de disparition, de là, moi je me suis dit qu’on pouvait faire de belles choses, mais que seul, ça allait être compliqué, donc il fallait que je trouve éventuellement quelques confrères qui avaient une démarche plus ou moins identique à la nôtre pour développer un peu ce pastoralisme dans nos entreprises au niveau national. Donc, en fait, ce n’est pas que ça a été simple mais ceux qui ont cru le plus en moi, c’étaient mes collègues avec qui, à l’époque, j’étais au bureau national de l’UNEP, qui eux, croyaient réellement au fait que cette activité était certainement une des possibilités d’avenir et de mise en marche dans la profession, et après, ce qu’il faut savoir, c’est que par rapport au commun des mortels de la profession, c’était plutôt une activité qui n’était pas très bien accueillie parce que le chef d’entreprise lambda considérait que ce n’était pas notre métier en fait. Alors moi, bien évidemment, au travers de ça, ce que j’avais bien compris, et d’ailleurs ça l’objet d’un de mes slogans au niveau de l’UNEP, c’était de dire que la profession devait s’emparer de la biodiversité, et de dire qu’on devait être les garants de la biodiversité. Il faut dire que c’était une belle phrase, encore fallait-il se l’accaparer et puis être capable de le démontrer. Aujourd’hui, j’ai envie de dire, c’est démontré par quelques entreprises mais loin d’être emparé par l’ensemble de la profession, on en est encore très loin. Peu importe. Aujourd’hui on a un besoin en entreprise, on est happé par un système marchand qui fait que les prix dérapent et on a besoin pour préserver à un moment des trames de prix plutôt attrayantes de se démarquer vis-à-vis des autres. La biodiversité et le développement durable étaient de bons moyens de se démarquer. Alors en fait, comme par hasard, les collègues avec qui après on a cherché à travailler ensemble sur le sujet, on était sur des marchés identiques. C’est-à-dire qu’on est tous AFAQ 26000, on est tous experts jardins bien évidemment, et on a tous une sensibilité sur le fait de dire qu’on devait être garant de la biodiversité. Et en fait, ces 4 autres collègues à qui j’ai donné le virus du pastoralisme dans les entreprises, c’était donc 4 collègues qui sont aujourd’hui encore au bureau national, ou qui y étaient. Et en fait, c’est Plaine Environnement qui les a initié au pastoralisme, qui a d’abord prêté des animaux à ces entreprises pour qu’ils démarrent et qui sont devenus après eux-mêmes propriétaires de leur troupe dans une démarche identique, d’adhérer à Géode, de faire de la reproduction et de faire de la sélection. Donc voilà. Et puis, une fois bien tous regroupés, l’idée nous est venu de faire cette démarche de dire qu’il fallait qu’on trouve un moyen, une action, pour développer cette préservation des races et des espèces, qu’elles soient animales ou végétales d’ailleurs, parce qu’on est concerné par les deux. Sauf que, ce n’était pas évident, parce qu’on était plutôt parti sur un système de formation, tout court. Il faut savoir que les formations c’est extrêmement compliqué à faire vivre et que les droits d’entrée sont extrêmement lourds, entre 500 000 et 1 millions d’euros, ce n’est pas encore dans nos moyens, on ne s’appelle pas LVMH, ni les gros groupes du CAC 40. Donc on a trouvé, en cherchant, un outil qui s’appelle le fonds de dotation, c’est un outil qui avait été apporté par Madame Lagarde, à l’époque ministre des finances, et qui est en fait un pur produit américain extrêmement libéral et qui permet avec quelques milliers d’euros de créer et de mettre les premiers fonds dans ce fonds de dotation, et en fait, après on peut mener quand même beaucoup d’actions, le but étant d’aller chercher les fonds, mais en fait c’est beaucoup plus simple à monter et à créer, d’où la création de ce fond de dotation en 2014, en juin 2014, qui aujourd’hui a commencé à fonctionner. On a créé le fond de dotation juridiquement, ce qui vient derrière c’est toute la création de la communication qui n’est pas simple, donc on a déjà mis en place toute la communication, qui a mis déjà au moins 6 mois, et puis aujourd’hui, on va passer à la phase supérieure, la recherche de fonds. Donc voilà ce qui nous a amené à la création de ce fonds de dotation.
XIII
*Vous m’avez dit précédemment, « on veut communiquer sur le pastoralisme, et seul ça allait être compliqué ». Pourquoi ça aurait été compliqué de monter ce projet seul ?
Je crois que je ne me suis pas trompé, déjà qu’à 4 ce n’est pas facile. Donc seul, ça aurait été encore plus compliqué. Parce que ce n’est pas de le monter seul, c’est de le faire vivre seul, parce qu’en fait, comme je le disais, dans nos entreprises on est tous multitâches, en plus c’est vrai avec tout ce qu’on doit faire aujourd’hui, c’est quand même un peu plus complexe qu’il y a plusieurs années, on passe plus de temps dans nos affaires et tout, donc en effet, créer ce fonds de dotation ça donnait envie, mais seul, même avec l’aide des collaborateurs ici qui sont déjà largement occupés, ça aurait été en effet compliqué. On s’en rend bien compte, même en étant 4 entreprises qui s’entendent bien et qui sont prêtes à donner du temps, on se rend compte déjà que ce n’est pas simple, donc seul… Et puis de toute façon, seul, il ne faut pas se leurrer, pour que notre action pèse, il fallait déjà qu’elle ait une couverture nationale sur le territoire, ce qui nous a donné la force là de l’avoir puisqu’en se regroupant à 4, ça nous permet pratiquement de couvrir au moins les ¾ du territoire national, alors que si j’avais été seul, à part couvrir l’Ile-de-France, je n’aurais pas été plus loin.
*Il y a avait donc une dimension géographique dans ce choix ?
D’envergure géographique, oui, parce que je pense que pour que ça soit représentatif, il faut que, dans la mesure où on dit préservation des races et des espèces, on est bien d’accord qu’il faut couvrir le territoire, qu’on ne peut pas se limiter à un département ou à une région quoi. Donc, c’était en effet le but de lui donner une échelle nationale, et puis après en se disant qu’à 4 on est plus fort que seul.
*Si je reprends ce que vous disiez, cette collaboration se rapporte à la division du temps ? Auriez-vous eu le temps de pouvoir le faire seul ?
Et puis à un moment c’est la réunion de moyens. Parce que en fait aujourd’hui, c’est pareil, on a dû mettre 5 000€ chacun au départ, ça fait 20 000€ à 4, si j’avais été seul il aurait fallu mettre 20 000€ au départ, donc voilà c’est la répartition des coûts. Du temps, des coûts, d’une répartition géographique, et en fait aussi la partie innovante de notre projet c’est de démontrer que 4 entreprises d’une même activité peuvent se regrouper et que l’aspect concurrentiel à un moment il faut le laisser de côté. Alors même si là on est éloigné par les distances, il y a quand même une idée commune qui valorise nos entreprises et, en effet, on pourrait se dire que c’est mieux de le faire seul qu’à plusieurs. Mais je pense que seul, ça n’aurait pas le même impact et la même qualité que ce qu’on peut lui apporter aujourd’hui.
*Vous parlez de « collègues », vous ne les considéré donc pas comme des concurrents ?
Absolument pas, moi je n’ai pas de concurrents.
*Vous disiez aussi que les entreprises « s’entendaient bien », est-ce que vous avez une relation amicale ? Et, est-ce que c’est lié à l’UNEP ? Vous connaissiez-vous d’avant ?
Alors oui, il y en a que je connais d’avant, un principalement, les autres je les connus grâce à l’UNEP et c’est l’intérêt à un moment de s’investir dans ces organismes, parce que souvent en effet on se dit qu’on n’a pas trop de temps, sauf qu’à chaque fois qu’on peut dire qu’on n’a pas trop le temps, soit on ne prend pas le temps et à mon avis ce sont des choses qu’on rate et c’est un peu dommage mais c’est la volonté de chacun, et chacun fait ce qu’il veut. Mais je trouve qu’à un moment en effet, parfois on a l’impression de perdre son temps, mais on ne perd pas tout son temps. C’est grâce à ces organismes qu’on grandit, qu’on voit les choses autrement, qu’on arrive plus facilement à se projeter, parce que sinon, si je reste ici, il y en aurait encore plus haut [montre la pile de dossier sur son bureau] et on a la tête dans le guidon constamment, on a la tête dans le guidon et on ne prend jamais de recul. Au moins, le fait de prendre le temps d’être dans ces organismes et puis prendre le temps de dialoguer avec ses collègues et autres, ça permet de prendre le recul et de grandir. Grâce à ça, on grandit tous les jours.
*Sont-ce les mêmes raisons qui vous ont poussé à faire partie de la commission innovation ?
XIV
Après, c’est plutôt qu’une fois qu’on est dedans, on s’investit dans diverses commissions. Et puis là en plus, c’est plus qu’une obligation, puisque c’est une mission qui m’est confiée en tant que vice-président du bureau national. Donc en fait, j’ai en charge l’innovation, et que l’innovation. Je n’ai qu’un seul sujet à m’occuper. Donc c’est un souhait de la présidente, la commission seule de l’innovation n’existait pas avant et c’est elle qui a souhaité que pendant ce mandat de 3 ans, on mette le paquet sur l’innovation, et donc ce sont les raisons pour lesquelles je n’ai que l’innovation. Et donc, bien évidemment, je fais partie de cette commission mais en fait je suis tout ce qui est innovation pour l’UNEP partout, puisque je suis aussi à Val’hor pour l’Astredor et à Plante et cité pour tout ce qui est innovation.
*Sur De Natura, avez-vous rencontré des conflits lors du développement de l’innovation ?
Avec mes partenaires directs, non aucun. Au contraire, c’est plus un plaisir de pouvoir faire voir le jour à ce projet tous ensemble ; raison d’ailleurs pour laquelle on a à peine fini de le créer qu’on a participé au concours d’innovation de l’UNEP, parce que je crois que c’était une innovation qui n’était pas que technique. Alors, pour nous tous, il y avait deux innovations. Il y avait une innovation de créer ce premier fond de dotation dans le métier du paysage, et la seconde c’était de démontrer que 4 entreprises pouvaient se grouper ensemble.
*Est-ce que le fait qu’il y ait eu un concours innovation à l’UNEP a été un accélérateur pour vous pour terminer votre projet ?
Non, coïncidence.
*Au niveau de l’organisation du travail, comme vous étiez géographiquement distants, comment avez-vous travaillé ? A distance ?
On a une réunion téléphonique par mois et on a une réunion physique par mois sur Paris. On a intégré du coup un cinquième larron qu’on appelle notre avocat, qui est spécialisé en droit de l’environnement, c’est lui qui nous a bâti le projet, et du coup, on lui avait demandé à l’époque s’il ne voulait pas entrer en tant qu’administrateur, ce qu’il a accepté, et du coup on se réunit…. Il a un cabinet à Lyon et un cabinet à Paris, donc on se réunit une fois par mois à son cabinet à Paris, dans le centre de Paris. Donc c’est une réunion physique et une réunion téléphonique, et après, entre-deux, si on a besoin de se joindre, on est capable de le faire s’il y a urgence. Donc voilà, c’est un peu la cadence de fonctionnement. Sachant que dans chaque entreprise, on a nommé une référente aussi, ici c’est Virginie, dans chaque entreprise il a un référent, une référente, qui est suppléant de l’administrateur.
*C’est donc très organisé ?
Ah bah oui, il faut [rire].
*Est-ce qu’il y a un leader ?
Il y a un président qui est Benoît Lambray, de chez Tarvel, et puis après il y a un trésorier, un secrétaire, ça c’est moi.
*ça fonctionne comme une association ?
Non, c’est un fonds de dotation tout court, ni une association, ni rien.
*Tout est contractualisé ?
Tout à fait, complètement. En fait, ce qu’il faut savoir, c’est que tout est permis globalement dans un fonds de dotation, sauf de bénéficier d’argents publiques pour alimenter les fonds. Même pour des questions qui seraient complètement recevables, une collectivité ne peut pas alimenter directement un fonds de dotation, donc voilà, c’est la seule interdiction qu’on ait, mais ça peut se comprendre. Alors après, il y a d’autres moyens, quand je dis dérivé, ce n’est pas dérivé, j’ai envie de dire, on a fait des
XV
miniatures, la collectivité va en acheter, on est en train de regarder mais a priori elle peut acheter directement à De Natura, mais elle ne peut pas faire de dons directement. Mais sinon, oui en effet, tout est assez bien orchestré.
*Au niveau du travail de chacun, est-ce que ça a été divisé de façon homogène ?
On n’a pas trop regardé, on a essayé de se diviser les tâches… Finalement, chacun dans sa région a plus ou moins la même charge de travail puisque si on veut que ça avance, chacun doit, sur sa région, développer à sa façon, y’a pas de méthode, comme toujours, mais développe à sa façon, avec ses relations le fonds de dotation. Donc il n’y a pas… tout le monde a en effet œuvré dans le même sens mais chacun à sa façon, dans sa région, avec ses relations.
*Avez-vous eu d’autres sources de financements que votre mise de départ pour vous aider à développer ce projet ?
Non. Aujourd’hui on va en effet commencé à lister les premiers apporteurs de fond, c’est la mission qu’on a maintenant, lister les premiers heureux donateurs et mécènes, pour essayer d’alimenter rapidement le fonds.
*Vous m’avez parlé de l’arrivée a posteriori d’un avocat dans votre projet. Y’a-t-il eu d’autres tâches que vous n’avez pas pu effectuer vous-même, des compétences que vous n’aviez pas en interne ?
L’intérêt de l’avoir, c’était un ami de notre collègue de Lyon, c’est qu’on se rend compte que comme en fait c’est assez libéral tout en ayant des règles à respecter, donc l’intérêt de l’avoir avec nous c’est qu’il peut vérifier très rapidement si les demandes qu’on a de nos éventuels clients, comment on peut les articuler et les intégrer. On se rend compte que les gens qui sont face à nous, quand on leur présente ce fond de dotation, sont vite alléchés par le sujet, ce qui peut, eux, en faire et l’exploiter, après le tout étant de savoir si ce qu’ils nous demandent est possible tel qu’ils nous le demandent, s’il faut comme qui dirait le décorer un peu sur les bords, et l’agrémenter de façon à ce que ça soit éligible. Donc en fait, je pense que les sujets où on a besoin d’aide, c’est en effet sur tous les aspects juridiques. Après on va avoir besoin d’aide sur tout ce qui est fidélisation des contrats et autre, dans le sens où nous on a les portes d’entrée pour d’éventuels mécènes et autres, mais après, ce qui nous manque, c’est le temps de prendre les affaires et de les prendre jusqu’au bout pour prendre le temps de les finaliser. Comme toujours on fait 50 000 choses à la fois, comme je te disais tout à l’heure, ce qu’il faut c’est d’arriver à avoir des personnes qui vont être concentrées sur la finalisation des contrats de mécénat quoi.
*ça va être externalisé ?
Oui, on va embaucher certainement sur 6 mois une personne, de façon à ce qu’elle puisse aller chercher des fonds, et que ces fonds puissent alimenter son salaire pour pouvoir perdurer.
*Y’a-t-il d’autres choses que vous avez externalisé jusqu’à maintenant ?
La communication. Le site internet, le visuel papier, et puis voilà. On l’a complètement externalisé. Ce sont les premiers fonds qui ont permis d’alimenter ça.
*Vous m’avez parlé, d’une part, du fait que l’UNEP vous avait permis de vous mettre en relation avec les autres entreprises avec lesquelles vous avez monté ce projet, et d’autre part, que vous aviez participé au concours innovation de l’UNEP. L’UNEP a-t-il joué d’autres rôles dans le développement de cette innovation ?
Non… Le fait d’avoir mis en avant cet aspect innovation au sein de l’UNEP et donc pour l’ensemble des adhérents de l’UNEP, moi je pense que l’intérêt, c’est de faire prendre à nos confrères et aux adhérents la prise en compte de l’innovation. Ce qui n’est pas simple parce que pour beaucoup de gens, l’innovation c’est faire du hi-Tech, de la haute-technologie et c’est un peu déjà le premier combat qu’on a à gérer, c’est de convaincre nos adhérents que même le jardinier peut faire de
XVI
l’innovation. Alors, pour tout le monde l’innovation ce n’est qu’avec des éprouvettes, ça se fait avec des ingénieurs et de la mécanique, alors que même dans le paysage, en faisant ce qu’on a fait, c’est de l’innovation. Après, tout dépend comment on s’accapare le mot innovation, et quelle définition on lui donne. En effet, le rôle de l’UNEP c’est de faire comprendre que même dans les métiers du paysage on peut innover. Après, le deuxième grand sujet, et on le voit à travers ce concours, c’est qu’à 99% c’était de l’innovation technique, et personne n’a essayé d’innover sur l’aspect social et sur l’aspect économique, alors qu’on a plein de choses à faire sur ces aspects. Non non, le rôle de l’UNEP c’est de faire comprendre à ses adhérents qu’il faut absolument innover si on veut que notre métier se mette en marge et soit en haut de l’affiche, comme les autres métiers.
*Cette politique pour dynamiser l’innovation dans la filière a-t-elle eu un impact sur vous ?
Alors nous, comme on est souvent dans les bureaux de l’UNEP, on est déjà extraterrestre avant l’heure, on était déjà dedans avant que l’UNEP fasse sa sortie de l’innovation en 2014. Non, on était déjà dedans avant, tous autant qu’on est.
*Si le développement de De Natura était à refaire, que changeriez-vous ?
Aujourd’hui, ce n’est pas pour être plus positif que positif, mais améliorer certainement, mais je ne sais pas s’il y a des choses à changer. Mais l’améliorer, je ne sais pas comment parce qu’on n’a pas de reproches à se faire, on a fait avec les moyens qu’on avait. Alors si, si on avait la chance d’avoir plus de moyens, on irait plus vite mais on le fait avec nos moyens et ça n’avance pas si mal, même les gros groupes ont du mal à croire qu’on a pu créer ce fonds avec 4 petites PME, ça veut dire qu’on est pas si mauvais que ça [rire].
*Pourquoi avoir choisi de coopérer avec d’autres entreprises de paysages ? Pourquoi pas avec d’autres entreprises plus tournées vers l’animal ?
Bah si en fait, à la base de notre démarche, notre coopérative de génétique était partie prenante, à la seule différence, c’est que cette coopérative de génétique, dans notre démarche, c’est un outil dont on peut avoir besoin, et le problème qu’on avait c’est que si elle devenait administrateur, elle ne pouvait plus donner de fonds, donc on se coupait de pouvoir amener des races pour les organiser en termes de génétique, donc finalement d’apporter des fonds pour aider ses races, donc en fait, on se coupait une jambe, donc du coup, on a abandonné, grâce à notre avocat qui nous a dit « Si vous intégrez Géode dedans en tant qu’administrateur, le fonds de dotation ne pourra pas alimenter Géode pour la mise en place de structuration de génétique, donc il ne faut pas le faire ». Mais on y avait pensé, on l’avait intégré dès le départ.
*Géode, même s’il ne fait pas partie du fond de dotation en quand même partenaire ?
Oui, de toute façon je suis administrateur de Géode, on est 13 actifs au sein de Géode et on fait d’ailleurs… De Natura est connu au sein de Géode, voir au-delà, et d’ailleurs quand on est au salon de l’agriculture, on communique sur ce sujet, donc on a plutôt une bonne appréciation des éleveurs par rapport au travail qu’on a fait depuis qu’on est dans ce conseil d’administration et qu’on a intégré le monde de l’élevage. Et de l’autre côté, depuis la création de De Natura, qui a vu le jour plus ou moins au moment du salon de l’agriculture qu’on va dire grand public, on a plutôt été bien accueilli par les éleveurs qui disent que ce qu’on fait, il faut le faire, c’est très important de préserver les races, du moins celles qui nous restent, et de l’autre côté, eux, c’est ce qu’on disait tout à l’heure, ils aimeraient bien le faire, mais ils n’en n’ont pas le temps et bien évidemment, pas les moyens non plus, se regrouper comme nous on l’a fait, ils n’ont pas le temps de le faire. Mais que c’est bien qu’on l’ait fait [rire]. Donc il y a un vrai partage avec le monde de l’élevage. Ça c’est pareil, c’est l’une des choses que j’avais un peu intégré dans le fond de ma tête, c’est que je savais que ça risquait de ne pas être facile de se faire accepter dans le monde de l’élevage, ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas, ça s’est bien passé dès le départ.
*Qu’est-ce que vous craigniez ?
XVII
C’est-à-dire que notre démarche était plutôt une démarche urbaine, avec des urbains et qu’on sait qu’en général, ils se disent : « non mais attend, ils ont de belles idées et tout, mais on va les laisser faire, on va bien rigoler ». Et finalement on leur a démontré que même quand on était des demis-urbains, on pouvait avoir la capacité de travailler ensemble, ce qui était plutôt sympa et qui reste plutôt sympa, puisqu’aujourd’hui on est associé à plein de démarches communes avec eux pour développer cette démarche. Et au même titre, à l’UNEP, on va rédiger les règles pro du pastoralisme, et bien évidemment on va les associer pour rédiger, comme on l’a fait pour les autres règles pro, il faut associer tous les membres qu’il y a à associer.
*Autour du fonds de dotation il y a Géode, il y a l’UNEP. Y’a-t-il d’autres partenaires ?
Des grands noms même, ça fait partie des développements qu’on veut avoir, des espèces de parrainage avec des grands noms, je ne sais pas où on va aller les chercher, mais des gens qui vont nous aider à porter encore plus médiatiquement le projet De Natura. Ça fait partie de nos futures recherches et prérogatives pour aider le fonds à être encore mieux médiatisé. On n’est pas au bout.
*J’aimerais revenir sur votre formation. Vous êtes issu d’une formation paysage ?
J’ai commencé par un bac D, ensuite j’ai fait une formation de commerce, et ensuite, je suis revenue au paysage, non pas par la force des choses, mais parce que ça a été l’occasion. J’aurais très bien pu finir dans le monde animal finalement. Ce qui fait que ma vieille mémoire sur ce que j’avais appris en bac D et ma passion pour les animaux, a fait que j’avais dit à mon client que personne d’autre ne toucherait aux animaux si ce n’est que moi, donc c’est la raison pour laquelle on s’est lancé directe dans la démarche.
*Sur De Natura, entre l’émergence de l’idée et le fait que le fond de dotation soit réellement constitué, ça a pris combien de temps ?
6 mois [rire].
*ça a été assez rapide !
Quand on a envie de faire les choses, on les fait, on essaye d’aller vite. 6 mois à peu près, on a commencé en septembre 2013 et en juin 2014… 8 mois, un peu plus de 6 mois. Ce qui était difficile au départ, c’était de partir sur ce fonds de dotation car on était parti sur des fondations, des choses comme ça, et grâce au concours de cet avocat, c’est lui qui nous a mis en ligne pour créer un fond de dotation plutôt que de se prendre la tête avec les fondations où c’est extrêmement compliqué. Et puis on n’aurait pas pu le faire ! Ou alors se rattacher… mais là, au moins, on a préservé toute notre liberté. Non non, ça a été assez vite !
*L’idée semble venir entièrement de Plaine environnement, je me demande comment vous avez fait pour aborder les autres et les convaincre sur un projet innovant, donc potentiellement risqué…
L’innovation c’est un risque au départ.
*Il a fallu les convaincre ?
Non non, la façon dont ça s’est mis en place chez tous… en fait, je leur ai donné le virus, c’est clair, et que la façon dont on l’a mis en place chez chacun... Plaine Environnement a montré sa pleine envie à ses confrères, de mettre en place le fonctionnement de ce pastoralisme. Et après, en ayant fonctionné comme ça, chacun a apporté un maximum d’idées pour amender l’idée et le bon fonctionnement de cette démarche. Donc, après l’idée de dire le fonds de dotation et tout, il fallait trouver des outils pour aider l’activité de nos entreprises à se développer et à se mettre en marge de nos chers confrères. Et après, je dirai que la miniature qu’on a, ce n’est pas moi qui l’ai trouvé, c’est un de mes autres collègues, on savait qu’il y avait quelque chose à faire avec la laine, mais on ne savait pas quoi. Voilà ce qu’on peut faire [me donne un petit mouton en laine], ça par exemple, c’est une idée d’un de mes collègues de Lyon, où l’idée c’était de dire : ces animaux qui sont des races en voie de disparition et
XVIII
qui « soi-disant » ne valaient rien, on se rend compte que cette race de brebis. Aujourd’hui, cette race de brebis, on a créé une AOP sur sa valeur gustative en viande, en cherchant on se rend compte qu’elle a une qualité de laine qui est bonne, voire très bonne, et qu’il fallait revaloriser chaque chose sur ces animaux et montrer que malgré qu’elles étaient en voie de disparition, il y a plein de choses à faire avec ces animaux. En fait, ça c’est une idée qui est venue d’un de mes autres collègues, et puis après, quand on sort ça, y’en a un qui dit : ça c’est bien, mais pourquoi on ne ferait pas travailler un atelier d’insertion, et puis après il y en a un autre qui… moi j’avais trouvé toute l’histoire de feutrines française, qui est un savoir-faire du patrimoine français, donc ça, il faut le défendre, donc au travers de cette petite miniature et de la laine de nos brebis on met en valeur le savoir-faire français sur les feutrines. Bon les gens ne savent pas ce que c’est que la feutrine et ne savent pas que la masse de la matière première est de la laine. Après on déroule, il y a plein de choses à démontrer et au même titre de la préservation du patrimoine, que ce soit animal ou végétal, on a aussi le patrimoine de savoir-faire. Donc après, on met comme ça une idée au milieu de la table, et chacun cogite pour savoir et voir comment on pourrait développer ça. Et aujourd’hui, on en est… on a une fileuse ici, on va développer avec l’entreprise qui nous fabrique les miniatures, on a une fileuse en Ile-de-France, avec laquelle on fait de l’animation. Aujourd’hui, moi j’ai été chercher une fileuse qu’on va mettre à disposition des entreprises si elles ont besoin… enfin voilà, on va développer d’autres choses. Donc chacun, quand il rentre chez lui, voit… il y a un de mes collègues qui m’a envoyé un mail hier pour me dire : tient, on pourrait faire une émission sur TF1, est-ce que ça te branche ? - Pas de problèmes, on y va ! [rire]. Donc voilà, chacun avec ses relations, avec ses idées, on met les idées au milieu de la table, et personne ne cherche à savoir qui a eu l’idée en premier, et c’est ce qui est intéressant. La plus belle idée c’est d’avoir mis ça en commun et de l’avoir fait évoluer comme on l’a fait évoluer. Encore une fois, tout seul, je n’aurais jamais fait ça. Après, encore faut-il avoir un esprit plutôt ouvert qu’un esprit individualiste, c’est sûr que j’aurais pu garder l’idée pour moi, mais je ne crois pas qu’on en serait là aujourd’hui.
Ce qui les étonne c’est qu’on puisse s’être regroupé à 4, et après, ce qui les étonne, c’est la vitesse avec laquelle on a mis ça en place : « nous ça fait des années qu’on essaye de mettre ça en place mais on y arrive pas », bah oui mais s’ils n’y arrivent pas c’est parce qu’il y en a toujours un qui est plus malin que son voisin et qui veut s’accaparer le sujet. On en revient toujours à ce problème-là d’individualisme, quand on veut tout ramener à soi, on voit bien, on ne s’en sort pas. Il suffit de regarder les politiques, on commence par-là, et voilà, ça montre qu’on est fait pour travailler en équipe et pas seul dans son coin.
*L’auriez-vous fait si les autres étaient sur la même zone de chalandise que vous ?
Bah oui, parce qu’aujourd’hui, Tarvel a été vendu au groupe SEGEX et on développe le pastoralisme en Ile de France avec SEGEX. Enfin, je ne sais pas, c’est pareil, à partir du moment où on maîtrise son savoir-faire, moi j’ai envie de dire que la concurrence ne me fait pas peur à partir de là. Si on maîtrise son savoir-faire et qu’on se considère bon, je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, on se ferait happer par son voisin. On se fait happer par son voisin quand on est sur des lignes telles qu’on peut les voir aujourd’hui en effet : tondre du gazon on peut dire que c’est un métier, mais on se rend bien compte que le premier à qui on donne une tondeuse, il saura tondre son gazon. On a affaire à une clientèle qui finalement n’en a rien à foutre de que le gars qui 10 minutes avant tonde soit celui qui pousse la serpillère. Je n’ai rien contre celui qui pousse la serpillère. Aujourd’hui, il y a quand même des boîtes qui se sont accaparées notre métier en disant « De toute façon tondre du gazon c’est comme pousser la serpillère dans le couloir d’une société, donc on va essayer de tout vendre dans le même package », alors que nous, on démarche nos clients sur ce qu’on est en train d’évoquer-là, on n’est plus du tout dans la même démarche et on ne peut pas se contenter de dire : « le mec qui est dans le couloir en train de pousser la serpillère, il va s’occuper du développement durable ». Mais c’est pareil, moi je n’ai pas la prétention de dire que la tondeuse est remplacée par l’animal, ce n’est pas le but non plus. Il faut aller mettre des animaux là où il y a du sens et de l’intérêt, sinon, si c’est juste pour remplacer et faire du buzz en disant qu’on a remplacé les tondeuses par des animaux, ça n’a zéro valeur, et en plus on remplace le poste « homme », donc socialement ce n’est pas très intéressant.
XIX
*Pour conclure, peut-être souhaiteriez-vous aborder des choses auxquelles je n’ai pas pensé sur l’innovation dans la filière paysage ?
Non bah, l’innovation en paysage, c’est ce que j’ai dit tout à l’heure, que j’avais exprimé clairement au congrès à Toulouse, disant que l’innovation, ça ne s’adressait pas seulement au hi-tech et aux métiers de la haute technologie, qu’il ne fallait pas penser non plus que dans nos métiers, ça se limitait seulement à la technique et donc bien aux 3 piliers du développement durable, le social et l’économie, surtout dans nos métiers, je pense qu’on a plein de choses à innover dans le social, et l’économique. Donc c’est surtout d’inciter nos collègues, s’ils ont envie d’innover, d’aller au-delà aussi de la technique. Quand les gens se l’accaparent, ne serait-ce que la technique, moi je trouve ça déjà bien. Après je pense qu’il faut que les choses évoluent. Aujourd’hui, on est en train, et c’était le thème de notre séminaire de bureau, essayer de réfléchir ce que sera notre métier avec le digital, d’ici 5 à 10 ans.
*Comment voyez-vous cet avenir ?
Je ne sais pas, mais peut-être qu’avec cet outil-là [montre son Smartphone], j’arriverai à mettre en place ma tondeuse robotisée dans mon jardin, comme je lui demanderai d’éclairer et de mettre l’arrosage automatique en route. Ce qu’on disait l’autre jour, c’est que Google sera capable, avec son satellite, d’aller dire, tel végétal, comment il s’appelle, j’ai oublié son nom dans mon jardin, voilà comment on l’a vu il y a 15 jours.
*Il y a 15 jours ?
En fait on a fait un séminaire chez BETC, c’est une émanation d’AVAS, et c’est la plus grosse agence de pub en France, et en fait, aujourd’hui, ils en viennent à ça. C’est-à-dire que dans notre service, ils font de la com, et ils font de la com digitale aussi, donc ils sont obligés de se transporter à l’innovation du digital aussi quoi.
Il y a autre chose aussi. On essaye de développer la recherche avec les apprentis ITIAPE (de l’ISA) pour que, aussi dans nos écoles, on puisse aider les futurs ingénieurs à se mettre en mode recherche sur tout ce qui est innovation. Et encore une fois, aller au-delà des toitures végétalisées et des essences qu’on peut mettre sur les toitures végétalisées. Je pense que là aussi c’est l’abécédaire des jeunes qu’on est en train de former pour ce qui va a arriver dans nos entreprises qui est déjà une démarche recherche et développement, et ça aussi c’est important. Si on forme les jeunes dès l’école à aller au-delà de ce qu’on apprend tous les jours, quand ils arrivent dans nos entreprises, la réflexion de ce qu’ils peuvent nous apporter est complètement différente. Donc ça se sera une de mes dernières batailles pour essayer de faire avancer la recherche en école d’ingénieur quoi. Surtout qu’on a un bel outil à l’ITIAPE, à l’ISA, donc il faut en profiter.
*Et un pôle de recherche et développement à Plaine environnement, c’est pour demain ?
C’est même déjà pour hier, sauf qu’on manque un peu de place et de temps encore une fois, j’ai un… Là, on est en train de mettre au point… J’ai deux projets en fait. J’ai de préparer le module d’une idée qui est de dire « redonnons du sens à notre jardin », c’est-à-dire en recréant de la biodiversité dans nos jardins par rapports aux jardins qu’on faisait il y a 20 ou 30 ans, donc ça c’est la première idée que j’ai à développer. Et puis, une autre sur le jardin nourricier sur ballots de paille, mais là, plus à titre pédagogique et à développer dans les écoles.
*Vous développeriez ces projets seuls, ou encore une fois avec des collègues ?
Ça peut s’associer dans l’avenir à De Natura, je ne sais pas si tu as vu, mais dans nos voies de développement dans De Natura, on a Vavilov, les banques de graines, et je pense qu’en partant des banques de graines, en partant du végétal, on a plein de choses à développer, surtout si on y met les écoles, on ferait des grainothèques, il y aurait plein de choses à faire.
*Vous ne garderiez donc pas forcément ces idées pour vous ?
XX
Encore une fois, si on veut donner une belle ampleur au projet et qu’on en parle, ça a plus de sens de les développer.
*La visée n’est pas d’obtenir un avantage concurrentiel ou un bénéfice supplémentaire ?
Bah, c’est-à-dire que le concurrentiel, il peut toujours exister, à la seule différence c’est qu’il faut avoir eu l’idée et être capable de la mettre en place rapidement. Une fois qu’on a tout mis en place, qu’on a tout cogité, piquer l’idée c’est toujours facile, mais ce n’est pas le tout de piquer l’idée, il faut la mettre en œuvre. Je n’ai pas peur de la concurrence, je n’ai de problèmes avec ça.
*J'ai lu dans un article de presse s'intéressant à De Natura : "Voilà comment six entreprises de paysage se sont retrouvées autour d’une vision alternative commune de leur métier avec des pratiques prenant l’écologie et la biodiversité domestique en compte.De fil en aiguille, un groupe de travail s’est constitué en novembre 2013 pour poursuivre cet engagement. Tous n’ont pas suivi puisqu’à l’arrivée De Natura compte quatre fondateurs."(LES POTINS D’ANGÈLE, AVRIL 2015). Pourriez-vous m'expliquer pourquoi 2 entreprises potentiellement concernées par l'innovation n'ont pas participé au projet ? Une volonté de leur part ? ou un frein de votre côté ?
Monsieur Lequertier est sorti car il ne s’est pas vraiment posé la question, je pense qu’il n’a pas tout perçu, mais il n’y a pas eu fâcherie et s’il veut réintégrer, il pourra, et ce sera le seul. Je pense qu’il avait quelques doutes sur son entreprise, et on sait bien que l’innovation est une aventure et reste incertaine.