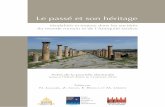TD3 Gradient géothermique Genèse des magmas STU – SVI Module de géologie II 2013
Le proudhonisme dans l'AIT : genèse et itinéraires
Transcript of Le proudhonisme dans l'AIT : genèse et itinéraires
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Le proudhonisme dans l'AIT : genèse et itinéraires
Samuel Hayat
Conservatoire national des arts et métiers
[Version de travail, ne pas diffuser. Commentaires bienvenus :
Pendant longtemps, l’historiographie a couramment admis
que la première section parisienne de l’Internationale, de 1864
à 1867, avait été proudhonienne2. Si ces dernières décennies,
certains travaux ont pu nuancer ou simplement rejeter cette
idée3, elle n’en demeure pas moins présente jusqu’à aujourd’hui
dans de nombreux écrits, historiens ou militants, sur cette
1 Merci beaucoup à Michel Cordillot pour ses commentaires sur une première version de ce texte.2 Voir par exemple l’ouvrage séminal de Jules-Louis Puech, Le Proudhonisme dans l’Association internationale des travailleurs (Paris: F. Alcan, 1907). Dans son article de synthèse né d’une recherche collective de grande ampleur, Jacques Rougerie considère aussi la première période de la section française, jusqu’aux deux procès parisiens, comme une période « proudhonienne ».Jacques Rougerie, ‘Les sections françaises de l’Association internationale des travailleurs’, in La premiere Internationale: l’institution, l’implantation, le rayonnement : [actes du Colloque international organise a] Paris, 16-18 nov. 1964 (Paris: Editions de Centre National de la Recherche Scientifique, 1968), pp. 93–127. Pour une présentation de l’historiographie de l’AIT, voir Daisy Eveline Devreese, ‘L’Association Internationale Des Travailleurs : Bilan de L’historiographie, Perspectives de Recherche’, Cahiers d’histoire de l’institut de recherches marxistes, 1989, 9–31.3 Bernard H. Moss, ‘La Première Internationale, La Coopération et Le Mouvement Ouvrier À Paris (1865-1871) : Le Mythe Du Proudhonisme’, Cahiers d’histoire de l’institut de recherches marxistes, 1989, 33–48; Julian P. W Archer, The First International in France, 1864-1872: Its Origins, Theories, and Impact (Lanham: University Press of America, 1997); Michel Cordillot, ‘Le fouriérisme dans la section parisienne de la Première Internationale (1865-1866)’, in Aux origines du socialisme moderne: la Premiere Internationale, la Commune de Paris, l’Exil recherches et travaux (Ivry-sur-Seine: Ed. de l’Atelier, 2010), pp. 19–32.
1
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
période4. Plutôt que de proposer ici un jugement tranché sur la
validité ou non de l’étiquette proudhonienne, on s’intéressera
plutôt, dans une perspective d’histoire sociale des idées, à la
construction sociale de la référence à Proudhon chez les
ouvriers de la section parisienne de l’Association
internationale des travailleurs (AIT)5. En effet, cette
référence existe bien dans leurs écrits et dans leurs prises de
positions, et c’est un fait qui a de quoi étonner. D’abord, il
est a priori suspect, s’agissant de militants ouvriers
réclamant le droit à parler et à agir pour eux-mêmes, de
rapporter leur pensée à celle d’un penseur professionnel, fût-
il d’origine populaire. Ensuite, quand bien même on accepterait
l’idée que les ouvriers tireraient leur pensée d’un auteur, que
ce soit Proudhon, Marx ou Bakounine, le choix de Proudhon est
une énigme. Contrairement aux saint-simoniens, aux fouriéristes
ou aux cabétistes, Proudhon n’a quasiment jamais fait école ou
participé à l’organisation d’un mouvement ouvrier – sauf
pendant quelques mois, en 1848. Comment expliquer alors que
l’on y rattache la première section parisienne de l’AIT, les
« Gravilliers » – que ce soit à l’époque ou dans
l’historiographie ? La question devient d’autant plus aigüe si
on replace l’AIT dans l’histoire du mouvement ouvrier
français : ce n’est pas seulement la section parisienne de
l’Internationale qui est censée hériter de Proudhon, mais
4 Voir par exemple la synthèse récente de Mathieu Léonard, L’emancipation des travailleurs: une histoire de la Premiere Internationale (Paris: la Fabrique éd, 2011).5 Bernard Pudal, ‘De l’histoire des idées politiques à l’hitsoire sociale des idées politiques’, in Les formes de l’activite politique: elements d’analyse sociologique, du XVIIIe siecle a nos jours (Paris: Presses universitaires de France, 2006), pp. 185–92; Frédérique Matonti, ‘Plaidoyer pour une histoire sociale des idées politiques’, Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 59-4bis (2013), 85–104.
2
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
aussi, en partie par ce biais, le syndicalisme révolutionnaire
français tout entier. L’étude de la construction de la
référence à Proudhon – son origine, son déploiement, ses effets
– est dès lors cruciale pour éclairer l’histoire intellectuelle
des ouvriers français organisés au XIXe siècle.
Le but de cette intervention est de rendre compte de ce
processus de construction d’un proudhonisme ouvrier, en
s’intéressant à la fois à son origine, à son contenu théorique
et à son rôle dans l’histoire plus générale du mouvement
ouvrier français du XIXe siècle. Pour cela, on reviendra
d'abord sur la genèse de la référence à Proudhon parmi les
ouvriers parisiens, en s'intéressant à la fois aux liens entre
Proudhon et le monde ouvrier avant la fondation de
l’Internationale et à l'itinéraire de certains membres clés de
la section. Dans un second temps, on montrera la façon dont la
référence à Proudhon est mobilisée par les dirigeants de la
section parisienne de l’AIT, en accordant une attention
particulière au Memoire des delegues français du Congrès de Genève en
1866. Enfin, on s’interrogera sur le rôle de cette mobilisation
du proudhonisme au sein de la section parisienne de l’AIT dans
la diffusion de certains de ses thèmes au-delà des frontières
de l’organisation, pour inclure cette analyse du proudhonisme
dans une réflexion plus large sur le rôle de l’AIT dans la
circulation transnationale des idées socialistes.
I. Qui sont les « proudhoniens » de l’Internationale ?
3
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Pour comprendre la genèse de la référence à Proudhon chez
les ouvriers de l’Internationale, il faut d’abord circonscrire
le groupe auquel on s’intéresse. Le terme « proudhoniens » est
d’abord utilisé par les adversaires des ouvriers de la section
française de l’Association internationale des travailleurs
(AIT). L’utilisation est indiscutablement péjorative, comme en
témoigne l’expression « ânes de proudhoniens » par laquelle
Karl Marx, dans une lettre du 11 septembre 1867, désigne les
militants de la section française. Qui sont donc ces
militants ? Et parmi ces membres, quels sont ceux dont parle
Marx, c'est-à-dire ceux qui sont les plus investis dans
l’Internationale ? Pour les besoins de l’analyse, on peut
définir au sein de la section parisienne de l’AIT trois cercles
concentriques : d’abord, les quatre représentants officiels
auprès du Conseil central ; puis les vingt membres officiels de
la commission qui gère les activités de la section parisienne ;
et enfin les simples adhérents. Je m’intéresserai ici aux deux
premiers cercles, en commençant par les quatre personnes qui
forment le cœur de la section.
Le premier cercle, ce sont les trois secrétaires-
correspondants du conseil central de Londres présents à Paris :
Tolain, Fribourg et Limousin (remplacé par Varlin après le
Congrès de Genève). Henri Tolain, né en 1828 à Paris, ouvrier
ciseleur sur bronze, est indubitablement le chef de file.
Contrairement aux trois autres, il était en effet présent à la
réunion londonienne de 1863, puis au Saint Martin’s Hall, en
1864. Il a par ailleurs été l’un des rédacteurs principaux du
Manifeste des Soixante. Ernest Fribourg, graveur décorateur, n’était
4
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
pas à Saint-Martin’s Hall, mais il joue un rôle de premier plan
dans l’organisation des débats de la section avant le Congrès
de Genève, dans leur publicisation, aussi, puisqu’il est très
actif dans les éphémères journaux de la section, puis dans la
rédaction des statuts de l’association. Charles Limousin, né en
1840, est ouvrier d’imprimerie, et il a signé le Manifeste des
Soixante. En 1865, il est secrétaire-correspondant de fait en
remplacement de son père, Antoine Limousin, présent à Saint-
Martin’s Hall, empêché pour des raisons de santé de continuer à
être actif dans l’AIT. S’il ne participe pas au Congrès de
Genève puis quitte les instances dirigeantes de
l’Internationale, il a néanmoins un rôle important dans
l’organisation et la publicisation de l’action de la section,
notamment en lançant la Tribune ouvriere, éphémère publication de
la section parisienne de l’AIT. Enfin, Eugène Varlin, né en
1839 à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), est ouvrier relieur.
C’est sûrement le plus avancé de tous, il a déjà une solide
expérience de gréviste, de mutuelliste, de coopérateur, il est
le porte-parole à Genève de la minorité qui défend
l’amélioration du travail des femmes et l’enseignement
obligatoire pour tous6.
Ces quatre ouvriers ont en commun d’appartenir à des
professions qu’il serait faux d’assimiler au prolétariat de
type industriel. Le jeune Charles Limousin est ouvrier
d’imprimerie, mais flirte un peu avec le journalisme. Varlin
est pauvre, d’origine paysanne, mais son métier est assez
qualifié, et c’est un autodidacte brillant. Quant à Fribourg et
6 Michel Cordillot, Eugene Varlin, chronique d’un espoir assassiné (Paris: Editions ouvrières, 1991).
5
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Tolain, ce sont clairement des membres de ce que l’on a pu
appeler l’aristocratie ouvrière : la ciselure et la gravure
sont des métiers de précision, largement artisanaux, souvent
bien rémunérés, où les ouvriers ont eu un véritable
apprentissage. Les chefs de file de la section parisienne de
l’AIT ont donc un profil bien particulier d’artisans lettrés,
pas nécessairement tous membres de prestigieux corps d’Etat,
mais en tout cas pas recrutés dans la fraction la plus
prolétarisée de la classe ouvrière.
Ce constat peut-il être étendu au deuxième cercle, c’est-
à-dire aux vingt membres officiels de la commission de la
section parisienne en 1865, dont font partie les onze délégués
à Genève) ? Même si l’on n’a pas toutes les informations
nécessaires pour chacun des délégués, le Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier nous permet de donner quelques éléments
d’analyse.
Sur vingt membres, on connaît les dates de naissance de
quinze d’entre eux. Ils ont entre 24 et 49 ans au moment du
Congrès de Genève, 33 ans en moyenne. Ce ne sont donc pas de
très jeunes hommes, mais plutôt des jeunes pères de famille,
certainement installés pour la plupart. Sur les treize dont on
connaît les lieux de naissance, trois seulement sont nés à
Paris, et un autre en région parisienne. Sur les neuf autres,
si l’on utilise les découpages régionaux actuels, quatre
viennent de Rhône Alpes, deux du Centre, un de Bourgogne, un du
Nord pas de Calais et un de Champagnes Ardennes. Illustration
s’il en est de la très grande mobilité des travailleurs urbains
du milieu du XIXe siècle, cette diversité dans les origines
6
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
géographiques permet d’invalider l’hypothèse selon laquelle ces
représentants ouvriers seraient quasiment des petit-bourgeois
insérés de longue date dans l’artisanat parisien : la plupart
ont dû venir à Paris pour exercer leur profession, certainement
avec une fortune très réduite. Cette caractérisation est
confirmée par une analyse en termes de métier. Il apparaît en
effet que le recrutement de ces ouvriers est plus ouvert que
dans le premier cercle. Certes, quasiment tous sont des
ouvriers de métier, et parmi eux la plus grande partie exercent
des métiers ayant requis un long apprentissage et offrant une
réelle stabilité. Cependant, on trouve, à côté des ouvriers du
bronze et de l’imprimerie, un corroyeur, un cordonnier, un
carrossier, un mécanicien, et même un ouvrier journalier, le
jeune Benoît Malon, qui exerce toutes sortes de métiers non
qualifiés.
Ces ouvriers dits « proudhoniens », on le voit, ne sont
pas véritablement représentatifs des travailleurs français :
d’abord, il n’y a pas de femmes parmi eux, alors qu’elles
constituent un bon tiers des travailleurs ; ensuite, il n’y a
pas un seul paysan, du fait de la localisation urbaine de la
section, alors que cela reste, et de loin, le secteur qui
emploie le plus de bras en France ; enfin, parce que quasiment
tous appartiennent à des corps d’état organisés, ce qui est
logique, car ils ont vraisemblablement été, pour beaucoup, à un
moment ou un autre, choisis pour représenter leur métier au
sein de l’AIT. Cependant, ils ne forment pas non plus une caste
à part, exclusivement parisienne : ils viennent en majorité
7
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
« des départements », savent lire mais travaillent pour la
quasi-totalité en dehors de l’industrie de l’imprimerie, et il
est très probable qu’aucun n’est propriétaire de son outil de
production. Ni petite bourgeoisie, ni prolétariat, ce deuxième
cercle permet de dessiner une image assez représentative non
pas des travailleurs français, mais en tout cas du mouvement
ouvrier urbain, et en particulier parisien, que l’on retrouve
en première ligne de toutes les insurrections du siècle, de la
révolution de 1830 à la Commune de Paris.
Le rapide examen des biographies de ces vingt ouvriers
permet de noter quelques autres faits. Tout d’abord, un seul
d’entre eux a participé (de façon connue) à la révolution de
1848. Leur âge et leur origine géographique jouent, bien sûr,
mais ce constat permet d’invalider l’hypothèse d’une simple
continuité entre les insurgés de juin 1848 et les fondateurs de
l’AIT. Le seul à avoir participé à la révolution de 1848 est
Louis Debock, ouvrier typographe, combattant de Février.
Collaborateur de la première heure au Representant du Peuple de
Fauvéty et Viard, Debock a fait partie avec les frères Mairet,
Duchêne et Vasbenter, de la délégation d’ouvriers imprimeurs
qui a visité Proudhon le 26 février 1848 pour lui demander de
collaborer au journal. Est-ce qu’il y aurait là une explication
de la diffusion du proudhonisme parmi eux ? C’est possible. Une
autre source, mais le raisonnement est là plus alambiqué,
pourrait être la franc-maçonnerie. On le sait, Proudhon, comme
beaucoup de républicains et de socialistes, était maçon. C’est
aussi le cas d’au moins huit des vingt membres de la commission
8
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
de la section française de l’AIT – un chiffre certainement
sous-estimé, puisque nous sommes très loin d’avoir des
biographies complètes sur chacun d’eux. Enfin, cinq membres de
la commission ont signé le Manifeste des Soixante, et ont donc dû
porter un intérêt particulier à la réponse qu’en a fait
Proudhon.
Au final, seuls Debock et Zéphirin Camélinat7 ont eu des
relations avérées et suivies avec Proudhon. Même Tolain, le
chef de file des Gravilliers, n’est pas un proche de Proudhon,
comme le prouve notamment sa défense des candidatures ouvrières
en 1864, alors que Proudhon était un partisan résolu de
l’abstention. Les Gravilliers ne sont donc pas proudhoniens au
sens où ils seraient dans la sphère d’influence de Proudhon ou
qu’ils seraient des proches, contrairement à quelqu’un comme
Gustave Chaudey, et avant la création de l’AIT, ils ne sont pas
particulièrement des thuriféraires du bisontin. Ils
n’appartiennent ni à la même génération que Proudhon (ils ont
33 ans en moyenne), ni aux mêmes cercles, et il n’ont pas
d’expérience politique en commun. L’idée selon laquelle ce
groupe serait « proudhonien » doit donc être nuancée : ils ne
suivent pas Proudhon, ne le connaissent pas directement et
n’ont pas participé (sauf Deboeck) aux projets menés par
Proudhon en 1848, dans lesquels il collabore effectivement avec
les représentants ouvriers, anciens délégués de la Commission7 A partir de sa rencontre avec Charles Beslay en 1862. Michel Cordillot, ‘Camélinat-le-communard, de Mailly-La-Ville à l’exil outre-Manche’, in Zephirin Camelinat (1840-1932): une vie pour la sociale : actes du colloque historique organise au Musee Saint-Germain a Auxerre le 11 octobre 2003 par Adiamos-89, ed. by Michel Cordillot(Auxerre: Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 2004),pp. 13–51 (p. 20).
9
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
du Luxembourg (Le Peuple, la candidature Raspail à l’élection de
décembre 1848, la Banque du Peuple).
III. Le Mémoire des délégués français de 1866, un texte proudhonien
Pourquoi alors les qualifier de proudhoniens ? S’agirait-
il simplement d’une erreur de notre récit historique ? Il y a
lieu d’en douter, pour une raison simple : la référence à
Proudhon n’est pas seulement une assignation faite de
l’extérieur, par Marx ou par les historiens, c’est une
référence (inattendue) directement importée dans les débats de
l’AIT par les Gravilliers, en septembre 1866, lors du premier
Congrès de l’AIT à Genève. Onze délégués parisiens, trois
délégués lyonnais et un délégué des ouvriers de Rouen y sont
présents. Les parisiens y présentent un Memoire, composé
collectivement en août en réponse à l’invitation du conseil
général, auxquels s’associent immédiatement les autres délégués
français. C’est au cours de cet événement, et notamment lors de
la présentation et de la discussion de ce texte, que la pensée
des ouvriers de la section française de l’Internationale se
trouve définie.
Le Memoire est une longue réponse collective aux points de
l’ordre du jour décidés par le Conseil de Londres. Elle est
organisée par ces points, exposant chaque fois la position de
la section parisienne de l’AIT, et sur deux points (l’éducation
et le travail des femmes), précisant que cette position n’est
pas unanime mais majoritaire, et rendant compte aussi de
10
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
l’opinion minoritaire. Dans l’historiographie, ce mémoire est
censé marquer l’apogée du moment proudhonien de l’AIT, dans un
double sens. D’abord, parce que les ouvriers identifiés comme
proudhoniens y imposent leur vue, mais aussi et surtout parce
que c’est là que la pensée de Proudhon sert explicitement de
guide pour construire la doctrine de l’AIT.
En quoi ce mémoire est-il proudhonien ? La première raison
de cette qualification est que Proudhon est le seul auteur
explicitement cité comme référence, à trois reprises (une
maxime de Benjamin Constant est aussi présente, mais sans être
développée), et de façon extensive. Les textes cités sont
l’Idee generale de la revolution au XIXe siecle de 1851 et la Capacite politique
des classes ouvrieres de 1865, deux ouvrages très politiques et très
radicaux de Proudhon, en particulier le premier. Le choix de la
Capacite s’explique par le fait que cette œuvre a été réalisée
en réponse au Manifeste des Soixante, dont cinq signataires font
partie du premier et du second cercle de l’AIT. En revanche,
que l’Idee generale soit utilisée indique qu’au moins une partie
des délégués avaient une bonne connaissance de l’œuvre de
Proudhon, au-delà de ses écrits les plus récents ou les plus
populaires, et est très significatif de la perspective défendue
par les Gravilliers.
L’examen des extraits que les délégués ont choisi de citer
permet d’avoir une idée de ce qui les intéresse chez Proudhon.
La citation de la Capacite intervient à la fin du préambule du
mémoire :
« Avant de légiférer, d’administrer, de bâtir des palais,
des temples, de faire la guerre, la Société travaille,
11
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
laboure, navigue, échange, exploite les terres et les mers.
Avant de sacrer des rois et d’instituer des dynasties, le
peuple fonde la famille, consacre des mariages, bâtit des
villes, etc8. »
On l’aura compris, il s’agit de justifier une idée forte : la
primauté de l’économique et du social sur le politique, idée
constitutive du socialisme depuis Saint-Simon puis du mouvement
ouvrier lui-même. En effet, ce qui donne son sens à l’action
des travailleurs en tant que travailleurs, et non que citoyens
faisant abstraction de leur activité économique, c’est bien que
dans cette activité se joue quelque chose de plus important et
peut-être de plus digne que la politique entendue comme
activité liée à la législation et à l’administration, c’est-à-
dire à l’Etat. On peut noter que cette citation révèle aussi le
positionnement épistémologique des délégués parisiens, que l’on
pourrait qualifier de pragmatique ou de matérialiste. En effet,
l’idée sous-jacente au passage de la constatation que
l’activité économique prime sur l’étatique au choix d’ancrer
l’organisation dans le domaine économique, c’est qu’il faut
partir de l’examen de ce qui existe pour en tirer l’idée et des
propositions positives. Ce n’est pas des principes que l’on
doit déduire l’action, mais des faits – ici le fait de la
primauté de l’économique. Cette position n’est pas commune à
tous les socialistes, mais elle est indubitablement présente
chez Proudhon, qui ne cesse, en particulier dans les ouvrages
8 Memoire des delegues français au Congres de Geneve, in E. Fribourg, L’Association internationale des travailleurs, Paris, Le Chevalier, 1871, p. 54. La citation est tirée de Pierre-Joseph Proudhon, De la capacite politique des classes ouvrieres, Paris, E. Dentu, 1865, p. 205.
12
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
cités par les délégués, de vouloir partir de la réalité de
l’activité économique pour en penser la transformation.
L’Idee generale est citée à deux reprises. Le premier
extrait, très long, est invoqué par la majorité de la section
pour faire valoir la nécessité de laisser l’éducation à la
charge des familles, plutôt que de la confier à l’Etat9. En
réalité, l’extrait cité est plutôt consacré à la dénonciation
par Proudhon de deux choses : d’une part, la création, par
l’Etat, d’une véritable aristocratie à travers les Ecoles
supérieures, et d’autre part la séparation entre instruction et
apprentissage. Cette centralité de la question de l’éducation
ne doit pas étonner : le mouvement ouvrier du XIXe siècle donne
à cette question une place fondamentale, et l’AIT ne fait pas
exception. Cependant, la position familialiste défendue ici,
appuyée par une citation de Proudhon qui ne porte pas
exactement sur ce point, est loin de faire l’unanimité dans la
section de l’AIT, et la minorité, emmenée par Varlin, se
désolidarise de cette prise de position.
Enfin, la seconde citation de l’Idee generale, plus courte,
illustre la partie intitulée « La coopération distinguée de
l’association ». Elle définit le contrat,
« essentiellement synallagmatique : il n’impose
d’obligation aux contractants que celle qui résulte de leur
promesse personnelle de tradition réciproque ; il n’est
soumis à aucune autorité extérieure ; il fait seul la loi
commune des parties ; il n’attend son exécution que de leur
initiative10. »
9 Memoire, op. cit., p. 60-62.
13
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Il s’agit donc de s’appuyer sur Proudhon pour justifier la
coopération et le contrat comme principes d’organisation de la
société future. C’est là un point central, qui constitue une
véritable différence avec les ouvriers de tendance plutôt
communiste, et en premier lieu avec les proches de Marx. Cette
primauté accordée au contrat, qui ne fait pas alors débat au
sein de la section parisienne, est indubitablement au cœur de
la spécificité de la position de la section dans l’AIT, et
justifie que l’on parle à son propos de proudhonisme.
En résumé, Proudhon sert à appuyer trois éléments clés de
la perspective défendue à Genève par les ouvriers français : le
primat de l’économique sur le politique, l’importance de la
question éducative, la fondation de la société future sur le
contrat. Si Proudhon n’est pas le seul auteur à défendre chacun
de ces points, leur combinaison dessine une idéologie
suffisamment spécifique pour que l’on puisse parler ici de
proudhonisme à propos des délégués. D’autant que l’influence
proudhonienne n’est pas ici secrète, indirecte ou
inconsciente : il s’agit d’une prise de position revendiquée
publiquement. Les théories de Proudhon sur les rapports entre
l’économique et le politique, sur l’éducation et sur les formes
de la société ouvrière à venir sont citées et reprises à leur
charge par les rédacteurs du Memoire.
On comprend alors les raisons du recours à Proudhon : les
membres de la section des Gravilliers vont chercher chez cet
auteur la mise en forme et la défense de leurs conceptions du
rôle de l’AIT, et plus généralement de leur positionnement. Il
10 Ibid., p. 72-73. La citation est tirée de Pierre-Joseph Proudhon, L’Idee generale de la revolution au XIXe siecle, Paris, Garnier, 1851, p. 125.
14
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
faut donc renverser ici la perspective : ce n’est pas Proudhon
qui influence les membres de l’AIT, mais plutôt ceux-ci qui
utilisent Proudhon et son vocabulaire pour prendre position. La
preuve en est que les textes utilisés proviennent d’une phase
de l’œuvre de Proudhon que celui-ci juge dépassée, et que les
Gravilliers délaissent parallèlement les ouvrages de Proudhon
les plus importants de la dernière partie de son œuvre, De la
Justice dans la revolution et dans l’Eglise et surtout Du Principe federatif. Ce
qu’ils vont chercher, parfois contre la lettre des textes
cités, c’est une justification à deux prises de position
cruciales :
1° La critique du principe d’association, au sens communiste,
au profit d’une coopération reposant sur la libre adhésion des
individus, allant de pair avec une critique de l’Etat comme
organisateur de l’économie. Pour cela, ils utilisent le
Proudhon anarchiste de l’Idee generale de la revolution, pour qui le
gouvernement direct est la forme la plus achevée de
l’exploitation politique, et l’association la forme dernière de
l’exploitation économique. L’Etat lui-même est constamment
dénoncé : dans sa volonté d’entretenir une armée permanente,
dans sa volonté d’organiser l’enseignement, juste dans l’impôt,
par lequel
« l’armée, les tribunaux, la police, les écoles, les
hôpitaux, hospices, maisons de refuge et de correction,
salles d’asile, crèches et autres institutions charitables,
la religion elle-même sont d’abord payées et entretenues
par le prolétaire, ensuite dirigées contre lui ; en sorte
15
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
que le prolétariat travaille non-seulement pour la caste
qui le dévore, celle des capitalistes, mais encore pour
celle qui le flagelle et l’abrutit11. »
Cette dénonciation radicale de l’Etat n’est pas alors
caractéristique des socialistes, elle est en revanche tout à
fait typique de certains écrits de Proudhon, en particulier de
l’Idee generale, citée à deux reprises dans le Memoire. Mais c’est
surtout le lien entre Etat et communisme qui mérite d’être
noté, en ce qu’il annonce les très houleux débats sur la
question de l’Etat au sein de l’Internationale. Pour les
délégués français, comme pour Proudhon, les choses sont
claires : le communisme et l’étatisme, c’est tout un. C’est ce
qui ressort de leur critique de l’association, très proche de
celle que fait Proudhon, toujours dans l’Idee generale :
« L’association de l’aveu de ses fondateurs eux-mêmes,
devait fondre tous les intérêts, annihiler les différences,
créer l’égalité absolue; or quelle loi devait présider à
cette fusion des volontés? Etait-ce le libre contrat? Non
sans doute : car tous les réformateurs, Cabet, R. Owen,
Fourier, Louis Blanc, etc., tout comme Lycurgue, partent de
cette base que la société est tout, a seule des droits, et
que l’individu n’a que des devoirs12. »
On retrouve là la critique proudhonienne de la communauté,
jusque dans les attaques contre les socialistes étatistes comme
Louis Blanc ou utopistes comme Cabet, Owen et Fourier. Face à
cette conception, ils défendent la coopération :
11 Ibid., p. 78.12 Ibid., p. 71.
16
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
« Tandis que l’association englobe les individus qui,
cessant d’être des personnes, deviennent des unités, la
coopération au contraire, groupe les hommes pour exalter
les forces et l’initiative de chacun. En sorte que la somme
des services, produits, liberté et bien-être est pour
chacun d’autant plus considérable que les coopérateurs
contractants sont plus nombreux; et, dans ce sens, il est
vrai de dire que la tendance du principe coopératif
“mutualité, fédération” est l’universalité. Or, on n’en
saurait dire autant de l’association qui, au-delà de
certaines limites, et à plus forte raison universalisée,
aboutit fatalement à un communisme gouvernemental, ou une
haute personnification de la communauté est chargée de
faire, d’après son bon plaisir et sans responsabilité
aucune, la réglementation du travail, la répartition des
produits13. »
Le point est crucial pour Proudhon, il l’est pour les délégués
français : la coopération est fondamentalement plus juste que
l’association, car son extension – par la méthode fédéraliste –
augmente la liberté des travailleurs, alors que l’extension de
l’association la réduit. C’est donc la conception même des
liens individu/collectivité qui est antagoniste, entre
l’association et la coopération :
« Dans l’Association l’intérêt général était le principe
supérieur devant lequel s’inclinait l’individu ; dans la
Coopération, c’est la collectivité qui s’organise, en vue
de fournir à l’individu, tous les moyens d’augmenter sa
liberté d’action, de développer son initiative13 Ibid., p. 72-73.
17
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
individuelle. Enfin, l’Association parait avoir pour but
d’unir des personnes et des choses ; au contraire, la
Coopération nous semble indiquer l’union des choses, et non
des personnes14. »
Au cœur de la conception défendue par les délégués
français, on trouve donc les personnes, qui restent séparées,
mais mettent en commun leur force, sur le strict plan des
choses, c’est-à-dire du produit. C’est cette figure de
l’individu travailleur contractant avec d’autres individus,
s’engageant dans un processus mutuelliste et fédératif tout en
gardant sa liberté, qui constitue le cœur de la spécificité de
la pensée des délégués français de l’AIT, appuyée sur la
lecture d’une certaine partie de l’œuvre de Proudhon.
Cependant, il y a lieu de douter qu’ils tirent cet anti-
étatisme de la lecture de Proudhon. C’est en effet un élément
crucial de la culture ouvrière française de l’époque, ancrée
dans la tradition corporative, et surtout renforcée par l’échec
de l’expérience de la révolution de 1848. L’idée selon laquelle
la forme gouvernement serait intrinsèquement incompatible avec
les droits des travailleurs, ou en tout cas que la conquête
politique est seconde dans l’émancipation, résulte des
événements de 1848 et de l’insurrection de juin.
L’interprétation que Proudhon fait de cet épisode, et les
conclusions anti-étatiques qu’il en tire dans les Confessions d’un
revolutionnaire et l’Idee generale de la revolution, ne sont pas alors en
rupture avec l’expérience des ouvriers organisés, qui se
retirent largement de l’activité politique après juin – mais
elle est en revanche en rupture avec les vues d’un Louis Blanc,14 Ibid., p. 74.
18
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
dont l’influence diminue considérablement après juin. Proudhon
fait écho à l’expérience ouvrière, et c’est pour ça qu’il est
repris, non du fait d’une influence privilégiée sur les
Gravilliers. On peut ici citer la Capacite : « A [la] conception gouvernementale vient s'opposer celle
des partisans de la liberté individuelle, suivant lesquels
la société doit être considérée, non comme une hiérarchie de
fonctions et de facultés, mais comme un système
d'équilibrations entre forces libres, dans lequel chacune
est assurée de jouir des mêmes droits à la condition de
remplir les mêmes devoirs, d'obtenir les mêmes avantages en
échange des mêmes services, système par conséquent
essentiellement égalitaire et libéral, qui exclut toute
acception de fortunes, de rangs et de classes. Or, voici
comment raisonnent et concluent ces anti-autoritaires, ou
libéraux. [...] Ils disent donc que l'Etat n'est autre chose
que la résultante de l'union librement formée entre sujets
égaux, indépendants, et tous justiciers [...] qu'en
conséquence il n'y a pas, dans la société, d'autre
prérogative que la liberté, d'autre suprématie que celle du
Droit. L'autorité et la charité, disent-ils, ont fait leur
temps; à leur place nous voulons la justice.
De ces prémisses, [...] ils concluent à une organisation sur
la plus vaste échelle du principe mutuelliste. — Service
pour service, disent-ils, produit pour produit, prêt pour
prêt, assurance pour assurance, crédit pour crédit, caution
pour caution, garantie pour garantie, etc. : telle est la
loi. [...] De là toutes les institutions du mutuellisme :
assurances mutuelles, crédit mutuel, secours mutuels,
enseignement mutuel ; garanties réciproques de débouché,
19
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
d'échange, de travail, de bonne qualité et de juste prix des
marchandises, etc. Voilà ce dont le mutuellisme prétend
faire, à l'aide de certaines institutions, un principe
d'Etat, une loi d'Etat, j'irai jusqu'à dire une sorte de
religion d'Etat. »15
Et plus loin dans le même ouvrage : « Transporté dans la sphère politique, ce que nous avons
appelé jusqu'à présent mutuellisme ou garantisme prend le
nom de fédéralisme. Dans une simple synonymie, nous est
donnée la révolution tout entière, politique et
économique.... »16
La congruence entre ces extraits et ceux du Memoire des delegues
français à Genève font croire aux historiens (et à une partie des
acteurs de l’AIT) que c’est la preuve d’une influence de
Proudhon sur les ouvriers. Or il s’agit là du résultat d’un
préjugé selon lequel les ouvriers ont besoin de penseurs pour
leur dire comment penser. Il est bien plus probable, au regard
des emprunts stratégiques que les Gravilliers font à Proudhon,
et à l’absence de rapports directs qu’ils entretiennent avec
lui, que cette proximité résulte avant tout d’une rencontre
entre les idées de Proudhon et l’expérience ouvrière après
1848.
2° L’autonomie ouvrière, allant de pair avec l’idée d’un primat
de l’économique sur le politique, et une interprétation
ouvriériste de l’AIT, selon laquelle si l’Internationale est
ouverte à tous, seuls les travailleurs manuels doivent être
15 Ibid., p. 86-87.16 Ibid., p. 173.
20
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
délégués, et l’AIT doit se placer exclusivement sur le terrain
économique. Il s’agit là d’un point de controverse majeur au
sein de l’AIT, et qui donne sa spécificité aux prises de
position de la section parisienne. S’agit-il là d’un point
spécifiquement proudhonien ? Il y a lieu d’en douter : c’est un
point central dans le mouvement ouvrier français en
constitution depuis les années 1830. On le voit dans les
journaux ouvriers du début des années 1830, puis dans la
formation de l’Atelier. On en voit en particulier l’importance
dans les textes ouvriers fondamentaux de 1848 : le règlement du
Comité central des ouvriers du département de la Seine, qui
pose le principe des candidatures ouvrières séparées, puis le
manifeste des delegues des corporations (ayant siege au Luxembourg) aux ouvriers
du departement de la Seine, qui définit comme tâche pour les
ouvriers l’organisation autonome des rapports économiques, sans
attendre l’intervention de l’Etat. Pourquoi alors cette prise
de position est-elle vue comme proudhonienne ? D’abord, parce
que Proudhon l’a reprise en 1848 : au sein du journal Le Peuple,
qui voit l’alliance entre Proudhon et les anciens délégués du
Luxembourg, l’idée d’une action autonome du prolétariat est
posée est acceptée. Ensuite, parce qu’en 1848, en tant que
représentant, Proudhon a porté cette idée à l’Assemblée,
notamment dans le discours du 31 juillet où il a dit parler au
nom du prolétariat, contre la bourgeoisie. Enfin, parce que
c’est l’idée qui est au cœur de la Capacite politique des classes
ouvrieres, sous la forme de l’exhortation faite aux ouvriers de
se séparer de la bourgeoisie et de s’organiser. Au fond, cette
idée n’est pas proudhonienne en soi, mais Proudhon, pour des
21
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
raisons tenant à la fois à la doctrine et à la stratégie
politique, s’en est fait à plusieurs moments le porte-drapeau.
On la retrouve dans la tradition ouvrière française,
indépendamment de Proudhon. Parmi les internationalistes, elle
est notamment défendue par Charles Limousin, pourtant plutôt
fouriériste que proudhonien, dans le « Discours
d’inauguration » du journal La Tribune ouvriere. Sciences – arts – industrie
– litterature, éphémère publication de la section parisienne de
l’AIT, vendue 5 centime17. Il y défend l’idée de la nécessité,
en matière de jugement intellectuel, de l’autonomie ouvrière :
« Quelques hommes de bonne volonté, ouvriers pour la
plupart, comprenant qu’au milieu du mouvement intellectuel
de notre époque il n’est plus suffisant qu’il y ait des
publications destinées aux ouvriers, mais qu’il faut aussi
qu’il y en ait émanant d’eux, entreprennent de fonder un
journal littéraire, scientifique et artistique, qui sera
rédigé principalement par des ouvriers. [...] Il est
évident que les ouvriers qui, en nombre chaque jour plus
considérable, demandent à participer à l’héritage
intellectuel des générations passées, doivent avoir sur
les sciences, les arts ou les lettres, une manière de voir
différente de celle des hommes exerçant ce que l’on
appelle les professions libérales. [...] Nous espérons que
ce journal deviendra une sorte de thermomètre des classes
laborieuses. Ce sera une voix de la foule s’adressant à17 Michel Cordillot a bien montré « l’existence de liens organiques entre lemouvement fouriériste et l’AIT » par le biais de cette publication, animée par deux fouriéristes, Charles Limousin son directeur, Antoine Bourdon son secrétaire de rédaction et Adolphe Clémence chez qui les bureaux sont installés. Cordillot, ‘Le fouriérisme dans la section parisienne de la Première Internationale (1865-1866)’, p. 23.
22
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
ceux qui savent, pour leur indiquer sur quels points ils
doivent porter leur action, et appréciant, en tant que les
lois le permettront, les efforts tentés pour amener le
bien-être matériel et moral des masses. A cet objet, très
large, nous en joindrons un autre plus spécial, jusqu’ici
trop négligé en France : l’étude de la parole. Par la
parole, j’entends la reproduction de la pensée, à l’aide
de mots, tant écrite que verbale. [...] A quelque sexe, à
quelque condition sociale qu’on appartiennen, posséder la
parole est d’une importance capitale à tous les points de
vue. [...] Cela est triste à dire ; mais aujourd’hui [...]
la faculté d’exprimer par des mots les conceptions du
cerveau est encore le privilège de quelques personnes
ayant fait des études spéciales. Quant au reste des
humains, et le reste, lectrices et lecteurs, c’est la
plupart de ceux qui, comme vous en moi, passent leur vie à
faire subir à la matière les transformations qui la
rendent consommable ; quant au reste, dis-je, ils sont
réduits, pour exprimer leurs pensées, à un nombre très
restreint d’expressions ne réalisant quelque fois que de
très loin l’accord de l’expression et de l’idée. [...] La
seconde des causes que j’ai annoncées, c’est le défaut
d’exercice. Rien ne se fait sans travail. [...] La Tribune
ouvriere est fondée pour faire FAIRE L’EXERCICE de la
parole aux ouvriers et aux ouvrières (oui, mesdames, nous
aussi nous vous appelons). [...] Ecrire ou parler ne
doivent pas être un métier ; quiconque est susceptible de
concevoir ou de comprendre une pensée doit savoir
23
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
l’exprimer, et si cette pensée peut être utile à autrui,
il doit trouver une tribune pour parler, un journal pour
écrire. »
On le voit, les ouvriers n’ont pas besoin de Proudhon pour
développer une défense argumentée de l’autonomie ouvrière, quel
qu’en soit le domaine.
Que peut-on en conclure ? D’une part, Proudhon est
indubitablement l’auteur majeur invoqué par les délégués de la
section parisienne de l’Internationale. Cependant, il est cité
en appui de deux idées qui s’ancrent dans une expérience
ouvrière dont Proudhon a lui même hérité, qu’il a mise en mots,
mais dont il n’est pas l’inventeur. Pour cette raison, parler
de proudhoniens à propos des Gravilliers peut sembler excessif,
ou en tout cas trompeur.
III. Le moment proudhonien de l’AIT
Faut-il en déduire qu’il n’y a pas de proudhonisme à l’AIT ?
C’est ce dernier pas qu’il faut à mon avis éviter de franchir.
Pour en comprendre les enjeux, il est nécessaire d’intégrer
cette réflexion dans le cadre plus large de la question
historiographique de l’influence de Proudhon sur le mouvement
ouvrier, et en particulier sur les ouvriers organisés18. De
l’apparition du syndicalisme révolutionnaire jusqu’aux travaux
des historiens contemporains du mouvement ouvrier ou de
l’anarchisme, la question a été posée : comment expliquer les
18 Pour une présentation complète de l’histoire et des enjeux épistémologiques de cette question, voir Patrice Rolland, « À propos de Proudhon : une querelle des influences », Revue française d’histoire des idees politiques, n° 2, 1995, p. 275-300.
24
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
similitudes que l’on peut observer entre la pensée de Proudhon
et celle des ouvriers organisés ?
Les raisons de cette similitude ont été analysées et
discutées par plusieurs générations de chercheurs. Tout
d’abord, par ceux qui ont directement vécu la création de la
CGT, et pour lesquels le syndicalisme français est assimilable
au syndicalisme révolutionnaire. Cette expérience est en effet
contemporaine, en France, d’un véritable « retour à
Proudhon »19. On pense évidemment à Georges Sorel et à Edouard
Berth20, mais il ne faudrait pas oublier l’importance de cette
question pour toute une génération d’historiens et de
juristes : Jules-Louis Puech consacre en 1907 une thèse au
proudhonisme dans l’Internationale21, Gaëtan Pirou une autre,
en 1910, sur le proudhonisme et le syndicalisme
révolutionnaire22, Maxime Leroy mène de front ses études sur
les idées sociales et son analyse exhaustive des règlements
d’associations ouvrières23, Edouard Droz s’interroge
directement, dans sa biographie de Proudhon, sur son influence
sur le mouvement ouvrier24, Lucien Febvre consacre à ce livre
un long article dans lequel il explore lui-même la question25…
Il faut attendre le second « retour à Proudhon » des années
19 Patrice Rolland, « Le retour à Proudhon, 1900-1920 », Mil neuf cent, vol. 10, n° 1, 1992, p. 5-29.20 Patrice Rolland, « La référence proudhonienne chez Georges Sorel », Cahiers Georges Sorel, vol. 7, n° 1, 1989, p. 127-161.21 Jules-Louis Puech, Le Proudhonisme dans l’Association internationale des travailleurs, Paris, F. Alcan, 1907.22 Gaëtan Pirou, Proudhonisme et syndicalisme revolutionnaire, Paris, A. Rousseau, 1910.23 Maxime Leroy, La Coutume ouvriere, Paris, 1913.24 Edouard Droz, P.-J. Proudhon (1809-1865), Paris, Pages libres, 1909.25 Lucien Febvre, « Une question d’influence : Proudhon et le syndicalisme », Revue de Synthese historique, vol. 19, n° 56, 1909, p. 179-193.
25
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
1960-1970 pour que la question retrouve une importance. Dans un
contexte marqué par l’affaiblissement du marxisme orthodoxe,
par la critique du « socialisme réel » et par la montée en
puissance du thème de l’autogestion, Proudhon fait alors
l’objet d’une redécouverte, et la question de son lien avec le
mouvement ouvrier devient d’autant plus importante que l’on
essaie alors d’en renouveler les formes. Parmi toute la
production de cette époque, il faut accorder une place
particulière à l’ouvrage de Pierre Ansart, Naissance de
l’anarchisme : esquisse d’une explication sociologique du proudhonisme (1970).
L’auteur s’y donne comme objectif de comprendre, comme d’autres
avant lui, « pourquoi les représentants ouvriers français au
sein de la Ière Internationale choisissent de se référer à
Proudhon »26 ; cependant, il choisit de chercher la réponse non
pas dans la diffusion de l’œuvre de Proudhon, mais dans ses
conditions mêmes de formation. Selon lui, c’est parce que la
pensée de Proudhon a été élaborée en interaction avec le
mouvement ouvrier des années 1830 et 1840, et en particulier
avec la pratique des canuts lyonnais, qu’elle trouve tant
d’échos dans le mouvement ouvrier en construction. Hormis cet
ouvrage fondamental de sociologie des idées, la question de
Proudhon et de son héritage font dans ces années l’objet de
nombreux textes, souvent très marqués politiquement27.
26 Pierre Ansart, op. cit., p. 17.27 Centre national d’étude des problèmes de sociologie et d’économie européennes, L’Actualite de Proudhon. Colloque des 24 et 25 novembre 1965, Bruxelles, Editions de l’Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, 1967. Jacques Julliard, Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action directe, Paris, Seuil, 1971. Jacques Langlois, Defense et actualite de Proudhon, Paris, Payot, 1976.
26
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Dans ces différents travaux, on peut dire avec Annie
Kriegel que deux hypothèses s’affrontent pour expliquer la
proximité entre la pensée de Proudhon et le syndicalisme
révolutionnaire : l’hypothèse de la filiation et celle de la
rencontre. Selon la première, il existe un lien plus ou moins
direct entre la pensée de Proudhon et la création du
syndicalisme révolutionnaire. Dans cette perspective, la CGT
est l’héritière de Proudhon, et n’aurait pas pris les mêmes
formes sans l’influence du bisontin. Cette filiation passe par
certains canaux, variables selon les auteurs : par les
anarchistes (hypothèse invalidée par Manfredonia), par la
Commune, dont « toutes les propositions [...] sont tirées en
droite ligne de l’œuvre de Proudhon »28, par les fondateurs de
la CGT, et bien sûr par l’intermédiaire de l’AIT. Selon Puech,
la référence à Proudhon n’est pas nécessairement au fondement
de l’action des ouvriers français de l’AIT, mais elle devient
rapidement consciente et explicite, jusqu’à culminer au Congrès
de Genève, en 1866 :« Au début du mouvement, quelques années auparavant, quoiqueun petit nombre d’ouvriers eussent lu une faible partie desœuvres de Proudhon, on peut dire que les idées du prolétariats’étaient rencontrées involontairement avec celles duphilosophe socialiste arrivant au déclin de sa vie, plutôtqu’elles n’en avaient subi l’influence. Mais en 1866, lasimilitude d’opinions est consciente et les mutuellistesparisiens savent qu’ils sont proudhoniens. »29
Ainsi, selon Puech, ce qui au départ n’est qu’une rencontre se
transforme en filiation. Dans des textes précédents, j’ai
essayé pour ma part de montrer l’existence d’une troisième
voie, à côté des hypothèses de la filiation et de la rencontre.
28 Ibidem, p. 27.29 Jules-Louis Puech, op. cit., p. 120.
27
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
L’hypothèse du « moment proudhonien » est que Proudhon offre
aux ouvriers français des solutions pour penser leur action
après l’échec de l’insurrection de juin. En effet, il se trouve
alors dans une position privilégiée qui lui permet de faire
connaître sa pensée : la plupart des autres chefs socialistes
ont été victimes de la répression, le gouvernementalisme
républicain a échoué, Proudhon a un réel poids dans les
journaux ouvriers, il mène le combat de la candidature de
Raspail aux élections de décembre 1848, il conduit l’expérience
de la Banque du Peuple avec les délégués ouvriers avant son
emprisonnement en 1849, il a accès à une tribune nationale par
sa position de député, il est considéré par les conservateurs
comme leur adversaire principal… Tous ces facteurs s’agrègent
pour donner à Proudhon une réelle audience dans une classe
ouvrière en construction, déstabilisée dans son identité
politique même par l’insurrection de juin et par sa répression.
Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’on retrouve
Proudhon comme référence majeure pour les fondateurs de la
section parisienne de l’AIT, puis plus tard chez les fondateurs
du syndicalisme révolutionnaire. Il ne s’agit ni de filiation,
ni de rencontre, mais d’un processus croisé de construction
idéelle des pratiques ouvrières et de construction sociale des
théories politiques socialistes. L’idée est la suivante : à
certains moments du processus de construction de la classe
ouvrière, ses pratiques font l’objet d’une réflexivité, d’une
systématisation et d’une formalisation quasi-juridique, qui
peuvent emprunter des outils théoriques et conceptuels
extérieurs à la tradition ouvrière. Une première formalisation
28
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
a lieu en 1830-1834, à laquelle Proudhon est étranger. Mais il
découvre à Lyon puis à Paris cette classe ouvrière déjà mise en
forme, composée d’individus qui pensent appartenir à une classe
capable d’agir comme un sujet politique, ayant adopté un
nouveau langage, une nouvelle manière de formuler leurs
pratiques et leurs revendications traditionnelles. Suite à
l’épreuve de juin 1848, Proudhon participe à la reconstitution
de la classe ouvrière, d’un nouveau formalisme qui débouche
ensuite sur un ensemble de pratiques sinon nouvelles, du moins
entièrement repensées, grâce aux outils conceptuels apportées
notamment par Proudhon (coopération économique, refus de l’Etat
et du jeu politique, autonomie par rapport à la bourgeoisie).
Avec l’apparition de l’Internationale, puis du syndicalisme
révolutionnaire, c’est un troisième temps de la construction de
la classe ouvrière qui a lieu, par idéalisation des pratiques
existantes… mais qui sont elles-mêmes marquées par l’influence
de Proudhon, au moins dans la façon dont elles se trouvent
formulées. Cette nouvelle formalisation n’est pas la
reproduction de la précédente, d’où des divergences réelles
avec Proudhon ; mais elle travaille une matière, la coutume
ouvrière, qui a déjà été marquée par le proudhonisme, d’où les
similitudes frappantes. C’est cela, l’hypothèse du moment
proudhonien : la diffusion large de pratiques ouvrières
préexistantes, mais formalisées en partie, au sein de la classe
ouvrière, à l’aide du vocabulaire et des idées de Proudhon, à
l’exclusion d’autres possibilités (soumission au pouvoir
politique, refus de conflictualité, appui sur le capital…).
29
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
On peut donc dire que parler de proudhonisme à propos des
membres parisiens de l’AIT n’est pas réellement un contresens,
du moment que l’on n’entend pas par proudhonisme signifier
l’adoption passive des idées de Proudhon par les Gravilliers,
mais souligner l’existence d’une convergence et d’une
interaction entre Proudhon (comme penseur et comme acteur
social et politique) et une partie des ouvriers, notamment
parisiens. Cependant, si l’on peut parler de « moment
proudhonien » et pas seulement de rencontre, c’est que cette
interaction, initialement localisée, a des effets bien au-delà
des seuls acteurs en présence, ici le groupe des Gravilliers.
Si ceux-ci invoquent Proudhon à l’appui de leurs convictions,
la référence à Proudhon produit par elle-même des effets au
sein de l’AIT, et par là au sein du mouvement ouvrier
international. On peut en particulier en relever trois.
Le premier effet porte sur la construction du proudhonisme
comme idéologie. La présentation sélective qu’en font les
Gravilliers donnent à la pensée de Proudhon une cohérence et
des traits qui ne sont pas nécessairement les plus saillants de
son œuvre. Ainsi, l’image d’un Proudhon ouvriériste,
anarchiste, coopérativiste, opposé à la grève, se construit
largement à partir des controverses qui ont lieu au sein de
l’AIT, respectivement autour de la question du rôle des non-
ouvriers dans l’organisation, de l’Etat, de la propriété des
moyens de production et de la stratégie d’émancipation. D’une
certaine manière, ce n’est pas Proudhon qui a fait les
Gravilliers, mais plutôt les Gravilliers qui ont « fait »
Proudhon, c'est-à-dire qui ont formé une certaine image de
30
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
Proudhon. Ce dernier se trouve ainsi érigé en inspirateur d’un
courant de l’AIT auquel il n’a pourtant pas participé : on
parle indifféremment des proudhoniens, des marxistes et des
bakouninistes, sans prendre en considération le fait que si
Marx et Bakounine ont effectivement eu des positions dans
l’Internationale, Proudhon n’y est qu’un fantôme. C’est peut-
être là une des raisons qui font que Proudhon est le plus connu
et le plus lu des socialistes français à partir des années
1870, alors que vingt ans avant Louis Blanc, Cabet ou même
Considerant avaient une audience incomparablement plus large.
Ainsi le proudhonisme des Gravilliers marquent d’abord
l’histoire de l’AIT en faisant de Proudhon un des auteurs
canoniques du mouvement ouvrier et du socialisme international,
un des moyens de baliser l’espace des prises de position au
sein de l’organisation et du champ politique et syndical.
Un second effet de la référence à Proudhon, qui n’est pas
exactement congruent avec le premier, est l’adoption, au-delà
du groupe des Gravilliers, d’un vocabulaire proudhonien. On l’a
dit, le vocabulaire de Proudhon est lui-même né de
l’observation du monde ouvrier et d’un travail d’idéalisation :
ainsi, comme l’a montré Pierre Ansart, le mutuellisme n’est pas
une invention de Proudhon, c’est avant tout une pratique
ouvrière des canuts lyonnais, dont Proudhon essaie de trouver
l’idée. Il fait de même, dans la Capacite, avec les pratiques
d’association ouvrière développées depuis la révolution de 1848
– et auxquelles il a lui-même contribué en tant qu’acteur
politique avant son emprisonnement en 1849. L’exemple le plus
frappant est certainement celui de fédération : l’idée d’une
31
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
association d’associations ne vient pas de Proudhon, on la
trouve chez le cordonnier Efrahem dans les années 1830, chez
Flora Tristan dans les années 1840, puis à partir de 1848 dans
l’ensemble du mouvement ouvrier. Mais le vocabulaire de la
fédération, importé du champ politique, appliqué à l’économie
et à l’organisation ouvrière elle-même, porte indubitablement
la marque de Proudhon. Le mot, et non la chose, mais le choix
du mot n’est pas sans importance, en particulier lors des
controverses comme celle portant sur le rôle du Conseil général
ou sur l’engagement politique des sections. Ainsi, en 1870, les
jurassiens font voter la résolution suivante :
« Le congrès romand commande à toutes les sections de
l'A.I.T. de renoncer à toute action ayant pour but
d'opérer la transformation sociale au moyen des réformes
politiques nationales, et de porter toute leur activité
sur la constitution fédérative de corps de métiers, seul
moyen d'assurer le succès de la révolution sociale. Cette
fédération est la véritable représentation du travail, qui
doit avoir lieu absolument en dehors des gouvernements
politiques. »
L’utilisation du vocabulaire fédératif permet aux bakouninistes
d’unifier et de mettre en cohérence trois idées principales :
l’AIT doit être elle-même organisée de façon fédérative, contre
l’autorité d’un Conseil général qui soit plus qu’un comité de
liaison ; ses sections doivent chercher à fédérer les corps de
métiers, avec l’idée sous-jacente d’une organisation autonome
et fédérative de l’activité économique ; au principe fédératif,
seul vrai, s’oppose le gouvernement politique, le principe
32
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
gouvernemental, intrinsèquement autoritaire. Les idées de
fédéralisme et de mutuellisme ne sont pas seulement des moyens
de nommer des états de choses déjà existants : ils fonctionnent
aussi comme opérateurs, comme intégration de différentes idées
qui existaient jusque là chez certains ouvriers, mais
séparément, et donc de transmission ensuite de ces idées comme
intrinsèquement liées entre elles. En cela, le vocabulaire
proudhonien a un effet sur l’AIT, au-delà des seuls Gravilliers
et de leurs intentions initiales dans leur référence à
Proudhon.
Enfin, le troisième effet de la référence à Proudhon
concerne ce que les politistes appellent l’agenda-setting, la
mise sur agenda. Avec leur Memoire, les ouvriers parisiens
entendent répondre aux questions posées par le Conseil général.
Ces questions sont les suivantes :
« 1° Quel doit être le but de l'association internationale
? Quels peuvent être ses moyens d'action 1
2° Du travail, de ses conséquences hygiéniques et morales;
de l'obligation du travail pour tous;
3° Du travail des femmes et des enfants dans les
fabriques, au point de vue sanitaire et moral;
4° Du chômage : des moyens d'y remédier;
5° Des grèves : de leurs effets;
6° De l'association: son principe, ses applications;
7° De l'enseignement primaire et professionnel;
8° Des relations du capital et du travail;
9° De la concurrence étrangère ; traité de commerce;
33
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
10° Des armées permanentes au point de vue de la
production;
11° La morale est-elle distincte de la religion? »
Les Gravilliers s’y appliquent, mais dans la réponse, en
utilisant Proudhon, ils introduisent une idée qui sera
rapidement l’objet l’une des controverses fondamentales de
l’AIT : la question de la propriété. Cette question n’est
évidemment pas étrangère au Conseil général, et certainement
pas à Marx ; cependant, la question de la définition du régime
de propriété, au-delà de la simple division propriété
privée/publique, ou propriété bourgeoise/communiste que l’on
trouve dans le Manifeste communiste, est indubitablement
introduite par les Gravilliers, dans leur discussion, largement
appuyée sur Proudhon, de la distinction entre association et
coopération. La question de la propriété n’est évoquée ni dans
les statuts de l’AIT ni dans les prises de position du Conseil
général avant le Congrès de Lausanne. Certes, ce n’est pas
Proudhon qui influence directement les ouvriers parisiens, mais
sa manière très spécifique de poser les problèmes, son intérêt
pour la question du régime juridique de propriété, sa volonté
de faire jouer l’antinomie entre propriété et communauté, a une
importance capitale sur les débats suivants. C’est notamment
César de Paepe, connaisseur de Proudhon, qui rebondit dès le
Congrès de Lausanne sur les propositions des Gravilliers pour
discuter des différentes formes de propriété, de leur
adaptation ou non à la terre, aux moyens de production, etc.,
qui permet l’émergence bientôt majoritaire d’un courant
collectiviste distinct à la fois du mutuellisme et du
34
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
communisme. Alors oui, on peut dire que dans ce débat les
proudhoniens ont perdu, et ce dès le Congrès de Bruxelles ;
mais la façon proudhonienne de considérer le problème a gagné.
Qu’est-ce que la propriete ?, sa question de 1840, est devenue la
question du mouvement ouvrier tout entier.
En conclusion, que peut-on dire du proudhonisme dans
l’Internationale ? D’abord, qu’il faut mettre en question ce
terme : il n’y a pas un proudhonisme qui serait du même ordre
que le marxisme ou le bakouninisme, car c’est un proudhonisme
sans Proudhon. Les Gravilliers ne sont globalement pas
proudhoniens, si l’on entend par là une proximité avec Proudhon
de son vivant (c’est seulement le cas de Louis Deboeck), ou
même une influence directe par la pensée du bisontin. En
revanche, Proudhon est bien la référence centrale de ces
ouvriers lorsqu’ils veulent appuyer leurs idées, pour une
raison forte, qui est que Proudhon et eux ont forgé ces idées
aux mêmes sources, issues des organisations ouvrières
précédentes et de l’expérience de la révolution de 1848 –
Proudhon lui-même ayant eu une importance cruciale dans la
diffusion parmi les ouvriers d’une interprétation anti-étatiste
des conséquences de cette révolution sur la stratégie ouvrière.
Les Gravilliers ne vont pas chercher chez Proudhon des idées –
ils n’ont pas besoin de lui pour penser – mais ils trouvent
chez lui l’écho de leurs propres idées, et se servent de ses
textes comme d’armes dans les controverses qui naissent au sein
de l’AIT. Cependant, cette opération n’est pas sans effet sur
l’AIT puis sur le mouvement ouvrier : Proudhon y devient une
35
Colloque « Il y a 150 ans, la Première internationale », Paris,19-20 juin 2014
référence (pour y adhérer ou s’y opposer), une partie de son
vocabulaire s’y impose, et certains thèmes de sa pensée, en
particulier la discussion de la propriété, deviennent des
points cruciaux de l’agenda de l’AIT, alors qu’ils étaient
auparavant marginaux.
Quant aux proudhoniens eux-mêmes, leur itinéraire
postérieur à l’expérience de la fondation de l’Internationale
prouve d’ailleurs la très grande diversité de leurs opinions,
et donc le peu de pertinence de l’étiquette proudhonienne.
Certains n’occuperont plus de rôle dirigeant après 1867 ; sur
ceux restants, une partie restera attachée au mutuellisme, une
autre partie rejoignant les collectivistes anti-autoritaires.
La plupart participèrent activement à la Commune (Camélinat,
Debock, Laplanche, Limousin, Malon, Varlin, Murat), certains se
tinrent à l’écart (Chemalé, Fournaise), d’autres allèrent
jusqu’à prendre parti contre elle (Fribourg, Tolain, Héligon).
De toute évidence, la référence à Proudhon n’engage pas à
l’adoption d’une doctrine – c’est peut-être là une des raisons
de sa faiblesse dans l’AIT, mais aussi une des clés de sa
résilience.
36