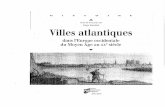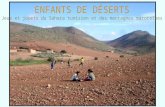"Les itinéraires d’al-Idrīsī dans le Sud tunisien : deux versions bien différentes"...
Transcript of "Les itinéraires d’al-Idrīsī dans le Sud tunisien : deux versions bien différentes"...
Vorstand der Deutschen Morgenlândischen Gesellschaft e.V. (DMG) 1.Vorsitzender und Beauftragter fur die DMG-Bibliothek: Prof. Dr. Stefan Leder, Orientwissenschaft-liches Zentrum, Martin-Luther-Universith Halle-Wittenberg, Mühlweg 15, 06099 Halle (Saale), E-Mail: [email protected]; 2. Vorsitzender: Manfred Hake, Suclasien-Institut, Ruprecht-Karls-Uni-versiat Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 330, 69120 Heidelberg, E-Mail: [email protected].
de; 1. Geschâftsführer: Prof. Dr. Jens Peter Laut, Orientalisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universitât Freiburg, Werthmannplatz 3, 79085 Freiburg i. Br., E-Mail: [email protected]; 2. Ge-
schâftsführer und Schriftleiter der ZDMG: Prof. Dr. Florian C. Reiter, Sinologie, Humboldt-Universitât Berlin, Unter den Linden 6,10099 Berlin, E-Mail: [email protected]; Schatzmeister: Andreas Pohlus, Institut fur Indologie und Südasienwissenschaften, Martin-Luther-Univershât Halle-Wittenberg, Emil-Abderhalden-Str. 9, 06099 Halle (Saale), E-Mail: [email protected]; Beisitzer: Prof. Dr. Heidrun Bruckner, Indologie, Universitât Würzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, E-Mail: Heidrun. [email protected] ; Prof. Dr. Dymitr Ibriszimow, Lehrstuhl Afrikanistik II, Universith Bayreuth, 95440 Bayreuth, Tel. 0921/55 35 81; Prof. Dr. Ulrich Marzolph, Enzyklopâdie des Mârchens, Friedlânder Weg 2, 37085 Giittingen; Dr. Anja Pistor-Hatam, Weidenweg 16, 52074 Aachen
Homepage der DMG: http://www.dmg-web.de
Redaktion der ZDMG (verantwortlich): Prof. Dr. Florian C. Reiter (s. o.)
Erscheinungsweise: Jâhrlich 2 Hefte
Bezugsbedingungen: Jahresabonnement E 84,—, Einzelheft f 43,50,—, jeweils zuzüglich Versandkosten. Ein Abonnement gilt, falls nicht befristet bestellt, zur Fortsetzung bis auf Widerruf. Kiindigungen mils-
sen bis zum Ablauf eines Jahres erfolgen. Mitglieder der DMG erhalten die Zeitschrift fur den M itglieds-beitrag (€ 60,— p. a.). Bestellungen an den Harrassowitz Verlag (s. u.) oder über jede Buchhand lung.
Antrâge auf Eintritt in die DMG an den 1. Geschâftsführer, Prof. Dr. Jens Peter Laut (s. o.), Anschriften-ânderungen an den Schatzmeister der DMG, Andreas Pohlus (s. o.).
Fachartikel und Rezensionen: Autorenrichtlinien (style sheet) liegen dem Jahresinhaltsverzeichnis in Heft 2 bei und kiinnen von der Homepage der DMG (s. o.) heruntergeladen werden. Es ist erforderlich, Beitrâge fur die ZDMG ais Datei und als Papierausdruck einzureichen. Rezensionsexemplare werden von den Mitherausgebern angefordert. Rezensionsangebote an die Schrift- leitung werden entsprechend weitergeleitet. Für unaufgefordert eingesandte Rezensionsexemplare besteht weder ein Recht auf Besprechung noch auf Rücksendung. Wenn erwünscht, wird eine Replik verbflent- licht, jedoch keine Gegenreplik. Der Redakion angebotene Beitrâge dürfen nicht bereits verüffentlicht sein oder gleichzeitig verafentlicht werden. Wiederabdrucke erfordern die Zustimmung der Herausgeber. Die ZDMG ist ein refereed journal.
Die Autoren sind fur die wissenschaftlichen Aussagen und Meinungen in ihren Beitrâgen ausschliefllich selbst verantwortlich.
Herstellung und Vertrieb der ZDMG Satz und Layout: Claudius Naumann, Ernst-Thâlmann-Str. 79, 14532 Kleinmachnow, E-Mail: [email protected] Verlag: Harrassowitz Verlag, 65174 Wiesbaden, Fax: 0611-530999, E-Mail: [email protected],
http://www.harrassowitz-verlag.de
© Deutsche Morgenlândische Gesellschaft e.V., 2007 Die Zeitschrift einschlidlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung aufierhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der DMG unzulâssig und strafbar. Das gilt insbesondere fur Vervielfâltigungen jeder Art, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und fur die Einspeicherung in elektronische Systeme. Druck und Verarbeitung: AZ Druck und Datentechnik, Kempten (Allgâu) Gedruckt auf alterungsbestândigem Papier Printed in Germany
ISSN 0341-0137
Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien : deux versions bien différentes
Par VIRGINIE PREVOST, Frasnes-lez-Anvaing
Si le Kitàb nuzhat al-mk&âq fi btiràq al- àfàq d'al-Idrisi' a été considérable-ment exploité, ce n'est pas le cas de son second ouvrage géographique, le Uns
al-muhag wa-rawcil al-furag. La comparaison entre ces deux textes s'avère pourtant fort intéressante : les renseignements concernant l'Ifriqiya mon-trent des différences importantes, tant du point de vue du développement accordé à tel ou tel lieu que des évaluations de distance.' Le Sud tunisien, compris dans la deuxième section du troisième climat, est un bon exemple de l'opposition entre les deux ouvrages et on constate en examinant les itinérai-res qui relient les points principaux un grand nombre de divergences. Cette région, célèbre pour ses productions de qualité et pour son rôle de marché au carrefour d'importantes routes commerciales, présente également l'avantage d'avoir été relativement bien détaillée par les géographes, ce qui nous offre de multiples points de comparaison pour étudier les renseignements d'al-Idrisi. Nous nous limiterons ici aux oasis proprement dites, Gabès (Qàbis), Gafsa (Qafsa), les oasis de la Qastiliya connues aujourd'hui sous le nom d'oasis du Djérid (arid) et celles du Nafzàwa, situées au sud de la grande sebkha ou chott al-Djérid (voir carte).
1) Le Nuzhat al-muatàq fi btiràq al- àfàq
Al-Idrisi commence sa description du Sud tunisien par Tozeur (Tawzar), chef-lieu/mactina de la Qastiliya, et établit les itinéraires suivants : de Tozeur, en marchant vers le sud-est pendant une petite étape, on atteint la ville d'al-klamma. À environ vingt milles se trouve Taqyùs, une jolie ville prospère située entre al-F.lamma et Gafsa. Taqyfis est séparée de Gafsa par une étape.' De Gafsa à Nefta (Nafta), il y a deux petites étapes. De Gafsa au Nafzâwa,
' Pour le Kitàb nuzhat al-muSidq, les notes font référence à l'éd. italienne Opus geo- graphicum, fasc. 3, 1972.
Ainsi, dans le Kitàb nuzhat al-mtatàq, al-Idrisi 1972 accorde un long développe-ment (pp. 305 -306) à deux îles du Sud tunisien, Djerba et Zira, alors qu'il les ignore dans le Uns al-muhai
Al-Idrisi 1972, p. 277.
354 VIRGINIE PREVOST
Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien 355
au sud, on compte un peu plus de deux jours ; de Tozeur au Nafzàwa, il faut un jour et une longue demi-journée.' De Nefta à Gabès, il y a un peu plus de trois étapes'. 5
Les indications fournies par le géographe comportent plusieurs erreurs et approximations. Tout d'abord, « al-Hamma » est mal située : elle se trouve en réalité au nord de Tozeur et non pas au sud-est comme le prétend al-Idrisi. 6 Cette erreur se retrouve sur la carte accompagnant l'ouvrage.' La petite étape qu'il indique entre les deux oasis est correcte, puisqu'elles sont séparées par 9 km.' Contrairement à d'autres géographes arabes, 9 al-Idrisi orthographie la ville avec un a bref. En Tunisie, ce toponyme est toujours prononcé avec une voyelle longue, ce qui établirait la légitimité de la graphie al-I:làmma qui serait la forme primitive du motu'
L'étape suivante est également mal placée par al-Idrisi: la Taqyfis mé-diévale se situait non loin de la route qui traverse la sebkha pour joindre le Nafzàwa, dans les proches environs de D e-g, dans le groupe d'oasis d'al-Udyàin (les oueds). Cette localité est bien connue des géographes" mais éga-lement des historiens médiévaux, puisqu'elle constitua un séjour important pour le rebelle Abù Yazid. 12 Taqyfis a succédé à la ville romaine de Thiges comme le prouvent les vestiges archéologiques et la filiation entre le nom ro-mano-berbère Thiges et le nom moderne de Dge" Dans la riche Qastiliya
Al-Idrisi 1972, p. 278. Al-Idrisi 1972, p. 279.
6 L'éd. DozY/DE GOEJE 1969, p. 104, donne également bayna &nit. b minhà wa-earq.
Très curieusement, l'éd. HADJ-SADOK 1983, p. 138, donne bayna eamàl minhî wa-earq,
mais la trad., p. 126, reste néanmoins « sud-est » (?). La trad. JAUBERT/NEF 1999 donne
« nord-est ». 7 Nous nous basons sur la carte la plus ancienne, celle du ms de Paris Arabe 2221,
photographiée dans MILLER 1926-1931, VI, taf. 22. Cette planche comporte également les photographies des mss d'Istanbul Aya Sofia 3502 et d'Oxford Greaves 42 (Uri 884) et Po-
cocke 375 (Uri 887). Sur les problèmes posés par ces cartes, voir DUCÈNE 2004, pp. 58-65. Al-Ilimyari 1975, s.v. Tawzar, reprend la petite étape entre Tozeur et « al-I -Jamma ».
GUÉRIN 1862, I, p. 268, met un peu moins de deux heures entre ces deux oasis. 9 Al-Yiqùbi 1967, p. 350 ;Kitàb al-istibsàr 1958, p. 157 ; al- (Umarl 1973, p. 229. À l'in-
verse, Ibn I-Jawqal 1967, p. 94, al-Bakrï 1965, p. 48/102 et Yàqfit, s.v. écrivent al-I-Jamma.
10 MARçAis/FARÈs 1931, p. 194, note 2. La graphie al-tlamma se justifierait selon eux par l'abrègement des voyelles longues devant un complexe consonantique, abrègement rare au Maghreb mais fréquent dans de nombreux parlers arabes orientaux. À l'inverse, BEN jAAFAR 1985, p. 73, pense que c'est le terme classique al-kiamma qui s'est modifié
avec l'usage en al-eàmma, peut-être à cause d'un changement d'accent. " Al-Ydebi 1967, p. 350 ; al-Muqaddasi 1950, pp. 4-5 ; Kitàb al-istibsàr 1958, p. 156;
Yâqfit, s.v. Taqyiis ; al-Ilmari 1973, P. 229. 12 Ibn al-Atir 1982, VIII, p. 422; Ibn ler' 1967, I, pp. 193-194 et pp. 216-220; Ibn
ljaldfin 1992, IV, p. 49 et VII, p. 16. 13 Voir TROUSSET 1990, P. 149.
tv
, „I 'L ., a l'Ile44. Gafsa ...
e4reitte ,
--
4 , .,.. 5 Gabès Qastdiya (Djérid)2 ,
.18N
.-Z-
4, '41%.11 afzàwa ,
6 9 ',e, Chott el-Djérid . `14>ieekytt
Q e.,zeti:i
..) 'f ''
4 / l
50Icm raeee Ge.m21,2_35ïil ...rad
1. Nefta 4. Dgà-S" (Taqyfis) 7. Zàwiyat al-Flart 2. Tozeur 5. tariq al-maballa 8. TalmIn (Turra) 3. Al-Flimma 6. Bagrî 9. Gbili
Fig. 1: Les oasis du Sud tunisien
médiévale, Taqyûs semble être particulièrement fertile et comblée. Le Kitàb al-istibyàr, qui en fait une description élogieuse, explique que Taqyfis est composée de quatre villes voisines : chacune est entourée de murs et il s'en faut de peu que les habitants d'une de ces villes ne puissent parler aux ha- bitants d'une autre, tant elles sont proches.'" Ainsi, Taqyfis désigne tantôt une seule ville, tantôt un ensemble de villes extrêmement voisines. Il va sans dire qu'au Moyen Âge, les abords du passage de la sebkha, haut lieu du com-merce transsaharien, abondaient certainement en villages. Aujourd'hui, de la même façon, la région de Dgàg se caractérise par la grande proximité de ses nombreuses petites localités. Taqyfis est encore signalée par plusieurs voya-geurs français du XIX' siècle. EUGÈNE PELLISSIER, notamment, décrit en
" Kitàb al-istibsàr 1958, p. 156 repris chez al-klimyari 1975, s.v. Taqyùs. Il est diffi-cile de déterminer quels étaient les quatre villages qui composaient Taqyfis dans le Kitàb al-istibsitr. Au début du XIV' siècle, al-Watwàt 1990, p. 376, énumère dans le district de Taqyfis six villages parmi lesquels on reconnaît Saddàda, Dgàà" et Kanfima. Un de ces six villages est nommé K.ba. Nous pensons qu'il faut l'identifier au lieu nommé Guebba où se situent les rares ruines de Thiges, décrit par BERBRUGGER 1858-1859, p. 16 et par TISSOT 1884-1888, II, pp. 683-684.
356 VIRGINIE PREVOST
Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien 357
1853 Oudiane, également nommée Taguious, comme une oasis assez étendue qui contient six villages dont Degache." Au début du XXe siècle, les oasis d'al-Udyàn portent encore le vieux nom de Taqyùs." Un lieu-dit s'appelle-rait toujours Tagyiis, là où débute la route qui traverse le chott? Les indi-cations géographiques fournies par al-Idrisi, tant dans son texte que dans sa carte, sont donc totalement inexactes : Taqyfis n'était certainement pas située à vingt milles d'« al-F.lamma »" mais en était bien plus proche ; elle était par contre fort éloignée de Gafsa. Cette mauvaise localisation s'est, cu-rieusement, répétée pour la Thiges romaine : plusieurs historiens la situent erronément à mi-chemin entre Gafsa et le Djérid."
La seule étape, trop courte, que donne al-Idrie entre Gafsa et Taqyûs s'explique par la mauvaise localisation de cette dernière." Il fallait généra-lement deux jours pour parcourir la distance séparant Gafsa des oasis du Djérid, la plus proche des oasis étant éloignée de Gafsa par environ 70 km à vol d'oiseau. Ainsi, la plupart des voyageurs français faisaient la route en deux jours et campaient à mi-chemin près d'un point d'eau. 21 Les géographes arabes donnent des renseignements très différents les uns des autres : si al-Bakri compte deux étapes entre Tozeur et Gafsa, Yâqùt ne donne qu'un jour et demi, al-Muqaddasî parle de trois étapes et al-Marràkugi affirme qu'il faut quatre étapes ! 22
Il semble acquis que deux jours sont nécessaires entre Gafsa et Tozeur. De Tozeur, il faut rajouter plus de 20 km pour gagner Nefta, soit une demi-journée aux dires d'al-cUmari. 23 Les deux petites étapes que donne al-Idrisi entre Gafsa et Nefta sont donc manifestement insuffisantes, mais elles cor-respondent à sa carte : Nefta y est placée à l'ouest de Gabès au lieu de figu-
" PELLISSIER 1980, p. 144. On retrouve les six villages chez DUVEYRIER 1881, p. 109 et
chez BERBRUGGER 1858-1859, p. 17. 16 PENET 1911, p. 110. '7 TALBI 1966, p. 193, note 3. " Cette information est reprise par al-klimyarii 1975, s.v. Taqyfis. 19 Voir notamment la carte de SALAMA 1951 et la carte dépliante de l'Histoire générale
de la Tunisie 2003. 28 Al-171imyari 1975, s.v. Qafsa donne aussi une étape entre ces deux villes. 21 PELLISSIER 1980, p. 142 ; CAGNAT/SALADIN 1886, p. 210 ; DE LA BERGE 1881, p. 219;
BERBRUGGER 1858-1859, pp. 9-15. GUÉRIN 1862, I, pp. 270-272, est à notre connaissance le seul qui fasse la route d'une traite : il part d'al-171àmma à minuit et atteint Gafsa qua-torze heures plus tard, après une marche éprouvante interrompue par une brève halte.
22 Al-Bakri 1965, p. 75/153; Yàqfit, s.v. Qafsa ; al-Muqaddasi 1950, pp. 64-65; al-
Marràkugi 1968, p. 258. 23 Al-Vmar-i 1973, p. 230. Entre Nefta et Tozeur, BERBRUGGER 1858-1859, p. 22, mar-
che rapidement pendant quatre heures tandis que GUÉRIN 1862, I, p. 265, met près de cinq
heures. Al-Bakri 1965, p. 48/102, suivi par Yàqfit et al-klimyari 1975, s.v. Nafta, donne
une étape entre Nefta et Tozeur.
rer dans la région du Djérid. 24 Le géographe compte un jour et une longue demi-journée pour se rendre de Tozeur au Nafzàwa, c'est-à-dire sans doute à l'oasis de Bari qui était à cette époque le chef-lieu de cette région. Cette fois, son estimation de la durée du trajet semble surévaluée. Il est bien évi-dent que la sebkha se traversait en une seule traite, les caravanes empruntant certainement le passage actuellement asphalté, le tariq al-mahalla qui reliait Taqyùs à Bari." Une seconde étape pouvait être consacrée à la distance en-tre Tozeur et Taqyùs mais elle ne semble pas indispensable. Al-Bakr -1-, ainsi, donne une seule étape entre Tozeur et Madinat Nafzàwa, c'est-à-dire Bagri. 26
Al-Idrisi compte « un peu plus de deux jours » de Gafsa au Nafzàwa, une durée qui paraît acceptable puisque le détour par Tozeur ne s'impose pas. Al-Bakri donne même une durée moindre, ne notant que deux étapes entre le Nafzàwa et Gafsa," mais son renseignement cadre mal avec les deux étapes qu'il indiquait entre Tozeur et Gafsa. De Nefta à Gabès, al-Idrisi donne un peu plus de trois étapes, ce qui semble bien court pour une distance avoisi-nant les 230 km : une demi-journée environ étant nécessaire pour aller de Nefta à Tozeur, une journée pour atteindre alors l'autre rive de la sebkha, il reste à accomplir le trajet d'environ 150 km qui lie le Nafzàwa à Gabès, qu'al-Bakri évalue à trois étapes et qu'at-Tigâni parcourt en quatre étapes." Il faut noter que le long trajet qu'al-Idrisi indique entre Nefta et Gabès ne correspond pas à ce qui figure sur sa carte.
Les itinéraires présentés dans la Nuzhat al-mkatàq appellent une dernière remarque : curieusement, al-Idrisi ne donne aucun détail sur le Nafzàwa qui compte pourtant à cette époque plusieurs oasis importantes. Plus loin, après avoir terminé l'évocation du bilàd Ifriqiya, il déclare passer au bilàd
24 Cette mauvaise localisation de Nefta est identique dans les mss d'Istanbul Aya Sofia 3502 et d'Oxford Pococke 375 (Uri 887). Dans le ms d'Oxford Greaves 42 (Uri 884), elle est représentée à mi-chemin entre « al-F.lamma » et Taqyfis mais est extrêmement éloignée de Tozeur.
25 Les récits des voyageurs français montrent qu'il était effectivement possible de par-courir cette distance en une journée : GUÉRIN 1862, I, pp. 247-250; TISSOT 1884-1888, I, pp. 123-127.
26 Al-Bakri 1965, p. 48/102, suivi par le Kitdb al- istibsdr 1958, p. 158. D'après les infor-mations d'al-`Umari 1973, p. 246, la traversée de la sebkha proprement dite nécessite plus d'une demi-journée ; il rapporte également que si l'on contourne la sebkha par les terres cultivées, un jour et une nuit sont nécessaires. Très curieusement, al-Ya`qfibi 1967, p. 350 signale que depuis les villes de la Qastiliya, trois étapes sont nécessaires pour rejoindre les villes du Nafzàwa.
27 Al-Bakri 1965, p. 47/102 ; Yàqfit, s.v. Nifzàwa. 28 Al-Bakri 1965, p. 47/102; at-Tierff 1958, pp. 134-142. Yàqfit, s.v. Nifzàwa, donne
trois jours. LEWICKI 1976, p. 29, estime que l'itinéraire Nefta-Gabès emprunte probable-ment le tariq at-tawzariyya, une piste aujourd'hui impraticable qui reliait jadis directe-ment Tozeur au nord du Nafzàwa. Nous pensons qu'al-Iddsï fait plutôt référence, comme les autres géographes, à l'important tariq al-maballa qui était bien plus sûr.
358 VIRGINIE PREVOST Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien 359
Nafzàwa : il évoque alors Sbeitla et Kairouan, déplorant l'état misérable que connaît l'ancienne capitale depuis la domination des Arabes." Il parle évi-demment ici du bilàd Qamiida3 ° et non du Nafzâwa !
Il faut admettre que les renseignements d'al-Idrisi sont dans l'ensem-ble assez inexacts, si l'on additionne les deux erreurs de localisation d'« al-Hamma » et de Taqyûs, la mauvaise appréciation des distances, la pauvreté des informations sur le Nafzâwa et sa confusion avec le bilàd Qamt7da. La carte jointe au texte présente aussi de nombreuses imperfections : « » est située à mi-chemin entre Tozeur et le Nafzàwa, Nefta est placée à l'ouest de Gabès. Les erreurs de localisation de la carte se retrouvent dans le texte, à l'exception de la distance séparant Nefta de Gabès. L'imprécision dont fait preuve al-Idrisi étonne d'autant plus qu'il est probable que Roger II, com-manditaire du Kitàb nuzhat al-nuatàq, accordait un intérêt tout particulier à la Tunisie, territoire qu'il convoitait ardemment. Avant l'achèvement de l'ouvrage en 1154, le roi normand s'était déjà emparé de Djerba en 529/1135,
événement loué par le géographe, 31 et avait conquis Mandiyya, Sousse et Sfax en 543/1148. Il est probable que la rédaction définitive du commentaire s'est réalisée dans de mauvaises conditions et dans la hâte provoquée par l'immi-nence du décès de Roger II, 32 ce qui pourrait expliquer les erreurs contenues dans le passage que nous avons analysé. À l'inverse, les descriptions des oasis et les informations sur leurs habitants, sur leurs cultures et productions sont particulièrement intéressantes, d'autant qu'elles offrent la seule description détaillée du sud de l'Ifriqiya pendant la période comprise entre l'arrivée des Banù Hill et celle des Banù Gniya et de Qarâqùg.
2) Le Uns al-muhag wa-rawd al-furag
Cet ouvrage géographique a été publié en fac-similé en 1984 par FUAT SEZ-GIN. Le volume présente le manuscrit découvert par JOSEPH HOROVITZ dans la bibliothèque Hekimoglu d'Istanbul, suivi par un autre manuscrit conservé dans la collection Hasan Hüsnü de la bibliothèque Süleymaniye d'Istanbul. Les deux copies publiées par FUAT SEZGIN montrent de nombreuses varian-tes. Nous nous basons ici sur le ms Hekimoglu 688 (H 688) : il est nettement plus lisible et est manifestement le plus ancien. Nous donnons en note, s'il y a lieu, les variations présentes dans le ms Hasan Hüsnü 1289 (HH 1289). Il
29 Al-Idrisi 1972, P. 283. Voir la trad. Dozv/DE GOEJE 1969, p. 128, note 1. 30 A1-U(1171bl. 1967, p. 349; Ibn Hawqal 1967, P. 94; al-Muqaddasi 1950, pp. 4-5; al-
Idrisi 1972, p. 276. 31 Al-Idrisi 1972, p. 305. 32 LEWICKI 1966, p. 54.
est probable qu'al-Idrisi a rédigé cet ouvrage — également connu sous le titre Rawd al-Jurag wa-nuzhat al-muhag — vers la fin du règne de Guillaume Pr
(1154-1166), fils et successeur de Roger II." Tout comme dans le Kitàb nuzhat al-musvtàq, al-Idrisi aborde la région
qui nous occupe par Tozeur, nommée « Tawzar Qastiliya » 34 :
4,4›:- ue■j.,:d t.tiLtS j L.M.1 1
,39k» , 38,), , 37Î;1, 36 5Id
.1.121 JI
41
« Entre Tozeur et al-Hàmma, on compte une courte étape, tout comme entre al-Hàmma et Taqyfis. De Taqyfis à Gafsa il faut un jour, de Gafsa à Nefta une étape. [...] Il y a quatre étapes entre Gafsa et Gabès. [...] Trois étapes sépa-rent Gafsa du Nafzà -wa. Le bilàd Nafz .awa comprend Turra, Gbili et al-Hart. Il y a quarante milles entre Turra et Gafsa, une étape entre Turra et
De Tozeur à Nefta, on compte une étape ».
On retrouve la courte étape entre Tozeur et al-Hàmma, déjà mentionnée dans le Kitàb nuzhat al-muftàq. Al-Idrisi adopte cette fois la graphie « al-Hâmma » qui seule demeure aujourd'hui. Al-Hâmma ne figure pas sur la carte accompagnant l'ouvrage. 42 La carte est bien différente de celle du Kitàb nuzhat al-muitàq : ici, Gafsa et Gabès sont séparées des autres oasis par un grand triangle représentant le djebel Demmer. De l'autre côté, Turra, Taqyùs, Tozeur et Nefta apparaissent distinctement.
La courte étape, correcte, mentionnée entre al-Hâmma et Taqyùs réta-blit cette dernière à sa place au sein du Djérid. Le jour de route indiqué entre Taqyûs et Gafsa correspond à ce qu'indiquent le texte et la carte de
" Al-Idrisi 1984 (introduction de SEZGIN au Uns al-muhag). Voir aussi l'introduction de MIRZAL 1989, qui a édité la partie consacrée à l'Andalus, et OMAN 1970, pp. 187-193, qui fait l'inventaire de toutes les mentions des ouvrages d'al-Idrisi chez les auteurs postérieurs.
34 H 688, p. 78; HH 1289, p. 61. Nous avons remplacé par [...] les passages qui ne concernent pas directement les oasis.
" HH 1289 : 36 H 688 et HH 1289 : 37 HH 1289: " H 688 : (s.p.) ; HH 1289 : " H688 : ,43 (s.p.) ; HH 1289 : 40 H 688 : ; HH 1289 : " HH 1289: sans point sur la première lettre. 42 Nous nous basons sur la carte figurant dans le ms H 688, p. 77 ; celle du ms HH 1289,
p. 60, est moins lisible. La carte établie par MILLER 1926-1931, I, 3, ne mentionne ni Bari ni Nefta. Elle indique Tara à la place de Turra. Plus loin, p. 83, MILLER identifie Tara à « Zarat », sans doute l'actuelle Zarràt, située non loin de la côte au sud de Gabès.
360 VIRGINIE PREVOST Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien 361
l'ouvrage précédent mais pas du tout à la carte du Uns al-muhag où les deux villes apparaissent très éloignées, en partie à cause du massif qui les sépare. Si l'on se rapporte à cette dernière carte, la seule étape que mentionne al-Idrisi entre Gafsa et Nefta est tout bonnement incroyable. Dans le Kitàb
nuzhat al-nuatàq, la mauvaise appréciation de la durée de cet itinéraire pouvait s'expliquer par la localisation erronée de Nefta, mais ici l'erreur est incompréhensible.
Al-Idrisi compte quatre étapes entre Gafsa et Gabès, ce qui est suffisant pour couvrir la distance d'environ 140 km qui sépare les deux villes. 43 Il in-dique trois étapes entre Gafsa et « Nafzàwa » sans plus de précision, alors que dans le Kitàb nuzhat al-muftàq, il donnait « un peu plus de deux jours », soit une durée moindre. L'affirmation du Uns al-muhag paraît plus correcte, même si la précédente était réalisable. Al-Idrisi passe ensuite au Nafzà.wa et fournit le nom de quatre cités qui étaient passées sous silence dans son autre ouvrage. Seule Turra est indiscutablement lisible dans les deux manuscrits, mais il nous paraît certain que la seconde ville citée par le géographe est Bari: elle revient, parfaitement lisible cette fois, quelques mots plus loin.
L'importance de l'actuelle Baki ne fait aucun doute pendant tout le Moyen Âge. Elle est signalée par de nombreux géographes qui adoptent pour la désigner des orthographes diverses proches de son nom actuel ou des dé-nominations tout autres. À l'époque d'al-Yiebi, déjà, M'ara est la ville principale du Nafzàwa et le lieu de résidence des câmil-s. 44 Al-Bakri l'évo-que sous le nom de Madinat Nafzàwa, 45 où madina a certainement le sens de chef-lieu. L'identité ne fait aucun doute : le géographe souligne son rempart, déjà mentionné par Ibn Hawqa1, 46 et une grande source appelée Tàwargà en langue berbère dont on ne peut atteindre le fond, source décrite par at-Tieni à l'extérieur de cette ville. 47 Le Kireib al-istib$cir décrit Bari à deux reprises, d'abord sous le nom de Bearii, puis sous le nom de Balad Nafzàwa,
mentionnant alors la source Tàwargâ. 48 L'auteur cite donc dans un premier temps la ville qu'il a visitée et qui porte alors le nom de Bar, puis rappelle la description qu'a donnée al-Bakri de cette ville sous le nom de Madinat
Nafzàwa, qu'il transforme en Balad Nafzàwa. CHARLES PELLAT suggère
" Al-MarrAugi 1968, P. 258, ne donne que trois étapes. 44 Al-Ya`qûbi 1967, P. 350. 45 Al-Bakri 1965, p. 47/101. 46 Ibn 1:lawqal 1967, pp. 93-94, qui écrit la ville comme al-Idrisi. Yàqùt, s.v., note Bugrà,
tandis qu'al-F.limyari 1975, s.v., donne B.g.rr -à, utilisant la seule orthographe qui double le « r ».
" At-Tieni 1958, pp. 153-154. TISSOT 1884-1888, I, pp. 116-117, note 1, décrit Ayn Tàwargà, un gouffre circulaire dont on a vainement tenté de mesurer la profondeur, situé près de Baga al-qadim.
48 Kitàb al-istibsàr 1958, pp. 157-158.
que le toponyme Bari a succédé à celui de Nafzàwa", mais cela nous semble inexact puisque les deux termes coexistaient déjà chez al-Yiqubi. À l'époque d'at-Tieni, le Nafzâwa a deux capitales, Turra et Bagri 50 .
Turra, dont le nom ne désigne plus aujourd'hui qu'un emplacement face à une source,m était bâtie tout près de l'actuelle Talmin, sur les ruines de Turris Tamalleni, une vaste cité romaine dont la superficie englobait plusieurs des pré-sents villages." C'est probablement chez al-Muqaddasi qu'elle est mentionnée pour la première fois." Il semble en effet que la ville de T.r.s soit égale à Turra : le géographe se serait inspiré dans sa transcription arabe de la forme latine classi-que « Turris » qui devait rester en usage parmi les classes cultivées de la société. 54 Elle apparaît ensuite chez al-Bakri qui décrit au sud de Madinat Nafzàwa une ville antique connue sous le nom d'al-Madina, munie d'un rempart, d'une mos-quée giimic, d'un hammàm et d'un nig', entourée de sources et de jardins." Le Kitdb al-istibsàr — comme c'était le cas pour Baki — l'évoque à deux reprises : il la décrit d'abord sous le nom de Turra, puis, reprenant al-Bakri, mentionne une ville antique connue sous le nom d'al-Madina. Il précise qu'elle n'est pas habitée et qu'elle renferme de nombreuses ruines antiques." Ici, l'auteur diffé-rencie donc Turra, la ville habitée décrite par al-Bakri sous le nom d'al-Madina, des ruines de Turris Tamalleni qui sont inhabitées. En 601/1204-1205, la ville est assiégée et prise par les troupes almoravides dirigées par Yahyâ ibn Gâniya. Les soldats y commettent tant de massacres et de pillages que Turra est déser-tée par ses habitants, qui s'éparpillent dans le Nafzâwa." Alors que le Kitàb al-istibscir décrit une ville au rempart fortifié, entourée d'une vaste palmeraie riche en oliviers qui donne toutes les sortes de fruits, at-Tigâni constate que sa qasba est en ruine et que seul demeure le rempart qui entourait la ville." Turra connaît alors un long déclin, tandis que s'affirme sa voisine Talmïn," bâtie
49 PELLAT, E1 2, S.V. Nafzàwa. 50 At-Tieni 1958, P. 142. " BÉDOUCHA 1987, P. 166. 52 On voyait encore à Talmin, à la fin du XIX' siècle, de nombreux vestiges de l'épo-
que où elle était Turris Tamalleni. GUÉRIN 1862, I, pp. 243-244; TISSOT 1884-1888, II, pp. 702-703.
" Al-Muqaddasi 1950, pp. 4-5. 54 LEWICKI 1953, pp. 456-457. " Al-Bakri 1965, pp. 47/101-102. L'ai-Madina d'al-Bakr' survit toujours dans les rui-
nes nommées Hen.i'ïr Madina qui étaient rattachées à Turris Tamalleni. DJELLOUL 1999, P. 20. Yàqfit, s.v. Turra, signale simplement que le nom de cette ville se prononce comme le mot turra qui désigne le bord d'un vêtement.
" Kitàb al-istibsàr 1958, pp. 157-158. " At-TenT 1958, P. 147. " Kitàb al- istib5àr 1958, P. 157; at-Teni 1958, P. 142. 59 Talm'in est sans doute de fondation récente à l'époque du Kitàb al-istibsdr 1958 qui la
mentionne, p. 158, sous le nom d'Aytimlin. Voir aussi al-Himyari 1975, s.v. TIm.lim.n.
362 VIRGINIE PREvosT Les itinéraires d'al-Idrisi' dans le Sud tunisien 363
également sur le vaste site de Turris Tamalleni. Fortement affaiblie, Turra est cependant attestée jusqu'au XVIIIe siècle. 60 On pourrait considérer que le Uns al-muhag est le premier ouvrage géographique qui cite le toponyme « Turra », étant donné que le Kitâb al-istibsàr porte la date de 587/1191 ; tou-tefois, il a été démontré que les ajouts qu'apporte cet ouvrage par rapport à al-Bakri sont le résultat des observations faites par son auteur en Ifriqiya aux environs de 1135." Cette constation n'a donc que peu d'importance.
Nous proposons d'identifier la troisième ville citée par al-Idrisi avec l'ac-tuel chef-lieu du Nafzàwa, désormais orthographié Gbili/Qbili/Kébili, que les voyageurs français écrivaient « Kebilli » 62 . Cette ancienne ville romaine porterait encore un nom chrétien, issu du latin capella/chapelle." Gbili fi-gure à plusieurs reprises dans des ouvrages ibàdites : elle apparaît dans le nom d'un important personnage ibàdite du Ville siècle, Abù Dàwùd al-Qibilli an-Nafzàwi" et est citée dans une chronique anonyme du XIIe siècle." Son importance à l'époque d'al-Idrisi ne fait donc aucun doute.
Il nous semble qu'il faut associer la quatrième localité citée par al-Idrisi au toponyme al-F.lart, qui revient sous des formes différentes à deux époques fort lointaines. Tout d'abord, les sources ibàdites mentionnent qu'un des quatre cantons du Sud tunisien sur lesquels s'exerce l'influence de l'imàm rustumide Aflah (823-871) se nomme Hart Naata ; il correspondrait à la plus occidentale des deux presqu'îles du nord du Nafzàwa." Des siècles plus tard, « Zàwiyat al-Hart » est une oasis située au nord-est de Bari, dans la région que couvrait manifestement Hart Nafàta. Les voyageurs français or-thographient son nom de multiples façons et l'un d'entre eux constate en 1887 qu'elle est déjà victime de Pensablement. 67 Zàwiyat al-Hart n'est plus aujourd'hui qu'une toute petite oasis. Il paraît certain que le toponyme « Hart » a toujours dû désigner une petite région ou un point plus précis dans le Nafzàwa. Si notre supposition est exacte, al-Hart d'al-Idrisi ferait donc la transition entre les deux expressions Hart Nafâta et Zàwiyat al-Hart.
60 BÉDOUCHA 1987, p. 171. LEVTZION 1994, pp. 201-217.
62 PELLISSIER 1980, p. 146; DUVEYRIER 1881, p. 114; GUÉRIN 1862, I, p. 241. TISSOT 1884-1888, II, p. 704, voit à « Kebilli » des débris antiques et souligne que la plupart des maisons y sont construites avec des matériaux romains.
LEWICKI 1953, pp. 460-461. 64 Abù Zakariyyà' 1985, p. 58 ; agSammàbi 1995, p. 50.
LEWICKI 1953, p. 460. BMIYYA 1976, p. 98; LEWICKI 1958, p. 11, qui écrit « Hart Nafàta », alors que dans s.v. al-Ibâçliyya, p. 676, il note « Hart Nafàtha ».
67 BARABAN 1887, p. 81, qui la nomme « El-Ahart ». TISSOT 1884-1888, I, p. 115,
parle de « Zaouïat el-Hart »; PELLISSIER 1980, p. 146, donne « Zaouiat-el-Ard »; Du-VEYRIER 1881, p. 113, l'appelle « Zaouiyet El-Harth ». MOREAU 1947, p. 36, dit « Zaouïet el-Harts ».
Les deux dernières localités que nous avons identifiées, Gbili et al-Hart, sont à peine reconnaissables dans les graphies de nos deux manuscrits. Tout comme c'est le cas pour le Kitàb nuzhat al-rnutâq, les copies du Uns al-muhag contiennent un grand nombre de noms déformés, ce qui mène à penser que le géographe avait dans sa copie originelle pris note de façon erronée ou illisible des informations orales dont il disposait, erreurs ré-pandues ensuite dans tous les manuscrits." En outre, les deux manuscrits que nous avons utilisés ont été manifestement recopiés peu soigneusement." Une dernière phrase relative aux itinéraires du Sud tunisien témoigne de ces imperfections :
71 ." l' JI r2; L j LI r j-)5_5; ,:7°3 "
En mêlant les deux copies, on reconstitue l'itinéraire suivant : « De Tozeur, on gagne al-Hàmma puis Taqyùs puis B.gg.ri puis Turra ».
Chacun des manuscrits comporte des erreurs. Tout d'abord, ils portent « Naqyùs » au lieu de Taqyùs, alors que la ville est correctement orthogra-phiée plus haut. Le ms H 688 présente l'itinéraire dans le bon ordre mais omet un « tumma il à » entre « Nagyils » et B.gg.ri, de sorte qu'on croirait qu'il s'agit d'un seul toponyme, à l'instar de « Tawzar Qastiliya ». Le ms HH 1289 sépare bien chacune des localités par « tumma il à » mais intervertit « Naqyùs » et B.g'g.ri, ce qui obligerait à traverser la sebkha à trois reprises !
En conclusion, les itinéraires du Sud tunisien présentés par al-Idrisi, tant dans le Kitb nuzhat al-mus'tàq que dans le Uns al-muhag sont souvent fau-tifs ou tout au moins nous sont parvenus comme tels dans les copies dont nous disposons. Les informations données par al-Bakri sont en général plus exactes. Les cartes de ces deux ouvrages comportent également plusieurs graves erreurs de localisation. Toutefois, le Uns al-muhag, en mention-nant quatre cités du Nafzâwa, dont deux toponymes inconnus des autres géographes arabes, se distingue par son originalité. C'est également le seul ouvrage qui établit à cette époque aussi précisément l'itinéraire qui conduit de Tozeur à Turra.
" LEWICKI 1966, p. 54. MIRZAL 1989, p. 29, au sujet de la partie consacrée à l'Andalus, confirme les innom-
brables fautes qui figurent dans les deux mss et mentionne, p. 27, la faible connaissance de l'arabe et le très bas niveau culturel du copiste du ms HH 1289 dans lequel les erreurs abondent, liées surtout à l'absence ou au mauvais emplacement des points diacritiques.
" H688 p.79. 7 ' HH 1289, p. 62.
364 VIRGINIE PREVOST Les itinéraires d'al-Idrisi dans le Sud tunisien 365
Bibliographie
Abù Zakariyyà' : Kitàb as-sira wa-abbàr al-a'imrna. Ed. 'A. AYYÙB. Tunis 1985. BMIYYA, S. : Al-Abàdiyya bi-l-darid. Tunis 1976. Al-Bakri : Kitàb al-masàlik wa-l-mamdlik. Ed. trad. partielle W. MAC GUCKIN DE
SLANE. Paris 1965. BARABAN, L. : A travers la Tunisie, études sur les oasis, les dunes, les forêts, la flore
et la géologie. Paris 1887. BÉDOUCHA, G. : L'eau, l'amie du puissant. Une communauté oasienne du Sud tuni-
sien. Paris 1987. BEN JAAFAR, E. : Les noms de lieux de Tunisie. Tunis 1985. BERBRUGGER, A. : « Itinéraires archéologiques en Tunisie. » Dans : Revue Africaine
(Alger) III (1858-1859), pp. 9-22. CAGNAT, R./H. SALADIN : « Voyage en Tunisie ». Dans : Le Tour du Monde (Paris)
LII (1886), pp. 193-224. DE LA BERGE, A. : En Tunisie. Paris 1881. DJELLOUL, N. : Les fortifications en Tunisie. Tunis 1999. DUCÈNE, J.-C. : « Le delta du Nil dans les cartes du Nuzhat al-muitàq d'al-Idrisi. »
Dans : ZDMG 154 ( 2004), pp. 57-70. DUVEYRIER, H. : La Tunisie. Paris 1881. GUÉRIN, V.: Voyage archéologique dans la Régence de Tunis. 2 vol. Paris 1862. Al-Himyari : Kitàb ar-rawçl al-mi`tàr fi babar Ed. I. (ABBÂs. Beyrouth
1975. Histoire générale de la Tunisie. I. L'Antiquité. Tunis/Paris 2003. Ibn al-Atir : fi" t - ta'rib. 13 vol. Beyrouth 1402/1982. Ibn Hawqal : Kitiib su rat al-ard. Ed. M. J. DE GOEJE/J. H. KRAMERS. Leiden 1967.
Ibn `Idàri : al-mugrib fi abbàr al-Andalus wa l -Magrib. Ed. G. S. CoLIN/
E. LÉVI-PROVENÇAL. 4 vol. Beyrouth 1967. Ibn Haldfm : Kitàb al- `ibar.7 vol. Beyrouth 1992. Al-Idrisi: Kitàb nuzhat / Opus geographicum sive « Liber ad eorum de-
lectationem qui terras peragrare studeant ». Ed. E. CERULLI et al. 9 fasc. Rome/ Naples 1970-1984 [Le Sud tunisien est compris dans le fasc. 3,1972].
- : Al-Ma grib wa-ard as-Siidàn wa-Mir wa-l-Andalus, ma'/da min Kitàb nuzhat al-muftàq fi btiràq al-àfàq / Description de l'Afrique et de l'Espagne. Ed. trad. R. DozY/M.J. DE GOEJE. Amsterdam 1969.
- : Idrisi. La première géographie de l'Occident. Trad. chevalier JAUBERT revue par
A. NEF. Paris 1999. - : Le Magrib au 12' siècle de l'hégire (6' siècle après J- C.) [sic]. Ed. trad. M. HADJ-
SADOK. Paris 1983. - : Uns al-rnuhag wa-rawd al-furag. Ed. en fac-similé F. SEZGIN. Frankfurt am
Main 1984. - : Los carninos de al-Andalus en el Siglo XII. Ed. trad. J. A. MIRZAL. Madrid 1989. Kitàb al-istibsàr fi `ag'à'ib al-amsàr. Ed. S. Z. 'ABD AL-HAMTD. Alexandrie 1958.
LEVTZION, N.: « The Twelfth-Century Anonymous Kitàb al-Istibsàr : a History of a Text. » Dans : Islam in West Africa. Religion, Society and Politics to 1800. Londres 1994, pp. 201-217.
LEWICKI, T.: « Une langue romane oubliée de l'Afrique du Nord. Observations d'un arabisant. » Dans : RO XVII (1953), pp. 415-480.
- : « Les ibàdites en Tunisie au moyen âge. » Dans : Academia Polacca di Scienze e Lettere (Rome), Conferenze, fasc. 6 (1958), pp. 1-16.
- : « A propos de la genèse du Nuzhat al- intatàq fi 'htiràq al-àfàq d'al-ldrisi. » Dans : Studi Magrebini (Naples) 1(1966), pp. 41 -55.
- : Etudes maghrébines et soudanaises. Varsovie 1976. Al-Marràkugi : Kitàb al-megib fi tales abbàr al-Magrib. Ed. R. DOZY. Amster-
dam 1968. MARÇAIS, W./J. FARÉS « Trois textes arabes d'el-Hâmma de Gabès. » Dans : JA
218 (1931), pp. 193-247. MILLER, K. : Mappae Arabicae. 6 vol. Stuttgart 1926-1931. MOREAU, P.: « Des lacs de sel aux chaos de sable. Le pays des Nefzaouas. » Dans :
IBLA (Tunis) X (1947), pp. 19-47. Al-MuqaddasT : Description de l'Occident musulman au IV' = X' siècle. Ed. trad. C.
PELLAT. Alger 1950. OMAN, G.: « A propos du second ouvrage géographique attribué au géographe
arabe al -Idrisi: le rawd al-uns wa nuzhat al-nafs. » Dans : Folia Orientalia (Cracovie) XII (1970), pp. 187-193.
PELLISSIER, E. : Description de la Régence de Tunis. Tunis 1980. PENET, P. : Kairouan, Sbeida, le Djérid. Tunis 1911. SALAMA, P. : Les voies romaines de l'Afrique du Nord. Alger 1951. M-Sammàbi : Kitàb as-siyar. Ed. partielle M. HASAN. Tunis 1995. TALBI, M. : L'Emirat aghlabide, 184-296/800-909. Histoire politique. Paris 1966. At-Teni: : Ribla. Ed. FI. H. 'ABD AL-WAHHÀB. Tunis 1958. TISSOT, C.: Géographie comparée de la province romaine d'Afrique. 2 vol. Paris
1884-1888. TROUSSET, P.: « Thiges et la civitas tigensium. » Dans : L'Afrique dans l'Occident
romain. Rome 1990, pp. 143-167. APUmari : Masàlik al-absàr fi mamàlik al-amsàr. Ed. partielle H. H. 'ABD AL-
WAHHÀB dans : « Description de l'Ifriqiya et d'al-Andalus au milieu du VIIIe/ XIVe siècle. » Dans : Cahiers de Tunisie (Tunis) XXI (1973), pp. 225-259.
Al-Watwàt : Manàhig al-fi kar wa -mabàhig al- `ibar. Ed. en fac-similé F. SEZGIN. Frankfurt am Main 1990.
Al-Yiebï : Kitàb al-buldàn. Ed. M. J. DE GOEJE. Leiden 1967. Yàqfit : Megam al-buldàn. 7 vol. Beyrouth s.d.