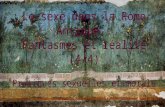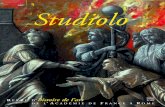Le premier retour de Perón : charisme et mobilisation populaire en novembre 1972
Nikolaï Kliouev et les Scythes: genèse de la révélation d'un poète populaire.
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Nikolaï Kliouev et les Scythes: genèse de la révélation d'un poète populaire.
Nikolaï Kliouev et les Scythes : la révélation d’un poète
« populaire ».
Nikolaï Kliouev (1884 – 1937) est contemporain à la
fois des poètes symbolistes de la seconde génération et
témoin des bouleversements historiques et culturels de la
Russie soviétique. Poète « paysan » autoproclamé, auteur
d’une autobiographie qu’il n’est pas aisé de dissocier du
mythe1, et d’une œuvre poétique au contenu et à
l’esthétique complexes, il a suscité des débats
passionnés sur l’authenticité de son identité
« populaire », aussi bien de son vivant que plus de
cinquante ans après sa mort2. L’on se pose encore
aujourd’hui la question de la sincérité de ses
déclarations, allant parfois jusqu’à confondre posture
artistique et construction idéologique, aussi bien
celle(s) du poète lui-même que celle(s) de ses lecteurs:
était-il véritablement « sacré par le peuple3 »,
descendant d’Avvakum4 et héritier de l’engagement
spirituel de ce dernier? Ou bien était-il « uniquement »
un stylisateur, qui dans son intérêt pour le paysan russe
aurait imité Alexandre Blok et d’autres poètes
symbolistes, et dont l’entrée sur la scène littéraire
serait marquée par l’opportunisme5 ?
Cette interrogation sur l’authenticité des origines
et de la posture populaires de Kliouev, qui relève avant
tout d’une étude biographique, pourrait, nous semble-t-
il, être inscrite dans une réflexion à visée plus large,
1
qui aborderait la relation qu’entretiennent, dans le
domaine russe, la culture « populaire6 » d’une part et
culture « savante » - ou culture de l’intelligentsia - de
l’autre. A partir de la première moitié du XIXe siècle,
ces relations modifient non seulement le paysage
littéraire, qui doit faire de plus en plus de place aux
nouveaux poètes venus du « peuple », mais vont jusqu’à
marquer le processus de création artistique, tandis que
ce dernier accorde, à la fin du siècle, une attention
1 Il s’agit du Destin de grèbe, [Гагарья судьбина], consigné en 1922,publié à titre posthume par A.Mixajlov dans Nord [Север],Petrozavodsk, juin 1992. Pour l’étude de l’oeuvre, cf. K.Azadovski,Le « Destin de grèbe » de Nikolaj Kljuev [« Гагарья судьбина » Николая Клюева],SPb, Inapress, 2004, 199 p.2 La première publication posthume des oeuvres de Nikolaj Kljuev n’aeu lieu qu’en 1977: N.Kljuev, Stixotvorenija i poemy, L.Švecova, V.Bazanovéd., « Biblioteka Poeta ». Malaja serija, L., Soveckij Pisatel’,1977, 559 p. 3 En référence au vers liminaire du poème « Я - посвященный отнарода », N.Kljuev, Le coeur de licorne [Сердце единорога], SPb, RXGI,1999, p. 391.4 Cf. « Retentit mon aïeul Avvakum » [« Гремел мой прадед Аввакум »]dans le poème « Là où l’éden est émaillé, où le Sirin [Где райфинифтяный и Сирин] », Kljuev N.A., Le coeur de licorne…, p. 340. Cettedéclaration poétique a été prise à la lettre notamment par lecritique S.Kunjaev, qui signa dans Notre contemporain [Наш современник],Moscou, octobre 2011) un essai sur Kljuev, intitulé « Toi – brûlantdescendant d’Avvakum…[Ты - жгучий отпрыск Аввакума…] »5 Cette thèse, bien qu’en des termes moins tranchés, est celledéfendue par K.Azadovski, auteur d’une monographie très sérieuse surla vie du poète, La vie de Nikolaj Kljuev - récit documenté [Жизнь НиколаяКлюева: документальное повествование], SPb, « Zvezda », 2002, 365 p.Les débats concernant l’authenticité de la posture poétique de Kljuevn’en sont pas moins très animés. Cf. par exemple K.Azadovskij, « Surle poète «populaire» et la «sainte» Russie [О « народном » поэте и« святой » Руси] », in NLO, 1993, no°5, p. 89.6 Une culture populaire conçue et perçue avant tout comme paysanne.Cf. K.Azadovski, Les poètes néo-paysans [Новокрестьянские поэты],Stavropol’, Stavropol’skoe knižnoe izdatel’stvo, 1992, p.18
2
particulière à la réception. Nikolaï Kliouev, dont
l’entrée sur la scène littéraire se fait en 19117,
deviendra une figure emblématique de ces relations entre
culture populaire et culture savante dans le premier
quart du XXe siècle. Aussi bien par son image publique que
par son esthétique, il accusera le gouffre qui sépare le
« peuple » et « l’intelligentsia », et, en parallèle à
une poétique du sujet profondément ancrée dans le
modernisme, élaborera un style archaïsant qui repose sur
le folklore. C’est dans le programme politique des
socialistes révolutionnaires de gauche que Kliouev va
trouver le plus d’échos à ses propres aspirations: dès
1912 en effet il décèle dans la presse socialiste
révolutionnaire8 une tribune qui lui fournit l’occasion
d’élaborer son image de poète populaire. Pour cette
raison, l'épisode de la collaboration avec l’almanach des
Scythes, organe littéraire proche du socialisme
révolutionnaire de gauche9 - où seront publiés, en août
1917, le cycle Terre et Fer et, en décembre de la même
année10, le Chant de l’Héliophore [Pesn’ Solncenosca], les Chants de
l’isba et le poème « Douze mois dans une année11 » -
constitue un jalon important dans l’histoire de ses
relations avec l’establishment littéraire, de même qu’il met
en lumière la façon dont, entre deux révolutions, Kliouev
est consacré comme poète populaire par l’intelligentsia
proche du populisme. Dans les deux numéros de la revue
qui verront le jour en 1917, ses poèmes vont côtoyer,
outre des publications d’autres poètes « paysans » -
3
S.Essenine, P.Orechine, A.Ganine - celles de A.Biély,
V.Brioussov, E.Zamiatine, M.Prichvine, A.Rémizov ou
encore L.Chestov. En d’autres termes, il s’agit d’une
plateforme unique sur laquelle cohabite la poésie
« paysanne » et divers représentants d’une culture
savante - poètes, prosateurs et philosophes. À la faveur
de la révolution, ces poètes « paysans », Kliouev en
tête, vont acquérir un nouveau droit de cité auprès d’une
intelligentsia qui voit en eux les détenteurs d’une
« vérité » spirituelle, sociale et politique,
particulièrement salvatrice à une époque de grands
changements.
Pour autant, si cet épisode de la trajectoire
poétique de Kliouev peut être interprété comme une
manifestation d’opportunisme, les implications
idéologiques et esthétiques qui en résultent n’en sont
pas moins cruciales pour mettre en lumière des aspects
fondamentaux de sa poétique dans les années
révolutionnaires.
1. Un rapprochement inévitable : les Scythes et les poètes « paysans » unis
dans leur vision de la révolution.
Les prémisses d’une collaboration éditoriale entre
Nikolaï Kliouev et Ivanov-Razoumnik sont à rechercher
dans les quelques années qui précèdent 1917. A la veille
de la révolution de février, la gloire du poète est à son
apogée12: il réalise une tournée dans toute la Russie aux
4
côtés de la chanteuse Natalia Plevitskaïa, dans
l’ensemble très appréciée du public, et qui apporte une
pierre supplémentaire à l’édification de son mythe
personnel, celui de poète populaire13 [narodnyj poet]. Alors
que les années 1910 avaient été celles de son entrée en
littérature, les années de la première guerre mondiale
vont donner une impulsion nouvelle autant à sa poésie
qu’à l’accueil que lui réservent ses contemporains. Son
quatrième recueil, Pensées séculières [Mirskie dumy], publié fin
janvier 1916, dans lequel il dit la guerre dans une
langue populaire, voire dialectale, fortement imprégnée
de folklore, sera particulièrement apprécié par la
critique patriotique et populiste. En premier lieu par
Ivanov-Razoumnik, écrivain et penseur, auteur, en 1907,
d’une Histoire de la pensée russe. Il lui consacre un article
laudatif intitulé « La terre et le fer »14, dans lequel il
explore le mythe de Kliouev – détenteur de «l'âme du
peuple» : «Nous voyons pour la première fois arriver en
littérature un poète issu de telles profondeurs
7 Avec la publication de son premier recueil poétique Le Carillon des Pins[Сосен Перезвон], Moscou, éd. Znamenskij i K°, 1912 (1911). 8 Dans la revue Les testaments [Заветы], qui a existé d’avril 1912 à août1914.9 Pour les influences du scythisme sur les écrivains, poètes etartistes cf. J.Leontiev, Les Scythes de la révolution russe. Le parti des Socialistesrévolutionnaires de gauche et ses compagnons de route littéraires [Скифы русскойреволюции. Партия левых эсеров и ее литературные попутчики], M., 2007,p.16. S’il est idéologiquement du socialisme révolutionnaire, Ivanov-Razoumnik déclare demeurer « non-affilié » au parti et veille à ceque ses almanachs ne soient « liés à un parti quelconque », tout enn'étant pas entièrement « apolitiques », cf. p. 154.10 Le deuxième numéro est daté de 1918.11 « Двенадцать месяцев в году…», N.Kljuev, Le Cœur de licorne… p.360.
5
populaires […]. Sa langue est une véritable « création
verbale » [slovotvorčestvo], inédite pour la ville, ancienne
pour le peuple […] sa force réside dans la terre et le
peuple15. » S’il ne s’agit pas de la première étude que
Ivanov-Razoumnik consacre au poète de Vytegra16, sa portée
est sans conteste des plus considérables. Dès cet
article, en effet, Razoumnik parle du « tourbillon » dans
lequel s’est engagé le peuple russe avec, d’un côté,
l’Occident, sa civilisation et son « fer », et de l’autre
l’Orient, la culture véritable et la « terre ». A
l’Orient comme au peuple russe appartient aussi la
« sagesse du sol », que le critique décèle en Kliouev17.
Cette opposition entre l’Orient et l’Occident deviendra
la pierre de touche de la réflexion politique et
spirituelle d’Ivanov-Razoumnik de ces années pré-
révolutionnaires. Elle scelle le début d’une nouvelle
étape dans les relations littéraires entre le poète et le
critique, qui seront placés sous le signe du
« scythisme ».
Dans l’Âge d’argent fasciné par la culture antique,
l’intérêt pour les Scythes18 avait encore été suscité par
les découvertes archéologiques de 1912-1913, dirigées par
le professeur Veselovski près de Nikopol. Ces preuves
matérielles de l’existence d’une civilisation ancienne en
Tauride avaient nourri le mythe du Scythe contemporain du
monde hellénistique et ancêtre des Slaves. Pour Ivanov-
Razoumnik toutefois, de même que pour le mouvement
littéraire et politique dont il est le porte-parole, le
6
scythisme est synonyme de « maximalisme spirituel ». Le
critique revendique sa filiation avec Alexandre Herzen,
qui avait fait, dans Passé et Pensées, le lien entre le
Scythe et le révolutionnaire, prêt à faire s’écrouler le
monde ancien19. Alors qu’il désigne Herzen comme « un
Scythe des années 184020 », Razoumnik justifie, par le
biais du scythisme, la spécificité de l’histoire russe
par rapport à la civilisation européenne. Dès 1917 en
effet, le critique populiste perçoit dans le scythisme le
symbole ultime de la « révolution de l’esprit »,
triomphant du conformisme et de « l’esprit petit-
bourgeois21 ». Dans l’article préfaçant le premier numéro
de la revue, il adapte les traits historiques du Scythe –
homme de la « steppe libre », obstiné, insolent,
triomphant - à l’histoire russe, qui voit survenir des
changements de taille dans l’actualité politique et
sociale : il est étranger à la « foule criarde de
bourgeois22 », et incarne « la « haute barbarie », appelée
à détruire la civilisation compromise par l’absurdité de
la guerre mondiale et à construire un ordre nouveau23.
Parmi les poètes « venus du peuple », c’est
Essenine, qui, en 1917, accentue le lien entre le
scythisme et la culture populaire. Dans sa lettre au
jeune Alexandre Chiriaevets datée du 24 juin, il établit
une opposition entre la « fraternité paysanne » et les
« littérateurs de Petersbourg », et écrit : « Nous sommes
des Scythes […] tandis qu’ils sont, eux, de culture
12 Cf. K.Azadovski, La vie de Nikolaj Kljuev… p.145.
7
romane […] des occidentalistes. Ils ont besoin de
l’Amérique, tandis qu’à nous suffisent […] le feu de bois
et la chanson de Sten’ka Razine24. » Pour le poète, le
cheval de bois qui orne les toits des isbas russes est un
symbole de la « Scythie, avec son mystère du nomade
éternel25 ». Il fait en cela écho à Kliouev, qui énumère
dans le premier poème du cycle Terre et fer les éléments
fondateurs de la culture russe antéhistorique26. Essenine
ira jusqu’à faire du « Scythe » une figure qui, en
renouant avec le passé mythologique de la Russie, dépasse
l’antagonisme entre Orient et Occident, dans un mépris de
la civilisation : « ni l’Occident, ni l’Orient avec
l’Egypte n’auraient pu inventer [le cheval de bois],
eussent-ils repris à l’envers toute leur culture27. » En
d’autres termes, le scythisme – chez Ivanov-Razoumnik
comme chez les poètes « paysans » – équivaut d’abord et
avant tout à un retour aux sources. Or, au-delà d’une
complicité « culturelle », ce concept va fournir à ces13 Notamment P.Sakulin, « Le chrysanthème populaire [Народныйзлатоцвет] », in Vestnik Evropy, mai 1916. 14 Ivanov-Razumnik R., « La terre et le fer (Echos littéraires).Pensées séculières. [Земля и железо. (Литерaтурные отклики). Мирскиедумы]», in Russkie vedomosti, 6 avril 1916. 15 «Впервые приходит в литературу поэт от такой глуби народной […]. Иречь его – подлинное «словотворчество», новое для города, старое длянарода <...> сила его – в земле и в народе». Cité par K.Azadovski,dans La vie de Nikolaj Kljuev… p.133 Le chercheur ajoute: « Le tonemphatique de cet article et quelques unes des déclarations qu’ilcontenait ont eu un grand effet, avant tout sur Kljuev. »16 Cf. Ivanov-Razumnik R., « La littérature russe en 1912 [Русскaялитерaтурa в 1912 году.] », Zavety, janvier 1913, p.60-61; « Lecommuniant joyeux de la nature (Poésie de N.Kljuev) [Природырaдостный причaстник (Поэзия Н. Клюевa)] », Zavety, 1914, p.45-49. 17 K.Azadovski, La vie de Nikolaj Kljuev… p.133-134.
8
poètes des outils intellectuels pour articuler leurs
aspirations révolutionnaires, celles de l’avènement d’un
paradis rural28, d’une « quatrième Rome » dont
l’instauration, en lieu et place d’une civilisation à
bout de souffle, est préparée chez Kliouev dès les œuvres
du début des années 1910. Ainsi, le poème liminaire de
son premier recueil, Le Carillon des pins, d’abord intitulé
« Les moissonneurs », affirme l’arrivée prochaine du
« siècle des épis d’or »29. L’attente d’un bouleversement
spirituel s’inscrit dans une aspiration plus globale de
voir l’avenir mettre fin à la fatalité propre au passé.
L’appel à « [rompre] les sceaux lourds du passé » entame
un poème de 191030, et le poète déclare dans un autre « Au
passé insoumis - / Nos regardons vers l’avenir31 ». Ce
sentiment d’attente traverse toute sa poésie des années
191032, et il est inséparable de la figure du « messie
ardent33 », de ce Christ « enflammé » aussi présent chez
Blok34. Ainsi, pour Kliouev, engagé aux côtés des
socialistes révolutionnaires de gauche déjà au moment de
la révolution de 190535, les révolutions de 1917 se
conçoivent au croisement d’espoirs politiques concernant
la campagne, et d’aspirations religieuses, en partie
construites en réponse à la mystique de l’apocalypse
caractéristique du symbolisme russe. Les Scythes, tout
comme Kliouev, attendent d’abord une révolution « de
l’esprit», et finalement très éloignée des objectifs
18 Pour un aperçu des œuvres littéraires du début du siècle inspiréespar le thème du scythisme, cf. J.Leontiev, Les Scythes de la révolution russe…p.13.
9
concrets de février et d’octobre 1917. Aussi, le
rapprochement idéologique avec le scythisme apparaît
particulièrement cohérent et s’inscrit pour le poète dans
une relation de longue date avec les socialistes
révolutionnaires.
2. Un dialogue poétique avec les Scythes : les figures de l’Orient chez Nikolaï
Kliouev.
Il n’est pas étonnant, alors, que l’accueil réservé
à Kliouev par le groupe des Scythes fut extrêmement
chaleureux. Bien plus, Ivanov-Razoumnik et Biély ont vu
en lui un véritable « génie populaire », le seul capable
d’exprimer avec justesse la culture et la langue du
peuple, d’incarner cet esprit à la fois révolutionnaire
et mystique qui caractérise, pour ces intellectuels, le
paysan russe. D’abord dans son étude sur le mot en
poésie, parue dans le premier numéro des Scythes, puis dans
19 Cf. la déclaration de Herzen: « Я, как настоящий скиф, с радостьювижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание -возвещать ему его близкую кончину. » Passé et pensées [Былое и думы],partie 5, chp. XLI.20 Titre du premier chapitre de la monographie de Ivanov-RazumnikA.I.Herzen. 1870 – 1920, Petrograd, Kolos, 1920, p. 5. 21 Un concept que Ivanov-Razumnik oppose à la notiond’« intelligentsia », dans la lignée de Herzen. Cf. Saraeva E.L.,« Le concept de la petite bourgeoisie dans les textes de A.Herzen etIvanov-Razumnik: un dialogue d’idées [Понятие мещанства в текстахА.И.Герцена и Иванова-Разумника: диалог идей] », Yaroslavl’skijpedagogičeskij vestnik, 2011, №3, t.1. p. 27-33.22 Ivanov-Razumnik R. « Les Scythes. En lieu d’une préface », Scythes,№1, août 1917, p.VIII23 Lorraine de Meaux, La Russie et la tentation de l’Orient, Paris, Fayard, 2010,p. 236.
10
son article sur le Chant de l'Héliophore, Biély loue le style
du poète, apprécie surtout la capacité de ce dernier à
«dire le monde», à revenir, par le langage,
« naturellement », à la source de la création36, qui va de
fait au-delà des antagonismes culturels37. Et, si Biély
tire de sa découverte de la poésie révolutionnaire de
Kliouev des conclusions enrichissantes en termes
esthétiques38, l’on perçoit en retour, chez l’auteur des
Chants de l’isba, la présence de motifs orientaux dont le
traitement accuse une influence du scythisme. Des motifs
sans doute suscités aussi par un voyage récent dans le
sud de l’Empire, comme en témoigne une lettre à
Chiriaevets datant de début 1917 : « J’étais dans le
Caucase et l’Orient m’est positivement monté à la tête.
Selon moi il s’agit d’une beauté inédite39. » Et de fait
l’Orient renvoie, chez le poète, à deux modèles de
construction poétique, qui suivent chacun une dynamique
différente.
D’une part, l’Orient et l’Occident s’insèrent dans
le paradigme antithétique élaboré dès les œuvres de
jeunesse, qui par ailleurs englobe les oppositions entre
le « nous » et le « vous », la nature et la machine, la
campagne et la ville40. Ces espaces deviennent d’autant
plus des topoï poétiques qu’ils sont associés aux motifs à
la fois religieux et érotiques, qui occupent une place
importante dans l’esthétique kliouevienne des années
1910. « Arrière, Occident ! – Serpent, Débauchée, / Notre
promis est le jeune Orient41 ! » écrira le poète entre
11
1916 et 1918. Mais cette opposition entre l’Orient et
l’Occident subit aussi un traitement similaire à celle
qui sépare « les moissonneurs » et les « intellectuels »
dans le célèbre poème de 1910, La voix du peuple. De la même
façon que le poète appelle, dans la dernière strophe, à
l’union des deux parties fraternelles42, il invitera
l’Orient et l’Occident, dans le Chant de l’Héliophore, à la
« ronde rituelle », animé d’un élan révolutionnaire et
internationaliste. La nouvelle ronde populaire suggère
non plus seulement la fusion de groupes sociaux jadis
divisés, mais bien le syncrétisme de toutes les
cultures : « La Chine et l’Europe, et le Nord et le
Sud, / dans une ronde d’amies s’uniront au palais43. »
« Le pain de toutes les tribus / Sera rompu entre les
frères44 » lit-on dans le poème publié à la suite, et
février 1917 correspond précisément au temps espéré de la
moisson45.
Le scythisme, et en particulier l’influence de la
critique positive de Ivanov-Razoumnik46, semblent donner
au poète l’impulsion nécessaire pour faire du motif de
l’Orient la figure de proue de sa poétique du syncrétisme
culturel et esthétique. Si la révolution paraît être la
raison première du rapprochement des nations et des
continents, de la chute des barrières sociales, l’univers
poétique tout entier de Kliouev des années 1916-1918 se
construit à partir de la fusion entre l’Orient, - comme
espace exotique des Mille et une nuits - et la Russie ancienne.
Une fusion qui se présente comme la condition sine qua non
12
de l’avènement ultime du paradis paysan : « Toutes les
races en une seule fusionnent : / Alger, et l’orange
Bombay / Sont cousues dans la blague de l’aïeul / Avant
les jours d’or, de résurrection47. »
L’opposition entre Orient et Occident, comme symbole
de la dénonciation de la culture occidentale, urbaine,
savante, et de résistance à celle-ci, ne disparaît
pourtant pas de la poésie de Kliouev, notamment des
œuvres qui entreront dans le recueil Le pain des lions.
L’Orient, et en particulier l’Asie, seront repris par le
poète dans leur acception violente de destructeurs de la
civilisation et de l’universalisme russe : « le pain des
lions, - écrit-il en 1922, - est finalement le destin de
24 « Мы ведь скифы, […] а они все романцы, […] все западники, имнужна Америка, а нам […] песня да костер Стеньки Разина. » S.Esenin,Œuvres complètes en 5 tomes, M., 1962, t.5, p.126. 25 Les sources de Marie [Ключи Марии], S.Esenin, Œuvres complètes… p.32.26 « Узнайте-же ныне: на кровле конек / Есть знак молчаливый, что путь наш далек. [Sachez désormais : sur le toit le cheval / Est le signe muet que très loin nous allons] », Scythes, août 1917, p.101.27 S.Esenin, Œuvres complètes… p.126.28 Cf. K.Azadovski, Les poètes néo-paysans… p.46.29 « Мы - жнецы вселенской нивы, / Вечеров уборки ждем. / И хоть смерть косой тлетворной / Нам грозит из лет седых: / Он придет нерукотворный / Век колосьев золотых », Le Carillon des Pins… p.1530 « Сломим же минувшего тяжкие печати », N.Kljuev, Le cœur de licorne… p.123. 31 « Но былому неподвластны - / Мы в грядущее глядим », Ibidem, p.134.32 « Уповать, что мир потерь / Канет в сумерки безвестья, / Что, как путник, стукнет в дверь / Ангел с ветвью влаговестья. » (1913) Ibidem,p.198. 33 « Скоро к голодному люду / Пламенный вестник придет. / К зрячим нещадно суровый, / Милостив к падщим в ночи […]. » 1908. 4334 Cf. « Задебренные лесом кручи... » A.Blok, Œuvres complètes en 20 tomes., M. Nauka, 1997, t.3, p.168.35 Cf. J.Leontiev, Les Scythes de la révolution russe…, p.235-236.
13
l’Occident et de l’Orient. La Russie acceptera l’Orient,
car elle est elle-même orientale, mais elle ne servira
plus de bouclier à l’Europe48. » La référence aux Scythes
d’Alexandre Blok, véritable manifeste de l’ensemble du
mouvement intellectuel du même nom, est ici explicite. On
y lit : « Tels des esclaves obéissants / Nous fumes le
bouclier entre deux races ennemies / Entre les Mongols et
l’Europe49 ! ». Ce poème de Blok, fondamental, résume les
postures contradictoires de Kliouev, qui, en même temps
qu’il appelle à l’union fraternelle, affirme la nature
barbare de l’Asie. Il va falloir attendre les années 1930
pour que la figure du Scythe soit de nouveau
opérationnelle pour Kliouev dans le contexte de la
résistance au pouvoir soviétique : « Sauveur
merveilleux ! / De ton sabot écrasant le Serpent, / Pour
nous, à terre devant le Khan, / Saint-Georges saura
cabrer sur le granit / L’héritage des juments
Scythes50 ! » écrira le poète dans son monumental Chant de la
Grande Mère.
L’Orient renvoie ainsi, chez Kliouev, à des concepts
parfois paradoxalement éloignés. Il s’agit d’abord d’une
36 A.Belyj, « Le bâton d’Aaron (sur le mot en poésie) », Scythes, août 1917, p.189-190.37 « Красота – в глубине, глубина не раскроется в миге, но зреет в веках; угловатости творчества христианской культуры выветвляют из времени великолепие башен романского стиля… », A.Belyj, « Le chant del’Héliophore [Песнь Солнценосца] », Skify, 1918 [déc. 1917], p.7. 38 Cf. Ibidem, p.1039 « Я был на Кавказе и положительно ошалел от Востока. По-моему, этокрасота неизреченная. » Nikolaj Kljuev, L’arbre du verbe [Словесноедрево], SPb, Rostok, 2003, p.242
14
manifestation du « paradis des épis d’or », tel que rêvé
par les poètes du peuple à la veille de la révolution, et
c’est sous l’égide de l’Orient qu’a lieu alors la fusion
fraternelle de tous les peuples. Toutefois, il est aussi
le symbole de cette culture paysanne, profondément russe,
qui s’oppose violemment à l’Occident et à sa
civilisation. Enfin, l’Orient, et le scythisme en
particulier, deviennent des symboles de résistance
absolue, comme du triomphe absolu de la liberté sur la
domination, et rejoint en cela le motif de la « sainte
révolte » prônée par les poètes « paysans » lors de la
révolution51. Domination qui est de fait vécue comme
étrangère, qu’elle soit d’ordre social, politique ou
culturel. Au moment de l’épisode des Scythes cependant,
l’orientalisme de Kliouev ouvre la porte à un espace de
rapprochement idéologique, dans lequel se réalise l’union
étonnante et éphémère entre les cultures populaire et
savante, toutes les deux intégrées dans un idéal qui les
dépasse. Pour autant, l’on peut se demander si une vision
partagée de la révolution est suffisante – et efficace –40 K.Azadovski, Les poètes néo-paysans… p.3841 « Сгинь Запад – Змея и Блудница, / Наш суженый – отрок Восток! », N.Kljuev, Le Coeur de licorne…, p.318.42 « Мы, как рек подземных струи, / К вам незримо притечем / И в безбрежном поцелуе / Души братские сольем. » Ibidem, p.126.43 «Китай и Европа, и Север и Юг Сойдутся в чертог хороводом подруг»,Skify, 1918 [déc. 1917] p.11.44 « Многоплеменный каравай / Поделят с братом брат », ibidem, p. 14.45 Ibidem46 Cf. K.Azadovski, La vie de Nikolaj Kljuev… p.139.47 « Все племена в едином слиты: / Алжир, оранжевый Бомбей / В кисетедедовском зашиты / До золотых, воскресных дней.» (1918). N.Kljuev, Le Coeur de licorne… p.391.
15
pour expliquer l’association du poète au groupe
littéraire des Scythes.
3. L'épisode des Scythes : une étape décisive dans la trajectoire poétique de
Kliouev.
Lorsque dans son article « Les poètes et la
révolution », Ivanov-Razoumnik fait des poètes
« paysans » les seuls chantres authentiques de la
révolution52, le critique ne se réfère plus à la même
authenticité que celle mise en cause par une certaine
réception de Kliouev lors de la décennie précédente. Ce
concept change de contenu : il ne s’agit plus de savoir
s’il est véritablement issu du peuple dont il se fait le
porte-parole, ou s’il est le véritable auteur de ses
chants et poèmes, ce qui importe, c’est qu’il exprime des
aspirations « authentiquement populaires » concernant la
révolution – puisqu’il voit en celle-ci une
transfiguration spirituelle associée à une transformation
politique et sociale. Et de fait, considéré dès avant la
révolution comme poète « populaire53 », il devient, sous
la plume du critique populiste, et au moment des
48 « Львиный хлеб это в конце концов – судьба Запада и Востока. Россия примет Восток, потому что она сама Восток, но не будет уже дляЕвропы щитом. » N.Kljuev, L’arbre du verbe… p. 5449 « Мы, как послушные холопы, / Держали щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы! », A.Blok, Les douze. Scythes [Двенадцать. Скифы], M. 1958, p.20.50 « Но дивный Спас! / Змею копытя, / За нас, пред ханом павших ниц, /Егорий вздыбет на граните / Наследье скифских кобылиц! », cf.N.Solnceva, « Les Scythes et le scythisme dans la littératurerusse », Moscou, Istoriko-literaturnoe nasledie, avril 2010 (№4).
16
bouleversements historiques de 1917, bien plus encore :
de « paysan » pour les uns, « prophète mystique » pour
d’autres, il se transforme désormais en véritable caution
d’authenticité pour une intelligentsia qui cherche à
comprendre et à accepter la révolution. Pour Ivanov-
Razoumnik, ceci est possible précisément parce que
Kliouev n’est pas un produit de la culture, mais qu’il
incarne un phénomène unique et spontané, et ce qui le
distingue des poètes « urbains » est bien
« l’authenticité des émotions54 ». Dans le même sens vont
les affirmations de Biély, qui écrit dans sa lettre à
Razoumnik du 4 janvier 1918 : « N.A.Kliouev […] me
préoccupe de plus en plus comme phénomène unique,
obligatoire, nécessaire : il est en effet le seul Génie
populaire [narodnyj Genij55]... »).
Toutefois, cette opinion exaltée n’est pas
universellement partagée : Evgueni Zamiatine, lui-même
proche des Scythes, jugera opportuniste sa participation
au recueil révolutionnaire et traitera Kliouev de « poète
de cour56 ». Il accusera les postulats internationalistes
du Chant de l’Héliophore, qui contredisent le patriotisme des
Pensées séculières, sans doute plus conforme à l’image
publique Kliouev d’un « poète populaire ». Même Ivanov-
Razoumnik, s’il est le premier à voir en lui un
authentique poète de génie, est loin de prêter
entièrement foi à la sincérité de ce dernier. Il écrit
dans sa lettre à Biély du 30 septembre 1918 : « Ce que
51 Cf. K.Azadovski, Les poètes néo-paysans… p.43.
17
vous écrivez sur le second [Essenine]57, - je peux le dire
aussi du premier [Kliouev] : ils sont tous les deux des
gens très pratiques, et cet esprit pratique se mêle
bizarrement au quasi « génie » du premier et à l’immense
[…] talent du second58. »
Effectivement, s’il existe entre Kliouev et les
Scythes des liens aussi bien esthétiques qu’idéologiques
profonds, les deux numéros de l’almanach, de même que les
autres organes éditoriaux proches de l’aile gauche du
socialisme révolutionnaire, à commencer par L’étendard du
travail [Znamja truda], lui fournissent d’abord un espace de
publication, de la même façon que dans les années 1910
Alexandre Blok lui avait ouvert les portes d'Apollon.
Lorsqu'en 1915 Kliouev écrit à Esenine qu'il leur faut
être des caméléons59 pour survivre en littérature, il met
le doigt sur cette frontière irréductible entre culture
savante et poésie paysanne, frontière que par ailleurs
lui-même cultive. Son rapport ambigu aux Scythes,
notamment du point de vue de l’engagement politique, est
là pour en témoigner. Ettore Lo Gatto, que le poète a
rencontré à Leningrad, écrira en 1929 : « J’ai discuté
avec Kliouev du « scythisme » et du leader de ce52 R.Ivanov-Razumnik, « Les poètes et la révolution [Поэты иреволюция] », Scythes, 1918 [déc. 1917], p. 1-5.53 Cf. par exemple B.Lavrov, « Conversation avec N.A.Kljuev [Беседа сН.А.Клюевым] », Novgorod, Volgar’, 23 déc. 1916. 54 R.Ivanov-Razumnik, « Les poètes et la révolution »… p.3.55 « Н.А.Клюев […] все более и более, как явление единственное,нужное, необходимое, меня волнует : ведь он – единственный народныйГений… » lettre du 4 janvier 1918 à Ivanov-Razumnik, dans Andrej Belyj etIvanov-Razumnik. Correspondance, A.Lavrov, J.Malmstad, T.Pavlova éds.,SPb, Atheneum, 1998, p.148.
18
mouvement, R.V.Ivanov-Razoumnik. Pourtant j’ai eu
l’impression qu’il n’était pas un partisan convaincu,
bien que les « Scythes » l’eussent loué en tant que poète
qui avait su incarner dans son œuvre la fusion entre le
mysticisme traditionnel et l’élément révolutionnaire60. »
Ainsi, c'est au cœur de ce rapport paradoxal qu'il
faudrait tenter d’interpréter ses vers publiés dans
l’almanach. Il semblerait bien qu’au-delà de tout
engagement politique, le poète voie dans cette expérience
l’occasion, avant tout, d’affirmer son mythe personnel.
Le choix des textes publiés dans les Scythes frappe
par son éclectisme : rien, au premier abord, ne semble
rapprocher le cycle Terre et fer, qui par son nom renvoie à
l’article critique évoqué plus haut de Ivanov-Razoumnik,
et qui est consacré à l’isba – centre de l’univers et
berceau de toutes les merveilles, à l’opposé de la
culture « rouillée61 », des Chants de l’isba, cycle lyrique
qui rassemble des poèmes rédigés entre 1914 et 1916 après
la mort de la mère du poète. Quant au Chant de l’Héliophore et
au poème « Douze mois en une année », ils sont tous les
deux des hymnes à l’union des peuples dans l’espace
commun du paradis rural, qui exploitent, comme on l’a vu,
des éléments essentiels de la poétique de Kliouev, mais56 E.Zamjatin, « Scythes ? [Скифы ли?] », Pensée [Мысль], Pétrograd, 1918, p.285-293. 57 Cf. Lettre à Ivanov-Razumnik du 23 septembre 1918 : « что-то Есенинмне по линии своего литературного поведения не очень нравится : ужочень практичен он… », Andrej Belyj et Ivanov-Razumnik. Correspondance… p.165.58 « То, что Вы пишите про второго, - я могу повторить про первого:оба они очень и очень практики, и практичность эта причудливопереплетается с почти «гениальностью» первого и огромным […] талантомвторого. » Ibidem, p.167.
19
sont avant tout composés pour la révolution. Ces poèmes,
très différents par leur contenu, sont unis par l’effet
qu’ils produisent sur leur lecteur : ils semblent en
effet renvoyer aux différentes facettes d’un mythe
personnel, dans lequel Kliouev est à la fois poète
« paysan », « révolutionnaire » et « populaire ». Une
représentation de soi qui n’est pas anodine dans cet
organe de la culture que sont les Scythes, et surtout à
l’heure des grands changements historiques.
Un poème en particulier, rédigé en 1916, est
symptomatique de cette posture spécifique : il s’agit du
cinquième du cycle Terre et fer, dédié à Serguei Essenine.
Kliouev y retrace son chemin depuis son arrivée sur la
scène littéraire en 1911 jusqu’à la guerre, dresse un
« bilan » de sa réception par l’élite littéraire et
artistique et justifie l’arrivée de Essenine sur cette
même scène. La publication de ces vers dans le premier
numéro des Scythes semble témoigner, de la part du poète,
d’une prise de conscience de sa trajectoire poétique au
moment du tournant qu’est la révolution. Alors que le
bouleversement historique est pressenti comme étant
l’ultime métamorphose, le « bilan » poétique paraît
bienvenu. Il est par ailleurs inséparable du motif de la
naissance très présent dans les poèmes rédigés entre 1916
59 « Être vert dans l’herbe et gris sur la pierre – tel est notreprogramme à tous les deux pour survivre», Nikolaj Kljuev, L’arbre duverbe… p.237.60 Cité par J.Leontiev, Les Scythes de la révolution russe… p.155.61 « Я видел звука лик, и музыку постиг, / Даря уста цветку, без ваших ржавых книг! », Skify, août 1917, p.103.
20
et 1918, notamment dans le cycle Le Sauveur [Spas]62. Sa
participation à l'entreprise des Scythes peut ainsi être
interprétée du point de vue de la quête d'identité
poétique, qui semble trouver un aboutissement dans
l'affirmation du poète « paysan » reconnu et admiré par
cette partie de l'intelligentsia qui s'engage avec au
moins autant d'espoir dans la nouvelle ère
révolutionnaire. Cette lecture fournit plusieurs clés de
compréhension de la trajectoire ultérieure du poète, et a
l’avantage d’expliciter l’ambigu balancement de Kliouev
entre sa position de rejet violent de l’occident et son
désir de fusion culturelle avec celui-ci. S’il est
reconnu comme le véritable porteur de l’esprit
révolutionnaire par Razoumnik, il déchante aussi
rapidement au contact avec la nouvelle réalité
bolchevique et, fort de sa posture de poète populaire, se
fait d’autant plus chantre et défenseur de la culture
paysanne. C’est enfin au moment de sa collaboration avec
les Scythes qu’il fait de l’isba le berceau de l’univers
et édifie le cosmos rural, notamment dans les Chants de
l’isba, qui participe largement à ériger, pièce par pièce,
son propre mythe de barde « sacré par le peuple».
Cette identité réaffirmée servira de prémisse à la
conception, quatre ans plus tard, de son autobiographie,
Le Destin du grèbe, qui sera un premier jalon dans la
résistance à la fois poétique et culturelle au nouvel
ordre bolchevique.
62 N.Kljuev, Le Coeur de licorne… p. 341-351.
21
L’expérience de la participation à l’almanach des
Scythes apparaît fondamentale pour Nikolaï Kliouev, aussi
bien du point de vue de son rapport à la révolution,
celui-ci concordant à la fois avec les idéaux d’un
« paradis rural » et le paradigme orientaliste des
Scythes, que du point de vue de la poétique. C’est en
effet au moment de sa collaboration de près avec le
cercle populiste de Ivanov-Razoumnik et les Scythes qu’il
développe les motifs orientaux dans sa poésie, motifs qui
viendront fusionner avec l’univers de l’isba russe,
métamorphosant celui-ci en un véritable cosmos. Le
scythisme ajoute ainsi une pierre de plus à l’édifice
poétique de Kliouev, bâti autour d’une double dynamique :
celle de l’antagonisme, et celle de la synthèse
créatrice, qui englobe l’immensité mythologique dans
l’espace ténu de l’isba.
L’épisode des Scythes est aussi, comme on l’a vu,
crucial pour aborder le problème de la relation du poète
à la culture « savante » : s’il s’intègre parfaitement au
projet du groupe littéraire, il profite aussi de cette
occasion pour affirmer toutes les composantes de son
mythe personnel, celui-là même qui le rend à la fois
complexe et attirant pour une intelligentsia en quête
d’une figure poétique véritablement russe autant que
révolutionnaire. Si les révolutions de 1917 lui offrent
une double caution d’authenticité, d’une part comme
chantre de l’avènement d’un paradis paysan – du moins
22
dans les premiers temps – d’autre part comme représentant
du peuple révolutionnaire, et de ce fait son tribun et
son barde, il devient à son tour, du point de vue des
socialistes révolutionnaires de gauche, une « caution »
de l’authenticité de leurs propres aspirations à une
révolution « spirituelle ». Enfin, le premier numéro de
l’almanach devient pour Kliouev un espace d’affirmation,
de justification et de revendication de sa trajectoire
poétique, qui le mène à devenir un poète révolutionnaire
fidèle à ses idéaux paysans. C’est sous le signe de
l’ultime union, difficilement concevable, entre
révolution bolchevique et « paradis rural», que sera
composé le recueil rassemblant les poètes « néo-
paysans », Le Carillon Rouge [Krasnyj zvon], paru au printemps
1918, dans lequel sera repris, en préface, l’article de
Ivanov-Razoumnik « Les poètes et la révolution ».
Toutefois l’absence d’un programme esthétique, poétique
et idéologique commun empêchera ces poètes, placés sous
le patronage de l’intelligentsia populiste, de former un
véritable mouvement littéraire et de donner suite à ce
recueil.
23