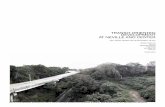Neville Rowley, "Pittura di luce: genèse d’une notion", Studiolo, 5, 2007, pp. 227–248
Transcript of Neville Rowley, "Pittura di luce: genèse d’une notion", Studiolo, 5, 2007, pp. 227–248
P A R U S E T À P A R A Î T R E :
1 - 2002 D o s s i e r : Rome et Paris 1650 - 1750
2 - 2003 D o s s i e r : Rome et l’Europe romantique
3 - 2005 D o s s i e r : Arts et théâtre, de la Renaissance au XXe siècle
4 - 2006 D o s s i e r : Le portrait entre Italie et Europe
5 - 2007 D o s s i e r : L’Art : de l’actualité à l’histoire
6 - 2008 D o s s i e r : L’Italie et les régions françaises
7 - 2009 D o s s i e r : La notion de genre dans les arts
INFO: www.villamedici.it
Studiolo
PIERRE ARIZZOLI-CLÉMENTELJean Leymarie tel que je l’ai connu
D O S S I E R : L’ A R T: D E L’ A C T U A L I T É À L’ H I S T O I R ESERGIO BERTELLIUna fonte storica non verbale
MARIA AGATA PINCELLILa Roma triumphans e la nascita dell’antiquaria: Biondo Flavio e Andrea Mantegna
GUY-FRANÇOIS LE THIECLes enjeux iconographiques et artistiques de la représentation de Lépante dans la culture italienne
CECILIA HURLEYUnmasking the Roman carnival – an antiquary’s view
CATHERINE CHEVILLOTPeut-on parler d’une sculpture d’histoire? Essai comparatif sur les monuments aux grands hommes en France et en Italie au XIXe siècle
LAURA IAMURRILionello Venturi e la storia dell’Impressionismo, 1932-1939
V A R I AMARIE-LAURE CASSIUS-DURANTONLe Songe de Marcantonio Raimondi. Proposition d’interprétation
MARIA GIULIA AURIGEMMAUn corpus perduto? Sui disegni di Jacopo Zucchi
NATALIA GOZZANOLa vita economica di Claude Lorrain. Conti bancari, investimenti in luoghi di monte e pagamenti inediti
SOPHIE COUËTOUXLes charmes de la chair peinte: Florence, XVIIe siècle
CHRISTIAN MICHELDes Vite de Bellori à l’Abrégé de la vie des Peintres de Roger de Piles: un changement de perspective
MARION LAGRANGEGiovanni Boldini (1842-1931) et la scène artistique parisienne, une réception équivoque
NEVILLE ROWLEY“Pittura di luce”: genèse d’une notion
I N F O R M A T I O N SÉLODIE COUÉCOULes institutions étrangères de recherche en Italie
L’histoire de l’art à l’Académie de France à Rome (2005-2006)
R É S U M É S D E S A R T I C L E S (français, italiens, anglais, allemands)B I O G R A P H I E S D E S A U T E U R S
ISBN 978-2-7572-0011-7ISSN 1635-081735 e296 pages / 150 illustrations
5
Stud
iolo
2007
-5
52007
Studiolo
R E V U E D’histoire de l’artD E L’ A C A D É M I E D E F R A N C E À R O M E
EN COUVERTURE: Andrea Mantegna, L'Introduction du culte de Cybèle à Rome,1505-1506, détail, London, National Gallery.
La Revue d’histoire de l’art de l’Académie de France à Rome se pro-
pose de publier des recherches sur les échanges artistiques entre
l’Italie et la France dans un large contexte européen, de la
Renaissance au XXe siècle. Elle constitue aussi un espace ouvert
aux débats les plus actuels qui occupent l’histoire de l’art, dans ses
objets comme dans ses méthodes. Chaque livraison, annuelle,
comporte un DOSSIER introduit par un essai général de mise
en perspective, des VARIA et une rubrique INFORMATIONS.
Les auteurs reflètent la diversité des méthodes actuelles de la
recherche dans les différentes formations françaises, européennes et
américaines: chercheurs, universitaires, conservateurs et professeurs
d’écoles d’art. La variété des sujets et des approches fait de cette
revue une publication illustrant la fécondité du dialogue artistique
et historiographique entre la France et l’Italie et les problématiques
modernes de l’histoire de l’art.
ultima COUV OK STUIOLO 5 10-07-2007 11:19 Pagina 1
L’historiographie récente se risque rarement à bapti-ser les mouvements artistiques des siècles passés. Elles’est plutôt engagée, depuis plus d’un siècle, à réévaluerdes dénominations d’abord péjoratives, de “gothique” à“baroque”. Pourtant, en 1990, l’exposition Pittura di luce,dirigée par Luciano Bellosi, donnait un nom à un courantde la peinture florentine du milieu du Quattrocento.Selon Bellosi, cette “peinture de lumière” consiste dans“le dépassement de la peinture extrêmement concentréeet dense de Masaccio pour une vision plus étendue etoptimiste, dans laquelle les couleurs s’emperlent delumière et la perspective devient un spectacle pour lesyeux” 1. Domenico Veneziano était présenté comme leporte-parole de cette tendance picturale, qui concernaitpresque tous les peintres florentins de l’époque, de FraAngelico à Giovanni di Francesco, à l’exception notablede Filippo Lippi.
On ne peut qu’être surpris par une proposition aussitardive, dans un domaine de l’histoire de l’art particuliè-rement étudié. Personne, avant 1990, n’aurait-il donc vuni compris la pittura di luce? Les organisateurs de l’expo-sition n’étaient pas si catégoriques, puisqu’ils plaçaientouvertement leur démarche dans la continuité d’un essaide Roberto Longhi publié en 1952, “Il ‘Maestro diPratovecchio’”2. Le but principal de Luciano Bellosi et deses collaborateurs était de réaffirmer l’existence d’unmouvement florentin jusqu’alors partiellement reconnu.De ce point de vue, l’exposition fut certainement un suc-cès: quinze ans plus tard, le moindre catalogue sur lapeinture du Quattrocento parle de “pittura di luce”3. Lamanifestation de 1990 s’est-elle contentée de nommer unmouvement déjà cerné par la critique, ou bien eut-elle unrôle plus décisif? Pour comprendre la portée de cet évé-nement, il importe de remonter aux origines de la notionde “peinture de lumière”.
La question de la pittura di luce parcourt toute la criti-que d’art du XXe siècle, comme en témoigne la “doubleinvention” de l’expression: plus de soixante ans avant l’ex-position éponyme, Roberto Longhi avait déjà décrit dansles mêmes termes la peinture de Domenico Veneziano. Lapremière redécouverte de cette manière remonte au début
du siècle, quand un regard nouveau se porte sur lesœuvres de Piero della Francesca. L’intérêt pour la lumièreet la couleur du peintre pousse les historiens de l’art à exa-miner ses contemporains florentins selon les mêmes critè-res. Cette première mise au jour, dont Adolfo Venturi etRoberto Longhi sont les principaux artisans, assujettit lemouvement florentin à la figure tutélaire de Piero. Ce n’estque dans son article de 1952 que Longhi délimite un cou-rant spécifiquement florentin, dominé cette fois parDomenico Veneziano. L’exposition de 1990 couronneracette longue maturation en donnant un nom au mouve-ment, ce qui marque le point de départ d’une reconnais-sance plus large et pose de nouvelles questions. Il nes’agira pas ici de les résoudre, mais seulement d’éprouverla validité de la notion de pittura di luce, en examinant lagenèse et les avatars de cette appellation.
UNE “SYNTHÈSE PERSPECTIVE DE FORME-COULEUR”:SOUS LE SIGNE DE PIERO DELLA FRANCESCA (1911-1950)
Pendant toute la première moitié du XXe siècle, la redé-couverte de la pittura di luce à Florence a été dépendantede celle de Piero della Francesca. Cette comparaison alongtemps empêché la reconnaissance d’une particularitéflorentine, mais elle a également permis à la critique d’artde souligner les qualités de lumière et de couleur d’artis-tes longtemps méconnus de ce point de vue.
Domenico Veneziano est sans aucun doute le peintreemblématique de cette redécouverte stylistique. Jusqu’auXIXe siècle, sa notoriété reposait non sur ses œuvres, maissur son prétendu assassinat par Andrea del Castagno,qu’avait romancé Vasari 4. La publication en 1850 d’undocument prouvant la présence de Piero della Francescadans l’atelier de Domenico en 1439 avait contribué à saréévaluation, mais les historiens d’art de la fin du XIXe sièclele considèrent encore principalement comme un peintre aunaturalisme un peu sec5. Le premier à affirmer clairementles valeurs chromatiques et lumineuses caractéristiques del’art de Domenico Veneziano est Adolfo Venturi, dans unvolume de sa Storia dell’arte italiana publié en 1911. C’est
130Studiolo 5 - 2007
“Pittura di luce”: genèse d’une notion
NEVILLE ROWLEY
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 130
V A R I A
surtout dans le panneau principal du Retable de sainte Lucieque Venturi discerne la “luminosité du coloris” propre àDomenico6. Cette particularité, tirée de Masolino et de FraAngelico, se retrouve ensuite chez Pesellino, Giovanni diFrancesco et Alesso Baldovinetti7. Les descriptions lyriquesque fait Venturi de la palette claire et de la luminositésolaire de telles œuvres permettent de comprendre l’exis-tence d’une “peinture de lumière” florentine.
Pour Adolfo Venturi, ces réalisations florentines nemarquent pourtant qu’une étape vers celui qui portera à laperfection ce “dolcissimo impasto di colore e di luce”:Piero della Francesca8. En 1911, la redécouverte de Pieroest déjà entamée, mais Venturi insiste sur l’importance dela claire luminosité du peintre dans la poétique de sesœuvres9. La peinture de Piero est présentée comme unesolution à des problèmes artistiques soulevés à Florence,sans avoir été complètement résolus. Piero sert doncd’aune à l’évaluation des œuvres de Domenico Venezianoet de ses contemporains florentins. Si Venturi ne parle pasde tendance, mais uniquement d’influences individuelles,c’est en grande partie à cause de sa conception essentielle-ment monographique de l’histoire de l’art. Caractéristiquede la critique d’art italienne depuis Vasari, cette position aété fortement réaffirmée par l’esthétique de BenedettoCroce. Pour ce dernier, l’art est l’intuition exprimée parl’artiste, l’historien d’art se devant de chercher la poésie del’artiste dans les œuvres elles-mêmes – et non plus deraconter une biographie à la manière vasarienne. Dès lors,l’étude monographique et les influences artistiques indivi-duelles deviennent la forme la plus appropriée du dis-cours sur l’art, ce qui nuit de fait à la mise en évidenced’un mouvement d’ensemble10.
L’analyse d’Adolfo Venturi marquera nettement lacompréhension de la personnalité artistique de DomenicoVeneziano. August Schmarsow est un bon témoin de cerevirement: alors qu’en 1893, la luminosité du peintre estdécrite comme un trait plutôt générique de son art, elle endevient sa caractéristique majeure en 191211. Mais c’est sur-tout Roberto Longhi qui développera les recherches deVenturi. Comme pour celui qui fut son maître, l’intérêt deLonghi pour les peintres florentins dépend égalementd’une admiration bien plus grande pour Piero dellaFrancesca. Dans l’un de ses premiers articles, “Piero deiFranceschi e lo sviluppo della pittura veneziana”, publiéen 1914 dans L’Arte, Longhi présente sa vision de la pein-ture italienne du Quattrocento: le style de Piero, hérité dePaolo Uccello et de Domenico Veneziano, réalise une “syn-thèse perspective de forme-couleur”, qui sera ensuite pour-suivie par Antonello de Messine, Giovanni Bellini et la“grande” peinture vénitienne du début du XVIe siècle, cellede Giorgione et du jeune Titien12. L’approche de Longhi,faite de descriptions enthousiastes et littéraires, reste pro-che de celle de Venturi, mais sa perspective historique esttrès différente de celle de son maître13. L’influence de l’art
de Piero s’étend en effet sur un territoire beaucoup plusvaste que l’Italie centrale à laquelle l’assignait Venturi. Ellen’est pas comprise de façon régionaliste et positiviste, maiscomme un développement artistique idéal qui impliquetoute l’histoire de la peinture italienne de la Renaissance.
L’étude de Longhi est donc essentiellement théorique.Dans ce sens, ses descriptions sont profondément mar-quées par les penseurs de la “pure visibilité”, dont ilconnaît les réflexions par l’entremise de Benedetto Croce14.La définition du style de Piero comme la sereine juxtaposi-tion de plans colorés permettant d’obtenir “la troisièmedans les deux dimensions” est ainsi directement inspiréede l’essai d’Adolf von Hildebrand, Das Problem der Form inden bildenden Kunst15. Longhi insiste notamment sur l’idée,à peine développée par Hildebrand, que la couleur joue unrôle fondamental dans l’illusion spatiale16. C’est en effetl’alliance de la couleur avec la perspective mathématiquequi définit son mouvement pictural, présenté comme larésolution du problème séculaire de l’opposition entre lareprésentation de l’espace et l’utilisation de la couleurpure17. Longhi définit ainsi une “pittura ‘di colore’”, danslaquelle le rôle de Florence est pionnier18. La matrice floren-tine, qui exclut encore des peintres comme Masaccio et FraAngelico, est néanmoins considérée comme la simplegenèse d’un mouvement plus important19.
En 1927, dans sa monographie sur Piero della Francesca,Roberto Longhi dresse un panorama plus circonstancié dela scène artistique florentine du Quattrocento. Par rapportà l’article de 1914, Piero fait davantage figure d’élève ins-piré que de génie solitaire20. Sa “synthèse perspective deforme-couleur” est préfigurée en effet dès le Trecento parMaso di Banco, avant de se développer au siècle suivant,d’abord chez Masaccio et Fra Angelico, puis dans l’œuvrede Paolo Uccello et surtout de Domenico Veneziano. Laforme “classique” que lui donne Piero sera poursuivie parles peintres vénitiens et jusqu’à Enguerrand Quarton. ÀFlorence, les artistes qui poursuivront cette manière, deGiovanni di Francesco à Alesso Baldovinetti, sont considé-rés comme les tenants d’un “mouvement ‘franceschien’[…] rapidement suffoqué”, et non comme les héritiers deDomenico Veneziano21. La figure de Piero voile la conti-nuité florentine22.
131 Studiolo 5 - 2007
1. Giovanni di Francesco, Paliotto di San Biagio, 1453, Petriolo, San Biagio.
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 131
La monographie sur Piero est capitale dans la fortunede la pittura di luce, puisque l’expression y est employéepour la première fois. Dans les premières pages de l’ou-vrage, Longhi parle en effet d’un “[…] maestro, forse il piùsottile fra tutti, addentro in ogni segreto dell’arte e in qual-che altro ancora, creduto di tecnica, questo, ma pronto atrasmutarsi in pittura di luce e di illuminante intimità, nelprovvidenziale impulso creativo di quei giorni: eraDomenico da Venezia, e con lui Piero stava nel 1439”23.
Longhi ne parle certes pas de “peinture de lumière”pour définir un mouvement ou une catégorie, mais ilemploie l’expression comme l’une des nombreuses figu-res d’un discours orné qui cherche à recréer sur la pageles rapports de forme perçus par le critique 24. Noyéedans un style que l’auteur lui-même jugera par la suite“un po’ troppo collet monté”25, la formule passera inaper-çue, à tel point que Luciano Bellosi sera persuadé del’avoir “inventée” pour l’exposition florentine de 199026.L’usage d’une telle expression témoigne néanmoinsd’une évolution sémantique importante: ce n’est plus laperspective ou la couleur qui résument l’art de Piero,mais la lumière elle-même27.
Si ces deux écrits sont fondamentaux dans la mise enévidence d’un courant particulier, leur nature “france-schienne” éclipse toute analyse spécifiquement florentine.Celle-ci se développe chez Longhi dans des articlesmonographiques, à commencer par celui, fondamental,consacré à Domenico Veneziano et publié dans L’Arte en1925. L’auteur ne se contente pas de définir “l’extaselumineuse et chromatique du monde de DomenicoVeneziano”, ce qu’Adolfo Venturi avait déjà fait en 1911et répétait dans le même fascicule, mais il réévalue nette-ment “l’importance de Domenico Veneziano pour ledevenir de la peinture, pas seulement toscane”28. S’il tientDomenico pour un artiste de premier plan, Longhi esttout autant attiré par les peintres dits mineurs, ces“parecchi curiosi e preziosi ‘camerieri di grandi uomini’”,comme Giovanni di Francesco, auquel il consacre un arti-cle en 192829. Mieux encore que les génies supérieurs, quigardent quelque chose d’insaisissable, ces artistes permet-tent de mettre en évidence les caractéristiques d’une ten-dance picturale. En faisant de Giovanni di Francesco sonprotagoniste, l’exposition Pittura di luce saura s’en souve-nir. Cette attention de Longhi pour les “petits maîtres” estétroitement liée à son activité de connaisseur. On trouvedans les mêmes années des analyses comparables chez unautre grand connoisseur, Richard Offner, qui met en évi-dence la lumière picturale si caractéristique de l’art deGiovanni di Francesco30, tandis qu’il note l’influence de lapalette claire de Domenico Veneziano chez un artiste dontil est le premier à reconstituer le parcours, le “Maître despanneaux Barberini”31.
Déjà sensible dans la monographie de 1927, la recon-sidération longhienne de Masaccio et de Fra Angelico
n’est pleinement consacrée qu’en 1940, dans les “Fatti diMasolino e di Masaccio”. Alors qu’en 1914 Masaccio étaitcompris comme le tenant d’une peinture essentiellementplastique, il est décrit en 1940 comme l’inspirateur de ce“côté plus subtilement aéré et coloré” qui sera compris enpremier lieu par Fra Angelico, puis développé dans lesannées 1430 par le Maître du Cloître des Orangers 32.Quant à Domenico Veneziano, il puisera sa propre “syn-thèse” autant dans les nouveautés de Masaccio que dansles subtilités de Masolino33. La conception d’un mouve-ment “franceschien” à Florence est toujours présente,même si un peintre, que Longhi nommera plus tardMaître de Pratovecchio, est touché directement par l’artde Domenico Veneziano34. Tout au long des publicationsde Longhi, la compréhension de la scène florentine a doncsensiblement évolué, comme en témoigne un nouvel essaisur Piero della Francesca daté de 1950. Fra Angelico etDomenico Veneziano y sont portés aux pinacles, tandisque Paolo Uccello n’est même plus mentionné 35. Encorecomprise selon la “peinture par antonomase” de Piero, lapeinture florentine du milieu du Quattrocento est prochede s’en détacher36.
Dans la réflexion de Roberto Longhi, l’élaborationd’une “synthèse perspective de forme-couleur” doitbeaucoup à son engagement pour l’art de la modernité.On souligne habituellement sa participation à la Voce etses liens avec les futuristes, mais Longhi compare toutautant les œuvres des peintres du Quattrocento à celles
132Studiolo 5 - 2007
2. DomenicoVeneziano, Retable de sainte Lucie (détail),c. 1445, Firenze,Galleria degli Uffizi.
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 132
V A R I A
des post-impressionnistes37. Sa mise en évidence du rôlede la couleur dans la construction de l’espace pictural,manifeste des artistes du début du siècle, devient égale-ment un topos de la nouvelle critique d’art italienne38. Cetteappréciation de la peinture florentine du Quattrocento àtravers les critères de l’art contemporain est égalementvisible dans la monographie que Ruth Kennedy consacreen 1938 à Alesso Baldovinetti. Les qualités picturales pro-pres au peintre ont en effet été révélées, selon Kennedy,par les œuvres de Cézanne ou Matisse, tandis queDomenico Veneziano est compris comme un impression-niste qui s’ignore39. Au-delà de l’anachronisme d’une telleanalyse, la luminosité et la palette claire de ces œuvres duQuattrocento est clairement comprise comme l’une deleurs valeurs artistiques principales40. Au début du XXesiè-cle, la production artistique contemporaine contribue doncà la redécouverte de la pittura di luce41.
À la connaissance directe de l’art de son temps, GeorgPudelko ajoute une préoccupation toute germanique pourles couleurs employées par ces peintres florentins. En 1934,il consacre une longue étude monographique à DomenicoVeneziano, dont il fait le premier nur-Maler42. Les “couleursresplendissantes” de Domenico sont également remar-quées par l’auteur dans l’Annonciation de San Lorenzo deFilippo Lippi43, et semblent également participer d’un “artsolaire”, apollinien, opposé au côté dionysiaque de laRenaissance que représentent selon lui les Batailles de PaoloUccello, “peintre lunaire” 44. À une époque où RobertoLonghi considère encore Domenico Veneziano et PaoloUccello comme les pères de la “synthèse perspective deforme-couleur”, la discrimination de Pudelko rend plusexplicite la différence entre les deux peintres. Même s’il estencore tributaire de la figure de Piero, ce courant “solaire”préfigure directement la notion de pittura di luce, tout enprécisant l’un de ses aspects fondamentaux.
Publiée en 1935, la thèse de doctorat d’HerbertSiebenhüner confirme l’intérêt porté par les chercheursgermaniques à ce moment pictural florentin. L’objectifprincipal de Siebenhüner consiste à rapprocher le SaintJérôme de Piero della Francesca à l’Accademia de Veniseavec les prescriptions sur le coloris contenues dans le DePictura d’Alberti. Mais l’auteur trace également la généa-logie d’une peinture essentiellement lumineuse, qui va deMasaccio à Piero, en passant par Domenico Veneziano45.La manière de Domenico, jugée comme “rétrograde” parson insistance sur la valeur décorative de la couleur, estpartagée par un groupe d’artistes, au premier rang des-quels figure Fra Angelico. Siebenhüner distingue nette-ment ce groupe de la tendance que personnifie FilippoLippi, et qui donne à voir un espace nettement moinslumineux46. Ces réflexions, moins éparses que ne l’étaientcelles de Pudelko, anticipent directement l’analyse de lascène artistique florentine que proposera, plus d’un demi-siècle plus tard, l’exposition Pittura di luce.
La conception de Longhi d’une “unité de la peintureitalienne de la Renaissance au nom de la ‘synthèse pers-pective de forme-couleur’ pierfranceschienne” 47 ne faitpourtant pas l’unanimité. Les spécialistes de Venise refu-sent de reconnaître une origine florentine à la peinturevénitienne, tandis que les études sur la peinture florentineconfèrent à Domenico Veneziano une importance encorerelative48. C’est en particulier le cas de l’ouvrage de MarioSalmi publié en 1936, Paolo Uccello, Andrea del Castagno,Domenico Veneziano. L’influence des propositions deLonghi est certes visible dans ses descriptions49, ainsi quedans le rôle alloué à Piero50, mais Salmi reste marqué parla traditionnelle discrimination en écoles, qui confine lapeinture florentine dans la maîtrise du dessin et laisse àVenise le sens de la couleur. Ainsi, de manière totalement
133 Studiolo 5 - 2007
3. Filippo Lippi, Annonciationde la mort de la Vierge et arrivéedes Apôtres (partie centrale de la prédelle de la Pala Barbadori),Firenze, Galleria degli Uffizi.
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 133
anachronique, le style de Domenico, jugé moins importantà Florence que celui d’Uccello et d’Andrea del Castagno,est attribué à ses origines vénitiennes51. Ces présupposés,qui datent de Vasari, furent en quelque sorte réaffirméspar les écrits de Bernard Berenson. Ils ont contribué ànuire à la reconnaissance d’un mouvement florentin quin’exalterait pas les “valeurs tactiles”52.
Ainsi, la première redécouverte de la pittura di luceest avant tout une affirmation des caractéristiques for-melles, de lumière et surtout de couleur, des peintres flo-rentins du milieu du Quattrocento. Ceux-ci ne sont pasencore considérés comme appartenant à un mouvementparticulier, mais plutôt compris comme des prolégomè-nes à Piero della Francesca. Ce n’est qu’en 1952 queRoberto Longhi étudiera le mouvement d’un point devue spécifiquement florentin.
LA “CULTURE DE DOMENICO VENEZIANO”:UN COURANT PICTURAL FLORENTIN (1952-1990)
Paru en 1952, l’article de Roberto Longhi intitulé “Il‘Maestro di Pratovecchio’” constitue le précédent majeurde l’exposition Pittura di luce53. La reconstitution de la per-sonnalité artistique de ce Maître de Pratovecchio est l’oc-casion pour Longhi de s’intéresser à sa période d’activité,de la fin des années 1430 aux années 1450 54. DomenicoVeneziano est alors “l’artiste le plus grand de toute laToscane”. La “nette luminosité transparente” de ses “cou-leurs amicales” est mise en strict parallèle avec le DePictura d’Alberti. À ce titre, Longhi insiste tout autant surl’aspect narratif des œuvres de Domenico. À Florence, la“narration ornée” du peintre est fondatrice d’une culturede laquelle participent Giovanni di Francesco, AlessoBaldovinetti, le Maître de Pratovecchio, mais aussi despeintres jugés “artisans” comme Neri di Bicci ou leMaître du cassone Adimari 55. Les artistes les plus célé-brés de l’époque, Filippo Lippi, Paolo Uccello, BenozzoGozzoli ou Andrea del Castagno, sont sèchement expé-diés, tandis que Fra Angelico est décrit comme cloîtré àSan Marco et isolé de l’aura de Domenico Veneziano. Àpartir des années 1460, la “culture de Domenico […]s’ensable dans la médiocrité” et fait place au goût plusénergique des frères Pollaiolo 56. Le courant florentin,interprété selon l’influence de Domenico Veneziano, estdonc étudié à part entière et plus seulement comme un“mouvement franceschien”.
L’essai de Longhi propose avant tout une nouvellehistoire de la peinture du milieu du Quattrocento floren-tin. Jusqu’à l’exposition de 1990, cette conception sera soitacceptée, soit rejetée en bloc par la critique: peu d’histo-riens essaieront de la compléter. Parmi ceux-ci, CarloVolpe fut l’un des premiers à revendiquer qu’à la fin desannées 1430, Filippo Lippi, à sa manière, prenait égale-
ment part à cette culture57. L’auteur insiste également surle rôle capital joué par Fra Angelico, parallèlement àDomenico Veneziano, dans ce qu’il appelle ironiquement,mais significativement, un “chiaro stil nuovo post-masac-cesco”. Près d’un quart de siècle plus tard, Carlo Volpeétudiera plus précisément le cas de Paolo Uccello. Les ana-lyses de Longhi étaient pour le moins contrastées à sonégard, puisque, de fondateur de la “synthèse perspective”en 1914, le peintre passait pour “arriéré” en 1952. La redé-couverte d’une fresque de sa main dans l’église SanDomenico de Bologne permet à Volpe de préciser l’intérêtpassager du peintre, dans les années 1430, pour les“valeurs” de Fra Angelico et de Domenico Veneziano58. Enoutre, l’auteur est le premier à faire explicitement remon-ter à Masaccio l’origine d’un mouvement florentin au“coloris uni et simple, avec des éclairages réfléchissantsqui ne dépareillent pas l’amitié des teintes claires”59.
134Studiolo 5 - 2007
4. Paolo Uccello, Saint Georges et le dragon, c. 1430-1431, Melbourne,National Gallery of Victoria.
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 134
V A R I A
Au début des années 1980, Liana Castelfranchi Vegass’intéresse elle aussi à cette “culture” florentine des années1430-1440, dont elle souligne l’originalité. Elle comprendcette peinture comme la mise en pratique du principealbertien de la “ricezione dei lumi”, et la baptise la “civili-sation d’Angelico et de Domenico”60. Ce besoin de nom-mer le courant florentin annonce l’exposition de 1990,tandis que la formule donne à Fra Angelico, “vrai pendantitalien de Van Eyck” 61, une importance que Longhi luiavait ôtée dans sa valorisation de Domenico Veneziano.Dans ses écrits postérieurs, Castelfranchi Vegas insisteparticulièrement sur cette figure de Fra Angelico, endémontrant comment sa peinture “de lumière et de cou-leur” traduit des préoccupations humanistes62. Plus encoreque Domenico Veneziano, l’auteur fait du dominicain legardien de cette manière picturale63. Avant même 1990,certains historiens ont donc une compréhension très clairede ce qui allait s’appeler la pittura di luce.
Les propositions critiques pour développer leshypothèses de Longhi dans un sens florentin sont relati-
vement peu nombreuses, si on les compare aux étudessur la diffusion géographique de cette “culture deDomenico Veneziano”. L’essai de 1952 ne se limitait pas,en effet, à la sphère florentine, mais définissait, au milieudu Quattrocento, une “communauté culturelle” particu-lière entre Florence, Sienne et Pérouse. Ainsi, la Madoned’humilité du Siennois Domenico di Bartolo, datée de1433, faisait supposer à Longhi la présence de DomenicoVeneziano à Florence dès cette date, tandis que Sassettaet Vecchietta apparaissaient par la suite très influencéspar l’art de ce dernier64. À Pérouse, Longhi décelait éga-lement l’empreinte de la peinture claire de DomenicoVeneziano (qui y travaille en 1438) dans les œuvres deBonfigli, de Boccati, du “brillant Caporali” et jusquedans la “narration lumineuse des panneaux de saintBernardin”, datés de 147365. L’attention particulière don-née au mouvement florentin ne le rendait donc pas pourautant indépendant du développement de la peintureitalienne, mais, au lieu d’être compris comme un précé-dent de Piero, c’est sa propre influence en Italie centralequi était mise en évidence.
Les liens entre les peintres siennois et DomenicoVeneziano, qui avaient déjà été pressentis par John Pope-Hennessy et Cesare Brandi, furent réaffirmés, deux ansaprès Longhi, par Ferdinando Bologna66. Mais c’est surtoutFederico Zeri qui choisit de développer, dans son ouvrageconsacré au Maître des panneaux Barberini, l’élargissementgéographique mis au jour par Longhi. Zeri accepte incon-ditionnellement les propositions de ce dernier quant aurôle joué à Florence par Domenico Veneziano et montrecomment son protagoniste a été influencé par cette“lumière qui n’est pas encore méridienne comme chezPiero della Francesca, mais qui atteint sa clarté limpidepar rapprochements et juxtapositions ‘perspectives’” 67.L’auteur situe à Pérouse la rencontre entre les deux artis-tes et met en évidence la diffusion du style de Domenicodirectement en Ombrie, puis dans les Marches. Si l’iden-tification qu’il propose pour le Maître des panneauxBarberini s’est révélée erronée, son ouvrage confirmel’existence du lien artistique existant entre des traditionspicturales jusqu’alors localement isolées68. En Émilie, l’in-fluence directe du style de Domenico Veneziano fut miseen évidence dans l’essai de Carlo Volpe sur Paolo Uccello69,puis en 1988 dans la monographie de Daniele Benaticonsacrée à la “bottega degli Erri”, l’atelier principal de laModène du second Quattrocento 70. La figure de Pieron’explique plus à elle seule la diffusion d’un style “lumi-neux” en Italie centrale71. La thèse de jeunesse de Longhisur le développement d’une synthèse perspective deforme-couleur est ainsi adaptée à la réévaluation du mou-vement florentin: parallèlement à l’étude spécifique de lapeinture florentine se développe la notion de pittura di luceau sens large, une peinture dans laquelle se retrouve cette“même solennelle lucidité, [ce] même coloris diaphane et
135 Studiolo 5 - 2007
5. Andrea del Castagno et Francesco da Faenza, Saint Jean l’Évangéliste,1442, Venezia, San Zaccaria, capella San Tarasio.
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 135
lumineux”72 qui constitue, selon Michel Laclotte, le “cou-rant le plus ‘moderne’ de la peinture méditerranéenne”73.
Cette reconnaissance d’un mouvement florentin indé-pendant et de ses développements particuliers est étroite-ment liée à l’évolution des conditions d’évaluation desœuvres d’art. Les restaurations permettent en effet de redé-couvrir la luminosité d’œuvres ternies par le temps: c’estlors d’une exposition de fresques détachées que le jeuneLuciano Bellosi commence à réfléchir sur les “effets detransparence cristalline” typiques de la mouvance deDomenico Veneziano74. De ce point de vue, c’est surtout laperception de Fra Angelico qui a le plus évolué par rapportà celle des artistes contemporains, et cela grâce à la restau-ration des fresques du couvent de San Marco. Ainsi, laPrésentation au Temple, “apparue dans toute sa luminosité”,a révélé un Fra Angelico “fauve”75, tandis que les subtilitéslumineuses de la Madone des Ombres ont pu être attribuéesà l’usage exclusif de la détrempe76. Plus généralement, ladiffusion des reproductions en couleur rend plus évidentesles caractéristiques communes des œuvres de ce mouve-ment. Une fois encore, Roberto Longhi a joué un rôle pré-curseur en stigmatisant, dès les années 1950, les limites dela “reproduction en noir et blanc, qui prive l’œuvre de toutson aspect chromatique”77. La palette particulière à la pit-tura di luce devient ainsi plus évidente.
Pourtant, tout comme avant-guerre, les propositionsde Longhi reçoivent un accueil controversé. En parlant de“civilisation de l’Angelico et de Domenico Veneziano”,Liana Castelfranchi Vegas a bien cerné une des limites del’article sur le Maître de Pratovecchio: l’apothéose deDomenico Veneziano a pour corollaire la minimisationexcessive de ses contemporains. Ce déséquilibre, intime-ment lié à la critique longhienne, apparaît par trop subjec-tif: l’importance des commandes accordées dans cesannées à des peintres comme Filippo Lippi, Fra Angelicoou Benozzo Gozzoli tempère singulièrement cette prise deposition78. Les intuitions capitales de Longhi sont doncmitigées par cette apparente partialité, notamment auprèsdes historiens de l’art anglo-saxons, qui se méfient égale-ment de son style inspiré et de ses attributions hardies79.Au sein de la critique italienne, la marginalisation des pro-positions de Longhi est en partie due au caractère polémi-que de son article de 1952. Mario Salmi y était notammentaccusé d’avoir sous-évalué, dans sa triple monographie de1936, l’importance historique de Domenico Veneziano àFlorence pour des raisons de “campanilisme toscan” 80.Salmi dénoncera en réponse “l’argumentation tortueuse[de l’article de Longhi], dont l’éclat suggestif n’est qu’ap-parence”81. De telles querelles empêcheront longtemps deparvenir à un consensus.
Hors du cercle longhien, la thèse défendue dans “Il‘Maestro di Pratovecchio’” n’est donc “guère plus qu’une
spéculation”82. Une certaine communauté stylistique rap-proche pourtant les nombreuses œuvres où la critiquecroit voir la main de Domenico Veneziano. Ainsi, qu’onlui attribue la Madone de Fra Angelico à Pise, le Saint Jeanl’Évangéliste des fresques signées par Andrea delCastagno et Francesco da Faenza à San Zaccaria de Venise(fig. 5), ou les Saints Jérôme et Jean-Baptiste de Masaccio àLondres (fig. 6), ce sont toujours les mêmes qualités deluminosité diffuse et d’harmonie de couleurs claires quisont mises en évidence 83. Plutôt que de reconnaître quel’attention pour cette lumière et ces couleurs participed’une tendance particulière, les historiens de l’art cher-chent à l’enfermer dans le style particulier d’un artiste. Enlui donnant un nom, l’exposition de 1990 permettra àcette tendance d’être plus largement reconnue.
“PITTURA DI LUCE”: UN SLOGAN (1990-2005)
À l’image de la lente élaboration de la notion de pit-tura di luce, Luciano Bellosi, l’organisateur principal del’exposition de 1990, a lui-même longuement médité la
136Studiolo 5 - 2007
6. Masaccio, Saints Jérôme etJean-Baptiste, 1428,London, NationalGallery.
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 136
V A R I A
question. En bon élève de Roberto Longhi, il se placedans la perspective de l’article de 1952 quand il décrit en1967 l’influence de la “poétique” de Domenico Venezianosur la production picturale florentine des années 1430 auxannées 147084. Dans ses écrits postérieurs, il ne manquerapas de faire allusion à cette “conception de la peintureplus calme, lumineuse et colorée” de la génération quisuit Masaccio85.
L’origine directe de l’exposition Pittura di luce remonteà une conférence de Luciano Bellosi prononcée en mai 1988à l’occasion de la restauration de la Prédelle Buonarroti deGiovanni di Francesco. Le texte, reproduit deux ans plustard en ouverture du catalogue, définit une période de lapeinture florentine qui commence en 1439 sur les échafau-dages de Sant’Egidio, où Piero della Francesca travailleauprès de Domenico Veneziano. Les années 1430 ne sontdonc pas concernées, y compris pour Domenico, qui netrouvera “ses aspects de luminosité claire et limpide” qu’àson retour de Pérouse86. Bellosi ne définit pas réellementcette “peinture de lumière”, mais se contente de descrip-
tions bucoliques, à peine plus sobres que celles de Venturiet de Longhi87. Plus qu’une étude synthétique, il étudie unà un les acteurs du mouvement, ce qui fait apparaître cer-taines divergences: au risque de contredire le titre de l’ex-position, la lumière picturale de l’artiste “sans doute leplus représentatif” du mouvement, Giovanni di Francesco,diffère de celle d’Alesso Baldovinetti88. En fait, le rappro-chement entre ces peintres se fait également par antithèse,puisque Bellosi décrit leur manière comme étouffée parcelle, plus sombre, de Filippo Lippi et de ses disciples.C’est donc en tant que “ligne perdante” que la pittura diluce fait l’objet, deux ans après la conférence, d’une exposi-tion à la Casa Buonarroti.
Par opposition aux quatre-vingt-treize entrées ducatalogue de l’exposition L’Età di Masaccio, organisée aumême moment au Palazzo Vecchio, seules trente-quatreœuvres sont exposées du 16 mai au 20 août 1990 à laCasa Buonarroti. Les organisateurs se vantent de ce choixplus qualitatif que quantitatif. Presque toutes les œuvres
137 Studiolo 5 - 2007
7. Matteo Civitali (attribué à),Vierge à l’Enfant avec sainteAnne, saint Michel, sainteCatherine d’Alexandrie, saint François et sainte MarieMadeleine, 1471, Berlin,Gemäldegalerie.
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 137
demandées ont d’ailleurs été prêtées, notamment le SaintJean-Baptiste au désert de Domenico Veneziano, venu de laNational Gallery of Art de Washington. L’expositionregroupe les protagonistes du courant décrit par Bellosi,ainsi que des œuvres de certains peintres moins impli-qués mais néanmoins influencés89. De l’aveu même desauteurs du catalogue, certaines œuvres sont pourtantassez éloignées de la peinture de lumière discutée,comme le Christ portant sa Croix de Paolo Uccello90. Quantaux vitraux et objets d’orfèvrerie exposés, leur présencemontre surtout que le discours de l’exposition concerneautant la mise en évidence d’une peinture “de lumière”,à l’espace pictural ensoleillé, que “de couleur”, privilé-giant l’accord des teintes91.
De fait, c’est bien un mouvement encore anonyme quedécrit ce catalogue. Hormis pour son titre, imposé tardive-ment par Luciano Bellosi92, l’expression “pittura di luce”n’est jamais employée pour désigner ce mouvement93. Plusque nommer une tendance, les notices cherchent plutôt àen affirmer l’existence 94. Dans cette optique, l’essai deGiovanni Agosti, qui clôt le catalogue, joue un rôle fonda-mental. L’auteur retrace en effet l’évolution de la penséelonghienne sur la peinture du milieu du Quattrocento flo-rentin, de l’essai sur Piero dei Franceschi à celui sur leMaître de Pratovecchio. L’exposition, présentée, on l’a vu,comme un prolongement de l’article de 1952, devientdonc l’héritière de toute l’historiographie longhienne 95.Pour autant, Agosti ne se prive pas de critiquer certainespositions de Longhi, à commencer par ses jugements devaleurs “irritants”. Son essai a ainsi une double fonctiondans le discours de l’exposition: la révérence à Longhi faitoffice de légitimation, tandis que le droit d’inventairerevendique une position novatrice96.
Si le ton de Giovanni Agosti reste relativement défé-rent envers les écrits de Roberto Longhi, il devient nette-ment plus virulent à propos de la littérature plus récentesur le Quattrocento florentin. Dans la grande veine polé-mique qui rappelle les échanges entre Roberto Longhi etMario Salmi, l’auteur fustige les trop érudites monogra-phies publiées par Phaidon Press, tout comme le principede “déhiérarchisation” affirmé comme base d’une “his-toire sociale de l’art”97. Agosti rejette toute tentative dechercher dans les documents écrits cette “tendance ‘plussimple et pure’ de la peinture florentine” qui constitue lesujet de l’exposition 98. Ces débordements, que CarloGinzburg critiquera sévèrement, n’ont pu que nuire à lacrédibilité de l’exposition toute entière99.
Pourtant, Ginzburg reconnaît que l’exposition “a faitdate […], non seulement pour la qualité très élevée desœuvres exposées, mais aussi parce qu’elle est née d’unvrai problème de recherche”100. Hormis l’essai de GiovanniAgosti, il loue de façon générale le catalogue et y apportemême quelque suggestion101. De fait, l’exposition a susciténombre de commentaires, plus ou moins pertinents 102.
Une des réactions les plus partagées est en fait liée aucontexte de l’exposition: la longue restauration des fres-ques de Masaccio dans la chapelle Brancacci est à peineachevée et laisse apparaître, à la surprise générale, une“couleur plus claire et lumineuse, plus en harmonie qu’onne le pensait avec Fra Angelico et Piero della Francesca”103.Keith Christiansen en déduit que Masaccio est bien lepremier “pittore di luce, tandis que la palette pastel deMasolino et son amour de l’architecture polychrome peu-vent être vus comme une source première de DomenicoVeneziano”104. Il distingue ainsi trois moments dans l’ap-préhension florentine de la lumière, dont les années 1440de Domenico Veneziano ne sont que la dernière phase,“signe d’un profond changement des valeurs de la sociétéflorentine”105. Bien qu’il juge erronée la problématique del’exposition, Christiansen ne fait donc qu’en développercertains aspects. Amanda Lillie formule, pour sa part, unecritique plus théorique: comment parler de “peinture delumière” sans citer la littérature artistique consacrée à lalumière (et à la couleur) des peintres du Quattrocento106?De la sorte, l’historienne regrette que l’essentiel du catalo-gue soit consacré à des questions d’attribution, qui laissentpeu de place à un discours d’ensemble. Ses réserves recou-pent également celles exprimées par Christiansen: si l’ex-clusion dogmatique du seul Filippo Lippi paraît excessive,la présence de la Prédelle de Quarate de Paolo Uccello sem-ble en revanche injustifiée. On le voit, l’ensemble de cesréactions suggère des développements qui dépassent lesintentions des organisateurs de l’exposition.
Le succès de Pittura di luce valut à Luciano Bellosid’organiser, deux ans plus tard, dans le cadre des commé-morations du cinquième centenaire de la mort de Pierodella Francesca, une exposition aux Offices sur la forma-tion florentine de l’artiste107. Intitulée Una Scuola per Piero,son sous-titre revendique la continuité avec la précédentemanifestation: Luce, colore e prospettiva nella formazione fio-rentina di Piero della Francesca.
Dans l’essai qui ouvre le catalogue, Bellosi élargitsa conception de la pittura di luce. En apparence, cettemanière, qui commence, avant même DomenicoVeneziano, chez Fra Angelico, ne concerne toujours quela peinture des années 1440 108. Pourtant, d’une part,l’auteur juge que les terres cuites vernissées de LucaDella Robbia, aux transparences dignes de DomenicoVeneziano, ont une “signification proche de celle de la‘peinture de lumière’”109, et, d’autre part, il constate qu’aucours des années 1430, il existe des préludes à la pittura diluce, visibles chez Domenico di Bartolo, Paolo Uccello, leMaître du Cloître des Orangers ou dans la première cam-pagne de marqueteries de la Sacristie des Messes de lacathédrale florentine, probablement dessinées par FilippoBrunelleschi. Bellosi fait même de ce dernier l’instigateurde la pittura di luce, celui qui en aurait directement transmis
138Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 138
V A R I A
les principes au jeune Domenico Veneziano110. Ainsi “l’in-venteur de la perspective” et l’architecte de la coupole duDuomo serait également l’instigateur de ce courant pictu-ral lumineux. Cette proposition, qui n’a pas rencontréd’écho dans la littérature artistique, est néanmoins fonda-mentale dans la réévaluation de la pittura di luce car elle luidonne ses lettres de noblesse. En dernier lieu, LucianoBellosi souligne le rayonnement géographique de cettemanière de peindre, notamment dans la version particu-lière qu’en propose Jean Fouquet111. Ce qui n’était, en 1990,qu’une tentative de regroupement volontairement réduiteà l’entourage de Giovanni di Francesco devient un vérita-ble champ d’investigations aux multiples directions.
Du reste, le catalogue est quelque peu différent decelui de la première exposition. Certains artistes discutésdeux ans auparavant – le Maître de Pratovecchio, Giovannidi Piamonte, Francesco Pesellino et Maso Finiguerra – nesont plus présents, de même que les œuvres d’orfèvrerie etde vitrail. D’autres peintres font leur apparition, à com-mencer par Masaccio, dont les fresques restaurées duCarmine sont placées apparaissent en étroit rapport avec la“sensibilité solaire” de Piero della Francesca112. Il faut ainsil’intermédiaire de Piero pour que Masaccio soit inclus dansle courant “lumineux” florentin. Les années 1430 sontreprésentées par des œuvres qui ont souvent été mises enparallèle avec la “civilisation de Fra Angelico et deDomenico Veneziano”, comme la Madone de Domenico diBartolo de 1433 ou une fresque détachée du Cloître desOrangers. Luca Della Robbia figure lui aussi au catalogue,notamment par un fragment du Tabernacle de Sant’Egidio,tandis que la palette claire d’une des fresques de laCappella dell’Assunta du Duomo de Prato rend la pré-sence de Paolo Uccello bien plus convaincante qu’en 1990.Mais le “clou” de l’exposition réside dans la reconstitution,pour la première fois depuis son démembrement au débutdu XIXe siècle, du Retable de sainte Lucie de DomenicoVeneziano. L’événement que constitue cette recompositionde l’œuvre manifeste de la pittura di luce florentine peutêtre vu comme une consécration, aussi bien pour l’artisteque pour le mouvement113. Cependant, le rayonnement deDomenico est une fois de plus atténué par celui de Pierodella Francesca: l’exposition est construite autour de Piero,et la présence d’une œuvre de sa maturité, le Diptyqued’Urbin, fait à nouveau de la pittura di luce florentine uneprémisse au génie du peintre de Borgo114.
Dans le catalogue de cette seconde exposition, l’ex-pression pittura di luce est relativement peu employée, lescollaborateurs de Bellosi ayant plus volontiers recours àdes synonymes, comme “poetica ornata”, “pittura pros-pettica e colorata” ou “cromatismo intriso di luce”, quandils ne reprennent pas le “moto ‘franceschiano’” de RobertoLonghi115. Ces nombreux équivalents mettent en évidencele caractère partiel d’une dénomination qui ne prend encompte, sans même le préciser, que l’aspect lumineux de
cette peinture. La formule de Bellosi, “longhienne” à plusd’un titre, est néanmoins extrêmement suggestive, ce quiva assurer son succès auprès de la critique italienne. Trèsvite, la littérature artistique de la péninsule va s’en empa-rer pour désigner une peinture “qu’il convien[dra] [dèslors] d’appeler ‘de lumière’”116. Le fait que l’expressionn’ait pas été discutée dans le catalogue de 1990 a sansdoute contribué à son aura: “pittura di luce” peut aussibien désigner l’exposition elle-même, le mouvement pic-tural florentin, ou plus généralement une manière lumi-neuse de peindre.
Luciano Bellosi a joué un rôle important dans la pro-pagation de “sa” formule, dont il se sert aussi bien pourdésigner le mouvement florentin en tant que tel quepour mettre en évidence son développement siennois117.L’expression permet en effet de souligner les affinitésentre la peinture de Domenico Veneziano et des œuvresnon florentines, de Toscane, des Marches, ou même deFrance 118. Le vaste écho que rencontre l’expressionauprès de la critique italienne est dû à un phénomènefréquent: une fois nommé, un courant est plus facile-ment identifié119. Cependant, la définition assez vague deLuciano Bellosi laisse la porte ouverte aux interprétationsles plus diverses 120. C’est contre ces excès que LianaCastelfranchi Vegas s’efforce de définir rigoureusement lemouvement florentin qu’elle avait appelé la “civilisation deDomenico et de l’Angelico”121. Pour la première fois, la pit-tura di luce est considérée comme un courant majeur de lapeinture italienne, mais aussi française, du Quattrocento122.
En dehors de l’Italie, l’expression est plus rarementemployée123. L’une des raisons tient au discours de l’ex-position de 1990, qui, en se limitant à des études mono-graphiques, ne se préoccupait pas des questions plusgénérales induites par une telle problématique. Riend’étonnant, dès lors, à ce que la littérature sur la lumièreet la couleur ne remarque pas une telle proposition. Seulsles connaisseurs daignent parfois la prendre en considé-ration, comme en témoigne un compte-rendu duBurlington Magazine: ne pouvant donner une attributionprécise à un panneau de la Staatsgalerie de Stuttgart,l’auteur affirme que “de toute façon, c’est de la pittura diluce”124. L’expression “poétique” n’est pour cela pas tra-duite, mais elle est devenue catégorie critique125.
La notion de pittura di luce tend même à s’affran-chir des limites qui lui ont été assignées à l’origine.L’identification du mouvement avec la personnalité artisti-que de Domenico Veneziano a ainsi pu être nuancée,notamment pour les années 1430. Le rôle de l’atelier de FraAngelico dans les débuts de la pittura di luce, déjà évoquépar Luciano Bellosi, a été réaffirmé par Giorgio Bonsanti126.Bellosi est lui-même allé le plus loin dans la recherche desorigines de la pittura di luce en proposant de voir dans ladernière œuvre connue de Masaccio, le panneau des SaintsJérôme et Jean-Baptiste de Londres (fig. 6), une manifestation
139 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 139
précoce du mouvement lumineux 127. Cette proposition,récurrente depuis les réflexions de Carlo Volpe, doit êtreprise sérieusement en considération, d’autant plus qu’elleémane de “l’inventeur” de la notion de pittura di luce,Luciano Bellosi, qui a eu le grand mérite de dépasser sapremière compréhension du mouvement.
Si Bellosi n’a pas participé à l’organisation de l’expo-sition consacrée en 2004 et 2005 à Fra Carnevale, celle-cipeut être néanmoins considérée comme un prolonge-ment majeur de ses recherches 128. Elle a notammentdémontré que le problème de la pittura di luce devait êtrelargement reconsidéré en mettant en évidence, d’unepart, le rôle problématique tenu par Filippo Lippi vis-à-vis de cette tendance. Keith Christiansen s’appuie ainsisur l’intérêt manifeste de Lippi envers les jeux de lumièrepour soutenir l’inadéquation de l’expression “peinturede lumière”129. Certaines œuvres de Lippi sont pourtantsi proches des valeurs de la pittura di luce que son exclu-sion du mouvement, compréhensible en 1990 d’un pointde vue dialectique, apparaît par trop radicale quinze ansplus tard130. En suivant, d’autre part, le parcours de FraCarnevale de Florence à Urbin, l’exposition a égalementétudié le rayonnement de la pittura di luce. Dans ce déve-loppement géographique, la disparition progressive del’historia pose la question de l’équivalence, que l’on peutdéduire des écrits de Longhi, entre pittura di luce et “nar-ration ornée”131. On pouvait penser que l’exposition, fruitd’une collaboration entre Italiens et Américains, allaitcontribuer à diffuser une certaine compréhension dumouvement dans la littérature anglo-saxonne. Cela nefut pas le cas, si l’on s’en tient à la récente exposition surFra Angelico organisée au Metropolitan Museum deNew York, dans laquelle la luminosité du coloris dupeintre est bien comprise comme une caractéristique deson style dans les années 1440 – sans qu’elle ne soitjamais mise en rapport avec la scène florentine132.
L’élaboration de la notion de pittura di luce florentineparcourt donc tout le XXe siècle. À la suite des intuitionsd’Adolfo Venturi, Roberto Longhi en a, dans un premiertemps, défini les caractéristiques, tout en subordonnant
son importance historique et artistique à celle de Pierodella Francesca. Ce n’est qu’en 1952 que Longhi délimiteun mouvement propre à Florence, dont l’art de Piero nereprésente qu’un des développements. Cette propositiona d’abord fait école dans une frange limitée de la critiqueitalienne, avant que l’exposition de 1990 ne la soutienneavec force. C’est surtout le fait même d’avoir nommécette tendance qui marque le point de départ d’une nou-velle compréhension de celle-ci. Depuis lors, le mouve-ment est en effet plus généralement reconnu, tandis queson appellation oriente l’attention vers la particularitélumineuse de ses œuvres. La réception critique de la pro-blématique de l’exposition et la diffusion de l’expression“pittura di luce” démontrent la richesse d’une notiondont les contours sont encore loin d’être figés et incitent àrepenser en profondeur la diffusion des nouveautés pic-turales dans l’Italie du XVe siècle.
Cette recherche historiographique a également faitapparaître de nombreuses interrogations quant audéveloppement historique propre de cette “peinture delumière”. En dépit de leur importance initiale, certainespropositions de l’exposition de 1990 demandent en effetà être réexaminées. Ainsi, au sein du cadre florentin,faut-il considérer la pittura di luce comme une tendancespécifique aux années 1440 de Domenico Veneziano et deFra Angelico, ou bien en élargir le spectre aux années1430, et même à Masaccio? Quant à Filippo Lippi et àPaolo Uccello, quelle place leur accorder dans un mouve-ment auquel ils semblent tantôt étrangers, tantôt partieprenante? Les nombreuses suggestions produites par lalittérature artistique doivent donc servir à affiner notrecompréhension directe du mouvement. Le vaste élargis-sement géographique de la notion de pittura di luce, posédès 1914 par Longhi, fait également apparaître une autredialectique majeure: au problème florentin s’oppose lerayonnement italien et méditerranéen d’une véritablemaniera. Cette acceptation plus large ne risque-t-elle pasde diluer la cohérence d’une telle catégorie critique? Làréside toute la complexité, mais aussi l’intérêt, de ce quis’est affirmé comme une question fondamentale de l’his-toire de l’art du Quattrocento133.
140Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 140
V A R I A
Notes
1. BELLOSI, 1990a, p. 11.
2. LONGHI, 1952a. Dans le catalogue, GiovanniAgosti revendique ouvertement qu’organiserl’exposition “era un po’ come tornare sui passidel Maestro di Pratovecchio […] per verificarloalla luce del destino degli studi e della nostrasensibilità” (AGOSTI Giovanni, 1990, p. 191).
3. On peut citer trois grandes expositions orga-nisées en Italie en 2004, sur Matteo Civitali,Pérugin et Fra Carnevale: pour les occurrencesde la pittura di luce, voir respectivement TEZA,2004, p. 57; FILIERI, 2004, p. 82; CHRISTIANSEN,2004, p. 53; et DE MARCHI, 2004, p. 71.
4. Parmi les interprétations romanesques quiont cours jusqu’à ce que Gaetano Milanesi nedémontre en 1862 que ce meurtre n’est qu’unefable, le sommet est incontestablement atteinten 1844 avec la publication d’un drame en qua-tre actes sur le sujet (DE BONI, 1844).
5. La figure la plus critiquée en ce sens sera lesaint Jean-Baptiste du Retable de saint Lucie desOffices, dans lequel Eugène Müntz ne voitqu’une “figure rabougrie, aux traits durs etpauvres, [qui] rappelle tous les excès du réal-isme florentin” (MÜNTZ, 1889, p. 625). Müntzs’inspire sans doute du jugement encore plussévère de Joseph Arthur Crowe et GiovanniBattista Cavalcaselle: “But the painter fallsinto excess of commonplace in the figure andface of the Baptist, whose lineaments, muscle,limbs, and extremities are a mere realisticstudy of nature. The vulgarity in this figure is,however, of essential interest to the critic as itreveals the source from which Piero dellaFrancesca obtained one of his most markeddefects” (CROWE, CAVALCASELLE, 1864, p. 317).
6. VENTURI A., 1911, p. 359: “in una cosa[Domenico] si differenzia da tutti: nel coloritodi quella tavola con la tonalità dominante diverdi chiari, con i colori in rapporto tran-quillo, come in un accordo di voci chiare,argentine, sull’architettura verde, rosata ebianca. Tutto par diafano in quella traspa-rente penombra […]”.
7. Pour Adolfo Venturi (ibidem, p. 392 et 406),Benozzo Gozzoli n’atteint pas la “finezza diricerca della luce” de Pesellino. Quant àGiovanni di Francesco, l’historien attribue en1911 ses œuvres à Pesello (ibidem, p. 382-384),mais c’est surtout en 1927 qu’il loue le “dia-fano rosa di Domenico Veneziano” dans laprédelle Buonarroti, donnée cette fois-ci àAlesso Baldovinetti (VENTURI A., 1927, p. 34):“Quest’opera, ancora tutta gioiosa delle notecromatiche del Beato Angelico e di DomenicoVeneziano, nei rossi vermigli, nei verdi ulivi-gni, nei rosei imbionditi da luce […]”. La vraiepersonnalité artistique de Baldovinetti étaitdéjà décrite en 1911 dans des termes très pro-ches de l’analyse de Domenico Veneziano,quand Venturi notait dans la Madone du Louvre
“[l’] atmosfera piena di luce, con un velo comedi rugiada, con ombre tenui sulle carni e lumidolcissimi, tali da produrre nell’insieme l’ef-fetto di figura immateriale” (VENTURI A., 1911,p. 550).
8. Ibidem, p. 359: “La luminosità del coloritoelettissimo e puro, appresa da Masolino edall’Angelico, ammodernata con lo studiodella prospettiva aerea, forma il gran meritodi Domenico Veneziano, ch’ebbe ad aiuto ecooperatore Piero della Francesca, il maestroche portò a perfezione quella tecnica, queldolcissimo impasto di colore e di luce”.
9. Ibidem, p. 440, à propos du Baptême de laNational Gallery de Londres: “Ma [Piero]sapeva intanto illuminarle [le sue forme],pauroso quasi degli scuri, facendo piovere labianca luce della nivea colomba dello SpiritoSanto, che largisce la vivezza de’ fiori allevesti, riflessi trasparenti alle carni alabastrine”.
10. THIBERGHIEN, 1991, p. 48-49: “[…] Lecontexte idéaliste du début du siècle, auquelBenedetto Croce avait fourni sa plus solidethéorie esthétique et qui préconisait contre leslectures stylistiques la monographie et l’étudedes artistes, était la caution idéologique etphilosophique de l’attribution pour les histo-riens de l’art de formation néo-idéaliste”.
11. SCHMARSOW, 1893 et 1912. Si l’article de1893 parle déjà (p. 197) d’une “überraschendeWiedergabe der Luft als leuchtenden Mediums,das die Körper im sonnenerhellten Raumumfluthet”, c’est de manière beaucoup moinssystématique qu’en 1912, quand le style deDomenico est clairement décrit comme unepeinture de lumière (p. 97): “In tutte le opere danoi esaminate, provandone autore il Veneziano,ricorre continuamente una caratteristica chedistingue questo pittore da tutti i contempora-nei fiorentini: l’abbondanza della luce chefluisce attorno alle forme e immerge i corpi inun ambiante scintillante”. Le lien entre AugustSchmarsow et Adolfo Venturi est démontré parle fait que l’article du premier est publié dans larevue du second, L’Arte.
12. LONGHI, 1914 (1961).
13. Maurizio Calvesi parle même du style “pré-longhien” de Venturi (CALVESI, 1994, p. 59).Cependant, sa proposition de voir dans l’idéede Longhi du “développement franceschien dela peinture vénitienne” le prolongement de lapensée de Venturi est trop réductrice (ibidem,p. 60). Giacomo Agosti a soutenu au contraire,de manière plus convaincante, que “lo scopo delsaggio [di Longhi era] di cancellare la visione diVenturi sulla diffusione centroitaliana dell’artedi Piero della Francesca” (AGOSTI Giacomo,1996, p. 205).
14. Benedetto Croce a écrit en 1911 un articlefondateur sur la “pure visibilité”, publié l’annéesuivante (CROCE, 1912), et dont il conseille lalecture à Longhi dans une lettre du 16 décem-bre 1912 (voir AGOSTI Giacomo, 1993, p. 242).
15. LONGHI, 1914 (1961), p. 64. Longhi insisteégalement sur la clarté de la représentation,qualité artistique principale selon KonradFiedler, grand ami de Hildebrand et principalthéoricien de la “pure visibilité”: “Come sen-sazione lirica questa resa prospettica dovevaesaltare e raffinare le nostre intuizioni di chia-rezza di rapporti spaziali armonicamente rag-giati” (ibidem).
16. HILDEBRAND, 1893 (1996), p. 81 parlait déjàde la couleur comme “Distanzträger”, mais sonattention est plus spécifiquement tournée versla “sculpture dans la pierre” et monochrome,liée à ses recherches artistiques personnelles.
17. LONGHI, 1914 (1961), p. 65.
18. L’expression “pittura ‘di colore’” est deGiacomo AGOSTI (AGOSTI Giacomo, 1991, p. 199).
19. Masaccio est considéré comme un pionnierdu chiaroscuro, dont la recherche spatiale aéclipsé l’intérêt pour la couleur. Dans la Brevema veridica storia della pittura italiana, rédigéela même année, le jugement de Longhi sur FraAngelico reste assez traditionnel (LONGHI, 1914[1980], p. 84): “Siamo anche troppo fanciulliper non volerci rifugiare in Angelico quandola vita ci stanca”. Il ne nie pas les qualités dupeintre, mais on est loin de la lecture d’un FraAngelico “moderne” qu’il proposera en 1940(LONGHI, 1940a [1975], p. 37-42).
20. SALVINI, 1977 (1988), p. 54: “Si, dans l’essaide 1914, Piero della Francesca apparaît commele génial inventeur de solutions à d’abstraitsproblèmes plastiques, dans la monographie de1928 [sic], le problème historique de l’art dePiero della Francesca est abordé dans le sensde la formation à la fois plastique et spirituelledu peintre lors des rencontres devant les fres-ques des églises florentines avec ses prophètes,avec ses maîtres”.
21. LONGHI, 1927a (1963), p. 14 et 73. La questiond’un art “franceschien” à Florence doit surtoutposer la question de la présence de Piero dansla cité toscane. Celle-ci n’est attestée qu’en 1439,auprès de Domenico Veneziano, mais l’œuvrede Piero montre d’étroites affinités avec desœuvres florentines plus tardives ne pouvantêtre simplement comprises comme un reflet desœuvres du peintre de Borgo, à commencer parle Retable de sainte Lucie de Domenico, qui nedate que du milieu des années 1440, ou encorele registre supérieur des fresques d’Andrea delCastagno à Sant’Apollonia, vraisemblablementexécuté en 1447.
22. En 1926, Longhi séparait nettement l’in-fluence artistique de Domenico Veneziano etde Paolo Uccello, visible selon lui dans lesfresques de la Cappella dell’Assunta de lacathédrale de Prato (aujourd’hui générale-ment attribuées à Uccello lui-même) et danscelles d’Andrea Delitio au duomo d’Atri, durayonnement de Piero, qui touche la Florenced’un peintre alors anonyme, le Maître du cas-sone Adimari, mais aussi Sienne et Pérouse
141 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 141
(LONGHI, 1926b [1967], p. 60). Sur le Maître duCassone Adimari, voir note 54.
23. LONGHI, 1927a (1963), p. 9. Bien entendu,c’est nous qui soulignons.
24. La traduction française de Jean Chuzeville,publiée la même année, nécessitera les servicesde Giuseppe Ungaretti pour transcrire les pas-sages les plus hermétiques. Dès 1927, on trouvedonc l’expression “peinture de lumière” enfrançais (LONGHI, 1927b, p. 16). Sur cet aspectdu style de Roberto Longhi, voir GARBOLI, 1982,ainsi que ROWLEY, à paraître.
25. LONGHI, 1963, p. VII.
26. Luciano Bellosi, communication orale,2003. Il s’agit bien en fait d’une “invention”,mais comprise dans le même sens que celle dela Vraie Croix dans la fresque de Piero àArezzo. Mauro Minardi a déjà fait remarquerque “la pregnante definizione, nell’alveo deirapporti Piero-Domenico Veneziano, si deveal Longhi, prima di essere introdotta qualecategoria critica da Bellosi in occasione dellanota mostra fiorentina del 1990” (MINARDI,1998, p. 33-34, n. 10). Plus qu’une définition, ilne s’agit encore que d’une métaphore.
27. Il est intéressant de constater que dès sespremiers articles, qu’ils concernent Piero oules Caravagesques, Longhi a toujours faitgrand cas de la lumière picturale.
28. LONGHI, 1925 (1967), p. 8. Pour Longhi (ibi-dem, p. 4), “il primo intento [di Domenico] èpur quello di cantare una storia – qualunquestoria – in una luminosa contrada”, ce quiannonce sa description de la peinture deDomenico selon la formule albertienne de“narration ornée” (voir infra). Pour l’article deVenturi, qui publie l’Annonciation de Domenicoau Fitzwilliam Museum de Cambridge, voirVENTURI A., 1925.
29. LONGHI, 1928 (1968), p. 23.
30. OFFNER, 1933, p. 177. Dans son article,Offner attribue à Giovanni di Francesco lepaliotto de l’église San Biagio à Petriolo (fig. 1),et souligne “the way the figure is maintainedin light”. Il poursuit de façon inspirée et clair-voyante: “But most essentially characteristicof this ambient is the intellectualization of thething seen, by means of both light and con-tour, an intense schematization of the materialas well as of the shape towards a sort of fixedseizebleness. This method, affected byBaldovinetti – which by a mysterious sympa-thy appears alike in Ferrara, Padua and Sienaand later even in Germany – is carried fartherby Giovanni to its logical conclusion”.
31. OFFNER, 1939. L’auteur remarque notam-ment (p. 224): “The Birth [of the Virgin] betraysthe source of our master’s color in terms moreeasily recognizable than in the Presentation.The range of color, high-pitched and deli-cate, was derived largely from Domenico[Veneziano], and indeed much of that system
of pale rosate and blue in a flat greyish or ivorycontext comes from him”.
32. LONGHI, 1940a (1975), p. 44: “La pittura fio-rentina […] si rimette in via con la rinnovatacoscienza della rivelazione di Masaccio, ma,insieme, anche nella parte più sottilmenteariosa e colorata che il maestro [...] parevaquasi aver quasi ‘stracurato’. Allora si vedonocrescere gli affreschi dell’anonimo nel Chiostrodegli Aranci in Badia, maestro […] di esteso,compatto colore da preludere, singolarmente,ai modi di un Antonello; e, negli stessi giorni,pur sui muri stretti di Sant’Egidio, si miniavibrante la narrativa fulgida del soppraggiuntoDomenico Veneziano, avendo sui ponti, ‘chol-lui’, il giovine Piero del Borgo San Sepolcro”.
33. Ibidem, p. 64, n. 29: “La luce di Masolino,[…] ha tuttavia un senso di esordio solivo, pri-maverile, da poter meglio germogliare, comeavvenne in effetto, nell’arte di DomenicoVeneziano”. Dans l’Annonciation Goldman de laNational Gallery of Art de Washington, Longhiadmire ainsi la “luce che, dalla invisibile fine-stra, viene a inondare nuovamente di tenerosole la stanzuccia interna della Vergine, il lettodi legno chiaro e la garza della cortina: mirabilepreludio all’imminente Domenico Veneziano”(ibidem, p. 32).
34. LONGHI, 1940b (1975), p. 135: “Qui però, è benchiaro che la libera accentuazione della formavien prima dalla lettura di Domenico Venezianoche di Piero o di Giovanni di Piamonte”.
35. LONGHI, 1950 (1963).
36. Ibidem, p. 92. Longhi donne une définition decette peinture (p. 84): “una visione poetica comeaccordo cristallino di volumi regolari […] che,sul filo della prospettiva, vengano a esporsi inuno spettacolo fluente di colore calmo e esteso”.
37. La conclusion de l’article de 1950 (ibidem)fait de Cézanne et Seurat les lointains continua-teurs de la synthèse de Piero: “Quelle antichesupreme ricerche di misura formale e cromatica,riaffiorano […] nei ricostruttori che accompa-gnano o seguono alla tenera poesia dell’impres-sionismo: in Cézanne, in Seurat, in qualcheaspetto del ‘sintetismo’. Qui è la storia segreta,anche se inconscia, del temporaneo ritorno aPiero della Francesca non tanto dei critici, chequesto importa meno, ma degli stessi artisti”.
38. Lionello Venturi déclare sa dette enversLonghi pour “la comprensione della prospet-tiva pittorica come piano cromatico” (VENTURI
L., 1915, p. 225, n. 1), tandis qu’Emilio Cecchisuivra le même mouvement (FERGONZI, 1991,p. 231-232): “La ricerca cecchiana di un nessoquattro-ottocentesco è aiutata dall’idea lon-ghiana della ‘sintesi prospettica di forma ecolore’: in Piero, come nel miglior Fattori onelle tavolette di Sernesi, sono gli incastri dizone cromatiche da suggerire, senza bisognodi chiaroscuro, la scalatura spaziale”.
39. KENNEDY, 1938, p. 18 (sur DomenicoVeneziano). Ibidem, p. 198: “Cézanne has shown
us the intense artistic and emotional value inmass as such, […] Matisse has revived thepalette of clear bright colors […]”.
40. “The Luminosity of Domenico’s Painting”est le titre d’une page (ibidem, p. 19) entière-ment occupée par une reproduction en noir etblanc du manteau de sainte Lucie, détail tirédu Retable de Domenico aux Offices (fig. 2).Cette luminosité, commune à Baldovinetti, estétudiée pour la première fois sous son aspecttechnique (p. 39): “The general light is caredfor by the high value of his colors. They arerarely of pure pigment; their intensity is nearlyalways lowered with white or grey”. J’ai déve-loppé cette particularité technique de la pitturadi luce, voir ROWLEY, à paraître.
41. Les artistes eux-mêmes sont bien con-scients de cette luminosité particulière, commeen témoigne Giorgio De Chirico: “Io vorrei cheaccanto a una tavola di Beato Angelico o diPiero della Francesca si mettesse una pittura diMonet e di Previati, per vedere la differenza;per vedere quale sarebbe la pittura più lumi-nosa” (souligné par l’auteur; DE CHIRICO, 1923,[1985], p. 243).
42. PUDELKO, 1934, p. 188.
43. PUDELKO, 1936, p. 60: “Anche ai colori splen-denti, di una lucentezza metallica, si adduconouna potenza luminosa e una chiarezza moltosuperiori al tono verdolino-sfumato nel qualesono avvolti i quadri all’incirca contemporanei.Soltanto la predella dell’Incoronatione di Parigi(Uffizi) [fig. 3] mostra una simile intonazionecoloristica…”. (Le “Couronnement de Paris” esten fait une Vierge à l’Enfant avec anges et saints,conservée au musée du Louvre et plus connuesous le nom de pala Barbadori).
44. PUDELKO, 1935, p. 37: “C’est justement lelunaire, opposé comme le côté nocturne àl’Apollinien de la Renaissance, à l’art solairede Piero della Francesca, qui recèle ces formesmagiques dont les civilisations archaïques etprimitives sont pénétrées”. Les connotationsnietzschéennes et surréalistes de la pensée dePudelko sont ici évidentes.
45. SIEBENHÜNER, 1935, p. 68. Longhi n’ignoraitpas la thèse de Siebenhüner, qu’il considéraitcomme un mauvais plagiat de ses propres thè-ses (LONGHI, 1963, p. 158): “Già la desinenzaastrattiva (Kolorismus) della parola chiavedenuncia il formalismo del seminario delHetzer da cui il saggio usciva. […] Mi limito acitare il brano che segue: ‘in Piero si realizza ilprocesso di portare a una sintesi di valoriespressivi del colore per la rappresentazionedello spazio e dei corpi e insieme i suoi valoridi bellezza’. La derivazione, sebbene alterata econfusa, è ancora abbastanza percepibile”.
46. Ibidem, p. 60: “Diese rückläufige Bewegungist nun nicht nur für Domenico Venezianocharakteristisch, sondern für eine ganzeGruppe von Künstlern, deren entschiedensterVertreter in Fra Angelico auftritt. Eine andere
142Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 142
V A R I A
Gruppe, die sich vornehmlich um FilippoLippi schart, behält dagegen die dumpfereFarbigkeit [...] bei und nimmt die eigenfarbi-gen Ausdruckmöglichkeiten nur in beschränk-tem Maße auf”.
47. AGOSTI Giacomo, 1991, p. 205.
48. L’influence de Piero sur la peinture véni-tienne est notamment critiquée par GiuseppeFiocco, dont l’ouvrage L’arte di Andrea Mantegnas’attirera une réplique cinglante de Longhi(LONGHI, 1926a [1967]).
49. Salmi note par exemple comment DomenicoVeneziano “distille la couleur abstraite del’Angelico en une peinture d’une luminositédiurne concrète” (SALMI, s. d. [1936], p. 76).Même le style de Salmi se fait longhien, aidésans doute par la traduction de Jean Chuzeville(voir supra, note 24). SALMI (1943 [1967], p. 19)rapprochera par la suite le style de Fra Angelicode celui de Piero, “per la luminosa bellezzadei colori”.
50. Ibidem, p. 22: le style “perspectif” des fre-sques de Sant’Egidio “per l’azione precipuadell’Alberti e di Piero, sarà diffuso in tuttaItalia, dal Perugino, al Carpaccio, al Bellini,mentre a Firenze si cercano altre soluzioni.Perché quella eccessiva sistematicità cheaveva condotto alle sublimi prospettive pier-francescane, dovette sembrare, nella secondametà del secolo, fatica da intarsiatori ai fioren-tini che la limitarono o quasi alle pale d’altarecon le sacre conversazioni”.
51. BELLOSI (1980, p. 33) rappelle dans ce sens:“È sopratutto l’aspetto colorato della pitturadi Piero a interessare Giovanni Bellini, ilpadre del cromatismo veneto – che prima dilui non esisteva”. Giuseppe Fiocco fait égale-ment de Domenico Veneziano un peintre del’école vénitienne, le père d’une “peinture delumière” cette fois toute vénitienne (FIOCCO,1945, p. XVI): “Per la prima volta [la luce]s’impone, attraverso al limpido armonicocolore, quale direttiva del dipingere, che pene-tra tutto e tutto esalta. Nella pala di SantaLucia dei Magnoli un chiarore di perla inar-genta le dolci figure del devoto convegno; fagià capolino il lume zenitale di Piero dellaFrancesca che impreziosisce gli oggetti, trasfe-rendoli in un’atmosfera estatica, abbagliata,che quasi elide l’ombra, e sfugge poi in mododeciso a quella densa e vigorosa perseguitaaccanitamente da Masaccio per dare vita esostanza alla sua umanità appassionata e perfar vibrare l’atmosfera intorno, come conqui-sterà per sempre Giorgione all’arte”.
52. Du reste, l’usage presque exclusif de pho-tographies en noir et blanc, dans la méthoded’attribution de Berenson, a conduit à méses-timer l’importance de la couleur, qui est selonlui “subordinated to form and movement”,dépendante de “visceral values” et réduite àun rôle essentiellement affectif (BERENSON,1950, p. 77 et 79).
53. LONGHI, 1952a.
54. À l’occasion de l’exposition d’Arezzo de1950, Roberto Longhi avait nommé cet artistele Maestro degli Arcangeli, en référence à sonpanneau des Trois Archanges de Berlin (LONGHI
1951 [1985], p. 299-300). Le nom du “Maestrodi Pratovecchio” apparaît pour la premièrefois dans le numéro de Paragone Arte précé-dant la parution de l’article éponyme, pourcorriger l’attribution à Boccati qu’avait faiteWilhelm von Bode du panneau berlinois(LONGHI, 1952c, p. 38). Cette même année uni-versitaire 1952-1953, Longhi consacre précisé-ment un cours au Maître de Pratovecchio(voir VOLPI, 2003, p. 197).
55. LONGHI, 1952a, p. 21. Le Maître du cas-sone Adimari, que Luciano Bellosi identifieraen 1969 avec le propre frère de Masaccio,Giovanni di Ser Giovanni, dit le Scheggia,était encore perçu par Longhi en 1926 commeun tenant du “mouvement franceschien” deFlorence (voir supra, note 21, ainsi que BELLOSI,HAINES, 1999).
56. dLONGHI, 1952a, p. 21.
57. VOLPE, 1956, p. 42: “[Nel] gradino conser-vato agli Uffizi [il s’agit de la prédelle de la PalaBarbadori du Louvre; fig. 3], che è la partedell’opera più squisitamente connessa dichiaro stil nuovo post-masaccesco, riesce diffi-cile non affermare che vi opera già il modellodi Domenico a Santa Lucia de’ Bardi, o un suomodello comunque perduto, ma di analoghemotivazioni, che il veneziano soltanto, comeper via contigua l’Angelico, poteva nutrire,incaricandosi dunque dell’unica alta medita-zione che qui si può ammettere tra lo scorcioluminoso del portico della Annuciazione lip-pesca e il portico ombroso del capolavoro diMasaccio a Berlino”. Ces remarques concordentparfaitement avec celles exprimées par Pudelkodans les années 1930 (voir supra, note 42).
58. Carlo Volpe décrit “la variante devotadell’Angelico, ricca di arcani filtri, dalla qualediscende una previdibile ma pura bellezza, rit-mata dai legamenti luminosi di simboliche geo-metrie, onde il colore e la forma sono luce(anagogica?) di spazio misurato e incorrutti-bile” (VOLPE, 1980, p. 9). Ainsi, le Saint Georges etle dragon de Paolo Uccello à la National Galleryde Melbourne (fig. 4) est compris comme un“straordinario dipinto, lucente appunto comeun Angelico (il cavallo […] sembra […] uscitodella predella della ‘Incoronazione’ delLouvre!)” (p. 17). D’autre part, Volpe (ibidem,p. 20) remarque qu’avec les Histoires de Noéd’Uccello au Cloître vert de Santa Maria Novella“concorda, a me sembra, una cultura nonanteriore a quella del quinto decennio: diDomenico Veneziano dopo la Pala de’ Magnoli,del Castagno e del primo Piero”.
59. Ibidem, p. 5. Cette “amitié des couleurs” estl’expression d’Alberti dont se servait le plussouvent Longhi pour décrire la palette de
Domenico Veneziano. L’attention de Volpe pour“l’amitié des teintes claires” du Quattrocentoest à mettre en parallèle avec sa recherche,beaucoup plus approfondie, sur le ”long par-cours de la ‘peinture très douce et si unie’”,cette tendance de la peinture toscane aprèsGiotto (VOLPE, 1983).
60. CASTELFRANCHI VEGAS, 1983 (1995), p. 44.Dans son premier article sur les rapports entreFlandres et Italie, l’auteur ne s’intéressait pasencore à la Florence des années 1430 et 1440(CASTELFRANCHI VEGAS, 1966).
61. CASTELFRANCHI VEGAS, 1983 (1995), p. 43 et 46note 37.
62. CASTELFRANCHI VEGAS, 1985, p. 103: “Volendoconsiderare nel loro complesso le paginealbertiane sulla ‘ricezione de’ lumi’ e suicolori, mi sembra che la loro più rilevantenovità, esplicita ed implicita, sia di legarestrettamente la ‘buona pittura’ alla definizionedella forma per via di ‘lume’ e di colore”. Voiraussi CASTELFRANCHI VEGAS, 1989.
63. Ibidem, p. 162: “L’accostamento dell’Angelicoa Domenico Veneziano torna a far rifletteresulla comune area di ricerche prospetticoluminose che dovette avvicinare i due pittoriper almeno un quindicennio. Non è detto,anzi, che le intense richerche prospettiche diDomenico […] non tendessero alla fine a pre-valere su quelle della pura ‘ricezione dei lumi’nei colori: a differenza proprio dell’Angelico,nel quale l’indivisibile ‘circoscrizione’ dellalinea è più che mai affidata al contatto fra duezone cromatiche”.
64. Sur Domenico di Bartolo, voir LONGHI,1952a, p. 17. En 1963, Longhi tempérera sonhypothèse (LONGHI, 1963, p. 158): “Il suo direperò che quel dipinto [la Madone de Domenicodi Bartolo] sia già colmo dei riflessi ‘dellanuova arte fiorentina di Domenico Veneziano’,le cui notizie cominciano parecchio più tardi,sorprende anche me, che pure sono semprestato incline ad ammettere la importanza diquel precedente; ma che avrebbe bisognato diuna più fondata dimostrazione. Tanto più serimane egualmente da chiarire come maiDomenico di Bartolo, in così forte anticipo nel1433 si mostri già pentito e dimentico di ogninovità fiorentina nel polittico di Perugia che èdel ’37, e cioè ancora anteriore alla comunitàdi lavoro fra Piero e il Veneziano a Firenze.Qui è probabilmente il segreto storico di unproblema cui ho cercato di portar qualchelume col mio saggio del 1954 [sic, il s’agit sansdoute de l’année de parution réelle de l’arti-cle] sul ‘Maestro di Pratovecchio’ ”.
65. LONGHI, 1952a, p. 19.
66. Voir POPE-HENNESSY, 1939, p. 110 (sur l’in-fluence de la palette de Domenico Venezianosur Sassetta); POPE-HENNESSY, 1944, p. 144(sur le rayonnement de l’art de DomenicoVeneziano dans la Sienne de Vecchietta); etBRANDI, s. d. [1949], p. 130. Brandi remarque
143 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 143
dans le style de Domenico Veneziano “un cam-biamento avvenuto nella qualità stessa dellaluce che perde la nebulosità appena sonnolentedi Masolino, per risolversi in una qualitàradiante, piuttosto interna che esterna all’im-magine”. BOLOGNA, 1954, p. 17-18: “Concordinel riconoscere l’origine fiorentina e pierfrance-schiana del dolce lume solare, […] mi domandoperché nelle opere d’epoca buona di Benvenuto[di Giovanni], non debba sembrare più calzantericonoscere un assorbimento sui generis diquell’accezione di lume, ancora sostanzial-mente ispirata da Domenico Veneziano, che eraattualissima fra Firenze e Perugia ancora alprincipio dell’ottavo decennio del secolo”.
67. ZERI, 1961, p. 23: “Chi ha visto la tavola diWashington [l’Annonciation] non potrà dimen-ticarne l’ammirevole intensità di luce, unaluce che non è ancora meridiana come inPiero della Francesca, ma che raggiunge la sualimpida chiarezza per via di accostamenti egiustapposizioni ‘prospettiche’, secondo cioèla sintassi che Domenico Veneziano porta almassimo raffinamento nella pala di SantaLucia de’ Magnoli”.
68. Sa proposition d’identification avecGiovanni Angelo d’Antonio a eu une fortunetenace, et n’a été définitivement écartée que trèsrécemment. Fra Carnevale est bien le Maîtredes panneaux Barberini, tandis que GiovanniAngelo d’Antonio est l’auteur des œuvres lesplus “lumineuses” de l’ancien corpus deGirolamo di Giovanni. Ce qui n’était qu’unehypothèse stylistique a été confirmé par la redé-couverte d’un document (voir MAZZALUPI,2003). Marilena Tamassia (dans BERTI, 1992,p. 196) cite à ce sujet une proposition de PietroZampetti, qui voit dans le style de “Girolamo”plus une influence de Domenico Venezianoque de Piero della Francesca. L’ouvrage deZampetti est sans doute ZAMPETTI, 1977.
69. VOLPE, 1980, p. 8: La fresque d’Uccello deSan Martino Maggiore, que publie Volpe, etcelles de la “ligne lumineuse” du Quattrocentoflorentin, “per analogia di quasi altrettantosolenni lucentezze metafisiche e per altissimitramiti, che fin qui avremmo detto soltantopierfranceschiani, competerebbero alla piùprestigiosa pittura del Rinascimento ferrarese:la cultura che, prima che in Ercole, ha in Cossastorici fondamenti”.
70. BENATI, 1988, p. 48: “La qualità tersa especchiante della luce, che non è tuttavia l’ab-bagliante e astratto lume di Piero dellaFrancesca, sotto il quale ogni cosa visibilesembra perdere i propri caratteri individuali edisporsi secondo una superiore geometria[…]”. Benati (ibidem) note également dans lePolyptyque de l’Oratorio della morte de laGalleria Estense de Modène “il chiarore dif-fuso che […] non può non rinviare che allalezione fiorentina di Domenico Veneziano edei suoi più stretti seguaci, a Firenze e fuori di
Firenze”. L’analyse de la peinture des Erri enfonction de Piero était due à Roberto Longhilui-même (LONGHI, 1934 [1956], p. 185).
71. BENATI, 1988, p. 50: “ ‘Copioso’ e ‘vario’divengono i termini entro i quali si riconosceuna casta plaga di cultura figurativa italianache, in taluni casi, aveva avuto modo di ali-mentarsi sull’esempio dello stesso Domenico:in Umbria, dove egli aveva a lungo operato inimprese purtroppo perdute, appare improntatada simili premesse l’attività del Boccati e delBonfigli, per non dire di quanto ancora si cogliedi queste stesse premesse nel ciclo delle piùtarde Storie di San Bernardino della Pinacotecadi Perugia, e così è per la Siena del Vecchietta eper le Marche del misterioso Maestro delleTavole Barberini”. Ibidem, p. 52: “Una certaconoscenza di fatti toscani di matrice non solodonatellesca e non ancora pierfranceschiana[era] praticabile a Ferrara entro gli anni ’50[…], in un senso che rinvia propriamente allapoetica di Domenico Veneziano”. Ce raisonne-ment avait déjà été proposé par le même BENATI,1986, p. 268.
72. LACLOTTE, 1967, p. 40: “Depuis queR. Longhi la proposa, on a souvent établi unecomparaison entre Enguerrand Quarton etPiero della Francesca: même solennelle luci-dité, même vision synthétique du paysage quiest aussi celle d’Antonello de Messine dansson Calvaire de Sibiu […], même coloris dia-phane et lumineux, voisin également de celuide Domenico Veneziano”.
73. LACLOTTE, 1970, p. 14: “On saisit mieux l’im-portance des valeurs spatiales chez l’artiste[Enguerrand Quarton], plus nettement ce quile sépare de la manière flamande, et comment– la vivacité lumineuse de son chromatismesouligne la parenté – il rejoint dans l’histoire lecourant le plus ‘moderne’ de la peinture médi-terranéenne, qui va de Domenico Veneziano aujeune Piero della Francesca, de Fra Angelico àFouquet, à Antonello et aussi à Jaime Hughet”.Liana Castelfranchi Vegas reprendra en 1983l’idée de la diffusion de l’art de DomenicoVeneziano et Fra Angelico dans le bassin médi-terranéen, notamment chez Quarton et Fouquet(CASTELFRANCHI VEGAS, 1983, p. 44).
74. BELLOSI, 1966 (2000), p. 96. Ironiquement,l’artiste qui vaut cette suggestion sera exclu del’exposition Pittura di luce: il s’agit de FilippoLippi dont la fresque de la Confirmation de laRègle carmélite “sorprende ogni volta che la siguarda in originale, per i risultati di traspa-renza cristallina che vanno già oltre i dati dicultura masaccesca e postulano […] la pre-senza di Domenico Veneziano a Firenze”.
75. BELLOSI, 1996, p. 26. La fresque a été restau-rée entre 1978 et 1983.
76. DINI, BONSANTI, 1986, p. 19: “Il diverso pro-cedimento si riflette nelle rifiniture e nella tra-sparenza e luminosità del colore. E tuttavial’effetto è bellissimo; il genio dell’artista si
esprime comunque, come accade per Pierodella Francesca”. Cette technique a permis à FraAngelico le “raggiungimento di effetti lumini-stici che la normale tecnica dell’affresco forsenon avrebbe reso possibili” (ibidem, p. 20).
77. LONGHI, 1952b, p. 4. Voir aussi LONGHI, 1964.Un éditorial du Burlington Magazine (“ColourReproductions”…, 1963) reconnaît l’attitudepionnière de Longhi dans ce domaine.
78. CHRISTIANSEN (1990, p. 738) parle de l’articlede Longhi comme d’un “tour-de-force of literarybrilliance, critical insight, and audacity, but […]not without its weak points. The first and mostimportant is whether the situation Longhievokes, after having abruptly swept aside FraAngelico, Filippo Lippi, and Uccello (Castagnoalso comes in for some hard knocks), has anyhistorical credibility. […] Domenico Veneziano[…] became not simply the great artist heobviously is, but the isolated protagonist ofFlorentine painting at mid-century”.
79. POPE-HENNESSY (1957 [1994], p. 315) a bienrésumé la conception anglo-saxonne du stylede Longhi dans un compte-rendu d’Officinaferrarese: “Such passages owe their fascinationto their essentially subjective character. ButProfessor Longhi’s subjectivity has its demer-its as well as its advantages”. HARTT (1959,p. 178, n. 43) trouvait “fantastic”, dans l’article de1952 (LONGHI, 1952a), l’attribution à DomenicoVeneziano du “second-hand Sienese diptychin Munich” aujourd’hui donné, suivant uneproposition de Luciano Bellosi, à Francesco diGiorgio Martini.
80. LONGHI, 1952a, p. 33, n. 11.
81. SALMI, 1954, p. 65.
82. WOHL, 1980, p. 156: “Longhi’s thesis thatthe Houston tondo [dit aussi tondo Strauss]and a twelve-sided salver of the same subjectin the Museum of Fine Arts in Boston belongto a tradition of narrativa ornata founded byDomenico Veneziano which flourished inFlorence, Siena, Perugia, and Ferrara is sup-ported by too little of Domenico’s work to bemore than a speculation”. Le développementferrarais de cette tradition n’est abordé parLonghi que de manière indirecte et ne serapas repris par la critique (LONGHI, 1952a, p. 34,n. 12). Sur ces deux plateaux d’accouchée etleur rapport avec Domenico Veneziano, voirBENATI, 1986, p. 260; BENATI, 1988, p. 55 etBENATI, 1991, p. 300-307.
83. PACCAGNINI, 1952, p. 115-118 (pour laMadone de Fra Angelico); SALMI, 1958;MURARO, 1959 (pour les fresques de SanZaccaria, signées par Andrea del Castagno etpar l’énigmatique Francesco da Faenza); etGIOSEFFI, 1962 (pour le panneau londonien deMasaccio, dont l’exécution sera attribuée à FraAngelico par WOHL, 1980, cat. 31). Au sujetdes fresques de San Tarasio, il convient derappeler que la proposition de Muraro avait étéingénieusement résolue par Federico Zeri: s’il
144Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 144
V A R I A
semble improbable que les parties “le piùfini e meditate” du cycle soient de DomenicoVeneziano – car pourquoi ne les aurait-il passignées? –, elles reviennent donc tout naturel-lement à la “nobile persona” de Francesco daFaenza (ZERI, 1960 [1991], p. 132). Pour uneautre identification de Francesco da Faenza,voir DE MARCHI, 1999, p. 124-126.
84. BELLOSI, 1967, p. 3: “A Firenze, […] più ingenerale si noterà che in quasi tutta la produ-zione pittorica dal quarto all’ottavo decennio,fino cioè agli inizi di Leonardo, si tende a raf-figurare le cose come ornate di quella traspa-renza luminosa che era la grande scoperta diDomenico Veneziano e la componente princi-pale della sua poetica”.
85. BELLOSI, 1980, p. 27: “In confronto a unavisione così severa e senza concessioni [cellede Masaccio], la generazione successiva ela-bora una concezione della pittura più serena,luminosa e colorata, che trova uno dei suoimomenti paradigmatici nella pala di SantaLucia dei Magnoli di Domenico Veneziano”.BELLOSI, 1987, p. 24: “Il dipinto di Berlino [uneVierge à l’Enfant, avec sainte Anne et quatre saints(fig. 7), que Bellosi attribue dans son article àGiovanni di Piamonte] rimanda a una culturapiù arcaica, più semplice e schietta: quella dimetà Quattrocento, basata ancora sullo spetta-colo creato dalla luce, che rende trasparentel’aria, fa cantare i colori, crea giochi d’ombreportate, rende qui perfettamente perspicuoil sontuoso broccato della veste di SantaCaterina, tira a lucido l’armatura del SanMichele, provoca bellissimi riflessi anche nellepenombre, tali da dare il senso di una splen-dida giornata di sole all’esterno di questoambiente”. L’œuvre a ensuite été attribuée àBaldassarre di Biagio del Firenze (MASSAGLI,2000, p. 284-285), et plus récemment à MatteoCivitali (DE MARCHI, 2004, p. 94-95, n. 77).
86. BELLOSI, 1990a, p. 31. Aujourd’hui large-ment acceptée, la question du séjour floren-tin de Domenico Veneziano au cours desannées 1430 a longtemps été débattue, et, en1990, Bellosi n’accordait qu’un crédit limité àcette hypothèse.
87. Ibidem, p. 11-12: “La pittura si fa chiara,come il cielo quando è sereno, come l’ariaquando è primavera; e perfino le ombre diven-tano nitide e trasparenti”.
88. BELLOSI (1990a, p. 45) note en effet chezBaldovinetti “l’accentuazione di un’atmosferadiafana che sembra come allontanare le figureal di là di un filtro opalescente, invece di esseresciorinate davanti agli occhi, in presa diretta,quasi per dare l’impressione di un meccanismolustro e tangibile, come accadeva in Giovannidi Francesco”.
89. Outre Domenico Veneziano, Bellosi (ibidem,p. 11) cite d’emblée Fra Angelico, Paolo Uccello,Andrea del Castagno, Alesso Baldovinetti, leMaître de Pratovecchio et Giovanni di Francesco.
Les autres artistes présents dans l’expositionsont Benozzo Gozzoli, Giovanni di Piamonte,Pesellino, Fra Carnevale, Maso Finiguerra etAndrea del Verrocchio.
90. Alessandro Angelini, dans BELLOSI, 1990b,p. 82: “Manca invece ancora nel Cristo porta-croce quell’atmosfera cristallina, quell’ariaazzurra che sarà il portato innovativo dellapittura di Domenico Veneziano, nel decenniosuccessivo, e che segnerà in modo indelebilelo stile dei suoi giovani seguaci”.
91. Cependant, l’affirmation sur “la precocitàcon cui l’ambiente fiorentino, anche in tecni-che diverse della pittura, seppe accogliere glistimoli e i suggerimenti che venivano dall’at-tività di Domenico Veneziano” est avancée parGiovanna Ragionieri (dans BELLOSI, 1990b,p. 188) sans véritable justification.
92. Luciano Bellosi, communication orale, 2003.
93. Seul Giovanni Agosti (1990, p. 193) citelibrement l’expression “pittura di luce d’illu-minante intimità” du Piero de Longhi, maissimplement pour souligner la figure de style.
94. Andrea De Marchi (dans BELLOSI, 1990b,p. 67) parle tout de même, non sans justesse,d’une “culture de Sant’Egidio”. La proposi-tion de Paola Barocchi, dans la préface ducatalogue (ibidem, p. 9), d’identifier cette cul-ture avec la “nuova maniera di colorire” dontparle Vasari à propos de Domenico Venezianoest sans doute trop optimiste. Vasari désignaitsurtout par cette expression la technique de lapeinture à l’huile, un “secret” décrit très juste-ment par Longhi comme “creduto di tecnica”(voir supra).
95. Voir supra, note 2. Giovanni Agosti est l’unde ceux qui ont eu l’idée de faire de la confé-rence de Bellosi une exposition (Andrea DeMarchi, communication orale, 2005).
96. Giovanni AGOSTI, 1990, p. 191: “Questainfatti non è una delle tante mostre ‘in memo-ria di Roberto Longhi’”.
97. Agosti (ibidem, p. 191 et 197) vise lamonographie d’Hellmut Wohl sur DomenicoVeneziano et celle de Marita Horster surAndrea del Castagno, toutes deux publiéeschez Phaidon en 1980, ainsi que l’essai d’EnricoCastelnuovo publié en 1977 dans Paragone Arteet intitulé “Per una storia sociale dell’arte”.
98. Ibidem, p. 197: “Reggerà a un esame socio-logico allora questa caratterizzazione di unatendenza ‘più semplice e schietta’ della pitturafiorentina, a metà del Quattrocento, ‘basataancora sull’appiombo delle figure e sullo spet-tacolo della luce, che rende trasparente l’aria,fa cantare i colori, crea giochi di ombre por-tate…’? E i libri dei ricordi? I catasti? Le com-pagnie soppresse? Le strategie parentali?” Lescitations proviennent de l’article de LucianoBellosi consacré à Giovanni di Piamonte(BELLOSI, 1987, p. 24).
99. GINZBURG, 1991, p. 28: “Dispiace vedereche c’è chi insiste nel contrapporre gli uni[documents stylistiques, c’est-à-dire les œuvres]agli altri [documents écrits: livres de comptes,cadastres, etc.], in pagine di chiassose vuotag-gini che deturpano un catalogo altrimenti diprim’ordine”. Carlo Ginzburg avait déjàdémontré de manière probante commentRoberto Longhi lui-même se servait, pour sesdatations, de “l’histoire sociale de l’art”(GINZBURG, 1982 [1994]).
100. GINZBURG, 1991, p. 23: “ ‘Pittura di luce’[…] ha fatto spicco nel sempre più fitto pano-rama espositivo non solo per la qualità delleopere esposte, ma perché nata da un pro-blema reale di ricerca. L’esatto opposto, perintendersi, della cinica (e giustamente con-dannata) operazione ordita a Venezia attornoa Tiziano”.
101. Ibidem, p. 23: “Il saggio introdduttivo diBellosi apre un catalogo che […] è all’altezzadella mostra”. Ibidem, p. 28: “Si può aggiun-gere che Domenico Veneziano, come supponeLonghi, era presumibilmente attivo a Firenzedal 1435 circa. Bellosi […] allude implicita-mente a quest’ipotesi senza darle troppo cre-dito”. Dans le catalogue, Andrea De Marchipenche également pour une présence précocede Domenico à Florence. Sur la position deBellosi, voir supra, note 85.
102. Parmi les compte-rendus succints, sedistinguent par leur efficacité ceux dePAOLUCCI, 1990 et de BROGGI, 1990. MANETTI
PICININI, 1990 présente l’exposition de façonassez banale, tandis que CORRAIN, 1991 et sur-tout LAZZI, 1990 en tirent des considérationsquelque peu brumeuses ou du moins horssujet. La palme est sans conteste détenue parCUVELIER, 1990. Celle-ci peine notamment àfaire de Domenico Veneziano un apôtre de lapittura di luce sur la seule foi de son Saint Jean-Baptiste au désert: “On a un peu de mal à tenirpour ‘peinture de lumière’ cette éblouissanteréclame pour sports d’hiver naturistes. Il fautpresque des Ray Ban pour supporter la réver-bération”. Ce n’est qu’à la prédelle Buonarrotique la journaliste a ce qu’on ne peut appelerqu’une illumination (ibidem, p. 19): “La voilà,la peinture de lumière! Les jaunes chauffent,les rouges tiennent à distances [sic] les bleusviolets, ciel inclus, tandis qu’un centurion, unconsul, dirige et tempère tout ce systèmechromatique en indiquant de l’index et l’auri-culaire (le salut funk?) sa tunique mauve.Mauve qui peut! Après ça, il n’y a plus rien àdire”. Difficile effectivement d’ajouter quoique ce soit…
103. Antonio Paolucci, dans BERTI, PAOLUCCI,1990, p. 17: “Dopo la sapiente pulitura, infatti,gli storici dell’arte sono stati costretti a rico-noscere che il Masaccio monocromo, ‘siro-niano’, al quale ci avevano abituato i manualidel liceo, cede a un pittore di un più chiaro e
145 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 145
luminoso colore, più in sintonia di quanto nonsi pensasse con il Beato Angelico e con Pierodella Francesca”. Sur la “coïncidence” entrecette “découverte” et l’exposition de 1990, jerenvoie à ROWLEY, 2006.
104. CHRISTIANSEN, 1990, p. 738.
105. Ibidem, p. 739. L’auteur propose de voirune explication à ce changement dans le Concilede Florence de 1439.
106. LILLIE, 1991.
107. Ce succès fut revendiqué la même annéepar la présidente de la Casa Buonarroti, PaolaBarocchi (Paola Barocchi, “Premessa”, dansBAROCCHI, 1992, p. 17).
108. BELLOSI, 1992b, p. 23. L’article sera repu-blié, avec quelques modifications, dans unnuméro de Città di vita consacré à Piero dellaFrancesca (BELLOSI, 1993b). Bellosi présenteraégalement son exposition dans Art e dossier(BELLOSI, 1992a).
109. BELLOSI, 1992b, p. 37.
110. Ibidem, p. 37-38. Contrairement au catalo-gue de 1990, Bellosi suppose donc la présenceactive de Domenico Veneziano à Florence dèsles années 1430 (voir supra, notes 85 et 100).
111. Ibidem, p. 49-51.
112. Antonio Natali dans BELLOSI, 1992c, p. 58:“E l’ascendente masaccesco [su Piero] s’ap-prezza ancor meglio ora che una pulitura hariportato la cromia degli affreschi del Carminea toni più chiari, e dunque anche più consonialla sensibilità solare di Piero”.
113. BELLOSI, 1992a, p. 18, a affirmé, de manièrepolémique et quelque peu ironique, que l’expo-sition aurait pu ne comporter que cette uniqueœuvre, ce qui aurait eu un impact très différentpour la fortune de Domenico Veneziano: “Lapala di Santa Lucia dei Magnoli è così rappre-sentativa del problema della formazione diPiero della Francesca che si è avuta la tenta-zione, anche per marcare un certo non alli-neamento con l’ecesso di mostre che hacaratterizzato questo 1992, di limitare la mostraa una sola opera: questa, appunto”.
114. Il est intéressant de noter que GiovanniAgosti ne participa pas à cette seconde mani-festation, mais fut, la même année, l’un desorganisateurs principaux d’une expositiondestinée à réévaluer une autre tendance duQuattrocento florentin, celle du “giardino diSan Marco”. La continuité avec l’exposition de1990 est d’ailleurs explicitement revendiquée,puisque Agosti cite littéralement la conclusionde son propre essai (dans BAROCCHI, 1992, p. 174:“I ragazzi della Pittura di luce rimanevano allafine attraccati in una piscina cromatica, traschizzi e croste di luce accesa, tutti contenti:adesso sono divenuti grandi in casa Medici…”).Cette généalogie, quelque peu forcée dupoint de vue formel, montre que l’intérêt del’auteur était surtout tourné vers le caractèrerebelle de la pittura di luce, loin de l’esprit
plus consensuel qui dominait le catalogue del’exposition des Offices, et dont l’absence del’excentrique Maître de Pratovecchio cher àLonghi est le stigmate.
115. Expressions employées respectivementdans le catalogue (BELLOSI, 1992) par AlessandroAngelini (p. 67), Laura Cavazzini (p. 130),Alessandro Cecchi (p. 125) et Antonio Natali(p. 132). Outre Luciano Bellosi (p. 23 et 138),Laura Cavazzini parle également (p. 90) des“ ‘pittori di luce’ fiorentini”.
116. GALLI, 1998, p. 27. Dès 1990, Luciano Bertiavait adoubé la “peinture de lumière” commela phase suivant “l’âge de Masaccio” (LucianoBerti, dans BERTI, PAOLUCCI, 1990, p. 43): “[Nel1439-1439] si sta passando intanto a un’altrafase, pittura specialmente ‘di luce’, circa cuiFirenze offre in contemporanea a questa mostraun’altra – in Casa Buonarroti – diretta daLuciano Bellosi”.
117. BELLOSI, 1996, p. 22; BELLOSI, 1998, p. 8-9 (àpropos de Fra Angelico); BELLOSI, 1999, p. 10(sur le Scheggia). Pour Sienne, voir BELLOSI,1993a, p. 50: “La cultura di DomenicoVeneziano, cui fa capo quella corrente dellapittura fiorentina che in una mostra del 1990abbiamo chiamato ‘pittura di luce’ […] va benoltre l’ambito fiorentino [e] dà il tono a tutta lapittura senese di secondo Quattrocento”. Lesréflexions de Bellosi sur ce point se sont déve-loppées en accord avec celles d’AlessandroAngelini (ANGELINI, 1988, p. 16). Pour un récentécho, voir DI MAIO, 2006, p. 135.
118. MASSAGLI, 2000, p. 287 remarque chez leLucquois Baldassarre di Biagio del Firenze “laluce [che] crea ombre avvolgenti che testimo-niano il fascino esercitato sul pittore dalla pro-duzione dei ‘pittori di luce’ fiorentini”. Voirégalement à ce sujet FILIERI, 2004. Du point devue de la peinture des Marches, MINARDI (1998,p. 18) voit en celui qu’il appelle encore Girolamodi Giovanni (et qui se trouve être GiovanniAngelo d’Antonio, voir supra, note 67) “quasi un‘pittore di luce’”. Giampietro Donnini étend cejugement à Lorenzo d’Alessandro dans SGARBI,PAPETTI, 2001, p. 136. Quant à DE MARCHI (2002,p. 64-69), il définit ouvertement les années 1450-1470 dans les Marches comme celles de la pitturadi luce, aussi bien à Pérouse et Urbin qu’àFoligno et Camerino. Enfin, l’idée bellosienned’une influence directe de la pittura di luce surJean Fouquet est développée par FiorellaSricchia Santoro, qui va jusqu’à placer le peintredans l’atelier de Fra Angelico au cours desannées 1440 (SRICCHIA SANTORO, 2003, p. 56).
119. L’analyse après restauration des fres-ques d’Andrea del Castagno au cénacle deSant’Apollonia est presque entièrementconduite selon une lecture “lumineuse”,comme le montre notamment le titre du cha-pitre: “Andrea del Castagno fra plasticismo epittura di luce: appunti e riflessioni sulrecente restauro” (voir PROTO PISANI, 2000).
120. Vittoria Garibaldi (dans PAOLUCCI, 2001,p. 110, cat. II. 1) fait ainsi de DomenicoGhirlandaio le “massimo diffusore a Roma”de la pittura di luce, ce qui reste problématique.121. CASTELFRANCHI VEGAS, 1996 (1997), p. 81:“Ces tentatives réélaborent les nouveautésrévolutionnaires introduites par Masaccio ausujet de la perspective. Elles concernent lerendu lumineux des couleurs, la recherched’ombres limpides et transparentes ainsi qued’un espace inondé de lumière. […] Les remar-ques répétées d’Alberti sur ‘l’amitié des cou-leurs’, à savoir sur leur rapprochement réussi,mais aussi sur la façon dont elles ‘captent lesvariations de la lumière’, paraissent connaîtreune vérification directe et concrète avec la‘peinture de lumière’”.122. Le chapitre IV de son ouvrage sur leQuattrocento s’intitule “La ‘peinture delumière’ en Toscane et en France” (ibidem, p. 81).123. En France, Jacques Gagliardi est l’un desseuls à mentionner l’existence de la pittura diluce dans sa brillante et atypique Conquête de lapeinture (GAGLIARDI, 1993 [2001], p. 371).124. SCHMIDT, 2001, p. 573: “This fragment of apredella is definitely not by Neri di Bicci,although an alternative is difficult to propose.At any rate, this is pittura di luce, from the orbitof Giovanni di Francesco and the Master ofPratovecchio”.125. THIÉBAUT, 2004, p. 121: “[DomenicoVeneziano], bientôt rejoint par Fra Angelico,Paolo Uccello et d’autres, semble avoir été lepremier adepte d’un courant, épris de pers-pective et de lumière, que Luciano Bellosi bap-tisera si poétiquement pittura di luce”. Sur lacomplémentarité des différentes traditions his-toriographiques à propos de la pittura di luce,voir ROWLEY, à paraître.126. Giorgio Bonsanti, dans SCUDIERI, RASARIO,2003, p. 152: “Emerge pienamente riconosci-bile la tendenza a una ‘pittura di luce’ che nondeve dunque attendere l’affermazione fioren-tina di Domenico Veneziano”. Pour la propo-sition de Bellosi, voir supra, note 107.127. BELLOSI, 2002, p. 38: “Gli effetti modernis-simi che si notano nel pannello londinese con iSanti Girolamo e Giovanni Battista di Masaccio[sono] così sottili e raffinati di luci radenti, diriverberi luminosi e cromatici da far pensareche siamo di fronte agli inizi di una svolta già aopera di Masaccio verso quell’importantissimaevoluzione che si attuerà compiutamente aFirenze negli anni quaranta con il fenomenoche abbiamo chiamato ‘pittura di luce’”.128. Fra Carnevale, 2004. L’exposition a donnélieu à un “troisième acte” à Urbin, pour uneexposition plus modeste mais qui approfon-dissait le parcours urbinate de Fra Carnevale(MARCHI, VALAZZI, 2005).129. CHRISTIANSEN, 2004, p. 64, n. 34: “Perquanto suggestiva, l’espressione [pittura diluce] è fuorviante, in quanto lascia intendere
146Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 146
V A R I A
che il Lippi fosse meno interessato alla luce ris-petto a Domenico Veneziano. Non è così: Lippiintendeva piuttosto esplorare un diverso equi-librio tra luce e forma”. La mise en évidence dela partialité de l’exclusion de Lippi lors de l’ex-position de 1990 et surtout de l’ambiguïté del’expression elle-même constitue néanmoinsune critique méritoire.
130. Nous insistons ici sur les remarques concor-dantes faisant de certaines œuvres de Lippi des“peintures de lumière” dans le même esprit quecelles de Domenico Veneziano, remarquestenues par Georg Pudelko (voir supra, note 42),par Carlo Volpe (voir supra, note 56) et mêmepar Luciano Bellosi (voir supra, note 73).
131. Pour DE MARCHI (2004, p. 91-92), les“Città ideali, ora divise fra Urbino, Berlino eBaltimora, non hanno più nulla a che spartire[…] con l’idea di una ‘Pittura di luce’ dove lospettacolo architettonico non è mai fine a sestesso ma sostanza della varietà dell’‘histo-ria’, in senso albertiano, anche se sono inqualche modo le eredi”. J’ai exprimé, dansun article rendant compte de l’exposition,quelques réserves sur une différenciationaussi radicale (voir ROWLEY, 2005a, p. 101, n. 32).Dans sa recension de l’exposition, SYSON,2005 élude le problème de la pittura di lucepour deux raisons: d’une part l’Annonciationdu peintre à la National Gallery of Art de
Washington lui évoque plus Filippo Lippique Domenico Veneziano, tandis que, d’au-tre part, l’influence de Piero della Francescasur Fra Carnevale lui semble négligeable.Contrairement à ce qu’il affirme (p. 138),pourtant, la présence de Piero à Urbin sem-ble, selon toute évidence, bien antérieure à1469 (voir, entre autres, Fra Carnevale, 2004,cat. 46).132. KANTER, PALLADINO, 2005. Pour une dis-cussion plus approfondie sur l’exposition,voir ROWLEY, 2005b.133. C’est cette problématique que je continued’étudier dans le cadre d’une thèse de doctoratentreprise à l’Université de Paris IV – Sorbonne.
147 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 147
Bibliographie** Cette étude étant historiographique, il a semblé plus clair – et plus révélateur –de présenter la bibliographie dans un ordre chronologique.
– DE BONI, 1844: Filippo De Boni, Domenico Veneziano e Andrea del Castagno:dramma, Firenze, Società tipografica, 1844.– CROWE, CAVALCASELLE, 1864: Joseph Arthur Crowe, Giovanni BattistaCavalcaselle, A New History of Painting in Italy from the Second to theSixteenth Century, II, London, Murray, 1864.– MÜNTZ, 1889: Eugène Müntz, Histoire de l’art pendant la Renaissance. I.Italie. Les primitifs, Paris, Hachette, 1889.– HILDEBRAND, 1893 (1996): Adolf von Hildebrand, Das Problem der Formin der bildenden Kunst, Strasbourg, Heitz, 1893 (édition consultée: Il pro-blema della forma, Milano, TEA Arte, 1996).– SCHMARSOW, 1893: August Schmarsow, “Die Cappella dell’Assunta inDom zu Prato”, Repertorium für Kunstwissenschaft, XVI, 1893, p. 159-197.–VENTURI A., 1911: Adolfo Venturi, Storia dell’arte italiana. VII. La pittura delQuattrocento, 1, Milano, Ulrico Hoepli, 1911.– CROCE, 1912: Benedetto Croce, “La teoria dell’arte come pura visibi-lità”, in Scritti vari di erudizione e critica in onore di Rodolfo Renier, Torino,Bocca, 1912, p. 259-270.– SCHMARSOW, 1912: August Schmarsow, “Domenico Veneziano”,L’Arte, XV, 1912, p. 9-20 et 81-97.– LONGHI, 1914 (1961): Roberto Longhi, “Piero dei Franceschi e lo svi-luppo della pittura veneziana”, L’Arte, XVII, 1914, p. 198-221 et 241-256(repris in Opere complete. I. Scritti giovanili, 1912-1922, Firenze, Sansoni,1961, I, p. 61-106).– LONGHI, 1914 (1980): Roberto Longhi, Breve ma veridica storia della pitturaitaliana (1914), Firenze, Sansoni, 1980.–VENTURI L., 1915: Lionello Venturi, “La posizione dell’Italia nelle artifigurative”, Nuova Antologia, 5e série, CLXXVI, mars-avril 1915, p. 213-225.– DE CHIRICO, 1923 (1985): Giorgio De Chirico, “Pro technica oratio” (1923)in Il meccanismo del pensiero. Critica, polemica, autobiografia. 1911-1943,Maurizio Fagiolo (éd.), Torino, Einaudi, 1985, p. 238-244.– LONGHI, 1925 (1967): Roberto Longhi, “Un frammento della pala diDomenico Veneziano per Santa Lucia dei Magnoli”, L’Arte, XXVIII, 1925,p. 31-35 (repris in Opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928, Firenze,Sansoni, 1967, I, p. 3-8).–VENTURI A., 1925: Adolfo Venturi, “Tavoletta di Domenico Veneziano”,L’Arte, XXVIII, 1925, p. 28-30.– LONGHI, 1926a (1967): Roberto Longhi, “Lettera pittorica a GiuseppeFiocco”, Vita Artistica, 1926, p. 127-139 (repris in Opere complete. II. Saggie ricerche 1925-1928, Firenze, Sansoni, 1967, I, p. 77-95).– LONGHI, 1926b (1967): Roberto Longhi, “Primizie di Lorenzo da Viterbo”,Vita artistica, 1926, p. 109-114 [repris in Opere complete. II. Saggi e ricerche1925-1928, Firenze, Sansoni, 1967, I, p. 53-61].– LONGHI, 1927a (1963): Roberto Longhi, Piero della Francesca, Roma,Valori Plastici, 1927 (repris in Opere complete. III. Piero della Francesca, 1927.Con aggiunte fino al 1962, Firenze, Sansoni, 1963).– LONGHI, 1927b: Roberto Longhi, Piero della Francesca, Paris, G. Grès & Cie,1927.–VENTURI A., 1927: Adolfo Venturi, “Predella di Alessio Baldovinetti inCasa Buonarroti a Firenze”, L’Arte, XXX, 1927, p. 34-38.– LONGHI, 1928 (1968): Roberto Longhi, “Ricerche su Giovanni diFrancesco”, Pinacotheca, I, n° 1, juillet-août, 1928, p. 34-48 (repris in Operecomplete. IV. “Me Pinxit” e quesiti caravaggeschi, 1928-1934, Firenze,Sansoni, 1968, p. 21-36).– OFFNER, 1933: Richard Offner, “The Mostra del Tesoro di FirenzeSacra – II”, The Burlington Magazine, LXIII, n° 367, octobre 1933, p. 166-178.– LONGHI, 1934 (1956): Roberto Longhi, Officina ferrarese, Roma, Edizionid’Italia, 1934 (repris in Opere complete. V. Officina ferrarese (1934), Firenze,Sansoni, 1956).– PUDELKO, 1934: Georg Pudelko, “Studien über Domenico Veneziano”,Mitteilungen des kunsthistorichen Institutes in Florenz, IV, 1934, p. 145-200.
– PUDELKO, 1935: Georg Pudelko, “Paolo Uccello peintre lunaire”,Minotaure, II, n° 7, 1935, p. 32-41.– SIEBENHÜNER, 1935: Herbert Siebenhüner, Über den Kolorismus derFrührenaissance, vornehmlich dargestellt an dem “Trattato della pittura” desL. B. Alberti und an einem Werke des Piero della Francesca, thèse de doctorat,Université de Leipzig, Schamberg, Gatzen & Hahn, 1935.– PUDELKO, 1936: Georg Pudelko, “Per la datazione delle opere di FraFilippo Lippi”, Rivista d’arte, XVIII, 1936, p. 45-76.– SALMI, s. d. [1936]: Mario Salmi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno,Domenico Veneziano, Roma, Valori Plastici, s. d. [1936] [édition consultée:Paris, Gallimard, s. d.].– KENNEDY, 1938: Ruth Wedgwood Kennedy, Alesso Baldovinetti: A Criticaland Historical Study, New Haven/London, Yale University Press, 1938.– OFFNER, 1939: Richard Offner, “The Barberini Panels and Their Painter”,in Wilhelm R. W. Kohler (éd.), Medieval Studies in Memory of A. KingsleyPorter, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1939, I, p. 205-253.– POPE-HENNESSY, 1939: John Pope-Hennessy, Sassetta, London, Chattoand Windus, 1939. 1956].– LONGHI, 1940a (1975): Roberto Longhi, “Fatti di Masolino e di Masaccio”,La Critica d’Arte, XXV-XXVI, n° 3-4, juillet-décembre 1940, p. 145-191(repris in Opere complete. VIII/1. “Fatti di Masolino e di Masaccio” e altri studisul Quattrocento, 1910-1967, Firenze, Sansoni, 1975, p. 3-65).– LONGHI, 1940b (1975): Roberto Longhi, “Genio degli anonimi: Giovannidi Piamonte?”, La Critica d’Arte, XXIII, janvier-mars 1940, p. 97-101(repris in idem, Opere complete. VIII/1. “Fatti di Masolino e di Masaccio” ealtri studi sul Quattrocento, 1910-1967, Firenze, Sansoni, 1975, p. 131-137).– SALMI, 1943 (1967), p. 19: Mario Salmi, Civiltà fiorentina del primoRinascimento, Firenze, Sansoni, 1943 (édition consultée: Firenze,Sansoni, 1967).– POPE-HENNESSY, 1944: John Pope-Hennessy, “The Development ofRealistic Painting in Siena, II”, The Burlington Magazine, LXXXIV, 1944,p. 139-145.– FIOCCO, 1945: Giuseppe Fiocco, La pittura toscana del Quattrocento,Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1945.– BRANDI, s. d. [1949]: Cesare Brandi, Quattrocentisti senesi, Milano,Ulrico Hoepli, s. d. [1949].– SALVINI, 1949 (1988): Roberto Salvini, “Introduzione”, in RobertoSalvini (éd.), La Critica d’arte moderna (la pura visibilità), Firenze, L’Arco,1949, p. 9-54 (édition consultée: Pure visibilité et formalisme dans la critiqued’art au début du XXe siècle, Paris, Klincksieck, 1988, p. 7-59).– BERENSON, 1950: Bernard Berenson, Aesthetics and History, London,Constable Publishers, 1950.– LONGHI, 1950 (1963): Roberto Longhi, “Piero in Arezzo (1950)”, in Operecomplete. III. Piero della Francesca, 1927. Con aggiunte fino al 1962, Firenze,Sansoni, 1963, p. 79-92.– LONGHI, 1951 (1985): Roberto Longhi, “La mostra di Arezzo”, ParagoneArte, II, n° 15, 1951, p. 50-63 (repris in Opere complete. XIII. Critica d’arte ebuongoverno, 1938-1969, Firenze, Sansoni, 1985, p. 293-304).– LONGHI, 1952a: Roberto Longhi, “Il ‘Maestro di Pratovecchio’”, ParagoneArte, III, n°35, novembre 1952, p. 10-37.– LONGHI, 1952b: Roberto Longhi, “Pittura - Colore - Storia e una domanda”,Paragone Arte, III, n° 33, septembre 1952, p. 3-6.– LONGHI, 1952c: Roberto Longhi, “Quadri italiani di Berlino a Sciaffusa”,Paragone Arte, III, n° 33, septembre 1952, p. 39-46.– PACCAGNINI, 1952: Giovanni Paccagnini, “Una proposta per DomenicoVeneziano”, Bollettino d’Arte, XXXVII, 4e série, n° 2, avril-juin 1952,p. 115-126.– BOLOGNA, 1954: Ferdinando Bologna, “Miniature di Benvenuto diGiovanni”, Paragone Arte, V, n° 51, mars 1954, p. 15-19.– SALMI, 1954: Mario Salmi, “Fuochi d’artificio o della pseudo critica”,Commentari, V, 1954, p. 65-78.– VOLPE, 1956: Carlo Volpe, “In margine a un Filippo Lippi”, ParagoneArte, VII, n° 83, novembre 1956, p. 38-45.– POPE-HENNESSY, 1957 (1994): John Pope-Hennessy, compte-rendu deLONGHI, 1934 (1956), The Times Literary Supplement, 1er février 1957
148Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 148
V A R I A
(repris in Walter Kaiser, Michael Mallon [éd.], On Artists and Art Historians.Selected Book Reviews of John Pope-Hennessy, Firenze, Leo S. Olschki,1994, p. 316-318).– SALMI, 1958: Mario Salmi, “Ancora di Andrea del Castagno: dopo ilrestauro degli affreschi di San Zaccaria a Venezia”, Bollettino d’Arte,4e série, XLIII, 1958, p. 117-140.– HARTT, 1959: Frederick Hartt, “The Earliest Works of Andrea delCastagno”, The Art Bulletin, XLI, 1959, p. 159-181 et 225-236.– MURARO, 1959: Michelangelo Muraro, “Domenico Veneziano at SanTarasio”, The Art Bulletin, XLI, 1959, p. 151-158.– ZERI, 1960 (1991): Federico Zeri, “Antonio da Firenze: un’aggiunta eun ridimensionamento”, Paragone Arte, XI, n°123, mars 1960 (repris inGiorno per giorno nella pittura. Scritti sull’arte toscana dal Trecento al primoCinquecento, Torino, Umberto Allemandi & Co., 1991, p. 129-132).– ZERI, 1961: Federico Zeri, Due dipinti, la filologia e un nome. Il Maestrodelle Tavole Barberini, Torino, Einaudi, 1961.– GIOSEFFI, 1962: Decio Gioseffi, “Domenico Veneziano: l’‘esordiomasaccesco’ e la tavola con i Santi Girolamo e Giovanni Battista nellaNational Gallery di Londra”, Emporium, CXXXV, 1962, p. 51-72.– “Colour Reproductions”…, 1963: “Colour Reproductions”, TheBurlington Magazine, CV, n° 719, février 1963, p. 47-48– LONGHI, 1963: Roberto Longhi, Opere complete. III. Piero della Francesca,1927. Con aggiunte fino al 1962, Firenze, Sansoni, 1963.– LONGHI, 1964: Roberto Longhi, “Il critico accanto al fotografo, al foto-colorista e al documentarista”, Paragone Arte, XV, n°169, janvier 1964,p. 29-38.– BELLOSI, 1966 (2000): Luciano Bellosi, “La Mostra di affreschi staccatial Forte Belvedere”, Paragone Arte, XVII, n° 201, 1966, p. 73-79 (repris inCome un prato fiorito. Studi sull’arte tardogotica, Milano, Jaca Book, 2000,p. 95-99).– CASTELFRANCHI VEGAS, 1966: Liana Castelfranchi Vegas, “I rapportiItalia-Fiandra”, Paragone Arte, XVII, n°195, mai 1966, p. 9-24 et n°201,novembre 1966, p. 42-69.– BELLOSI, 1967: Luciano Bellosi, “Intorno ad Andrea del Castagno”,Paragone Arte, XVIII, n° 211/31, septembre 1967, p. 3-18.– LACLOTTE, 1967: Michel Laclotte, “Rencontres franco-italiennes au milieudu XVe siècle”, Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae,XIII, 1967, p. 33-41.– LACLOTTE, 1970: Michel Laclotte, “Un Retable d’Enguerrand Quarton”,Revue de l’art, IX, 1970, p. 6-14.– ZAMPETTI, 1977: Pietro Zampetti, Pittura a Camerino: una congiunturapittorica del sec. XV. Corso di ricerca svolto nell’anno accademico 1976-1977,Urbino, Co. S.U.R., 1977.– BELLOSI, 1980: Luciano Bellosi, “La rappresentazione dello spazio”, inGiovanni Previtali (éd.), Storia dell’arte italiana. I, 4. Ricerche spaziali e tecno-logie, Torino, Einaudi, 1980, p. 5-39.– VOLPE, 1980: Carlo Volpe, “Paolo Uccello a Bologna”, Paragone Arte,XXXI, n° 365, juillet 1980, p. 3-28.– WOHL, 1980: Hellmut Wohl, The Paintings of Domenico Veneziano, ca.1410-1461: A Study in Florentine Art of the Early Renaissance, Oxford,Phaidon, 1980.– GARBOLI, 1982: Cesare Garboli, “Longhi lettore”, in Giovanni Previtali(éd.), L’arte di scrivere sull’arte. Roberto Longhi nella cultura del nostrotempo, Roma, Editori Riuniti, 1982, p. 108-125.– GINZBURG, 1982 (1994): Carlo Ginzburg, “Datazione assoluta e data-zione relativa: sul metodo di Longhi”, Paragone Arte, XXXIII, n°386,avril 1982, p. 5-17 (repris in idem, Indagini su Piero. Il Battesimo, il ciclo diArezzo, la Flagellazione di Urbino, Torino, Einaudi, 1994, p. 149-161).– CASTELFRANCHI VEGAS, 1983 (1995): Liana Castelfranchi Vegas, Italia eFiandra nella pittura del Quattrocento, Milano, Jaca Book, 1983 (éditionconsultée: Italie et Flandres. Primitifs flamands et Renaissance italienne, Paris,L’Aventurine, 1995).– VOLPE, 1983: Carlo Volpe, “Il lungo percorso del ‘dipingere dolcissimoe tanto unito’”, in Federico Zeri (éd.), Storia dell’arte italiana, II, 1, Dalmedioevo al Quattrocento, Torino, Einaudi, 1983, p. 229-304.
– CASTELFRANCHI VEGAS, 1985: Liana Castelfranchi Vegas, “L’Angelico eil ‘De Pictura’ dell’Alberti”, Paragone Arte, XXXVI, n° 419-423, janvier-mai 1985, p. 97-106.– BENATI, 1986: Daniele Benati, “La pittura a Ferrara e nei documentiestensi nel secondo Quattrocento. Parma e Piacenza”, in Federico Zeri(éd.), La pittura in italia. Il Quattrocento, Milano, Electa, 1986, I, p. 256-271.– DINI, BONSANTI, 1986: Dino Dini, Giorgio Bonsanti, “Fra Angelico e gliaffreschi nel Convento di San Marco (ca. 1441-50)”, in Eve Borsook,Fiorella Gioffredi Superbi (éd.), Tecnica e stile. Esempi di pittura murale delRinascimento italiano, I, Milano, Silvana Editoriale, 1986, p. 17-24.– BELLOSI, 1987: Luciano Bellosi, “Giovanni di Piamonte e gli affreschidi Piero ad Arezzo”, Prospettiva, 50, novembre 1987, p. 15-35.– ANGELINI, 1988: Alessandro Angelini, “Francesco di Giorgio pittore e lasua bottega. Alcune osservazioni su una recente monografia”, Prospettiva,52, janvier 1988, p. 10-24.– BENATI, 1988: Daniele Benati, La Bottega degli Erri e la pittura del Rinascimentoa Modena, Modena, Artioli Editore, 1988.– CASTELFRANCHI VEGAS, 1989: Liana Castelfranchi Vegas, L’Angelico el’umanismo, Milano, Jaca Book, 1989.– AGOSTI Giovanni, 1990: Giovanni Agosti, “Ai ragionati margini diun’esposizione”, in Luciano Bellosi (éd.), Pittura di luce: Giovanni diFrancesco e l’arte fiorentina di metà Quattrocento, (catalogue d’exposition:Firenze, Casa Buonarroti, 16 mai - 20 août 1990), Milano, Olivetti et Electa,1990, p. 191-197.– BELLOSI, 1990a: Luciano Bellosi, “Giovanni di Francesco e l’arte fioren-tina di metà Quattrocento”, in Luciano Bellosi (éd.), Pittura di luce:Giovanni di Francesco e l’arte fiorentina di metà Quattrocento, (catalogued’exposition: Firenze, Casa Buonarroti, 16 mai - 20 août 1990), Milano,Olivetti et Electa, 1990, p. 11-45.– BELLOSI, 1990b: Luciano Bellosi (éd.), Pittura di luce: Giovanni di Francescoe l’arte fiorentina di metà Quattrocento, (catalogue d’exposition: Firenze,Casa Buonarroti, 16 mai - 20 août 1990), Milano, Olivetti et Electa, 1990.– BERTI, PAOLUCCI, 1990: Luciano Berti, Antonio Paolucci (éd.), L’età diMasaccio. Il primo Quattrocento a Firenze, (catalogue d’exposition: Firenze,Palazzo Vecchio, 7 juin - 16 septembre 1990), Milano, Electa, 1990.– BROGGI, 1990: Mauro Broggi, compte-rendu de BELLOSI, 1990b, FMR,édition italienne, 5/1990, Ephemeris, juillet 1990, p. 16.– CHRISTIANSEN, 1990: Keith Christiansen, “Florence. Masaccio and the‘pittura di luce’ ”, The Burlington Magazine, CXXXII, n° 1051, octobre 1990,p. 736-739.– CUVELIER, 1990: Pascaline Cuvelier, « XVe: la B. D. selon Giovanni diFrancesco », Libération, 11-12 août 1990, p. 18-19.– LAZZI, 1990: Giovanna Lazzi, compte-rendu de BELLOSI, 1990b,Antichità viva, XXIX, n°5, 1990, p. 60-62.– MANETTI PICININI, 1990: A. Manetti Piccinini, “Giovanni di Francesco ealtri grandi perdenti”, Il Giornale dell’arte, VIII, n° 77, avril 1990, p. 16.– PAOLUCCI, 1990: Antonio Paolucci, “‘La pittura di luce’ nel trentenniodell’arte fiorentina/2 (dalla morte di Masaccio, 1428, a quella diDomenico Veneziano, 1457 [sic])”, Amici dei musei, n° 46, novembre 1990,p. 17-19.– AGOSTI Giacomo, 1991: Giacomo Agosti, “Da Piero dei Franceschi aPiero della Francesca (Qualche avvertenza per la lettura di due saggilonghiani)”, in Maria Mimita Lamberti, Maurizio Fagiolo Dell’Arco(éd.), Piero della Francesca e il Novecento. Prospettiva, spazio, luce, geometria,pittura murale, tonalismo 1920/1938, (catalogue d’exposition: Sansepolcro,Museo Civico, Sala delle Pietre, 6 juillet - 12 octobre 1991), Venezia,Marsilio, 1991, p. 199-209.– BENATI, 1991: Daniele Benati, in Andrea Di Lorenzo (et alii) (éd.), Le muse eil principe. Catalogo, (catalogue d’exposition: Milano, Museo Poldi Pezzoli,20 septembre - 1er décembre 2001), Modène, Franco Cosimo PaniniEditore, 1991, cat. 77.– CORRAIN, 1991: Lucia Corrain, “Chiari di luna e pittura di luce”, in MarioSbriccoli (éd.), La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna(Laboratorio di storia, 3), Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, p. 165-169.– FERGONZI, 1991: Flavio Fergonzi, “Un momento difficile: quattro
149 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 149
momenti di Piero contemporaneo nella critica del primo Novecento”, inMaria Mimita Lamberti, Maurizio Fagiolo Dell’Arco (éd.), Piero dellaFrancesca e il Novecento. Prospettiva, spazio, luce, geometria, pittura murale,tonalismo 1920/1938, (catalogue d’exposition: Sansepolcro, Museo Civico,Sala delle Pietre, 6 juillet - 12 octobre 1991), Venezia, Marsilio, 1991,p. 229-243.– GINZBURG, 1991: Carlo Ginzburg, “Ancora su Piero della Francesca eGiovanni di Francesco”, Paragone Arte, 42e année, XXIX, n° 499, sep-tembre 1991, p. 23-32.– LILLIE, 1991: Amanda Lillie, compte-rendu de Pittura di luce, RenaissanceStudies, V, n° 3, septembre 1991, p. 353-356.– TIBERGHIEN, 1991: Gilles A. Thiberghien, “De Cavalcaselle à Longhi: attri-bution et idéalisme en Italie”, Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne,36, été 1991, p. 39-52.– BAROCCHI, 1992: Paola Barocchi (éd.), Il giardino di San Marco. Maestri ecompagni del giovane Michelangelo, (catalogue d’exposition: Firenze, CasaBuonarroti, 30 juin - 19 octobre 1992), Milano, Silvana Editoriale, 1992.– BELLOSI, 1992a: Luciano Bellosi, “A scuola di luce. La formazione fio-rentina di Piero della Francesca”, Art e dossier, VII, n° 72, 1992, p. 17-21.– BELLOSI, 1992b: Luciano Bellosi, “Sulla formazione fiorentina di Pierodella Francesca”, in Luciano Bellosi (éd.), Una scuola per Piero. Luce, coloree prospettiva nella formazione fiorentina di Piero della Francesca, (catalogued’exposition: Firenze, Galleria degli Uffizi, 27 septembre 1992 - 10 jan-vier 1993), Venezia, Marsilio, 1992, p. 17-54.– BELLOSI, 1992c: Luciano Bellosi (éd.), Una scuola per Piero. Luce, colore eprospettiva nella formazione fiorentina di Piero della Francesca, (catalogued’exposition: Firenze, Galleria degli Uffizi, 27 septembre 1992 - 10 jan-vier 1993), Venezia, Marsilio, 1992.– BERTI, 1992: Luciano Berti (éd.), Nel raggio di Piero. La pittura nell’Italiacentrale nell’età di Piero della Francesca, (catalogue d’exposition: Sansepolcro,Casa di Piero, 11 juillet - 31 octobre 1992), Venezia, Marsilio, 1992.– AGOSTI Giacomo, 1993: Giacomo Agosti, “Longhi editore fra Berensone Venturi”, in Bernard Berenson, Roberto Longhi, Lettere e scartafacci.1912-1957, Cesare Garboli et Cristina Montagnani (éd.), Milano, Adelphi,1993, p. 231-251.– BELLOSI, 1993a: Luciano Bellosi, “Il ‘vero’ Francesco di Giorgio e l’artea Siena nella seconda metà del Quattrocento”, in Luciano Bellosi (éd.),Francesco di Giorgio e il Rinascimento a Siena 1450-1500, (catalogue d’ex-position: Siena, Sant’Agostino, 25 avril - 31 juillet 1993), Milano, Electa,1993, p. 19-89.– BELLOSI, 1993b: Luciano Bellosi, “La formazione fiorentina di Piero”,Città di vita, XLVIII, n° 6, novembre - décembre 1993, p. 513-529.– GAGLIARDI, 1993 (2001): Jacques Gagliardi, La Conquête de la peinture. Àl’aube de la Renaissance du XIIIe siècle au XVe siècle, Paris, Flammarion, 1993(édition consultée: Paris, Flammarion, 2001).– CALVESI, 1994: Maurizio Calvesi, “La ‘riscoperta’ moderna di Pierodella Francesca, il contributo di Adolfo Venturi”, in Maurizio Calvesi, Pierodella Francesca nel XV e nel XX secolo, Roma, Lithos Editrice, 1994, p. 55-60.– AGOSTI Giacomo, 1996: Giacomo Agosti, La nascita della storia dell’artein Italia. Adolfo Venturi dal museo all’università 1880-1940, Venezia,Marsilio, 1996.– BELLOSI, 1996: Luciano Bellosi, “Una testimonanzia su Dino Dini esull’Angelico a San Marco” in Daniela Dini (éd.), Gli affreschi del BeatoAngelico nel convento di San Marco a Firenze, Torino, Umberto Allemandi,1996, p. 19-28.– CASTELFRANCHI VEGAS, 1996 (1997): Liana Castelfranchi Vegas,Quattrocento, Milano, Jaca Book, 1996 (édition consultée: Quattrocento.La fin du Moyen Age et le renouvellement des arts, Paris, Desclée deBrouwer, 1997).– BELLOSI, GALLI, 1998: Luciano Bellosi, Aldo Galli, Un nuovo dipintodell’Angelico, (catalogue d’exposition: Torino, Galleria Antichi MaestriPittori, 24 octobre - 19 décembre 1998), Torino, Antichi Maestri Pittori,1998.– BELLOSI, 1998: BELLOSI, “Un nuovo dipinto dell’Angelico”, in BELLOSI,GALLI, 1998.
– GALLI, 1998: Aldo Galli, “L’assestamento dell’attività dell’Angelico:25 anni di studi”, in BELLOSI, GALLI, 1998.– MINARDI, 1998: Mauro Minardi, “Sotto il segno di Piero: il caso diGirolamo di Giovanni e un episodio di pittura di corte a Camerino”,Prospettiva, 89-90, janvier-avril 1998, p. 16-39.– BELLOSI, HAINES, 1999: Luciano Bellosi, Margaret Haines, Lo Scheggia,Firenze et Siena, Maschietto e Musolino, 1999.– BELLOSI, 1999: “Il Maestro del Cassone Adimari e il suo grande fratello”,in BELLOSI, HAINES, 1999.– DE MARCHI, 1999: Andrea De Marchi, “Problemi aperti su Squarcionepittore e sui romagnoli a Padova”, in Alberta De Nicolò Salmazo (éd.),Francesco Squarcione “Pictorum Gymnasiarcha Singularis”, (actes dejournées d’études: Padoue, 10-11 février 1998), Padoue, Il Poligrafo, 1999,p. 113-129.– MASSAGLI, 2000: Riccardo Massagli, “Baldassarre di Biagio del Firenzee Matteo Civitali pittore: qualche novità sulla pittura lucchese disecondo Quattrocento”, Arte cristiana, LXXXVIII, n°799, juillet-août 2000,p. 281-296.– PROTO PISANI, 2000: Rosanna Caterina Proto Pisani (éd.), Luce e disegnonegli affreschi di Andrea del Castagno, Livourne, Sillabe, 2000.– PAOLUCCI, 2001: Antonio Paolucci (éd.), Rinascimento. Capolavori deimusei italiani. Tokyo – Roma 2001, (catalogue d’exposition: Roma, ScuderiePapali al Quirinale, 15 septembre 2001 - 6 janvier 2002), Milano, Skira, 2001.– SCHMIDT, 2001: Victor M. Schmidt, compte-rendu d’August BernardRave (éd.), Frühe italienische Tafelmalerei, Stuttgart, Staatsgalerie Stuttgart,1999, The Burlington Magazine, CXLIII, n° 1182, septembre 2001, p. 572-573.– SGARBI, PAPETTI, 2001: Vittorio Sgarbi, Stefano Papetti (éd.), I pittori delRinascimento a Sanseverino, (catalogue d’exposition: San Severino Marche,Palazzo Servanzi Confidati, 28 juillet - 5 novembre 2001), Milano,Federico Motta, 2001.– BELLOSI, 2002: Luciano Bellosi, “Da Brunelleschi a Masaccio: le originidel Rinascimento”, in Luciano Bellosi (éd.), Masaccio e le origini delRinascimento, (catalogue d’exposition: San Giovanni Valdarno, CasaMasaccio, 20 septembre - 21 décembre 2002), Genève/Milano, Skira,2002, p. 15-51.– DE MARCHI, 2002: Andrea De Marchi, “Pittori a Camerino nelQuattocento: le ombre di Gentile e la luce di Piero”, in Andrea De Marchi(éd.), Pittori a Camerino nel Quattrocento, Milano, Federico Motta, 2002,p. 24-99.– MAZZALUPI, 2003: Matteo Mazzalupi, “Giovanni Angelo d’Antonio 1452:un punto fermo per la pittura rinascimentale a Camerino”, Nuovi studi.Rivista d’arte antica e moderna, VIII, n° 10, 2003, p. 25-32.– SCUDIERI, RASARIO, 2003: Magnolia Scudieri, Giovanna Rasario (éd.),Miniatura del ‘400 a San Marco. Dalle suggestioni avignonesi all’ambientedell’Angelico, (catalogue d’exposition: Firenze, Museo di San Marco,1er avril - 30 juin 2003), Firenze, Giunti, 2003.– SRICCHIA SANTORO, 2003: Fiorella Sricchia Santoro, “Jean Fouquet enItalie”, in François Avril (éd.), Jean Fouquet. Peintre et enlumineur du XVe siè-cle, (catalogue d’exposition: Paris, Bibliothèque nationale de France, 25 mars- 22 juin 2003), Paris, Bibliothèque nationale de France/Hazan, 2003,p. 50-63.– VOLPI, 2003: Marisa Volpi, “Longhi e l’arte contemporanea”, in ClaudioSpadoni (éd.), Da Renoir a de Staël. Roberto Longhi e il moderno, (catalogued’exposition: Ravenne, Logetta Lombardesca, 23 février - 30 juin 2003),Milano, Marzotta, 2003, p. 197-201.– CHRISTIANSEN, 2004: Keith Christiansen, “La Firenze di Fra Carnevalenegli anni quaranta del Quattrocento”, in Fra Carnevale. Un artista rina-scimentale da Filippo Lippi a Piero della Francesca, (catalogue d’exposition:Milano, Pinacoteca di Brera, 13 octobre 2004 - 9 janvier 2005; New York,The Metropolitan Museum of Art, 1er février - 1er mai 2005), Milano,Olivares, p. 39-65.– DE MARCHI, 2004: Andrea De Marchi, “Fra Carnevale, Urbino, leMarche: un paradigma alternativo di Rinascimento”, in Fra Carnevale.Un artista rinascimentale da Filippo Lippi a Piero della Francesca, (catalogued’exposition: Milano, Pinacoteca di Brera, 13 octobre 2004 - 9 janvier
150Studiolo 5 - 2007
NEVILLE ROWLEY “Pittura di luce”: genèse d’une notion
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 150
V A R I A
2005; New York, The Metropolitan Museum of Art, 1er février - 1er mai2005), Milano, Olivares, 2004, p. 67-95.– FILIERI, 2004: Maria Teresa Filieri, “Matteo Civitali e Baldassarre diBiagio “Pictores””, in Matteo Civitali e il suo tempo. Pittori, scultori e orafia Lucca nel tardo Quattrocento, (catalogue d’exposition: Lucques, MuseoNazionale di Villa Guinigi, 3 avril - 11 juillet 2004), Milano, SilvanaEditoriale, 2004, p. 79-93.– Fra Carnevale, 2004: Fra Carnevale. Un artista rinascimentale da FilippoLippi a Piero della Francesca, (catalogue d’exposition: Milano, Pinacotecadi Brera, 13 octobre 2004 - 9 janvier 2005; New York, The MetropolitanMuseum of Art, 1er février - 1er mai 2005), Milano, Olivares, 2004.– TEZA, 2004: Laura Teza, “Pittori a Perugia tra il settimo e l’ottavo decen-nio del XV secolo”, in Vittoria Garibaldi, Francesco Federico Mancini(éd.), Perugino. Il divin pittore, (catalogue d’exposition: Pérouse, GalleriaNazionale dell’Umbria, 28 février - 18 juillet 2004), Milano, SilvanaEditoriale, 2004, p. 55-71.– THIÉBAUT, 2004: Dominique Thiébaut, “La Provence”, in DominiqueThiébaut, Philippe Lorentz, François-René Martin, Primitifs français.Découvertes et redécouvertes, (catalogue d’exposition: Paris, musée duLouvre, 27 février - 17 mai 2004), Paris, RMN, 2004, p. 108-161.– KANTER, PALLADINO, 2005: Laurence Kanter, Pia Palladino, Fra Angelico,(catalogue d’exposition: New York, The Metropolitan Museum of Art,26 octobre 2005 - 29 janvier 2006), New York/New Haven/London, TheMetropolitan Museum of Art/Yale University Press, 2005.– MARCHI, VALAZZI, 2005: Alessandro Marchi, Maria Rosaria Valazzi (éd.),
Il Rinascimento a Urbino. Fra’ Carnevale e gli artisti del Palazzo di Federico,(catalogue d’exposition: Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 20 juil-let - 14 novembre 2005), Milano, Skira, 2005.– SYSON, 2005: Luke Syson, compte-rendu de Fra Carnevale, 2004, TheBurlington Magazine, CXLVII, n° 1223, février 2005, p. 135-138.– DI MAIO, 2006: Ippolita di Maio, “Qualche considerazione su un dipintonapoletano di Matteo di Giovanni: la Strage degli Innocenti di SantaCaterina a Formello”, in Cecilia Alessi, Alessandro Bagnoli éd., Matteodi Giovanni. Cronaca di una strage dipinta, (catalogue d’exposition: Siena,Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi, 23 juin - 8 octobre 2006),Asciano, Ali edizioni, 2006, p. 130-145.– ROWLEY, 2005a: Neville Rowley, “La Renaissance de Fra Carnevale”,Annali dell’Università di Ferrara. Sezione Storia, 2, octobre 2005, p. 87-111.– ROWLEY, 2005b: Neville Rowley, “Le ambiguità di Fra Angelico”,Prospettiva, 119-120, juillet-octobre 2005, p. 156-164.– ROWLEY, 2006: Neville Rowley, “La redécouverte de la couleur dansles peintures murales du Quattrocento: le fait des restaurations?”, inCouleur et Temps. La couleur en conservation et restauration, (actes de la12e journées d’études de la SFIIC, Paris, Institut national du patrimoine,21-24 juin 2006), Champs-sur-Marne, SFIIC, 2006, p. 53-65.– ROWLEY, à paraître: Neville Rowley, “La pittura di luce à Florence auQuattrocento: une lumière poétique ou scientifique?”, in DanièleJacquart, Michel Hochmann (éd.), Lumière et vision dans les sciences etdans les arts, de l’Antiquité au XVIIe siècle, (actes de colloque: Paris, Institutnational d’histoire de l’art, 9-11 juin 2005), à paraître.
151 Studiolo 5 - 2007
2-VARIA Studiolo 5 13/06/07 18:39 Page 151