Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation du décoratif In: Romantisme, 1983,...
-
Upload
u-bordeaux3 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation du décoratif In: Romantisme, 1983,...
Didier Coste
Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation dudécoratifIn: Romantisme, 1983, n°42. Décadence. pp. 103-117.
Citer ce document / Cite this document :
Coste Didier. Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation du décoratif. In: Romantisme, 1983, n°42. Décadence. pp.103-117.
doi : 10.3406/roman.1983.4680
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1983_num_13_42_4680
Didier COSTE
Robert de Montesquiou, poète critique : la cristallisation du décoratif
Bien qu'elle fût une querelle larvée plutôt qu'un débat aux termes clairement posés, ou peut-être précisément à cause de cela, la question de l'ornement était au centre des difficultés que l'esthétique de la période « Art Nouveau » se donnait à affronter dans ses diverses manifestations, un peu comme la mimesis au temps de Flaubert ou les questions de l'objet, puis du langage, tout récemment, ont servi à la fois de pôle de référence et de stimulant à la réflexion et à la production artistiques. Mais s'il est un personnage — et une œuvre — autour de qui, et en quoi, le magnétisme du décoratif s'est fait sentir, ses contradictions se sont manifestées et des solutions ont été pressenties, ce sont certes entre tous le personnage et l'œuvre de Montesquiou. Sans qu'il fût universel par son écoute du monde qui l'entourait, ni même par sa culture, ou moins encore par le rayonnement de son œuvre, nous le retrouvons, éclatant ou caché, à chaque pas de l'étude du « tournant du siècle ». Même ses lacunes, ses dédains, ses omissions sont significatifs de la réalité et des limites de l'Art Nouveau, coïncident avec les failles faute desquelles l'Art Nouveau n'eût pas été de son temps et n'aurait donc pu advenir, ni être dépassé. Si l'Ajt Nouveau, comme toute avant- garde sous le règne de la bourgeoisie, fut dans une large mesure isolé au sein de la culture dont il annonçait et préparait de plus complets bouleversements (exposé plus que vendu, comme les meubles de chez Bing), Montesquiou et son œuvre occupèrent au sein même de l'Art Nouveau une position similaire, celle d'un corps cataly tique qu'on retrouve intact à la fin de l'opération et à l'égard de qui il est donc logique que l'on sous-estime sa dette. Pourtant c'est après lui et non pas après Rimbaud que l'idéologie romantique appartient au passé.
S'agissant avant tout d'une tension théorisée comme celle de l'essentiel et de l'accessoire ou, en sens inverse, du texte et du prétexte, il est remarquable que Montesquiou en ait été en sa personne et en la réception de son œuvre la première victime, dans l'opinion de ses contemporains et des nôtres.
Au début de ses mémoires posthumes, Les Pas effacés, Montesquiou s'empresse de s'indigner que l'on en soit venu, à la suite de Dumas père, à ignorer l'historicité de d'Artagnan son ancêtre, lequel figure pourtant en bonne place, ce vaillant capitaine, dans l'historiographie du temps et les Mémoires de Saint-Simon. Va-t-on, ajoute-t-il, se demander un jour si Cyrano de Bergerac a vraiment existé ? Il ne croyait
104 Didier Coste
pas si bien dire, ou peut-être pressentait-il ce qui l'attendait lui-même ? Aujourd'hui encore (ou déjà) à peine le public lettré conçoit-il dans l'ombre de Charlus son existence. Le rôle de modèle étant historique, se prête par excellence à la manipulation théâtrale : un lieu commun de l'imaginaire. En foi de quoi il s'agit pour les érudits de déterminer le plan sur lequel se recouperaient le des Esseintes de Huysmans, le Muzarett de Jean Lorrain, le Paon de Rostand et le Charlus proustien, auxquels qui sait si l'on ne pourrait pas joindre avec quelque raison le vicomte de Passavant des Faux-Monnayeurs. Un tel portrait-robot ne serait pas d'ailleurs dépourvu d'intérêt ; peu ressemblant à un quelconque modèle, bien moins convaincant que celui qu'on obtiendrait en superposant les images signées par Whistler et Boldini, La Gandara, Doucet, Troubetskoy, Laszlo, Sem et Vallotton, il nous renseignerait sur les contours sociaux de la représentation.
L'attitude opposée, celle d'un biographe précis, ne vaudrait pas mieux tant qu'elle négligerait la qualité de grand « imaginifique » de Montesquiou, à l'égal de d'Annunzio, quoique à sa française façon. Alors la part belle faite au Montesquiou des salons, des fêtes et des rapprochements féconds, au maillon entre Loti et Mallarmé, entre Roussel et Proust, à celui qui fît connaître à Fauré des textes de Verlaine et monta la combinaison d'Annunzio-Debussy-Ida Rubinstein, doit lui être faite plus belle encore mais moins futilement. « Montesquiou a promulgué une façon de sentir et de vivre », a-t-on dit sur sa tombe (1). Oui, promulgué, or l'autorité qu'il se fît sans qu'on la lui reconnût volontiers, seuls ses écrits la font encore et peuvent témoigner de la vitalité d'une esthétique que « le goût entêté de la perfection », selon Lucie Delarue-Mardrus (2), ne figea pas. Il n'est d'autre façon d'« inventer » Montesquiou, comme Barrés souhaitait qu'on le fît (3) que de le lire. C'est ce qui est maintenant possible grâce à l'entrée dans le domaine public et à une réédition récente (4). Nous allons, trop rapidement, le tenter autour de deux axes de réflexion (l'espace, le temps) et du langage qui parcourt leurs chevauchements. Ainsi s'esquisserait une approximation du plus grand commun déterminant.
Le premier ensemblier
Une judicieuse distinction entre environnement vital (écologique, si l'on veut) et simple enveloppe ou emballage, eût évité bien des contre-sens fâcheux sur Montesquiou, sur Loti, et d'autres. Le goût de l'apparat chez le premier, du travestissement chez le second, les ont ridiculisés et fait taxer de « superficiels », sans qu'on s'interroge sur le sens profond de cette surface. Or on ne doit jamais se laisser abuser par le changement de perspective que nous impose la muséifîcation de l'Art
(1) Lucie Delarue-Mardrus, dans Montesquiou, Les Pas effacés, Émile-Paul, 1923, t.HI,p.3O2. (2) Ibid. (3) Voir Philippe Jullian, Robert de Montesquiou, un prince 1900, Perrin, 1965, p.269. (4) Montesquiou, Les Hortensias bleus, introduction par D. Faye-Patry et B. Tara- vant, coll. « Les Pâmés », Ed. des Autres, 1979.
Robert de Montesquiou, poète critique 1 05
Nouveau, remettant en quelque sorte « à l'endroit » ce que celui-ci avait pris à cœur de renverser : dans l'Art Nouveau, l'extérieur est vu de l'intérieur et il en est le garant. Ainsi en est-il de Loti qui s'admire comme effet dans le paysage ; on pourrait en dire autant de Marcel qui projette sur sa destinée l'ambiguïté de la destination, les affres et la solution d'un problème géographique imaginaire. Mais Montesquiou lui-même opère, aussi manifestement que Mallarmé, le retournement de la position romantique. C'est l'une des majeures découvertes de sa modernité que la substitution par lui du génie du lieu au lieu du génie, en quoi il s'oppose diamétralement à Barrés toujours en quête, à Ai- gues-Mortes, à Tolède et partout, de ce qui du dehors dicte l'action, voire l'être. Il définit lui-même son identité : « ce genius loci que chacun est, et se sent très bien être dans le lieu de son âme » (5). Image facile ? Certes non, mais vérité décisive pour peu que l'on tienne compte des mille signes concurrents se résumant en un axiome unique : vivre, c'est habiter (et réciproquement). Sûr témoin, la table des Pas effacés dont les sections couvrant la plus grande part d'une vie d'adulte s'intitulent : « Mes demeures » (400 pages, près de la moitié de l'ouvrage) et d'autres : « Mes berceaux », « Mes prisons », « Voyages immobiles », tandis que le premier volume, consacré aux ancêtres, s'obsède aussi de topographie et prend la forme d'une galerie. D'ailleurs, le Gnôti seau ton de Montesquiou consiste à trouver, articulant ses complications, « une symétrie et des lois secrètes » (6).
Montesquiou avoue volontiers la « manie » qui l'a « tenu » toute sa vie : « la fureur des arrangements décoratifs, des appartements ornés, des installations magnifiques » (7). Le ton de l'activité (la fureur) et ses moyens (la magnificence) sont les deux seules concessions, toutes de surface, si j'ose dire, qu'il fasse à des Esseintes, pour rectifier aussitôt, en des pages décisives, le sens de sa recherche :
« II me faut bien chercher et, j'espère, découvrir, à cet emploi de mes facultés, un mobile plus respectable que celui d'agencer des formes et de combiner des couleurs, d'assortir des tentures et de ranger des meubles ; ce serait rentrer dans le genre 'tapissier' qui ne vise pas bien haut et s'arrête bien vite (8). »
Des Esseintes fixait au plus près, sur ses murs et ses plafonds, le couvercle de son spleen, ou les couvercles, semblables à des hémisphères de Magdebourg, de son vide intérieur. Des Esseintes n'existait qu'en creux dans un monde qu'il devait s'interdire parce que remplir le vide intérieur, sa seule réalité, eût été annuler sa propre existence, et il dépérissait cependant, buté aux parois de la création, et de la Création : image profondément catholique d'une humanité séparée de son Dieu par une différence de pression que seule peut abolir la mort — ou la conversion. Tandis que l'agnostique (versant athée) Montesquiou ne se bâtit pas une retraite, il élabore son propre statut de résident et s'installe (« J'installe
(5) Les Pas effacés, t.II, p. 1 0. (6) Ibid., p. 9. (7) /&«/., p.88. (8) Ibid.
106 Didier Coste
par la science / En l'œuvre de ma patience »). Mais surtout, de même qu'entre les arts du langage et les arts plastiques (9), il sait trouver dans la querelle des décorateurs anciens et des modernes une voie moyenne appelée à survivre aux modernes eux-mêmes et à grandir sur leurs décombres, entre le désespoir servile de la copie et le désespoir promé- théen de la création : c'est l'arrangement, la composition, qui devait être la panacée indifféremment de Valéry, Claudel, Proust et Gide, et jusqu'à la nôtre, structuralistes que nous sommes tous, peu ou prou.
On connaît les plaies de l'art décoratif français au XIXe siècle, dont la principale fut l'imitation ou, pire, la reconstitution, quasiment paléontologique ; elle affligea tout autant l'architecture et, s'il avait laissé libre cours à ses talents d'ingénieur, Viollet-Leduc nous eût peut-être légué mieux que fonds de scène pour visiteurs du soir. De 1850 à 1900, sinon les meilleurs esprits, du moins les plus intéressés à l'image de marque des produits nationaux, ne cessèrent de s'en plaindre. Le rapporteur du jury du meuble à l'Exposition Universelle de 1889 s'écriait: « combien il est regrettable que nos ébénistes [...] ne nous délivrent pas de la constante imitation des temps passés » (10). Cependant le règne exclusif du plagiat et de ses dérivés contenait en germe l'un de ses plus sûrs antidotes : comme un seul déguisement ne peut faire longtemps fureur, il conduisait à l'éclectisme historique. Le Henri II ou le Louis XIII ne pouvant guère prétendre succéder au Louis XV, comme les styles s'étaient jusque là remplacés, on aboutissait à la juxtaposition de toutes sortes de décors, authentiques ou faux et diversement archéologiques, auxquels s'ajoutait l'éclectisme géographique des bibelots, dû au second investissement colonial du monde et au pillage qui l'accompagnait. Pour échapper au chaos et au pur bric-à-brac (fût-il d'art, le mot blesse Montesquiou), pour animer et personnaliser ce répertoire très vaste mais apparemment fini de formes et de matières, il fallait recourir à une notion neuve, différente de la traditionnelle collection : l'arrangement, et donc au personnage englobant qu'on ne devait pas tarder à appeler un « ensemblier ». Montesquiou, sans négliger ce qu'il devait à l'exemple précurseur des Gon- court, fut le premier des ensembliers. Entre le fatras de turqueries sans usage rapporté chez soi par le grand-père Montesquiou, ou les vrais magasins d'accessoires qu'étaient sous Napoléon-le-Petit beaucoup d'ateliers d'artistes, et le culte de la composition où se rencontreront nos presque contemporains Saint-John Perse et l'Aragon de La Mise à mort, il y a eu Montesquiou, mais aussi, peu avant lui, et assez ingénument, le narcissisme efficace de telle personnalité qui conférait à son décor de brocante sa propre unité intime, celle de ses fantasmes, par exemple Sarah Bernhardt. On remarquera aussi que la carrière d'un décorateur professionnel, on pourrait dire du décorateur
(9) « Ma voie se préparait ailleurs, dans des chemins limitrophes mais non frayés, dont je repérais le tracé un peu à tâtons, mû par un instinct irrésistible et mystérieux, pareil à celui qui fait subir par les flots l'influence d'un astre » {Ibid., p. 89). (10) Voir Gabriel Mourey, Essai sur l'art décoratif français moderne, OUendorff, 1921, p. 5.
Robert de Montesquiou, poète critique 107
par excellence, que fut Eugène Grasset, a suivi des lignes semblables à celle de Montesquiou (11).
Bien que Montesquiou ait patronné Galle, passé des commandes à Lalique et se soit lié avec tant d'autres représentants de l'Art Nouveau français inventeur de formes, le souci de la forme originale particulière n'a pas été son souci dominant mais, à travers et sous la mode, son essence décorative, la volonté que les formes définissant et occupant un espace soient belles ensemble, invitent à demeurer ici, en leur ensemble, et à le parcourir de tous les sens. L'article sur « le mobilier libre » de Bing (12), significativement, défend l'Art Nouveau au nom de la tradition du nouveau, en accolant d'emblée un vers de La Fontaine (« II me faut du nouveau n'en fût-il plus au monde ») à celui de Baudelaire sur le même sujet. Il le défend non pas avec un éphémère engouement mais pour sa fécondité de révolution décorative plus que pour ses réalisations actuelles.
A l'unité décorative on va par deux voies. La première, commune à la sédimentation de tout style, considère l'objet lui-même :
« Ainsi peuvent passer pour non avenus, en tant que réussites définitives, bien des objets exposés à l'Art Nouveau, que justifie pourtant leur qualité de précurseurs, d'annonciateurs de ceux qui viendront, dégagés de gongorisme ou de pauvretés, quand tant d'éléments hybrides et hétérogènes et d influences étrangères se seront répartis en un objet ou fondus en un style (13). »
La seconde voie s'applique à la coexistence d'objets de toutes époques et de toutes provenances :
« L'art de l'ameublement consistera donc au moins autant dans le groupement subtil et disert de ces choses, en apparence disparates [...], que dans les nouvelles créations [...] Ce n'est sans doute pas par la forme variée jusqu'à l'épuisement que brilleront les meubles d'un nouveau style (14). »
Pourquoi ?
« Les éléments d'innovation dans le meuble seraient la couleur, doucement dosée — et surtout quelque chose de symbolique et de pensif, de par le décor variant et commentant un texte, une idée (15). »
On atteint ainsi, insensiblement, le point capital, orchestrant et généralisant ce que signifiaient de leur côté les meubles-poèmes de Galle, bien loin des marqueteries architecturales de la Renaissance : l'écriture et la décoration deviennent idéalement une seule et même activité. Aux antipodes de l'illusion : la signifiance.
(11) Voir Mourey, ouvr.cit., p.64 et suiv. ( 12) Montesquiou, Roseaux pen «mři, Fasquelle, 1897, p. 157 à 166.
3 p (14) Ibid., p. 164-1 65. (15)/Ш.,р.165-166.
108 Didier Coste
« [...] rien que le style du rêve, enchaîné par l'association des idées [...] Je tiens de telles fantaisies murales et mobilières pour des écritures, à la fois littéraires et musicales ; on retrouvera ces idées dans les poésies que j'ai dites, qu'elles me suggéraient (16). »
La tentation de l'idéogramme et du pictogramme qui contribue à faire du Coup de dés la pierre angulaire de la littérature moderne et à laquelle Apollinaire, voire Claudel, puis les surréalistes allaient bientôt laisser la bride sur le cou, était l'extrême aboutissement formel de ce que certains appellent encore le Symbolisme. Elle est présente, réprimée mais consciente, dans une part appréciable de l'œuvre poétique mais aussi de l'œuvre critique (qu'il aurait pu légitimement, avant Cocteau, appeler « Poésie critique ») de Montesquiou ; elle donne en tant que telle, reconnue et contenue, ses meilleures pages. Pour lui, donc, répétons-le, l'écriture a lieu, au sens le plus fort, elle fait et tient lieu. Il n'y a pas d'espace préexistant ; on ne considère l'espace comme matériau, à un certain point de départ, que pour simplifier ; il n'y a pas d'espace naturel en littérature, et les métaphores spatiales filées, au premier abord naturelles, sont reversées, comme par Proust, à l'espace littéraire.
Un bel exemple dans l'article sur Mallarmé, au titre révélateur de « La porte ouverte au jardin fermé du roi », emprunté certes à l'alchimie mais écrivant un espace déjà blanchotien, que seule l'écriture pouvait commettre :
« Qui sait si l'actuelle incompréhension ne maintient pas ainsi les poésies de Mallarmé comme des réserves de langage, pareilles à ces névés de neiges éternelles [...] Un jour ainsi, quand le courant de la littérature incolore aura emporté et dissipé toutes les idées-mères, on verra fondre et se dissoudre ce langage saturé de concepts, dont la quintessence redonnera du ton aux veules phraseologies. Je ne disconviens pas qu'un cataclysme de bibliothèque n'y soit peut-être nécessaire ; quelques suppressions, par des incendies de librairie, secondés par des disparitions de texte [...] » (17).
Admirable compréhension de Mallarmé, d'avoir saisi le poids propre et la richesse d*un anti-contexte, d'un contexte de manque, mais aussi image combien proche de celles développées par Michel Butor dans son article sur « La critique et l'invention » ( 1 8) et par Philippe Sollers dans le rêve initial de Drame. Les idées décoratives de distribution, d'assemblage, d'assortiment, s'appliquent désormais à tous les niveaux : de celui des mots dans la phrase à l'œuvre entière d'un écrivain dans la paroi de la bibliothèque universelle. On ne peut manquer d'être frappé du souci d'ordonnance formelle que manifestent par division en parties et sous- parties pourvues de titres, alternances, disposition en forme de, etc., des recueils de poésies thématiquement et stylistiquement disparates de Montesquiou tels que Les Paons ou Le Chef des odeurs suaves. C'est
(16) Montesquiou, Les Pas effacés, t.II, p. 1 1 2. (17) Montesquiou, Diptyque de Flandre, Triptyque de France, Chiberre, 1921, p.224. (1 8) Michel Butor, Répertoire III, Minuit, p.8.
Robert de Montesquieu, poète critique 1 09
qu'il y a symbiose du texte et des objets contextuels en leur précise disposition, et que le jeu des échanges constitue la vie (et la survie) et du texte et du prétexte. On ne peut rompre cette disposition décorative sans briser la magie et tout anéantir.
Le poème «Le coucher de la morte », le plus (mais si peu) répandu des poèmes de Montesquiou, illustre à merveille ce qu'on vient de dire :
« Un jour qu'elle sentit que son cœur était las, Voyant qu'il lui faudrait mourir à cette peine, Elle fit travailler une bière d'ébène, Et disposer au fond de riches matelas.
Pour qu'ils fussent moelleux, elle les fit emplir De tous les billets doux dont on l'avait lassée ; Dans la chambre on les fait apporter par brassée, Et bientôt le tapis s'en voit ensevelir.
Longtemps on en bourra les coussins de linon ; Sans trêve on les tassa dans les grands sacs d'étoffe ; Parfois on voyait luire, au passage, des strophes, Parfois, à la volée, on démêlait un nom... » (19).
On note, à la volée, comme le confort perpétuel de la beauté justifie la prolixité littéraire, le remplacement des fleurs par des lettres (apportées par brassée), la position intermédiaire et médiatrice de celles-ci entre le corps de beauté, qu'il s'agit d'embaumer, et les parois décorées (une bière travaillée) qu'il habitera ; enfin l'intime relation, voire la confusion, entre les poèmes et les éléments traditionnels du décor : le tapis d'abord enseveli sous eux, puis les strophes qui luisent, comme une porcelaine ou un satin, et le nom qu'on démêle, comme un ruban. La catachrèse du « tombeau » poétique est ici exposée et exploitée dans toute sa littéralité.
« Et quand les érudits et les archéologues Ouvrirent le tombeau de cette Tahoser,
La Morte, par mille ans de ténèbre arrosée, Dormait sans une atteinte et sans une douleur ; En sa couche d'amour on eût dit une fleur Que de loin vivifie une ancienne rosée... » (20).
Le verbe fleuri a maintenu en fleur la femme-fleur, aussi bien faite fleur par le verbe qui la fleurit. Attention ! Il ne faut pas y toucher :
« Mais quand du divin socle ils la firent descendre, Pour chercher du secret l'invisible filon, Ce qui reste du vol saisi d'un papillon Leur filtra dans la main en lumineuse cendre (21). »
(19) Montesquiou, Les Chauves-souris (1893), éd. définitive, G. Richard, 1907, p.463. (20) Ibid. ,p.465. (21) Ibid.
110 Didier Coste
II faut certainement y voir un avertissement à ceux qui veulent « démonter la magie » de la poésie, mais mieux vaut ne pas le prendre en un sens primaire : plutôt, le poème ne doit pas s'expliquer par une référence, mais être pris dans son entièreté et traité avec le respect qu'implique une lecture, une écoute poétique. En effet, les billets qui avaient jusque-là conservé la morte en « immarcessible lys », « étaient les espoirs et les désirs d'un jour / Qui reprenaient de loin leur tendresse finie » (22). La ressemblance de la Muse à qui le « murmure d'amour » qui l'entoure assure l'éternité tant qu'il n'est pas dérangé, avec le poète dont la production est favorisée ou même assurée par la transmutation osmotique de son décor, comme le montrent les poèmes de « Céans », vaut ainsi non seulement dans l'ordre de l'espace, mais dans celui du temps, car il n'y a d'éternité que dans l'arrangement qui fixe l'éphémère et rend présent le lointain. L'éphémère, rendu au temps, tombe en poudre.
Le souverain des choses transitoires
L'espace était encore une portion réalisable de l'infini organisé légué par Galilée, Copernic et Newton ; Einstein n'était pas venu jeter le discrédit sur lui et en faire « une de nos notions ». Par contre, le « suspends ton vol » romantique était resté sans effet ; tandis que les derniers élégiaques (Albert Samain, Charles Guérin) poussaient encore de faibles plaintes, les modernes allaient reprendre au bond l'écho et s'installer dans la sécurité offerte — provisoirement, mais on ne le savait pas — par l'espace. L'autre attitude romantique vis-à-vis du temps, qui consistait non pas dans l'injonction magique, et stérile, aux tons de prière, mais dans un espoir de maîtrise correspondant à la croissance capitaliste (le temps fait partie de la nature, force qui, même hostile, doit pouvoir être conquise, et il peut aussi accumuler des intérêts composés, Eugène Sue l'a prouvé) et prolongeant l'illusion encyclopédique, l'attitude donc qui, de La Légende des Siècles à Leconte de Lisle en passant par La Chute d'un ange, avait remis en honneur l'épopée, se trouvait également condamnée. Seuls quelques socialistes tels que Verhaeren, quelques utopistes tels que René Ghil, attendant la fin de l'histoire, tenteront timidement de renouer avec elle. L'heure est au lyrisme individuel. Le temps demeurait l'ennemi de l'individu, et en particulier du poète (successivité de la lecture). Les deux procédés qui restent pour l'attaquer sont l'un tactique, voire logistique (on adapte, on améliore ses armes en accordant une plus grande attention à la technique musicale), l'autre stratégique : diviser pour vaincre, diviser le temps jusqu'à l'unité minimale de l'instant pour, dans un poème minimal, la lui soustraire. Tout se passe donc comme si l'affermissement de l'espace littéraire, l'illusion perspectiviste spatiale, permettait de décomposer et de renier la « perspective » temporelle. La continuité devient celle du changement, la tradition, celle de dissembler, s'annu- lant elle-même :
(22) Ibid., p .464.
Robert de Montesquieu, poète critique 111
« toute l'apologétique à l'usage des savants et des artistes, des inventeurs, est composée de ces mots qui les assimilent à des pionniers ou à des vigies, décernant de ce fait le titre de nouveaux aux mondes qu'ils nous révèlent » (23).
L'instant ainsi conçu a une existence paradoxale, il naît sur fond de passé mais par détachement de la durée. Montesquiou aimait à citer « le joli mot du Prince de Ligne : 'En amour, il n'y a que les commencements' », sans l'appliquer, bien sûr, à l'amour — sa tombe auprès du Chancelier de Fleurs en témoigne. L'instant doit son éclat, sa préciosité, à la matière temps dont il est fait mais ne s'identifie que par abstraction, comme la robe en rayons de lune de Peau d'Ane ; la formule alchimique recherchée par Montesquiou et tout l'Art Nouveau est celle qui isolerait du cours qui la fonde et sans la faner, la valeur du temps (que l'instant symbolise) ou qui, en termes kandinskiens, résumerait la ligne dans le point. Le temps, vecteur du changement, est hostile à l'homme parce que l'homme n'a pas de prise sur lui, parce qu'il file à une vitesse constante, immuable ; mais, si l'on admet que l'on puisse le contracter dans l'instant, l'action inverse sera à son tour possible, l'expression de l'instant dans une durée sans limite, sans commencement ni fin, l'éternité, durée « arrêtée » parce que spatiali- sée, parcourable en tous sens, réversible comme le texte moderne, multiplement pluriel, dont parle Roland Barthes dans S/Z. Le point, étrangement, procure le plan, en tous cas l'identifie, ce qu'on peut observer souvent dans le graphisme Art Nouveau, chez Beardsley notamment.
Chez Montesquiou l'éternité de l'instant a recours à trois catégories thématiques principales : le fragile, le figé et le fossile. Il les partage avec Mallarmé mais les valorise différemment, d'autant qu'elles forment chez lui une série continue.
Le fragile, l'éphémère par excellence, que distille la partie intitulée « Demi-teintes » des Chauves-souris, est le domaine de l'aérien, tel « le souvenir dans les airs / D'un passage de concerts » (24), des créatures volantes, des parfums et, par-dessus tout, d'une rose qui s'effeuille :
« Rien de plus lourd ni plus grave Que l'attachement suave, Impondérable et subtil Du pollen pour le pistil- Tout ce qui fut diaphane Et délicat, - et se fane (25). »
La rose est emblématique même si, parfois, durant « un siècle de douze heures », le poète trouve sa vie naturelle encore trop longue à son goût. A l'humble, longue, profonde vision de la femme-rose ronsardienne que prolongeait et troublait le spectre de la vieillesse, Montesquiou oppose
(23) Roseaux pensants, p. 1 58. (24) Les Chauves-souris, p. 39. (25) Ibid.
112 Didier Coste
l'entrevision, au passage, de la rose-souveraine. Racontons, à la clé de cette esthétique, extraite des Paons (26), l'« Histoire d'une rose ». Une reine, en sa promenade au bois qu'elle ne veut ralentir, aperçoit une rose qu'elle cueillera au retour pour l'avoir plus fraîche ; en attendant, elle place un gardien auprès de la rose, mais l'oublie au retour ; la rose se fane, les gardiens qui ne gardent plus rien se succèdent ; la révolution gronde, on va guillotiner la reine et l'ordre n'est pas feint
« De la mener mourir, en l'affreuse journée... Et son sang coule, et c'est la rose de jadis Que sa tête qui tombe, effeuillée et fanée, Par qui les mots, sur l'autre rose, furent dits.
— Mais c'est un ordre exprès qu'un mot de souveraine, Son vœu fragile dure au-delà du malheur ; Et nous veillons encore le spectre de la Reine Qu'ordonne de garder le spectre de la fleur. »
La rose est adroite, qui réalise un subtil paradoxe. Se vengeant de n'avoir pas été cueillie, donc de la durée, déclinante et vaine, qu'on lui a infligée, elle fait accomplir par la Reine son destin manqué ; or, si la Reine devient ainsi, par sa mort, Rose, la Rose devient Reine à son tour en répétant Tordre qui fut donné à son sujet ; mais cet ordre est transfiguré, redressé par la mort, car la mort, elle, est bien à garder, non la vie. La vengeance de la Rose est en vérité un pardon, ou plutôt une faveur, une leçon aussi : urgente est la mort pour que de la mémoire se lève l'hyperbole. Sans doute, contrairement à Mallarmé, « effleuré par l'oiseau qu'il éclaire », Montesquiou, sonneur, ne gémit pas de n'entendre « descendre à lui qu'un tintement lointain » (27), et il ne salue pas encore l'autonomie du texte. L'éternité conquise sur l'éphémère et par sa dissipation doit être aussi délicate que lui, tous les matériaux ne sont pas bons. Cependant on aurait tort de s'exagérer l'importance de cette opposition, comme le montre un commun traitement du thème de l'éventail :
« L'Éventail est une aile au bout d'un geste pâle, [...] Et lorsque vous frappez légèrement le Rêve Qu'attiraient, du lointain, vos lèvres de corail, Peut-être que, là-haut, dans l'Espace, il s'achève Aux infinis, où l'a repoussé l'Éventail (28). »
Sans doute est-on encore en partie dans la communication universelle et presque dans la communion des saints. L'infiniment ténu, l'infîni- ment léger, l'éventail comme les « squelettes de roitelets », est sûr moyen de communication avec l'Infini. Les oiseaux de l'Art Nouveau n'ont pas à se cacher pour mourir. Mais c'est une position essentielle-
(26) Montesquiou, Les Paons (1901), éd. définitive, G. Richard, 1908, p.228-229. (27) Mallarmé, « Le Sonneur », Oeuvres complètes, Pléiade, p. 36. (28) Montesquiou, Les Paons, éd.cit.,p.\ 19.
Robert de Montesquiou, poète critique 113
ment irréligieuse qui investit de la plus haute dignité les choses humaines à proportion de leur vanité, et il faut ajouter surtout à cette gloire de la vanité la contrepartie qui l'explique : l'éventail bat, il va et vient, il est versus, il se répète. La répétition est le mode de vie favori du décoratif, ce qui engage le fragile et l'éphémère dans un processus de duplication salvateur, par lequel la continuité est le fruit de l'interruption.
Ce n'est pas à dire que l'esthétique d'une période aussi transitoire, reposant sur le paradoxe, puisse ou veuille s'épargner les antinomies : face à l'oiseau, il y a la chauve-souris, volatile sans légèreté, et, face à la rose, l'hortensia, qui n'a pas d'odeur et ne se fane pas. Ils représentent la tentation de l'abstrait, à l'autre bout de la gamme, cette autre forme d'immortalisation de l'instant qu'est le fossile, mais entre les deux réside peut-être le plus intéressant : le figé.
Si le fragile, aérien, capitalisait dans l'instant sur l'évanescence — l'éventement, la disparition -, le figé, touchant le fluide, éternise le changeant, l'instable, l'écoulement :
« Mais, dans son compliqué méandre si Ton erre, On aura des couleurs et des parfums figés, Des rayons assoupis, des mirages rangés, La versatilité faite stationnaire (29). »
La glace, qui emprisonnait le cygne mallarméen, n'est pas douloureuse à Montesquiou, qui compare l'œuvre du Maître justement à un glacier lent dispensateur de fertilités, mais, s'il se manifeste encore dans la laque et les émaux, c'est dans le verre que le figé se réalise le plus pleinement. Un mouvement qui n'était pas originaire, mais par lequel le feu a fait de l'eau, s'y trouve pris :
« Galle prince du verre et prêtre du vitrail, [...] Qui vas pilant du spath et filant du corail [...] Tu produis de l'onyx, ou du jade [...] Puis, tu mêles ensuite à cette pierre dure Comme des pleurs de lune ou des feux de soleil (30). »
Le verre donne forme à l'informe, mais il y ajoute « les reflets, échos des formes » (31), empêchant celles-ci, en les démultipliant, de devenir contraignantes. Le figé est ce qui a d'abord fléchi et qui détient pour nous, en réserve, une ductilité première, car « le charme des objets, des émaux et des laques / A notre émotion actuelle se ploie » (32). Le décoratif ne dicte pas l'émotion, il s'y prête en la réverbérant ou lui prête son prisme. Montesquiou cite dans Roseaux pensants (33) un vénérable livre où le verre est appelé « métal transparent », celui en vérité d'une clé qui nous ouvre les murailles pour revenir ici. De même qu'il est
(29) Montesquiou, Les Chauves-souris, éd. cit., p.32. (30) Montesquiou, Le Chef des odeurs suaves (1893), éd. définitive, G. Richard, 1907, p. 110-111. (3 1 ) Les Chauves-souris, p. 39. (32) Le Chef des odeurs suaves, p. 102. (33)P.177.
1 14 Didier Coste
concentré de voyage, le verre est contraction de temps, et les deux axes se réunissent dans la coulée :
« De Galle, ses fauves coulées De couleur au cœur du cristal, Et ses belles bulles moulées
Métal (34). »
Le liquide, lui-même déguisé en solide, habille et emprisonne l'aérien, la bulle, figure entre toutes fugitive de l'instant. Le verre se dit ici pour le vers, de Montesquiou qui « conserve surpris ce qui n'est qu'un moment » (35). Ce qui ne peut se faire qu'en préservant à la surface les signes du transitoire — ainsi la mode : « De Tiffany, ses chiffonnages / D'émail à l'argent mélangé » (36) — ni sans retrouver au terme du processus de conservation la fragilité même qui l'a motivé :
« Appliqué toujours plus à noter les sveltesses, Et les exquisites, et les délicatesses, Si de mon fin labeur, quelque jour, un fragment Se retrouve, qu'il soit tel un éclat charmant De verre de Venise [...] [...] où la cassure en l'épaisseur fait luire Comme l'arrêt laiteux d'un courant irisé » (37).
L'organique, le féminin du travail se retrouve dans le minéral travaillé. La coupe révèle, comme en l'éventail mallarméen, un « blanc vol fermé », un « rire enseveli [...] /Au fond de l'unanime pli ! » (38) Le figé est un état-limite du fragile qu'il prend comme il est pris, éternité transitoire, entre deux de ses moments. Extrême ralenti d'une agonie, étalement du ténu, il est le siège d'une infinie fragmentation qui délivrera, en la rendant non au temps mais à l'éternité pure, la définitive brisure. Dans le miroir complaisant, dans le miroir heureux de Montesquiou, plutôt que de la cendre, c'est un peu d'invisible poudre d'or qui redescend.
On voit cependant que, du siècle de douze heures de la rose aux « nobles réussites dont nous sont seuls révélés les résultats polis et l'on dirait aisés » (39), la concentration du temps n'est pas achevée. Il reste à trouver une éternité d'instant cristallisé qui restitue à l'infini, répétés à volonté, des instants enivrants « l'arôme alambiqué / Comme un bouquet vivant de vieilles violettes » (40), c'est cette éternité étymologique que j'appelle fossile, car elle a lieu dans les pierres, témoins d'un temps, d'un choix non humain (le rare quantitatif s'y substitue à l'éphé-
(34) Montesquiou, Les Hortensias bleus (1896), éd. définitive, G. Richard, 1906, p.147. (35) Les Chauves-souris, p. 31 . (36) Les Hortensias bleus, p.147. (37) Le Chef des odeurs suaves, p. 103. (38) Mallarmé, O.C., p.58. (39) Roseaux pensants, p. 179. (40) Les Chauves-souris, p.3 1 .
Robert de Mon tesquiou, poète critique 115
mère avant de la reproduire), et dans les produits humains qui représentent, incorporent les pierres ou sont métaphoriquement tels.
La pierre, éternité détentrice de l'instant, boucle la boucle en fournissant le corollaire et l'antithèse de la rose, instant détenteur d'éternité. Le nom de Lalique, pierre lui-même, le trahit : « Lalique, sonorité cliquetante et rimant bien à relique » (41). « Maître des irisations et des chatoiements », l'orfèvre réalise une œuvre dans laquelle la compression de l'espace redit la concentration du temps : « Troie en ignition dans un flamboiement d'opale » (42), ou bien c'est le labrador « tout plein d'ailes de papillons pétrifiés » (43). Ainsi la pierre précieuse désigne-t-elle ce qui demeure de narratif dans la poésie lyrique et, bien qu'elle marque un saut qualitatif dans la série thématique, elle n'en rompt pas la continuité, bien au contraire : « L'Art des ruissellements d'irradiations, / Nul autre que Moreau ne sut ce qu'il déferle » (44), écrit Montesquiou de celui qu'il appelle ailleurs le lapidaire. Le flux infiniment divers du vivant périssable peut se transporter sans perte dans la concision grâce à la résonance de la connotation, aux multiples facettes du signifiant prismatique. N'est-ce pas de diamants aussi que l'on fait des rivières ? Comme Léon Frédéric en faisait de corps d'enfants. La combinaison, par l'orfèvre, des pierres en une parure ou, par le peintre, des couleurs sur la toile, suscite un mouvement qui à jamais vient de s'arrêter, semblable à l'instant parfait de la danse qui fascinera Valéry, non point parcours mais suspension de « la Salomé qu'arrête une stupeur de sang » (45). La pierre qui n'est pas plus que la danseuse causée détient pour potentiel toutes les mutations. Il ne faut pas prendre pour un banal compliment ces vers : « La pierre vive dont l'âme fut éblouie, / Ce fut la Salomé, la Fuller, la Lofe » (46). Trois faces par le nom pluriel, faces multiples dans la série vocalique ; l'éclat est inconcevable sans le rythme qu'il ne fait que porter à son paroxysme en le résumant. Il n'est donc nullement contradictoire que Moreau, peintre de l'hiératique, ait été aussi, et peut-être avant tout, peintre de ciels, car les ciels, éternels instantanés, exaltent et résorbent tour à tour le factice du mouvant : « Et fleurs feintes, et plumes fallacieuses, escarboucles mensongères, s'engloutissent dans le sourire coupé de l'horizon, qui se referme comme les deux lèvres d'une plaie » (47) ou d'un écrin.
Il y a une explication presque historique de ce succès, si c'en est un : l'œuvre de Moreau est le « refuge des Dieux », de tous les Dieux, elle est la demeure des maîtres d'un avenir révolu, de même que les pierres précieuses sont porteuses de sorts, qu'il ne faut plus croire, qui ne veulent plus rien dire que leur ambiguïté. Sortilèges ou maléfices ? Qu'importe, s'ils sont les uns et les autres inefficaces ? Si, il importe, car la vraie valeur est ce qui passe entre deux sens antinomi-
(41) Roseaux pensan ts, p . 1 69 . (42) Ibid. (43) Ibid., p.m. (44) Les Paons, p. 11. (45) Ibid. ,p.78. (46) /bit/., p. 195. (47) Montesquiou, Altesses sérénissimes,Juven, 1907, p. 39.
116 Didier Coste
ques et vides, étincelle gratuite entre une double gratuité. Définition de l'image poétique, modernité déjà surréaliste d'un sens dépourvu d'en- soi, qui n'est que rencontre ? Sans doute, mais aussi définition de l'esprit (de l'humour) qui est essentiellement de la même nature, opérant, Freud l'a montré, à un haut degré de figuralité. L'esprit joue non seulement dans la biographie mais dans l'écriture de Montesquiou un rôle absolument central ; si on l'en séparait ou le négligeait, on se condamnerait à mécomprendre non seulement l'œuvre de Montesquiou mais la plupart de ses contemporains. On a par exemple trop tôt fait d'assigner au rire mallarméen la figuration du seul désir (sexuel), car il est aussi, comme chez Montesquiou, la bonne humeur de Cratyle, l'éclat qui fusionne le sémantique et le phonétique et résulte de la cristallisation des inconciliables venus de la nuit du langage ; il copule, par la nécessité irresponsable du fait accompli, des forces verbales qui ne s'étaient pas encore identifiées, un magnétisme encore inconnu parce que jusque là de part et d'autre sans objet adéquat : « J'immobiliserai ce qui vibre un instant : / L'arc en ciel qui s'efface à peine qu'il se bande » (48).
L'esprit, tout autant que la notation poétique, réalise ce vœu, car, selon qu'on le considère, il est à la fois trait et pierre (lapidaire), « Surgi de la croupe et du bond / D'une verrerie éphémère ». L'esthétique de la surprise et du saisissement réunit sur un même plan les « images nouvelles et in vues » (49) et le « hormis l'y taire » du « Petit air (guerrier)», les épigrammes percutantes des Quarante bergères et les délicatesses de la lyre de plume « qui s'accorde / Dans les plumes de l'Oiseau-Ly- re » (50). Entre les deux, les jeux verbaux les plus décriés prennent soudain un sens plus actuel que toutes les colombes poignardées. Mieux que le « Zaïmph » des Chauves-souris :
« Les toilettes des étoiles, Les étoiles de la nuit, Les étoffes et les toiles De l'aile à qui le jour nuit » (51),
l'étonnant « Ecce Homo » qui est tout lingua :
« Les rimes sont des rames Qui battent de leurs lames Le fleuve qui s'achève Aux rives de mon rêve » (52),
et renferme ces deux constats définitifs : « Si rares sont les rires », et : « Les roses sont des ruses ». Bonne raison de ne renoncer ni aux unes ni aux autres ; cependant, la ruse fait entrer indiscrètement dans l'écriture le temps d'une attente qu'on croyait en avoir chassé. Le décoratif reste,
(48) Les Chauves-souris, p.3 1 . (49) Huysmans,>4 rebours (1884), Fasquelle, 1923, p.262. (50) Les Chauves-souris, p.34. (),р (52) Les Hortensias bleus, p.303.
Robert de Montesquiou, poète critique 117
malgré tous les efforts, écartelé entre deux extrêmes, d'une part la « répétition diversifiée », d'autre part la singularité de l'objet, siège du Mythe, telle qu'en l'œuvre de Gustave Moreau :
« Au vol de l'Espace, au pas du Temps, Elle est isolée et suspendue, Comme un météore où les Printemps Ont perpétué leur chanson tue » (53).
Malgré qu'on en ait, la lutte pour éterniser l'instant, si elle trouve ses images dans le fragile, le figé et le fossile, passe elle aussi par la composition, seule médiatrice entre l'habitant du monde et sa demeure. Malgré certaines apparences, c'est une leçon courageuse et tournée vers l'avenir que Montesquiou « étant du passé, même avant l'heure », a donnée à son temps. Ce qui se cherchait dans l'érotisme lancinant et souvent oblique de la fin du XIXe siècle, parfois péniblement, n'était rien d'autre enfin que le même décoratif souci d'un art habitable, à défaut de nature (abominé sous le nom d'esthétisme par ceux qui ne savaient pas la nature perdue ou à qui elle avait déjà cessé de manquer). Avec un peu de chance nous y retrouverions, rassérénant l'ombre du Maestro, « un écho du cristallin chantier/ Où s'est élaboré son délicat poème » (54).
(Université de Pau)
(53) Les Paons, p.82. (54) Les Hortensias bleus, p.401 .



























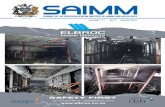




![[Meticilin resistant Staphylococcus aureus and liver abscess: a retrospective analysis of 117 patients]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632546fd545c645c7f099e01/meticilin-resistant-staphylococcus-aureus-and-liver-abscess-a-retrospective-analysis.jpg)



