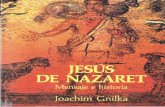Entre steppes et stèles, Territoires et identités au Bachkortostan
Régionalisme, dreyfusisme et nationalisme. Lettres d'Émile Durkheim et de Georges Sorel au poète...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Régionalisme, dreyfusisme et nationalisme. Lettres d'Émile Durkheim et de Georges Sorel au poète...
RÉGIONALISME, DREYFUSISME ET NATIONALISMELettres d'Émile Durkheim et de Georges Sorel au poète Joachim Gasquet (1899-1911)Willy Gianinazzi Société d’études soréliennes | Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle 2008/1 - n° 26pages 143 à 162
ISSN 1146-1225ISBN 9782912338266
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2008-1-page-143.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gianinazzi Willy,« Régionalisme, dreyfusisme et nationalisme » Lettres d'Émile Durkheim et de Georges Sorel au poète
Joachim Gasquet (1899-1911),
Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2008/1 n° 26, p. 143-162.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Société d’études soréliennes.
© Société d’études soréliennes. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
143
Régionalisme, dreyfusisme et nationalismeLettres d’Émile Durkheim et de Georges Sorel au poète Joachim Gasquet (1899-1911)
Willy Gianinazzi
Introduction
Les rapports que la gauche a noués à la fin du xixe siècle avec les milieux artistiques de la Provence sont très mal connus. Ceux qu’a entretenus Charles Maurras, natif de Martigues et ex-étudiant à Aix, paraissaient autrement naturels et significatifs. De Durkheim, républicain socialisant, ne filtrait que le droit de réponse qu’il avait demandé à son admirateur intempestif, Joachim Gasquet, directeur de la revue aixoise le Pays de France, alors que la correspondance inédite révèle l’existence d’une empathie antérieure. Les historiens connaissaient certes « la collaboration régulière de Sorel en 1899 et 1900 au Pays de France », mais c’était pour qualifier ce dernier tantôt de « revue d’extrême droite 1 » tantôt d’« ouvertement conservateur 2 ». Il me souvient que, lors de la soutenance de la thèse sur Sorel de Shlomo Sand, en 1982, Madeleine Rebérioux – qui, à l’évidence, n’avait point connaissance d’un éloge contemporain de Jaurès par Gasquet 3 – y voyait là un signe de l’ambiguïté foncière de Georges Sorel. Il n’en est rien. Manifestement, l’évolution postérieure de Gasquet et de quelques-uns de ses amis vers le nationalisme et le traditionalisme a fait écran. Un retour sur ce milieu de province s’impose donc.
�. Madeleine Rebérioux, « Début du xxe siècle : socialistes et syndicalistes français », Annales ESS, XIX, 5, juillet-décembre 1964, p. 981 n.�. Shlomo Sand, L’illusion du politique. Georges Sorel et le débat intellectuel 1900, Paris, La Découverte, 1985, p. 130. Plus loin, avec atténuation : « Plutôt de droite » (ibid.).�. Joachim Gasquet, « La pensée de Jaurès », le Mémorial d’Aix, 20 juillet 1899.
DOCUMENTS
Documents.indd 1 9/05/08 11:16:49
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
144
Joachim Gasquet félibre et naturiste
Lorsque Joachim Gasquet (1873-1921) fonde en 1899 le Pays de France, il n’a pas vingt-six ans. Et pourtant, il a déjà accumulé les expériences éditoriales, littéraires et politico-culturelles. Fils d’un patron boulanger aisé d’Aix-en-Provence (ami d’enfance de Paul Cézanne), élève brillant et poète précoce, il crée à dix-neuf ans, en janvier 1892, la revue poétique la Syrinx qui débute avec un poème de Charles Maurras, qu’il connaît depuis l’enfance et qui est son parrain 4. Au fil de ses treize numéros, le mensuel publie Paul Valéry, Camille Mauclair, André Gide (alias André Walter), mais aussi des poètes romans. Dès cette époque, l’engagement de Gasquet en faveur du renouveau de la culture provençale est attesté. En 1891, il participe à un banquet félibre et c’est la « reine » du Félibrige, la future romancière Marie Gasquet, qu’il épouse en 1896. Il fait œuvre de prosélytisme auprès de ses professeurs de lycée, Louis Bertrand, et d’université, le philosophe Georges Dumesnil, nommés pour quelque temps à Aix.
En ces années où la jeunesse lycéenne et universitaire participe en première ligne au réveil aussi bien de la littérature locale que de l’esprit régionaliste 5, Gasquet réussit à réunir autour de lui un céna-cle de jeunes poètes aixois et tisse des liens de forte amitié avec un dense réseau de lettrés, notamment des Toulousains déjà versés dans la création de revues poétiques 6 – liens que renforce l’usage systéma-tique des dédicaces imprimées 7. André Gide est du nombre 8.
�. Sur le jeune Gasquet et le milieu littéraire qu’il fréquente, voir Louise Mallerin (ed.), Emmanuel Signoret. Lettres inédites à Joachim Gasquet, Aix-en-Provence, Publications-diffusion Université de Provence, 1988. Sur les rapports entre Gasquet et Maurras, de cinq ans son aîné, voir en outre Stéphane Giocanti, Charles Maurras. Le chaos et l ’ordre, s.l., Flammarion, 2006.�. Anne-Marie Thiesse, Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris, Puf, 1991.�. Hormis Bertrand et Dumesnil, citons les Aixois Paul Souchon, Emmanuel Signoret, Joseph d’Arbaud, Xavier de Magallon (né en 1866), Léon Parsons, le Marseillais Edmond Jaloux, les Toulousains Marc Lafargue et Jean Viollis – tous poètes nés, à un cas près, dans les années soixante-dix –, et l’écrivain, spécialiste de Saint-Saëns, enseignant alors à Nice, Émile Baumann.�. C’est ainsi que Maurras, envoyant son Anthinea à Gasquet (et, via celui-ci, à Lafargue), se doit d’expliquer pourquoi il a omis la dédicace à son « ami » (lettre à Gasquet du 22 octobre [1901], Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence, fonds Gasquet (FG), 1871 (1737) f ° 596).�. Sur ses rapports avec Gasquet et les poètes méridionaux, voir Peter Schnyder, Pré-textes. André Gide et la tentation de la critique, Paris, Intertextes, 1988. Sur la référence gidienne et symboliste chez Gasquet, qui plus tard laissera sceptique Georges Sorel (cf. ci-après sa lettre de 1905), voir Christian Angelet, « Le Narcisse de Joachim
Documents.indd 2 9/05/08 11:16:51
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
145
À partir de mai 1896 et pendant presque deux ans, Gasquet édite une nouvelle revue, les Mois dorés. Au symbolisme de la Syrinx, qui veut « créer du rêve », succède une poétique de l’amour de la vie, optimiste, prométhéenne et païenne, dont Gasquet fixe l’objet dans la représen-tation du Beau à travers les paysages, singulièrement de Provence, tels que les peignent, avec pinceaux ou plume, son ami Cézanne, Monnet, Zola, et Mallarmé qu’à la différence des post-symbolistes, il ne renie pas 9. Passé au crible de cette nouvelle théorie « naturiste » codifiée par le jeune poète Saint-Georges de Bouhélier, l’art est appelé à jouer les premiers rôles dans la vie de la nation. Car le Beau, qui réalise la Justice, participe d’un ordre hiérarchisé et moral, ou « ordre juste », qui est censé ordonner la vie des groupements humains, cependant que la démocratie découle de « l’affreuse notion de l’égalité de tout et de tous ». Cet aristocratisme s’accompagne d’un appel à la race du sang, à la tradition et aux valeurs de la terre maternelle 10.
Le primat de la patrie, qui est ainsi affirmé, ne contredit pas une revendication pour laquelle Gasquet se bat dès 1892. Suivant Frédéric Mistral, fondateur célébré du mouvement provençal, et de concert avec Maurras, qui n’est pas alors royaliste, il défend l’option fédéraliste, que les félibres jacobins ne peuvent admettre 11. Il s’agit précisément de promouvoir les autonomies locales et les langues régionales dans les écoles. Ce fédéralisme, qu’appuie la gauche proudhonienne du félibre, n’est pas dressé contre les principes de la Révolution française qu’il doit au contraire mener à leur perfection 12. Car Gasquet est républicain.
Gasquet et les premiers écrits de Gide », in Christian Berg et al. (eds.), Retours du mythe, Amsterdam-Atlanta GA, Rodopi, 1996, p. 133-141.�. Joachim Gasquet, « Créer du rêve », la Syrinx, I, 3, mars 1892, p. 71-75 (dédié à André Gide) ; Id., « Prométhée délivré », l’Ermitage (Paris), XVIII, juin 1899, p. 416-419 (sollicité par Gide) ; sur le paysage : Id., « Notes pour servir à l’histoire du naturisme », la Plume littéraire, artistique et sociale (Paris), IX, 205, 1er novembre 1897, p. 672-673 (sollicité par Saint-Georges de Bouhélier), et Id., « Les idées et les faits », le Pays de France, I, 1, janvier 1899, p. 59-60 ; sur Cézanne : Id., « Juillet », les Mois dorés, 3, juillet 1896, p. 94-96, et Id., « Le sang provençal », les Mois dorés, 12-13, mars-avril 1898, p. 378-381. Sur la symbiose intellectuelle entre Gasquet et Cézanne, voir Jean Arrouye et al. (eds.), Cézanne en Provence, Aix-en-Provence, Musée Granet, 2006.�0. J. Gasquet, « Notes… », art. cit., p. 673-674 ; Id., « Notes pour servir à l’histoire du naturisme », la Revue naturiste (Paris), I, 5, juillet 1897, p. 198-201. Voir aussi Id., « Les idées et les faits », le Pays de France, I, 2, février 1899, p. 118, 120. Sur le mouvement poétique naturiste, mais avec quelques approximations à propos de Gasquet, voir Michel Décaudin, La crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française. 1895-1911, Toulouse, Privat, 1960.��. S. Giocanti, op. cit., p. 107-111. Sur son fédéralisme, voir aussi Joachim Gasquet, « Le réveil », le Mémorial d’Aix, 3 août 1899.��. Joachim Gasquet, « Les idées et les faits », le Pays de France, I, 3, mars 1899, p. 195.
Documents.indd 3 9/05/08 11:16:51
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
146
Joachim Gasquet républicain et dreyfusard
Peu porté aux analyses politiques, Gasquet est néanmoins saisi par l’immense enjeu moral que représente à ses yeux l’affaire Dreyfus. Cet émoi partisan, qu’il partage avec ses amis Bertrand, Léon Parsons et Maurice Le Blond – l’autre chef de file du naturisme –, le pousse à écrire quelques éditoriaux enflammés pour l’hebdomadaire local, le Mémorial d’Aix. Le 22 juin 1899, il invite à l’union de toutes les forces républicaines en érigeant en exemple à suivre le ralliement socialiste de Francis de Pressensé sous l’effet de l’Affaire 13 ; le 29, il voit dans la Ligue des droits de l’homme, créée un an auparavant, le lieu « où s’est réfugié tout ce qui restait encore en nous de l’âme de la Révolution » et invite à la constitution de sections dans chaque ville (il ne manquera pas d’y adhérer et de participer à ses réunions) ; le 6 juillet, c’est à la régénération morale de la France qu’il appelle. Le 13, il dit croire que par l’affaire Dreyfus la France s’est ressaisie :
L’Affaire a été l ’occasion qui nous a servi à voir combien nous nous portions mal. Elle n’est pas une cause, elle est un effet. Et même, on peut dire qu’en un certain sens elle a été un bien ; elle a réveillé, sorti de leur torpeur indifférente tous ceux qui avaient gardé quelque pensée en eux, qui sentaient encore, malgré tout, battre dans leur sang quelque chose des grands sentiments français […] La génération, qui vit le jour aux environs de soixante-dix et qui fut élevée dans l’horreur de la guerre et dans la conscience du droit foulé, entre en scène aujourd’hui, c’est avec l ’Affaire Dreyfus qu’elle aborde la vie politique. C’est elle qui a acclamé, soutenu les Émile Zola, les Jaurès, les Clémenceau [sic]. D’instinct elle est allée vers les quelques hommes qui restaient debout au milieu des foules couchées. Elle n’a d’amour que pour la Justice, elle veut élargir le patriotisme jusqu’à l’humanité 14.
Tout en ayant apprécié les précédents, c’est à ce dernier article qu’Émile Durkheim réagit dans une lettre de compliments qu’il adresse à Gasquet le 16 juillet 1899. De son côté, Georges Sorel a déjà amorcé sa collaboration au Pays de France que le poète a fondé au début de l’année. On comprend que pour ces deux dreyfusards, il n’y a aucune vergogne à se lier avec un partisan ouvert de leur cause.
��. Sur l’engagement de Pressensé, voir Rémi Fabre, Francis de Pressensé et la défense des droits de l’homme. Un intellectuel au combat, Rennes, Pur, 2004.��. Joachim Gasquet, « Premiers symptômes », le Mémorial d’Aix, 13 juillet 1899.
Documents.indd 4 9/05/08 11:16:52
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
147
La première orientation du Pays de France
Quelle est l’empreinte que donnent au Pays de France son directeur et ses rédacteurs pendant au moins sa première année et demie d’existence ? Conformément à une tendance présente dans la plupart des revues d’avant-garde pendant la décennie qui s’achève, il n’est plus question d’abstention politique. Par le nombre des contributions, le mensuel aixois est pour moitié une revue littéraire, mais c’est la franchise des prises de position politiques qui détermine sa physionomie. Le premier numéro de janvier s’ouvre avec un article-programme de Dumesnil, à la philosophie duquel Gasquet sera de plus en plus sensible 15. Il parle de la douceur qu’évoque le mot « pays » que les Français réfèrent autant au village qu’à la province, puis se lance, suivant la tradition de la polémique romane, dans une diatribe contre la puissance montante et expansion-niste des États-Unis. S’agissant de la guerre américano-espagnole à propos de Cuba, la protestation a une teneur réactionnaire qui est tout le contraire d’une attaque antiaméricaine ultérieure de Marc Lafargue, dirigée cette fois contre l’asservissement des Philippines (n° 5). Ce poète dreyfusard 16, au socialisme assumé 17, marque de son empreinte la revue par une série de « Notes sociales » engagées (n°s 5 sq.), alors que le Dr S. Jankelevitch disserte sur la jeunesse révolutionnaire russe (n° 9) et que le jeune Charles Maybon présente « Les sociétés communistes aux États-Unis » (n°s 17 sq.). L’élitisme de Gasquet et de l’administrateur du périodique, le félibre Marie Demolins, fait certes contraste (n° 1), mais ne brouille guère l’image socialiste de la revue dans la mesure où il est noyé dans des considérations esthético-éthiques. Quant à Gide, qui y publie un fragment de Proserpine (n° 12), il réserve son élitisme à l’Ermi-tage, auquel il collabore régulièrement : « Marc Lafargue compromet son nom délicieux à louanger le populaire […] Ô ! Marc Lafargue ! vous dont j’aimais les vers, défiez-vous des foules […] Sympathiser avec la foule, c’est déchoir 18 ». D’où la réplique dans le Pays de France du jeune poète Jules Nadi, alors guesdiste : « Le reproche nous a brûlés comme un soufflet […] Qu’importe ! » S’agissant des foules, « nous demeurons
��. Sur Georges Dumesnil, qui a déjà commencé durant les années précédentes son cheminement vers le catholicisme, voir Louis-Alphonse Maugendre, La renaissance catholique au début du xxe siècle, I, Paris, Beauchesne, 1963.��. Voir son engagement en défense de Zola et Dreyfus dans l ’Aurore, 3 juin 1898.��. Au même moment, il prend en charge la chronique artistique et littéraire à la Jeunesse socialiste de Toulouse qui sort son premier numéro en avril 1899. Cet éphé-mère mensuel, qui déclare se rattacher idéalement à la revue homonyme fondée à Toulouse en 1895 par Hubert Lagardelle, est l’organe de la Fédération des jeunesses socialistes du Midi.��. A.G., « Lettre à Angèle », l ’Ermitage, XIX, juillet 1899, p. 70-71.
Documents.indd 5 9/05/08 11:16:53
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
148
sûrs de ses sentiments » (n° 9, p. 521). Et si Gasquet invoque l’aristo-cratisme du Zarathoustra de Nietzsche (n° 2) – « Nos procédés sont donc contraires », lui écrit Nadi 19 – et se réclame de Saint-Georges de Bouhélier pour fustiger le « cosmopolitisme » littéraire (n° 11), dès qu’il passe au niveau politique, c’est soit pour en appeler à une « aristocratie républicaine » incarnée par des savants comme Émile Durkheim et Célestin Bouglé (n° 14) – de même qu’un autre poète, Jean Viollis, introduit à « la sociologie positive » (n°s 1 sq.) –, soit pour saluer le fédéralisme de ses collaborateurs Marc Lafargue et Emmanuel Delbousquet (encore un jeune poète toulousain), soit encore pour s’incliner devant le socialisme non jacobin et millerandiste de son ami journaliste Léon Parsons (n° 16).
Nous ne connaissons pas les circonstances qui ont amené Sorel à collaborer à la revue. Sa correspondance avec Gasquet est incomplète, celui-ci ayant apparemment pour habitude de ne conserver que les lettres qui lui importent et d’en recycler d’autres pour ses brouillons (sa pièce Dionysos est écrite sur des versos de lettres !). Mais il est clair que la participation de Sorel renforce la connotation socialiste de la revue. Elle se déploie de février 1899 à novembre 1900 avec une certaine assiduité (n°s 2, 4, 7, 9 sq., 14 sq., 23 20). Sorel y traite principalement de questions concernant le mouvement socialiste et ouvrier. À une exception près, les thèmes et les orientations qu’il développe sont parfaitement conformes à l’esprit de cette revue de province. L’inflexion anti-allemande qui par-court telle description de la social-démocratie d’outre-Rhin complète l’anglo-saxophobie latiniste de la revue. L’anti-parisianisme, qui fait également surface dans ses lettres à Gasquet, rejoint le régionalisme et le fédéralisme, fers de lance de la revue : « Nous sommes trop habitués à considérer la France, écrit-il, comme une dépendance de sa capitale, à juger notre pays d’après les idées qui sont à la mode dans les cercles de Paris 21. » À l’inverse, Sorel est loin d’emboîter le pas à Gasquet lorsqu’il se réclame de l’égalité, prônée par les ouvriers socialistes, et lorsqu’il récuse le « principe de hiérarchie » dont, à son avis, furent imbus les révolutionnaires français, puis Saint-Simon et Fourier, et que véhicule tout politicien ou socialiste parlementaire 22.
��. Lettre à Gasquet s.d. [février 1899], FG, 1872 (1738), f° 219.�0. Tous ces articles sont répertoriés dans la bibliographie des écrits de Sorel établie par Shlomo Sand en annexe de Jacques Julliard, Shlomo Sand (eds.), Georges Sorel en son temps, Paris, Éd. du Seuil, 1985, p. 436-439.��. Georges Sorel, « Le socialisme et la Révolution française », le Pays de France, I, 4, avril 1899, p. 221.��. Ibid., p. 227-228.
Documents.indd 6 9/05/08 11:16:54
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
149
Le tournant nationaliste
Le régionalisme, tel qu’il a été conçu en France à ses débuts dans les années quatre-vingt-dix, ne s’est jamais opposé au culte de la Patrie 23. Au même titre que les foisonnantes études locales du folklore, il en est même une composante, largement acquise au républicanisme 24, parfois même dreyfusarde, qui, à travers le pullulement des littératures locales, veut témoigner de l’ancrage de la Patrie dans la diversité du territoire. C’est ainsi que le conçoivent Gasquet et les naturistes à la suite de Saint-Georges de Bouhélier, lui-même dreyfusard. Le glis-sement du patriotisme au nationalisme n’est donc qu’une question de degré, mais, comme le montre le cas de Lafargue, n’a rien de fatal et, en tout état de cause, ne peut se faire que par un choix politique délibéré. Comment donc des dreyfusards ont-ils pu franchir le pas ?
La déception vis-à-vis du bloc dreyfusard arrivé au pouvoir en est le mobile apparent. Mais chez Gasquet le basculement a été extrêmement rapide, dès les premiers mois de 1900. En en donnant un récit sur le mode de la conversion religieuse, qui d’ailleurs n’allait pas tarder, il prend l’aspect d’une révélation soudaine. L’engouement pour le combat dreyfusard se dissipant, il fait place au sentiment d’un état de décadence et de corruption du pays. On remarquera que l’évé-nement déclencheur invoqué est un topos constitutif du ressentiment des jeunes lettrés de province : la venue à Paris d’un provincial 25, derrière lequel se cache l’auteur lui-même.
Il a eu la mauvaise inspiration d’assister à une séance de la Chambre. Toutes ses illusions tombent […] Le mal démocratique s’est brusquement affirmé à ses yeux […] Il aperçoit tout d’un coup, à travers les séances du Parlement, les excitations de la presse, les déclamations de l ’estrade, les hurlements de la rue, le visage torturé de la troisième République, comme Taine jadis vit, der-rière les incendies de la Commune, la face monstrueuse de la bête jacobine. En lui tout s’éclaire. Il s’est souvenu de tout un ordre de phénomènes, qui dormaient dans sa mémoire et qu’il avait négli-gés jusques là, qu’il est étonné même de retrouver maintenant si vivaces et si précis. Le boulangisme, Panama, les banqueroutes
��. A.-M. Thiesse, op. cit.��. Le félibre Xavier de Magallon, monarchiste depuis son jeune âge, fait figure d’exception dans l’entourage régionaliste de Gasquet.��. Lafargue, « monté » à Paris, écrit ainsi à Gasquet : « Paris est une atroce ville. Tu le sais autant que moi » (lettre s.d. [1899-1900], FG, 1870 (1736), f ° 356).
Documents.indd 7 9/05/08 11:16:54
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
150
politiques ou commerciales, les kracks [sic] moraux ou industriels, Fourmies et l ’affaire des décorations, Madagascar et les attentats anarchistes, tous ces faits que, durant ces dernières années, il avait appris, d’une curiosité distraite, au hasard des conversations, à tra-vers la brume des comptes-rendus, les reportages outrés du journal quotidien, que souvent d’ailleurs il avait négligé de lire, tous ces faits aujourd’hui lui apparaissent dans leur réalité historique, il les groupe, les enchaîne les uns aux autres, il comprend qu’ils ne se sont pas produits au hasard, que ce sont de véritables événements et non des accidents négligeables, qu’une même logique préside à leur développement et que tout cela, en un mot, a préparé, amené la crise aiguë de cette affaire Dreyfus et doit être la forte indication que la patrie a besoin d’énergiques remèdes 26.
Nul n’est dupe : Parsons désapprouve dans sa brochure Aux intel-lectuels ces « avances aux nationalistes », que corroborent des références à Déroulède 27, Bertrand se dit « déconcerté 28 » et rédige une mise au point (n° 17-18), tandis que Maurice Barrès remarque l’article et le cite. Gasquet insiste : il fait l’éloge, cette fois, des romans de Barrès, dont l’emblématique Les déracinés (ibid.) – le livre qui pousse Gide à se démarquer, mais qui fera de Lafargue, toujours socialiste, un régionaliste barrésien 29. Barrès, ému, lui écrit qu’il est « heureux de [son] témoignage » car « enfin l’isolement » dont il est victime « va se rompre 30 ». Durkheim, affligé, lui signifie au contraire son incompré-hension. Quelque temps plus tard, Pressensé désavoue dans la presse l’évolution de Gasquet 31.
��. Joachim Gasquet, « Les idées et les faits », le Pays de France, II, 14, février 1900, p. 120-122.��. Voir aussi sa lettre à Gasquet du 27 février 1900, FG, 1872 (1738), f ° 314.��. Lettre à Gasquet du 4 mars 1900 dans Louis Bertrand, « Lettres à Joachim Gasquet », in Terre de résurrection, Maurice Ricord (ed.), Paris, Éd. de la Nouvelle France, 1947, p. 100. Sur les rapports Gasquet-Bertrand, voir aussi Eugène Simon, Louis Bertrand et la Provence, Toulon, L’Astrado, 1975.��. Voir André Gide, « À propos des Déracinés de Maurice Barrès », l’Ermitage, XVI, février 1898, p. 81-87, et Marc Lafargue, « Lettre d’un Languedocien sur Maurice Barrès » (lettre ouverte à André Gide), le Midi fédéral, 1905, sur Gidiana.net : www.gidiana.net/articles/GideDetail2.1903.8.htm (1/4/2008).�0. Lettre à Gasquet datée du lundi de Pentecôte 1900, FG, 1866 (1732), f ° 736.��. Dans une lettre à Maurras du 8 avril 1901, Jacques Bainville s’en fait l’écho et commente ainsi : « Comme il dissimule mal son dépit et sa crainte de voir échapper les meilleurs éléments de la cohorte dreyfusienne. » (Pierre-Jean Deschodt, Cher maître. Lettres à Charles Maurras de l’Académie française, s.l., Christian de Bartillat, 1995, p. 57.)
Documents.indd 8 9/05/08 11:16:55
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
151
Sorel, quant à lui, n’enverra plus d’articles nouveaux au Pays de France, à l’exception d’un texte non politique concernant l’architec-ture – domaine dans lequel il fait montre de connaissances techniques et historiques impressionnantes. Dans ses lettres au directeur, il se dit frappé par l’évolution de la revue et revient, tout comme Durkheim qui remonte au boulangisme, sur ce qu’a représenté pour sa généra-tion l’affaire Dreyfus (en révélant au passage son dreyfusisme de la première heure). Lorsque Gasquet se laisse gagner par le nationalisme monarchiste de Maurras en lequel il voit la solution aux désordres qui secouent la patrie 32, il s’échine à lui expliquer quelle est à son avis la vraie nature de ce nationalisme tout parisien : un effet de mode et une fiction d’intellectuels montant un « décor » qui appartient à ce que Sorel désignerait volontiers comme « le domaine artistique de la vie politique ». En d’autres termes, une idéologie contingente et super-ficielle qui cache autre chose 33. Mais Durkheim a tort – réagit-il au droit de réponse que le sociologue obtient dans le Pays de France – en y opposant un « culte de la raison » que personne ne suit.
Dans le prolongement de ce raisonnement, Sorel décortique les ressorts grossiers qui, à son sens, sont à la base de l’antisémitisme nationaliste. Il confirmera par la suite son aversion pour l’antisémi-tisme politique 34. Mais il est curieux de noter que l’un des mobiles exposés est précisément celui qui expliquera plus tard l’antisémitisme
��. Joachim Gasquet, « Les idées et les faits », le Pays de France, II, 24, décembre 1900, p. 727-734, et III, 26, février 1901, p. 96. Dans une conférence où il reconstruit sa biographie, il dit avoir été conquis par l’enquête de Maurras sur la monarchie et avoir rejoint l’Action française : « De l’anarchisme dreyfusien au nationalisme inté-gral », l ’Action française, IV, 44, 15 avril 1901, p. 616-636, puis avec ce même titre dans le Pays de France, III, 35, novembre-décembre 1901.��. Au même moment, Sorel revient dans des notes ajoutées à La ruine du monde antique (Paris, Jacques, [1902]) sur la signification de la fiction patriotique qu’il avait abordée dans « La fin du paganisme », série d’articles de 1894 que recueille cet ouvrage. J’ai essayé de comprendre le sens de cette réflexion dans Willy Gianinazzi, Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante (1889-1914), Paris, Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2006, p. 77-79.��. Entre autres exemples, à l’encontre de l’antisémitisme de l’Action française : « Je suis convaincu – conclut-il un article où il examine les rapports entre prolétariat et monarchistes –, et vraiment je ne saurais pas ne pas l’être, que l’antisémitisme empêchera l’Action française de mener à terme l’œuvre d’éducation que Charles Maurras aurait été capable d’accomplir en France. Nous aurons ainsi une nouvelle preuve des inconvénients très graves que présente la confusion d’une entreprise intel-lectuelle avec une propagande qui ne s’occupe que des contingences. » (Georges Sorel, « Camelots du roi e militi del proletariato. I monarchici dell’Action française e i sindacalisti », il Giornale d’Italia, 16 février 1911, repris in Decadenza parlamentare, Marco Gervasoni (ed.), Milan, M&B Publishing, 1998, p. 196.)
Documents.indd 9 9/05/08 11:16:56
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
152
intime de Sorel, à savoir la volonté de se soustraire à l’influence de groupes intellectuels dominants.
L’engagement nationaliste de Gasquet pose le problème du rap-port de l’artiste à la politique. C’est ce problème délicat que sou-lève un critique de Lafargue qui lui demande à quel titre il loue l’esprit classique de Maurras, « épris d’ordre et de vérité » : « Nous voudrions savoir si vous désignez uniquement la vérité et le bel ordre littéraires 35. » Dans le cas de Gasquet, le doute n’est pas permis : il n’y a pas de solution de continuité entre sa vision artistique de la nature et sa nouvelle foi politique. En constituant, par la colonisation totale de l’esprit, une passerelle entre art et engagement dans le siècle, sa conversion religieuse clarifie les permanences intimes : le retour à l’ordre n’est jamais que l’acceptation, politiquement affirmée, de cet ordre divin qu’en païen, il décelait déjà dans la nature et qui main-tenant le ramène au catholicisme de son enfance. Le 3 décembre 1901, il annonce qu’il pratique à son ami Émile Baumann 36.
Ne comptant plus, de l’aveu même du directeur, que des colla-borateurs catholiques et monarchistes, le Pays de France périclite, en dépit des contributions de Maurras, et suspend bientôt sa parution. Gasquet lui fait succéder en 1904 un modeste bulletin thomiste. Le traditionalisme catholique, qu’il partage avec ses vieux amis Baumann et Dumesnil – ce dernier a entre-temps fondé, en 1907, sa propre revue catholique, l ’Amitié de France –, explique la reprise de contact entre Gasquet et Sorel à l’époque où ce dernier, momentanément replié sur les questions spirituelles 37, s’emploie à faire connaître Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc de son ami Charles Péguy *.
��. Edmond Pilon, « Charles Maurras expliqué par Marc Lafargue », la Plume littéraire, artistique et sociale, 316, 15 juin 1902, p. 767. Il est fait référence à l’éloge d’Anthinea par Marc Lafargue dans « Lettre de Paris », la Revue provinciale (Toulouse), II, 15 mai 1902, p. 142-145, cit. à la p. 144.��. Lettre reproduite en fac-simile dans Émile Baumann, Mémoires, Lyon, La Nouvelle Édition, 1943, hors texte. Sur le phénomène historique de la conversion, avec référence entre autres à Bertrand, Dumesnil et Gasquet, voir Frédéric Gugelot, La conversion des intellectuels au catholicisme en France. 1885-1935, Paris, CNRS Éd., 1998.��. Émile Baumann, qui avait fréquenté Sorel aux bureaux de l ’Indépendance, fondée en 1911, le confirme dans ses Mémoires : « Ce n’était ni la politique ni les questions sociales qui faisaient la matière de nos entretiens, je veux dire des discours qu’adossé à une table, les bras croisés, Sorel improvisait en épanchant devant nous sa faconde nourrie de lectures. Il parlait des mystiques, de sainte Thérèse, de saint Jean de la Croix, de la sœur Labouré, non en dilettante, mais avec une enthousiaste vénération, presque en croyant. » (É. Baumann, op. cit., p. 333.)* Je remercie Neil McWilliam, qui s’apprête à publier des études sur Gasquet, pour les remarques et les conseils qu’il m’a aimablement prodigués.
Documents.indd 10 9/05/08 11:16:57
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
153
Lettres d’Émile Durkheim à Joachim Gasquet (1899-1900) 1
116 juillet 1899
Monsieur,J’ignore si c’est à vous que je dois l ’envoi du Mémorial d’Aix ; mais je
tiens à vous remercier et je vous demande la permission de vous féliciter des articles que vous y publiez. Celui que j’ai reçu hier en particulier m’a fait un très vif plaisir 2. Outre qu’il est d’une très belle forme, les idées y sont si justes, elles sont si conformes à ce que je pense moi-même que j’ai été tout heureux en le lisant. Oui, il peut sortir beaucoup de bien de l ’Affaire ; mais il faut maintenant lutter ferme pour empêcher les politiciens d’en dissiper les résultats. L’anarchie morale et intellectuelle d’aujourd’hui vaut mieux que l ’ordre apparent d’hier : elle peut venir de ce que les vieux cadres, dans lesquels on s’enfermait, sont brisés et que les nouveaux ne sont pas trouvés. Mais c’est déjà beaucoup que de s’être affranchi des premiers. Il faut travailler à un reclassement profond des idées et des esprits. C’est ce que vous faites ; je souhaite de tout cœur que vos efforts aboutissent.
Agréer, je vous prie, Monsieur, l ’expression de mes sentiments très distingués et de ma sympathie
E. Durkheim
24 juin 1900
Cher Monsieur,Avec la même netteté que j’ai mise à vous exprimer, il y a près d’un an,
ma vive sympathie pour la courageuse et belle campagne que vous meniez alors, je me dois et je vous dois à vous-même de vous dire combien votre récente attitude m’a contristé. Les sentiments mêmes que vous voulez bien avoir pour moi m’en font une obligation.
�. Déposées dans le fonds Gasquet de la Bibliothèque municipale Méjanes, à Aix-en-Provence, sous la cote 1869 (1735), f ° 294-297. Les deux premières comportent l’adresse manuscrite « Bordeaux, 218 Bd de Talence ». Pour l’ensemble des lettres, transcrites avec l’aide toujours précieuse de Michel Prat, nous uniformisons la présentation typographique selon le code en vigueur aujourd’hui. Les incises entre parenthèses à chevrons correspondent à des ratures significatives.�. Joachim Gasquet, « Premiers symptômes », le Mémorial d’Aix, 13 juillet 1899. Sur son contenu, voir ci-devant, p. 146.
Documents.indd 11 9/05/08 11:16:57
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
154
Je m’expliquais encore vos indulgences pour Déroulède dont le Don Quichotisme ardent peut faire illusion. Mais Barrès 3 ! Je n’ai jamais rien trouvé chez celui-là de généreux et de vivant. Tout ce qu’il fait et tout ce qu’il dit a quelque chose d’étriqué et d’artificiel. J’ai lu ses Déracinés et, tout en m’intéressant à l ’effort, je n’y ai rien vu qui ne fût factice et conventionnel. Je n’y ai même rien retrouvé de mon pays lorrain. Et quant à sa philosophie, hélas ! c’est une philosophie de troisième et quatrième main.
Mais je conçois que tout cela soit matière à désarçonner. Aussi vous dois-je les vraies raisons de mon jugement. Les hommes se sont classés en France [à propos du boulangisme] beaucoup plus exactement encore qu’à propos de l’affaire Dreyfus 4. Vous étiez peut-être encore bien jeune alors – si je juge de votre âge d’après celui de votre ami Parsons 5 – et vous avez mal connu cette aventure. Vous ne savez peut-être pas à quelle honte on nous a alors exposés ; la fuite de Boulanger et sa mort ont démon-tré quel était le personnage. Ceux qui, le connaissant, – et ce qu’il était sautait aux yeux – n’ont pas craint de faire courir à leur pays le risque d’une telle ignominie, devraient rester éternellement au banc de l’opinion, si la conscience publique en France n’était pas dans un état de veulerie si alarmant.
Vous combattiez, il y a un an, pour la cause de la justice, pour la dignité de la pensée ; ne voyez-vous pas que tout cela est menacé par les gens aux-quels vous tendez la main et de manière à ce que toute compromission avec eux soit impossible ? Le péril est trop grand.
Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, l ’expression de mes très dis-tingués sentiments
E. Durkheim
�. Gasquet avait mentionné élogieusement les Chants du soldat de Paul Déroulède, L’appel au soldat et Les déracinés de Maurice Barrès dans ses chroniques « Les idées et les faits », le Pays de France, II, 14, février 1900, p. 126, et 17-18, mai-juin 1900, p. 350-351.�. La phrase, à cheval sur deux pages, comporte vraisemblablement le lapsus calami que nous introduisons. Maurice Barrès avait été boulangiste.�. Léon Parsons, journaliste, militant socialiste et dreyfusard. Rédacteur à l ’Aurore, plus tard collaborateur d’Aristide Briand.
Documents.indd 12 9/05/08 11:16:58
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
155
3
Bordeaux, le 9 novembre 1900 6
Monsieur,Dans votre récent article du Pays de France (nov. 1900), vous me
faites l ’honneur de citer un passage de ma Division du travail 7. Cette citation m’oblige à décliner toute solidarité avec les conséquences que vous tirez du passage invoqué. Sans doute, j’ai dit et je maintiens que notre rationalisme individualiste eût été, pour la société romaine, un principe de mort ; mais il est pour nos sociétés européennes, et principalement pour notre pays, un principe de vie. Car nous avons dépassé, depuis un certain nombre de siècles, la phase de la cité. Subordonner le culte de la raison à quoi que ce soit d’autre serait pour nous un suicide ; car toute cohésion sociale est impossible sans un minimum d’idées communes, et je ne vois pas d’autre idée où tous les Français puissent communier. Le culte du drapeau peut être très noble ; mais il dégénère en fétichisme et superstition grossière, quand on attribue au drapeau, qui n’est qu’un symbole, une sorte de prépondérance sur les sentiments qu’il doit symboliser et qui lui donnent toute sa valeur.
Je vous serais obligé de bien vouloir publier ces explications dans votre prochain numéro ; car je tiens à ce qu’il n’y ait pas de doute sur ma pensée 8.
Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, l ’expression de mes plus dis-tingués sentiments.
E. Durkheim
�. Avec en-tête : « L’année sociologique. Éditeur : F. Alcan-Paris. Direction. 218, Boulevard de Talence. Bordeaux. »�. En la faisant précéder de cette accroche, « Que les néo-intellectuels n’aillent pas plus loin. Je les avertis du scandale : on va célébrer l’armée », Gasquet citait ce passage de La division du travail social : « C’est partout un devoir fondamental que d’assurer l’existence de la patrie ». En note, il donnait la suite de la citation : « Or, il n’est pas douteux que si les peuples qui nous ont précédés avaient eu pour la dignité indivi-duelle le respect que nous professons aujourd’hui, ils n’auraient pas pu vivre. Pour qu’ils pussent se maintenir, étant données leurs conditions d’existence, il était abso-lument nécessaire que l’individu fût moins jaloux de son indépendance. » Et Gasquet commentait : « Voilà trois phrases que je ne cesse de méditer depuis plusieurs jours. Elles sont grosses de conséquences. Il faut en exprimer tous le sens positif. Vivre d’abord, se maintenir, et philosopher, respecter ensuite, c’est l’évident devoir d’un peuple. Il est bien difficile d’établir quelles sont nos réelles conditions d’existence aujourd’hui : pendant que nous les étudions, allons au plus pressé, maintenons la France en vie. » ( Joachim Gasquet, « Les idées et les faits », le Pays de France, II, 23, novembre 1900, p. 662.)�. Ce droit de réponse fut publié dans le Pays de France, III, 26, février 1901, p. 85-86. Nous avons suivi l’autographe.
Documents.indd 13 9/05/08 11:16:59
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
156
Lettres de Georges Sorel à Joachim Gasquet (1900-1911) 1
17 novembre 1900 2
Cher confrère,Je suis avec le plus grand intérêt vos chroniques mensuelles du Pays
de France, dans lesquelles je crois trouver l’expression des sentiments qui inspirent la jeunesse lettrée et pensante de province. Je suis frappé de l’évo-lution des idées qui s’y manifeste : il y a environ un an vous paraissiez surtout sympathique aux tendances socialistes et aujourd’hui l’idée natio-naliste paraît l’emporter chez vous. Lagardelle qui lit, également avec soin, vos articles, a été frappé comme moi de cette évolution et il croit qu’elle est assez générale en province. Il est vrai que chez vous et vos collaborateurs le patriotisme régional joue un rôle prépondérant et nous ne trouvons rien de semblable chez les nationalistes parisiens.
Ne pensez-vous pas que ce serait un beau sujet d’article que « l’évolu-tion des idées provinciales » ? Je crois que vous rendrez un vrai service aux hommes qui suivent le mouvement des idées, si vous faites cette étude dans votre revue. À l’heure actuelle Paris ne connaît plus du tout la province et celle-ci ne se connaît peut-être pas très bien elle-même.
Votre dévouéG. Sorel
23 mars 1901
Cher confrère,Je viens de recevoir le n° de février du Pays de France. Je n’ai pas reçu
le n° de janvier ; on m’a présenté hier la quittance d’abonnement, que j’ai acceptée. Je suis donc un abonné en règle.
Permettez-moi de vous faire remarquer que votre nationalisme est peut-être de nature à éloigner de vous beaucoup de forces jeunes et d ’hommes réfléchis, tous désireux de collaborer à < un rajeunissement > une renaissance de la vie provinciale, mais peu désireux de travailler au
�. Déposées dans le fonds Gasquet de la Bibliothèque municipale Méjanes, à Aix-en-Provence, sous la cote 1873 (1739), f ° 264-275. La plupart des lettres, toutes bordées de noir, comportent l’adresse manuscrite « 25 rue Denfert-Rochereau à Boulogne (Seine) ».�. Afin d’y répondre, cette lettre a été publiée, sans indication d’auteur, par Joachim Gasquet dans « Les idées et les faits », le Pays de France, II, 24, décembre 1900, p. 729 n. Nous suivons l’autographe.
Documents.indd 14 9/05/08 11:16:59
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
157
succès des idées de quelques Parisiens. Car il faut bien le proclamer bien haut, le nationalisme de Maurras et autres est un article essentielle-ment parisien, un article de mode, – comme a été l ’individualisme il y a quelques années, – comme est le socialisme dans < la > une partie de la jeunesse depuis l’affaire Dreyfus, – comme a été l’« amoralisme » artistique, et comme tant d’autres parisienneries assez éphémères.
Ne serait-il pas intéressant d’élever à côté de ces ombres changean-tes l ’édifice moins ondoyant, mais plus stable, des idées provinciales ? La grande différence de Paris et de la province s’est manifestée durant l’affaire Dreyfus ; aujourd’hui nous avons < encore > beaucoup de peine à compren-dre comment cette affaire a pu se produire ; à l ’heure actuelle les socialistes qui ont été dreyfusistes dès la première heure (comme moi, qui n’ai jamais cru dès 1894 à la culpabilité) ont de la peine à comprendre pourquoi les socialistes ont, les uns agi dans un sens, les autres dans un autre ; il n’y a pas dans l’immense arsenal des articles de Jaurès 3 un seul argument tiré des principes du socialisme !
L’affaire Dreyfus (comme le nationalisme) appartient à ce domaine de choses superficielles par rapport à la vie < provinciale > générale du pays, que j’appellerais volontiers le domaine artistique de la vie politique. C’est pour cela que les socialistes n’ont pu justifier leur action par des principes spécifiques ; les théories socialistes restent impuissantes pour expliquer de pareils drames 4 qui se déroulent dans les têtes des intellectuels des métropoles.
Ces drames ne sont pas rares dans l ’histoire : faut-il rappeler l ’enthousiasme de nos pères pour les Grecs et pour les Polonais, gens assez peu intéressants ? Durant la Restauration on n’a cessé de reprocher aux Bourbons d’être rentrés sur les fourgons des Alliés, alors que c’était la Charte qui avait été apportée et imposée par les Alliés. De 1852 à 1860 l’Europe a vécu sous la menace d’Idées napoléoniennes, qui étaient de purs rêves formés dans les cerveaux de quelques familiers de Napoléon III. L’anticléricalisme qui fit fureur il y a 20 ans était aussi un drame intellectuel, fort peu en rapport avec les aspirations du pays.
Je suis étonné que vous suiviez les nationalistes parisiens dans leur[s] < néo-monarchisme > rêves monarchiques ; < c’est, je crois, […] 5 snobisme > ils s’amusent à nos dépens ; et à quoi [bon], parler de restaurer un roi, avec
�. Voir Jean Jaurès, Les temps de l’affaire Dreyfus. 1897-1899, Éric Cahm, Madeleine Rebérioux (eds.), in Œuvres, VI et VII, Paris, Fayard, 2001.�. Le mot « drame », souvent utilisé par Sorel, signifie tantôt « récit vivant » tantôt « transport de l’esprit », mais aussi « suite d’événements qui agitent un pays ».�. Un ou deux mots raturés illisibles.
Documents.indd 15 9/05/08 11:17:00
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
158
une cour, dans un pays qui est monarchique dans sa vie matérielle mais qui a < l ’« idéal » > la « poésie démocratique » ! Nous sommes en France comme ces peuples restés païens au fond et réfractaires à la foi au Christ, mais irréductibles dans leurs apparences catholiques. Nous ne comprenons rien à la liberté, nous avons des mœurs appropriées au despotisme et nous ne pouvons vivre sans avoir l ’illusion d’une démocratie. Nous jouons une vie irréelle ; et cette opposition est devenue pour nous une nécessité, comme le pseudo-catholicisme d’une grande partie de l’Italie est devenu une nécessité.
À quoi bon un monarque, venant soulever des passions et forcer le pays à reprendre les « masques du drame » au lieu de s’occuper de ses affaires, alors que la république s’est si bien adaptée aux mœurs monarchiques ?
Pour vous le nationalisme, c’est la vie pratique, < l’étude > le retour au réel des situations sociales, la recherche de la réforme juridique, patiente et appuyée sur les traditions du pays. Ce nationalisme est tout autre chose que celui des gens de lettres parisiens.
Quant à Durkheim sa lettre est cocasse 6 ; quand il [sic] a-t-il vu un peuple communier dans une idée abstraite ? S’il y a une chose dont les Français se moquent joliment c’est du « culte de la raison ». Il n’y a que les professeurs pour être aveugles à ce point.
Dans les articles si souvent bouffons de Lafargue, il y a quelque chose de vrai : les peuples n’agissent point en raison des idées de Justice, de Vérité, de Morale ; ils agissent en raison de ressorts beaucoup plus simples et plus cachés, dont dépend la vie journalière. Le « manteau idéaliste » n’est qu’un vêtement de luxe, qu’on met pour les jours de fête et qui ne change pas la nature intime de l’homme. À ce point de vue il a raison contre Jaurès 7 : le désir d’être à son aise agit plus que l’amour de la Vérité ; et l ’histoire est chose assez grossière.
Si l ’on va au fond du nationalisme antisémitique on trouve beaucoup de ces ressorts grossiers, mais puissants : le désir d’être tranquille, – la peur d’une guerre, – l’absence de sympathie pour des gens appartenant à des classes riches et d’origine étrangère, – le besoin de trouver dans les Juifs des êtres symboliques chargés de toutes les exécrations d’un peuple en voie de transformations sociales douloureuses, – le sentiment obscur qu’il y a dans les idées socialistes quelque chose d’absolument contraire aux traditions
�. Voir le Pays de France, III, 26, février 1901, p. 85-86. La lettre, datée du 9 novembre 1900, est reproduite ci-devant.�. Allusion à la célèbre controverse qui opposa Jean Jaurès et Paul Lafargue lors de conférences respectives publiées dans la Jeunesse socialiste en 1895, puis la même année en brochure sous le titre Idéalisme et matérialisme dans la conception de l’histoire.
Documents.indd 16 9/05/08 11:17:01
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
159
monarchiques dont nous vivons, – le < désir > besoin de s’émanciper de la puissance trop respectée de certains groupes intellectuels, – la tendance à créer de nouvelles formes d’agitations ; etc. J’énonce toutes ces causes un peu au hasard et sans beaucoup de précision.
Le nationalisme est, à mes yeux, un décor fabriqué pour couvrir autre chose que ce qui paraît.
Mais je m’aperçois que je fais un discours et que j’ai écrit 8 pages bien-tôt. Mon excuse est que je suis des vôtres de la première heure et que je crois vous avoir soumis des réflexions qui peuvent être utiles pour votre revue.
Votre dévouéG. Sorel
Si vous aviez un n° de juillet 1900 en trop, je serai bien aise de l’avoir ; je ne puis retrouver ce n° dans ma collection. – Cette lettre est naturel-lement toute personnelle.
312 mars 1905
Cher Monsieur,Je vous remercie bien d’avoir songé à votre ancien collaborateur et
de m’avoir envoyé l’article de M. Tardy sur votre Dionysios [sic] 8. J’ai appris par les Débats que votre drame était publié ; s’il ne l’avait été, je vous aurais proposé de le faire paraître dans les Cahiers de la quinzaine de Péguy – que vous connaissez.
Je suis un peu effrayé, je vous l’avoue, de l’accumulation de symboles que M. Tardy découvre dans votre drame ; le public doit être un peu déso-rienté. Les anciens me semblent avoir eu grand raison de présenter toujours des fables que leurs auditeurs connaissaient parfaitement. Le drame doit être compris à demi-mot et sans qu’on ait besoin de saisir toute la logique du discours. C’est ce que ne comprennent pas ceux qui veulent faire des pièces à thèses.
Les auteurs qui prônent un théatre du peuple, me semblent aller contre l ’expérience en voulant lui apprendre la sociologie au théatre : le peuple français n’a plus de légendes ; il ne comprend facilement que le crime du Petit Journal, ce qui lui permet de goûter le drame de l’Ambigu 9.
Il y aurait, pour un poète comme vous, un beau sujet à traiter : ce
�. Joachim Gasquet, Dionysos. Tragédie lyrique en trois actes, Paris, Libr. Charpentier et Fasquelle, 1905. Tirée des Bacchantes d’Euripide, cette tragédie fut représentée au Théâtre antique d’Orange en avril 1904 et reprise à l’Œuvre de Paris en février 1905. Nous n’avons pu retrouver la référence de la recension mentionnée.�. L’Ambigu, théâtre populaire de Paris.
Documents.indd 17 9/05/08 11:17:01
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
160
serait la détermination des tas de sentiment[s] d’un peuple par le théa-tre populaire. Ainsi la pièce patriotique n’a pas beaucoup de succès ; la pièce d’aventures extravagantes et audacieuses produit toujours son effet ; l ’Ambigu est resté plus moral que le roman contemporain ; la jeune fille persécutée qui devient riche plaît prodigieusement au spectateur, etc. Je doute que les pièces de nos grands auteurs du Français 10 aient un grand succès auprès du peuple ; l ’apologie de l’amour coupable froisse encore les âmes simples.
Mais je m’aperçois que je m’égare et que le savetier parle de la c[h]lamyde.
Agréez avec mes remerciements, l ’expression de mon dévouement
G. Sorel
413 [mars 11] 1910
Monsieur,Je suis très heureux de connaître le jugement que vous portez sur le
Mystère de la charité de Jeanne d’Arc 12 ; Péguy, qui a fort goûté vos articles sur Rostand 13, sera très flatté de vos appréciations que je lui com-muniquerai jeudi.
La situation est aujourd’hui celle-ci. Il y a une très grande opposition dans le monde universitaire et parmi les républicains qui comprennent, plus ou moins instinctivement, la portée du livre. Les opposants paraissent vouloir adopter une tactique fort habile : ne pas proclamer hautement leur haine, accepter l’ensemble en faisant des réserves, refuser ainsi tout combat et attendre patiemment que le silence les délivre d’une obsession contre laquelle la lutte directe serait difficile. Cette tactique est très dangereuse pour Péguy ; pour empêcher le succès de ses ennemis, il faudrait pouvoir agir sur un monde provincial, moins versatile que le monde parisien ; mais ce monde n’écoute pas facilement les gens qui n’ont pas déjà une autorité. Il aurait été très utile de pouvoir obtenir un article dans le Correspondant qui a une clientèle de lecteurs acheteurs de livres ; mais cela ne se fera pas sans peine 14.
�0. Le Théâtre-Français, théâtre de Paris.��. Sorel écrit par erreur « février ».��. Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc, Cahiers de la Quinzaine, XIe série, 6e cahier, 16 janvier 1910.��. Joachim Gasquet, « Le krach Rostand », l ’Éclair, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 février et 1er mars 1910.��. Au même moment, Sorel essayait en vain de convaincre Daniel Halévy d’écrire
Documents.indd 18 9/05/08 11:17:02
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
161
Pour le moment, il va y avoir un article de M. P. Lasserre dans l’Action française ; je crois que cet article sera très bon pour Péguy 15.
Ne pourriez-vous exprimer quelque part votre opinion, en faisant res-sortir à la fois la valeur littéraire et la portée sociale de l’œuvre ? Les grands journaux de province sont malheureusement presque tous « blocards ». Je crois que l’Éclair est assez lu en province : si M. Judet voulait bien vous autoriser à parler de ce livre avec l ’ampleur que comporte l ’importance du sujet, on obtiendrait peut-être un résultat sérieux.
Une démarche a été faite auprès de Drumont et il est très probable qu’il donnera son avis dans la Libre parole. Je crois qu’il faudra essayer aussi d’obtenir un article dans l’Univers qui doit avoir encore en province pas mal de fidèles.
Agréez avec mes remerciements l ’assurance de mon entier dévouement
G. Sorel
Si vous étiez libre un jeudi l’après-midi, vous feriez grand plaisir à Péguy en passant aux Cahiers de la quinzaine 8 rue de la Sorbonne 16 ; il y a là tous les jeudis une petite bande d’amis de Péguy qui seraient heureux de causer avec vous.
5
18 mars 1910Cher monsieur,
J’ai montré hier à Péguy votre lettre ; il a été très frappé des belles observations de critique littéraire qu’elle renferme et il vous serait extrê-mement obligé si vous pouviez consacrer au Mystère de Jeanne d’Arc une étude dans l’Éclair 17.
Drumont a écrit le 14 un article très beau, dans lequel il a donné cours à la tristesse qu’avait réveillée en lui l ’émotion produite par la lecture 18. L’Univers va faire un article 19 ; il y en aura un dans les Débats 20.
un article pour le Correspondant (voir les lettres du 8 et 12 [mars] 1910, in Michel Prat (ed.), « Lettres de Georges Sorel à Daniel Halévy (1907-1920) », Mil neuf cent, 12, 1994, p. 180-182).��. L’article de Pierre Lasserre paraîtra dans le numéro du 22 mars 1910.��. Depuis 1906, Gasquet avait un pied-à-terre à Paris.��. Joachim Gasquet ne fit pas d’article dans l ’Éclair.��. Édouard Drumont publia son article dans la Libre parole.��. Il sera publié par Eugène Tavernier dans le numéro du 27 mars 1910.�0. Il sera publié par Henry Bidou dans le numéro du 31 mai 1910.
Documents.indd 19 9/05/08 11:17:03
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes
Comme je vous l’ai dit l ’autre jour, la grosse affaire est d’agir sur la clientèle provinciale ; à Paris il y a une telle mobilité qu’on n’est jamais sûr de son public. Les adversaires du livre (et ils sont légion dans la « Défense républicaine ») comptent sur cette mobilité pour avoir raison de Péguy ; ils trouvent habile de ne pas livrer de bataille. Il n’est pas facile de vaincre dans de pareilles conditions.
Agréez, avec mes remerciements, l ’assurance de mes sentiments tout dévoués
G. Sorel
623 novembre 1911
Cher monsieur,J’ai vu hier M. E. Baumann qui m’a donné votre adresse et m’a appris
que vous lisiez avec plaisir l’Indépendance 21. Cette revue commence à avoir une assez bonne place à Paris et nous espérons que, si tous les amis de la revue s’occupent de la propager, sa vie régulière sera rapidement assurée.
Nous serions extrêmement heureux de pouvoir vous compter parmi nos collaborateurs. M. E. Baumann pense que vous seriez disposé à aider notre entreprise ; nous nous efforçons de n’admettre que des articles d’une bonne tenue littéraire et d’une noble élévation ; votre place serait vraiment bien parmi nous 22.
Agréez, avec l ’assurance de mes meilleurs souvenirs, celle de mes sen-timents les plus dévoués.
G. Sorel
��. Émile Baumann (1868-1941), écrivain catholique, alors professeur au lycée de Sens, était un ami de longue date de Gasquet (leur rencontre remontait à 1895) avec qui il entretenait une abondante correspondance (au vu de laquelle se trouve confortée l’opinion de Sorel pour qui Baumann se regarde « comme un prédestiné et une sorte d’inspiré », cf. la lettre à Joseph Lotte du 20 janvier 1913, in l ’Amitié Charles Péguy, V, 33, mai 1953, p. 14). Il fut membre dès le départ du comité de rédaction de l ’Indépendance, revue co-fondée par Sorel et Jean Variot en mars 1911. Sur Baumann, voir Louis-Alphonse Maugendre, La renaissance catholique au début du xxe siècle, V, Paris, Beauchesne, 1969.��. Joachim Gasquet ne collaborera pas à la revue. Émile Baumann avait consacré un article à son recueil de vers Le paradis retrouvé : « Le prisme lyrique », l ’Indépendance, I, 9, 1er juillet 1911, p. 364-369.
Documents.indd 20 9/05/08 11:17:04
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
90.
44.2
20.1
04 -
16/
04/2
015
16h1
1. ©
Soc
iété
d’é
tude
s so
rélie
nnes
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 90.44.220.104 - 16/04/2015 16h11. ©
Société d’études soréliennes