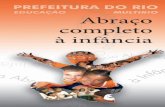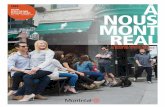Les formations d’élite face à leur nouveau public. Ethnographie du travail de recrutement des...
-
Upload
u-picardie -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Les formations d’élite face à leur nouveau public. Ethnographie du travail de recrutement des...
Les formations d’élite face à leur nouveau public.Ethnographie du travail de recrutement des élèves de milieu
populaire à l’Université d’Oxford.
Elite institutions and their new audiences.Ethnography of Student recruitment activities in a context of
Widening participationThe case of Oxford University.
Annabelle AllouchMaître de conférences en Sociologie à l’Université de Picardie-
Jules Verne (CURAPP-ESS/CNRS)Chercheure associée à Sciences Po (OSC/CNRS)
Working paper présenté au colloque RESUP 2014 à l’ENS de Lyon
Abstract :Le présent article a pour objectif de cerner les pratiquesprofessionnelles liées à l’ouverture sociale dans uneuniversité d’élite et ses conséquences sur les missions etl’organisation des admissions, à partir du cas des programmesmis en œuvre à l’Université d’Oxford. Pour ce faire, il emploie une approche inspirée de travaux desociologie économique développés autour de la notion de« captation », pensée ici comme un mode de coordination entreune institution et un public aux caractéristiques socialesdisjointes. A partir de cette grille d’analyse, l’article repose sur troispoints. Il souligne tout d’abord l’importance de labureaucratisation de l’ouverture sociale à Oxford, qui rendpossible l’émergence d’un espace institutionnel distinct, dotéde personnels, d’un réseau et de routines professionnelles adhoc. En fait, cet espace est investi comme un dispositifsociotechnique qui vise, par le biais de diverses stratégies, àconvertir les principes de jugement des élèves, à la faveur del’offre universitaire proposée par Oxford. Néanmoins, cette«coordination par la conversion/prescription » se heurte àplusieurs limites, qui remettent en cause son efficacité : laréputation élitiste et la faiblesse des liens avec
l’enseignement secondaire tendent ainsi à réduire les chancesd’un engagement définitif de l’élève.
Comprendre l’ouverture sociale comme un dispositif de« captation » présente deux avantages. Tout d’abord, celapermet de souligner que le rôle des admissions ne relève passeulement de la catégorisation des individus par l’institutionmais également d’une forme de coordination rhétorique,symbolique et matérielle qui se propose de pallier au « déficitsociocognitif » des élèves. Les admissions ne relèvent doncplus seulement d’un jugement académique mais d’unesocialisation institutionnelle dont les bornes temporelles etsymboliques dépassent largement les frontières du « concours ».Ensuite, le recours à la captation permet d’éclairer le rôle ducontexte institutionnel dans les processus de socialisation misen œuvre par ce type de programmes, mais aussi la porosité del’ouverture sociale avec d’autres questions qui s’imposent auxinstitutions universitaires, comme l’individualisation durapport entre l’institution et son élève dans un contexte demarchandisation du secteur.
Les formations d’élite face à leur nouveau public.Ethnographie du travail de recrutement des élèves de milieupopulaire à l’Université d’Oxford.
Annabelle Allouch
Les programmes d’ouverture sociale lancés au début des années2000 dans les Grandes Ecoles françaises 1 ont fait l’objetd’une attention médiatique inédite dans le champ del’éducation. Toutefois, leurs effets sur les institutionsd’élite à leur initiative demeurent largement méconnus, à lafaveur des effets controversés qu’ils susciteraient sur lestrajectoires scolaires et sociales des élèves. A partir del’étude la mise en œuvre de l’ouverture sociale à l’Universitéd’Oxford, cet article éclaire les reconfigurations1 On utilise ici la notion d’ « ouverture sociale » comme catégorieautochtone. L’emploi d’un tel terme par les acteurs repose sur la nécessitéde différencier ce type de programmes d’autres politiques visant àaméliorer l’égalité des chances, ou, plus récemment, la « diversité » dansle secteur éducatif et dans l’accès au marché du travail.
institutionnelles suscitées par ce type de programmes et leursconséquences sur les services chargés des admissions enpremière année. Plus largement, l’étude illustre le changementau sein des structures des formations d’élite, de leursmissions de socialisation et de sélection lorsqu’elles sont« saisies » par de nouveaux publics.
Le choix de concentrer l’étude sur l’Université d’Oxford,institution traditionnellement associée à la formation desélites britanniques (Rothblatt, 2007), consiste à fournir unpoint de comparaison aux études françaises portant sur l’accèsaux filières d’excellence, ou sur la figure du concours, quirelèvent souvent d’une approche exclusivement nationale(Eymeri-Douzans, 2012)2. L’étude du cas de l’Angleterre3
apparaît particulièrement pertinente pour trois raisons4. Toutd’abord, le système d’enseignement supérieur anglais secaractérise, tout comme le système français, par une fortesegmentation entre filières d’élite et universités plus oumoins « massifiées », créatrice d’une forte ségrégation socialeà l’entrée (Boliver, 2006 ; Shavit, 2007). La question del’ouverture sociale s’y présente donc sous des termes trèssimilaires à la France, notamment parce qu’elle se fonde sur untravail sur les classes sociales plutôt que sur l’ethnicité,plus centrale aux Etats-Unis. Ensuite, l’Angleterre s’impose comme un contexte typique pourétudier les modalités de réforme des institutions du supérieurdans un contexte de libéralisation de l’éducation (Gewirtz,2001; Ball, 2007 ; van Zanten, 2010). Le marché y est alorsperçu par les autorités publiques comme un levier possible derégulation de la qualité de l’offre éducative, dans le
2 La mobilisation de l’exemple de l’affirmative action « à l’américaine » estquant à elle mobilisée pour illustrer le caractère moralement inacceptabledes quotas ethniques dans le cadre légal français. Les travaux de DanielSabbagh (Par exemple, 2006) ainsi que le numéro récent de Sociétéscontemporaines sur la diversité dans la formation des élites constituent uneexception (Sociétés contemporaines, 2010). 3 On parlera ici du cas anglais et non britannique, étant donné que lapolitique d’enseignement supérieur est dévolue à chacune des « nations »qui composent le Royaume-Uni. 4 Se pencher sur le cas de cette université sélective mais étrangère permetpar ailleurs de mettre à distance les nombreux commentaires sur les GrandesEcoles françaises, oscillant généralement entre accusations d’élitisme etanalyses mobilisant des formes vulgarisées de la théorie de la reproductionsociale.
secondaire et dans le supérieur (BIS, 2011). Il est égalementinvesti comme un moyen de réduire les inégalités scolaires parune simplification de l’accès à l’information des élèves demilieux populaires (McCraig, 2011). L’exemple anglais permetainsi d’éclaircir les modalités de l’articulation despolitiques d’ouverture sociale avec d’autres enjeuxinstitutionnels, dont celles visant à la marchandisation del’enseignement supérieur, alors que celles-ci demeurentdéconnectées dans le cas français5.Enfin, au regard des programmes d’ouverture sociale français,les politiques d’ouverture sociale anglaises reposent sur unevoie médiane qui permet de repenser les catégories instituéespar les acteurs français (Allouch, 2013). En effet, elles neproposent pas de réformer l’examen d’entrée en première annéecomme c’est le cas à Sciences Po, mais elles l’amendent,notamment en fournissant aux enseignants des données surl’origine sociale et scolaire des étudiants6. Parallèlement,elles promeuvent la création de nouveaux espaces desocialisation anticipatrice organisés avant le moment desadmissions : c’est le système de l’outreach7. Reconnue par les
5 Une telle déconnection entre le traitement de la question de l’ouverturesociale et celui des marchés de recrutement des universités ainsi qu’avecla question du positionnement de l’école dans le champ du supérieur est enpartie liée aux discours des acteurs sur l’ouverture sociale qui seréclament d’abord de logiques de solidarité. Par ailleurs, l’articulationde ces logiques avec des logiques marchandes émergentes dans le champéducatif sont rendues muettes par l’appropriation de notions comme celle de« diversité » qui, d’origine managériale, inclut ces logiques marchandes demanière implicite. (Duru-Bellat, 2011, Sénac-Slawinski, 2011)
6 Il s’agit des contextual data qui, à partir de 2008, permettent auxexaminateurs d’établir la participation de l’élève aux différentes offresd’outreach. D’autres universités pourront par ailleurs reconnaître cetravail de « labellisation » de la valeur sociale et scolaire de l’élève(Milburn, 2009).7 L’usage de cette notion n’est pas à proprement parler limitée au secteurde l’éducation, bien qu’elle y soit utilisée comme une méthode privilégiéed’inclusion de populations marginalisées, de par leur appartenance à ungroupe social ou ethnique, dans un contexte de coupe budgétaire : lalittérature professionnelle sur l’outreach à l’université la désigne ainsicomme « une tentative systématique de pourvoir des services au-delà deslimites conventionnelles, à des segments particulier d’une communauté (…).L’outreach suggère précisément l’idée qu’il faut “entrer en contact” (reachingout) avec le monde au-delà des frontières de l’institution. » (Dolan, 2008,p.3)
institutions publiques pour son caractère flexible etrelativement peu coûteux (Sutton trust, 2010 ; Milburn 2009),l’outreach se décline en une multitude d’activités de formationvisant à élever les ambitions (« aspiration raising ») d’élèvesissus de milieux populaires, c’est-à-dire à les inciter àentrer dans l’enseignement supérieur. Il s’agit ici, commec’est le cas des programmes de type « Une Grande Ecole,Pourquoi pas moi ? » à l’ESSEC, d’assurer la socialisation decertains publics à des normes culturelles et scolaires envigueur dans l’espace universitaire, au travers d’activitéspédagogiques et ludiques multiples (Allouch, van Zanten, 2008).Ces activités n’ont pas pour but exclusif de capter de nouveauxcandidats vers les procédures de recrutement des universitésqui les organisent. Selon le contexte institutionnel danslequel elles s’inscrivent, elles peuvent également s’articulerà une mission de promotion de l’enseignement supérieur pourtous, selon un discours de justification qui relève de ladéfense de l’égalité des chances.
Dans toutes ces dimensions, l’ouverture sociale institue unerelation inédite entre les institutions de formation des éliteset un nouveau type de public (voire un nouveau groupe social),qui n’était autrefois pas concerné par leur offre académique etqu’elles contribuent à qualifier scolairement 8. L’ouverturesociale affecte donc non seulement les référentiels mobilisésdans le cadre de politiques éducatives étatiques (van Zanten,2010 ; Soubiron, 2010) mais également la nature des missionsdes établissements du supérieur et leur organisation, enpromouvant une mission de « recrutement » des élèves au seindes admissions, qui anticipe le travail de sélection àproprement parler.
Le présent article vise donc à cerner les pratiquesprofessionnelles liées à l’ouverture sociale dans une
8 Ce public est socialement caractérisé par son appartenance aux classespopulaires (working-class), par un handicap d’accès à un capital économiqueet/ou culturel et social (deprived background) et par le fait qu’il soit issud’établissements publics du secondaire (from state schools). Est par ailleurspris en compte le fait qu’aucun des membres de la famille de l’élève nesoit passé par une formation du supérieur. L’usage de ces critères pourdéfinir le public de l’outreach contribue à légitimer cette catégorisationdes classes populaires dans l’espace scolaire et à assurer leur diffusiondans l’espace public.
université d’élite et ses conséquences sur les missions etl’organisation des admissions. Il s’agit moins de se concentrersur les effets des programmes sur les élèves (Allouch, 2013 ;Oberti et al., 2009 ; Pasquali, 2009) que sur les interactionsprofessionnelles et institutionnelles que ces programmesimpliquent. En ce sens, l’ethnographie de l’institution autravail, à partir des pratiques et des représentations de ceuxqui y officient –et en particulier les personnelsadministratifs- permet de comprendre les conditionsorganisationnelles qui prévalent lors de la sélection et de lasocialisation des élèves dans ces établissements d’élite, alorsque cette dimension est largement passée sous silence dansl’abondante littérature disponible sur la question.
Note méthodologique
Cet article se fonde sur des observations participantes menées entre2008 et 2010 lors de séances d’activités pédagogiques de trois collegesde l’Université d’Oxford. Alors que nos observations visaient àcomprendre les modalités de transmission des savoirs à l’œuvre dansces dispositifs (Allouch, 2013), on a vu émerger, à partir dutravail des agents, des logiques de reconfiguration plus larges desmissions des universités. Ces données ethnographiques ont étécomplétées par une cinquantaine entretiens semi-directifs auprès desagents responsables de l’ouverture sociale et des bénéficiaires desdispositifs, ainsi que par une analyse documentaire des rapportsofficiels produits par l’université entre 1993 et 2010.
Dans les faits, la politique d’ouverture sociale menée àl’Université d’Oxford apparaît multiforme parce qu’elle n’est pascentralisée dans les mains d’un seul service. Son caractère plurielreflète ainsi l’organisation fédérale de l’université, divisée entreune administration centrale chargée de la gouvernance et desdépartements disciplinaires chargés de la recherche, et d’une partiedes cours. Au niveau « fédéré », l’ouverture sociale joue aussi dansles colleges9, puissantes unités de formation dont le prestige estfondé sur une autonomie organisationnelle et financière plus oumoins grande vis-à-vis de l’Université. Ce prestige assure également
9 Historiquement, les colleges sont les premières entités de l’université.S’assimilant à des monastères plus ou moins organisés sous la forme d’uneconfédération, elles assurent la formation, le logement et les loisirs desélèves au sein d’un groupe dont le nombre varie selon leur capacitéd’accueil. Ils se différencient des départements, création récente, par lefait qu’ils n’assurent pas d’activités de recherche. Ces derniers sontquant à eux directement financés par l’université centrale.
la reconnaissance de leur autorité traditionnelle de dernièreinstance dans les décisions d’admission10.
Malgré cette pluralité des dispositifs, le réseau resserré d’acteursqui interviennent sur ces questions nous a conduit à anonymiser nonseulement le nom des individus mais aussi celui des colleges del’Université. Les administrateurs et chargés de mission del’ouverture sociale représentant environ une cinquantaine depersonnes réparties à la hauteur d’une à deux personnes par colleges -identifier les colleges reviendrait ainsi à identifier les agents.Néanmoins, on a tenté ici de préciser pour les plus importantsd’entre eux les caractéristiques (taille du college, prestige, rapportà des réseaux d’anciens, etc.) qui illustrent leur positionspécifique dans l’espace du recrutement oxonien.
Plus largement, le choix de se concentrer sur l’ouverture socialemet au jour l’existence d’une spécialisation dans le travail desadmissions, consécutive à une individualisation des principes derecrutement autour des caractéristiques des élèves. En conséquence,on ne traitera ici que des politiques d’admission vues par le prismede l’ouverture sociale, puisque les acteurs qui y sont impliqués nesont ni chargés des admissions d’étudiants internationaux11, ni desétudiants entrant au niveau du Master (postgraduates).
La littérature sur les admissions dans ce type d’institutionsapparaît en effet avant tout centrée sur les effets scolaireset sociaux de la sélection sur les individus. La sociologiecritique a ainsi développé une théorie des admissions vuescomme un rite de passage qui, limité par les bornes temporellesdu concours, viendrait certifier scolairement les dispositionssociales des individus. Dans cette perspective, les procéduresde sélection se voient attribuer le statut d’une boîte noirequi valide « comme par magie » les acquis de la socialisationreçue au préalable, en particulier au sein des classespréparatoires aux Grandes écoles, pour le cas français(Bourdieu, 1989).
10 Un entretien oral assuré par les enseignants permet de conforter leurmainmise sur les décisions liées à la sélection. Celles-ci demeurenttoutefois standardisées entre les colleges, sous la houlette del’administration centrale.11 Pour une étude des procédures d’accueil des étudiants internationaux à l’Université d’Oxford, on se reportera à la thèse de Mariana Losada (2011).
Des études plus récentes ont néanmoins cherché à « ouvrir »cette boîte noire, en tentant d’appréhender les logiquesinstitutionnelles qui président aux décisions d’admission(Karabel, 2008 ; Darmon, 2012). Elles s’inscrivent dans unrenouveau des travaux sur la sélection et la socialisation ausein des formations d’élite, particulièrement fécond aux Etats-Unis (Anteby, 2013 ; Gatzambide-Fernandez, 2010 ; Khan, 2011 ;McDonough, 1997). Parmi ces études, l’enquête menée parMitchell Stevens au sein du service de recrutement d’uneuniversité d’élite américaine a la première soulignél’importance de l’organisation matérielle de l’université (enparticulier le travail de tri des candidatures par lespersonnels administratifs) comme une variable déterminante dansles décisions de sélection (Stevens, 2008).
Une telle lecture organisationnelle des admissions saisies parle travail des agents administratifs est également présentedans un ensemble d’études parfois appelée « enrollmentmanagement ». Comme dans l’analyse de Mitchell Stevens, ellesse concentrent sur la capacité des institutions à orienter demanière stratégique le recrutement de leurs étudiants selon unesérie de variables endogènes et exogènes (Black, 2004 ;Hossler, Bean, 1990). Elles soulignent alors l’importance de lastabilité des personnels et des relations institutionnelles àl’intérieur des universités pour la maîtrise de leurrecrutement (Kraatz et al, 2010)12.
Cette approche centrée sur les acteurs « du bas de l’actionpublique »- ces « street level bureaucrats » pour reprendre le termede Michael Lipsky- présente trois avantages. Elle rend enpremier lieu visible le travail quotidien d’adaptation desroutines de classement et de socialisation des individus parl’institution scolaire. En cela, elle fournit unéclaircissement sur les conditions organisationnelles de cettesocialisation élitaire. Ensuite, elle éclaire la constructioninstitutionnelle de ce type d’établissements, en se déprenant
12 L’article se concentrera également sur le travail administratif desagents de recrutement, sans négliger leurs trajectoires sociales et lesdiscours qu’ils développent à l’égard de l’égalité des chances. Notre étudepropose ici une lecture de l’organisation et du travail d’une universitéproche des travaux français sur les guichets des administrations publiques(Avril et al., 2005 ; Dubois, 1999 ; Siblot, 2006).
de la parole des acteurs les plus visibles dans desinstitutions où la prise de décision est souvent décrite commepersonnelle et hiérarchique (Garrigou, 2001). Enfin, comme il adéjà été dit, cette approche permet de discuter l’articulationentre les enjeux des différentes réformes dans le champ del’enseignement supérieur, sans présumer de leur caractèreforcément complémentaire ou de leur exclusivité sur le terrain.
Si les programmes d’ouverture sociale à Oxford contribuent àéclairer les conditions du travail de socialisation dans lesétablissements d’élite, ils répondent également à des logiquesinstitutionnelles particulières qu’il convient de décrire. Ce que les programmes d’ouverture sociale contribuent à créerde manière artificielle c’est en fait une disjonction entre uneinstitution d’élites et un public en quelque sorte« inattendu » : celui d’élèves issus de milieux populaires dontles dispositions sociales et scolaires ne relèvent pas, a priori,des routines institutionnelles de l’Université. Ce constat dedisjonction relève à la fois de dispositions du groupeobjectivables par le sociologue (sur la base de la professiondes parents, du choix des établissements scolaires et desfilières, de la zone d’habitation, etc. mis au regard du publictraditionnel de l’Université) mais également, comme on l’a dit,d’un travail de catégorisation sociale des individus effectuépar l’institution. Les élèves concernés par l’ouverture socialesont ainsi définis par un « déficit sociocognitif », qui renddifficile voire impossible l’identification de l’offrepédagogique d’Oxford comme un horizon des possibles.
Comment dès lors assurer la coordination entre ces deuxgroupes ?
Des analyses issues de la sociologie économique fournissent unegrille de lecture pertinente des processus de coordination ausein d’un échange marchand13. Elles postulent ainsi que la
13 L’usage de la sociologie économique pour comprendre des logiquesinstitutionnelles propres à l’enseignement supérieur a particulièrement étédéveloppé par les travaux de Christine Musselin. C’est en particulier lecas de ces travaux portant sur les processus de sélection desuniversitaires en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, quimobilisent les travaux de Lucien Karpik (2007) (Musselin, 2005). On seplace dans la continuité de ces analyses.
coordination entre une offre et une demande relève de lamobilisation de dispositifs sociotechniques et d’un réseaud’acteurs spécifiques, qui rendent possible la « captation »d’un client vers l’offre qui lui est proposée (Cochoy, 2004 ;Dubuisson-Quellier, 1999). Le processus de la captationconsiste alors à orienter le choix des clients puis à s’assurerleur engagement dans la relation marchande. La captation peutégalement contraindre et convertir les dispositions du client,lorsqu’elle repose sur un dispositif sociotechnique particulierqui permet l’encadrement très resserré de l’individu versl’offre (Trompette, 2005). Elle fournit donc une lecture relationnelle de la coordinationmarchande où l’échange n’est jamais seulement déterminé par lesseules qualités de l’offre (« Oxford est trop élitiste », pourreprendre le discours de sens commun ») ni par les seulesdispositions des clients (« les étudiants de milieu populairene sont pas intéressés par l’Université d’Oxford et, plusgénéralement, par des études longues ») 14. Au contraire, commel’affirme Pascale Trompette dans ses travaux sur le marchéfunéraire, la coordination peut finalement dépendre del’environnement matériel et symbolique dans lequel elles’inscrit15.
Recourir à « la captation » permet alors de comprendre, demanière plus fine et en contexte, les logiques de constructionpar les universités de dispositifs visant à susciterl’engagement d’élèves de milieu populaire ; la manière dont cesdispositifs tentent, par le biais de l’usage stratégique d’unenvironnement matériel donné, d’affecter et d’orienter leschoix scolaires des élèves ; et, plus globalement, decomprendre les effets de ces dispositifs ad hoc surl’organisation matérielle des admissions, c’est-à-dire sur14 Cette grille de lecture relationnelle présente alors l’avantage des’émanciper d’une sociologie de la mobilité sociale par l’école qui reposeavant tout sur une compréhension des dispositions sociales des étudiants demilieux populaires et qui tend, du même coup, à négliger les effetsspécifiques du contexte universitaire dans lequel ils s’engagent.15 On ne postule pas ici que l’ouverture sociale, ni même le systèmeéducatif dans son ensemble, relève effectivement d’une relation marchande.Il s’agit plutôt de considérer que la relation marchande relève d’unerelation sociale plus générale, celle de la coordination, que l’on trouveparticulièrement dans le cas des marchés économiques, mais qui s’enémancipe largement.
l’organisation des dispositifs traditionnels de recrutement etde sélection des élèves.
L’article propose donc un développement en trois temps. Tout d’abord, l’ouverture sociale affecte l’organisation desadmissions en ce qu’elles les politisent. Elles deviennentalors l’objet d’une régulation accrue par les autoritéspubliques. Cette régulation aboutit à une bureaucratisation del’ouverture sociale marquée par l’émergence de personnelsspécialisés. Cette bureaucratisation accompagne plusglobalement un glissement du travail des admissions d’unefonction administrative anonyme vers une relation de serviceindividualisée aux candidats. Ce sont ces logiquesinstitutionnelles qui rendent possible l’émergence de nouveauxespaces de socialisation, spécialement dédiés à la captationdes élèves de milieux populaires (I). La deuxième partie del’article se penche quant à elle sur les différentes étapes quiorganisent le travail de la captation lors des séancesd’outreach. Celui-ci se déroule en deux ou trois temps. Onassiste d’abord à un travail de légitimation du caractèredistinctif de l’offre pédagogique et de l’organisation del’Université d’Oxford. Ensuite, les agents tentent deneutraliser les espaces ou les pratiques universitaires lesplus socialement situées par un travail discursif et grâce àdes leviers ludiques. En cela, ils tentent de mettre en œuvreune conversion des principes de jugement scolaire des élèves àla faveur de l’offre oxonienne. Ils s’imposent donc comme desintermédiaires agissant, dans le cadre d’un dispositifsociotechnique précis, dans un but prescriptif (II). Toutefois,les processus de captation connaissent également des « ratés »,qui ne permettent de s’assurer de l’engagement des élèves quede manière marginale. Ceci est lié, d’une part, à l’émergencede multiples dispositifs d’ouverture sociale qui visent tous àattirer le même type d’élève. Les agents chargés de lacaptation se trouvent alors dans une situation de concurrenceavant même le début de l’interaction avec l’élève. D’autrepart, la captation oxonienne se heurte à la faiblesse du réseaud’agents dont elle bénéficie. En effet, la réputation élitistede l’établissement crée une tension avec les enseignants,pourtant chargés d’assurer la continuité symbolique dudispositif. Celle-ci ne se résout que dans « une mise en scèneritualisée de soi » par les agents, dans le but d’établir une
relation de confiance entre l’institution et ses nouveauxpublics. De ce point de vue, le bon fonctionnement de lacaptation des classes populaires à Oxford apparaît étroitementdépendant de la capacité des agents administratifs à pérenniserle lien avec des acteurs aux intérêts volatiles, dans uncontexte spatio-temporel très étendu (III).
1. Sélectionner sans reproduire : conditions politiques etinstitutionnelles du recrutement des classes populaires àl’Université d’Oxford
Comprendre les actions de captation des élèves de milieupopulaire à l’Université d’Oxford nécessite d’effectuer unretour sur les conditions institutionnelles d’émergence del’ouverture sociale en Angleterre. Celles-ci s’inscrivent dansun contexte plus large de reconfiguration du rapport desuniversités d’élite à l’Etat, à la faveur de ce dernier, ce quicontribue à fortement politiser la question des admissions.L’ouverture sociale s’inscrit également dans un contexte deglissement du travail des admissions d’une tâche administrativeanonyme à un service individualisé aux candidats, désormaisconsidérés comme des usagers dotés de droits. C’est ce contexte de politisation, d’individualisation dutraitement des étudiants et de reconfiguration des pouvoirs àl’intérieur et à l’extérieur de l’Université qui explique la
forme de l’ouverture sociale mise en œuvre à Oxford.Concrètement, celle-ci prend la forme d’une fortebureaucratisation, marquée par l’emploi de personnels et lacréation de routines professionnels ad hoc. Cettebureaucratisation rend à son tour possible l’émergence d’unespace de formation stabilisé, spécialement dédié aux classespopulaires : c’est l’outreach. Néanmoins, le personnel en charge de ces questions demeure peulégitime et écartelé entre une mission de solidarité et unemission de recrutement correspondant aux intérêts stratégiquesde l’institution.
1.1. Le New Labour et l’accroissement de la régulation de l’enseignement supérieurpar l’Etat L’arrivée au pouvoir du New Labour en 1997 ratifie le changementde paradigme des travaillistes sur l’éducation. Plutôt que decontinuer à soutenir une politique égalitariste portée par lescomprehensive schools, le parti au pouvoir se convertit à uneacceptation large de l’égalité des chances qui valorise uneapproche plus individualisante des inégalités scolaires. Celle-ci accompagne un tournant néo-libéral plus général despolitiques sociales anglaises vers une responsabilisation descitoyens et la promotion des pratiques de choix dans le servicepublic (Tournadre-Planck, 2010 ; Bartlett et al., 1998). Ils’agit aussi, dans un contexte de crise budgétaire,d’encourager la délégation des questions éducatives à denouveaux acteurs non étatiques (Ball, 2004). C’estparticulièrement le cas des universités, identifiées comme unmaillon central des trajectoires de mobilité sociale etacadémique (Milburn, 2009).
La promotion d’un traitement individualisé des inégalitésscolaires a pour conséquence une segmentation de l’offreéducative, non seulement à destination des plus défavorisés,mais aussi à destination de ceux identifiés comme les plusméritants (Ball, 2009). Ainsi, les programmes Gifted and Talentedou encore AimHigher, créés en 1998 (Chilosi, Noble, Broadhead,2010), visent à identifier des jeunes aux bons résultats endépit d’un environnement social jugé handicapant16. Dans la
16Selon la production institutionnelle, ce qui caractérise l’origine socialed’un individu n’est plus son appartenance à la classe ouvrière mais son
doctrine travailliste, le lancement de ces mesures corresponden fait à l’objectif de l’accès de 50% d’une classe d’âge àl’université, afin de répondre à la demande d’une « économie dela connaissance » qui nécessiterait l’entrée de nouveauxpublics à l’université (Tapper, 2007).
Cette approche apparaît relativement contradictoire avec laposture de retrait à l’égard des besoins du marché du travailet aux injonctions de l’État qu’entretiennenttraditionnellement les Universités d’Oxford et celle deCambridge (Ramirez, 2007). Contrairement au cas français desGrandes Écoles, la formation des cadres et des hauts-fonctionnaires ne relève pas des compétences originelles de cesdeux ancient universities et notamment d’Oxford (Vernon, 2004). Aucontraire, on assiste au XVIIème siècle à un glissement desmissions de l’Université du rôle de formation du clergécatholique et anglican à celui de formation des héritiers desgrandes familles anglaises (Soares, 1999). Celles-ci assurenten retour le financement de l’Université par le biais dedonations ainsi que par celui des frais d’inscription, ce quipermet à Oxford de bénéficier de capitaux économiques etsymboliques importants et relativement indépendants du budgetde l’État. Cette indépendance lui permettait de mettre àdistance les velléités étatiques de contrôle du secteur (Deemet al, 2007).
Néanmoins, un tel retrait apparaît difficilement tenable au vude l’accroissement de la part de l’État dans le financement del’université, qui rend inévitable une participation auxpolitiques d’ouverture nationale lancées au niveau national(Soares, 1999). Ce phénomène, qui date de l’après-guerre, s’estvu amplifié dans les années 1980 par l’intervention croissanted’autorités gouvernementales comme le Higher Education FundingCouncil (HEFCE) dans la régulation du secteur (Tapper, 2007).Paradoxalement, malgré leur caractère traditionnellement privé,les universités présentent donc de grandes similitudes avecl’ensemble des services publics visés par des politiques de
immersion dans un milieu caractérisé par des ressources financièreslimitées et une limitation dans la possibilité des choix scolaires quis’ouvrent à lui au lycée. Cela s’accompagne d’une paupérisation de l’espacede vie qui entraîne une dégradation de l’accès à un capital social utile àl’entrée dans le supérieur et sur le marché du travail (voir par exempleMilburn, 2009).
modernisation de l’État-Providence fondées sur la réduction descoûts et l’introduction de logiques de rentabilité et decompétitivité (Le Galès, Scott, 2009). Le cas de l’Universitéd’Oxford paraît ainsi symptomatique d’un environnement normatifécartelé entre injonction à la démocratisation de l’accès enpremière année, intérêt économique et légitimation politique,pour une institution d’élite caractérisée traditionnellementpar sa sélectivité sociale (Zimdars, 2007).
La pression croissante sur les établissements d’enseignementsupérieur en matière d’ouverture sociale s’illustre enparticulier par la mise en œuvre d’un système national derégulation et d’évaluation par les résultats géré par uneagence indépendante : l’Office for Fair Access (OFFA). Créée en 2004,son pouvoir repose sur la mise en œuvre d’une politique decontractualisation avec les universités qui s’engagent toutes àrespecter des objectifs chiffrés visant à assurer la diversitésociale des étudiants. Il s’agit en particulier de développerdes pratiques permettant l’augmentation du nombre d’étudiantsissus de milieux populaires, ce qui signifie que l’universitédoit désormais être capable de produire des chiffresfalsifiables sur les caractéristiques sociales de sesétudiants. En assurant une régulation par l’évaluation derésultats, cette autorité contribue donc à asseoir le pouvoirdu « Ministère de l’Enseignement supérieur » sur lesuniversités.
L’ouverture sociale contribue également à légitimer lapolitique gouvernementale de dérégulation des fraisd’inscription lancée en 1997 par le rapport Dearing et qui faitl’objet d’une forte controverse parmi les parlementairestravaillistes (Watson, 2007). En contrepartie du respect desobjectifs chiffrés, les universités se voient accorder lapossibilité d’augmenter leurs frais d’inscription, à cette dateencore fixés à un plafond de 3000 livres sterlings. Ainsi, loinde s’inscrire exclusivement dans une logique de solidarité,l’ouverture sociale anglaise relève de logiques de marché oùles élèves de milieu populaire identifiés comme « àpotentiel17 » permettraient de répondre aux injonctions17 La notion de potentiel est une notion clé pour comprendre l’impact desprogrammes d’ouverture sociale sur les épreuves de sélection ainsi que letravail de catégorisation des élèves qu’ils établissent. Il s’agit d’unenotion d’origine managériale qui est associée à certains tests
contradictoires posées à l’Université par l’État et par lemarché de l’enseignement supérieur. 1.2. Les admissions : d’une fonction administrative au service à l’usager
Les réformes entreprises incitent également au renouvellementdes pratiques des agents chargés des admissions et à leursrapports aux usagers en général qui, de simples candidatsanonymes, deviennent non seulement des « consommateurséclairés » (BIS, 2011) mais aussi des citoyens dotés de droitsà l’égard d’institutions désormais responsables (accountable)(Feintuck, Stevens, 2013). Un tel glissement engendre unereconfiguration du travail des enseignants du supérieur, quivoient leur monopole sur les admissions remis en cause par denouveaux personnels administratifs chargés d’assurer unrecrutement qui se présente désormais comme une « nouvellerelation de service », en amont de la décision de sélection.
“En soi, les admissions sont un service à l’institution parce qu’ellesconstituent un mécanisme qui assure la transition des étudiants entre lelycée et un cours à l’université. Maintenant, ça va être bien plus qu’uneprocédure. Il va falloir que les gens en charge des admissions développentun ethos de service (service ethos) parce qu’ils vont être confrontés à desconsommateurs qui répondent à leurs propres intérêts au sein del’institution. C’est quelque chose que les personnels ne voient pasforcément parce que les admissions répondent d’abord à une fonctionadministrative. Les élèves c’est d’abord des fichiers administratifs, vousles traitez, puis un jour ils rentrent à la fac, ou non. Ce n’est plus lecas : il faut rencontrer les parents, les enseignants, les servicesd’orientation et bien-sûr les élèves. ( …) Maintenant, il faut informer,rassurer, assurer la transparence : tout ce qui fait la stratégie d’unservice client se retrouve dans les admissions. Du coup, les managersdoivent se rendent compte que leur rôle ne se limite plus à amener desétudiants à occuper des places disponibles. » (Administratrice d’unorganisme national chargé de l’enseignement supérieur, Septembre 2010.)
Dans ces conditions, le service des admissions devient uninterlocuteur à part entière des candidats et de leurfamille18 : principal pourvoyeur d’informations sur les
psychotechniques de sélection visant à établir l’admission sur des critèresalternatifs aux résultats scolaires afin de faciliter la diversité sociale.Par extension, cette notion contribue finalement à créer une catégoriealternative qui désigne les bons élèves de classes populaires dans lesystème éducatif sélectif (Allouch, 2013). 18 Ce droit concerne d’ailleurs également la famille des candidats quibénéficient de recours possibles, devant une juridiction interne àl’Université, contre des décisions d’admission qui leur semblent contraires
épreuves d’entrée en première année, il n’est plus seulementune simple procédure bureaucratique et anonyme mais un guichetaccueillant qui incite à l’interaction entre les agentsinstitutionnels et les étudiants. A Oxford, la direction desadmissions se dote en 2006 d’une équipe chargée spécifiquementde l’accueil du public, dans un espace dédié : l’admissioninformation centre. Le service n’apparaît plus exclusivement tournéexclusivement vers des besoins logistiques de l’Université,mais devient un secteur stratégique dans sa gouvernance et sonrapport aux groupes professionnels –enseignants du secondaireen tête- et sociaux.
Si cette proximité symbolique accrue affecte l’ensemble despublics de l’université, elle concerne particulièrement lescandidats visés par l’ouverture sociale. Ainsi, la proximitégéographique, assurée par la mobilité des routinesprofessionnelles des agents, avec les écoles « défavorisées»partenaires des programmes doit assurer l’efficacité desdispositifs autour d’un territoire aux contours évolutifs : la« communauté » (Schnecker, 2010). Un tel postulat facilite ladétection d’individus correspondant aux critères sociaux etscolaires dans les lycées, rôle délégué jusqu’en 2010 à desplateformes déconcentrées liées à AimHigher, avec lesquelles lesuniversités sont invitées à collaborer (HEFCE, 2003). Avec leurdisparition, les universités sont ainsi chargées de mettre enrelation les établissements, les élèves et leurs parents, encourt-circuitant les autorités éducatives locales, conformémentà la réorganisation des politiques éducatives prévues par leparti travailliste (Antanion, Dyson et Raffo, 2007). Enconséquence, ces plateformes concourent à l’élaboration d’unréseau localisé d’écoles qui génère une demande de service àl’égard des institutions du supérieur. Paradoxalement, cetancrage local du réseau d’ouverture sociale contribue àréinscrire l’Université d’Oxford dans « une communauté », alorsque ses objectifs de recrutement se définissent de longue datedans un cadre national et international (Evans, 2010).
Ces logiques nationales d’individualisation et de proximitésymbolique ou géographique avec les publics se traduisent en
aux principes de transparence et d’équité revendiquées par l’Université. Cecas souligne la prégnance des logiques de juridicisation des admissions quiaccompagnent la marchandisation de l’enseignement supérieur en Angleterre.
interne par l’emploi de nouveaux personnels, qui validentl’existence d’un espace de recrutement spécifique aux élèves declasses populaires. Néanmoins, la forte politisation de laquestion ne se traduit pas par une forte légitimité de cesnouveaux agents, qui demeurent pris dans des logiques decompétition internes à l’Université.
1.3. La bureaucratisation de l’offre d’ouverture sociale à Oxford et l’émergence denouveaux personnels
La multiplication des plateformes de type Aim Higher suscite uneexplosion des demandes d’informations de la part desétablissements du secondaire et l’institutionnalisation del’offre de l’ouverture sociale à Oxford. Ce phénomènes’accompagne de la mise en œuvre des premiers contrats signés(access agreements) avec l’OFFA. En conséquence, on assiste à laréforme de la gestion des admissions au sein del’administration centrale d’Oxford qui crée, en 2006, unservice entier dédié à l’ouverture sociale afin de rationaliserl’offre d’outreach déjà foisonnante. Ce nouveau service, quis’articule avec le département des relations publiques, marquela prise de pouvoir de l’Université centrale sur les admissionspuisqu’il remplace l’Oxford central admission office (OCAO) géré par lescolleges, traditionnellement chargés de l’organisation matérielledes épreuves.
Parallèlement à l’institutionnalisation de la question auniveau de l’administration centrale, les colleges d’Oxfordemploient à partir de 2000 un personnel ad hoc et spécialisé :les chargés de mission « Ouverture sociale » (access and wideningparticipation officers). Ces derniers assurent aussi le traitementbureaucratique de la demande de visites et d’informationssuscitées par les plateformes comme Aim Higher. Toutefois, cettebureaucratisation « en cascade » n’est pas synonyme d’une plusgrande cohésion entre les services, qui demeurent autonomes lesuns des autres. Hiérarchiquement, les personnels des collegesdépendent soit des enseignants ayant la charge des admissionsau sein du college, soit des secrétaires généraux de ces mêmesinstitutions qui occupent, elles, des fonctionsadministratives. Cette dichotomie renforce encorel’hétérogénéité de leurs missions d’un college à l’autre.
C’est dans ce contexte que le Gainsborough college 19, qui concentreles attributs symboliques et matériels du projet oxonien deformation des élites20, développe son offre d’outreach. À partirde 2004, il emploie à cet effet une jeune diplômée de français,Liz, recrutée sur la base de sa connaissance intime del’Université. Mais sa jeunesse et le fait qu’il s’agisse de sonpremier emploi salarié la placent dans une position dominée àl’intérieur du college. Le traitement de l’ouverture socialeapparaît comme un travail peu valorisé au sein del’institution, d’autant plus qu’il est déconnecté desopérations de sélection des élèves qui reviennent auxenseignants. Vu du college, il se présente alors comme relevantexclusivement d’une logique charitable.
Le profil de Liz est un bon exemple de la trajectoireprofessionnelle de ces chargés de mission, catégorie d’agentslargement féminisée (sur une cinquantaine de personnes, oncompte seulement deux hommes), nouvellement diplômée (entre 25et 30 ans en moyenne) et pour qui il s’agit souvent du premieremploi permanent. Ces agents se caractérisent par ailleurs parune forme de militantisme pragmatique qui les rapproche desjeunes enseignants français (Rayou, van Zanten, 2004). L’entréedans la fonction est ainsi corrélée à des formes antérieuresd’engagement pour la cause, par exemple en tant que tuteur(Allouch, van Zanten, 2008) ou bien à la suite d’une premièreexpérience d’enseignement. Elle peut également relever d’unetrajectoire sociale ascendante marquée par l’accès au diplômeuniversitaire. C’est justement ce qu’indique une chargée demission de St Jerome, idéal-typique de la fonction :
« Je viens d’un milieu non traditionnel (non-traditionnal background) selon lesstandards d’Oxford. Je venais d’une école publique du nord de l’Angleterrequi envoie rarement des élèves à Oxford ou à Cambridge. C’est quelque chosedont j’ai pris conscience en arrivant ici. Je voulais qu’il y ait plus degens comme moi à Oxford, donc je me suis investie dans plein de projetsétudiants d’ouverture sociale21. ” (Chargée de mission du St Jerome college)
19 Il s’agit d’un nom fictif.20 Gainsborough college est le lieu de formation d’une cinquantaine de premiersministres britanniques et de 17 gouverneurs des Indes. Il se caractérisepar ailleurs par un recrutement très élitiste (il est le college qui reçoitle plus de candidatures de la part des anciens d’Eton) et par unenvironnement architectural qu’on peut qualifier de « gothiqueflamboyant », qui en fait un des lieux les plus visités de l’Université.
Malgré les difficultés liées à sa fonction, Liz développe uneoffre pléthorique d’activités à destination d’élèves dusecondaire, de la troisième à la Terminale, mais aussi àdestination de leurs enseignants et leurs parents. En, 2007-2008, elle organise ainsi 72 évènements dont 47 journées devisite à Oxford. Elle visite à son tour 15 lycées partenaires.Parmi ces 72 évènements, 43 concernent des state schools, 13 despublic schools22 et 13 des évènements à destination d’autres typesde populations (enseignants, élèves handicapés, etc.)23.
Mais le développement de cette offre n’épuise pas la questionde son ajustement avec la demande émanant des usagers : le rôledes chargés de mission s’assimile alors à celuid’intermédiaires24 qui gèrent l’appariement entre offre etdemande d’ouverture sociale. C’est dans ce travaild’appariement de l’outreach qu’émerge le recrutement desuniversités, fruit de la négociation des acteurs entre lesinjonctions contradictoires dictées par le principe desolidarité qui sous-tend initialement l’ouverture sociale, etla nécessité de garder en tête les intérêts institutionnelsspécifiques de l’Université liés à la sélection des meilleursélèves. Dans ce cadre, c’est la position spécifique d’Oxford ausein du champ académique ainsi que son organisation collégialequi déterminent les pratiques des acteurs, plutôt que la seulerégulation étatique à l’œuvre par le biais de l’OFFA, bras« armé » de l’HEFCE. Mais ces tensions internes affaiblissentégalement les missions de ces personnels.
21 Les extraits d’entretien et d’observations ont été traduits parl’auteure. 22 La chargé de mission demeure parfois tributaire des réseaux déjàexistants qui lient son college à des lycées privés ou à des lycées publicsréputés, qui peuvent être amenés à investir les dispositifs d’ouverturesociale comme une source alternative d’informations pour leurs élèves.Conformément à sa position dominée de l’agent au sein de l’institution, Lizpeut difficilement refuser d’organiser une journée d’accueil, même pour desélèves qui ne correspondent pas aux critères sociaux généralement associésaux dispositifs. 23 Archives personnelles de la chargée de mission de Gainsbourough College. 24 La notion d’intermédiaire est empruntée à la sociologie économique,notamment appliquée au marché du travail. Elle souligne l’importance depersonnel ad hoc dans la construction des marchés, c’est-à-dire dans larencontre entre une offre de biens et une demande. Sur ce point, voir parexemple Bessy C. et al, 2001.
Student
Recruit
-mentAccess
Widening
Participatio
n
Il cible spécifiquement les écoles les plus performantes académiquement qu’elles soient publiques ou privées. BUT: Faire que ces étudiants candidatent à Oxford et à St Matthews.Il cible les étudiants les plus performants académiquement, scolarisés dans le secteur public, issus d’un milieu socio-économique peu élevé, les minorités ethniques et les populations qui bénéficient d’une aide sociale. BUT : Faire qu’ils considèrent l’offre d’Oxford, qu’ils candidatent et, lorsque cela est pertinent qu’ils candidatent à St Matthews.
Il cible les étudiants dotés du potentiel pour progresser jusqu’aux A-levels, qu’ils considèrent une candidature à Oxford ou pas. BUT: Faire que ces étudiants restent au lycée après 16 ans dans le but ultime d’atteindre une filière du supérieur, quelle qu’elle soit.
1.4. L’égalité des chances sous tension : entre militantisme pour l’égalité et respectdes logiques institutionnelles de recrutement
Au problème de la faible légitimité institutionnelle des agentss’ajoute celui de leur écartèlement entre plusieurs impératifs,tous sous-entendus dans l’outreach. En principe, l’offre estdéfinie par le service central des admissions et repose surtrois critères, tels qu’ils sont exposés par les acteurs dansle schéma suivant. Ce type de document, que l’on retrouvefréquemment affiché dans les bureaux des agents, émane desacteurs du centre : en proposant aux chargés de mission desprincipes d’éclaircissement et de justification de leursfonctions, ils rendent en théorie possible une standardisationdes pratiques entre les colleges, sous l’égide du service centralde l’Université.
Fig.1 : Reproduction du schéma des politiques d’égalité des chances àl’Université d’Oxford, Mai 200925.
25 Document fourni par la chargée de mission de St Matthews, accroché au mur de son bureau. Mai 2009.
Si le schéma paraît a priori clair, le chargé de mission seretrouve pris dans des injonctions contradictoires sur leterrain, imposées par les agencements locaux propres à chaquecollege ou à chaque département, selon leur position sur lemarché du recrutement oxonien. En découle une disjonction entrele registre militant et le registre gestionnaire autour de sesconditions de travail, où la gestion de la question durecrutement adapté aux besoins de l’université apparaît commeun « sale boulot ». Il considéré comme entrant en contradictionavec l’engagement au nom de la cause de l’égalité des chanceset de la justice sociale qui présidait à l’entrée dans lafonction.
« L’outreach, pour moi c’est vendre ma discipline dans tout le pays, enparticulier dans les écoles publiques. Mais est-ce que c’est de la wideningparticipation où l’on essaie de faire que plus de gens y soient concernés parl’éducation (Get people more included in education)? Est-ce que c’est de l’accessafin que les gens rentrent dans l’enseignement supérieur? Est-ce que c’estdu recrutement (student recruitment), spécifiquement tourné vers l’objectifd’avoir des candidats en musique à Oxford ? Tous ces objectifs sontdifférents: Recruter des étudiants pour Oxford, ça n’est pas vendre madiscipline à des écoles publiques. Parce que je vends ma matière (I am sellingmy subject) à des élèves qui n’auront jamais trois A aux A-levels. Et donc quine seront jamais éligibles à Oxford. Et il faut qu’il y ait un équilibreentre ces objectifs. Et à mon avis, la musique est un excellent instrumentpour améliorer les ambitions concernant l’enseignement supérieur. Alors,moi je veux prendre le point de vue de widening participation, mais je subis despressions pour que plus de gens postulent (…). Des pressions de la part del’équipe des admissions de l’université. De la faculté. Il y a une vraietension entre l’outreach et le fait de vendre ma discipline et le fait de merendre compte que ça va encore prendre cinq ans avant que les gens necommencent à candidater. Mais je suis seulement là pour deux ans et il fautque j’atteigne un résultat. Et ça, ça m’embête. » (Chargée d’ouverturesociale, Département de musique)
D’un côté, la logique de la widening participation correspond à uneapproche politique du problème des inégalités scolaires quireflète la position complexe de l’Université face à l’Etat, auxpolitiques éducatives et aux attentes de la société. Del’autre, la logique d’Access, imbriquée dans celle du studentrecruitment, correspond à la nécessaire captation de candidatsprésentant plusieurs caractéristiques importantes pour lalégitimité politique de l’université mais aussi pour la survieéconomique de certaines de ses composantes. C’est enparticulier le cas des colleges les moins dotés financièrement,sans donateurs privés ou simplement sans fonds propres, mais
aussi des facultés disciplinaires les moins prestigieuses pourqui l’outreach représente un afflux potentiel de demandesd’inscription. Ce que dévoile la tentative de définition de l’outreach par ceschargés de mission, c’est donc le travail de ciblage des élèveseffectué en amont par les agents. Dès la prise de contact avecle lycée, les chargés de mission sont invités à catégoriser lesélèves selon les objectifs institutionnels à remplir. Auxmeilleurs élèves (où à ceux captés en amont par des plateformesd’outreach), on propose des activités d’access. Aux autres, onpropose des activités moins intensives ou qui concernentl’accès au supérieur en général et non à Oxford en particulier.Cette activité de tri, toujours fondée sur l’étude de donnéesstatistiques sur le lycée, est définie comme une étape obligéedu travail des agents. C’est ce qu’explique la chargée demission du St Matthews collège :
« Depuis quelques années, St Matthews a travaillé selon une idée à laquelleje n’adhère pas forcément et qui repose sur le fait que ce sont les écolesqui nous contactent avant que nous les contactions. Ils nous demandent devenir ou de monter une visite ici. J’essaie de cibler ce que l’on fait,parce qu’évidemment nous voulons des jeunes qui viennent des écoles quin’ont que faire de nous. Parfois, ce sont d’excellentes écoles mais ilsn’envoient simplement pas leurs élèves à Oxford. Nous, ce que l’on veutc’est que ces écoles viennent mais si l’on se contente de dire “Toutes lesécoles peuvent venir”, ce type d’écoles ne viendra pas. Il faut que l’on yaille et faire que les écoles s’impliquent. C’est quelque chose surlaquelle je travaille et qui n’a pas été fait ces dernières années à StMatthews. Donc on a toujours les mêmes écoles, encore et toujours, et cen’est pas quelque chose de très positif. Et même dans ce groupe d’écoles,il y a des enseignants qui... qui peut-être ne sont pas prêts à offrir lesoutien académique dont un élève aurait besoin pour entrer à Oxford.”(Chargé de mission à St Matthews.)
En instaurant une catégorisation claire des lycées, on se donnefinalement les moyens d’atteindre les objectifs des troiscatégories décrites par le schéma, ce qui, par ailleurs, permetà l’agent de faire correspondre ses pratiques à son ethosmilitant.
L’introduction de l’ouverture sociale par la voie d’unerégulation étatique institutionnalise les conditions d’unedisjonction sociale entre une institution dont la missionoriginelle est celle de former les élites avec des publicspopulaires dont le nombre –régulation par l’évaluation oblige-
doit dépasser le seuil atteint par les anciens « boursiers »(scholar)26. Néanmoins, cette introduction ne reflète passeulement la capacité des institutions à intérioriser unecritique qui porterait sur leur recrutement élitiste endéveloppant une nouvelle bureaucratie (Boltanski, Chiappello,1999). L’étude rapprochée des routines professionnelles del’ouverture sociale permet également de souligner l’émergenced’un espace professionnel et pédagogique particulier quis’autonomise institutionnellement, tout en restant contraintpar des enjeux stratégiques liés à la position de l’institutiondans l’espace académique et dans le champ du pouvoir. Cesenjeux sont également relatifs aux rapports de force autour desadmissions entre les colleges et les services centraux del’Université. On comprend alors que le recours à la captationfonctionne non seulement comme une tentative de réponse à laquestion de la coordination avec le public, mais aussi auxquestions posées par l’organisation particulière del’Université. C’est ce contexte particulier qui détermineégalement le travail des agents de l’ouverture socialeoxonienne lors des séances d’outreach. C’est donc la nature dece travail de captation, qui s’assimile en fait à un travail desocialisation à des principes de jugement scolaire spécifiques,que l’on souhaiterait désormais aborder.
26 La figure du « scholar », terme traduit dans la sociologie française parle terme de « boursiers », désigne de la fin du XVIIIème siècle au début duXXème siècle les étudiants oxoniens (ou de Cambridge) titulaires d’unebourse d’études (scholarship), obtenue sur critères scolaires. L’obtention decette bourse trouvait en fait une force d’assignation statutaire dans lamesure où elle signifiait moins le niveau scolaire de l’élève que le manquede ressources financières de ses parents. Le statut de scholar, véritableexception statistique dans la population étudiante de l’époque, sedistinguait alors de celui de commoner, étudiant inscrit de droit sur labase de ses ressources familiales et, le plus souvent, sur larecommandation de divers acteurs pédagogiques (Deans de colleges, enseignantsdu secondaire privé, etc.). La figure du scholar a été particulièrementpopularisée par les travaux de Richard Hoggart, notamment ceux rédigés àpartir de sa propre trajectoire (Hoggart, 2013). Néanmoins, elle ne désignepas seulement les étudiants de milieux populaires scolarisés dans lesinstitutions d’élite mais également ceux qui suivaient leur scolarité dansdes lycées sélectifs : les Grammar schools.
2. Former pour recruter: rhétoriques et pratiques de lacaptation des classes populaires dans les séancesd’outreach
La sélection à l’Université ne relève donc pas seulement d’untravail de catégorisation, mais également d’un travail decaptation de populations. Dans le cas de l’ouverture sociale, oùles candidats se différencient par leurs caractéristiquessociales, la captation repose sur trois éléments. Tout d’abord,elle se présente une forme de socialisation scolaire, celled’une séquence d’apprentissage sur la base d’une interaction detype magistrale. Ces séances ne relèvent pas d’une simpletransmission d’informations utiles, mais de l’explicitation desspécificités pédagogiques et sociales proposée par l’Universitéd’Oxford. C’est particulièrement le cas de l’architecture etdes espaces de l’Université jugés les plus explicitementélitaires. Enfin, la captation repose sur une proposition deconversion des principes de jugement à l’œuvre dans le choix deson université. Dès lors, les politiques d’ouverture sociale illustrent lacapacité de l’institution à fabriquer des cadres narratifs quireposent sur la mise en scène complexe de l’environnement del’université, dans une tension constante entre la nécessité desauvegarder le signal de l’excellence et celle de décrypter sescodes à destination d’un public non initié. Ces cadresnarratifs, qui opèrent comme autant de dispositifs orientant lejugement des « usagers » ne font pas qu’assurer la coordinationde l’institution avec ses nouveaux publics. Elles contribuentégalement à structurer les identités institutionnelles desrécipiendaires (Chauvin, 2009)27.
3.1. Formes et contenu de l’outreach : expliciter les tenants d’une offre universitairespécifique
Lorsqu’on se penche sur le contenu des séances d’outreach ausein des différents colleges, on s’aperçoit d’une grandehomogénéité des discours entre les différents acteursinterrogés qui ne reflète pas l’hétérogénéité des missions des27 Autrement dit, ces cadres narratifs ont un effet performatif sur ladéfinition par l’institution des publics de ce message et de leurscaractéristiques sociales. En cela, il semble qu’on assiste à unedéfinition par l’institution scolaire elle- même des déterminants légitimesde choix scolaire.
agents. Ainsi, le postulat principal est partout le même : ilconsiste à socialiser les élèves dans un temps court (d’un jourà une semaine) çà un ensemble d’éléments sur l’enseignementsupérieur et sur l’offre pédagogique d’Oxford en particulier. Cette homogénéité s’explique en partie par le développementprogressif de forums institutionnels de bonnes pratiques entreagents28, mais également par l’existence de réseauxinterpersonnels forts entre ces agents, qui répondent à descaractéristiques sociales et scolaires proches.
Du point de vue du type d’interaction mis en œuvre, l’outreachprend toujours une forme pédagogique fondée sur un rapportentre l’émetteur d’une parole magistrale -le chargé de mission-et le groupe des « usagers » (élèves et enseignants). Laspécificité du rapport pédagogique repose également sur sonenvironnement matériel : il s’agit généralement d’une salle decours ou une salle de réunion d’un college. Toutefois, la pompeliée à la décoration (plafonds gothiques, moquette épaisse etcramoisie, boiseries et stucs, etc.) rappelle le caractèreexceptionnel du lieu dans lequel prend place ce rapportpédagogique. Ce que l’outreach met en scène, c’est en faitl’enchâssement de l’ordinaire (la classe, les pairs, le rapportmagistral) dans un environnement extraordinaire (l’histoire dupays, la religion, les pratiques culturelles et socialeslégitimes d’une classe dominante, etc.). En cela, l’outreach secontente de reproduire dans un temps limité ce qui fait laspécificité implicite de l’offre académique du diplômed’Oxford, à savoir la possibilité d’inclure une trajectoireindividuelle dans l’histoire d’une classe sociale déterminée.
Les évènements d’outreach abordent toutes les questions jugéescentrales par l’institution (admissions, finances, offrepédagogique et sociale, etc.), en divisant la journée de visiteen une série de présentations suivies d’une discussion puisd’une visite guidée du college. Il s’agit alors de se livrer àun travail d’explicitation des particularités de l’institution,de ses ressources spécifiques. Ainsi, la journée débutetoujours par une présentation magistrale, sous une forme plusou moins ludique et interactive, qui explicite la spécificitéde l’offre éducative d’Oxford dans le paysage universitaire.
28 Ces forums pallient alors leur manque de formation ainsi que l’éclatementdes structures proposant de tels programmes d’outreach.
Les acteurs définissent cette spécificité comme relevant detrois ordres : pédagogique, organisationnel et enfin, matérielet financier.
L’offre pédagogique oxonienne est définie comme largementdifférenciée par son organisation fédérale. La question duchoix du college apparaît à cet égard comme un obstaclesupplémentaire dans le processus de choix de l’offre oxoniennepar les élèves. C’est ce qu’indique un enseignant d’histoire duSt Jerome College, en se mettant à la place d’un candidat :
« À quelle université candidater ? Et bien, Oxford n’a pas l’air pas malquand on regarde toutes les universités. Donc, quel college choisir ?(Rires) « Mais c’est quoi ce truc, un college? Bon, finalement je candidate àManchester!” »
Echelon déterminant dans les processus de socialisationétudiante à Oxford, le choix du college représente donc unrisque supplémentaire de “perdre” le candidat, ce qui nécessiteune explicitation particulière de la part du chargé de mission.En parallèle, la spécificité de l’offre pédagogique repose surune approche disciplinaire et curriculaire, considérée comme lereflet de l’absence de lien traditionnel entre Oxford et lemarché du travail (Ramirez, 2007). La filière « littératureanglaise » (English) se détourne ainsi le plus souvent del’apport des sciences sociales ou de disciplines connexes commeles arts du spectacle et la communication. La filière« management » ne date quant à elle que de la fin des années1990 avec la création de la Said Business School. Ce mode destructuration des savoirs, ne valorisant qu’à la marge lesdoubles parcours et l’interdisciplinarité29, est présenté parles agents comme spécifique à l’Université. En choisissantOxford, les élèves s’engagent donc dans un système pédagogiquefortement différencié de celui des autres universités, qui
29 L’absence de disciplines jugées attractives pour les élèves issus de stateschools, car relevant davantage d’une forme de formation professionnelle àrendement immédiat comme le journalisme, est compensée par la possibilitéde participer à une activité étudiante, à la manière d’acteurs célèbresdiplômés d’Oxford mais passés par les compagnies théâtrales étudiantes. Lerecours à la vie sociale permet ainsi de mettre en scène l’expérienceétudiante sur un registre de l’intime et du quotidien qui s’accommode del’exceptionnalité du lieu.
n’est pas, selon le propos des agents, « adapté à tout lemonde. »
Enfin, les ressources matérielles de l’Université sontfortement valorisées mais sous un aspect avant toutquantitatif. Toutefois, il s’agit moins de valoriser lesbourses, pourtant nombreuses, que les ressources matériellesdisponibles. C’est par exemple le cas du parc informatique(« 10 000 ordinateurs, deux milliards d’équipement scientifiquepour 12000 étudiants ») ou de la bibliothèque de l’université,la célèbre Bodleian library présentée comme un fonds de « plus de11 millions de livres, 80 000 titres de presse, 300 milesd’étagères. » (Observation à Holbein College, Mai 2009). Le recours àdes chiffres dont la valeur doit frapper les esprit forme ainsisystème avec l’environnement exceptionnel de l’Université. Parailleurs, la question des frais d’inscription fait l’objet d’untraitement particulier (voir l’encadré suivant).
Les rituels scolaires de l’Université ne sont quant à eux pasdirectement abordés, sauf en cas de question des lycéens.L’espace-temps d’Oxford est en effet saturé de rituelsscolaires (d’entrée, d’examens, de remise de diplômes, depassage à l’année suivante, etc.) qui ont comme particularitéd’être imbriqués au sein de rituels religieux. C’est parexemple le cas de la cérémonie de matriculation où les nouveauxentrants sont bénis en latin par les autorités de l’Université.Cette sacralisation des étapes de la formation, qui s’inscritparfaitement dans la mission traditionnelle de formation desélites de l’institution, peut paraître incompatible avec unelogique d’ouverture sociale, où le public a été généralementscolarisé au sein d’établissements publics et laïcs. Les agentsmettent à ce titre un point d’honneur à rappeler que lafréquentation des chapelles des colleges demeure au gré dechacun30.
« La disparition » : le paradoxe des « récits » liés aux fraisd’inscription
30 Plus globalement, il faut noter que l’ouverture sociale se caractérisejustement des deux côtés de la Manche par une relégitimation des rituelsscolaires laïques dans l’objectif d’élever les niveaux d’aspiration desélèves des milieux populaires.
L’ensemble des études anglaises souligne l’importance du coût des étudesdans la formulation des choix universitaires (voir par exemple Ball etal., 2001), alors même que les frais de scolarité et d’inscription àl’Université sur la période sont amenés à tripler. Or, les chargés demission oxoniens n’abordent explicitement l’aspect économique du choixuniversitaire que sous deux angles. Tout d’abord, sous la forme d’un mythedont il faudrait se détacher : celui selon lequel il faudrait être riche et« bourge » (being rich and posh) pour entrer à Oxford. Dans ce cas, « êtreriche » ne semble pas cibler particulier un cumul de capitaux économiquesmais désigne plutôt le cumul de plusieurs types de ressources dont desressources économiques, cumul qui caractériserait les élites anglaises.Dans un second temps, la dimension économique du choix est compriseexclusivement au travers du prisme de l’accès aux bourses étudiantes. Dansce sens, l’importance de l’argent comme déterminant du choix n’est abordéque par le biais des réponses qui y sont apportées, sans bien même que leproblème du financement ne soit vraiment traité. À partir de nos observations, on constate que les lycéens ont d’ailleursfortement intériorisé cette « disparition »31, en ne posant généralement peude question sur les fees. Dans le cas d’une question éventuelle, lesintermédiaires se contentent d’enclencher deux types de récits : d’un côté,ils rappellent qu’Oxford est l’université où les bourses étudiantes sontles plus généreuses (voir notre encadré précédent sur les mythes). Del’autre, les agents soulignent le fait que le paiement effectif des fraisd’inscription ne survient qu’à partir du paiement du premier salaire.Cette disparition peut s’expliquer de deux façons : soit parce que leschargés de mission tendraient à se censurer en anticipant les craintespossibles que peuvent susciter les frais d’inscription, soit parce quel’information sur ce point était confisquée par les agents spécifiquementchargés des bourses, au sein du service des finances de l’universitécentrale à l’époque de l’enquête. C’est ce que m’indique Dawn, chargée del’ouverture sociale dans deux colleges d’Oxford, qui n’arrive même pas àaccéder à une information à partir du site internet de l’Université.
“There is quite a lot of financial information on the web but again, it’swell hidden! Until last year, it was not one of the main sections on theuniversity website. Even when you went to the undergraduate admissions,there was not a finance section. It was there, it’s just that it was not onthe main menu so...” (Dawn, charge de l’ouverture sociale à St Christopher et St James College)
De ce point de vue, c’est la division du travail entre les services et lemonopole spécifique de la question financière par le niveau central del’université qui induit le cloisonnement de l’information. Plus globalement dans le cas des financements, on voit encore à quel pointle rôle des intermédiaires consiste en fait à produire un ensemble de
31 Résultat qui va à l’encontre des discours de certains enquêtés quim’indiquent qu’il s’agit de l’une des préoccupations centrales des élèves.Il faut alors voir dans le travail de présentation des « mythes » associésà Oxford un travail d’élaboration des argumentaires qui se concentrent surtel ou tel point, selon la trajectoire des individus et leur expérienceuniversitaire.
récits, plus ou moins anecdotiques ou mettant en scène leur propreparcours, et qui visent à orienter les pratiques des choix des acteurs enles ajustant à l’offre pédagogique de l’établissement.
Les observations des séances d’outreach et l’identification desgrands principes d’organisation rhétorique et matérielle quiles traversent permettent de spécifier la nature du travail decaptation mis en œuvre par les chargés de mission. Celui-cirepose sur une logique de socialisation paradoxale, puisquel’élève est invité à intérioriser le caractère distinctif del’offre universitaire. Néanmoins, cette distinction reposeavant tout sur des éléments d’autant plus mélioratifs qu’ilssont situés sur une échelle de valeur qui relève de l’universscolaire (une grande bibliothèque, un suivi pédagogiqueindividuel, une approche disciplinaire traditionnelle, etc.) ou« méritocratique», terme entendu comme la reconnaissancesociale et scolaire des candidats, en particulier incarné parla possibilité d’obtenir de bourses d’études. Les élémentsrelevant plus explicitement d’une position sociale élitaire ouplus sujets à controverse, comme l’architecture, l’histoire del’Université et les conditions de sélection en première année,font quant à eux l’objet d’un travail de « neutralisationsociale » particulier.
3.2. Gérer l’exceptionnel : l’ouverture sociale au prisme du patrimoine symbolique etmatériel d’Oxford.
L’une des fonctions des agents consiste à déconstruire lecaractère exceptionnel de l’ensemble symbolique etarchitectural universitaire, tel qu’il est imbriqué dans laville d’Oxford et plus globalement dans l’histoire monarchiqueet religieuse du pays. A ce titre, le travail d’outreach se concentre particulièrement(mais pas exclusivement) sur le dévoilement de la procédured’admission, perçue comme un « curriculum caché » comportant unensemble complexe de codes symboliques. Ce travail dedévoilement (myth debunking) et de mise en transparence reposesur l’usage rhétorique de la figure du « mythe », définie commel’ensemble des représentations communes ayant trait àl’Université d’Oxford, telles qu’elles diffusées par la pressebritannique et par le système scolaire. Considérées comme un
ensemble systémique, ces mythes forment alors « la réputation »de l’institution.
« Oxford, c’est snob et chic, c’est une université riche seulement faitepour les riches. Il y a un code secret pour y rentrer. Personne ne saitvraiment de quoi il s’agit mais ça doit être lié à ce que vos parents ontpu faire dans leur vie. Là-bas, c’est tous des rats de bibliothèque, ilsn’ont pas de vie, ne voient personne, les tutors sont des gens bizarres (…).Et puis, on les fait venir ici et ils se rendent compte que ce n’est pasforcément la vérité. La manière dont je parle d’Oxford dans ma présentationest radicalement différente de celle dont on parle d’Oxford en général (…).La manière dont je parle d’Oxford est différente parce que les images despinacles, des colleges grandioses rebutent les étudiants des zones aveclesquelles je travaille. On peut en parler plus tard, mais il faut qu’ilsse soient d’abord bien approprié ce qu’est un college avant que je leur disequ’il a été fondé au 17ème siècle. » (Chargée de mission du Reynolds college)
En supposant que la réputation agisse de manière décisive surle choix des récipiendaires de l’outreach, les agents conduisentautant ces derniers à intégrer l’existence de ces mythes que ladémonstration de leur caractère faussé. Ce faisant, ilssocialisent les élèves à un comportement de mise à distanceréflexive des déterminants de leurs choix académiques. Pour ledire autrement, ils les invitent à tester la validité desoutils cognitifs traditionnels mis à leur disposition par leurmilieu social d’origine, leurs parents, leurs enseignants. Enretour, les élèves doivent embrasser les outils proposés commeautant de dispositifs de jugement légitimes. On valorise ainsile goût personnel pour une discipline plutôt que l’influencedes pairs ; l’attraction du challenge intellectuel ;l’expérience étudiante au sens social comme au sens académiquedu terme, etc. (voir l’encadré suivant).
« Qui entre à Oxford (ou pas) ? » Le travail de démythification descritères d’admissions
La déconstruction des mythes associés à Oxford se fonde essentiellement surl’anticipation des représentations des élèves concernant les critèresd’entrée à l’Université. Quelle que soit l’offre « pédagogique » proposée,les mythes constituent –avec les bourses et les conditions d’entrée et deformation- un passage considéré comme obligé des séances d’outreach. Lesextraits d’observation suivants donnent quelques exemples de la teneur dece discours.
« Qui entre à Oxford ? 1) Les critères qui ne sont pas pris en compte :
-Etre riche, snob, être un rat de bibliothèque ou d’une famille qui estallée à l’université.-Venir d’un certain type d’école (sous-entendu d’une public school, ndlr).-En fait, il n’y a qu’un admis sur un million de candidats. 2) Les critères qui sont vraiment pris en compte :-Votre discipline vous passionne.-Vous avez obtenu trois As ou A* aux A-levels. -Vous avez envie de travailler dur (tout en ayant une vie sociale)-Vous être le meilleur, quelle que soit votre origine.”
“Il n’est pas obligatoire d’être riche pour venir ici et Oxford n’est pasplus chère que les autres universités. Et nous avons le système de boursesle plus généreux de toute l’Angleterre ! »
De même, l’obligation éventuelle de faire de l’aviron –image stéréotypée del’activité de l’élève oxonien- est relativisée par les chargés demission sur le ton de l’humour et de l’autodérision.«L’aviron ce n’est pas pour tout le monde, moi y compris ! Ça a été undésastre ! Mais c’est quelque chose qu’on fait très souvent quand on arriveici. » (Extrait d’Aspiration day à Holbein college, 17 Mai 2009.)
C’est donc le travail de neutralisation du caractère socialement situé dela réputation de l’Université qui se donne ici à voir. Celui-cis’accompagne par ailleurs d’un gommage paradoxal du caractère exceptionnelde l’élection scolaire, fourni par l’examen d’entrée. L’admission à Oxfordn’est en ce sens plus impossible, mais à la condition qu’elle repose surdes ressorts de volonté, de goût et de combativité individuels, principessont au cœur du message de l’outreach et auxquels l’élève est invité à seconvertir. Par la présentation et la démythification de l’Université, c’est donc laquestion du rapport au travail scolaire et à la docilité attendue quidevient centrale. Ainsi, les chargés de mission oscillent constamment entrenécessité de rappeler qu’un minimum de travail scolaire est nécessaire afinde remplir l’exigence minimale des trois A au A-levels, et la peur de générerune résistance des enseignants, qui pourraient juger qu’un telinvestissement scolaire sera probablement peu couronné de succès dansl’espace du supérieur. Comme dans le cas français des dispositifs de Sciences Po et de l’ESSEC, lanécessité de s’attacher la croyance des enseignants afin de « capter » lepublic des élèves se fait par la négociation avec les normes scolaires lesplus légitimes dans l’espace universitaire.
Ce travail discursif de « démythification » des catégoriesd’entendement académique s’accompagne d’un travail in situ,propre à la visite, de prise de connaissance de l’espaceuniversitaire. Or celui-ci se caractérise par un travail dedéconstruction des codes symboliques (blasons, devises latines,références aux anciens élèves célèbres, etc.) et architecturaux(omniprésence des lieux de culte anglicans, organisation des
lieux de vie étudiante qui s’intègrent dans des ensemblesinitialement dédiés à la vie monacale, etc.) dans unenvironnement matériel jugé socialement marqué par soninscription dans l’histoire monarchique et aristocratique dupays32. Cet élément est fortement intériorisé par tous lesacteurs académiques ou administratifs de l’Université, pour quiles éléments gothiques ou néo-gothiques de l’architecture nedoivent pas constituer un motif de dissuasion des élèves desclasses populaires en marquant leur distance culturelle etsociale vis-à-vis de l’institution. Il ne s’agit pas pourautant de négliger le signal spécifique de l’ancienneté del’Université, qui ancre matériellement sa réputationd’excellence dans une authentique tradition multiséculaire deformation des élites.
« Si vous mettez les colleges côté à côte, vous voyez qu’il y a les plusanciens qui sont aussi les plus célèbres, mais aussi un college plus moderneet un autre type plus intermédiaire comme Keble, qui date de l’époquevictorienne. Et lorsque les étudiants postulent, ils peuvent faire un choixentre ces colleges (…). Peut-être que ce ne sera pas celui où ils finirontpar étudier mais ils peuvent dire : « Oh, je ne veux pas de toute cettearchitecture gothique. » ou : « Je veux un lieu où il y ait du sport. »Voilà le genre de choses qui peut déterminer le choix des gens. Ça a l’airtrivial d’un point de vue académique mais ce choix va déterminer la manièredont ils vont pouvoir profiter de leurs trois années d’études. »(Administratrice du service central des admissions à Oxford, Juin 2009)
C’est cette logique de neutralisation sociale des espacesuniversitaires qui irrigue l’ensemble de l’offre d’outreachproposé à Oxford. L’institution a en fait recours à une« ludicisation » du scolaire afin pallier l’anomie etl’ascétisme des pratiques universitaires, ascétisme d’ailleursmatérialisé dans les murs des cloîtres oxoniens. À ce titre,l’une des responsables des admissions nous indique qu’elleporte une attention particulière à la fabrication annuelle dela brochure de l’Université33.
32 Il faut d’ailleurs noter le caractère fluctuant de la frontière entre lesespaces publics ou semi-publics de l’université, dédiés, notamment pendantles vacances scolaires, au tourisme de masse et les espaces privés (ousemi-privés) dédiés à la formation et à la vie étudiante et dont l’accèsest limité aux étudiants et aux personnels de l’Université.33 Sur l’importance des brochures et d’autres dispositifs comme les journéesportes-ouvertes, voir les travaux de Ball et al., 2001 et de Ball, Van Zanten, 1998.
« Je pense que le message qui sous-tend tout ce que nous faisons, c’estcelui de mettre un terme aux clichés en disant : « Oui, c’est vrai, nousavons des bâtiments anciens mais les gens qui y vivent sont normaux. »Quand je travaillais dans les relations publiques, j’étais responsable dela brochure de l’université qui s’inscrit évidemment dans ce que nouspensons être à la pointe de…de notre stratégie de vente, si vous voulez.Mon idée concernant la couverture de la brochure, c’est que les lecteursveulent des gens normaux devant des bâtiments magnifiques, parce que ceserait idiot de dire que nous avons des bâtiments ordinaires et que c’estd’ailleurs ça qui fait la réputation d’Oxford, ce que la distingue. Mais tuas besoin de dire que les gens font des choses normales dans cetenvironnement. (…) Je pense que l’architecture très traditionnelle descolleges ne nous aide pas. Ils ont une grande porte de bois, pas de nom surleur fronton. C’est un style monacal qui remonte à leurs origines. Tous lescolleges les plus anciens ont un air intimidant. Si vous n’avez aucune raisond’y entrer, vous restez à l’extérieur” (Administratrice, service desadmissions, administration centrale)
Dans ce travail de dévoilement des caractéristiques sociales del’espace, des références à la culture populaire sontrégulièrement mobilisées afin de stimuler l’imaginaire desélèves. Ainsi, l’immense salle à manger des étudiants et desenseignants du Christ Church college devient consécutivement lasalle à manger de l’école des sorciers dans les films tirés del’ouvrage de JK Rowling, Harry Potter, ou encore le lieu de viede Lewis Caroll, celui-ci s’étant inspiré de nombreux objetsprésents dans la salle dans son livre Alice au pays des merveilles.Les portraits du cardinal Wolfsey, conseiller d’Henri VIII etfondateur du college, ou encore de John Locke, un ancien élèveet enseignant, qui ornent les murs sont quant à eux passés soussilence. Il semble alors qu’on assiste à une véritable« économie des ancêtres » propre à l’outreach, où sont exhibésdes anciens avant tout contemporains et associés au monde desmédias (le scientifique Stephen Hawking, des présentateursvedettes de la BBC, Rowan Atkinson, des médaillés olympiquesbritanniques, etc.) ou du politique (David Cameron, Tony etChérie Blair, Bill Clinton, etc).
L’usage de la notion de « trappes à ancêtres », développée parMary Douglas à la suite d’Evans Pritchard, paraît pertinentpour comprendre les logiques de mobilisation des anciensélèves. Selon elle, l’appel aux ancêtres dans les sociétésdites primitives correspond à une volonté de mise en scèned’une vision égalitariste de la société où tous les individus
seraient inscrits dans un même lignage, celui des ancêtres(Douglas, 1999). En mobilisant les anciens, même s’ils sontassociés à des pratiques culturelles « populaires » et« générationnelles », c’est donc paradoxalement ce processusd’établissement de ce lignage qui se donnerait à voir. Dans uncontexte ludique qui se veut en rupture avec le temps scolaire,le recours à la culture populaire sert de grille de lectured’un monde social marqué par sa proximité explicite avec lasphère religieuse chrétienne et avec les pratiques del’aristocratie et de la bourgeoisie.
Le cas de l’usage détourné d’Harry Potter apparaît d’ailleursd’autant plus intéressant que cette série d’ouvrages proposejustement d’une vision ironique du système de formation desélites anglaises. Par le biais d’une mise en abime inversée,c’est donc la caricature qui vaut ici comme modèle etfonctionne comme grille de lecture des normes en cours dansl’espace social réel. Ce type d’exemples littéraires est enfait courant dans l’ouverture sociale à Oxford. L’ouvraged’Evelyn Waugh Brideshead revisited qui met en scène la vied’étudiants oxoniens au début du XXème siècle, est par exemplemobilisé pour souligner aux yeux des enseignants la distancequi existe entre l’Oxford contemporaine et l’image de lieu deformation des enfants de l’aristocratie décadente décrite parle livre34. C’est la production de ces cadres narratifsspécifiques aux publics de l’ouverture sociale anglaise quifinit par se diffuser dans le reste de l’espace scolaire et,plus largement, dans l’espace public35.
L’outreach fonctionne donc comme un espace où la coordinationrepose sur une conversion/prescription à des principes dejugement académiques alternatifs. Pour ce faire, il est dotéd’intermédiaires (les agents) et d’un dispositif sociotechnique
34 Des références littéraires similaires, comme le Bel-Ami de Guy deMaupassant ou Les Promesses de l’Aube de Romain Gary, sont également mobiliséespar les tuteurs et les lycéens eux-mêmes dans le cadre des politiquesfrançaises, afin d’exalter non pas la « normalité » d’institutionssocialement «distinctives» mais un goût pour l’ascension sociale (Allouch,2013).35 D’autant plus qu’elles s’appuient sur des narrations et des pratiquesdéjà expérimentées par le tourisme de masse, dont l’outreach reprendcertaines formes, comme la visite guidée.
spécifique (les présentations et les visites) qui visent àorienter les individus vers une offre oxonienne désormais« qualifiée » de légitime.A partir de là, un élève passé par le cadre de l’ouverturesociale devrait pouvoir prouver sa capacité à formuler et àjustifier ses choix scolaires selon les critères attendus parl’institution, qui les lui a elle-même inculqués. Tout commeles agents économiques qui construisent le marché de manièreperformative (Callon, 1998), l’outreach formerait alors desindividus à des comportements capables de légitimer et doncreproduire a postériori la hiérarchisation de l’espace académique.Toutefois, ce dispositif rencontre un certain nombre de limitesliées à la réputation élitiste de l’offre oxonienne, qui, sielle peut être mobilisée comme distinctive, peut égalementmettre à mal les liens –déjà fragiles- établis avec d’autresacteurs du réseau formé par le programme d’ouverture sociale,et notamment avec les enseignants du secondaire. Ces sont ceslimites que l’on souhaiterait aborder dans une dernière partie,en revenant sur les processus de captation et de mise en réseaumis en œuvre par les agents autour des séances d’outreach.
3. Une captation impossible ? Enjeux de concurrence et de réputation dans lesdispositifs d’ouverture sociale
La catégorisation institutionnelle des individus selon leursdispositions sociales - en fonction des intérêts del’institution- fait figure de première étape dans le processusde coordination. La légitimation des spécificités de l’offred’Oxford, la neutralisation des espaces sociaux les plusélitaires ainsi que la conversion des principes routiniers dejugements scolaires doivent en quelque sorte parachever ceprocessus. Or, ce dernier n’est pas exempt de difficultés qui,en quelque sorte, enrayent l’enchaînement entre les différentesétapes de la captation.
Ces limites sont triples. Tout d’abord, elles sont liées à lanature non-contractuelle de la relation avec les enseignants dusecondaire. En effet, l’outreach ne se définit pas par unerelation de pouvoir dissymétrique, où l’institution etl’individu seraient liés par un contrat ou par un prixdéterminant la délivrance d’une prestation/allocation. Alorsque l’Université agît sous le coup de contraintes normatives et
financières, elle ne peut donc elle-même contraindre ni laparticipation des publics populaires, ni leur candidatureeffective in fine. Ensuite, l’efficacité du dispositif est limitée par laqualification de l’offre oxonienne, qui demeure « élitiste »,notamment aux yeux des enseignants.
Dès lors, contrairement au cas des marchés funéraires décritspar Pascale Trompette, les enseignants n’assurent pas la miseen place d’un continuum spatio-temporel et/ou symbolique autourde l’élève, qui permettrait sa captation de manière continue.Cet enjeu est d’autant plus crucial que le temps de l’admissionest un temps long. Ainsi, la candidature survient au mieuxtrois mois après les séances d’outreach (pour le cas desTerminales), et au pire deux ans plus tard (pour le cas desélèves de Seconde). Comment faire, dès lors, pour assurer lacontinuité de la captation des élèves ? Ce sont cesdifficultés dans les processus d’articulation des étapes de lacaptation que l’on abordera ici.
3.1. Prendre contact : le difficile enrôlement des enseignants
La première difficulté de coordination à laquelle est confrontél’agent est celle du démarchage des publics potentiellementconcernés par l’ouverture sociale. Si la demande est suscitéepar la multiplication des intermédiaires institutionnels entreenseignement secondaire et supérieure, elle suppose tout demême un travail systématique de publicisation de l’offreoxonienne, dans un environnement marqué par une concurrenced’autant plus forte entre les universités qu’elles recherchentsouvent le même type de publics formés de bons élèves issus demilieu défavorisé. Concrètement, chacun des dispositifs de l’Université repose surl’entretien de liens privilégiés avec des enseignants dusecondaire, à partir d’une liste préétablie de contactstransmis par le biais des réseaux locaux de type AimHigher, outout simplement sur la demande des établissements. En l’absencede ce premier contact, les chargés de mission tentent d’établirpar eux-mêmes une relation avec des interlocuteurs du
secondaire afin de proposer la palette des services à leurdisposition :
« J’ai une liste de toutes les écoles et des contacts réguliers de Liz.Donc, ce que je fais, c’est d’écrire à chaque école. Je leur explique ceque je fais, j’essaie de trouver le contact le plus pertinent. Danscertaines écoles, il y a des coordinateurs « Gifted and Talented ». Parfois lecontact, c’est le proviseur du lycée. Une fois qu’on a trouvé qui pourraitêtre ce premier contact (…), on envoie un mail général qui dit « Chersenseignants, voilà les activités que l’on vous propose… « Aspiration days », ateliers, journéedédiée à une discipline des Humanités… Alors je laisse mes coordonnées etj’attends. La plupart du temps, les écoles reviennent vers nous en disantqu’ils ont bien reçu la lettre et qu’ils voudraient organiser quelquechose.» (Chargé de mission à Hockney College)
La mise en place de cette relation avec les lycées étant lepremier gage du fonctionnement du dispositif, les acteurscomptent sur la diversité de l’offre d’évènements, en supposantque cela stimulera les demandes émanant des types de lycées etd’enseignants recherchés. L’offre varie selon l’âge, puisque lecontenu s’adapte selon que les élèves sont en début ou en finde cycle du secondaire. Cette diversité se matérialise par uneproduction documentaire institutionnelle foisonnante(brochures, CD-roms, posters, etc.) distribuée de manièreintensive. Au fur et à mesure de la multiplication des acteursconcurrentiels dans le champ (c’est-à-dire d’une offre émanantd’autres universités), cette diversification de l’offre devientessentielle, d’autant plus que toutes visent le même type depopulations d’élèves « à potentiel ». C’est d’autant plus lecas pour Oxford que l’Université demeure tributaire d’unrecrutement national et international, donc d’un recrutementqui ne s’ancre a priori pas dans une configuration localeprécise :
« La plupart des universités ont une aire d’influence sur laquelle ils seconcentrent. A Londres, la plupart des étudiants viennent de Londres.Evidemment, ce n’est pas le cas pour nous, mais ça nous laisse aussibeaucoup plus de liberté, d’une certaine façon. Mais il faut que l’on fasseaussi attention de ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Jetravaille dans le pays tout entier. Par exemple, si tu travailles avec desélèves plus jeunes, il est possible que tu dupliques ce que font déjà desuniversités locales et qui le font de la même manière, notamment pour cequi concerne l’élévation des aspirations (aspiration raising).”(Administratrice, Hockney College)
Dans cette configuration, l’offre d’Oxford n’apparaît plus quecomme une proposition parmi d’autres, dépendante du choixexclusif des enseignants, d’autant plus que le champ n’est lui-même pas fluide, puisque le choix des élèves reste déterminépar leur origine sociale et par leurs représentations d’Oxford,notamment sur l’influence des médias (Archers et al., 1999).L’agent est donc invité à penser le contexte de son offred’outreach dans une logique de compétition avec celles d’autresuniversités. Comme pour une étude de marché, la propositiond’offre aura d’autant plus de chances d’aboutir qu’ellecorrespondra aux attentes des enseignants du secondaire36.
Ce travail d’ajustement est décrit par l’administratrice duHockney college comme relevant d’un fine tuning, c’est-à-dire d’unemise en correspondance entre l’offre de l’université et lademande d’outreach37. Cette opération de tuning pourra orienter lecontenu du service proposé selon les caractéristiques de sesélèves. Dans l’idéal, cette « co-production du service » permetainsi de s’assurer de l’engagement de l’enseignant.
En l’absence de ce travail d’ajustement, l’incertitude surl’offre à faire valoir et sur l’efficacité du lien avecl’enseignant demeure. Il est ainsi fréquent que le chargé demission, notamment lors de visites faites dans les écoles,s’aperçoive sur place que la présentation qu’il avaitinitialement prévue n’est pas adaptée au public finalementprésent, ou alors qu’elle n’est pas adaptée au contexteinstitutionnel de la visite. Ainsi, une visite programmée commeétant l’exclusivité d’Oxford peut devenir un « forum del’enseignement supérieur » plus large, où la présentationd’Oxford sera mise en concurrence avec celle d’autresuniversités, obligeant le chargé de mission à « bricoler » sonmessage institutionnel en cours de route38. N’étant pascontractuellement tenus, rien n’indique que les enseignantssélectionneront les élèves correspondant parfaitement à l’offre
36 Néanmoins, le contexte institutionnel éducatif ne considère pas cetterelation comme une relation quasi-marchande, bien qu’elle puisse en avoirles caractéristiques. Il nous semble qu’on se trouve là face à un « tabousocial », comme c’est le cas pour les entreprises de restauration scolaireou encore de pompes funèbres (Dubuisson-Quellier, 1999 ; Trompette, 2005).37 Entretien avec HE, administratrice de Hockney college, Mai 2009.38 Observation d’un forum du supérieur (Higher Education fair) dans un lycée dela région de Birmingham, le 3 Mai 2009.
de service, ni même qu’ils se déplaceront39 ou accueilleront lechargé de mission dans leur établissement. Dans ces conditions, seule l’instauration d’une relation deconfiance entre l’agent, l’enseignant et l’élève permet demettre un terme à la situation d’incertitude causée parl’absence de contrat légal et moral entre les acteurs.
3.2. Etablir « un contrat de confiance » : réputation et mise en scène de l’authenticitéde l’offre
La sociologie du choix scolaire souligne le rôle de laréputation comme l’un des modes de coordination ordinairesentre les institutions scolaires et leurs publics (van Zanten,2009)40. Or, dans le cas de l’Université d’Oxford, cetteréputation peut précisément susciter une forme de méfiance dela part des enseignants qui, bien que présents lors des séancesd’outreach, peuvent s’interroger sur la moralité de l’offre quileur est faite :
« Une fois de temps en temps, on peut rencontrer un prof qui utilise lefait que le débat est ouvert avec les élèves pour remettre en cause tout ceque vous dites. Que vous mentez ou inventez le fait qu’Oxford seraitaccessible. Ca peut être vraiment dérangeant parce que vous savez que vousêtes face à un public d’élèves qui sont eux, plutôt ouverts et prêts àécouter ce que vous avez à dire. Mais l’enseignant peut quitter la salle,parce qu’il est convaincu que ce que vous dites est faux. C’est vraimentdérangeant.» (Chargée de mission à Hockney college)39 Comme indiqué précédemment, cette sélection ex-ante du public estexclusivement effectuée par les professeurs du secondaire sur lesquels lesresponsables de l’outreach n’ont que peu de prise. Ils peuventéventuellement refuser les demandes émanant de groupes qui ne rentrent pasdans les groupes cibles définis par les universités, en les orientant versdes évènements plus classiques de portes ouvertes. Toutefois un refus resteexceptionnel. Lors de nos observations, nous nous rendons ainsi comptequ’un des groupes bénéficiant d’un dispositif est en fait une classe d’uneindependent school et que le père d’une des élèves n’est autre que leprofesseur chargé des admissions du college, et par ailleurs le supérieurhiérarchique de Liz. Celle-ci s’en plaint avec véhémence avant dem’indiquer qu’elle ne peut rien y faire. 40 C’est également le cas des écrits d’Erwing Goffman sur l’établissementd’une relation de service à l’intérieur de l’«institution totale» qu’estl’hôpital psychiatrique (1968). Selon le schéma déployé par l’auteur,l’entrée de l’usager dans la relation de service est motivée par l’identitéprofessionnelle du prestataire (en l’occurrence, le médecin) et lareconnaissance de son expertise, fondée sur sa réputation. Dans le casétudié, c’est aussi la réputation d’excellence d’Oxford qui fait entrerl’enseignant dans le dispositif.
En l’absence de liens contractuels ou moraux forts, laconfiance dans le professionnalisme et la bonne foi de l’expert(ici l’Université) s’imposent comme une condition sinequanone dela relation. Cela nécessite donc un travail constant derenforcement de ce lien, qui n’est pas réductible àl’ajustement précis de l’offre à la demande (ou fine tuning)décrit plus haut par l’administratrice du Hockney college.Concrètement, ce travail réside dans la mobilisation discursive de la trajectoiresociale et scolaire du chargé de mission. Comme c’est le cas despetits fonctionnaires comme les facteurs ou les employés demairie (Cartier, 2003 ; Siblot, 2006), les agents chargés del’ouverture sociale sont amenés à valoriser leur originesociale populaire, ou encore leur appartenance locale, afin defaciliter la délivrance de la prestation. Néanmoins, cettetrajectoire pour être valide dans un tel contexte, doitattester d’une similitude avec celle des usagers. C’est le casde la chargée de mission du Reynolds College qui, née au nord del’Angleterre, met en avant son accent comme une preuve del’authenticité de sa mobilité sociale et géographique et, dumême coup, atteste de l’authenticité du message dont elle sefait porteuse dans la séance d’outreach41.
« Pour moi, c’est très important que les élèves m’entendent parler. Cen’est généralement pas ce à quoi ils s’attendent. Lorsque je téléphone àl’enseignant, la communication passe tout de suite mieux. Les enfantsréagissent aussi très bien à mon accent. Même lorsqu’ils viennent du Sud del’Angleterre, je n’hésite pas à leur dire que je viens du Nord du pays.C’est un signal fort. Et je suis certaine que c’est l’une des raisons pourlaquelle ils m’ont recrutée. Et c’est vrai que ça m’aide. Je suis trèsattachée à la forme académique, mais je n’impose pas aux jeunes mesintérêts académiques. Je parle de mes cours de manière enthousiaste, maisje fais bien attention de ne pas faire sans cesse référence à des chosestrop académiques. Par exemple, quand je les emmène au musée, je ne leur dispas : « Voilà une toile formidable de tel ou tel peintre, blablabla ». Jeleur dis : « Voilà une peinture que je trouve vraiment géniale, vousdevriez aller dans ce musée et voir ce qui vous intéresse, vous. ” (Chargéede mission, Reynolds college)
41 L’accent du Nord de l’Angleterre fait l’objet d’une lecture sociale dansl’imaginaire national, qui associe plus largement les habitants de villesindustrielles comme Manchester ou Liverpool aux classes populaires et aumilieu ouvrier (working class). Lors de notre entretien réalisé en anglais,cette chargée de mission m’indiquera qu’elle parlera justement sans accentafin de faciliter ma compréhension. Cette indication souligne ainsi lacapacité de l’agent à manipuler cette ressource de manière stratégiqueselon les interlocuteurs et selon le message à délivrer.
Ressource mobilisée à destination des enseignants et desélèves, l’accent –ici couplé avec la mise en scène d’un rapportdistancié aux pratiques culturelles et langagières légitimes-relève de la mise en récit stratégique de sa trajectoire parl’agent. On retrouve systématiquement ce travail de narrationde soi lorsqu’on observe les séances d’outreach, selon unscénario immuable qui rappelle la trame séquentielles des policynarratives décrites par Claudio Radaelli42: après une bonnescolarité dans un lycée défavorisé ou géographiquement isolé,l’agent a l’opportunité –avec l’aide d’un adjuvant,généralement un enseignant- d’entrer à Oxford ou dans uneuniversité prestigieuse. À la joie de l’entrée succède en faitle choc (la plupart du temps euphémisé et concentré sur ladifférence du niveau d’exigence scolaire) de l’entrée dans unmilieu reposant sur des normes culturelles, sociales etscolaires propres aux classes moyennes et supérieures etdifférenciées du milieu d’origine. Malgré la prise deconscience de son altérité sociale, et grâce à une capacité derésilience et au soutien de son environnement académique,l’étudiant réussit brillamment sa scolarité et entre sur lemarché du travail.
Cette mise en récit permet d’attester de manière immédiate etirréfutable de la validité du message institutionnel, tout encontribuant à réduire la distance sociale entre les deuxparties. En théorie, on retrouve ici les « deux corps duguichetier » décrits par Vincent Dubois (Dubois, 1999).L’agent, de par sa position en surplomb, se fait le porteur dudiscours de l’institution : il délivre donc le message du« Pourquoi pas moi ? », qui est globalement celui del’institution qu’il représente. Avec son récit et son corps, ilcrée ainsi un lien de connivence et d’attachement avec l’élève.L’agent construit ainsi un rapport de confiance fondé surl’authenticité, en mettant l’institution et les pratiquessociales et culturelles qui lui sont associées à distance, parexemple en parlant avec un accent. Si on peut résumer cetteapproche par la formule : « Pourquoi pas toi, puisque je suis42 « L’ordre temporel des évènements (ou la séquentialité) est une propriétéfondamentale des policy narratives. (ou récits). Les trames ainsi construites reposent sur l’exactitude ou la fausseté des éléments de l’histoire. (…) A ce titre, ils transmettent donc du sens et suggèrent de l’action » (Radaelli, 2010, p. 549)
passé par là ? », le caractère systématique de la mise en récitde l’agent répond avant tout à une attente institutionnelle(l’agent du Reynolds college pense qu’elle a d’ailleurs étéemployée pour son origine) qui relève de la compétenceprofessionnelle : on joue donc la distance à l’institution plusqu’on ne la met en œuvre.
À propos de la construction de la confiance dans les firmes,Pascal Ughetto suggère quant à lui que ce lien de confiance nepeut s’établir dans le cadre d’une économie de service,précisément parce que ce service est par nature troppersonnalisé (Ughetto, 2003). En effet, cette personnalisationlimite la capacité du consommateur à établir des comparaisonsentre les offres qui lui sont proposées, c’est-à-dire qu’ellerend le travail de « commensuration »43 impossible, puisque lesoffres se différencient trop fortement les unes des autres.Cette situation crée alors une incertitude qui peut interromprela relation entre la firme et son client. Dans notre cas, ilsemble alors que c’est la mise en scène de de sescaractéristiques sociales et scolaires propres par l’agent quiassure la continuité du lien, parce qu’il permet une mise enéquivalence entre sa trajectoire et celle de l’élève. Cefaisant, il contribue à réduire le spectre des incertitudespotentielles (scolaires, sociales, éventuellement financières)liées à la candidature en première année. La captation et la« canalisation »44 des usagers vers l’offre d’Oxford dépendentalors de sa capacité à établir une relation de confiance entrel’institution qu’il incarne, l’élève de milieu populaire et sonenseignant. La confiance instaure alors un contrat moral, dontles ressorts fortement affectifs pourraient « obliger »l’élève au mieux à candidater à Oxford, au « pire » à envisagerl’offre comme une alternative crédible.
L’ethnographie de l’ouverture sociale permet de faire surgir unnouveau type de relation entre l’Université d’Oxford et sonusager, qui ne se limite ni à la catégorisationinstitutionnelle des individus « qui viennent à elle » lors desépreuves de sélection, ni à leur socialisation académique et
43 C’est-à-dire de mise en équivalence des offres de diplôme universitaire.44 Pour reprendre le terme de Pascale Trompette au sujet du continuum spatio-temporel assuré sur les marchés funéraires.
sociale45 dans le cadre de leur scolarité. Cette relations’émancipe également d’un contrat normatif et financier quirégit normalement les interactions entre l’étudiant etl’Université, et qui est généralement scellé par une décisiond’admission puis par le paiement de frais d’inscription. Iln’existe pas d’avantage de contrat moral entre l’institution etson public, ce qui justifie l’intervention de l’agent et lamise en scène « de soi » qu’il met en œuvre.
Si elle ne peut se réduire à des relations contractuelles déjàexistantes, quels sont donc les ressorts de cette relationdisjointe mis au jour par l’ouverture sociale ? L’ouverture sociale institue en fait un lien marqué, comme dansle cas des processus de captation sur les marchés funéraires,par l’activation d’un levier émotionnel. Ce recours à l’affectrompt avec les pratiques antérieures liées à la standardisationdu traitement des candidats mis en œuvre en particulier dansl’après-guerre, où ces derniers souvent laissés dans un relatifanonymat (Allouch, 2013). De ce point de vue, le recours àl’affectif est le produit logique du glissement des admissionsd’une standardisation à une individualisation du traitement descandidats46.
La difficulté pour les agents à garantir la continuité du lienentre l’institution et l’élève souligne également l’inversionrelative du rapport de force entre les deux parties.L’institution académique n’y est plus présentée comme « toutepuissante» mais, au contraire, comme une organisation dont lefonctionnement routinier dépend fortement des publics quiviennent à elles. D’où la nécessité d’investir en amont dans la
45 Dans le sens que l’institution socialise les individus à un habitus socialement situé.46 Ce type d’interactions « affectives » n’est évidemment pas foncièrementinnovant dans les établissements d’élite, même s’il a été souvent réduit àla seule notion d’ « esprit de corps ». On définira ici l’esprit de corpscomme l’attachement de l’individu à la défense des intérêts d’uneinstitution en dehors et à l’intérieur de l’espace académique. Cetattachement repose sur un sentiment d’appartenance à une communautééducative à qui l’on associe un ensemble de valeurs et de pratiquesscolaires jugées spécifiques. Le « rite d’admission » incarne alors laformation de cette communauté et doit inaugurer (notamment chez celui-cidont les caractéristiques sociales et scolaires ne sont pas « disjointes »)chez l’individu les premières manifestations de ce sentimentd’appartenance.
construction de ces publics par le biais de nouveaux agentsintermédiaires, qui permettent de résoudre la disjonction entreles deux parties. On se confronte ici à des phénomènesconcomitants à ceux que l’on peut trouver dans les études surla construction de marchés des singularités, particulièrementautour des mondes de l’art (Roueff, 2010). Cela ne signifie pasque cette relation de captation des publics n’existait pasauparavant, par exemple sous la forme de parrainage (Turner,1966) mais qu’elle existe sous une forme renouvelée. En effet,la politisation des admissions frappent d’illégitimité lesformes anciennes de captation -notamment par le biais d’uneentente avec les enseignants des publics schools. Ce phénomène,bien qu’ancien, « frappe » cycliquement ces formes decaptation, désormais considérées comme contraires à une lecturede la sélection comme éthique et morale47. L’ouverture socialene permet donc pas seulement de « politiser » les admissions(Darmon, 2012), elle les moralise également, selon lesprincipes fixés à la fois par les rapports à l’Etat mais aussiles rapports de force internes à l’Université.
Conclusion
L’analyse ethnographique du travail des agents de l’outreachpermet de rétablir les modalités concrètes de production despolitiques d’ouverture sociale d’Oxford et la manière dontelles instituent un nouveau mode de relation entre uneUniversité initialement dédiée à la formation des élites et denouveaux publics populaires. Elle illustre à ce titre lacapacité organisationnelle de ce type d’établissements -d’ailleurs loin d’être homogènes dans leur structure- à adapterleur discours et leur identité à des contraintesinstitutionnelles données. De ce point de vue, le travail deneutralisation des espaces élitaires mais aussi la mise enscène de la trajectoire ascendante des agents, soulignent àquel point les ressources des institutions d’élite ne reposentpas seulement sur la mobilisation du « signal » de l’excellenceacadémique socialement située, mais également sur lareconfiguration constante de ce signal.
47 Pour plus de détail sur ce point voir les chapitres 4 et 5 de la thèse d’Annabelle Allouch (Allouch, 2013).
Le cadrage théorique mobilisé, qui s’éloigne volontairement desanalyses habituellement usitées pour comprendre les processusde reproduction dans l’accès à l’enseignement supérieur –d’ailleurs souvent mobilisées par les acteurs eux-mêmes-,permet en fait de revenir de manière pertinente à la questionde la formation des inégalités dans les processus d’admissiondes établissements d’élite. Il souligne à ce titre l’émergencede nouveaux espaces de recrutement qui anticipent le travail decatégorisation des individus traditionnellement alloué auxadmissions. En fait, malgré les injonctions étatiques, cetravail de recrutement ne parviendrait pas réellement às’émanciper des inégalités traditionnellement produites par lesprocédures de sélection. Dans un contexte institutionnel etpolitique propice à la valorisation de formes de sélectionformelles (nouveaux types de concours) ou informelles(orientation, active, etc.), l’étude ne fait alors que rappelerque la sélection est intrinsèquement un processus socialségrégatif, qui repose sur le tri des individus, quelle quesoit la nature de ce tri et la rhétorique (de solidarité, dediversité, etc.) qui le sous-tend48.Au regard des études disponibles sur l’ouverture sociale, quiportent souvent sur la genèse des dispositifs ou bien –demanière exclusive- sur la socialisation des élèves àl’intérieur des établissements, l’approche « par la captation »rend possible une contextualisation institutionnelle souventmanquante dans l’analyse. Considérer l’espace de recrutement48 L’approche par la captation et, plus globalement, par la coordinationpermet également de relativiser le poids souvent exorbitant donné en Franceaux épreuves de sélection dans la compréhension des structuresuniversitaires d’élite. La « figure du concours », son caractèreméritocratique ambigu et le mystère des critères de sélection mis en œuvre– d’ailleurs savamment orchestré par les institutions elles-mêmes-, tendentalors à obscurcir le travail formel et informel de coordination entrel’institution académique et ses publics. En fait, « tout ce passe commesi » le travail de sélection de l’institution se limitait à l’ouverture duconcours, qui apparaîtrait plus ou moins connu ou plus ou moins attractifselon les dispositions des élèves et leur trajectoire. L’ouverturesociale, en créant une situation de disjonction extrême avec les publics,fournit alors une loupe idéale aux processus ailleurs passés sous silence :loin d’être limitée à un rôle de validation des inégalités sociales déjàexistantes dans le système scolaire, l’établissement du supérieur d’élite« crée » également ses publics, selon les intérêts qu’elle a à défendre. Onretrouve ici, à partir du cas d’Oxford, l’une des conclusions du travail deMitchell Stevens sur les universités de l’Ivy League.
comme un espace de socialisation à des principes de jugementspropres à chaque institution permet ainsi de souligner que cetype de dispositifs, dédié à la mobilité sociale ascendanted’individus de classes populaires, s’ancre évidemment dans uncontexte institutionnel déterminé par la position del’établissement dans le champ académique, ainsi que dans sonrapport à l’Etat et aux groupes sociaux. Il semble alors àl’auteur qu’on ne fait que rappeler la nécessité déjà bienconnue49 d’une analyse comparative (ou de fournir un effort decomparaison des monographies disponibles) qui permette des’extraire des discours particulièrement prégnants produits pardes institutions d’élite françaises « dominantes ».
D’un point de vue méthodologique, cet article repose sur uneenquête de terrain menée à l’Université d’Oxford entre 2008 et2010, c’est-à-dire quelques mois avant la mise en œuvre réformede l’enseignement supérieur visant à la hausse des fraisd’inscriptions universitaire (BIS, 2011). Les donnéesillustrent assez clairement la présence de logiquesd’interaction qui peuvent relever de modes informelles decommodification du secteur, parfois de façon bien antérieures àla réforme du gouvernement Cameron/Clegg. De ce point de vue,le recul chronologique fournit par l’enquête rend visible unensemble de facteurs explicatifs du changement institutionnelpropres à l’offre et au positionnement spécifique del’établissement dans le champ du supérieur qui, de fait, nedépendent pas directement des orientations des politiquesnationales.
49 On se réfère ici aux travaux de Pierre Bourdieu et de Monique de Saint-Martin.
Bibliographie
Allouch Annabelle, 2013, « L’ouverture sociale commeconfiguration. Processus et pratiques de sélection et desocialisation des classes populaires dans les établissementsd’élite. Une comparaison France-Angleterre », Thèse de sociologie,Institut d’Etudes Politiques de Paris (OSC).
Allouch A., van Zanten A., 2008, Formateurs ou Grands Frères ?Les tuteurs des dispositifs d’ouverture sociale dans lesformations d’élite. Educations et Sociétés 21 (1). 49-65.
Antaniou L., Dyson A. et Raffo, C., 2008. Entre incantation etfébrilité : les nouvelles politiques d’éducation prioritaire enGrande-Bretagne (1997-2007). In : Demeuse M., Frandji D.,Rochex J.-Y., (Eds.). Les politiques d’éducation prioritaire enEurope. Conceptions, mises en œuvre, débats. ENS Editions/INRP,Lyon.
Anteby M., 2013. Manufacturing morals; The values of silence inBusiness school education, Chicago : The University of ChicagoPress.
Archer L., Hutchings M. et Ross A., 1999. Higher Education andSocial Class. Issues of Exclusion and Enclusion.Routledge/Falmer, London.
Avril C., Cartier M., Siblot Y., 2005. Les rapports auxservices publics des usagers et des agents des milieuxpopulaires. Quels effets des réformes de modernisation ?.Sociétés contemporaines 58 (2), 5-18.
Ball S., 2007. Education PLC. Understanding Private SectorParticipation in Public Sector education. Routledge, London.
Ball S., 2009. The Education Debate, Policy Press, London.
Ball S., Reay D., Davies M., 2001. Degrees of Choice. Class,Race, Gender and Higher Education, Trentham books, London.
Ball S., van Zanten A.. 1998. Logiques de marché et éthiquescontextualisées dans les systèmes scolaires français etbritannique. Education et sociétés 1 (1), 47-71.
Bartlett W., Roberts J., Le Grand J., 1998. Quasi-marketReforms in the 1990s. A Revolution in Social Policy. The PolityPress, London.
Bessy C. et al., 2001. Des marchés du travail équitables ? Uneapproche comparative France/Royaume-Uni. PLE-Peter Lang, Paris.
Black, J., 2004. Defining enrollment management: The structuralframe. College and University Journal, 79 (4), 37–39.
Boltanski L., Chiappello E., 1999. Le nouvel esprit ducapitalisme, Paris : Le Seuil.
Bourdieu P., Passeron, J.-C., 1970. La reproduction. Editions deMinuit, Paris.
Bourdieu P., 1989. La noblesse d’état, Paris : éditions deMinuit.
Callon M., 1998. The Embeddedness of Economic Markets inEconomics. In : Callon M. (Ed.). The Laws of the Markets.Blackwell publishers, Oxford.
Cartier M., 2003. Les facteurs et leurs tournées. Un servicepublic au quotidien. La Découverte, Paris.
Chauvin, P.-M., 2009. Le marché des réputations. Cadres,chiffres et entrepreneurs de réputation sur le marché desGrands Crus de Bordeaux. Thèse de sociologie à l’UniversitéBordeaux II.
Chilosi, D., Noble, M., Broadhead, Ph., 2010. Measuring theEffect of AimHigher on Schooling Attainment and HigherEducation Applications and Entries. Journal of further andHigher Education 34 (1), 1-10.
Cochoy F., 2004, (Dir.), La capitation des publics. C’est pourmieux te séduire, mon client…. Toulouse : Pressesuniversitaires du Mirail.
BIS, 2011. Higher Education: Students at the heart of thesystem. Rapport au parlement britannique.
Darmon M., 2012. Sélectionner, élire, prédire : lerecrutement des classes préparatoires. Sociétés contemporaines86, 5-29.
Deem R., 2007. Reshaping English universities in the 21stcentury in the context of New Labour’s public service reform.The views of university leaders. Communication pour la Societyfor Research on Higher Education.
Dolan E., 2008. Education outreach and public engagement,Springer, London.
Douglas M., 1999. Comment pensent les institutions. LaDécouverte/ Revue du M.A.U.S.S, Paris.
Dubois V., 1999. La vie au guichet. Relation administrative ettraitement de la misère. Economica, Paris.
Dubuisson-Quellier S., 1999. Le prestataire, le client et leconsommateur. Sociologie d’une relation marchande. RevueFrançaise de Sociologie 40 (4), 671-688.
Duru-Bellat M., 2011. La diversité : esquisse de critiquesociologique. Notes et documents de l’OSC 2011 (03).
Evans G., 2010. The University of Oxford. A new history.IBTamis, London.
Eymeri-Dozans J.-M., 2012. Le concours à l’épreuve. RevueFrançaise d’Administration publique 142 (2), 307-325.
Feintuck M., Stevens R., 2013. School admissions andaccountability. Planning, choice or chance ?. London : PolicyPress.
Garrigou, A., 2001. Les élites contre la République. SciencesPo et l’ENA. Paris : La Découverte.
Gatzambide-Fernandez Ruben, 2009. The best of the best.Becoming elite at and American Boarding School, Cambridge:Harvard University Press.
Gewirtz S., 2001. The managerial school: Post-welfarism andsocial justice, Routledge, London.
Goffman E., 1968. Asiles. Etude sur la condition sociale desmalades mentaux. Editions de Minuit, Paris.
HEFCE, 2003. Feasibility study for the development ofAimHigher: P4P, Rapport officiel.
Hoggart R.,1991 (2013). 33 Newport Street. Autobiographie d’unintellectuel issu des classes populaires anglaises, Paris :éditions de l’EHESS.
Hossler D., Bean J., 1990, The strategic management of collegeenrollement, San Francisco : Jossey-Bass.
Karabel J., 2005. The Chosen: The Hidden History of Admissionand Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton, Boston: HoughtonMifflin.
Khan S., 2011, Privilege. The making of an adolescent elite atSaint Paul’s. Princeton and Oxford, Princeton University Press.
Karpik L., 2007. L’économie des singularités. Gallimard, Paris.
Kraatz M. et al., 2010, Precarious value and mundaneinnovations : enrollment management in American liberal artscolleges, Academy of Managament journal 53 (6), 1521-1545.
Latour V., 2010. Un multiculturalisme maîtrisé (Bristol). In :Le Texier E. et al (Eds.). Les politiques de diversité.Expériences anglaises et américaines. Presses de Sciences Po,Paris.
Le Galès P., Scott A., 2009. Une révolution bureaucratiquebritannique ?. Revue française de sociologie 49 (2), 301-330.
Losada M. 2011. L’accueil des étudiants étrangers, entreattraction et contrôle : logiques institutionnelles etstratégies individuelles. Une étude comparée des cas françaiset britanniques, Thèse pour le doctorat de Sciences Politique,Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Maroy C., 2008. Vers une régulation post-bureaucratique dessystèmes d’enseignement en Europe ?. Sociologie et sociétés 40(1), 31-55
Masson Ph., 1999. Les coulisses d’un lycée ordinaire. Enquêtesur les établissements scolaires des années 1990. PUF, Paris.
McCraig N., 2011. Access agreements, widening participation andmarket positionality: Enabling student choice?. In : MolesworthM. (Ed.). The Marketisation of Higher Education and the studentas consumer, Routledge, London.
McDonough P., 1994. “Buying and selling Higher Education. Thesocial construction of the college applicant”, Journal ofHigher Education, Vol.65 (4), p. 427-446.McDonough P., 1997. Choosing Colleges. How Social Class andSchools Structure Opportunity, New York : SUNY Press.
Milburn A., 2009. Report from the Independent Commission onSocial Mobility. Rapport au parlement britannique.
Musselin C., 2001, La longue marche des universités, Paris :PUF.
Musselin C., 2005, Le marché des universitaires, France,Allemagne, Etats-Unis, Paris : Les Presses de Sciences Po.
Oberti M., Sanselme F., Voisin A., 2009. Ce que Sciences Pofait aux lycéens et à leurs parents. Méritocratie et perceptiondes inégalités. Actes de la recherche en sciences sociales 180(5), 102-124.
Oxford University, 1998. University's Mission Statement andStrategic Plan. Oxford University Gazette, Gazette No. 4484 (3).
Pasquali P., 2010. Les déplacés de l’ouverture sociale.Sociologie d’une expérimentation sociale. Actes de la rechercheen sciences sociales 183 (3), 86-105.
Radaelli C., 2010. Les policy narratives (ou récits). In :Boussaguet L. et al. Dictionnaire des Politiques publiques.Presses de Sciences Po, Paris.
Ramirez F., 2007. Growing commonalities and persistentdifferences in Higher Education: Universities between globalmodels and national legacies. In Meyer H.-D., Rowan B. (Eds.),New institutionalism in Education, SUNY Press, New York.
Rayou P., van Zanten A., 2004. Enquête sur les nouveauxenseignants. Vont-ils changer l’école ?. Bayard, Paris.
Roueff O., 2010. « La montée des intermédiaires. Domesticationdu goût et formation du champ du jazz en France, 1941-1960 ».Actes de la Recherche en Sciences Sociales 181-182, 34-59.
Rothblatt S., 2007. Education Abiding Moral Dilemma. Merit andWorth in the Cross-Atlantic Democracies, London: Symposiumbooks.
Sabbagh D., 2006. Une convergence problématique. Les stratégiesde légitimation de la discrimination positive en France et auxEtats-Unis. Politix 73 (1), 211-229.
Sabbagh D., van Zanten A., 2010. Diversité et formation desélites : France-USA, Sociétés Contemporaines 79 (3), 160 pages(special issue).
Schnecker, C., 2010. Le concept anglo-saxon de communauté.Description ou évaluation ?. In : Sainseaulieu I., Salzbrun M.
et Amiotte-Suchet L., (Ed.). Faire communauté en société, PUR,Rennes.
Senac- Slawinski R., 2012. L’invention de la diversité. PUF,Paris.
Shavit Y. et al, 2007. Stratification in Higher Education: acomparative study, Stanford: Stanford University press.
Siblot Y., 2006. Faire valoir ses droits au quotidien, Lesservices publics dans les quartiers populaires. Presses deSciences Po, Paris.
Soares J., 1999. The decline of privilege. The modernisation ofOxford University, Stanford University Press, Stanford.
Soubiron A., 2010. L’action publique expérimentale. Lesdispositifs d’égalité des chances dans les Grandes écolesfrançaises, Thèse pour le doctorat en Science Politique,Université de Paris-Dauphine.
Steiner Ph., 2007. La sociologie économique. La Découverte, Paris.
Sutton Trust (The), 2010. Ten years review of Sutton Trustsummer schools. Rapport officiel.
Tapper T., 2007. The governance of British Education; Thestruggle for policy control. Springer, London.
Thomas L., 2002. Collaboration within and between HigherEducation institutions in England. A review of policy andpractice. In: Thomas L., (Ed.). Collaboration to widenparticipation in Higher Education, London: St Paul’s-TheEuropean access network.
Tournadre-Plancq J., 2010. L'heure du choix. Personnalisation et compétition dans l'État social britannique. Raisons politiques 37, 147-170.
Trompette P., 2005. Une Economie de la captation : Dynamiquesconcurrentielles au sein du secteur funéraire. Revue Françaisede Sociologie 46 (2), 233-244.
Turner, R., 1966. Modes of ascent through Education :sponsored and contest mobility. In : Class, status and Power :social stratification in comparative perspective, Bendix R.,Lipset S. M., New York : Free Press, 449-458.
van Zanten A., 2009. Choisir son école. Stratégies familialeset médiation locale. Paris : PUF.
van Zanten A., 2010. L’ouverture sociale dans les Grandes Ecoles, diversification des élites ou renouveau des politiques éducatives ?. Sociétés Contemporaines 79 (3), 69-95
Vernon K., 2004. Universities and the State in England, 1850 –1939, Routledge Falmer, London.
Watson D. (Ed.), 2007. The Dearing Report. Ten years on.London : Institute of Education.
Zimdars A., 2007. Challenges to meritocracy? A study of thesocial mechanisms in student selection and progression at theUniversity of Oxford. Thèse de sociologie, Université d’Oxford.