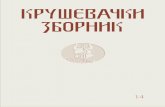« ‘Le Mort saisit le Vif’ Don Giovanni face à la Loi… » in Actes du Colloque Droit et...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of « ‘Le Mort saisit le Vif’ Don Giovanni face à la Loi… » in Actes du Colloque Droit et...
(( LE MORT SAISIT LE VIF )) DON GIOVANNI FACE A LA LOI . . .
Emmanuelle PESQUÉ ODB - Opéra Passion
Historienne - Musicographe
à la mémoire de mes parents, Alain et Anne-Marie SAYAG
« Le mort saisit le vif (par son hoir le plus proche). » Cet ancien adage exprimant la continuité de la succession au Moyen Age, qui eut une telle fortune qu'elle finit par figurer l'instantanéité de la succession royale1, peut être doublement utilisé ici, bien qu'il ne soit pas réellement question de succession, si ce n'est de l'héritage littéraire dont fut bénéficiaire Lorenzo Da Ponte, le librettiste qui va principalement faire l'objet de cette communication.
Cet adage trouvera ici sa pertinence, car dans les traditionnels récits d'apparitions de morts, le revenant semble « saisir le vif H, qu'il soit son héritier direct ou non, pour présenter sa requête. Il s'agit principalement de se rappeler au souvenir des vivants, en général pour demander des messes pour son salut. Dans le cas présent, la figure littéraire, si marquante dans les récits d'apparitions médiévales, d'exempla et de récits de prédication2, est renversée, mais le fondement du texte s'appuie toujours sur les récits d'apparitions liés à la traversée d'un cimetière. Ce thème récurrent de prédication passa rapidement dans le folklore et se mêle à celui de la statue animée, symbole social, qui remplace avantageusement sur scène la figure des transis.
' KRYNEN J., «Le mort saisit le vif: Genèse médiévale du principe d'instantanéité de la succession royale@ançaise. » in Journal des Savants, juillet-décembre 1984, pp. 187-22 1.
KLAPPER Joseph, Exernpla aus Handschrijï'en des Mittelalters. (Sammlung mittellateinischer Texte 2) Heidelberg, 1911, No 46 : «De ebrio qui defunctum invitavit )). La thématique a été relevée par TUBACH Frederic C., Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious Tales. Helsinki, 1969, (FFC204) ainsi que par BERLIOZ Jacques et POLO DE BEAULIEU Marie-Anne, Les Exempla médiévaux. Introduction à la recherche, suivie des tables critiques de l'Index Exemplorum de Frederic C Tubach. Carcassonne ; Grae et Hésiode, 1992.
198 Emmanuelle PESQUE
Ce geste contractuel irrévocable à valeur juridique et religieuse est au cœur de la première élaboration du futur mythe : Gabriel Téllez (dit Tirso de Molina), un moine madrilène, écrivit sans doute vers 1620, une cornedia, El Burlador de Sevilla y Convitato di piedra (L'Abuseur de Séville ou le convive de pierre)3. Sa pièce s'inscrit dans un débat théologique précis : la conversion in articulo mortis suffit-elle à gagner le Paradis ? Si tel était le cas, une conversion en dernière minute suffirait à s'assurer le Salut, tout autant qu'une vie édifiante. On remet donc en évidence dans ce XVIIe siècle tenté par le libertinage, la notion du Dieu terrible de l'Ancien Testament, afin de se garder des dérives de la croyance en la Grâce et c'est l'un des objectifs revendiqués de Tirso de Molina. Son Don Juan n'a qu'un leitmotiv : « Tan / Que largo me 10 fiais », « si lointaine est mon échéance ». Mais lorsqu'il est brûlé par la main de la statue, il réclame un confesseur et l'absolution. Sa requête est refüsée, car « si [Don Juan] doit ainsi payer, telle est la justice de Dieu : « Oeil pour oeil, dent pour dent » )> (v. 954-956, traduction de Pierre Guenoun, Aubier-Flammarion, 1968).
Le texte passa rapidement à Naples, et de là, essaima en Italie. Des adaptations italiennes, sous le titre de Il Convitato dipietra, firent la joie de la commedia dell' arte tout comme d'un public plus choisi, quand Goldoni adapta a son tour les pér.ipéties de la fable.' En dehors de ce dernier, qui essaya de rationaliser la narration, « donner la main en gage » fait partie des « invariants » de la fable, comme le disait Jean ~ousset', d'un élément sans lequel la fable perdrait son identité propre, car Don Juan est essentiellement quelqu'un qui promet et trahit sa parole. On retrouve ce motif systématiquement aux côtés de l'exposition de ses transgressions, de la rencontre dans le cimetière, de l'invitation (ou des invitations) à souper, et de(s) retour(s) du mort à travers sa statue animée.
Comme l'a aussi démontré Jean Rousset, Don Juan apparaît dès le début comme un suspect mis en accusation par un groupe de personnes, puis en coupable, qui finit par être condamné. Le protagoniste principal qui refüse la Loi et toute contrainte sociale et transgresse les interdits légaux, se heurte plus ou moins directement aux représentants du pouvoir. Cette représentation régalienne s'incarne plus généralement dans ses délégations, parmi lesquelles prend place la figure du Commandeur, officier, gouverneur, soldat et juge. Le
La première édition imprimée de la pièce date de 1630, mais la date d'élaboration demeure inconnue. Serge Maure1 a rapproché la thématique de la pièce d'une autre de Tirso de Molina, El Contenado por desconfiado (Le Damné par manque de confiance), qui montre un ermite qui s'inflige d'excessives mortifications par manque de confiance envers la Grâce. CJ: MAUREL Serge, L'Univers dramatique de Tirso de Molina. Poitiers ; Publications de l'université de Poitiers, 1971.
Don Giovanni Tenorio, O sia il Dissoluto. ( 1 736)
ROUSSET Jean, Le Mj7the de Don Juan. Paris ; Armand Colin, 1976.
Acte II - Scène I : Don Giovanniface à la Loi 199
souverain lui-même n'est plus qu'une figure allusive, incarnée par son représentant, un ministre, de moins en moins présent sur les scènes d'opéra.6
A travers le livret de Da Ponte, Il Dissoluto punito osia Il Don Giovanni (Prague, 1787 - Vienne, 1788), qui contribua à fixer le mythe sous sa forme lyrique, et tout en s'appuyant sur quelques exemples provenant des principales moutures précédant Mozart, nous allons voir comment ce canevas souvent considéré comme une « belle et étonnante porcherie »7, répond à certaines des préoccupations réformistes de Joseph II à travers le châtiment du séducteur puni.
Comme la plupart des souverains ((éclairés )), Joseph II oeuvra avec constance pour réformer le corpus législatif et lutter contre la superstition. Les grands changements portant sur l'organisation légale furent entamés par l'empereur avec un zèle doctrinaire, et ne furent achevés que sous le règne de son neveu François II. Ces réformes sont paradoxales, car elles tendaient à placer tout l'appareil judiciaire sous le contrôle de 1'Etat alors qu'elles furent représentées comme étant plus souples et plus libérales, tout l'effort de la propagande s'efforçant de montrer que le pouvoir de plus en plus étendu de 1'Etat était une panacée pour ses sujets. La contradiction entre un absolutisme grandissant et la liberté amoindrie des sujets soumis à une autorité arbitraire fut résolue en avançant que les abus de la justice décentralisée et féodale étaient pires que ceux que l'on pouvait attendre de l'absolutisme le plus tyrannique, et que le souverain, sans être un tyran, exerçait son pouvoir dans l'intérêt de l'Etat, ce qui était une garantie suffisante pour tous. On n'est donc pas loin des théories romaines qui fondent le principat d'Auguste, considéré comme Pater Patriae.
Les légistes réformateurs qui travaillèrent sous le règne de Marie-Thérèse se retrouvèrent face à un corpus de loi très disparate. Le droit criminel était un mélange de la Loi Carolina de 1532 et de la Ferdinandea de 1656, sur laquelle se superposait la Peinliche HalsGerichtsordnung de 1707. Sans compter de nombreuses juridictions de première instance, aux compétences qui se
Si Tirso fait intervenir les rois de Naples et de Castille, lieux des exploits de Don Juan, les livrets d'opéra sont plus économes en la matière. Dans L'Empio Punito (A. Melani et Acciaiuoli, 1669), qui transpose l'intrigue dans une Grèce antique de fantaisie, on trouve le roi Atrace, père dlIpomene, que cherche à séduire Acrimante (lequel a abandonné son épouse Atamira, que convoite Atrace ...), qui est pleinement intégré à l'action ; les autres incarnations de l'autorité royale le sont de moins en moins. La Pravita castigata (Bambini et Mingotti, 1734) mentionne dans la liste des personnages un «Don Garzia, gonsigliero del re >> ; Il Convitato di pietra (Righini et Porta, 1776), « Don Alfonso, ministro del re di Castiglia >>, Il Convitato di pietra (Tritto et Lorenzi, 1783), « Il Marchese Dorasquez, ministro del re ».
Comme la qualifie le Cavaliere Tempesta dans Il Cappricio drammatico (scène 5 ) de Bertati qui précédait la représentation de son Don Giovanni O sia Il Convitato di pietra (1 782).
200 Emmanuelle PESQUÉ
recoupaient et en concurrence les unes avec les autres.' En ce qui concerne la procédure d'appel, il était extrêmement compliqué de savoir quelle cour serait compétente, hors le fait que le souverain se réservait le droit de décider quels cas seraient portés à son attention.
Les cours inférieures étaient habilitées à infliger des amendes, qui tombaient généralement dans la poche du juge. Il s'agissait en général d'infractions comme l'adultère féminin -les hommes n'étaient en général pas inquiétés-, l'ivresse sur la voie publique, etc ... Sauf si des nobles étaient impliqués dans l'affaire, l'emprisonnement était peu appliqué. On préférait une humiliation publique (le pilori) ou une flagellation publique.
Les crimes les plus sérieux comme le vol, la contrefaçon, le viol, le meurtre, la conspiration, le crime de lèse majesté, étaient punis par la mutilation ou la peine capitale, exécutée publiquement.
Des premières réformes furent instituées par Marie-Thérèse : en 1749, on créa une haute cour d'appel, la Oberste Justizstelle, qui centralisait les procédures d'appel pour les procès criminels, mais créait une cour indépendante aux juges nommés directement par le souverain, et nommés à vie. C'était établir le principe que la justice serait indépendante de l'administration. Ce principe fut également étendu aux cours de première instance.
Dès 1771, Joseph II, qui avait toujours eu une grande inclinaison pour l'étude du droit -il avait étudié le droit avec Christian August von Beck, un pragmatiste qui insistait sur la place du monarque dispensateur de la loi-, demanda à l'un de ses légistes d'abréger le Codex Theresiana de 1759, pour le libérer des contradictions internes que ce premier travail de compilation conservait encore, et pour que sa lecture soit accessible à tous.
En 1775, on abolit enfin la torture, et on restreignit la peine de mort, non pour des raison humanitaires, mais parce que Joseph II ne considérait pas la mort comme une sanction suffisamment exemplaire. A la mort de sa mère, le souverain s'attacha à d'autres réformes de fond. En 1781, il fit paraître le Allgemeine Gerichtordnung. Il réduisit le nombre de cours en première instance et les cours d'appel. Les nobles n'eurent plus droit à une justice d'exception. Certaines punitions furent rétablies, et la peine de mort maintenue, bien qu'elle fut souvent changée en prison à perpétuité. (Mais les conditions d'emprisonnement furent si terribles que Joseph II pensa que cela servirait de dissuasion suffisante, de même que les travaux forcés qui consistaient le plus
* Par exemple, en Bohème, pour un population de 4,5 millions d'habitants, il n'y avait pas moins de 378 cours de première instance ! A part les paysans qui étaient soumis à leur justice féodale, chaque guilde ou corporation pouvait se faire juger par ses pairs
Acte II - Scène I : Don Giovanni face à la Loi 20 1
souvent à substituer les hommes condamnés aux chevaux de halage dans les rivières.)
Le nouveau code criminel fut promulgué en janvier 1787. Les crimes tels que l'adultère, le blasphème, la sodomie, l'assassinat, la bigamie, la séduction, le rapt furent classés parmi les crimes d'Etat, et durent être poursuivis, même en absence de l'accusé. Le duel fut totalement interdit, et le duelliste survivant devait désormais être considéré obligatoirement comme un meurtrier9. Les juges n'eurent plus la possibilité de trouver des arrangements avec la loi, mais durent obligatoirement engager les poursuites.10 La qualité de noble ne comporta plus aucun privilège de judicature : on trouva donc des aristocrates parmi ceux qui balayaient les rues de Vienne ...
Joseph II se préoccupait également de la morale publique, comme le prouve la création de la Commission de Chasteté dont Casanova se fit l'écho, et qui avait pour mission de réprimer la prostitution. Joseph II intervint par ailleurs de manière avérée dans un cas de séduction. Le Baron d'Argenso1 ayant séduit et « mis grosse » la Baronne Zachy, l'empereur intervint auprès du ministre de la police, le Comte Pergen, pour que ce dernier convainque les parents de la jeune fille d'accepter le mariage qu'ils avaient jusque là refusé". L'institution du mariage intéressait suffisamment Joseph II pour qu'il fasse publier en janvier 1783 un décret, instituant le mariage comme un contrat civil1'. Il précisa que le mariage lui-même est un contrat civil, en conséquence de quoi le gouvernement a le droit de décider de la validité du contrat de mariage. »13 Cela provoqua évidemment la fureur du Clergé, ce à quoi Joseph II répliqua que cela ne violait pas le sacrement de mariage et ne s'appliquait qu'aux aspects contractuels de ce dernier.
Ces deux préoccupations, morale publique et procès criminel, se rejoignent dans un fait divers qui défraya la chronique et marqua durablement les esprits. (Préalablement à cette affaire, autre cas d'intervention impériale, Marie- Thérèse avait déjà retiré à la cour compétente le jugement d'un noble qui avait
Joseph II : « I hate theprinciples of those who attempt to justzjj thepractice, and who run each other though the body in cold blood. [...] I consider such a man as no better than a Roman gladiator. », cité dans PADOVER Saul Kussiel, The revolutionary emperor, Joseph II of Austria. Londres ; Eyre and Spottiswoode, 1967, p. 138
'O De nombreux éléments de cette présentation rapide sont inspirées par BERNARD Paul P., The Limits of Enlightement. Joseph II and the Law. Chicago ; University of Illinois Press, 1979.
l1 Pergen Akten, XXIIl3, 2 janvier 1784. Cité dans BERNARD Paul P., op.cit.
l2 FEJTO François, Joseph II, un Habsbourg révolutionnaire. (Ed corrigée et complétée) Paris; Perrin, 2004
l3 PADOVER Saul Kussiel, The revolutionary emperor, Joseph II of Austria. op. cit., pp. 136-1 37.
202 Emmanuelle PESQUÉ
« engrossé )) deux soeurs. Au lieu d'un avertissement, ce dernier fut confiné en un monastère une année entière.")
La sanction contre Franz Zaglauer von zahlheimls fut bien plus sévère. Ce jeune h o m e de bonne famille, fonctionnaire impérial, couvert de dettes, subit le supplice de la roue le 10 mars 1786 pour avoir assassiné sa logeuse et maîtresse (plus âgée que lui) afin de la dévaliser. Ce fut la dernière exécution capitale sous le règne de Joseph II, la peine de mort n'étant abolie définitivement qu'en 1788, quoique elle ne fut en pratique jamais appliquée. Joseph II intervint directement pour que la sentence soit réellement appliquée et non commuée en travaux forcés à perpétuité. Or l'exécution capitale eut lieu sur la place du Hoher Markt, devant une foule de près de 30 000 personnes, non loin du logement de Mozart. On ne sait s'il y assista ou s'il entendit seulement le bruit de la foule. On a avancé que le concerto en Ut mineur K. 491, perçu c o m e si tragique, entré dans le catalogue mozartien quelques 14 jours plus tard, serait une conséquence directe de cet événement. Si on ne peut lier obligatoirement vie personnelle et travail de composition, il est difficile de se dire que Mozart ait pu ignorer ce fait divers, qui défraya les conversations et fit croire en un arrêt des réformes joséphiniennes, lorsqu'il écrivit Don Giovanni. Quant au libertinage sexuel, on peut sans doute avoir un aperçu de la morale mozartienne dans la lettre qu'il écrivit à son ami Emilian Gottfried Jacquin, le 4 novembre 1787 : « [...] Le 29 oct., mon opéra D. Giovanni a été mis en scène avec le plus brillant succès. - [...] d'autant plus que vous semblez avoir abandonné maintenant votre ancienne manière de vivre quelque peu agitée ; - vous vous persuadez chaque jour du bien fondé de mes petits sermons, n'est-ce pas ?- Le plaisir d'un amour volage, capricieux, n'est-il pas éternellement éloigné du bonheur véritable que procure un véritable et raisonnable amour ? [...] Mais sans plaisanterie, ; - vous m'êtes au fond un peu redevable d'être devenu digne de Mlle N... car dans votre amendement, ou votre conversion, je n'ai pas joué le moindre rôle. [...] »16
Les réformes de Joseph II avaient besoin d'être largement publicisées. La programmation du Burgtheater, l'opéra de la Cour, sur laquelle il gardait un droit de regard tatillon, fut également un moyen de faire connaître ses ambitions législatives.17 Da Ponte, poète de la Cour, « prêté » à un imprésario
l4 OGRIS Werner, << Maria Theresia Judex », in Anzeigen der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, C X (1974), pp. 233-240, cité par BERNARD Paul P., op. cit.
l5 Cf BAUERLE Adolf, Zahlheim Ein Wiener Criminalroman. Vienne, 1858, et BRAUNBEHRENS Volkmar, Mozart in Vienna, 1781-1 791. Londres ; Andre Deutsch, 1990, pp. 27 1-277.
l6 Traduction de Geneviève GEFFRAY. MOZART W . A., Correspondance. 1786-1791. Paris ; Flammarion (Harmoniques), 1992, pp. 19 1 - 192.
l7 ((Joseph's approach to the theatre was shaped by Enlightment ideology. In establishing a Nationaltheater, Joseph gave expression to the view that regarded theatre as an instrument of socialpolicy which aimed to educate and keep the citizenly in good order [...] ». LINK Dorothea,
Acte II - Scène I : Don Giovanni face à la Loi 203
de Prague, à l'occasion de la visite de l'archiduchesse Maria-Theresia et de son nouvel époux, le prince Anton Clemenz de Saxe, le 14 octobre 178718, est sans doute une preuve de l'intérêt de Joseph II pour la propagande possible que pouvait représenter cet opéra. Par ailleurs, la programmation d'un opéra tel que Don Giovanni donné pour des festivités de mariage à Prague n'a rien qui étonne, car les thématiques mises en avant ne se bornaient plus à la félicité conjugale mais également aux vertus princières, comme le maintien de la loi par le souverain.19
La reprise viennoise de mai 1788, voulue par l'Empereur, ne s'explique pas uniquement par la position de force de Da Ponte dans les jeux de pouvoirs au Burgtheater, qui lui permit de faire représenter ses livrets. Tout comme le théâtre de Laxenburg -la villégiature impériale, où l'on reprenait les succès de l'année-, était ouvert à tous, y compris la paysannerie locale, comme le rapporte Michael Kelly dans ses ~erniniscences'~-, le Burgtheater permettait de brasser le public et de servir d'écho de la politique officielle2'.
Don Giovanni, ce « giovane cavaliere estremanente licenzioso » comme le qualifie Da Ponte, est stigmatisé par son valet de l'appellation de « malandrino » dans la scène d'ouverture : ce terme fut d'ailleurs changé en « libertin0 » dans l'autographe de Mozart par la suite, terme qui s'applique au XVIIIe siècle pour un libertin par ses moeurs, mais qui ne qualifie pas forcément un esprit fort et athée. Cependant Don Giovanni cumule crimes et pêchés (faute contre la loi divine). En voici le catalogue raisonné. Tentative de viol, adultère, rapt par séduction. Homicide, à la suite d'un duel (même si Da Ponte prend soin d'atténuer la responsabilité de Don Giovanni.) Blasphème, libertinage moral.
La moquerie et la rupture du contrat de mariage (en tant que sacrement et contrat social) résument les deux plans sur lesquels Don Giovanni bafoue la morale et la Loi. En effet, le « L a ci darem la mano » n'est autre qu'une promesse de mariage a juras par le don de la main et l'échange de paroles. Le Concile de Trente posait de nombreuses conditions à la validité du mariage. Cela avait aussi pour volonté d'empêcher les mariages de force ou par surprise, et contrecarrer les mariages clandestins et le rapt par séduction, réel ou
The National Court Theatre in Mozart's Vienna. Sources and Documents, 1783-1 792. Oxford ; Clarendon Press, 1998, p. 1. Ce qui était valable pour le théâtre l'est aussi en ce qui concerne l'opéra.
l8 La première eut lieu le 29 octobre, en l'absence du couple impérial.
l9 Cf: LINK Dorothea, The National Court Theatre in Mozart's Vienna. op. cit. p. 304
KELLY Michael, Reminiscences of Michael Kelly ..., New York, 1826. p. 154.
'' Sur la politique et l'organisation du Burgtheater, cf: LMK Dorothea, The National Court Theatre in Mozart's Vienna. op. cit. p. 479 sq.
204 Emmanuelle PESQUÉ
simulé.22 Don Juan s'inscrit dans la tradition du mariage « a yuras » fondé sur le serment, qui était considéré comme tout aussi valable que le mariage in facie Ecclesiae. Cependant on peut introduire une différence entre les mariages supposés de Donna Elvira et de Zerlina. Alors que la première a cohabité trois jours à Burgos avec son séducteur, elle peut avancer que son union est un nzatrimonium perfectum puisqu'il a été consommé. Elle est bien l'épouse de Don Giovanni. Zerline en est restée au stade, en quelques sorte, du matrimonium initiatum, à l'échange des consentements ... Mais n'a-t-elle pas déjà échangé les mêmes serments avec Masetto ? Elle serait alors tout aussi coupable de polygamie que Don Giovanni.. .
Le châtiment de Don Giovanni est inéluctable, ainsi le veut la morale de l'histoire. Néanmoins cette fin est préfigurée tout au long du livret de Da Ponte par des annonces textuelles, qui citent L'Enfer de a an te" (que Da Ponte lisait durant sa rédaction du poème"), puis par des allusions aux cinq sens, qui explicitent la relation de cause à effet des actions de Don Giovanni. Le séducteur récolte ce qu'il a semé, c'est la loi du talion.
Dès l'introduction, on sait que la fin du séducteur est proche : à son entrée Donna Anna menace : «Non sperar, se non m'uccidi / ch'io ti lasci fuggir mai ». Puis Donna Elvira reitère le danger : « Non sperarlo, O scellerato, / ho perduto la prudenza » (1, SC. 12, no 9 quatuor) ; plus lapidaire, le « Nol sperate ! » de Don Ottavio, un pistolet à la main (finale 1), trouve un écho final qui annonce que justice est faite, dans la lamentation de Leporello : « Più non sperate di ritorvarlo. .. ))
L'écho le plus manifeste du contrepoint est évidemment le geste qui scelle le contrat : à la fausse promesse de mariage « e là, gioiello mio, ci sposeremo ... Là ci darem la mano .... )) répond le « Dammi la mano in pegno. », et sa version comique quand Zerlina ligote Leporello (II, 10 de la version de Vienne): « Dammi la man ! ». Mais on retrouve des allusion à la transgression par le regard (« Oh guarda guarda / che bella gioventù, che belle donne ! » (1, 8) à laquelle répond le regard de la statue (Leporello : « A h padron mio ... mirate . . . / che seguita.. . a guardar » (II, 1 1 duetto) , tout comme l'allusion à 1' « odorat parfait »" de Don Giovanni, qui sent à distance 1'« odor di femmina ))
lui est renvoyé par Donna Elvira : « Restati barbaro, ne1 lezzo immondo.. ».
22 Sur l'évolution du droit du mariage, cJ: GAUDEMET Jean, Le mariage en Occident. Paris ; Cerf, 1987.
23 Un article de Felicity Baker analyse le livret de Da Ponte à la lumière de cette thématique : BAKER Felicity, « The Figures of Hel1 in the Don Giovanni Libretto. » in Words about Mozart. Essays in Honour o f Stanley Sadie. (Ed. Dorothea Link & Judith Nagley). Woodbridge ; Boydell & Brewer, 2005.
24 DA PONTE Lorenzo, Memorie, Libretti Mozartiani. (Ed. G Armani). Milan ; Garzanti, 1976. p. 125.
25 Leporello : (( Cospetto ! / Che odorat0 petjGetto ! » (1, 4)
Acte II - Scène I : Don Giovanni face à la Loi 205
L'ouïe est sollicitée par les musiques de fête de Don Giovanni et l'iiltrusion de la statue qui frappe à la porte. Avec le souper, les cinq sens sont enfin déployés.
Autres prémonitions, le cuor di sasso de Don Giovanni sera vaincu par l'uom di sasso, et le burladoJ6 sera trompé par plus fort que lui : dans la scène du cimetière, Don Giovanni ne considère-t-il pas tout d'abord que « Sarà qualcun di fuori / che si burla di noi » Or cette personne d'« en dehors )) appartient au règne de l'Au-delà absolu.
Le procès de Don Giovanni est ponctué dans le texte par trois étapes, qu'on a pu qualifier de « tribunaux 3' : une mise en accusation (Finale 1), une fausse arrestation (Sextuor) et l'exécution de la sentence par le tribunal de Dieu (Finale II) avant l'arrestation officielle. Ces étapes sont d'ailleurs sous-tendue par la possibilité offerte à Don Giovanni de reconnaître sa culpabilité, ce qu'il se refuse à faire.
Don Ottavio devient pleinement, avec l'opéra de Bertati et Gazzaniga, puis de Da Ponte et Mozart, celui par lequel la justice aurait dû arriver. Le personnage n'a rien de l'aristocrate falot et inefficace popularisé par le film de Joseph Losey et dans la plupart des mises en scènes actuelles. Il faut dire que l'habitude de représenter Don Giovanni de Mozart dans une version hybride mêlant les versions de Prague (1787) et Vienne (1788), n'aide en rien le personnage.
Le fiancé de Donna Anna est une image spéculaire inversée du rôle-titre, la figure du « fort honnête gentilhomme » que ce dernier aurait pu être, sans idéaliser outre mesure le portrait : Donna Anna attendait bien Don Ottavio, et « deux heures du matin » n'est pas l'heure des visites de courtoisie ... Cependant, cet aristocrate prend ses responsabilités au sérieux : Donna Anna trouve en lui «padre e sposo », c'est à dire une sorte de tuteur légal, un substitut d'autorité paternelle, puisque les règles sociales du deuil empêchent leur mariage officiel immédiat. On peut aussi considérer qu'on est typiquement dans le cadre du verba de futuro suivi de relations charnelles, qui signifiaient mariage. La relation d'Anna et Ottavio est donc d'un ((mariage présumé », forme qui fut bannie par le Concile de Trente. Ces fiançailles engageaient totalement au mariage, sans doute sanctionné par le Commandeur, étant donné la publicité du compagnonnage des deux jeunes gens. (Ce même principe peut faire également conclure sans trop de risque d'erreurs à la bigamie démultipliée de Don Giovanni ...)
26 Sa fonction de trompeur et de beau parleur est mentionnée par Zerlina ( ( M a pu6 burlarmi encor >>) et Donna Elvira (« nido d'inganni >>, « mentitore »).
27 CJ: BAUMAN Thomas, (( The Three Trials of Don Giovanni )) in The Pleasure and Perils of Genius : Mostly Mozart. (Ed. Peter Oswald et Leonard Zegans). Madison ; International Universities Press, 1993.
206 Emmanuelle PESQUE
On est bien loin des versions antérieures dans lesquelles Ottavio est au mieux un époux de convenance (Porta-Righini). Sans cet appui masculin justifié par le librettiste, la fille du Mort a licence d'aller demander justice directement au représentant du ~ o i . "
Dans la version dapontienne, Don Ottavio prend les choses en main. S'il arrive l'épée en main (« con ferro ignudo in mano ») dans la demeure de Donna Anna, et s'il dégaine également son arme lors du Sextuor (II, 7), c'est que l'appréhension de l'intrus a lieu dans la maison de Donna Anna, et qu'il s'agit bien d'une violation de domicile. Il est donc tout à fait dans son droit. Par contre, il ne fait que brandir son pistolet lors de la fête donnée par Don Giovanni ; le temps de livrer celui-ci à la justice ? On ne le saura pas, puisque le criminel s'est enfui.
Don Ottavio obéit donc à la loi, tout en demeurant fidèle à l'idéal chevaleresque qui fonde le rôle2', ce qui est reflété dans le traitement musical. Hélas, la redondance de ses deux arie accentue l'impossibilité structurelle du personnage à traduire le criminel devant la loi ....
Le deuxième acte permet également de découvrir une variante signifiante : dans la version définitive, Leporello étant découvert puis démasqué, il est menacé de mort violente comme tout bouc émissaire. On assiste à une scène de quasi lynchage, lancé par Masetto (« Accoppatelo mec0 tutti tre »). Il n'est pas inintéressant de noter que le paysan se met également à la tête d'un groupe armé, en fin de vengeance privée contre un noble, ce qui s'apparente fortement à une jacquerie3'. Or Ottavio précise qu'il va «punir » Leporello. Mais cette punition passe par l'appel à la répression légale, comme il le précise dans le récitatif de Prague (II, IO)", tout de suite après. On est donc loin de l'acte de violence illégal qu'il contribue à arrêter.
Les archives de Dux conservent deux feuillets manuscrits de la main de Giacomo Casanova (ami et correspondant de longue date de Da Ponte) qui reprennent une partie du texte de Da Ponte ainsi que des variantes pour la
'* Donna Anna s'adresse directement à Don Alfonso pour demander justice, plutôt qu'à Ottavio. Il est vrai qu'elle avait préalablement exprimé à son père sa répugnance à épouser le Duc Ottavio, par ordre du roi, (1, 3 et 4).
29 Jean-Loup CHARVET dans LIEloquence des larmes. Paris; Desclée de Brower, 2000, a consacré un chapitre à Don Ottavio et aux sources musicales baroques qui préfigurent également le personnage.
30 Une révolte des paysans de Transylvanie se déclara fin 1784. Ils luttaient contre la défense fanatique de leurs privilèges des nobles hongrois. En 1783, Joseph II se rendant en Transylvanie s'était aperçu que l'ordonnance abolissant le servage n'avait pas été portée à la connaissance des populations par les fonctionnaires nobles, qui en avaient empêché la publication. Par ailleurs, pour une analyse des conflits sociaux dans les opéras de Mozart, cf « Mozart, class conflicts and Enlightment. )) dans ARBLASTER Anthony, Viva la Liberta ! Politics in Opera. Verso, 1992. 31 ... un ricorso / vo ' far a chi si deve, e in pochi istanti / vendicarvi prometto ... B.
Acte II - Scène I : Don Giovanniface à la Loi 207
scène 9 du second acte. Une première variation consiste en un soliloque de Leporello qui présente sa défense : « [...] Io merito perdon, / Colpevole non son. [...] Lasciate andar in Pace / Un povero innocente, /Non sono contumace, / Ofendervi non so / E ve 10 prover6 [...] »" Une autre feuille de la main de Casanova fait alterner les supplications de Leporello et les menaces de sentences de ses juges : l'envoi à la potence (« Alla forca !») aux galères (« In galera !»), l'obligation balayer les rues (« Vada a scopar lapiazza »), menace à laquelle Leporello réplique qu'il est de « sang illustre », ce qui fait directement allusion aux réformes de janvier 1787, tout comme la dernière peine, (( Dunque le barche strascinerà », pire que la condamnation à mort, comme on l'a vu. Casanova, qui fut à Vienne le secrétaire de l'ambassadeur de la République de Venise, Sebastiano Foscarini, en 1784 et 1785, était bien au fait des réformes engagées.. .
Quelque soit la version retenue, la démonstration est claire : la responsabilité du maintien des règles, apanage des élites, contribue ainsi à maintenir la stabilité de la société.
Don Ottavio, certain de connaître le coupable, va alors chercher les autorités. L'action de 1'Etat doit se substituer de manière officielle au règlement de compte privé, duel (interdit par les autorités) ou autre : c'est ce que Donna Anna n'a pas compris totalement, et le parcours mental et émotionnel du personnage dans la version de Da Ponte est d'en prendre conscience. La purgation des passions qu'on retrouve si souvent chez les personnages mis en musique par Mozart, comme l'ont démontré les travaux de Jean-Victor ~ocquardl', est une fois de plus à l'oeuvre.
Dernière étape de ce processus inscrit dans la légalité, l'arrestation qui n'aura pas lieu, au domicile de Don Giovanni. On peut par ailleurs se demander si le choix de la localisation du souper ultime du rôle-titre -outre l'efficacité accrue de concentrer en un seul épisode invitation et contre-invitation par Bertati, puis Da Ponte- n'est pas fondé sur la logique qui veut qu'on appréhende logiquement un suspect chez lui. Les didascalies de la scena ultima précisent bien que font irruption Don Ottavio etc ... « con ministri di giustizia » L'omission scénique de ces figurants contribue d'ailleurs à brouiller l'autre morale de l'oeuvre : nul n'est censé ignorer et bafouer la Loi.
Les justiciers humains étant voués à l'échec de par la constitution du mythe, la dernière manche reste à la statue, comme il se doit. Mais Da Ponte infléchit en partie le sens originellement religieux du texte : son Commendatore affirme de manière autoritaire sa nature surnaturelle (« non si pasce di cibo mortale /
32 Les textes de Casanova sont reproduits dans DA PONTE Lorenzo, Libretti Viennesi. (Ed. Lorenzo Della Cha). Parme; Hugo Guanda, 1999, vol. II, pp. 17 15- 17 17.
33 Cf: HOCQUARD Jean-Victor, La pensée de Mozart. Paris ; Seuil, 1958, et Mozart, l'amour, la mort. Paris ; Séguier, 1987.
208 Emmanuelle PESQUÉ
chi si pasce di cibo celeste ») mais n'en propose pas moins un échange d'invitations à souper. Ce qui fausse évidemment la loi tacite de l'équilibre de l'échange entre don et contre-don. Cependant, cette Loi n'est pas aussi terrible que celle de Tirso : la statue offre la possibilité à Don Giovanni de battre sa coulpe (« Pèntiti, cangia vita : / è l'ultirno rnornento »). Cette affirmation de l'existence d'une Loi divine est également martelée lors de la scène du cimetière.
Le cimetière comme lieu privilégié du contact entre vivant et mort n'est pas non plus neutre ; c'est un espace intermédiaire qui se plaçait traditionnellement entre l'habitat et l'église, et qui «joue un rôle médiateur : [durant le Moyen Age] les vivants n'ont de cesse de le traverser quand ils vont à l'église ou en reviennent, mais aussi quand ils se rendent d'un bout à l'autre du village, ou en ville, d'un quartier à l'autre. Ils le longent et le traversent et y vaquent à des activités ludiques ou mercantiles qui en apparence n'ont pas de grands rapports avec la mort ou les morts. ))34
Le sépulcre du Commandeur dans toutes ses incarnations révèle l'évolution de la topographie funéraire des XVIIe et XVIIIe siècles3'. Ce qui nous concerne ici est l'épitaphe, probablement rédigée par Donna Anna, ce qui confirme son désir obstiné d'un acte de vengeance privée : on peut difficilement interpréter autrement la prescience ahurissante qu'aurait le Commandeur à inscrire un texte vengeur au lieu de la liste usuelle des hauts faits reflétant son statut et perpétuant son souvenir. Bertati va plus loin encore dans l'explication : il montre dans la scène 19, le Duca Ottavio donnant le texte à un sculpteur qui va graver l'inscription. Or le tombeau, commandé du vivant du Commandeur n'est « pas achevée depuis un mois. »36
Cette mise en garde menaçante, traditionnelle dans les livrets, est contredite par Da Ponte. Dans sa version, le défi de Don Giovanni à la statue est inversé : c'est le Commandeur qui l'enjoint de « laisser la paix aux morts ». On rejoint de cette manière les récits médiévaux qui définissent le cimetière comme un monde clos, un lieu d'entre-deux (mondes) qu'il n'est pas bon de traverser, un espace devenu physiquement malsain pour les sensibilités plus hygiénistes des
34 SCHMITT Jean-Claude, Les revenants. Les vivants et les morts dans la societé médiévale. Paris; Gallimard (NRF), 1994, p. 210.
35 Dans le cadre de cette étude, c$ BAKER Malcolm, (( Odzooh ! A Man of Stone. Earth, heaven and hell in eighteenth-centuv tomb sculpture. » dans Don Giovanni. Myths of Seduction and Betrayal. (Ed. Jonathan Miller). New York, Schocken Books, 1990.
36 11 Duca Ottavio, con carta in mano ed un incisore. « Questo mausoleo, che ancor vivente / l'eroe Comendatore / apprestare si fece, / un mese mon è ancor ch'è terminato. [...] Su quella base intanto / a caratteri d'oro / sian queste note incise. » (dà carta al10 scultore, che va a formare l'iscrizione) « Tremi pur chi l'uccise, / se avvien che l'empio mai / di qua passi e le scorga, / e apprenda almen che, se occultar si puote / alla giustizia umana, / non sfuggirà del ciel l'ira sovrana. » (parte).
Acte II - Scène I : Don Giovanni face à la Loi 209
~umières)', enfin un lieu de superstition qu'il faut bannir en périphérie de la ville. Cette interpellation, ainsi que son soulignement musical par les trombones, instruments principalement utilisés pour la musique religieuse, claironnent le statut du Commandeur. Un Commandeur qui dans sa vie terrestre détenait un pouvoir délégué de sanction, et parachève sa fonction dans une toute autre ((juridiction ».
Les humains n'ont plus qu'à constater les faits et tirer la morale de la fable, qui se clôt dans une espèce d'amertume adoucie."
«Le mort saisit le v$.. », disait-on en introduction ... Cette expression du remords qui suscite parfois les récits d'apparitions de revenants dans les récits médiévaux, n'est-elle pas également applicable dans 1' ((affaire Don Giovanni ». Peut-on imaginer Don Giovanni empli de remords ?
Influencés par l'inflexion du mythe par le génie de l'opéra mozartien, nous le pouvons difficilement. Mais Nunziato Porta peignit un Don Giovanni se lamentant sur son sort, car la fatale beauté des femmes l'a fait devenir meurtrier (II, l), et qui, fuyant la justice du roi, se réfugie devant le tombeau du Commandeur. Il s'assoupit devant la statue, et y est surprit par Donna Anna, qui hésite à le tuer avec sa propre épée (Aria : Ombra del padre amato, / Dimmi che vuoi da me. .. ») Sur le point de passer à l'acte, elle est fléchie par Don Giovanni, qui lui propose de l'épouser ou de l'exécuter sur le champ sans passer par l'outrage de la justice royale ... (II, 3)
Cette piste fut abandonnée pour affirmer avec plus de force l'inéluctable de la sanction, quelques fussent les remords, et la prééminence de la loi.
Cette affirmation avait bien besoin d'être martelée, comme l'énonciation recto ton0 du Commandeur, compte tenu de la fascination exercée par la musique de Mozart. Car la parole séductrice de Don Giovanni, si elle pervertit le sens, se fracasse néanmoins sur la Statue, comme l'a suggéré Kierkegaard.. .
37 Joseph II légiféra également dans ce domaine. Ces décisions eurent un impact direct sur l'enterrement de Mozart puisque l'organisation des funérailles fut réformée par Joseph II en 1784. Ces mesures furent reçues avec une grande hostilité par la population et le clergé et certaines des mesures furent abrogées en 1786.
38 On constate un même type de chœur final doux-amer dans Il Re Teodoro de Paisiello, qui voit le rôle-titre incarcéré pour dettes et en butte aux moqueries des autres protagonistes. Sur l'organisation du lieto fine dans le Don Giovanni de Mozart et les problématiques soulevées par les deux fins possibles (on ne sait exactement ce qui fut représenté à Vienne), cf: ROBDISON Michael F., The alternative endings of Don Giovanni » in Opera Bu fa in Mozart's Vienna. (Ed. Mary Hunter Mary & James Webster). Cambridge ; Cambridge University Press, 1997, pp. 261-285.