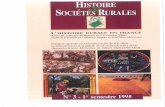L'art pariétal, miroir des sociétés paléolithiques
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of L'art pariétal, miroir des sociétés paléolithiques
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
ISSN: 0514-7336
EL ARTE PARIETAL, ESPEJO DE LAS SOCIEDADESPALEOLÍTICAS
L’art pariétal, miroir des sociétés paléolithiques
Georges SAUVET* y André WLODARCZYK*** Université Paris-XIII. F-93430 Villetaneuse.Correo-e: [email protected]** Université Lille-III. F-59653 Villeneuve-d’AscqCorreo-e: [email protected]
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 29-12-01
BIBLID [0514-7336 (2000-2001) 53-54; 215-238]
RESUMEN: El presente trabajo aboga por un estudio del arte parietal como instrumento del conoci-miento de la geografía humana de las sociedades de cazadores y de la evolución de sus redes de alianza,durante el Paleolítico superior. Tomando como ejemplo el componente figurativo de este arte y un ampliocorpus de 3981 figuras procedentes de 154 yacimientos franceses y españoles, se demuestra que las asocia-ciones entre especies animales diferentes obedecen a reglas simples y coherentes, que se dejan fácilmenteexprimir por un modelo formal. El análisis de doce sub-conjuntos sincrónicos y diacrónicos evidencia lamovilidad de las connexiones interregionales (por ejemplo el desarrollo del Solutrense cantábrico en rela-ción con los centros peninsulares y con escaso contacto con el sudoeste francés, al contrario de la situaciónque prevalece durante el Magdaleniense medio-superior). Sin embargo conforta la idea que las variacionesregionales operan dentro de un sistema de pensamiento religioso relativamente estable. Una segunda fasedel trabajo se propone describir la estructuración del arte parietal a un nivel mucho más fino, teniendo encuenta la diversidad formal de cada figura y sus relaciones topológicas con las demás. Una larga base dedatos está en curso de elaboración para su tratamiento con las técnicas de “extracción de conocimiento”(Knowledge Discovery in Databases). Unos resultados preliminares dejan esperar que una base de datos deeste tipo servirá el objetivo y proporcionará une visión más precisa y segura de la historia de los pueblospaleolíticos, dado que la fuente del estilo propio de cada grupo debe buscarse en la construcción gráfica depaneles complejos.
Palabras clave: Arte paleolítico. Análisis estructural. Semiótica. Extracción de conocimiento.
ABSTRACT: This paper pleads in favour of the study of parietal art as a means to investigate the humangeography of palaeolithic hunter-gatherers in Europe and the evolution of their alliance networks. Takingthe example of the figurative component of Rock Art and a large corpus of 3981 figures from 154 Frenchand Spanish sites, the paper shows that the associations of animal species obey simple and coherent rulesthat are easy to express with a formal model. The analysis of 12 synchronic and diachronic subsets demons-trates that the links between regions are moving (as exemplified by Cantabria which shows close contactwith the rest of the Iberian Peninsula during Solutrean and scarce relation with South-West of France,whereas it is the contrary during Middle and Upper Magdalenian). However, the observed regional variationsseem to operate within a unique religious thought, the structure of which remained relativelely stable. Asecond stage of this research aims at a much finer description of the structure of palaeolithic parietal art,taking into account the formal diversity of each image and its topological relations to the others. A hugedatabase compatible with the techniques of Knowledge Discovery in Databases is under construction. Preli-minary results show how this kind of information may lead to a better understanding of the history ofhunter-gatherers groups during Upper Palaeolithic, because the stylistic originality of each group should besought in the graphic elaboration of complex panels.
Key words: Paleolithic Art, Structural Analysis, Semiotics, Knowledge Discovery in Databases.
Le débat actuel sur l’auteur des plus ancien-nes représentations symboliques (homme deNéandertal ou homo sapiens sapiens?) et sur ladate exacte de cette “invention” est un faux débatqui ne mérite pas l’intérêt académique qu’on luiporte. Que l’homme de Néandertal, aux envi-rons de 35.000-40.000 ans B.P., c’est-à-dire dansles derniers instants de sa longue histoire, aitcommencé à percer des dents ou des coquillagespour en faire des objets de parure, au momentmême où d’autres hommes –anatomiquementdifférents– faisaient irruption dans son territoire,est une chose possible, bien qu’on ne disposed’aucun argument irréfutable pour trancher. Leseul fait avéré est que les derniers Néandertaliensont disparu en quelques milliers d’années, après200.000 ans d’existence et que les nouveauxvenus accordaient à la représentation symboliqueune place cruciale dans leur vie sociale, dévelop-pant et diversifiant tous les modes d’expressionplastique imaginables, de la sculpture au mode-lage, à la peinture et à la gravure. Il n’est pointnécessaire d’entrer dans une vaine discussiontechnique sur la validité des datations par leradiocarbone ou la thermoluminescence, pourconstater qu’en quelques milliers d’années, onvoit la culture matérielle dite “aurignacienne”,caractérisée par une production abondante delames et de lamelles et d’outils en os et bois de cervidé, se répandre à travers toute l’Europe,marquant son passage de productions graphiquesauxquelles il est difficile de refuser le qualificatifd’art, puisque le chemin est jalonné par les sta-tuettes d’ivoire du Vogelherd, les symboles vul-vaires sur blocs calcaires du Périgord et les gran-des fresques animalières de la grotte Chauvet. Lesquelques dizaines d’objets décorés, attribués defaçon plus ou moins forcée aux derniers Néan-dertaliens, ne pèsent pas bien lourd devant lesmilliers de représentations mobilières et pariéta-les qui vont aller en se multipliant tout au longdu Paléolithique supérieur jusqu’à l’apogée mag-dalénienne, sans qu’aucune raison taphonomi-que ou démographique ne puisse expliquer cebrusque saut quantitatif.
Les incontournables “chefs-d’œuvre de l’artpaléolithique” qui illustrent la plupart des ouvra-ges sur cette période de la préhistoire ont détour-né l’attention d’une véritable réflexion portant
sur l’ensemble des productions graphiques (de laplus modeste trace de couleur furtivement lais-sée du bout des doigts dans quelque recoin auxfresques monumentales de Lascaux et d’Altami-ra) et sur ce qu’elles sont susceptibles de nousapprendre sur les sociétés de chasseurs-cueilleursde cette époque, sur leurs structures sociales,leurs réseaux d’alliance, les phases d’expansion etde régression, les ruptures qui n’ont pas manquéde se produire, puisque c’est le propre de toutesociété humaine. Or, les productions graphiquessont, pour les peuples sans écriture, un élémentvital d’identification, un moyen de s’enracinerdans le passé et de se projeter dans l’avenir, unfacteur de stabilité et de cohésion. C’est doncune mine d’informations inestimable pour quiveut se donner la peine de les déchiffrer, maisforce est de constater que cette mine a été jus-qu’à présent largement sous-exploitée. On estsurpris par le décalage qui existe entre le remar-quable travail d’enquêteur que les préhistorienssont capables de faire pour tirer un maximumde renseignements des observations réalisées aucours de fouilles, alors qu’ils se contentent géné-ralement d’hypothèses vagues et invérifiables dèsqu’il s’agit des productions mobilières ou parié-tales. Il est regrettable que le même soin, lamême souci d’exploiter méthodiquement la moin-dre parcelle d’information, ne soit pas mis auservice de l’étude de l’art paléolithique qui cons-titue encore malheureusement un domaine derecherche séparé, souvent négligé et livré aux élu-cubrations les plus débridées. Un progrès sensi-ble sera enregistré lorsque l’art paléolithique seraabordé comme un vestige parmi d’autres et quel’on s’attachera à décrypter l’information qu’ilrecèle en utilisant non seulement les méthodes etles raisonnements propres à l’archéologie, maisaussi d’autres qui sont à développer spécifique-ment. Cet article se veut un plaidoyer pourune valorisation de l’art paléolithique dans cetteperspective de reconstruction anthropologiqueglobale.
L’unité de l’art paléolithique est générale-ment admise sans que l’on se demande sur quoielle repose, ni ce qu’elle implique sur le plananthropologique. Comment reconnaît-on uneœuvre paléolithique? Quels sont les critères quel’on utilise, implicitement le plus souvent, pour
216 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
la distinguer des productions d’autres époques?Pourquoi la communauté scientifique dans sonensemble fut-elle si réticente à admettre l’ancien-neté des peintures de la grotte de Zubialde, bienavant que la supercherie ne soit découverte?Pourquoi, au contraire, cette même communau-té a-t-elle admis l’âge paléolithique des gravuresde la vallée du Côa, en dépit des “expertises” quileur prêtaient un âge sub-actuel? Ces prises deposition ne reposent pas le plus souvent sur desraisons objectives, mais sur le sentiment diffusque l’ensemble des œuvres paléolithiques consti-tue une seule et même tradition artistique. Desgisements à très longue stratigraphie commecelui du Parpalló avec ses milliers de plaquettesgravées accumulées sans changement notoirependant des millénaires contribuent sans aucundoute à fonder ce sentiment de permanence,mais en se contentant de ce constat empirique,le préhistorien se prive d’une ouverture sur lesvéritables questions d’historien et d’anthropolo-gue qui devraient être au cœur de sa réflexion.Qu’implique la permanence d’une tradition artis-tique tout au long du Paléolithique supérieur, dupoint de vue de l’organisation sociale de petitsgroupes disséminés sur des centaines de milliersde km2? Les divisions traditionnelles en Aurig-nacien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, opé-rées sur la base des outillages, ont-elles une sig-nification “culturelle” s’il y a transmission d’unetradition artistique ininterrompue? La tâche estimmense, car pour appréhender l’unité de cettetradition artistique, il est indispensable d’étudierl’ensemble des productions et nous devonsaccepter l’idée de nous hisser à un niveau d’abs-traction élevé pour la découvrir.
Il est vrai que l’on peut aussi prendre le pro-blème par l’autre bout, en remarquant que lesproductions des différentes périodes et des diffé-rentes régions présentent des différences notablessur le plan thématique et stylistique. De la grot-te Chauvet à celle de Niaux en passant par Gar-gas, Cussac, Pech-Merle, Lascaux, etc., on peutsuivre pendant 20 millénaires les cheminements,les évolutions d’une forme d’art plastique quifrappe autant par sa longévité que par sa capaci-té de renouvellement. Les grottes qui présententdes œuvres de différents styles, appartenant selontoute vraisemblance à différentes époques, comme
Altamira, El Castillo, La Garma, Les Trois-Frè-res, illustrent à la fois la permanence et la diver-sité de cet art. La mise en évidence des caractèrespropres à chaque époque et à chaque région(voire à chaque site) constitue l’exercice préférédes spécialistes de l’art paléolithique, qui sont engénéral portés davantage à l’analyse qu’à lasynthèse. Cette façon d’aborder l’art paléolithi-que est digne d’intérêt à condition que l’arbrene cache pas la forêt et que les vues parcellairespatiemment disséquées soient finalement rassem-blées et remises en contexte dans l’espace-tempspaléolithique, ce qui est rarement fait. Pour notrepart, nous regrettons que les deux approches qui ne sont que méthodologiquement opposéessoient la plupart du temps vécues comme dog-matiquement antagonistes ; notre discipline n’arien à y gagner.
Bases structurales de l’art pariétal paléolithique
L’idée que les productions non utilitaires, aupremier rang desquelles figure l’art mobilier et pariétal, constituent le meilleur moyen dontnous disposons pour comprendre l’histoire desrelations entre les groupes humains du Paléo-lithique supérieur commence à pénétrer dansbeaucoup de travaux récents. Le problème estimmense et il y a mille façons complémentairesde l’aborder. L’approche qui fut la nôtre dans destravaux antérieurs repose sur un certain nombrede prémisses inspirées des travaux de Leroi-Gourhan et de Laming-Emperaire. Vers la fin desannées 50, ces deux auteurs venaient de conclu-re séparément que l’art pariétal paléolithiquerépondait à des règles de construction touchantà la fois à la distribution des œuvres dans l’espa-ce de la caverne et à la constitution des assem-blages de thèmes figuratifs et de signes. Cetteconclusion s’opposait à l’idée imposée depuis ledébut du siècle par l’autorité de l’abbé Breuil,idée selon laquelle les figures ne valaient quepour elles-mêmes et étaient accumulées sur lesparois sans aucune organisation. Pour les besoinsde sa démonstration, Leroi-Gourhan avait déve-loppé un appareil statistique rudimentaire repo-sant sur un certain nombre de simplifications quiont heurté les idées de l’époque. Il proposait,
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 217
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
entre autres, de décompter seulement les “sujetsde composition”, c’est-à-dire les espèces animalesfigurant dans chaque groupement naturel de figu-res appelé “panneau”, indépendamment du nom-bre de représentations. Ainsi, les vingt bisons duplafond d’Altamira étaient décomptés pour uneoccurrence du sujet Bison. On voit bien ce quecette façon d’opérer pouvait avoir de choquantpour les historiens de l’art. Cette façon de se his-ser à un niveau d’analyse extrêmement abstraitétait pourtant la seule permettant de mettre enévidence des régularités et de battre en brèchel’hypothèse d’une distribution aléatoire des espè-ces animales que, pour simplifier, on pourraitappeler “l’hypothèse Breuil”.
Notre contribution au débat soulevé par lemodèle de structuration de l’art pariétal deLeroi-Gourhan se caractérise essentiellement parun raffinement des méthodes statistiques, desti-né à rendre les conclusions plus sûres, et par l’in-troduction de méthodes structurales empruntéesà la sémiologie et à la linguistique informatiquepermettant de donner aux règles d’organisationun formalisme plus rigoureux (Sauvet et al.,1977; Sauvet et Sauvet, 1979; Sauvet, 1988; Sau-vet et Wlodarczyk, 1995).
Nous nous contenterons de rappeler ici lesprincipaux résultats auxquels nous sommes par-venus. Toutefois, notre corpus a sensiblementévolué depuis 1995, notamment grâce à l’incor-poration de sites majeurs comme la grotte Chau-vet avec son contingent exceptionnel de félins etde Rhinocéros. Les chiffres que nous présentonsici sont les tout derniers de notre corpus quicompte aujourd’hui 3.981 figures provenant de86 sites français et 68 sites espagnols, contre 3.295en 1995, soit une augmentation de plus de 20%.Pourtant les principales conclusions demeurentinchangées (sauf précisément en ce qui concerneles félins et les Rhinocéros), ce qui est une preu-ve de la stabilité atteinte.
L’objectif étant de tester l’hypothèse selonlaquelle l’assemblage de motifs figuratifs en pan-neaux obéissait à des règles de construction, nousavons tout d’abord établi la liste des représenta-tions identifiables (Tableau 1). Les espèces ani-males très rarement figurées (celles qui représen-tent moins de 0,5% du total), telles que lesoiseaux (0,44%), les mégacéros (0,27%), les isards,
saïgas, élans, mustélidés, canidés, etc., ont étérassemblées dans une catégorie “Divers”, car laméthode utilisée a pour but de mettre en lumiè-re les faits saillants, les lignes de force les plussolidement ancrées. La seule espèce pour laque-lle il est possible de distinguer avec certitude lesdeux sexes, en raison de caractères sexuels secon-daires, est Cervus elaphus. C’est pourquoi nousavons utilisé deux catégories distinctes pour lecerf et la biche (les différences de comportementiconographique du mâle et de la femelle justi-fient a posteriori notre choix). On aboutit ainsià une liste de 14 motifs, inchangée depuis nospremiers travaux.
Le corpus est constitué de 753 panneauxmonothématiques et 508 panneaux polythémati-ques, comportant de deux à six thèmes, qui don-nent prise à une analyse de leur contenu. Pourfaciliter le repérage d’éléments de structure récu-rrents, nous avons procédé à un codage de cha-que panneau selon les thèmes figuratifs qu’il con-tient, en faisant abstraction du nombre réel defigures de chaque espèce (les “sujets de composi-tion” de Leroi-Gourhan que nous appelons “thè-mes”). Cette façon de faire a heurté la sensibilitéde beaucoup de préhistoriens qui refusaient deréduire la splendeur esthétique d’un ensemblecomme le grand plafond d’Altamira à un ensem-ble de symboles tel que Ch + Bn + Bi. Nousregrettons également cette perte cruelle d’infor-mations, mais nous prétendons que c’était laseule façon de mettre en évidence l’existence derègles de composition et que le travail devaitcommencer par là. Si nous n’avions trouvé quele chaos à ce niveau d’abstraction, sans douten’aurait-il pas valu la peine de poursuivre danscette voie. Au contraire, le fait d’avoir mis enévidence une base structurale étonnamment clai-re et stable nous montre que l’art pariétal paléo-lithique met en œuvre un système complexe dereprésentations possédant des valeurs propres,qu’il est maintenant impératif d’explorer endétail, récupérant au passage les données quenous avions provisoirement écartées.
Revenons un instant sur la méthode utilisée etsur les principales conclusions qu’elle nous a per-mis d’atteindre. La liste des 508 panneaux poly-thématiques est automatiquement convertie enune table de co-occurrences de 14 x 14 indiquant
218 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
dans chaque cellule le nombre d’associations dumotif I et du motif J (Tableau 2). Ce tableau estsoumis à diverses analyses statistiques dont laplus riche en enseignements est l’Analyse Facto-rielle des Correspondances (AFC) suivie d’une
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH).Cette méthode permet de regrouper les motifs enfonction de leurs affinités et de constituer ainsi defaçon totalement objective des classes thématiques.Par rapport à notre résultat de 1995 (Sauvet et
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 219
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
TABLEAU 1: Fréquence des 14 motifs figuratifs identifiables de l’art pariétal paléolithique dans un corpus de 3981 figuresprovenant de 154 sites français et espagnols (nombre d’unités figuratives et nombre de panneaux comportantune ou plusieurs occurrences du motif ).
MOTIF SYMBOLE NOMBRE FIGURES (%) NOMBRE DEDE FIGURES THÈMES
(OCCURRENCES)
Cheval Ch 1099 27,6 554Bison Bn 820 20,6 346Bouquetin Bq 396 9,9 257Mammouth Ma 341 8,6 176Biche Bi 265 6,7 135Aurochs (Bos) Bos 228 5,7 148Cerf Ce 203 5,1 133Renne Re 138 3,5 72Anthropomorphe An 134 3,4 83Lion Li 90 2,3 53Rhinocéros Rh 75 1,9 36Ours Ur 67 1,7 51Poissons Po 39 1,0 20Divers Div 86 2,2 62
Total 3981 100 2126
TABLEAU 2: Tableau des co-occurrences des motifs figuratifs dans les 508 panneaux polythématiques du corpus (les symbolessont ceux du Table.
ch bn bq bos ce bi ma re ur an li rh po divch 329 139 94 77 64 50 33 33 22 40 25 10 3 23bn 139 214 59 16 25 23 39 31 14 28 9 13 4 18bq 94 59 166 37 42 26 20 17 11 18 7 4 4 14bos 77 16 37 113 32 18 11 4 4 12 6 3 1 3ce 64 25 42 32 108 34 6 5 6 7 1 1 2 9bi 50 23 26 18 34 87 0 4 2 7 1 0 1 5ma 33 39 20 11 6 0 76 9 11 6 7 10 1 4re 33 31 17 4 5 4 9 57 9 4 3 1 1 4ur 22 14 11 4 6 2 11 9 41 3 4 2 1 3an 40 28 18 12 7 7 6 4 3 65 4 1 2 2li 25 9 7 6 1 1 7 3 4 4 40 7 0 3rh 10 13 4 3 1 0 10 1 2 1 7 24 0 3po 3 4 4 1 2 1 1 1 1 2 0 0 11 3div 23 18 14 3 9 5 4 4 3 2 3 3 3 42total 942 632 519 337 342 258 233 182 133 199 117 79 34 136
Wlodarczyk, 1995), la plupart des conclusionssont inchangées, mais on observe aussi quelqueschangements consécutifs à l’apport massif de félinset de Rhinocéros de la grotte Chauvet (Figure 1).Ces deux motifs constituent désormais une classeà eux seuls. Les constantes sont la place centrale
du groupe Cheval-Bison-Bouquetin et les rôlespériphériques des classes Mammouth-Renne-Ours(désormais amputée du Rhinocéros) et Cerf-Biche-Aurochs. Les Anthropomorphes, très proches dugroupe Cheval-Bison-Bouquetin, se regroupentavec les Poissons et les animaux “divers”.
220 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 1. Analyse Factorielle des Correspondances du Tableau 2. Projection dans le plan [1,2] (les domaines circonscritssont issus de la Classification Hiérarchique Ascendante effectuée sur les coordonnées factorielles).
Nous trouvons donc cinq groupements natu-rels que nous appelons des classes:
Classe 1: Cheval-Bison-BouquetinClasse 2: Anthropomorphes, Poissons, DiversClasse 3: Mammouth, Renne, OursClasse 4: Rhinocéros, félinsClasse 5: Cerf, Biche, Aurochs
Une première remarque s’impose. Le nom-bre des combinaisons qui ont été effectivementproduites est extrêmement réduit par rapport aunombre de combinaisons qu’il était théorique-ment possible de réaliser: 199 sur 6.461, en neconsidérant que des panneaux de 2 à 6 thèmespuisque c’est la complexité maximale observée.De très fortes contraintes s’exercent donc sur lasélection des thèmes qu’il est possible d’assem-bler. C’est, à notre avis, l’argument le plus fortdont nous disposions en faveur d’une construc-tion thématique des panneaux et donc de l’exis-tence d’un discours sous-jacent présidant auchoix des motifs assemblés.
L’étape suivante consiste à se demander com-ment les classes issues de l’AFC peuvent aider àmieux comprendre les règles d’association. Pourcela, une réduction supplémentaire doit êtreeffectuée. Elle consiste à remplacer chaque motifpar la classe à laquelle il appartient. Par exem-ple, un panneau Cheval-Bison-Biche sera recodé1-1-5. Cette ultime transposition permet de met-tre en évidence le rôle très particulier joué par laclasse 1: 65% des dyades renferment au moinsun élément de la classe 1 ; c’est aussi le cas de91% des triades et de plus de 97% des tétrades,pentades et hexades. La Figure 2 montre com-ment il est possible de générer automatiquementtoutes les structures possibles en partant des dif-férents types de dyades et en ajoutant successive-ment un élément (entre parenthèses figurentle nombre de cas attestés dans notre corpus et lenombre de combinaisons possibles). On constateainsi que les structures qui ont été produites sonttrès nettement concentrées dans la partie supé-rieure gauche du tableau. Au contraire, un trèsgrand nombre de structures possibles n’ont pasété produites et se localisent majoritairementdans la partie inférieure droite du tableau. Nonseulement cette façon d’exprimer les donnéesconfirme l’existence de règles, mais elle montre
la régularité et la cohérence de celles-ci. Il estpossible de définir quelques règles simples dontl’application a pour effet de supprimer un grandnombre de cas sans pour autant supprimer beau-coup de cas existants. Par exemple:
Règle 1: toute tétrade doit comporter au moinsun élément de la classe 1.
Règle 2: toute pentade ou hexade doit compor-ter au moins deux éléments de la classe 1.
Règle 3: Si un panneau renferme trois élémentsou plus n’appartenant pas à la classe 1, ceux-ci nepeuvent appartenir à trois classes différentes.
L’application de ces trois règles élimine toutesles structures qui figurent en grisé sur la Figure 2.
Le dernier pas que l’on peut franchir est unesimple conséquence des observations précéden-tes. Les règles ci-dessus constituent une sortede “grammaire” générant un nombre limité decombinaisons thématiques. L’utilisation d’unlangage de programmation tel que Prolog rendl’écriture d’un telle “grammaire” facile et auto-matique (Sauvet et Wlodarczyk, 1995). L’adé-quation du modèle à la réalité paléolithique semesure par la proportion de panneaux réels quisont effectivement générés par le modèle, tandisque la contrainte exercée par cette “grammaire”se mesure par la réduction du nombre de pan-neaux qu’elle est capable de produire par rapportau nombre total de combinaisons possibles. Lerésultat est, nous semble-t-il, extrêmement pro-bant. En effet, le modèle proposé s’avère trèscontraignant puisqu’il ne génère que 1.616 pan-neaux au lieu de 6.461 (taux de réduction 75%),tout en préservant une excellente adéquation à la réalité puisque 192 des 199 types de pan-neaux existants sont produits (adéquation 96,5%).Il n’y a pas lieu de s’inquiéter des quelques pan-neaux qui ne sont pas produits, car ces dernierspeuvent résulter de défauts d’analyse (figures maldéterminées, panneaux incorrectement délimi-tés). Il est également possible que des panneaux“grammaticalement incorrects” aient été produitspar les Paléolithiques eux-mêmes, car la mise enœuvre de règles a inévitablement un caractèreprobabiliste.
Soyons clair. Le modèle proposé ne prétend enaucune façon révéler la grammaire paléolithique.Il a pour seul but de montrer que les assemblages
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 221
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
222 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 2. Construction des panneaux polythématiques de 2 à 6 thèmes par adjonction progressive d’éléments (le chiffre 1désigne un élément de la classe 1; les lettres x, y, z, w désignent des éléments des 4 autres classes).
thématiques réalisés sur les parois des cavernesne sont pas le fruit du hasard, mais qu’ils répon-daient à des règles suffisamment stables et récu-rrentes pour qu’il soit possible de les modéliser àl’aide de quelques contraintes.
Unité et diversité de l’art pariétal paléolithique
Les résultats que nous venons de résumerbrièvement sont surprenants par leur netteté,mais nous devons rester extrêmement modestesquant à leur portée. Autant nous revendiquonsle droit à la réduction que nous avons opérée (leregroupement en panneaux, la réduction auxthèmes présents étaient des procédures indispen-sables pour démontrer l’existence de régularités),autant nous sommes convaincus que les régularitésmises en évidence sont biaisées par les réductionsopérées. Ce serait une erreur de prendre au piedde la lettre les règles, telles que nous les avons for-mulées, et de prétendre que nous avons découvertdes “lois” paléolithiques. Sans doute n’ont-ellesqu’un lointain rapport avec la réalité paléolithi-que. Leur seul mérite est de mettre en évidencel’existence de contraintes fortes.
Les conclusions auxquelles nous sommes par-venus ne constituent qu’une première étape d’unlong travail, mais une étape-clef puisque les sui-vantes en dépendaient. Si nous n’avions rien trou-vé de remarquable au niveau d’abstraction auquelnous nous sommes placés, il aurait été inutile decontinuer et nous aurions dû conclure que Breuilavait raison et que les assemblages de figuresétaient le fruit du hasard. Tel n’est pas le cas.Nous devons abandonner l’idée d’un chaos d’ani-maux jetés sans ordre sur les parois par quelquechamane pour commémorer son voyage au paysdes esprits. Au contraire, ce que nous voyonsapparaître, c’est un petit nombre de personnagesentretenant entre eux des relations relativementstables, ce qui implique l’existence d’une penséeorganisatrice sous-jacente (selon toute vraisem-blance, ces personnages sont les acteurs de récitsmythiques fondant un véritable panthéon, maiscette hypothèse n’est pas indispensable).
Les résultats de cette première partie du tra-vail nous encouragent à mettre en chantier uneseconde phase, correspondant à une analyse
beaucoup plus fine, qui permettra de mieuxcomprendre les contacts entre groupes contem-porains et l’évolution de leurs liens au cours dutemps, bref d’esquisser une véritable géographiehumaine et de l’inclure dans une perspective his-torique (Conkey, 1990).
Les deux aspects les plus critiqués de la pro-cédure préconisée par Leroi-Gourhan et quenous avons reprise en grande partie sont: 1) lerassemblement en un corpus unique d’œuvresdispersées dans le temps et dans l’espace; 2) l’a-bandon des représentations individuelles au pro-fit des “sujets de composition”. Nous reconnais-sons parfaitement le bien-fondé de ces deuxcritiques, mais nous nous sommes déjà justifiéssur la nécessité d’avoir pratiqué ces deux appro-ximations dans un premier temps. Le résultatayant dépassé notre attente en dévoilant la puis-sance des contraintes qui se sont exercées sur lamise en place des œuvres dans l’espace souter-rain, il convient maintenant de prendre en comp-te ces deux objections.
Diachronie et sectorisation géographique
Pour répondre à l’objection d’hétérogénéitéde notre corpus, la seule façon de procéder est dele subdiviser en sous-ensembles géographique-ment délimités et correspondant à des tranchesde temps bien définies, mais une telle opéra-tion soulève de grandes difficultés. Quelles sont les régions “naturelles” qu’il faut prendre encompte? Quelles coupures chronologiques peut-on raisonnablement pratiquer, compte tenu del’incertitude des datations? Dans ce domaine,nous n’avons pas cherché à faire preuve d’origi-nalité, car le découpage du corpus n’est pournous qu’un moyen de repérer d’éventuelles diffé-renciations synchroniques et diachroniques. Unecertaine marge d’approximation ne devrait pasempêcher d’atteindre ce but. Les grandes régionsretenues correspondent à des groupements quiapparaissent plus ou moins spontanément surune carte de répartition des sites (voir Figure 3).Toutefois, le regroupement de la plus grande par-tie de la Péninsule ibérique en une seule région(“Espagne Centre et Sud”) n’est justifié que parla nécessité de disposer d’ensembles d’une tailleminimale. A l’opposé, on nous reprochera sans
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 223
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
224 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 3. Carte des sous-ensembles retenus pour l’analyse régionale et diachronique.
doute d’avoir rassemblé les Asturies, la Cantabrieet le Pays Basque en une seule région (Régioncantabrique) alors que de subtiles différences sefont jour entre l’Ouest et l’Est.
Sur le plan chronologique, la seule coupurequ’il nous a paru possible de pratiquer est cellequi sépare les figures attribuables au Style III deLeroi-Gourhan (assimilables en grande partie auSolutréen et au Magdalénien ancien, là où ilexiste) et les figures de Style IV (Magdalénienmoyen et supérieur). Pour les phases anciennes,un certain nombre de datations directes par leradiocarbone rendues possibles par la techniqueAMS ont montré que les critères définissant leStyle II et le Style III étaient difficilement utili-sables à des fins chronologiques (il suffit de citerles exemples de Cougnac et d’une partie aumoins du Pech-Merle autour de 25.000 BP, deCosquer entre 28.000 et 18.000 BP, et de Chau-vet autour de 30.000 BP). C’est pourquoi nousavons préféré rassembler les sites attribués auStyle II et III en une seule période, bien quecelle-ci soit très longue1. Cette approximation est
justifiée par le but poursuivi qui est seulementde nous doter d’un moyen de mettre en éviden-ce une éventuelle évolution thématique au coursdu temps. On notera que même cette approxi-mation s’est révélée impossible pour certainesrégions, par manque de précision chronologiqueou par manque d’effectifs.
La comparaison des douze sous-ensemblesrégionaux et chronologiques ainsi obtenus per-met un certain nombre d’observations qui méri-tent d’être discutées (Tableau 3). On observe eneffet à la fois des constantes et des variations quifournissent une vision contrastée de l’art parié-tal. En premier lieu, on note que le Cheval occu-pe la première ou la seconde place dans tous lessous-ensembles: c’est de loin le motif animalierqui présente la plus grande stabilité. Si le Paléo-lithique supérieur a parfois été appelé “l’âge duRenne”, c’est plutôt d’un “âge du Cheval” qu’ilfaudrait parler du point de vue artistique. Inci-demment, il faut noter que l’omniprésence duCheval sur les parois des cavernes contraste avecson importance économique qui est très varia-ble. Même lorsque le Cheval est presque absentdes restes fauniques, c’est souvent lui qui consti-tue l’animal dominant du bestiaire (à Ekain parexemple, Barandiarán et Altuna, 1977).
L’espèce animale qui vient en seconde posi-tion dans le corpus global est le Bison, mais soncas est très différent de celui du Cheval, car il
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 225
1 Cette position a l’avantage de ne pas nous obli-ger à trancher prématurément la question de l’art parié-tal antérieur au Style III dans la région cantabrique(Gravettien ou encore plus ancien), qui existe certaine-ment, mais n’est pas encore complètement défini (For-tea, 1994; González Sainz, 1999a, 1999b).
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
TABLEAU 3: Sous-ensembles chronologiques et régionaux de l’art pariétal paléolithique. Archaïque: figures antérieures auMagdalénien moyen (Styles II et III de Leroi-Gourhan); IV: figures attribuées au Magdalénien moyen etsupérieur (Style IV de Leroi-Gourhan).
ch bn bq bos ce bi ma re ur an li rh po div totalR. cantabrique archaïque 150 47 94 78 86 196 2 2 2 5 1 0 3 8 674R. cantabrique IV 83 151 55 14 10 10 1 15 5 1 0 0 7 7 359Pyrénées archaïque 47 23 11 8 7 1 6 0 0 2 0 0 0 2 107Pyrénées IV 205 355 56 4 14 10 2 24 9 37 12 2 7 16 753Quercy archaïque 18 10 15 6 10 2 19 0 1 7 2 0 2 7 99Quercy IV 29 13 11 2 1 3 0 12 0 10 0 0 0 8 89Périgord archaïque 178 49 38 48 16 4 10 25 9 11 12 3 1 8 412Périgord IV 171 127 30 10 17 6 199 47 21 43 7 13 1 6 698Rhône-Languedoc archaïque 100 41 52 26 19 5 77 11 16 4 52 55 1 19 478Rhône-Languedoc IV 6 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13Espagne Centre et Sud 99 0 29 26 20 28 0 1 1 13 3 1 16 4 241France-Nord 13 3 1 4 3 0 25 1 3 1 1 1 1 1 58Total 1.099 820 396 228 203 265 341 138 67 134 90 75 39 86 3.981
présente de fortes variations régionales et tem-porelles. S’il est second en moyenne, il doit sonrang à la région cantabrique, aux Pyrénées et auPérigord. Ailleurs, il est rare (Rhône-Languedoc)ou complètement absent (Espagne Centre etSud). Il est donc légitime de se demander si cesvariations correspondent à des ruptures, c’est-à-dire à des systèmes différents qui seraient sim-plement juxtaposés les uns aux autres, sans liende parenté, ou seulement à des aménagementspartiels d’un même système. L’absence de repré-sentations de bisons dans toute la séquence duParpalló (Villaverde, 1994) et dans les grottesde la Meseta et de l’Andalousie doit être miseen relation avec son absence dans les gisementsde ces mêmes régions. La question est alors desavoir si la place qui est occupée ailleurs par leBison est ici occupée par un autre animal et sila substitution s’effectue seulement terme àterme ou si elle entraîne une redistribution desvaleurs des autres éléments du système au pointque celui-ci s’en trouve complètement boulever-sé et dénaturé. Il est très difficile de répondre àune telle question, car il faudrait étudier séparé-ment les structures de chaque sous-ensemble etse doter des moyens de les comparer (v. infra).Dans l’état actuel de nos connaissances, le seulargument que nous possédions en faveur dedéveloppements régionaux autonomes ayantconduit à des divergences thématiques et stylis-tiques est l’existence de figures qui semblenttotalement étrangères aux productions locales.On peut citer le cas d’un bison finement gravédans la grotte d’Ebbou: sa situation à l’écart ducheminement et son style magdalénien “classi-que” font de lui un intrus dans le canyon del’Ardèche2. On notera, comme pour le Cheval,que le Bison est parfois dominant dans l’artpariétal d’une grotte, alors qu’il est très peu pré-sent dans la faune consommée, comme à Santi-mamiñe par exemple (Altuna, 1994).
Le troisième animal par ordre d’importancedans le corpus global est le Bouquetin. Or, cetteposition reflète bien le rôle remarquablementconstant qu’il occupe dans chaque sous-systèmedu Tableau 3, puisqu’il est second ou troisièmedans huit cas sur onze. Autant la dissymétrie dela répartition du Bison que nous venons de dis-cuter est l’indice de variations indéniables sur leplan régional et temporel, autant la constance duCheval et du Bouquetin plaide en faveur d’unsystème unique dont certains éléments majeursassurent la continuité dans l’espace et dans letemps. Nous devons donc rechercher dans les don-nées archéologiques à notre disposition les argu-ments permettant de comprendre les mécanismesd’interactions entre groupes voisins et l’évolutionde ces relations au cours du temps.
C’est encore une fois aux méthodes statisti-ques d’analyse des données que nous feronsappel. Le traitement du Tableau 3 par AFC etCAH donne un résultat relativement facile àinterpréter qui mérite quelques commentaires(Figure 4). Comme on pouvait s’y attendre, leCheval et le Bouquetin occupent le centre d’untriangle dont l’un des sommets est occupé par leMammouth et le Rhinocéros (Rhône-Languedocarchaïque et Nord), un autre sommet par leBison (Pyrénées-IV et Cantabres-IV) et la troi-sième par la biche (Cantabres archaïque). Il estintéressant de noter que ce schéma triangulaireest pratiquement identique à celui que nousavions publié en 1979 (Sauvet et Sauvet, 1979:Fig. 1) malgré l’accroissement considérable desdonnées depuis cette date (1.297 figures à l’épo-que contre 3.981 aujourd’hui): le “pôle” Mam-mouth-Rhinocéros était déjà mis en évidence parl’AFC, bien avant la spectaculaire découverte dela grotte Chauvet!
Le changement de position de certainesrégions entre les phases anciennes du Paléolithi-que supérieur (Styles II-III) et l’apogée magda-lénienne (Style IV) est intéressant à remarquer.Pour les Pyrénées, le déplacement est dû à uneaugmentation importante du rôle du Bison. Lamême tendance est observée pour la région can-tabrique dont le profil thématique se rapprochefortement de celui des Pyrénées au Magdalénien,alors que les deux régions étaient très nettementséparées aux périodes antérieures, en raison du
226 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
2 Leroi-Gourhan, dans la notice qu’il consacre àgrotte d’Ebbou dans Préhistoire de l’Art occidental (1965,p. 328), note que les deux seuls bisons que renferme lagrotte semblent être des ajouts postérieurs à la constitu-tion de la décoration principale et il imagine des visi-teurs paléolithiques porteurs de “la tradition du style IVancien de l’ouest” retrouvant ce sanctuaire ancien et leremettant à leur goût.
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
rôle dominant de la biche dans les Cantabres.Or, cette observation est parfaitement conformeaux données archéologiques. En effet, dans larégion cantabrique, la période solutréenne estparticulièrement resplendissante et semble se
prolonger longtemps, tandis qu’en Aquitaine sedéveloppe les premières phases du Magdalénien.Par exemple, le gisement Solutréen supérieur deChufín, daté de 17480 ± 120 BP, et attribuablepar ses pollens à une oscillation tempérée (Boyer-
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 227
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 4. Analyse Factorielle des Correspondances des sous-ensembles chronologiques et régionaux du Tableau 3 (les symbo-les sont ceux du Tableau 1).
Klein, 1980) est apparemment contemporain duMagdalénien de Lascaux et de Gabillou (Aujoulatet al., 1998). Le Solutréen terminal de Las Caldas(17380 ± 215 BP) confirme cette hypothèse (Cor-chón, 1999). Cela traduit sans doute le fait quela région cantabrique a connu une évolution pro-pre jusqu’aux alentours de 16000 BP.
Le développement artistique autonome de larégion cantabrique se manifeste non seulement surle plan thématique par la place accordée à certainsmotifs comme l’aurochs et les cervidés (le cerf etsurtout la biche), mais aussi sur le plan techniqueavec les silhouettes rouges faites de ponctuationsplus ou moins congruentes et, dans le domaine dela gravure mobilière ou pariétale, par de larges ban-des striées figurant les volumes et les masses mus-culaires. Puis, à partir du Magdalénien moyen, l’ar-chéologie nous montre une nette convergence desindustries des deux côtés des Pyrénées. Parallèle-ment, nous constatons que les thématiques sesont rapprochées: le Bison qui était relativementrare dans la période précédente est maintenantabondant et les cervidés ont considérablementreculé. Il y a donc une étroite corrélation entre lesdonnées archéologiques et les données de l’artpariétal.
Comment peut-on interpréter cette situation?Le fait que la région cantabrique ait développéune thématique particulière durant le Solutréenmontre que ses liens avec le monde aquitain ontdû se raréfier, sinon se rompre pendant une assezlongue période (y compris pendant les phases lesplus anciennes du Magdalénien)3. Un peu plustard, les communications ont dû se rétablir et l’onconstate, aussi bien dans les industries que dansl’art pariétal et mobilier, une rapide homogénéi-sation (les signes claviformes de La Cullalvera et
du Pindal, ainsi que les contours découpés de LaViña montrent l’existence de liens renoués avec lemonde pyrénéen). Mais que s’est-il passé pendantla phase de séparation? Les croyances se sont-ellescomplètement dénaturées au point que l’on puisseparler d’une autre culture? Probablement pas. L’é-volution observée se limite à une poussée specta-culaire de l’aurochs, du cerf et de la biche, c’est-à-dire à une variation des proportions des thèmesfigurés. Or, il n’est pas difficile de voir d’où vientcette influence: elle vient de la Péninsule ibéri-que. Les sites paléolithiques de la Meseta et del’Andalousie, ainsi que les sites de plein air de FozCôa, de Siega Verde et de Domingo García mon-trent l’influence écrasante de l’aurochs et des cer-vidés4. La thématique des abris de la vallée duNalón (La Viña, la Lluera I, Godulfo, Los Mur-ciélagos, Entrefoces, Santo Adriano, Los Tornei-ros, etc.) n’est pas différente et montre même desaffinités stylistiques indéniables avec les sites deplein air péninsulaires (Fortea, 1994, 2002). Surla côte méditerranéenne, l’art mobilier du Parpa-lló et l’art pariétal de Cova Fosca montrent lesmêmes tendances. Tout se passe donc comme siun basculement s’était produit aux environs de20000-18000 BP, au moment du maximum gla-ciaire, la région cantabrique, coupée de ses liensavec l’Aquitaine, s’étant alors rapprochée du restede la Péninsule ibérique. Plus tard, aux environs de16000-15000 BP, le mouvement semble s’être ànouveau inversé.
L’analyse techno-stylistique confirme quependant une période approximativement centréesur le Solutréen, la région cantabrique a déve-loppé un style propre. Les figures rouges, notam-ment les biches avec le traitement caractéristiquedes oreilles en V et l’élongation exagérée du cou,marquent une époque et une région. Sans allerjusqu’à parler d’une “école de Ramales”, il estclair que les biches d’Arenaza, de Covalanas,du Pendo et de la Pasiega constituent un groupe
228 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
3 Les dates 14C les plus anciennes du faciès de typeRascaño, considéré par P. Utrilla comme le Magdalénienle plus archaïque de la région cantabrique, ne sont pasantérieures à 16433 ± 131 BP (Rascaño, niv. 5) (Utrilla,1989) et l’auteur insiste sur la caractère graduel de la“magdalénisation” du substrat solutréen, lui même con-sidéré comme en voie de “désolutréanisation” par d’au-tres auteurs (Corchón, 1999). Les termes employés disentassez que la transition fut un processus lent, progressifet sans solution de continuité. S’il en fut ainsi dans ledomaine technique, pourquoi en aurait-il été autrementdans le domaine des croyances?
4 Les sites de Foz Côa, Siega Verde et DomingoGarcía ne figurent pas actuellement dans notre corpus.Pourtant, on peut noter que les thèmes principaux de lagrande région “Espagne Centre et Sud” sont les che-vaux, les caprinés, les cervidés et l’Aurochs. L’incorpora-tion des sites de plein air ne modifiera pas sensiblementla position du point représentatif sur le graphe de laFigure 4.
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
formellement et techniquement homogène (Ape-llaniz, 1982). Ce style connaît une certaine évo-lution vers des formes plus statiques et moinsstylisées dont l’un des derniers avatars pourraitêtre la biche du Pindal. Or, dans cette grotte,apparaissent non seulement les signes clavifor-mes déjà mentionnés, mais aussi des bisons fine-ment gravés traités par des séries de hachuresserrées qui rappellent fortement les bisons arié-geois du Magdalénien moyen. Il est difficile deconcevoir que ces œuvres sont le fruit de con-vergences totalement indépendantes. Trop d’ar-guments plaident en faveur de contacts rétablisentre les deux régions pour qu’on puisse les igno-rer (Fortea, 1989).
Il est évidemment impossible d’interpréterles phénomènes observés en termes historiques.Ce que nous constatons, c’est que les réseauxd’échange sont loin d’être stables. Les liens tis-sés entre les groupes se font et se défont au fildu temps, probablement en fonction d’événe-ments qui échappent totalement aux moyensd’investigation archéologiques dont nous dispo-sons, faute d’un chronomètre suffisamment pré-cis. Nous ignorons non seulement la cause, maisaussi l’importance et la durée de ces change-ments stratégiques. Toutefois, il semble que lesmodifications entraînées par ces basculementsrestent assez superficielles et que les fossés crééspar l’isolement soient peu profonds, puisqu’ils secomblent rapidement lorsque le contact est réta-bli. Il semble que les divergences produites parun temps de séparation même relativement longsoient rapidement effacées, ce qui montre unegrande faculté d’adaptation. On peut y voirl’indice que les systèmes de croyances ne sontpas fondamentalement remis en cause au coursde ces phases d’isolement, ce qui tendrait àmontrer que le contenu évolue moins vite quela forme. Des modifications telles que le reculde la biche et l’importance grandissante duBison observée dans les Cantabres au début du Magdalénien moyen apparaissent finale-ment comme des épiphénomènes. Tout se passecomme si les régions disposaient d’une margede liberté leur permettant d’accorder plus oumoins d’importance à telle ou telle espèce ani-male, sans que cela remette en cause l’intégrité dusystème.
Sites magdaléniens pyrénéens et cantabriques:une diversité d’origine non régionale
Le rapprochement thématique qui sembles’opérer au cours du Magdalénien entre les Pyré-nées et la région cantabrique nous a incité àrechercher les indices d’une éventuelle progressiond’est en ouest. Pour cela, nous avons sélectionnéune vingtaine de grottes ornées magdaléniennesréparties sur un peu plus de 600 km, de Fonta-net (Ariège) à Covaciella (Asturies), et les avonssoumises à une nouvelle AFC. Cette analyse estbeaucoup plus fine que le précédent puisqu’ellepermet de comparer directement le contenu thé-matique des sites (Figure 5). Comme on pouvaits’y attendre, l’axe 1 oppose les deux thèmes majo-ritaires du corpus, le Cheval et le Bison, et l’onconstate que les grottes ornées se répartissententre ces deux pôles sans qu’apparaissent des ten-dances géographiques nettes. Par exemple, Cova-ciella (Asturies), Altxerri (Guipuzcoa), Santima-miñe (Viscaya) voisinent dans le premier planfactoriel avec trois grottes ariégeoises (Les Trois-Frères, Le Mas-d’Azil et Bédeilhac) en raison dela prédominance du Bison, tandis que, parmi lessites à Cheval majoritaire, on trouve non seule-ment les sites basques d’Etcheberri-ko-Karbia(Pyr.-Atlantiques), d’Oxocelhaya (Pyr.-Atlanti-ques) et d’Ekain (Guipuzcoa), mais aussi LasMonedas (Cantabrie) et Montespan (Haute-Garonne). Certains sites proches de l’équilibreCheval-Bison se trouvent aussi bien dans lesAsturies (El Pindal), en Cantabrie (El Castillo)et en Ariège (Le Portel). Le fait que le schémasemble quelque peu brouillé sur le plan géogra-phique ne le rend pas moins intéressant, puis-qu’il apporte, au contraire, l’indication précieuseque la diversité apparente n’est pas d’originerégionale. En effet, on constate que des grottesvoisines et sans doute peu éloignées dans letemps présentent des différences thématiquesimportantes et sont en quelque sorte complé-mentaires par rapport aux deux thèmes majeurs:il suffit de comparer Altxerri (59% de bisons, 5%de chevaux) et Ekain (63% de chevaux, 16% debisons). La complémentarité peut même s’exer-cer à l’intérieur d’un même site, dans des sec-teurs différents: au Portel, la galerie Régnault ren-ferme 11 chevaux et 3 bisons et la galerie Breuil
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 229
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
11 bisons et 3 chevaux. Leroi-Gourhan a racontéque c’est cette observation qui fut à l’origine deson interprétation binaire de l’art pariétal (Leroi-Gourhan, 1965: p. 81). En Périgord, l’inversion
des proportions de chevaux et de bisons entreles Combarelles et Font-de-Gaume a été recon-nue de longue date (Roussot, 1984); dans notrecorpus, les chiffres sont presque symétriques:
230 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 5. Analyse Factorielle des Correspondances des contenus thématiques de 20 grottes magdaléniennes cantabriques etpyrénéennes (Aurochs, Mammouth et Rhinocéros, très rares, ont été placés en éléments supplémentaires et ne par-ticipent pas à la définition des axes).
Ch = 40,3%, Bn = 16,1% aux Combarelles; Ch =21,1%, Bn = 42,3% à Font-de-Gaume. Les sanc-tuaires dits “monothématiques” parce qu’ils pré-sentent un thème figuratif ou abstrait, unique outrès largement majoritaire, comme Las Herrerías(signes réticulés), La Lluera II (signes triangulai-res), Arenaza et El Pendo (biche), El Bosque(Bouquetin), ne représentent que l’aboutissementde cette tendance à la disjonction (Jordá, 1979;Fortea, 1990). Il semble que les sites de plein airde la Meseta n’échappent pas à la règle. Onobserve par exemple que les différentes espècesanimales sont très inégalement représentées dansles différents secteurs de Domingo García: leCheval représente 84,6% des espèces détermina-bles à la Dehesa de Carbonero (11 sur 13), tan-dis que 69% des caprinés sont concentrés à LasCanteras (11 sur 16) (Ripoll et Municio, 1999).
L’ensemble de ces observations tend à mon-trer que tous les sanctuaires participent d’unmême ensemble de significations, mais que cha-cun d’eux n’exprime qu’une partie du discours,en fonction du rôle spécifique qui lui est dévo-lu. On peut penser par exemple que certains sites(ou certaines parties de sites) étaient fréquentésen des circonstances précises liées à la célébra-tion de rites au cours desquels seuls certains épi-sodes du mythe étaient réactivés. Rites liés auretour de ressources saisonnières, rites d’initia-tion, mariages, commémoration d’un ancêtremythique, etc.: il est aisé d’imaginer divers typesd’événements qui jalonnent la vie des groupes dechasseurs et conduisent à une sorte de focalisa-tion sur un aspect particulier du mythe. Dansune telle hypothèse, l’ensemble des sites d’uneépoque doit être regardé par nous comme unesorte de kaléidoscope des croyances paléolithi-ques que seule une approche globale peut per-mettre de reconstituer. Si tel était le cas, celaexpliquerait la cohérence du modèle formel quenous avons décrit plus haut et justifierait a pos-teriori la méthode statistique utilisée puisquel’objectif de celle-ci est justement de rassembleret d’ordonner les pièces d’un puzzle dispersées àtravers un grand nombre de sites.
R. Layton a récemment proposé une appro-che de l’art rupestre qui pourrait permettre detrancher entre plusieurs hypothèses interprétati-ves telles que la chamanisme ou le totémisme
(Layton, 2000). A partir de quelques exemplesd’arts rupestres réalisés par des sociétés pour les-quelles on possède des données ethnographiquesconcernant leur organisation totémique (Wes-tern Kimberley, Australie) ou leur pratique duchamanisme (Karoo, Afrique du Sud), R. Lay-ton montre que les deux types de sociétés pro-duisent des arts rupestres qui diffèrent profon-dément dans leur structure. On observe parexemple des différences significatives dans les fréquences des différents thèmes, ainsi que dansleur distribution dans différents sites, les sociétéschamaniques tendant à favoriser deux ou troismotifs principaux communs à presque tous lessites, tandis que les sociétés totémiques montrentune plus grande diversité de motifs dont beau-coup n’apparaissent que dans un ou deux sites.Il y a donc là a priori un moyen de distinguerces deux grands types de comportement socio-religieux et la méthode peut avoir un caractèreprédictif très utile, si elle est appliquée à un artrupestre de tradition inconnue comme l’art palé-olithique. Toutefois, l’interprétation n’est pasdénuée d’ambiguïté, car deux régions d’Afriquedu Sud où le chamanisme est pratiqué (Karooet Drakensberg) montrent entre elles de nettesdifférences, peut-être en raison de la faible tailledes échantillons utilisés dans ce travail prélimi-naire. L’art pariétal paléolithique semble présen-ter lui aussi un comportement ambigu, puisqueles considérations que nous venons de dévelop-per sur la disjonction des motifs entre des sitesvoisins serait plutôt en faveur du totémisme,tandis que l’iconographie limitée à quelquesmotifs principaux serait en faveur du chamanis-me. Sans doute parce que l’art paléolithique n’estni l’un, ni l’autre. La méthode devrait êtreouverte à d’autres hypothèses, comme par exem-ple celle d’un art d’inspiration religieuse nonchamanique: quelle différence cela ferait-il dupoint de vue iconographique? Ces réserves n’a-moindrissent nullement l’intérêt potentiel de laméthode qui représente à nos yeux la seuleapproche archéologiquement viable des ques-tions d’interprétation, puisqu’elle permet dedépasser à la fois le comparatisme ethnographi-que et le structuralisme, en les réconciliant dansune analyse structurale intégrée des productionspréhistoriques et ethnographiques.
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 231
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
Prendre en compte la diversité formelle
La discussion qui précède indique une voie derecherche susceptible d’enrichir notre connaissan-ce des sociétés paléolithiques. Elle montre en touscas l’intérêt qu’il y a à valoriser l’art pariétal dansune perspective anthropologique. A ce débat, l’a-nalyse structurale, telle que nous l’avons conduitejusqu’à présent, a pu apporter une contributionintéressante, mais elle montre ses limites qui sonten grande partie dues au fait d’opérer sur des don-nées trop agrégées (les espèces animales). Il con-vient donc de dépasser ce stade pour prendre encompte la diversité des aspects formels.
Dans cette nouvelle phase de recherche, cha-que figure doit retrouver son identité graphique,c’est-à-dire qu’elle doit être décrite à l’aide d’uncertain nombre de caractéristiques définissantnon seulement sa forme propre, mais aussi leséléments contextuels de son environnement gra-phique, ainsi que les caractéristiques topographi-ques de son emplacement dans la grotte. Denouveau, s’agissant d’une recherche qui vise àreconnaître des similitudes et des différencesparmi un grand nombre d’occurrences, les carac-téristiques formelles doivent être codifiées afinde constituer une base de données régulière.Nous avons opté pour une structuration desdonnées du type attributs-valeurs dans laquellechaque figure pariétale est décrite à l’aide d’attri-buts pouvant prendre un certain nombre devaleurs prédéterminées. L’établissement d’uneliste d’attributs et de leurs valeurs possibles estune tâche difficile qui dépend dans une grandemesure du degré d’approximation que l’on estprêt à assumer. Une description trop poussée quianalyserait les figures trait par trait, élément ana-tomique par élément anatomique, consommeraitun temps extrêmement long, et donnerait une baseinfiniment lourde, dont il ne sortirait probablementrien. A l’inverse, si le nombre d’attributs-valeurs esttrop réduit, on ne trouvera probablement rien quenous ne sachions déjà. Il faudra donc procéderpar approximations successives et le mode d’en-registrement des données devra être souple etaisément modifiable afin de suivre l’évolution dela recherche. Il y a donc une réflexion méthodo-logique à mener dont nous ne pouvons livreraujourd’hui qu’un premier état, qui permettra
seulement de montrer la nature des résultats quel’on peut attendre.
Base de données de deuxième génération
Pour mettre en place une procédure adaptéeà notre problématique, nous avons constitué, àtitre préliminaire, une base de données expéri-mentale, encore très partielle puisqu’elle compteactuellement 2381 figures réparties dans 528panneaux provenant de 56 sites. Les attributsretenus dans cette première approche sont aunombre de cinq: les “éléments corporels” (pou-vant prendre 7 valeurs), la “taille” (5 valeurs),l’ “orientation” (13 valeurs), la “technique” (14valeurs), l’ “animation” (5 valeurs).
Par exemple, dans l’état actuel de cette grille,l’attribut “éléments corporels” peut prendre septvaleurs: animal complet, protomé, animal acépha-le, animal sans patte, avant-main, arrière-train,ligne cervico-dorsale. De même, l’orientation dela figure est codée selon les conventions d’une rosedes vents: par exemple, NE désigne un profil droitoblique ascendant, E (profil droit), SE (profildroit oblique descendant), Sd (profil droit tom-bant), Sg (profil gauche tombant), etc...
Le but de ce travail étant d’approfondir notreconnaissance des associations, l’un des aspectsimportants de la description de chaque figure estl’enregistrement de son contexte graphique, c’est-à-dire les figures qui l’entourent. Pour cela, laposition de chaque figure est notée dans un systè-me de coordonnées cartésiennes, en unités arbi-traires. Cette information peut être automatique-ment recodée en indiquant pour chaque figure(identifiée par un numéro d’ordre) la position surune rose des vents des figures avoisinantes (ellesaussi identifiées). Par exemple, un codage tel quech1(E)<E>ch2(O) désigne un cheval (n° 1 dansle panneau) en profil droit avec, à sa droite (àl’est), un cheval (n° 2) tourné vers la gauche: ils’agit donc de deux chevaux affrontés. Ce codage,très commode et facile à automatiser, permet d’ex-plorer rapidement toutes les dispositions possibles,espèce par espèce, ce qui nous a déjà permis defaire quelques observations inattendues que nousprésenterons ci-dessous à titre de premier aperçu.
Dans ce travail préliminaire, les signes n’ontpas été pris en compte, mais il nous semble
232 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
indispensable de les introduire dans un secondtemps, car nous sommes convaincus qu’ils for-ment un tout indissociable avec les représenta-tions figuratives. La difficulté est avant tout d’or-dre typologique. Le système de 14 clefs que nousavions proposé en son temps devra subir quel-ques aménagements pour être opérationnel dansle cadre de la présente étude (Sauvet et al., 1977).
Le stockage d’informations sous forme de lis-tes d’objets caractérisés par des attributs et desvaleurs est classique dans toutes les méthodesactuelles d’extraction automatique des connais-sances, connues dans la littérature anglaisecomme Knowledge Discovery in Databases ouData Mining (Fayyad et al., 1996, Bramer, ed.,1999; Hand et al., 2000). L’une de ces métho-des, appelée Rough Set theory (Pawlak, 1991),est particulièrement adaptée à notre problème,
puisqu’elle permet, lorsqu’on est confronté à unensemble d’objets inconnus, de déterminer lesattributs qui possèdent le pouvoir discriminantle plus fort, c’est-à-dire ceux qui jouent un rôleprépondérant dans la hiérarchie des attributs etla constitution de classes d’objets apparentés oustructurellement liés. Dans la phase de tâtonne-ments où nous sommes, l’intérêt d’une telleméthode est de nous aider à affiner progressive-ment la liste des critères descriptifs et de sélec-tionner les plus aptes à servir notre objectif.
L’application des algorithmes proposés par laRough Set theory nous a permis de classer les cinqattributs que nous avions sélectionnés dans unpremier temps, par ordre de pouvoir discrimi-nant décroissant (Figure 6):
éléments corporels > orientation > taille >technique > animation.
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 233
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 6. Détermination automatique du pouvoir discriminant des cinq attributs retenus pour décrire les représentationsanimales, à l’aide des algorithmes de la Rough Set theory (Pawlak, 1991).
Cet ordre est le même en ce qui concerne leschevaux, les bisons et les bouquetins, ce qui sem-ble indiquer qu’il s’agit d’une constante liée aufonctionnement même du système figuratif.
Examinant de plus près la raison pour laquel-le les éléments corporels jouent un rôle si impor-tant, on constate effectivement que les différentesespèces sont concernées à des titres très diverspar les différentes valeurs de cet attribut. Enlimitant la comparaison au Cheval et au Bison(seules espèces suffisamment abondantes dansnotre corpus expérimental pour permettre d’at-teindre des conclusions statistiquement fiables),on constate que le Cheval présente par rapport
au Bison un très fort excès de protomés, alorsque le Bison présente un excès significatif dereprésentations acéphales et de lignes cervico-dorsales (Figure 7).
L’orientation des figures est l’attribut quivient en seconde position. Son importance estsans doute due au fait qu’il concerne aussi la dis-position relative des figures et donc la construc-tion des panneaux. L’intérêt de cet attribut estdonc indéniable et l’examen préliminaire auquelnous nous sommes livrés réserve effectivementquelques surprises. Pour toutes les espèces ani-males, à l’exception du cheval, il y a une majori-té de figures tournées vers la gauche (Figure 8),
234 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 7. Comparaison de l’attribut “éléments corporels” du Cheval et du Bison par la méthode statistique de Laplace-Gauss. Les fréquences Fch et Fbn ont été calculées pour chaque valeur de l’attribut, ainsi que les écarts-types s. Lerapport t = |Fch - Fbn|/s permet de déterminer la probabilité que l’écart entre les deux fréquences soit unique-ment dû aux fluctuations d’échantillonnage (t = 1, intervalle de confiance à 67%; t = 2, intervalle de confianceà 95%, t=3, intervalle de confiance à 99,7%).
une différence qui est statistiquement significati-ve compte tenu des nombres de figures concer-nées ; en effet, il y a plus de 99,7% de chancesque la différence par rapport à une distribution50:50 ne soit pas due à des fluctuations d’échan-tillonnage. Dans ce cas, l’excès de figures en pro-fil gauche pourrait facilement s’expliquer par lapratique d’artistes droitiers commençant préfé-rentiellement leur représentation par la tête (Fritz1999). Toutefois, le Cheval vient contredire cetteexplication simpliste, puisque 55,8 % des chevauxsont pour leur part figurés en profil droit. Nonseulement cette proportion est significativementdifférente d’un distribution 50:50 (probabilitésupérieure à plus de 99,7%), mais l’inversion parrapport aux autres espèces est également signifi-cative à plus de 99,7%. Encore une fois, et surce critère a priori inattendu, on constate que leCheval montre un comportement figuratif sin-gulier. Tout se passe comme si, dans les panneaux
polythématiques, le modèle de construction quivenait le plus spontanément à l’esprit des artistesconsistait à mettre en scène un ou plusieurs che-vaux tournés vers la droite et des représentantsd’autres espèces tournés vers la gauche. On note-ra que l’idée parfois avancée selon laquelle l’o-rientation des figures par rapport à l’entrée de lagrotte serait signifiante (animaux “entrant” ou“sortant”) ne trouve pas de confirmation dansnotre corpus préliminaire.
Les informations de notre base de donnéespermettent également de nous intéresser aux ani-maux figurés en position verticale (ascendant oudescendant). On constate encore que les diffé-rentes espèces ne sont pas logées à la mêmeenseigne. Les chevaux et les bisons présentent ànouveau une disparité très intéressante puisque,parmi les animaux verticaux, les chevaux sont enproportion très inférieure à leur proportion glo-bale (19,4% au lieu de 27,5%), tandis que les
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 235
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 8. Orientation des principales espèces animales de l’art pariétal paléolithique. Seul le cheval présente une majoritéde figures en profil droit.
bisons sont en proportion très supérieure (43,3%au lieu de 29,8%). Cette observation est peut-être corrélée avec le fait que beaucoup de bisonsdisposés verticalement utilisent des reliefs naturels(Altxerri, El Castillo, Las Monedas, Santimami-ñe, Oxocelhaya, Les Trois-Frères, etc.). Or, nousavons déjà observé que le Bison faisait l’objetd’une attention particulière pour l’utilisation desreliefs, au contraire du Cheval (Sauvet et Tosello,1999).
Les mêmes données se prêtent également àde nombreuses remarques concernant les asso-ciations de voisinage immédiat. En ce qui con-cerne les paires d’animaux de même espèce (dya-des homospécifiques), on observe que lesanimaux de même orientation sont nettementplus fréquents que les animaux opposés (affron-tés ou croisés) (Figure 9). De plus, on note, pourles chevaux, un renforcement de la tendance àformer des paires orientées à droite, tandis que,pour les bisons, c’est un renforcement de la ten-dance à former des paires orientées à gauche,confirmant ainsi les observations signalées plushaut. En ce qui concerne les paires Cheval-Bison
(seule dyade hétérospécifique pour laquelle nouspossédons des données suffisantes), on observedes anomalies très intéressantes par rapport à ceque l’on devrait observer si leurs orientationsétaient quelconques: lorsque deux animaux sesuivent, c’est plus souvent le bison qui suit lecheval que le contraire; dans le cas d’animauxopposés, ils sont plus souvent croisés qu’affron-tés (Figure 9). Toutefois, les chiffres sont encoretrop faibles pour que l’on puisse considérer cesobservations autrement que comme des tendan-ces à confirmer.
Compte tenu du nombre de panneaux quiconstituent la base de données partielle dontnous venons d’exposer quelques résultats préli-minaires, il est actuellement impossible de prati-quer des subdivisions régionales ou temporelles,de sorte que nous ne pouvons dire si les faitsremarquables sont des constantes communes àtoutes les régions et toutes les époques ou si l’onpeut les mettre sur le compte de spécificités loca-les. Nous espérons que la suite du travail per-mettra de répondre à de telles questions et qu’ilsera alors possible de mettre en évidence des
236 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
FIG. 9. Dispositions relatives des paires homospécifiques et hétérospécifiques de chevaux et de bisons.
types de construction propres à certains groupes.On peut en effet penser que, même si le conte-nu du message à transmettre est pratiquement lemême pour tous les groupes, les procédés demise en forme graphique offrent une infinievariété dans laquelle chaque groupe puisera lesmarques visibles de son identité. C’est certaine-ment dans la manière d’assembler les élémentsconstituant ce que Leroi-Gourhan appelait lemythogramme que l’on a le plus de chance de dis-cerner des “effets de style” et donc de parvenir àdélimiter des zones d’influence territoriale (sicette notion a un sens).
Nous sommes convaincus que le travail encours apportera une riche moisson d’informa-tions sur les sociétés paléolithiques à mettre enparallèle avec les données issues de fouilles moder-nes. Malheureusement la constitution d’une basede données du type de celle dont nous avonsbesoin est une tâche immense et l’on peut crain-dre que même lorsqu’elle sera complétée, elle nepermettra pas de répondre à toutes les questionsenvisagées. On est toutefois en droit d’espérer,compte tenu de la labilité de liens régionaux évoquée plus haut, que nous serons en mesurede donner corps à une véritable géographiquehumaine et à sa dynamique sociale.
Note: une partie de ce travail a été effectuéedans le cadre d’une action du Centre Nationalde la Recherche Scientifique “Origine de l’Hom-me, du Langage et des Langues”, au sein d’un pro-jet de recherche intitulé “Emergence et fonctiondes systèmes sémiologiques dans les groupes humainsdu Paléolithique supérieur” (http://www.ohll.ish-lyon.cnrs.fr).
Bibliographie
ALTUNA, J. (1994): ‘‘La relación fauna consumida-fauna representada en el Paleolítico superior can-tábrico’’, Complutum, 5, pp. 303-311.
APELLANIZ, J. M. (1982): El arte prehistórico del PaísVasco y sus vecinos. Bilbao: Desclée de Brouwer,232 pp.
AUJOULAT, N.; CLEYET-MERLE, J.-J.; GAUSSEN, J.; TISNE-
RAT, N. et VALLADAS, H. (1998): ‘‘Approche chro-nologique de quelques grottes ornées paléolithiques
du Périgord par datation carbone14, en spectro-métrie de masse par accélérateur, de leur mobi-lier archéologique’’, Paléo, 10, pp. 319-323.
BARANDIARÁN, J. M. (de) et ALTUNA, J. (1977): ‘‘Exca-vaciones en Ekain (memoria de las campañas1969-75)”, Munibe, 29, pp. 3-58.
BOYER-KLEIN, A. (1980): ‘‘Nouveaux résultats paly-nologiques de sites solutréens et magdalénienscantabriques’’, Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 77, pp.103-107.
BRAMER, M. A. (ed.) (1999): Knowledge discovery anddata mining: theory and practice. IEE Books.
CONKEY, M. W. (1990): ‘‘L’art mobilier et l’établisse-ment de géographies sociales’’. En L’art des objetsau Paléolithique. t. 2. Les voies de la recherche.Colloque international Foix-Le Mas-d’Azil (Nov.1987). Direction du Patrimoine, pp. 163-172.
CORCHÓN RODRIGUEZ, M. S. (1999): ‘‘Solutrense yMagdaleniense del Oeste de la cornisa cantábri-ca: dataciones 14C (calibradas) y marco cronoló-gico’’, Zephyrus, LII, pp. 3-32.
FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. etUTHURUSAMY, R. (eds.) (1996): Advances in Kno-wledge Discovery and Data Mining. AAAI/MITPress, 625 pp.
FORTEA PEREZ, J. (1989): ‘‘El Magdaleniense medioen Asturias, Cantabria y País Vasco’’. En Le Mag-dalénien en Europe (Actes du XIe congrès UISPP,Mayence, 1987), E.R.A.U.L., 38, pp. 419-437.
— (1990): ‘‘Cuevas de la Lluera. Informe sobre lostrabajos referentes a sus artes parietales’’. En Exca-vaciones arqueológicas en Asturias 1983-86. Ovie-do, pp. 19-28.
— (1994): ‘‘Los ‘santuarios’ exteriores en el Paleolí-tico cantábrico’’, Complutum, 5, pp. 203-220.
— (2002): ‘‘L’art rupestre paléolithique dans laPéninsule Ibérique. Découvertes récentes, géogra-phie et chronologie’’. En Actes du 125e congrèsnational des societés historiques et scientifiques.Lille, 2000 (à paraître).
FRITZ, C. (1999): ‘‘La gravure dans l’art mobiliermagdalénien. Du geste à la représentation’’.D.A.F., 75. Paris: Maison des Sciences de l’Hom-me, 216 pp.
GONZÁLEZ SAINZ, C. (1999a): ‘‘Algunos problemasactuales en la ordenación cronólogica del artepaleolítico en Cantabria’’. En I encuentro de His-toria de Cantabria (Santander, 1996), t. I, pp.149-166.
— (1999b): ‘‘Sobre la organización cronológica de lasmanifestaciones gráficas del Paleolítico superior.Perplejidades y algunos apuntes desde la regióncantábrica’’, Edades, 6, pp. 123-144.
Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas 237
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238
HAND, D. J.; MANNILA, H. et SMYTH, P. (2000): Prin-ciples of Data Mining. MIT Press, 425 pp.
JORDÁ, F. (1979): “‘Santuarios’ y ‘capillas’ monote-máticos en el arte rupestre cantábrico”. En Estu-dios dedicados à C. Callejo Serrano. Cáceres.
LAYTON, R. (2000): ‘‘Shamanism, totemism and rockart: les chamanes de la préhistoire in the contextof rock art research’’. Cambridge ArchaeologicalJournal, 10, pp. 169-186.
PAWLAK, Z. (1991): Rough sets-Theoretical aspects ofreasoning about data. Boston: Kluwer AcademicPublishers.
RIPOLL PERELLO, S. et MUNICIO GONZÁLEZ, L. (dirs.)(1999): Domingo García. Arte rupestre paléolíticoal aire libre en la meseta castellana. Memorias 8Arqueología en Castilla y León, 278 pp.
ROUSSOT, A. (1984): ‘‘Approche statistique du bes-tiaire figuré dans l’art pariétal’’, L’Anthropologie, t.88, pp. 485-498.
SAUVET, G. (1988): ‘‘La communication graphiquepaléolithique (de l’analyse quantitative d’un cor-pus de données à son interprétation sémiologi-que)’’, L’Anthropologie, t. 92, pp. 3-16.
SAUVET G. et SAUVET S. (1979): ‘‘Fonction sémiolo-gique de l’art pariétal animalier franco-cantabri-que’’, Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 76, pp. 340-354.
SAUVET, G.; SAUVET, S. et WLODARCZYK, A. (1977):‘‘Essai de sémiologie préhistorique (pour une théo-rie des premiers signes graphiques de l’homme)’’,Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 74, pp. 545-558.
SAUVET, G. et TOSELLO G. (1998): ‘‘Le mythe paléo-lithique de la caverne’’. En Le Propre de l’Hom-me, 213 pp. Lausanne: Ed. Delachaux & Niestlé,pp. 55-90.
SAUVET, G. et WLODARCZYK A. (1995): ‘‘Elémentsd’une grammaire formelle de l’art pariétal paléo-lithique’’, L’Anthropologie, t. 99, pp. 193-211.
UTRILLA MIRANDA, P. (1989): ‘‘El Magdalenienseinferior en la costa cantábrica’’. En Le Magdalé-nien en Europe (Actes du XIe congrès UISPP,Mayence, 1987). E.R.A.U.L., 38, pp. 399-415.
VILLAVERDE BONILLA, V. (1994): Arte paleolítico de lacova del Parpalló. Diputació de Valencia, 2 vols.
238 Georges Sauvet y André Wlodarczyk / El arte parietal, espejo de las sociedades paleolíticas
© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 215-238