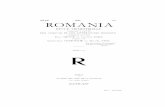La géographie connective ou le miroir du cosmos humboldtien
-
Upload
univ-grenoble-alpes -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La géographie connective ou le miroir du cosmos humboldtien
La géographie connective ou le miroir du cosmos humboldtien
Laura Péaud
Je souhaite interroger l’identité de la géographie humboldtienne, qui est à mon sens une
parfaite illustration du thème du colloque « l’unité dans la diversité ». J’approche la
géographie humboldtienne à partir d’une définition : « la géographie connective »
(Péaud 2009), qui me paraît particulièrement opératoire et qui permet de comprendre
non seulement l’identité disciplinaire de la géographie, mais aussi la vision
humboldtienne du cosmos.
Pourquoi avoir choisi l’entrée par la géographie ?
- Cela présente tout d’abord un intérêt pour moi, jeune géographe de 2009 : il
s’agit de questionner sa modernité au début du XXIème siècle et d’effectuer un
travail de mémoire disciplinaire.
- Mais surtout : La géographie humboldtienne regroupe les principaux éléments
de sa posture scientifique : c’est grâce à elle qu’il met en place une méthode et
un protocole scientifique. La géographie est l’étalon scientifique humboldtien.
- Partant, elle est le miroir de sa vision du cosmos, dont Kosmos est
l’aboutissement en même temps que le point d’acmé.
La géographie constitue donc une porte d’entrée particulière, qui permet de
cerner le système humboldtien dans son ensemble.
Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer un retour sur la formation scientifique
et géographique d’Alexander von Humboldt. La géographie est pour lui un véritable
« programme de recherche », au sens de I. Lakatos : elle fonde une véritable identité
disciplinaire. Une citation de H. Beck (Beck 1985) illustre cette constatation :
« Infolgedessen hat Alexander von Humboldt auch in keiner anderen Wissenschaft
ähnlich stark nachgewirkt wie in der Geographie. » : Humboldt n’est allé nulle part
aussi loin dans les sciences que dans la géographie. Si l’on veut comprendre la science
humboldtienne, le détour par la géographie est donc indispensable. « Der Weg zur
Geographie » (Beck 1985), autre expression de H. Beck, caractérise le parcours
scientifique humboldtien, qu’il construit tout au long de sa vie.
Sa formation ne commence pourtant pas par la géographie, mais avec une
éducation généraliste qui se poursuit par la botanique et la géologie, notamment aux
mines du Freiberg en 1791. Humboldt est un savant dix-huitiémiste, encyclopédiste.
Néanmoins, c’est la géographie qui a finalement sa préférence, grâce à laquelle
Humboldt construit peu à peu sa vision de cosmos. Dans l’Essai sur la géographie des
plantes (1807), qui doit être considéré comme le manifeste de la géographie
humboldtienne, Humboldt dit déjà la prédominance de cette science dans ses
préoccupations scientifiques : « C’est depuis ma première jeunesse que j’ai conçu
l’idée de cet ouvrage. J’ai communiqué la première esquisse d’une géographie des
plantes en 1790, au célèbre compagnon de Cook, M. Georges Forster ».
On a donc un réel programme de recherche, qu’il amplifie tout au long de sa vie.
La date à retenir est très certainement 1821, puisque c’est l’année où Humboldt fonde,
avec d’autres, la première société de géographie, à Paris. On suit également sa
progression géographique au fil de ses publications, avec entre autres :
- Essai sur la géographie des plantes, 1807
- Tableaux de la nature, 1808
- Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne, 1811
- Mémoire sur les lignes isothermes, 1817
- Essai politique sur l’île de Cuba, 1826
- Asie centrale, 1843
- Kosmos, à partir de 1845 : l’entreprise géographique humboldtienne trouve son
aboutissement et son plein épanouissement dans le cosmos.
Le moment clé est le Voyage en Amérique de 1799 à 1804, à la suite duquel il
fonde les bases de son système géographique.
Il s’agit donc d’interroger sa géographie dans le but de comprendre sa vision du
cosmos. L’expression « géographie connective » (Péaud 2009) est la meilleure pour
aborder dans leur richesse et leur ensemble les implications de la géographie
humboldtienne, car elle permet de considérer à la fois la géographie et son identité
disciplinaire, ainsi que la posture scientifique globale de Humboldt et son rapport au
monde (compris autant comme l’ensemble de faits naturels que comme les faits sociaux,
et considérant les interactions entre les deux).
En explorant les différents aspects de la « géographie connective »
humboldtienne, c’est la trame de son système cosmologique que l’on peut tisser.
Le parcours proposé ici déroulera le fil de la géographie en considérant trois
niveaux :
- Sur le plan disciplinaire : la géographie en tant que discipline, en démontrant que
Humboldt donne lui donne une véritable identité et la fait entrer dans la
modernité. Elle est définissable comme « eine physische Welbeschreibung »,
expression que Humboldt utilise lui-même.
- Sur le plan de l’histoire des sciences : la géographie subsume et sublime les
autres sciences. Il est possible de la qualifier de reine des sciences, ou
géopoétique, car elle transcende les différences disciplinaires, se faisant à la fois
entreprise objectivante et récit poétique.
- Sur le plan historique, politique, culturel et social : la géographie au service de
l’humanité. Elle est clairement une cosmopolitique.
La géographie humboldtienne est donc connective pour ces trois objets : le
monde des faits naturels, le monde de la communauté savante, et l’humanité
progressante.
Je fonde mon travail sur trois sources essentielles : la correspondance de
Humboldt, l’Essai sur le géographie des plantes et Kosmos.
I. L’unité du monde dans la diversité des faits : La géographie connective envisagée
sur le plan de l’identité disciplinaire.
La première force de la géographie humboldtienne est de considérer la connectivité de
tous les faits naturels et sociaux dans le monde. Elle réalise donc l’unité du monde, car
elle prend en charge les éléments du « ciel à la terre », comme Humboldt le dit dans
Kosmos. Quels sont les grands principes de la géographie humboldtienne ?
1. Une géographie connective dans l’espace : du local au général
Humboldt n’envisage jamais les phénomènes dans leur stricte localité, mais introduit au
contraire, en plus de la causalité, le principe de géographie générale. C’est ce
qu’Humboldt appelle lui-même le principe des « grandes vues », en prenant de la
hauteur sur le sujet de recherche, le géographe en saisit tous les enjeux.
Humboldt fait en réalité montre d’une double ambition :
- d’une part, embrasser le monde du ciel à la terre, en saisissant tous les
phénomènes du monde ;
- d’autre part, lier entre eux tous ces phénomènes en faisant surgir des
interactions, des connexions ; le local n’est pas séparable du général. La
géographie acquiert donc ainsi une caractéristique multiscalaire.
Je ne donnerai ici que trois formules qui résument ce premier principe spatial.
Dans l’Essai sur la géographie des plantes (1807), Humboldt indique son ambition de
tout comprendre : « J’y embrasse tous les phénomènes de physique que l’on observe
tant à la surface du globe que dans l’atmosphère qui l’entoure ». Dans Kosmos, il
évoque « die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen », liant ainsi le
particulier et le tout, introduisant le jeu des échelles dans la géographie moderne. Enfin,
une dernière formule, écrite à Boussingault en 1822, dit le caractère holistique de la
géographie humboldtienne : « si mon ouvrage a quelque mérite, c’est dans l’ensemble
des vues qui embrassent les formations des deux hémisphères ; c’est le premier essai de
ce genre ». Ce qui est extraordinaire chez Humboldt, c’est la conscience qu’il a de la
nouveauté de sa géographie et de ses conceptions scientifiques.
La géographie humboldtienne est donc connective sur le plan spatial, en se
basant sur les liens entre particulier et global, en acquérant dans sa modernité une
multiscalérité.
A. Buttimer (Buttimer 2001) a également très bien décrit sa capacité de
connecter spatialement les faits : « Ce grand esprit ne reste pas absorbé dans la
contemplation du fait local ; il reporte ses yeux vers les autres régions où s’observent
des faits analogues, et c’est toujours une loi générale, valable pour toutes les
circonstances semblables qu’il cherche à dégager. L’étude d’aucun point ne lui semble
indépendante de la connaissance de l’ensemble du globe. »
2. Une géographie connective dans le temps : le principe historiciste
Ce principe connectif est valable autant dans l’espace que dans le temps : l’historicité
humboldtienne est une des clés pour comprendre sa vision géographique et scientifique.
Tout comme il n’envisage jamais un fait dans sa particularité locale, il ne l’envisage
jamais non plus à un instant T, mais compris dans une continuité temporelle. La
définition de l’historicité peut être celle proposée par L.M. Morfaux (Morfaux 1999) :
« condition de l’existant humain, qui, tout en étant engagé dans le temps et solidaire de
son passé et de l’histoire, s’en dégage en se situant par rapport à cette condition et en se
projetant librement dans l’avenir ».
Ce deuxième principe est très clair chez Humboldt, en particulier en ce qui
concerne ses études sur la volcanologie. A Arago en 1822 il écrit « il est bien important
de fixer, à de certaines époques, l’état des choses dans les phénomènes variables, j’ai
mesuré à plusieurs reprises tout le pourtour du cratère » et à son frère Wilhelm en 1822 :
« il est très important de constater d’époque en époque la configuration du Vésuve : ce
sont autant de points fixes dans des phénomènes variables par leur nature ».
Humboldt a pleine conscience que la nature évolue et qu’il est donc nécessaire
de l’envisager sur le temps long. A cela s’ajoute aussi la conscience et l’affirmation que
la science évolue elle aussi, au même titre que les faits qu’elle étudie. La science est
mouvante, voire même vectorielle, comme le dit si bien O. Ette. Cela est
particulièrement claire dans l’ouvrage humboldtien l’Histoire de la géographie du
Nouveau Continent (1836), dans lequel il a cette phrase : « Quel que ce soit le motif,
tout ce qui excite au mouvement, soit erreur, soit précision vague et instinctive, soit
argumentation raisonnée, conduit à étendre la sphère des idées, à ouvrir de nouvelles
voies au pouvoir de l’intelligence ». Par là, il manifeste sa conscience du mouvement
que toute science peut connaître dans son développement.
Comme le dit W.-H. Hein (Hein 1985), il fait preuve d’une « gemeinsame
Verständnis für den historischer Bezug der Wissenschaften ». L’historicité
humboldtienne est donc double, prenant en compte à la fois les objets d’étude et la
science elle-même. Elle connecte temporellement les faits et les savants.
3. Une géographie connective dans son protocole : rigueur et normalisation
méthodologiques
La géographie humboldtienne est donc connective dans l’espace et dans le
temps, et cette connectivité se traduit aussi dans la méthodologie qu’il déploie. Les deux
maîtres mots sont :
- la collecte systématique des faits et des observations,
- la comparaison / die Vergleichung.
Le voyage en Amérique avec Bonpland est à ce titre exemplaire, car il permet à
Humboldt de mettre en place ses principes géographiques théoriques, mais surtout de
les mettre en pratique sur le terrain, en créant un protocole géographique. La
correspondance humboldtienne à ses collègues européens est éloquente. Les instruments
et le protocole scientifiques y tiennent une très grande place. A Lalande en 1799 « j’ai
consigné dans mes manuscrits jusqu’aux plus petits détails » (lettre à Lalande du 14
décembre 1799) : il est en effet nécessaire de tout mesurer et tout observer, pour pouvoir
ensuite comparer et nouer des interactions entre les phénomènes.
La comparaison des faits et des lieux est en effet un principe méthodologique
central dans le protocole humboldtien. Sa correspondance regorge d’exemples très
concrets : il s’agit de « faire des analyses comparatives à celles des Andes, au Mont
Cenis, à l’ex-République de Gênes » (lettre à Vaughan du 10 juin 1805) d’interroger les
observations « infiniment curieuses sous le rapport de leur analogie avec les Andes »
(lettre à Arago du 25 février 1829), ou encore de récolter « de quoi comparer vos
nouveaux états avec les anciens » (lettre à Spiker du 23 mai 1828). La comparaison,
comprise comme méthode scientifique est géographique, est le point de départ de toute
connectivité dans le temps et dans l’espace.
L’instrumentation de la géographie ne doit donc pas seulement être comprise
comme une méthode au service d’une discipline. Elle est elle-même partie et symbole
de la géographie connective. Elle représente aussi bien qu’elle contribue à créer les
bases de la géographie humboldtienne.
Humboldt se fait régulièrement représenté sur le terrain, entouré de ses
instruments. Le tableau de Eduard Ender par exemple, Humboldt und Bonpland in ihrer
Dschungelhütte, réalisé en 1850, montre les deux savants au milieu de relevés et de
mesures. Ce tableau illustre l’importance des mesures et de l’instrumentation au sein du
protocole scientifique humboldtien, qui devient lui-même miroir de la géographie
connective.
La « géographie connective » humboldtienne permet de définir une vraie identité
disciplinaire. La connectivité est perceptible dans l’espace, dans le temps, ainsi que dans
la rigueur protocolaire humboldtienne. Cette connectivité, comprise au niveau de
l’identité disciplinaire, permet au géographe de cerner le monde dans son ensemble. La
géographie est donc une « physische Weltbeschreibung ».
De plus, Humboldt fait la transition épistémologique du XVIIIème au XIXème
siècle, en faisant entrer la géographie dans sa modernité. La connectivité y participe très
largement.
En faisant d’elle la science du monde, qui relie tous les faits entre eux,
Humboldt lui confère une vaste ambition épistémologique. Conséquemment, la
géographie endosse une place spécifique dans le champ de l’histoire des sciences en
général. Non seulement, elle est connective pour les faits, mais elle l’est aussi pour la
communauté savante.
II. L’Unité géographique dans la pluralité scientifique : La géographie envisagée
sur le plan de l’histoire des sciences
Dans le champ de l’histoire des sciences, la force de la géographie humboldtienne est
aussi de réunir les sciences, les hommes de sciences, et ainsi de se poser en tant que
« reine des sciences », dans laquelle les autres se subsument et se subliment.
1. Le réseau scientifique humboldtien
Le réseau humboldtien, 1804-1829 : un macrocosme pluridisciplinaire.
Source : Laura Péaud, 2009
Ce graphique a été construit à partir des 60 correspondants principaux de
Humboldt sur la période 1804-1829, période sur laquelle j’ai travaillé précédemment.
La liste des correspondants est donc incomplète, mais permet de représenter de façon
efficace le réseau scientifique humboldtien : Humboldt bâtit un véritable macrocosme
scientifique et géographique autour de lui. Il connecte entre eux les hommes de
sciences, par delà leur appartenance disciplinaire et nationale, puisque ses
correspondants et collègues sont issus de tous horizons géographiques.
Humboldt met en place, conjointement à ce réseau mondial, une très importante
collaboration pour ses travaux géographiques. Le travail géographique ne s’envisage en
effet que dans la coopération. Dans ce sens, les autres sciences servent la géographie.
Cela est particulièrement présent dans la correspondance humboldtienne, qui est un
vecteur privilégié pour relier entre eux les savants et leurs travaux : par exemple,
lorsqu’il demande à Berghaus de l’aider pour réaliser un atlas de cartes pour Kosmos en
1828. Ou bien encore dans la préface de l’Essai sur la géographie des plantes
(Humboldt 1807), il a cette formule explicite : « M. Decandolle m’a fourni des
matériaux intéressans (sic) sur la Géographie des plantes des Hautes-Alpes : M.
Ramond m’en a communiqué sur la Flore des Pyrénées : j’en ai tiré d’autres des
ouvrages classiques de M. Willdenow. Il était important de comparer les phénomènes de
la végétation équinoxiale avec ceux que présente notre sol européen. M. Delambre a
bien voulu enrichir mon tableau de plusieurs mesures de hauteurs qui n’ont jamais été
publiées. »
La géographie n’est pas seulement une discipline à part entière, elle est la
science qui, dans son ambition holistique de compréhension du monde, englobe les
travaux des autres sciences, les sublime dans une optique connective.
2. La géographie, reine des sciences
La géographie humboldtienne est donc à comprendre dans une approche
transdisciplinaire, voire même supradisciplinaire, puisque les sciences comprises pour
elles-mêmes n’existent plus en tant que telles. Les sciences sont d’ailleurs autant
positives que sociales, pour le dire avec nos mots d’universitaire du XXIème siècle.
Cela est très clair chez Humboldt, dès l’Essai sur la géographie des plantes (Humboldt
1807) : « c’est par le secours de la géographie des plantes que l’on peut remonter avec
quelques certitude jusqu’au premier état physique du globe ». Humboldt multiplie les
formules semblables, qui tendent à montrer que seul le détour par la géographie permet
de satisfaire cette ambition scientifique, celle de comprendre le monde dans son
ensemble. Ici, c’est avec la géographie des plantes, mais au fur et à mesure de ses écrits,
cette impression se renforce pour toutes les branches de la géographie. Cela est aussi
très visible dans les cours publics donnés à l’Université et à la Singakademie, ainsi que
dans Kosmos.
Ce qui traduit le plus cela, c’est le titre de ses ouvrages. Jusqu’en 1799,
Humboldt écrit essentiellement des monographies : sur la Florae Fribergensis, sur le
galvanisme, etc. Mais à partir de son voyage, les ouvrages ont des titres au pluriel : Vues
des Cordillères des Andes, Ansichten der Natur, jusqu’à Kosmos, qui est un singulier à
valeur d’universel. D’ailleurs, il n’évoque jamais la géographie au singulier, mais
toujours au pluriel. « Les sciences géographiques » : voici l’expression que l’on
retrouve le plus souvent sous sa plume, qui traduit bien la caractéristique unificatrice de
la géographie.
La géographie humboldtienne va en réalité plus loin que rassembler l’ensemble
des sciences, c’est le monde de la culture qu’elle prend aussi en charge. Humboldt
affirme d’ailleurs à Arago : « il me paraissait utile de prouver que ma première ambition
est celle d’un homme de lettres » (lettre à Arago du 20 août 1827). La géographie
humboldtienne endosse donc des ambitions aussi bien scientifique que littéraire et
culturelles : elle veut être la science du monde par excellence, celle par qui tout doit
passer. A cet égard, on peut alors la définir comme « géopoétique », puisqu’elle se situe
au croisement entre Natur- et Kulturwissenschaften.
3. La pasigraphie, langue universelle
La géographie est donc la science de synthèse par excellence : non seulement, elle fait le
pari de faire du monde son objet d’étude particulier, mais encore qui se considère
comme le seul moyen de lier les sciences. Cette double ambition connective est
symbolisée par la langue universelle que Humboldt met au point, à savoir la
pasigraphie.
Dans son désir de dire le monde, il faut trouver la façon de l’exprimer. Humboldt
fustige les langues, qui n’étant pas identiques sur toute la planète, ne permettent pas de
réaliser une connexion parfaite des sciences. Il en fait part à son frère : « Que la
différence des langues est une difficulté depuis que l’on n’écrit plus en latin. Que l’on
perd de tems (sic) avec les traductions » (lettre à Wilhelm von Humboldt du 7 mai
1824). Il y remédie en inventant la langue pasigraphique : langue graphique universelle,
comprise par tous et qui contribue à la formation d’une internationale du savoir.
Quelques planches de l'Essai sur la géographie des plantes (1807) montrent la
pratique de la langue universelle : les symboles graphiques universels permettent de
communiquer entre tous les savants, sans l’obstacle linguistique. De plus, chaque carte
met aussi en relation les phénomènes, en l'occurrence les peuplements végétaux, à
différentes échelles. On retrouve le caractère multiscalaire de la géographie : le monde
est présent, par la mappemonde, ainsi que le local avec les coupes de montagnes. On
trouve également la question des interactions, puisque sur grâce à des représentations en
coupe, Humboldt lie l’altitude, la température, l’occupation végétale et animale et la
situation géographique. La langue pasigraphique est donc extrêmement riche, pour
comprendre l’ambition de la géographie humboldtienne. Elle concentre en elle-même
ses grands principes et rend l’expression « géographie connective » opératoire.
H. Beck (Beck 1986) résume ainsi l’apport humboldtien par la pasigraphie : «
hatte Humboldt den Eindruck, die Sprache allein könne nicht die Fülle seiner Versuche
nicht genau beschreiben oder führe zu sinnverwirrender pedantischer Ausführlichkeit.
So entwickelte er Buchstabenformeln, auf die er gröβten Wert legte. (...) Von diesen
Gedanken ausgehend entwickelte er die Idee einer Pasigraphie, eine
allgemeinverständlichen Schriftzeichensprache, und verstand bald darunter die exacte,
übersichtliche und leichbegreifliche Darstellung geognostischer und geographischer
Erscheinungen durch Buchstaben, Richtungspfeile, Symbole und abgekürzte
Bezeichnungen für Formationen und Gesteine ».
Dans le plan de l’histoire des sciences, Humboldt semble avoir une modernité
d’avance par rapport à ses contemporains : tout comme le géographe surplombe le
monde, la géographie surplombe et sublime les autres sciences, les autres domaines. Au
travers de la pasigraphie, symbole de cette ambition scientifique, la géographie
humboldtienne affirme sa place : celle de science carrefour, de science de synthèse,
mieux de « reine des sciences ».
III. La géographie au service de l’humanité : La géographie envisagée sur le plan
de l’Histoire, de la société et du politique
La géographie humboldtienne n’est pas utopiste, mais au contraire complètement ancrée
dans le temps et dans la société. Elle procède d’une vision utilitariste de la science, qui
ne peut s’entendre qu’au service de la société et surtout de l’humanité progressante.
1. Connecter les individualités humaines
La géographie humboldtienne n’est pas uniquement connective pour les faits naturels et
les sciences, mais elle est aussi un facteur de lien pour la communauté humaine. Cela
passe par deux choses.
D’une part, reconnaître les différences culturelles en même temps qu’affirmer
l’unité d’une humanité progressante (l’influence kantienne est très sensible chez
Humboldt sur ce sujet).
Humboldt est profondément humaniste, l’homme doit être considéré comme le
centre de son système scientifique, sans lequel celui-ci n’aurait aucun sens. Comme
Humboldt le dit lui-même au Président Jefferson, il s’agit d’« étudier les hommes dans
tous leurs états de barbarie et de culture » (lettre à Jefferson du 24 mai 1804). Cette
phrase implique donc de considérer l’humanité dans son ensemble, tout en prenant en
compte les différences spatiales et historiques. Tout comme la science est prise dans un
mouvement temporel différencié, l’humanité connaît aussi un processus de
développement. K. Hammacher (Hammacher 1976) note très bien que Humboldt croit,
comme Kant, « in dem grossen Entwicklungs-Prozess der fortscheintenden
Menschheit ». L’héritage kantien est également très présent dans cette phrase en forme
de sentence écrite à Pictet en 1821 : « le vrai bonheur de l’homme consiste dans la
culture de l’intelligence » (lettre à Pictet du 7 septembre 1821). L’unité de l’humanité
passe donc par le savoir, celui que la géographie construit, et qui à son tour encourage la
progression de l’homme.
D’autre part, cette unité de l’humanité passe par la construction d’un espace du
savoir commun à tous : l’importance de la transmission et de la diffusion s’explique
ainsi.
La qualité de médiateur de Humboldt s’exerce là aussi, entre scientifiques et non
scientifiques. L’enseignement et la vulgarisation du savoir scientifique fait aussi partie
de la mission du savant. Humboldt remplit cette tâche par les lectures, qu’il fait à la
Singakademie et à l’Université, à son retour à Berlin entre l’automne 1827 et l’automne
1828. Ses « Vorlesungen über physische Geographie » (lettre à Berghaus du 20
décembre 1827) sont des cours gratuits, publics, pour tous, au succès exceptionnel :
« J’ai ouvert aujourd’hui deux cours publics » (lettre à Spiker du 25 février 1828). Le
caractère public est très important et neuf, car il signifie un accès libre et égal au savoir.
L’dée forte de Humboldt se situe dans cette phrase à Bollmann : « Ideen können nur
nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden » (lettre à Bollmann du 15 octobre
1799).
2. Une géographie au service de l’homme : projet de cosmopolitique
Humboldt va plus loin que mettre le savoir à disposition de tous, il propose en fait une
cosmopolitique, c’est-à-dire une application concrète et politique de son projet, utile aux
hommes et à leur gouvernement. Ce programme s’exprime à travers son projet de centre
scientifique au Mexique, qu’il discute beaucoup avec Boussingault, lui-même alors en
Amérique du Sud, et son frère, à partir de 1822. Avant cette date, il n’en fait aucune
mention dans les lettres. A Wilhelm il annonce : « j’ai un grand projet d’un grand
établissement central des sciences à Mexico » (lettre à Wilhelm von Humboldt du 17
octobre 1822). Dans une lettre de 1822 à Boussingault, il résume les points clés de ce
centre : il veut « un établissement dans une des grandes villes des Cordillères, une belle
collection d’instruments, des appareils météorologiques », qui permettent « une
centralisation des observations », grâce à la « réunion de jeunes gens instruits propres à
être employés par les différents gouvernements » (lettre à Boussingault du 5 août 1822).
Ce projet ne verra pas le jour, mais il est le symbole du caractère connectif de la
géographie. Cet aspect est aussi sensible dans des œuvres comme Essai politique sur le
Royaume de la Nouvelle-Espagne ou Essai politique sur l’île de Cuba, même si elles
n’ont pas le caractère programmatique de ce qui peut apparaître dans la correspondance.
Celle-ci ne se contente pas de lier entre eux les faits, elle relie les hommes, de science et
les profanes, en créant une internationale du savoir, en leur proposant un gouvernement
cosmopolitique directement tiré de ses enseignements. La connectivité de la géographie
humboldtienne va donc bien au-delà du simple niveau épistémologique : en s’affirmant
dans l’histoire des sciences, dans la politique et dans la société des hommes, elle pose
l’ambition humboldtienne pour la science, et conséquemment pour le cosmos.
Conclusion
En guise de conclusion, je propose le schéma suivant, qui permet de saisir l’ampleur et
les ambitions de la géographie connective humboldtienne, sur les trois niveaux évoqués
précédemment.
La force de la géographie humboldtienne est qu’elle permet de comprendre, de
façon systémique, sa compréhension du monde, de sa posture scientifique, de sa posture
au monde, bref de sa vision du cosmos. L’aboutissement de cette géographie connective
est bien sûr Kosmos, qui résume et réunit les différents éléments abordés :
- sur le plan épistémologique, une géographie universaliste et holistique ;
- sur le plan de l’histoire des sciences, une géographie surplombante et
englobante ;
- sur le plan de l’histoire, de la politique et de la société, une géographie pour le
gouvernement de l’humanité.
La géographie humboldtienne, l'unité dans la diversité
Source : Laura Péaud, 2009
L’œuvre de la maturité, Kosmos, est à la fois une concrétisation épistémologique
de la géographie connective humboldtienne, un don à la science et l’humanité, un outil
atemporel au service du monde. La géographie contemporaine du début du XXIème,
ainsi que la politique, auraient tout intérêt à réinvestir les héritages humboldtiens, qui
peut nous donner des clés dans cette période de crise multiple.
Bibliographie indicative
Beck, Hanno (1982) : Groβe Geographen, Pioniere, Auβenseiter, Gelehrte. Berlin :
Dietrich Reimer Verlag.
Berghaus, Heinrich ; Humboldt, Alexandre de (1863) : Briefwechsel Alexander von
Humboldt’s mit Heinrich Berghaus aus den Jahren 1825 bis 1858. Leipzig : H.
Costenoble.
Berthelot, Jean-Michel (2001) : Epistémologie des sciences sociales. Paris : PUF.
Buttimer, Anne (2001) : « Alexander von Humboldt », Actes d’un colloque dans le
cadre du festival international de géographie de Saint-Dié, http://fig-st-
die.education.fr/actes/actes_2001/rocques/article.htm.
Ette, Ottmar (dir.) (2001) : Alexander von Humboldt. Aufbruch in die Moderne. Berlin :
Akademie Verlag.
Ette, Ottmar (2006) : Alexander von Humboldt, die Humboldtsche Wissenschaft und
ihre Relevanz im Netzzeitalter, in : Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien,
Humboldt im Netz, numéro 12.
Ette, Ottmar (2009) : Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Frankfurt am
Main und Leipzig : Insel am Main.
Hammacher, Klaus (1976) : Universalismus und Wissenschaft im Werk und Wirken der
Brüder Humboldt. Francfurt am Main : Vittorio Klostermann.
Hein, Wolfgang-Hagen (dir.) (1985) : Alexander von Humboldt, Leben und Werk.
Frankfurter am Main : Weisbecker Verlag.
Humboldt, Alexandre de (1807) : Essai sur la géographie des plantes, accompagné d’un
tableau physique des régions équinoxiales, fondé sur des mesures exécutées, depuis le
dixième degré de latitude boréale jusqu’au dixième degré de latitude australe, pendant
les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. Paris : Schoell.
Humboldt, Alexandre de (1826) : Essai politique sur l’île de Cuba : avec une carte et un
supplément qui renferme des considérations sur la population, la richesse territoriale et
le commerce de l’archipel des Antilles et de Colombia. Paris : Gide Fils.
Humboldt, Alexandre de (2000) : Cosmos : essai d’une description physique du monde.
Paris : Edition Utz.
Humboldt, Alexandre de (1867) : Atlas du Cosmos, contenant les cartes… applicables à
tous les ouvrages de sciences physiques et naturelles et particulièrement aux œuvres
d’Alexandre de Humboldt et de François Arago, Alexandre Vuillemin, dirigé par J.A.
Barral. Paris : Morgans.
Humboldt, Alexandre de (1907) : Correspondance d’Alexandre de Humboldt avec
François Arago, éditées par E.T. Paris : Hamy.
Humboldt, Alexandre de (1865) : Correspondance scientifique et littéraire, recueillie,
publiée et précédée d’une notice et d’une introduction, par M. de la Roquette, E. Paris :
Ducrocq.
Humboldt, Alexandre de (1869) : Correspondance scientifique et littéraire, recueillie,
publiée et précédée d’une notice et d’une introduction, par M. de la Roquette. Paris :
Ducrocq.
Humboldt, Alexandre de (1880) : Briefe Alexander’s von Humboldt an seiner Bruder
Wilhelm. Stuttgart : J. G. Cotta.
Humboldt, Alexandre de (1993) : Briefe aus Amerika (1799-1804), Akademie Verlag,
Berlin
Kant, Immanuel (1988) : Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique,
traduit par J.-M. Muglioni. Paris : Bordas.
Kuhn, Thomas (1983) : La structure des révolutions scientifiques. Paris : Champs
Flammarion.
Péaud, Laura (2009) : Entre continuité scientifique et révolution épistémologique : la fabrique de la géographie sous la plume d’Alexander von Humboldt. Lyon : Mémoire demaster 1, Ecole Normale Supérieur Lettres et Sciences Humaines.