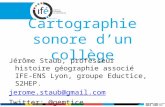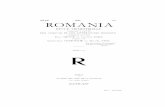Catholicisme et nation au miroir d'une cathédrale
-
Upload
ens-cachan -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Catholicisme et nation au miroir d'une cathédrale
CHAPITRE 10. CATHOLICISME ET NATION AU MIROIR D'UNECATHÉDRALE Claire de Galembert
in Antonela Capelle-Pogacean et al., Religion(s) et identits) en Europe Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) | Académique 2008pages 255 à 279
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/religions-et-identites-en-europe---page-255.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de Galembert Claire,« Chapitre 10. Catholicisme et nation au miroir d'une cathédrale », in Antonela Capelle-Pogacean
et al., Religion(s) et identits) en Europe
Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Académique », 2008 p. 255-279.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.).
© Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.). Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
Chapitre 10
CATHOLICISME ET NATION AU MIROIR D’UNE CATHÉDRALE
Claire DE GALEMBERT
L’évocation de la ville d’Évry, ville nouvelle située à 35 km au sud-est de Paris, est devenue quasi indissociable de celle de sa cathédrale, sortie de terre au début des années 1990. Depuis, c’est
bien souvent la silhouette de l’œuvre de l’architecte suisse Mario Botta, un cylindre tronqué en briques roses surmonté d’une couronne d’arbres, qui tient lieu d’emblème à ce nouveau centre urbain. Il n’est point de chronologie de la ville, même succincte, qui n’évoque comme un fait marquant la construction de la cathédrale, au début des années 1990. Le bref historique retraçant « l’aventure urbaine d’Évry », que l’on trouve sur le site officiel de la ville d’Évry est à cet égard éloquent. À peine dix dates sont retenues pour relater l’« aventure ». Parmi elles, deux se rapportent à la cathédrale ; la première renvoie à la pose de sa première pierre ; la seconde à la visite du pape Jean-Paul II, venu consacrer le lieu de culte en 19971, à l’occasion de sa visite en France pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Ces observations liminaires suggérant les affinités élec-tives qu’entretiendraient ville et catholicisme en France font d’Évry un terrain d’observation empirique privilégié pour qui s’interroge sur l’état des relations entre nation et catholicisme dans ce pays aujourd’hui. La place dévolue à la cathédrale, tant dans la narration de l’histoire de la ville
1. Voir le site internet : www.ville-evry.com ou encore la chronologie instituti-onnelle de la ville d’Évry disponible sur le site internet : www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr.
Livre identite et religion.indb 255Livre identite et religion.indb 255 19/12/07 18:17:4219/12/07 18:17:42
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
256RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
nouvelle que dans l’espace de celle-ci ne saurait en effet être dissociée de la place qu’occupe le catholicisme dans l’imaginaire national2.
Cette étude permet, comme toute approche monographique, une obser-vation « rapprochée » de la manière dont des acteurs religieux et publics, ancrés dans un contexte précis, construisent ou reconstruisent leurs rap-ports à partir d’un projet immobilier d’un genre singulier, qui outre ses attributs fonctionnels, se caractérise par une charge symbolique mêlant mémoire religieuse et mémoire nationale. L’observation est d’autant plus stimulante que le contexte ville nouvelle forme une situation quasi expérimentale. La création des villes nouvelles, œuvre par excellence de l’État planificateur3, résulte en effet d’une politique nationale d’aména-gement du territoire initiée au milieu des années 1960, sous l’impulsion du général De Gaulle, visant à canaliser l’urbanisation anarchique de la région parisienne4. Cette politique symbolise ainsi une sorte d’âge d’or de l’urbanisme d’État. Cette action planificatrice ne se limite pas seule-ment à la répartition des nouveaux pôles urbains dans la région Île de France mais se prolonge dans leur aménagement sur la durée via l’action des établissements publics d’aménagements qui en ont la charge. Aussi, l’érection d’une cathédrale dans l’un de ces centres urbains n’est-elle pas étrangère à la manière dont les acteurs publics et en particulier les urbanistes d’État, nonobstant le principe de laïcité, sont susceptibles de s’approprier ce symbole religieux comme instrument d’aménagement. Toutefois la construction d’une cathédrale, n’est pas seulement la résul-tante d’un accord circonstanciel entre des acteurs et groupes catégoriels qui se côtoient et ont un commun « intérêt » à cette édification. Quelles que soient les stratégies des acteurs défendant le projet et le degré uti-litariste de leurs motivations, la logique collective, en portant le projet sur le terrain de l’intérêt général ou du bien commun, délocalise le projet
2. La présente réflexion vient approfondir celle que nous avions proposée dans un article paru en 1999. Voir Claire de Galembert, « Cathédrale d’État ? cathédrale catholique ? cathédrale de la ville nouvelle ? les équivoques de la cathédrale d’Évry », Archives de sciences sociales des religions, 107, juillet-septembre 1999, p. 109-137.3. Cf. Sylvia Ostrowetsky, L’Imaginaire bâtisseur. Les villes nouvelles françaises. Paris, Librairie des Méridiens, 1983.4. Cf. Pierre Merlin, Les Villes nouvelles en France, Paris, PUF, 1997. Rappelons que les villes nouvelles naquirent d’une décision du général de Gaulle d’organiser la région parisienne. En 1961 fut ainsi créé le district de la région de Paris, dont la direction fut confiée à Paul Delouvrier. Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (SDAURP) publié en 1965 envisageait la fondation de 8 nouveaux centres urbains autour de Paris. Évry compte parmi les 5 villes nouvelles qui furent lancées à l’issue des missions d’études et d’aménagement.
Livre identite et religion.indb 256Livre identite et religion.indb 256 19/12/07 18:17:4219/12/07 18:17:42
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
257Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
pour le soumettre à l’épreuve du jugement « public »5, épreuve qui s’est d’ailleurs moins jouée à l’échelle locale que sur la scène nationale. La cathédrale à l’état de projet accède en effet presque instantanément à cette scène. La conférence de presse au ministère de la Culture annonçant son lancement, l’extraordinaire popularité médiatique dont elle bénéficie d’emblée, les affiches d’appel au don s’adressant au quidam de la rue, les timbres postes frappés à son effigie mis en circulation dans les années 1990 sont autant de supports contribuant à diffuser ce qui se constitue d’emblée en « événement ».
L’accueil réservé au projet par l’opinion publique, au sens d’opinions publiquement exprimées, ne manque pas d’étonner : et cela en raison non seulement de l’idée que peut se faire le sens commun de la laïcité mais aussi de la marginalisation croissante du catholicisme dans la société française. Sollicité pour participer au comité de parrainage de ladite cathédrale, le médiéviste Georges Duby, auteur d’une magistrale réflexion sur les cathédrales6, s’étonnait lui-même de l’enthousiasme suscité par un tel projet eu égard à son caractère a priori anachronique. « J’avoue que je ne comprends pas très bien » confiait-il à la presse. « C’est en effet la première fois que l’on construit une cathédrale en Île de France. Et cela paraît en complet déphasage avec ce qui est devenu le sentiment religieux de notre société7 ». Précisément, le succès du projet semble être conditionné par le flottement du symbole auquel il réfère. La cathédrale s’impose comme un projet composite et un symbole fondamentalement hybride. La faible lisibilité du projet architectural ne ferait à cet égard que transcrire dans la pierre l’incertitude quant au statut symbolique d’un pôle d’identification collective dont la place en centre-ville n’est légitime qu’au travers d’une euphémisation de ses origines catholiques.
La genèse de la cathédrale d’Évry est à cet égard éloquente8. La syner-gie d’acteurs qui sont à l’origine du projet, la pluralité des logiques qui
5. Cf. Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard, 1991.6. Georges Duby, Le Temps des cathédrales : l’art et la société 980-1420, Paris, Gallimard, 1976.7. Le Parisien, 12 avril 1993.8. Les analyses que l’on présentera résultent d’entretiens réalisés auprès des acteurs catholiques (l’évêque, son vicaire épiscopal chargé du suivi du dossier cathédrale, les membres de l’équipe pastorale locale) et publics (urbanistes de la ville nouvelle) réalisés en 1998, du dépouillement d’une très abondante revue de presse, de la lecture d’ouvrages et d’articles relatifs à la cathédrale réalisés par certaines des témoins ou personnes impliquées à divers titres dans sa construction. En particulier, Jacques Longuet, Autour d’une cathédrale. Paris, Médiaspaul, 1995 ; Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, Paris, Odile Jacob, 1996 ; Guy
Livre identite et religion.indb 257Livre identite et religion.indb 257 19/12/07 18:17:4219/12/07 18:17:42
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
258RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
s’y côtoient sont révélateurs de la porosité des frontières délimitant les sphères du religieux et du politique, du privé et du public que l’on tend trop souvent à penser comme des sphères autarciques. L’ensemble des interactions dont la cathédrale est le fruit donne ainsi à voir une zone intermédiaire dans laquelle se croisent les acteurs et les intérêts symbo-liques et matériels dont ils sont porteurs. Cette « co-construction », qu’il convient, à travers le cheminement du projet, de saisir dans une perspective dynamique invite à analyser en terme de continuum ce que les catégories classiques tendent au contraire à construire en terme de sphères autarciques et exclusives les unes des autres. L’objet qui en découle présente ainsi un caractère fondamentalement hybride, chacun des acteurs apportant en quelque sorte sa propre définition à l’objet qu’il s’agit de construire et continue de se construire. La mobilisation d’acteurs situés dans des sphères sociales a priori exclusives et obéissant à des rationalités distinctes, n’est cependant pas exclusive d’une différenciation, sinon d’une concurrence, entre logiques d’interprétation du sens de cet objet en devenir. Aussi, la pérégrination du projet, à la faveur de laquelle il se précise et se matérialise, met-elle en lumière des dynamiques d’appropriations multiples qui, en en relativisant la nature confessionnelle de la cathédrale, n’en contribue pas moins à sa réinvention.
Au commencement était le verbe…
C’est en 1988 qu’est annoncé officiellement le projet de construire une cathédrale au cœur de la ville nouvelle d’Évry. Cette date ne fait toutefois que marquer la sortie des limbes d’un projet en gestation depuis le début des années 1980. De fait, ni ses origines ni les facteurs qui ont contribué à son émergence ne sont aisés à déterminer. On lit ici9 que l’initiative en revient à l’évêque du diocèse fraîchement créé, on entend là que l’impul-sion décisive a été donnée par l’Établissement public d’aménagement10. On rapporte ailleurs que le ministre socialiste de la culture de l’époque, Jack Lang, se proclame « bâtisseur de cathédrale ». L’incertitude qui domine concernant le moment et l’acte fondateurs est indissociable de sa genèse
Herbulot, L’Espérance au risque d’un diocèse, entretiens avec Jean-François Courtille et Gérald M. Omnès, Paris, Desclée de Brouwer, 2003 ; Mario Botta, La Cathédrale d’Évry, Milan, Skira, 2000.9. Voir par exemple dans Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, op. cit., p. 71.10. Entretien avec François Desbruyère, urbaniste de l’établissement public ayant suivi le dossier.
Livre identite et religion.indb 258Livre identite et religion.indb 258 19/12/07 18:17:4319/12/07 18:17:43
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
259Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
composite. Il est d’ailleurs révélateur que cette incertitude ne suscite ni débat ni polémique entre les acteurs impliqués dans le projet, aucun ne contes-tant à l’autre la légitimité de se prévaloir de la paternité de la cathédrale. Les limbes ne sont donc ni tout à fait religieux ni tout à fait profanes : ils se situent dans l’entre-deux ou plutôt à la confluence des deux. Comme l’affirme Yves Boucly, le directeur de l’Établissement public11 de la ville d’Évry en poste au moment de la gestation, puis de la concrétisation du projet, la construction d’une cathédrale dans cette ville nouvelle « résulte d’une étonnante rencontre entre un projet avant tout cultuel (manifester la présence de l’Église dans les nouveaux lieux de vie), un projet urba-nistique d’une ville nouvelle en développement qui se cherche un centre, et un projet culturel12 ». La « narration » relativement consensuelle de la germination du projet, qui, une fois porté au jour se matérialise avec une fulgurante rapidité13, confirme bien que sa condition de félicité réside dans l’intersection de différents cercles d’acteurs, la cathédrale devenant en quelque sorte le fruit en même temps que le creuset d’intérêts matériels et symboliques sans la rencontre desquels, elle n’aurait jamais vu le jour.
Une ville en quête d’âme et d’image
Au début des années 1980, les urbanistes de la ville nouvelle sont – à les en croire14 – confrontés à un problème d’urbanisme majeur : la ville d’Évry n’a pas d’âme. Ils font le constat des limites de l’urbanisme modernisateur de la ville nouvelle. Il faut rappeler que, comme toutes les villes nouvelles, Évry est née de la signature d’un décret à la fin des années 1960. Ainsi la
11. L’Établissement public de la ville nouvelle d’Évry, institution chargée de l’impulsion et du suivi de la constitution de la ville nouvelle est composé d’élus communaux, départementaux ainsi que de représentants de différents ministères et propriétaires de l’ensemble des terrains de la ville.12. Voir Yves Boucly, « L’agence nationale pour les arts sacrés, Évry » dans Forme et sens. La formation à la dimension religieuse du patrimoine culturel, actes de colloque, Paris, La Documentation française, 1997, p. 225.13. Il faudra à peine dix ans pour que le projet fortement encouragé par les aménageurs urbains de la ville nouvelle et appuyé par le ministère de la Culture aboutisse. En 1988, l’architecte tessionois Mario Botta dévoile la maquette de la future cathédrale dans les locaux du ministère de la Culture en présence de Mgr Herbulot, l’évêque du diocèse d’Évry et du cardinal archevêque de Paris Mgr Lustiger et du ministre Jack Lang. En 1991 la première pierre de l’édifice est posée. Mise à la disposition des fidèles en 1995, elle est officiellement inaugurée lors des fêtes de Pâques en 1996.14. Les urbanistes, chargés de la rédaction de la plaquette de promotion de la ville nouvelle affirment ainsi : « le centre ressemblait à une succession d’îlots dans les chantiers. Le visiteur tournait autour en voiture sans pouvoir y accéder ».
Livre identite et religion.indb 259Livre identite et religion.indb 259 19/12/07 18:17:4319/12/07 18:17:43
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
260RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
petite ville d’Évry-petit-Bourg (5 000 habitants), située à quelque 30 km au sud de Paris, au cœur des terres à blé et à betteraves du Hurepoix se voit-elle – par le hasard de la politique et de la géographie – transformée en nouveau pôle urbain d’Île de France. En 1967, l’Établissement Public d’Aménagement de la ville nouvelle d’Évry15 prend pieds sur les lieux. De manière tout à fait symbolique, le premier édifice d’importance à sortir de terre (1971) est celui de la préfecture, œuvre colossale de l’architecte Guy Lagneau, mandaté à cet effet par le ministre de la Culture de l’époque, André Malraux. Peu après le centre de la ville nouvelle voit le jour se déployant autour d’une Agora (inaugurée en 1975) dans l’environnement duquel s’implantent différents services administratifs (une antenne de l’ANPE), des centres commerciaux (Centre commercial et 120 commerces divers et variés), des équipements culturels (salles de cinémas et de spectacle, bibliothèque) et de loisirs (patinoire, piscine).
Or, fondu dans l’espace par un urbanisme de dalle et de résille, ce centre dépourvu de trait saillant ne remplit pas la fonction qui lui est dévolue au départ : devenir non seulement un pôle à partir duquel le reste du tissu urbain se structure mais surtout une sorte de pôle d’identification collective pour les Évryens. Au-delà même du problème d’organisation de l’espace, ce serait – toujours à suivre la rhétorique de justification ex-post de nos acteurs – le problème de l’intégration sociale qui se pose. Il se pose avec d’autant plus d’acuité que dans le cas d’une ville nouvelle, les citadins ou plus exactement ceux qui sont appelés à le devenir forment une population aux origines géographiques diverses. Avec un solde migratoire de 50 000 personnes entre 1962 et 1990, son peuplement résulte pour 70 % de l’installation de nouveaux arrivants. Fédérer cette population en développant un sentiment collectif d’appartenance à la ville constitue à l’évidence un enjeu majeur.
Les interrogations relatives aux vertus fédératrices du centre aménagé dans les années 1970 sont loin d’être l’apanage des urbanistes d’Évry. Elles ont pour arrière-plan un déplacement non négligeable qui se joue au tournant des années 1970-1980 : la fonction de la ville nouvelle est dès lors moins perçue par rapport à l’ensemble de la région parisienne qu’en fonction de considérations plus locales, visant à faire des villes nouvelles des centres urbains à la fois autonomes et équilibrés16. Ce déplacement va
15. Il s’agit de l’institution provisoire composée de représentants de l’État central et d’élus locaux chargés par l’État central de la conception et du déve-loppement urbain.16. Voir Daniel Behar, Philippe Estebe et Sophie Gonnard, Les Villes en Île de France ou la fortune d’un malentendu. Revue de la Littérature (1995-2000), Paris, Acadie, 2004, p. 36 et 37.
Livre identite et religion.indb 260Livre identite et religion.indb 260 19/12/07 18:17:4319/12/07 18:17:43
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
261Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
de pair avec un scepticisme croissant quant au modernisme architectural, tel qu’il s’est imposé en France dans le sillage de Le Corbusier. Il appa-raît en effet, que le critère « fonctionnel » qui a dominé ce modernisme architectural et écrasé les points de repères symboliques qui structuraient traditionnellement la ville, ne suffit pas à agréger les différentes trajectoires individuelles qui s’entrecroisent quotidiennement en une « communauté de destin ». Comme le note l’un des rédacteurs d’une plaquette relative à l’architecture évryienne, « la foi dans la technique cesse d’être ce qu’elle était. L’idée de faire table rase du passé pour construire la modernité marque le pas. Le structuralisme est affaibli. L’intelligenstia retrouve des vertus dans l’héritage du passé. Le “patrimoine” devient à la mode17 ». Dans la logique de cette argumentation, la cathédrale d’Évry participerait rien de moins que d’une refondation de la ville. « La cathédrale d’Évry n’est pas simplement un édifice religieux. Elle a été conçue comme une manière de faire évoluer le tissu urbain en cours de façonnage », écrit Claude Mollard, responsable de l’agence d’ingénierie culturelle qui a joué le rôle de coor-donnateur de l’action entre acteurs publics et acteurs religieux et a monté le dossier financier de la cathédrale. Plus radical encore, l’architecte, Mario Botta, affirme que la construction d’une cathédrale à Évry équivaut à la « reconstruction de la ville18 ». Moins absolu quant au ferment de centralité que représente la cathédrale, Jacques Guyard, le député-maire socialiste en fonction au moment où le projet de cathédrale est porté sur les fonts baptismaux affirme : « ce qui fait d’Évry une ville, c’est d’abord qu’elle a un territoire limité, et ensuite qu’elle a un centre que l’on commence à percevoir correctement. Ce n’était pas le cas jusqu’à ces dernières années, puisque le premier centre construit, avec le centre commercial, l’Agora et la préfecture, était tout sauf un lieu de convivialité. Or un centre, c’est un lieu où les gens vivent, où les fonctions se mélangent, ce qui n’était pas tout à fait le cas. Maintenant ça commence à venir… le cours Blaise Pascal, le quartier de la mairie, la construction de la cathédrale, tout cela dote la ville d’un vrai centre. Et un vrai centre, c’est la ville ».
Il ne fait aucun doute que le projet de construction d’une cathédrale participe d’un réagencement de l’espace de la ville nouvelle qui s’opère dans les années 1980. S’ils répugnent à le désigner comme tel, les urba-nistes de l’établissement public d’Évry (Epevry) conçoivent un « nouveau centre », situé à peine à cinq cents mètres du centre initial. Plus fidèle à
17. André Darmagnac, Évry, ville nouvelle. Témoin des architectures contem-poraines, Évry, Éditions du San-Évry. 1994, p. 7.18. Cité dans Jacques Longuet, Autour d’une cathédrale, op. cit., p. 72.
Livre identite et religion.indb 261Livre identite et religion.indb 261 19/12/07 18:17:4419/12/07 18:17:44
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
262RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
une conception traditionnelle de l’organisation de ce qu’ils appellent la « ville classique » par opposition à la « ville moderne », ce nouveau projet renoue avec la représentation traditionnelle que l’on se fait d’un centre-ville : une place (au nom évocateur de place des droits de l’homme et du citoyen…), un beffroi, un clocher. Situé à proximité de grands axes de communication, ce nouveau centre est à la fois d’accès facile et conçu comme un lieu repérable. À cet effet, les aménageurs urbains optent délibérément pour une visibilité forte et un style « monumental ».
Le débat entre les Anciens et les Modernes, mis en avant par les acteurs, survalorisant sans doute la « rupture » que marque la cathédrale dans l’histoire de la ville, ne fait en réalité autre que témoigner de l’essouffle-ment de l’utopie mobilisatrice qu’a pu constituer la ville nouvelle à ses débuts, essoufflement auquel ne sont pas étrangers la crise pétrolière et le retour de la droite libérale au pouvoir.
De manière sous-jacente, pointe ainsi une inquiétude quant au déve-loppement de la ville en partie tributaire de l’intérêt que sont susceptibles d’y porter les investisseurs privés. Au-delà même de la structuration d’un nouveau centre, et en creux de cette rhétorique justifiant le retour d’un élément de tradition comme facteur de mise en cohérence du tissu urbain, la construction d’une cathédrale au cœur de la cité, est suscep-tible de devenir en même temps qu’un support de notoriété un vecteur de changement d’image de cette ville nouvelle. En même temps qu’outil de restructuration interne la cathédrale serait dans cette perspective un support de communication sur la ville. Il s’agirait d’une véritable opération symbolique, qui tout en assurant la notoriété d’Évry dans l’espace national la doterait d’une image à la fois distinctive et valorisante.
Dans cette perspective, on ne saurait sous-estimer le rôle joué par le dynamisme des religions minoritaires et en particulier de l’islam. Comme l’affirme Jacques Guyard, à l’époque maire d’Évry, « il eût été quand même un peu étonnant qu’ayant une synagogue, une église de mormons, une église des adventistes, un centre culturel islamique, dans un pays d’aussi vieille tradition chrétienne que le nôtre, […] on ne finisse pas par avoir un lieu fort du culte catholique19 ». Quoique le lien soit rarement expli-citement établi entre les deux lieux de culte, et ce tant dans le discours des acteurs publics que catholique, la construction de la cathédrale est indissociable de l’érection du centre islamique, dont la première pierre est
19. Voir son intervention dans L’Architecture religieuse et retour du monumen-tal, Actes des rencontres internationales d’Évry, 20-21 septembre 1989, Évry, Epévry éditeur, 1990.
Livre identite et religion.indb 262Livre identite et religion.indb 262 19/12/07 18:17:4419/12/07 18:17:44
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
263Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
posée en 198420. Ce lieu de culte n’a en effet rien de la confidentialité des salles de prières qui caractérisent l’islam en France de l’époque. Avec ses 5 000 mètres carrés, il s’affirme comme la première mosquée cathédrale de l’islam transplanté. Il symbolise un nouvel âge de l’islam en France : celui de son enracinement. C’est le minaret en construction de la mosquée d’Évry qui figure en couverture du livre que Gilles Kepel consacre à la « naissance de cette nouvelle religion » en France, livre qui tout en mar-quant la constitution de l’islam de France en objet de recherche participe à la transformation de cette question en problème public21. La mosquée est certes peu invoquée dans les discours des acteurs. Mais elle agit en quelque sorte comme un tiers absent. Elle configure implicitement les champ des possibles. La cathédrale devenant l’emblème quasi nécessaire d’une ville dont la mosquée, et les représentations péjoratives qu’elle véhicule, pourrait devenir le stigmate.
Une Église en quête de visibilité
Si pour cet ensemble de raisons le projet de bâtir une cathédrale à Évry a été fortement encouragé sinon suggéré par les acteurs publics22, il n’eût pas abouti sans l’assentiment ni la coopération des acteurs religieux. Au moment où de leur côté les urbanistes affirment avoir pris conscience des déficiences intégratives du modernisme architectural, du sien l’Église catholique constate les limites d’une pastorale qui a misé sur des stratégies de l’enfouissement. La construction de la cathédrale d’Évry symbolise à cet égard la rupture avec deux décennies de discrétion architecturale, dont les villes nouvelles ont constitué des terrains expérimentaux d’élection23. Ce mode de présence procède à la fois d’une sécularisation interne et d’une
20. Comme le révèle l’article relatif à la mosquée d’Évry de Mounia Bennani-Chraïbi, les porteurs du projet d’une salle de prière à Évry n’ont quant à eux pas hésité à s’adresser dès le début des années 1980 à la municipalité qui transmet le dossier à l’établissement public qui à travers ses agents se montrera non seulement soucieux de ce que la ville nouvelle témoigne de toutes les sensibilités religieuses mais encouragera les porteurs du projet à entreprendre un projet plus ambitieux. Voir Mounia Bennani-Chraïbi, « La mosquée d’Évry : le coût de la paix sociale », Les Cahiers de l’Orient, 16-17, 1989.21. Gilles Kepel, Les Banlieues de l’islam. Naissance d’une religion en France, Paris, Seuil, 1985.22. Entretien avec F. Desbruyère, urbaniste à l’Epévry23. Voir sur ce point et à titre de comparaison ce qu’en dit Caroline de Saint Pierre dans son article « Créer de la localité en ville nouvelle : l’exemple de Cergy », Ethnologie française, 33, 2003, p. 83 : « Une autre figure de “pionnier” du commencement [de la ville nouvelle] est celle de prêtres, pour qui la création d’une ville nouvelle est interprétée comme devant favoriser chez les chrétiens une
Livre identite et religion.indb 263Livre identite et religion.indb 263 19/12/07 18:17:4519/12/07 18:17:45
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
264RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
volonté de retrouver dans une Église « postconstantinienne » l’esprit de ses origines évangéliques, plus axé sur l’investissement du monde profane et du militantisme social que sur l’exaltation du sacré et la médiation du culte et des rites.
À cet égard les hésitations des autorités diocésaines, et en particulier de l’évêque Mgr Herbulot, à répondre aux sollicitations des aménageurs urbains, sont caractéristiques d’une certaine forme de désinvestissement pratique et imaginaire du lieu de culte au profit du militantisme social, ou pour le dire autrement, de « l’église de pierres » au profit de « l’Église des hommes »24. Mgr Herbulot, évoquant sa réaction aux sollicitations des différents acteurs à construire une cathédrale, le reconnaît lui-même : « j’ai longtemps dit non » et c’est presque avec résignation qu’il semble ajouter, interviewé en 1991, par un journaliste de Témoignage chrétien : « Il y a quatre ans, il a bien fallu prendre une décision25. »
Le déficit d’équipement cultuel catholique réduit de la ville d’Évry au début des années 1980 traduit remarquablement cette remise en question de l’importance des édifices cultuels qui conduit certains théologiens à poser la question de leur utilité même. À l’époque, il n’existe en effet pratiquement que des lieux de culte confidentiels, discrets, fondus dans le tissu urbain. En dépit de la coutume selon laquelle le siège de l’évêque se situe dans le chef-lieu de département, l’évêque se contente de l’Église gothique de Saint Spire située à Corbeil. Quant à la communauté catho-lique, elle se réunit dans des locaux sans grande visibilité symbolique, disséminés dans la ville ou encore dans les petites églises situés à la périphérie dans les anciens villages que la ville nouvelle a pour ambition de fondre dans un espace urbain cohérent. Lorsque les fêtes liturgiques nécessitent davantage d’espace, le diocèse recourt à des locaux profanes. Les confirmations ont lieu dans une salle des fêtes, les ordinations sous un chapiteau et le synode diocésain qui s’achève en 1990 s’effectue dans des locaux prêtés par le Syndicat de l’agglomération nouvelle (SAN).
Ce n’est qu’au début des années 1980, quelque temps après le transfert du siège de l’évêché à Évry, que l’idée de construire une église susceptible de rassembler la communauté catholique évryenne commence à s’imposer,
nouvelle vie religieuse, sans lieu de culte spécifique et où les croyants pourraient prendre les choses en main ».24. D’après Franck Debié et Pierre Vérot, si la période 1955-1965 se caractérise par un très grand dynamisme de la part des diocèses en matières architecturales, les villes nouvelles portent la trace d’un « sous-équipement délibéré ». Cf. Franck Debié et Pierre Vérot, Urbanisme et Art Sacré. Une aventure du XXe siècle, Paris, Critérion, 1991.25. Témoignage chrétien, 13 avril 1991.
Livre identite et religion.indb 264Livre identite et religion.indb 264 19/12/07 18:17:4519/12/07 18:17:45
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
265Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
ou du moins que l’absence d’un tel édifice finit par paraître inadmissible. Le dynamisme architectural des religions minoritaires, qui quant à elles n’hésitent pas à solliciter les acteurs publics, est sans doute un aiguillon non négligeable. Il n’est d’ailleurs pas exclu que les urbanistes de la ville nouvelle aient joué sur la corde de l’émulation interreligieuse pour emporter l’adhésion des acteurs catholiques en faveur d’un projet architectural ambitieux.
Les débats internes que suscite ce projet d’église centrale témoignent d’ailleurs bien des difficultés qu’a le diocèse à rompre avec cette politique de discrétion architecturale. À ceux qui du côté des laïcs préconisent un projet d’ampleur – estimant que plus le projet sera ambitieux sur le plan architectural plus il sera facile à financer – les autorités du diocèse, et en particulier le chancelier, opposent un profond scepticisme et des difficultés financières. Un tel projet leur apparaît d’autant plus déraisonnable que certains secteurs de la ville encore en expansion requerront des équi-pements religieux. Dans un premier temps, les autorités du diocèse se prononcent en faveur d’un édifice modeste, permettant donc au diocèse et aux Chantier du Cardinal d’en assumer seuls le financement et l’entretien. Dans cette perspective, on opte alors pour une église de taille moyenne. L’architecte du diocèse, qui travaille en collaboration avec les Chantiers du cardinal, table sur des assemblées de 30 à 60 personnes en semaine, 300 le dimanche, 600 les jours de fêtes. Le budget prévu est de 25 millions. En dépit de cette orientation initiale, le diocèse s’engage finalement sur la voie d’un projet plus ambitieux.
Tandis que l’architecte du diocèse est dessaisi du dossier d’autres cabinets sont consultés. Trois projets successifs sont examinés. Une pro-position d’église souterraine, un peu similaire à l’église Saint Pie X de Lourdes est suivie d’une autre, envisageant la construction d’une église « mitoyenne », complètement intégrée dans un corps de bâtiments aux fonctions non exclusivement cultuelles. C’est en définitive le projet de l’architecte suisse Mario Botta, dont le nom est suggéré par l’établisse-ment Public, qui est retenu. La rotondité autant que ses proportions de l’édifice prévu témoignent alors d’une volonté de différenciation et de visibilité qui consomme la rupture avec la pastorale d’enfouissement qui a prévalu précédemment. De manière significative, le Père Alain Bobière, le vicaire épiscopal chargé par le diocèse du suivi du dossier, écrit dans un bulletin destiné aux catholiques d’Évry, « Sortons de nos tanières et de nos souterrains, cessons de raser les murs. Le temps des catacombes, l’Église du silence c’est fini26 ! »
26. Cité dans Le Progrès, 16 mars 1990.
Livre identite et religion.indb 265Livre identite et religion.indb 265 19/12/07 18:17:4519/12/07 18:17:45
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
266RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
Un ministre « bâtisseur de cathédrale »
L’investissement du ministère de la Culture dans le projet marque le début de la « carrière nationale » du projet en même temps que sa sortie des limbes. Il constitue une étape décisive dans sa réussite, à en croire les témoins et observateurs. Ce changement d’échelle territoriale du projet est certes favorisé par le contexte dans lequel il a germé. Projets d’intérêt général (PIG), les villes nouvelles, placées sous la tutelle de l’État, trans-cendent l’intérêt immédiat des communes qui en relèvent. L’Établissement public d’aménagement constitue ainsi un lieu de continuité entre le centre (Paris) et le local. Mais ce changement d’échelle semble indissociable de la transformation du statut de l’édifice à construire, le retour d’une cathédrale sur la scène urbaine impliquant presque instantanément l’investissement de l’État central dans le projet. Ce qui n’est évidemment pas exclusif du fait qu’à l’inverse, la proximité de l’État implique ce dimensionnement ambitieux du projet. Quoi qu’il en soit, c’est en circulant dans le monde de la haute fonction publique que le projet migre de l’espace local à l’es-pace central, et ce faisant, surgit sur la scène nationale. Claude Mollard, à la fois président de l’agence d’ingénierie culturelle abcd, qui conseille l’Établissement public pour monter le projet, et conseiller technique auprès du ministre de la Culture de l’époque Jack Lang semble avoir joué ici un rôle essentiel27. « Je rencontre Jack Lang au printemps 1988, raconte-t-il, alors qu’il revient rue de Valois exercer son deuxième mandat de ministre de la Culture. J’évoque avec lui plusieurs projets sur lesquels je travaille, notamment celui de la cathédrale d’Évry. Il ne s’intéresse qu’à celui-ci. Son œil s’illumine. Il se voit déjà lui-même en bâtisseur de cathédrale. Il veut aussitôt voir la maquette. Elle est encore à réaliser. » Quelques mois plus tard, sollicité par courrier par Mgr Herbulot pour examiner comment le diocèse et le ministre de la Culture pourraient porter ensemble un tel projet, Jack Lang assure l’évêque de son soutien « intellectuel, moral et matériel28 ». Cet investissement du ministre se traduit par son engagement dans la stratégie de communication relative à la cathédrale. C’est ainsi de la rue de Valois, et non, comme cela avait été prévu initialement, du siège de l’archevêché de Paris qu’est officialisée la nouvelle et qu’est dévoilée en 1988 la maquette de la future cathédrale, en présence du cardinal Archevêque de Paris, Mgr Lustiger, de l’architecte, Mario Botta, et de
27. Voir Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, op. cit.28. Selon la lettre du ministre adressée à Mgr Herbulot en date du 15 décembre 1988.
Livre identite et religion.indb 266Livre identite et religion.indb 266 19/12/07 18:17:4619/12/07 18:17:46
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
267Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
Mgr Herbulot, l’évêque d’Évry. Il s’accompagne d’autre part de l’annonce immédiate du financement partiel du projet par le ministère, sur lequel on reviendra. Contournant l’obstacle de la loi de 1905 selon laquelle la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, le ministre affirme contribuer au financement d’un lieu de culture et non d’un lieu de culte. Pour marquer matériellement cette distinction, son soutien se traduit par l’adjonction d’un espace muséographique à l’édifice cultuel, les financements étant en principe exclusivement réservés au financement de cet espace appelé à devenir un musée d’art sacré.
L’emblème d’une laïcité apaisée
Cet investissement d’un acteur ministériel a pour toile de fond le développement des grands projets culturels à Paris et dans la région pari-sienne (Centre Georges Pompidou, Musée d’Orsay, la Villette, l’Opéra de la Bastille, etc.) qui caractérise les décennies 1980 et 1990. L’intérêt porté au projet par le ministre Jack Lang, qui s’explique sans doute également par son goût prononcé pour les projets artistiques d’avant-garde29, s’inscrit en outre dans un contexte de libéralisation de la laïcité qui succède à la phase de tension au début de la décennie 198030. Cette participation financière du ministère de la Culture, qui n’ira pas comme on le verra sans susciter de réticences au sein de l’équipe gouvernementale, marque incontestablement un repositionnement du gouvernement socialiste sur la question religieuse, celle-ci s’imposant sur la scène publique à travers différents dossiers (tels que celui de l’islam ou encore celui des sectes). Elle participe non seu-lement d’une gestion pacifiée des rapports avec les religions mais aussi d’une reconnaissance accrue de leur contribution à la vie de la cité comme en atteste diversement, la politique de reconnaissance de l’islam mise en œuvre par Pierre Joxe, la réflexion sur la préservation et la transmission du patrimoine cultuel, l’association d’acteurs religieux à la résolution de la crise néocalédonnienne en 198831 ou encore l’instrumentalisation du fait islamique par les acteurs publics dans les banlieues32.
29. On pense bien évidemment aux Colonnes de Buren au Palais-Royal.30. Ces tensions ont été illustrées doublement par les conflits impliquant l’islam dans les grèves touchant l’industrie automobile (1983) et l’affrontement impliquant l’Église catholique sur la question scolaire (1984).31. Sur ce sujet voir le développement qu’y consacre Danièle Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le Converti, Paris, Flammarion, 1999, p. 264 et suivantes.32. « De l’inscription de l’islam dans l’espace urbain », Annales de la recherche urbaine. Politique de la ville. Recherche de terrains, 68-69, septembre-décembre 1995, p. 178-195.
Livre identite et religion.indb 267Livre identite et religion.indb 267 19/12/07 18:17:4619/12/07 18:17:46
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
268RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
Révélatrice de la porosité des frontières séparant les champs politiques et religieux, publics et privés, la cathédrale d’Évry s’impose ainsi à l’état de projet comme le véhicule d’une multiplicité de messages adressés à différents publics par les différents acteurs qui s’allient en vue de sa réactualisation. La cathédrale se définit dès lors moins comme une fin en soi que comme prétexte et support de communication. S’y entrecroisent, pour s’entremêler parfois, le message de l’Église adressé à ses fidèles et à la société, celui du ministère de la Culture en faveur du patrimoine de l’art contemporain, ceux des urbanistes adressés aussi bien aux Évryiens qu’à ceux qui pourraient être amenés à le devenir, celui du gouverne-ment en faveur d’une laïcité apaisée, celui de l’architecte en direction de son public. Tout se passe en somme comme si la légitimité même de la construction d’une cathédrale dans le centre-ville d’Évry avait pour nécessaire corollaire une logique d’euphémisation ou de dépassement de sa vocation cultuelle.
De fait, dans le discours des acteurs publics, cette fonction est bien souvent gommée au profit des dimensions urbanistique, patrimoniale et artistique de l’édifice. Geste architectural s’inscrivant dans un projet urbain, celui-ci répond à une volonté de structurer l’espace et le temps du nouveau centre urbain. Il est clair à cet égard que si une cathédrale est associée à la centralité, c’est moins en raison de sa fonctionnalité cultuelle, qu’en raison du fait que côtoyant l’hôtel de ville elle est susceptible de réactua-liser un schéma urbain traditionnel. Autrement dit le projet, jouant sur un appel à une supposée mémoire collective, conçoit l’édifice comme une greffe de mémoire susceptible d’inscrire la ville dans la continuité d’une histoire nationale, à laquelle la cathédrale serait indissolublement liée. Les propos de Mario Botta sont à cet égard éloquents : « La cathédrale, par sa fonction de pôle spirituel et sa portée symbolique, nous renvoie à une histoire millénaire et remplit un vide – le vide de la mémoire propre à la ville nouvelle. Aussi est-il nécessaire de créer des institutions, qui au-delà de la simple satisfaction des besoins fonctionnels de la vie quotidienne, sachent relier l’homme du temps présent à la richesse d’un héritage, d’un patrimoine collectif. Ainsi, construire une cathédrale c’est inévitablement être renvoyé à une mémoire et à un passé qui nous appartiennent comme des valeurs dont nous ressentons profondément l’appel33. » De même pour les urbanistes, c’est rarement la fonction cultuelle de l’édifice qui est mise en avant. Tout au plus la cathédrale est-elle considérée par eux comme
33. Mario Botta, cité dans Jacques Longuet, Autour d’une cathédrale, op. cit., p. 11-12.
Livre identite et religion.indb 268Livre identite et religion.indb 268 19/12/07 18:17:4619/12/07 18:17:46
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
269Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
la maison de la transcendance, un espace sacré, un lieu de spiritualité vague, a confessionnelle, anonyme. Dans leur discours, comme dans celui de l’architecte, tout se passe en somme comme si la cathédrale n’avait en somme de cathédrale que le nom. Dépouillée de ses attributs confes-sionnels, elle est une sorte de coquille vide destinée à devenir le temple d’une religiosité moderne aux contours indécis. Le terme de cathédrale, apparent garant de continuité historique, semble n’être en somme qu’un alibi masquant l’ampleur du décalage existant entre le contexte histo rique dans lequel émergent les premières cathédrales et celui dans lequel a germé le projet de la cathédrale d’Évry. Alors qu’elle est au Moyen Âge le produit autant que la manifestation d’une cohésion sociale dans laquelle le catholicisme joue un rôle fondamental, la cathédrale des urbanistes et du ministère est bien plus la traduction d’une désarticulation du symbole à son référent confessionnel d’origine. Comme l’affirme le député-maire d’Évry soucieux que puissent s’affirmer à travers des lieux identifiables des exigences de spiritualité et de valeurs morales : « C’est là un problème qui dépasse l’Église qui est vraiment un problème de civilisation : il faut des cités avec des lieux qui élèvent34. »
… Et le verbe se fit pierre
Si donc l’investissement de l’Église dans un projet immobilier d’ampleur participe d’un retour à une pastorale de visibilité, il ne s’agit en aucun cas – quoique puisse suggérer la dédicace de la cathédrale baptisée « Notre-Dame de la Résurrection » – de renouer avec une utopie de totalisation religieuse passant par une christianisation de l’espace et de la société. Le retour d’un édifice cultuel au centre de la ville est bien moins imputable à une stratégie de reconquête qu’il ne résulte d’une mobilisation des acteurs publics en quête de pôles d’identification collective susceptible de restruc-turer une ville en devenir tout en en changeant l’image. On se trouve ainsi dans une situation paradoxale dans laquelle l’institution catholique, se conformant aux exigences de la laïcité et assumant sa marginalisation dans la société, est amenée, presque malgré elle, à occuper une place pri-vilégiée dans l’espace public – au double sens géographique et symbolique du terme – à laquelle pourtant, on l’a vu, elle ne prétendait pas a priori. S’il est incontestable qu’elle retire des avantages non négligeables d’une telle situation, comme en attestent les retombées en termes de notoriété et
34. Voir son intervention dans le cadre du colloque, L’architecture religieuse et le retour du monumental, op. cit., p. 191.
Livre identite et religion.indb 269Livre identite et religion.indb 269 19/12/07 18:17:4719/12/07 18:17:47
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
270RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
de financements liées à l’investissement du ministère de la Culture dans le projet, ce retour au centre a un coût : la maîtrise de la symbolique de l’édifice à construire échappe en partie aux acteurs catholiques. Bien que toujours consultées et mises en avant dans les médias, les institutions diocésaines se voient ainsi en partie déssaisies d’un projet dont elles sont pourtant officiellement commanditaires et in fine destinataires. Quoique projet privé, le pilotage de l’opération est dominé par les acteurs publics. La matérialisation du projet en objet bâti traduit remarquablement ces interdépendances entre les acteurs, interdépendance qui confine parfois à la dépossession des acteurs catholiques.
Le programme fixé à l’architecte, dont le choix revient plus à l’établis-sement public qu’aux acteurs catholiques35, est à cet égard éloquent. Il est prévu que l’édifice s’insère dans un projet immobilier plus large intitulé « l’îlot cathédrale », comprenant outre un lieu de culte de mille mètres carrés environ, quatre mille cinq cents mètres carrés de bureaux, neuf mille cinq cents mètres carrés de logements, deux milles mètres carrés de commerces et de services ainsi que deux cent cinquante places de stationnement. Quant à la cathédrale proprement dite, les préoccupations cultuelles des acteurs catholiques composent au stade du programme avec celles des urbanistes. Si les premiers insistent pour que l’édifice se conforme aux exigences liturgiques postconciliaires et symbolise l’idée d’assemblée, les seconds, qui ont décidé au préalable de son emplacement, mettent l’accent sur la visibilité de l’édifice et donnent des indications précises sur le matériau de construction ainsi que sur la disposition de l’édifice à construire. Autre trace matérielle de cette interdépendance entre les acteurs catholiques et publics : l’adjonction d’un musée à la cathédrale résultant des résistances opposées au financement public de l’édifice religieux. L’investissement du ministre de la Culture dans le projet ne suscite certes guère de protestation au sein de l’opinion publique. Il en va autrement au sein de l’adminis-tration. Le soutien financier, promis par le ministre (5 millions de Francs de la part du ministère), se heurte à des résistances internes au sein de la sphère gouvernementale36 au point que l’arbitrage présidentiel sera
35. Panorama, avril 1993.36. Comme le raconte Claude Mollard : « Pendant près de six mois, le dossier dort au ministère de l’Intérieur, dont le ministre est également traditionnellement le ministre des cultes. De bureaux en directions, il échoue finalement entre les mains du directeur de cabinet du ministre, qui nous reçoit aimablement, Yves Boucly et moi, et promet une réponse du ministre Pierre Joxe, à son collègue de la culture. Cette réponse ne vient jamais. Du côté de la culture, les fonction-naires sont bien obligés de tenir compte des engagements pris par leur patron, mais ne manifestent pas, il faut bien le dire, le même empressement que leur
Livre identite et religion.indb 270Livre identite et religion.indb 270 19/12/07 18:17:4719/12/07 18:17:47
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
271Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
sollicité. Les promoteurs du projet s’ingénient alors à contourner l’obstacle en vidant de son contenu l’obstacle juridique opposable à ce soutien de l’État. Jouant sur des réseaux d’acteurs impliqués dans la préservation du patrimoine tant au niveau de l’administration centrale que régionale, une commission de travail propose alors que la cathédrale héberge un centre national d’art sacré, étant entendu que les financements publics seraient exclusivement destinés audit centre. De cette légalisation du projet, permettant de composer avec la loi 1905, résultera un renflement qui va de l’autel au plafond de verre de la cathédrale, l’espace muséographique surplombant le chœur, l’espace liturgique par excellence.
Cette implication des acteurs publics dans le projet ne se traduit pas seulement par la répartition des espaces entre les acteurs impliqués dedans. L’esquisse elle-même de l’édifice porte la trace de leurs interventions. Selon le directeur de l’Établissement public « la minceur des indications de pro-gramme fourni par l’évêché, le caractère non déterminant des travaux de la réflexion antérieure sur le rapport entre la liturgie et l’architecture, ont laissé libre cours, d’une part, au dialogue entre l’architecte et l’urbaniste d’Epevry, François Desbruyères, sur le thème de la composition urbaine, et, d’autre part, à la présentation directe par Mario Botta du résultat de ses réflexions sur l’architecture du monument37 ». Le ministre de la Culture, s’autorise lui aussi à intervenir personnellement pour amender l’esquisse architecturale proposée par l’architecte. Comme en témoigne Claude Mollard : « Ses exigences, le mot est prononcé, sont peut-être à l’origine de l’une des plus importantes modifications du projet entre l’esquisse initiale et le projet définitif : l’implantation de l’escalier en forme d’échauguette sur le fronton extérieur du bâtiment, qui permet de faire communiquer les différents étages du centre d’art sacré, d’animer une façade trop monotone et de donner une base au campanile surmonté de la croix38. »
De fait, le langage architectural déployé par l’œuvre de Mario Botta reflète également la perte de prise sur le projet des acteurs catholique, manifestant un arrachement de la cathédrale au terreau catholique dont elle a surgi. La construction d’un tel édifice n’a de sens à ses yeux qu’en ce qu’elle est une « reproposition (sic) d’anciennes valeurs avec une clef
ministre. Certains agissent plus sournoisement, et, par des notes argumentées, savent renvoyer la balle qui leur est présentée. Botter en toucher peut être l’une des formes des beaux-arts pratiquée par l’administration. ». Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, op. cit. .37. Ibid., p. 89.38. Ibid.
Livre identite et religion.indb 271Livre identite et religion.indb 271 19/12/07 18:17:4819/12/07 18:17:48
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
272RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
d’interprétation actuelle39 ». Dans cette perspective, c’est une version méta-historique de la cathédrale qu’il propose. La signification catholique de l’édifice, contingente à ses yeux, lui importe moins que ce qu’elle dit de l’expérience religieuse de l’humanité. Ce qui prime à ses yeux c’est que la cathédrale continue de remplir la fonction de pôle sacré au cœur de la cité qu’elle remplissait dans la cité médiévale. Une cathédrale est avant tout un lieu symbolique de gratuité, par oppositions aux valeurs techniques et fonctionnelles du reste de la ville. Elle est pour l’architecte « un lieu de pause et de silence », un « espace pour l’esprit […] qui puisse aider les hommes à affronter la vie et la lutte quotidienne » ou encore « une occasion de prière et de réflexion ». Elle est destinée aussi bien à ceux qui s’y rendent qu’à ceux qui tout en l’identifiant comme un lieu à part ne s’y rendront jamais. « La cathédrale doit être disponible au-delà de sa fonction strictement religieuse à laquelle elle ne peut se résumer, mais qu’elle doit transcender40. » Dans une ère marquée par la marginalisation du christianisme, la réactualisation de la cathédrale passe à ses yeux par un dépassement de la tradition religieuse qui l’a engendrée. Quand il invoque le « grand passé » ce n’est pas pour inscrire la cathédrale dans une filiation historique mais bien au contraire pour l’en affranchir au nom d’un retour à l’expérience religieuse « primaire » de l’homme.
L’édifice proposé, puis réalisé, n’a en effet rien des vaisseaux gothiques auxquels l’imaginaire collectif associe immuablement la cathédrale. Le plan circulaire s’est substitué à la traditionnelle croix latine. Point de nefs ni de croisée d’ogives, ni de transept, pas plus que de portail ni de flèche. Un cylindre de briques rouges, tronqué, haut de 36 mètres en sa plus haute extrémité, surplombé d’une couronne de 24 tilleuls argentés : telle se présente l’esquisse de l’architecte. Rien a priori des attributs traditionnels les cathédrales. Extérieurement, à l’exception du campanile discret surmonté d’une croix sobre et tout aussi discrète, l’édifice est dénué de toute symbolique confessionnelle déchiffrable instantanément. Les références chrétiennes n’en sont certes pas absentes. L’édifice met l’accent sur le symbole de la succession apostolique à travers les alvéoles réservées à des vitraux représentant les douze apôtres ou encore l’autel qui, reproduisant le modèle de celui de Saint Pierre de Rome, plonge son pied dans le caveau dans lequel des niches sont aménagées pour recevoir les sépultures des évêques qui se succéderont à la tête du diocèse. La piscine
39. Voir son intervention dans le cadre du colloque L’architecture religieuse et le retour du monumental, op. cit , p. 198.40. Cité par Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, op. cit. , p. 230.
Livre identite et religion.indb 272Livre identite et religion.indb 272 19/12/07 18:17:4819/12/07 18:17:48
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
273Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
baptismale de marbre de Carrare, située à gauche de l’autel réactualise la tradition de l’ecclesia mater41. Mais, ces symboles davantage présents à l’intérieur de l’édifice qu’à l’extérieur, ornent l’édifice plus qu’ils ne le structurent. Comme le remarquent opportunément quelques observateurs : la forme prise par l’édifice est plus caractéristique de son auteur qu’elle ne reflète une identité confessionnelle42. La cathédrale de Botta parachèverait ainsi l’émancipation de la cathédrale du pouvoir sacerdotal qu’évoque Victor Hugo à propos du passage de l’art roman à l’art gothique43 : « La cathédrale elle-même, cet édifice si dogmatique, envahie désormais par la bourgeoisie, par la commune, échappe au prêtre et tombe au pouvoir de l’artiste. L’artiste la bâtit à sa guise. Adieu le mystère, le mythe et la loi. Voici la fantaisie et le caprice. Pourvu que le prêtre ait sa basilique et son autel il n’a rien à dire. Les quatre murs sont à l’artiste. Le livre architectural n’appartient plus au sacerdoce, à la religion, à Rome, il est à l’imagination, à la poésie, au peuple44. »
De manière surprenante, les responsables du diocèse semblent assumer sans difficulté apparente cette déconnexion entre le langage architectural et la tradition catholique. Lorsqu’il s’adresse à ses fidèles pour solliciter leur générosité, Mgr Herbulot se refuse à une lecture exclusivement confessionnelle de la cathédrale. Il décline les différents niveaux de significations dont elle est porteuse sans prétendre les hiérarchiser : cœur battant du diocèse, la cathédrale est simultanément un lieu d’enracinement indispensable à la ville nouvelle, une expression architecturale du sacré nécessaire à tout homme, une œuvre d’art moderne. Tout se passe en somme comme si les acteurs du diocèse ne sauraient être les dépositaires légitimes de l’édifice sans consentir à un tel dépassement.
Vox populi vox dei…
Dans cet unanimisme, une voix dissonante résonne cependant, qui fustige à mots couverts les concessions qu’implique le retour d’un édifice catholique au cœur de la cité. Invité à se prononcer sur le projet, le cardinal archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, quoiqu’accompagnant le projet, exprime tout d’abord son malaise eu égard au défi que représente à ses
41. Le baptistère fut longtemps l’attribut exclusif des cathédrales.42. Franck Debié et Pierre Vérot, Urbanisme et Art Sacré. Une aventure du XXe siècle, op. cit. , p. 350.43. Évocation dont on peut se demander si elle ne se rapporte pas plus aux bouleversements sociaux du XIXe que ceux du XIIIe siècle.44. Notre-Dame de Paris, Paris, Gallimard, 1974, p. 250.
Livre identite et religion.indb 273Livre identite et religion.indb 273 19/12/07 18:17:4819/12/07 18:17:48
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
274RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
yeux l’imbrication des fonctions cultuelle et muséographique. À l’instar de Picabia comparant les musées à des cimetières, le cardinal met en exergue le message potentiellement mortifère, à ses yeux, d’une cathédrale, qui ne pourrait être réactualisée qu’à la condition d’être d’emblée imaginée comme le conservatoire d’une espèce en péril voire le précieux résidu d’un monde voué à l’oubli. « En ce qui concerne la conjonction de cette cathédrale et du musée, je m’inquiète ou, si vous préférez, j’espère. J’appelle cette espérance un défi. Je suis inquiet si l’on juxtaposait une cathédrale qui pourrait devenir un musée et un musée qui ambitionnerait de devenir une cathédrale. De fait dans plusieurs pays, hors de France, des cathédrales sont devenues des musées ; c’est aussi une tentation en France pour ceux qui ont en charge de préserver le patrimoine. Je l’ai dit au ministre : il ne le souhaite pas. En effet, tout homme sensible à l’histoire et à la nature des objets liturgiques comprend que si les cathédrales devenaient des musées, ce serait la mort des cathédrales en tant qu’œuvres d’art. Ainsi le temple de Louqsor. C’est un objet mort ; il a perdu à jamais sa vie et donc sa signification. Seuls les hommes qui s’en servent et l’habitent en manifestent le sens. L’objet lui-même ne le dit pas. La beauté de Louqsor qui nous fascine encore a enfoui désormais son secret ! ». De même exprime-t-il ses réserves quant à l’insignifiance théologique de l’esquisse de Mario Botta. « En voyant défi-ler les trois formes cylindriques de Mario Botta, je me disais : “Il y a une expression typique de Mario Botta. Est-ce déjà un langage architectural ? En effet il s’agit d’une architecture d’auteur, d’une architecture signée. […] Il y a un langage architectural lorsque le langage est communicable, […] Lorsque le passant pourra dire non pas : ‘tiens, c’est du Botta’, mais ‘tiens c’est une église45’.” […] Personne ne peut artificiellement créer des signes. Le propre d’un signe, c’est d’être adopté et reconnu par une société. Il en va de même pour la langue parlée. Il ne suffit pas de créer des mots arbitrairement.[…]. Pour constituer un langage véritable, les mots doivent sortir de la bouche de milliers de gens qui les reconnaissent comme leur langue et devenir propriété d’un peuple ». De cette analyse sur l’indétermination du rapport entre forme et sens sourd une inquiétude fondamentale quant à ce qu’elle pourrait traduire des compromissions d’un catholicisme qui, sous prétexte de redevenir une référence centrale, consentirait à devenir, à la faveur d’une instrumentalisation politique, théologiquement informe ; le monument proposé par Botta ayant en quelque sorte valeur de métaphore
45. « La cathédrale et le musée d’art sacré », dans L’architecture religieuse et le retour du monumental, op. cit. , p. 183.
Livre identite et religion.indb 274Livre identite et religion.indb 274 19/12/07 18:17:4919/12/07 18:17:49
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
275Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
d’un catholicisme moins force structurante que stock de symboles dispo-nibles à tous les réemplois.
Tandis que retentissent les interrogations inquiètes du cardinal Archevêque de Paris sur la lisibilité catholique d’un édifice dont l’Église est dépositaire en même temps qu’elle en est dépossédée se pose la question fondamen-tale de l’appropriation par un public élargi d’un projet conçu en vase clos entre des décideurs publics et catholiques. En posant cette question, le cardinal ne fait autre que mettre le doigt sur une vérité sociologique selon laquelle la définition du sens d’un objet ne se joue pas simplement dans une interaction entre les concepteurs qui imposeraient en quelque sorte un sens clos à des récepteurs contraints soit d’y adhérer soit de le rejeter : cette définition se rejoue en partie dans une interaction entre les concepteurs et les récepteurs du projet.
En l’espèce la question de l’adhésion à l’édifice est d’autant plus cruciale qu’elle conditionne en partie le financement du projet. Aussi spectaculaire soit-il le financement assuré par l’État et les collectivités territoriales reste limité ne composant qu’une petite partie d’un budget total estimé à plus de 60 millions de francs. Le mécénat d’entreprise n’ayant pas donné les résultats escomptés les promoteurs du projet sont contraints de recon-sidérer leur schéma de financement46. C’est dès lors majoritairement sur la souscription publique que repose le nouveau plan de financement de la cathédrale, estimée à 85 millions de francs47. C’est ainsi que dès 1990 une campagne de communication est lancée visant à soutenir cet appel au don. Plusieurs centaines de d’affiches adressent ainsi le slogan suivant à l’homme de la rue : « Qui peut construire une cathédrale aujourd’hui ? Vous ! ». En livrant la cathédrale à la logique marchande, les promoteurs la soumettent à l’épreuve de la reconnaissance.
Or, si cette stratégie de marketing direct s’avère fructueuse48, elle remet à l’honneur la vocation religieuse et cultuelle de l’édifice en cours de construc-tion en ce qu’elle révèle une logique d’appropriation catholique du projet. Le donateur se caractérise en effet, aux dires de l’agence marketing, par une
46. En 1989, le schéma de financement se présentait comme suit. Le coût total de l’édifice était estimé à 47 millions de francs. Il était prévu que 5 millions proviennent des Chantiers du Cardinal ; 4 millions de l’évêché de Munich jumelé avec l’évêché d’Évry ; 18 millions soient versés pour le centre d’Art par le ministère de la Culture et les collectivités publiques ; 20 millions via le mécénat d’entreprise.47. Censés se répartir comme suit : chantiers du cardinal : 5 millions ; évêché de Munich : 4 millions ; Mécénat d’entreprise : 5 millions de francs ; Collectivités pub-liques (pour le centre d’art sacré) : 13 millions ; Marketing direct : 58 millions.48. Les taux de réponses aux sollicitations se caractérisent en effet pas le fait qu’ils sont bien plus élevés que (entre 25 et 30 % selon les cas) ce qui se produit habituellement.
Livre identite et religion.indb 275Livre identite et religion.indb 275 19/12/07 18:17:4919/12/07 18:17:49
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
276RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
adhésion à l’institution catholique49. La stratégie marketing mise en œuvre à partir de 1990 avait en effet tablé sur deux cibles privilégiées. Les « catho-liques pratiquants » d’une part, les « intellos citadins et branchés amateurs d’art contemporain » selon la typologie rapide proposée par Jean Di Scullo directeur de l’agence abcd. Sur la base de cette typologie, elle a conçu deux types de message. Le premier « paupériste », toujours selon l’expression du directeur de l’agence, ayant pour support du papier recyclé jouait sur un double registre patrimonial et spirituel : y figurait un message de l’évêque exprimant ce que signifiait la fondation de cette nouvelle cathédrale dans le département de l’Essonne. Le second « plus chic » adressé à la seconde cible avait pour support un papier de qualité, plié dans une enveloppe carrée insistant sur les enjeux à la fois artis tiques et culturels du projet. Les premiers tests ayant rapidement démontré l’écrasement du premier message sur le second ont conduit à recentrer la campagne marketing sur la cible catholique50. Toutefois, en même temps qu’ils se l’approprient les donateurs n’en désavouent pas moins le parti pris architectural de Mario Botta. C’est moins à l’architecture d’auteur qu’à l’idée de la cathédrale en tant que telle qu’adhèrent les donateurs. Observant une baisse sensible des dons dès lors que l’esquisse du projet de Botta figurait sur les lettres sollicitant d’éventuels souscripteurs, la campagne de communication s’est délibérément centrée soit sur une image patrimoniale de la cathédrale soit sur sa fonction spirituelle. Les supports de ces lettres ont ainsi alterné entre une représentation des vitraux de la cathédrale de Chartres ou une photographie de Jean-Paul II ou encore de l’évêque du diocèse. Le succès des « gadgets religieux » proposés ou offerts aux souscripteurs en contrepartie de leurs dons est lui aussi révélateur de cette logique d’appropriation de l’édifice51 par un public catholique.
De ce déphasage entre le stade de la conception du projet de celui de son appropriation, qui conduit à communiquer sur un support décalé par rapport à l’objet financé par le donateur, résulte également une logique d’appropriation qui se joue quant à elle dans la contestation. Tant les commentaires consignés dans les livres d’or recueillant les appréciations et commentaires des visiteurs venus découvrir le lieu que la presse catholique
49. « Nous ne disposons pas d’étude sociologique de cette population, mais de quelques indications données par le père Bobière ou par ceux qui ont géré de près les fichiers. Le donateur de la cathédrale est un homme ou une femme d’âge plutôt avancé, en général catholique pratiquant, domicilié pour les deux tiers voire les trois quarts dans la région Île de France. » Claude Mollard, La Cathédrale d’Évry, op. cit. , p. 121.50. Entretien.51. Tels que des possibilités de joindre au don une prière personnelle, destinée à être enterrée dans les fondations de la cathédrale durant une cérémonie durant laquelle le souscripteur peut exiger qu’elle soit lue.
Livre identite et religion.indb 276Livre identite et religion.indb 276 19/12/07 18:17:5019/12/07 18:17:50
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
277Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
témoignent de cette ambivalence entre adhésion et désaveu. Ce désaveu s’exprime aussi bien à l’état brut au travers d’un « elle a une sale gueule » que sous la forme de remarques naïves d’enfants raillant « la laideur de cette cathédrale ronde et rose ». Il peut prendre aussi la forme d’un discours argumenté dénonçant « un péché d’esthétisme ». Néanmoins quelles que soient les modalités d’expression de la critique, qui se décline d’ailleurs moins sur le mode du rejet que du regret52, il est frappant d’observer que celle-ci se déploie pour l’essentiel au sein de la sphère catholique.
De même la mise en usage de l’édifice donne-t-elle lieu à un mouvement de réappropriation symbolique de l’édifice. Si au stade de la conception les acteurs catholiques ont assumé les différents niveaux de discours sur la cathédrale, l’entrée en possession de l’édifice se traduit par une volonté de réinscrire l’édifice dans une tradition confessionnelle. C’est un véritable dispositif de relecture catholique du lieu qui est alors mis en place. Des visites organisées par les laïcs ainsi qu’un petit vade-mecum disponible à l’entrée de la cathédrale proposent ainsi un parcours des lieux menant du baptistère à l’autel puis à la crypte octogonale de la chapelle de jour. Le dispositif visant à compenser le manque de lisibilité architecturale s’em-ploie à en légitimer l’aspect déroutant par des références à des précédents historiques. La rotondité de la cathédrale ferait ainsi écho aux églises byzantines. Pour qui en douterait, une reproduction de l’Église du Saint Sépulcre figure au dos du fascicule destiné à orienter et informer les visi-teurs. Dans le même esprit, les guides attachent de l’importance à conférer le matériau utilisé pour la construction de la cathédrale d’une connotation biblique : la brique devient ainsi un symbole vétéro-testamentaire.
Quoi qu’il en soit de la logique de reconfessionnalisation du lieu que révèle le stade de l’appropriation de l’objet, revenir sur les conditions de la « fabrique » de la cathédrale d’Évry témoigne d’un singulier brouillage des frontières entre le privé et le public, le politique et le religieux, le local et le national. Sous-jacente à ce brouillage se dessine une action collective impliquant une coalition d’acteurs improbable – du moins si l’on se réfère à ce que dispose la loi 1905 en matière de séparation entre l’Église et l’État.
Toutefois ce qui frappe ici c’est moins ce que l’histoire de la cathédrale d’Évry dévoile d’influences réciproques entre le public et le religieux que l’absence de protestations qu’une telle coopération suscite. L’accueil favorable que réserve au projet l’opinion publique n’empêche pas, comme
52. À titre de comparaison on pourra se reporter à « l’affaire » des colonnes de Buren. Nathalie Heinich, « Les colonnes de Buren au Palais Royal. Ethnographie d’une affaire », Ethnologie française. 25,1995, 4, p. 525-539.
Livre identite et religion.indb 277Livre identite et religion.indb 277 19/12/07 18:17:5019/12/07 18:17:50
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
278RELIGION(S) ET IDENTITÉ(S) EN EUROPE
on l’a vu, quelques résistances et mobilisations hostiles. Mais ces mani-festations d’hostilité ont assez peu à voir avec les grandes controverses qui caractérisent la guerre des deux France.
Plusieurs facteurs favorisent la construction d’un tel consensus. Celui-ci tient sans doute au statut à part de la cathédrale, dont l’historien André Vauchez souligne qu’à la différence des autres églises elles n’apparaissent pas simplement comme des édifices purement religieux, mais plutôt comme des mémoriaux où s’inscrivent et se mêlent l’histoire sacrée et profane de notre pays53. Il renvoie sans doute aussi à l’économie du lieu auquel cette cathédrale est destinée : la ville nouvelle compte tenu de ces particularités politico-administrative et de son statut de ville en devenir, constituant une sorte « d’ailleurs ». Il procède enfin de ce qu’on a coutume de désigner comme la nouvelle laïcité. La cathédrale d’Évry ne ferait que traduire des déplacements qui se sont opérés d’une laïcité de combat, hostile à une Église qui n’a pas abandonné ses projets de domination du champ politique, à une laïcité de compromis, reconnaissant à l’Église catholique – comme à toute force de la société civile – un rôle spécifique dans la société civile. En l’espèce on pourrait conclure à une sorte de partenariat césaro-papiste : l’État reconnaissant à l’Église catholique une fonction centrale dans le champ des valeurs religieuses ou même des valeurs tout court et l’appelant à la rescousse comme pourvoyeur de sens dans une société travaillée par des forces centrifuges et en voie d’atomisation. La cathédrale, dans sa double fonction de réceptable des mémoires nationale et religieuse, ne ferait en somme que réunir ce que la laïcité n’est jamais parvenue à séparer.
Dans la réalité, les choses sont autrement plus complexes. Tout d’abord, entre la représentation que l’on se fait de la laïcité et sa réalité pratique, il y a un décalage que sociologues et historiens ont mis au jour et qui amène à s’interroger sur le caractère inédit de telles coopérations. D’autre part, il convient d’insister sur le fait que ceux-là mêmes qui encouragent les acteurs catholiques à se lancer dans la construction d’une cathédrale ne croient à aucun moment en la capacité du catholicisme à resserrer le lien social : l’Église catholique est tout au plus un médiateur indispen sable pour crédibiliser le projet. Si retrouvailles il y a, force est d’admettre que ni les acteurs publics ni les acteurs catholiques ne maîtrisent la signi-fication du symbole qu’ils réactualisent. Au total ce qui est frappant dans le discours des acteurs politiques et des acteurs religieux c’est une
53. André Vauchez, « La cathédrale », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, tome 3, volume 2, Paris, Gallimard, p. 94.
Livre identite et religion.indb 278Livre identite et religion.indb 278 19/12/07 18:17:5019/12/07 18:17:50
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)
279Catholicisme et nation au miroir d’une cathédrale
ambivalence très forte entre d’un côté le souci de faire émerger un pôle de rassemblement et de l’autre le refus de définir de manière définitive ce qui doit être ce pôle. Si consensus il y a, c’est bien sûr ce point : il ne peut y avoir de pôle d’identification collectif que dans le fluctuant, le polysémique, le pluriel. De ce point de vue, la cathédrale d’Évry est d’une certaine manière insaisissable. C’est peut-être une certaine forme de vide qui en garantit la cohérence, du moins au stade de sa conception. Elle n’a de cathédrale que le nom : ce mot de cathédrale – à forte portée émotionnelle – est le lieu de cristallisation des significations foisonnantes qui se côtoient, s’enchevêtrent, se recouvrent parfois en partie, sans jamais ni se superposer totalement ni prétendre s’exclure. Derrière l’apparente garantie de continuité historique qui semble apporter la construction de cet édifice dans la ville d’Évry se jouent des déplacements considérables. Si les institutions politiques et religieuses sont à l’origine du projet, aucune d’entre elles n’en maîtrise l’aboutissement ni la signification ultime. Le projet leur échappe en partie. En somme, la cathédrale d’Évry est peut-être moins un projet strictement politique ni strictement religieux qu’un lieu d’émergence d’une civilité qui tout en transcendant le clivage entre religion et politique dédifférencie ces deux champs et les annihilent en partie. Il existerait de ce point de vue une forme d’homologie entre la situation matérielle et symbolique de la cathédrale, le flottement du symbole reflétant d’une part la perte de contrôle du catholicisme sur le sens d’un édifice né en son sein, d’autre part une forme de désarroi du politique n’ayant d’autre alternative que de réinvestir des symboles religieux. Il n’est pas impossible que la cathédrale soit de ces « fonds symboliques » dont parle P. Ricœur susceptibles de se pérenniser tout en s’ouvrant à de nouvelles interprétations54. Reste que si nation et catholicisme se retrouvent dans la cathédrale d’Évry, c’est plus à l’état de fragments désarticulés que de synthèse structurée et structurante.
54. Paul Ricœur, « Structure et herméneutique (1963) », dans Paul Ricœur, Lectures 2. La contrée des philosophes, Paris, Seuil, 1999.
Livre identite et religion.indb 279Livre identite et religion.indb 279 19/12/07 18:17:5119/12/07 18:17:51
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
EN
S C
acha
n -
- 1
94.1
99.9
0.57
- 1
3/03
/201
5 00
h28.
© P
ress
es d
e S
cien
ces
Po
(P.F
.N.S
.P.)
Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - E
NS
Cachan - - 194.199.90.57 - 13/03/2015 00h28. ©
Presses de S
ciences Po (P
.F.N
.S.P
.)