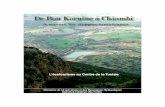L'approvisionnement en eau de Zama (Tunisie), le barrage d'Aïn Jebour
-
Upload
univ-tlse2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'approvisionnement en eau de Zama (Tunisie), le barrage d'Aïn Jebour
REGARDS CROISÉS D’ORIENT ET D’OCCIDENT LES BARRAGES DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE
Édités par
François BARATTE, Christian Julien ROBIN et Elsa ROCCA
Orient & Méditerranée | Archéologie
no 14
Éditions de Boccard
Directeur de la collectionJean-Claude CHEYNET, Université Paris-Sorbonne - UMR 8167 Orient & Méditerranée
Responsable éditorialeFabienne DUGAST
Création de la maquette et mise en pageFabien TESSIER
© Éditions de Boccard - 2013ISBN : 978-2-7018-0357-9ISSN : 2101-3195
Le colloque et sa publication ont été assurés avec la contribution de l’Agence nationale de la recherche (CSD9 – Sciences humaines et sociales Projet 07-BLAN-10372)
Illustration de couverture
L’Écluse méridionale de la Digue de Maʾrib vue depuis le lit du wādī Dhana. Elle est flanquée par le Pylône d’Abraha à son extrémité amont (à droite sur le cliché)[cliché : C. Robin]
IntroductIon
Une étude sur le thème de l’adduction d’eau s’im-posait à Zama et dans ses environs pour deux raisons (figure 1). D’abord parce que la « grande histoire », celle de la bataille de 202 avant J. C., nous montre Hannibal et Scipion en quête de la meilleure position
pour l’alimentation de leurs troupes en eau1. En second lieu, parce que l’exploration de terrain, repre-nant celle réalisée dans les années 1900, n’a cessé de confirmer l’importance de la ville antique et de ses « monuments des eaux » (figure 2). Grâce à une coopé-ration jusqu’à ce jour exemplaire entre archéologues tunisiens de l’Institut National du Patrimoine et fran-çais de Toulouse (université de Toulouse 2-le-Mirail, CNRS, École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, Institut universitaire de France), conforme aux accords-cadres de 2002 associant l’INP et les orga-nismes français, une réelle capacité collective s’est développée, permettant de faire face à un travail qui s’est révélé aussi considérable que passionnant. Celui-ci s’inscrit dans une tendance récente de la recherche en terre d’Afrique, qui a vu, un siècle après les explorations pionnières de Gauckler, et dans le même temps que de brèves synthèses2, s’esquisser tout un courant de nouvelles recherches de terrain : celles conduites par N. Ferchiou au Temple des eaux de Zaghouan3, par J.-L. Paillet sur l’aqueduc de Cherchell4, sous la direction de H. Ben Hassen et L. Maurin à Oudhna5, celles d’étudiants dirigés par M. Khanoussi à Dougga ou à Uchi Maius6, la synthèse préliminaire sur le Nord tunisien de A. Chouchane (Diplôme d’Études Approfondies de l’Université de Bordeaux 3) ou bien les restaurations récentes et en cours de l’aqueduc de Carthage…
1. Cf. Polybe, XV, 5-6 ; Tite-Live, XXX, 29, 9-10 ; Appien, Libyca 40.2. Par exemple Slim et al. 2003, p. 236-244.3. mrabet 1992-1993.4. leveau, Paillet 1976.5. ben HaSSen, maurin (dir.) 1998, p. 189-204 et CHouCHane,
texier 2004.6. KHanouSSi, maStino 1997, p. 31-34.
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE).
LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR
Ahmed Ferjaoui (Institut national du Patrimoine, Tunis)Jean-Marie Pailler (Université de Toulouse 2-le-Mirail [IUF], TRACES-UMR 5608, Toulouse)
Christian DarleS (École nationale supérieure d’architecture, Toulouse)Avec la collaboration de Jean-Louis borDeS (École centrale des Arts et Manufactures, Paris)
Regards croisés d’Orient et d’Occident. Les barrages dans l’Antiquité tardive, édités par François Baratte, Christian Julien Robin et Elsa Rocca, 2013 — p. 139-164
Figure 1 ‒ Situation de Zama, aujourd’hui le village de Jama, au cœur du territoire actuel de la Tunisie. Le site, à l’extré-mité nord-est du Jebel Massouge, domine la plaine de Siliana. [Cartographie : C. Darles]
140 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Lors d’une conférence (avril 2003) exposant nos travaux au gouvernorat de Siliana, devant un audi-toire d’ingénieurs et spécialistes en hydraulique, nous avons mesuré l’intérêt rencontré dans la région par cette confrontation de l’antique et de l’actuel.Comment les habitants d’une cité aussi importante
que Zama ont-ils réussi à répondre à tant de besoins malgré une situation naturelle peu favorable sur l’extrême avancée de la chaîne du Djebel Massouge ? Quelle maîtrise du territoire, de ses ressources, de son relief et de son climat une telle entreprise supposait-elle de leur part ? Quelles relations établir entre l’évolution du système d’adduction d’eau et l’histoire générale de la ville et de son territoire ? C’est en nous posant ces questions que nous avons été amenés à étudier dans son ensemble le problème de l’alimen-tation en eau de la ville, et plus particulièrement de la place qu’y a occupé un exceptionnel barrage de captage des eaux (figure 3).Avant le commencement de notre travail, on
savait seulement que le site de Jama (nom du village actuel) abritait, dans sa partie haute, trois très grandes citernes allongées et parallèles. Ces citernes étaient alimentées, semblait-il, par deux aqueducs, l’un provenant d’Aïn Slimane, l’autre d’Aïn Jebour. Les traces matérielles de ce réseau ont frappé depuis
longtemps l’imagination des habitants de Jama, puis-que en se fondant sur ces traces ils ont pu imaginer une légende expliquant le nom de la ville7. Pour ces habitants, le nom de Ja-ma est constitué de deux élé-ments : ja (geb), apporter, -ma, l’eau. Qui a apporté l’eau à Zama ? Deux prétendants qui voulaient épouser la plus belle fille du village. Elle a promis sa main à celui qui arriverait le premier. Le premier arrivé vient d’Aïn Jebour, mais il meurt d’épuisement (ou par suite d’une traîtrise…), tellement la route était longue et difficile : « Djemet geb el mê oue met » [« il ap-porte l’eau et sa propre mort »]… L’autre, venu d’Aïn Slimane, arrive second. Il a perdu la course, mais c’est lui qui épouse la plus belle fille de Jama.La ville est située dans un environnement kars-
tique de collines calcaires avec de nombreuses cultures dans les dépressions et dans la plaine de Siliana. Le massif calcaire est riche en sources sur les flancs du Jebel Massouge8, d’autres sont captées sous forme
7. Cf. le mémoire de DESS de S. Srarefi (en arabe) dirigé par A. Ferjaoui. Plusieurs habitants du village (Malika, Mohamed, Nour), que nous remercions, nous ont confié des variantes mineures de ce récit, dont des parallèles sont attestés ailleurs au Maghreb.
8. Voir la toponymie de la carte au 1 / 40 000e dressée dès 1922 par le Service Géographique de l’Armée.
Figure 2 ‒ Vue générale en direction du nord-est. Au premier plan, village de Jama situé sur une nécropole antique, les citernes antiques derrière les arbres, à l’arrière-plan, la maison de fouilles, en limite du site antique. [Cliché : C. Darles]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 141
de puits au centre de la dépression. Il existe égale-ment une source thermale. La pluviométrie oscille entre 200 et 500 mm, avec une moyenne pour Jama de 400 mm. Un système de captage et d’approvision-nement de certaines zones par aqueduc a été installé en 1903. Actuellement les sources sont contrôlées et plusieurs barrages collinaires ont été édifiés9. 600 à 700 km de conduites ont été réalisés dans la région, accompagnés de stations de pompage et de traitement des eaux10. La source de Jama elle-même est pérenne ; certainement très ancienne dans son utilisation, elle prend actuellement la forme d’un puits utilisé quoti-diennement par les habitants du village.À partir de l’époque de Zama Regia, capitale royale
des Numides, et surtout de la ville romaine, les sys-tèmes d’alimentation en eau d’une agglomération de plus en plus importante et peuplée se sont fondés sur les constats et les expériences des époques précé-dentes. En un mot, on est alors allé chercher l’eau là où l’on savait la trouver en abondance, pour alimenter les besoins de la cité. Nos recherches de ces dernières
9. Vingt-six barrages sur trente-cinq ont déjà été réalisés.10. On peut voir un état de la situation il y a plus d’un demi-siècle chez Joseph Tixeront (tixeront 1953).
années permettent de présenter de ces itinéraires de l’eau, envisagés dans la longue durée, une vision totalement renouvelée de part et d’autre du Djebel Massouge. Il est nécessaire de signaler l’élaboration durant les années vingt, par le Service géographique de l’Armée, d’une carte topographique (feuille XLVI-Siliana). Réalisée par des officiers topographes dès 1922, elle a été régulièrement complétée et sert encore de référence à sa dernière publication. Les ruines romaines sont indiquées ainsi que les sources et les puits. Force est de constater que l’occupation de ce territoire fertile a été particulièrement dense (et répartie de manière homogène) durant l’Antiquité bien plus qu’aujourd’hui où l’implantation de grands domaines agricoles a créé un remembrement im-portant et un regroupement généralisé de l’habitat (figure 4).
cartographIe commentée des ItInéraIres
L’importance des découvertes faites depuis plus de trois ans se mesure au simple examen comparé de l’état des connaissances avant le début de nos recherches et de l’idée que nous pouvons nous faire aujourd’hui de cette même question.
Figure 3 ‒ Vue générale du barrage d’Aïn Jebour depuis l’aval. [Cliché : C. Darles]
142 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Il y a quelques années n’étaient connus – maté-riellement – que les grandes citernes proches de la Maison de fouille, dans la ville haute, le superbe pont-aqueduc sur l’oued Krafès ainsi que, par bribes infimes, quelques tronçons visibles de deux aqueducs en contrebas de la ville antique ; on situait approxi-mativement le point de départ respectif de ces der-niers, grâce aux légendes locales dont il vient d’être question11.En 2005-2006, nous avons pu enrichir les connais-
sances relatives à l’approvisionnement antique en eau (figure 5). Ce ne sont pas moins de cinq, voire six aqueducs qui ont été clairement repérés sur le terrain et, en plusieurs points, entièrement mis au jour et fouillés ; le pont-aqueduc sur l’oued Krafès a donné lieu à une première étude détaillée. En amont, des aménagements de captage aussi spectaculaires que variés ont été identifiés, cartographiés, et ont fait l’objet d’un début d’étude approfondie. Le barrage d’Aïn Jebour, notamment, dont l’état de conservation est exceptionnel, ne connaît qu’un très petit nombre de parallèles dans le monde romain (Glanum, de rares
11. Cf. Pailler et al. 2005.
exemples en Espagne12 ou en Syrie13). En aval, nos investigations nous ont conduits à l’entrée de la ville antique, zone encore très mal connue dont cette recherche contribue à définir les contours. Deux des aqueducs, on le sait aujourd’hui (celui d’Aïn Jebour [C4, sans doute dédoublé en C6 en fin de parcours] et celui d’Aïn Ben Ali [C5]), aboutissaient aux grandes citernes à l’entrée de la ville haute, qui ont fait l’objet d’un examen architectural préliminaire. Au moins deux autres conduits (C1, C2, en provenance d’Aïn Slimane) semblent avoir débouché sur des structures de distribution situées à mi-pente. Un cinquième, de provenance encore inconnue mais certainement d’Aïn el Babouch (C3), peut avoir alimenté la ville basse.Ces résultats spectaculaires sont le fruit d’une
quadruple démarche d’enquête orale (laquelle pour-rait bien laisser présager la découverte à venir d’au moins un nouvel aqueduc), de prospection systé-matique de terrain (on notera que le ravinement et le creusement d’oueds depuis l’époque antique ont livré plusieurs fois des coupes révélatrices), de fouilles localisées et de topographie générale des
12. GorGeS, riCo 1999.13. Calvet, Geyer 1992.
Figure 4 ‒ Extrait de la carte d’état major actuelle fondée sur la première carte éditée en 1922 par le Service géographique de l’Armée française. Les ruines antiques sont indiquées avec la mention RR. L’implantation du barrage est indiquée par un point noir. Le quadrillage est kilométrique.
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 143
secteurs concernés. Les tracés, là où ils sont connus, sont désormais positionnés par rapport aux courbes de niveau. Vu leur faible pente, et comme on pouvait s’y attendre, ils respectent l’allure générale de ces courbes. Là où ce n’est pas le cas, deux explications peuvent se présenter : rupture de pente délibérée de la conduite (par exemple avec la chute d’eau du conduit à l’entrée du pont sur l’oued Krafès), modifi-cation des reliefs sous l’action de l’homme et de la nature depuis l’Antiquité.
Captages et itinéraires : vue d’ensemble
D’où provenaient ces aqueducs ? Plusieurs pros-pections sur le terrain ont permis de repérer certains éléments de leur tracé. On est ainsi conduit à remon-ter jusque vers la source principale d’Aïn Slimane, à 5 km à vol d’oiseau au sud-ouest de Zama, sur le versant sud du Djebel Massouge, où ont été retrouvés des éléments de rigoles de captage creusées dans le rocher. Ces rigoles paraissent avoir abouti à un grand bassin de décantation et de distribution occulté par des installations modernes. De là, un aqueduc doublé dans un second temps (C1-C2) partait en direction d’une zone relativement basse de la ville antique.
Sur le même versant, un autre aqueduc (C5) trouvait sa source à Aïn Ben Ali, à 9 km de Zama, et passait au dessus d’Aïn Slimane. Nous en avons trouvé plusieurs traces, éléments de canalisation et ponts sur deux oueds, qui n’ont pas encore été étudiées. Cette cana-lisation supérieure C5 aboutissait sans nul doute aux grandes citernes de Jama (figure 6).Ces citernes, nous le savons par la légende comme
par la prospection de terrain, étaient également ali-mentées à partir d’Aïn Jebour, à 10 km à vol d’oiseau de Zama, au sud-ouest, sur le versant nord du Djebel Massouge. À mi-chemin, l’élément spectaculaire connu depuis longtemps est le franchissement de l’oued Krafès. En amont comme en aval de ce pont, des élé-ments du tracé de l’aqueduc ont pu être reconnus : dalles de canalisation, tronçons de tunnel, passage de l’aqueduc sur au moins un autre pont dont il reste plusieurs piles (figure 7).L’aqueduc C4 a son point de départ à Aïn Jebour à
750 m d’altitude environ. Ce nom désigne en fait un ensemble de sources situées en contrebas du massif, sur son versant nord. À cet endroit aboutissent à la fois deux oueds, les eaux provenant de sources vauclu-siennes situées plus haut sur le versant et les eaux de ruissellement de surface du bassin versant. C’est en
Figure 5 ‒ Carte des 6 aqueducs alimentant Zama à partir des sources dispersées sur les flancs externes du Jebel Massouge. Les étoiles indiquent les monuments cités dans le texte. [Cartographie : C. Darles]
144 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Figure 6 ‒ Vue des citernes en direction du sud-est. [Cliché : C. Darles]
Figure 7 ‒ Vue du pont-aqueduc au-dessus de l’oued Krafès depuis le nord-est : le « pont de Krafès ». [Cliché : C. Darles]
Figure 8 ‒ Vue du pont-aqueduc au départ de l’aqueduc C4, en direction de l’ouest depuis l’aval du thalweg : le « pont d’Aïn Jebour ». [Cliché : C. Darles]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 145
ce point qu’a été placé le captage romain, qui a permis de recueillir, de stocker temporairement, de décanter (avec évacuation par un déversoir en cas de trop-plein) et d’expédier les eaux en direction de la ville. Le premier tronçon de l’aqueduc partant du barrage est particulièrement remarquable : il est construit sur le versant en forte pente de la partie basse de la vallée et se poursuit par un passage sur les piles d’un pont construit dans un surplomb impressionnant (figure 8).À l’emplacement du captage, à Aïn Jebour, un
barrage a été édifié. Son rôle semble résider moins dans la retenue d’eau – un objectif certes bien réel – que dans la collecte de plusieurs sources vauclusiennes et de différentes eaux de ruissellement.
Le barrage d’aïn djebour
Cette construction, repérée comme « Ruine Ro-maine » (RR) sur la carte topographique élaborée en 1922, n’avait fait, jusqu’à ce jour, l’objet d’aucune étude. Cet ensemble monumental construit en grand appareil mesure plus de 30 m de long en travers d’un petit vallon, il est large à sa base de plus de 7 m et haut de près de 6 m (figure 9). Il a été procédé au
relevé architectural du monument, en plan et en coupe. L’ensemble du vallon a été topographié de manière à être modélisé en parallèle avec l’étude constructive de l’édifice.
L’implantation
Le barrage, parfaitement orienté ouest / est, est situé en travers d’un thalweg descendant de la dépres-sion cultivée qui sépare les deux crêtes du Jebel Massouge traversé par la route qui mène de Siliana à Sidi Bourouis. L’ouvrage d’art destiné à la collecte d’une quantité maximale d’eau est situé à la rupture de pente de cette petite vallée qui domine en balcon les zones cultivées situées plus au nord du Jebel. L’eau est pérenne et de multiples provenances. Cette petite vallée sud-nord récupère les eaux de ruissellement du bassin versant14 et celles d’un puits où l’eau affleure
14. Le bassin versant a une superficie relativement restreinte de moins de 2 km2, insuffisante pour l’alimentation d’un aqueduc. Ce sont avant tout les résurgences qui pro-duisent des eaux pérennes en provenance de tout l’en-semble karstique que représente le Jebel Massouge.
Figure 9 ‒ Vue actuelle du barrage depuis l’aval. On peut constater la permanence du flot torrentiel. [Cliché : C. Darles]
146 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Figure 10 ‒ Élévation du barrage droit que nous considérons comme primitif, implanté sur des strates de calcaire fortement inclinées. On peut observer d’importantes concrétions à hauteur du sommet de l’édifice qui indiquent bien la hauteur du remplissage en eau du bassin arrière. [Cliché : C. Darles]
en permanence. L’inclinaison des couches géologiques est double, d’une part vers l’est, d’autre part vers le sud. Ainsi tout le ruissellement de la rive gauche se déverse dans le ruisseau qui plus bas recueille les eaux d’un affluent venu de l’ouest. À une centaine de mètres en amont se situent les lieux d’extraction de la pierre ainsi qu’un petit établissement antique lié sans nul doute à cette activité.
Le bâti conservé et son état
D’ouest en est le barrage est constitué d’un pre-mier mur linéaire en grand appareil de 3 m de haut, conservé sur une longueur de 15 m environ (figure 10). Ensuite une « cavea » comprenant quinze assises forme un arc de cercle d’un diamètre de 21 m en partie haute et de 13 m en partie basse. La paroi courbe du barrage est conservée sur une hauteur de 5,50 m. Elle a été arrachée dans sa partie orientale par le tor-rent. On peut restituer l’ensemble bâti qui rejoignait les strates de calcaire de la rive droite. Les sédiments
ont (petit à petit ?) comblé la retenue du barrage en créant derrière lui une plate-forme de plus de 35 m de long. Le torrent l’ayant entaillée par la suite jusqu’au substrat rocheux, nous sommes en présence d’une coupe parfaite et précieuse pour la compré-hension de la structure interne du mur comme pour la composition et la mise en œuvre de son parement. Le sommet du barrage est lui-même composé par la maçonnerie de la conduite de l’aqueduc, tranchée actuellement par le torrent. Le processus de collu-vionnement est ici particulièrement lisible. Au sud, de grandes dalles taillées, qui correspondent au fond du specus de l’aqueduc, parsèment le fond du thalweg. Ces dalles proviennent de carrières situées à quelques centaines de mètres en amont, au bord du torrent, sur les deux rives (figure 11). De nombreuses traces d’emboîtures indiquent l’utilisation fonction-nelle de ces blocs directement issus des fronts de taille de l’exploitation où la roche est généralement débitée en dalles dont l’épaisseur correspond à celle des strates de calcaire (figure 12).
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 147
Figure 11 ‒ Une des carrières situées au-dessus du site du barrage. La régularité des strates a favorisé l’exploitation permanente de ces carrières locales durant l’Antiquité. [Cliché : C. Darles]
Figure 12 ‒ La roche est utilisée dans-œuvre avec un minimum de travail de préparation. Les traces d’emboitures pour les coins qui ont servi à l’extraction sont toujours visibles. Il faut noter que ces blocs ont été mis en œuvre en inversant le sens d’extraction : le haut se retrouve en position inférieure. [Cliché : C. Darles]
148 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Un édifice fonctionnel
Peu de barrages antiques ont été repérés et les dernières recherches d’ensemble n’ont pas beaucoup étendu le corpus15. Il est donc tentant de qualifier cet édifice de « premier barrage-voûte conservé de l’histoire des techniques »16. L’emplacement a été choisi avec discernement. Ce petit vallon, comme on l’a vu, reçoit à la fois les eaux pérennes qui viennent d’un puits manifestement antique situé en partie supérieure du torrent oriental, celles de plusieurs sources vau-clusiennes, ainsi que de nombreux ruissellements
15. SmitH 1971.16. Par allusion au titre du bel article de S. Agusta-Boularot et J.-L. Paillet, « Le barrage et l’aqueduc occidental de Glanum : le premier barrage-voûte de l’histoire des techniques ? (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France) » : aGuSta-boularot, Paillet 1998. Ce dernier barrage ne subsiste en effet, selon les auteurs, qu’à travers des relevés anciens et sous la forme de maigres « traces de vestiges » (p. 128), essentiellement d’ancrages dans les parois rocheu-ses. L’étude date ce barrage de l’époque augustéenne. Le barrage d’Aïn Jebour, quant à lui, semble être en tout cas le premier « barrage à gradins » connu.
de pente guidés par les canalisations naturelles que forment les strates inclinées en dévers. De plus, de nombreux petits ruisseaux se jettent dans ce torrent ; les paysans, encore de nos jours, en calment le flot tumultueux par de petits seuils bâtis qui assagissent la descente des eaux lors des orages et en période de grandes pluies et de crues17 (figure 13).
On peut ainsi constater une multiplicité d’apports d’eaux dans ce bassin de retenue dont le rôle de décantation est, dans un premier temps, nécessaire et important. Cette eau est également « stockée » de manière à fournir avec régularité un débit permanent à l’aqueduc, On peut estimer à 3 000 m3 le volume de ce stockage. En cas de trop forte montée des eaux, un déversoir de trop-plein est aménagé18. Comme
17. Nous pensons que ces crues, peut-être relativement fréquentes, peuvent être très violentes. Vu la pente très forte du thalweg principal, elles ont provoqué sans nul doute des dégâts importants au monument.
18. Ce déversoir fonctionnait également quand, pour une raison ou une autre, le débit de l’aqueduc était inférieur à celui des différents captages cumulés qui remplissaient le réservoir du barrage.
Figure 13 ‒ Vision du site au moment de sa redécouverte ; on peut évaluer le bassin arrière aujourd’hui colmaté par les colluvions. L’ensemble a été tranché par le torrent offrant une coupe naturelle de l’ouvrage. [Cliché : C. Darles]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 149
Figure 14 ‒ Vue rapprochée de la coupe du barrage, résultat de l’arrachement de sa partie droite par les flots. On peut distinguer parfaitement le départ de l’aqueduc C4. [Cliché : C. Darles]
nous l’avons dit, et comme cela apparaît sur la figure (figure 14), l’ensemble du monument est actuelle-ment dissymétrique. Si, sur la rive droite, la voûte de l’édifice semble avoir été ancrée dans la roche, sur la rive gauche, la partie voûtée se raccorde non au substrat rocheux de la rive mais à un mur rectiligne en grand appareil qui barre partiellement la petite vallée de ce côté. Nous n’aurions donc pas un véri-table barrage-voûte, au sens très précis du terme, dont la caractéristique est de solliciter les parois naturelles de la vallée dans la tenue de l’édifice. Il s’agirait d’un « barrage-poids voûté ». Peut-être faut-il restituer pour cet ensemble deux états successifs. Le mur droit serait ainsi le vestige d’un premier barrage-poids effondré, et consolidé ultérieurement par un ouvrage en arc de cercle. Selon Jean-Louis Bordes, le réservoir en amont du barrage a pu se remplir très rapidement d’alluvions, ce qui n’aurait pas empêché la percolation de l’eau à travers ces sédiments afin d’alimenter l’aqueduc suffisamment. De nombreuses concrétions indiquent que l’eau n’a jamais cessé de s’infiltrer dans ce monument, en provenance du réservoir arrière (figure 15). Nous pouvons également considérer cet ouvrage comme
un barrage submersible car le problème majeur du site est la protection (donc la sauvegarde) de la structure contre les crues qui peuvent être violentes. La forme circulaire, selon J.-L. Bordes, permettrait donc « d’augmenter la longueur de déversement et de diminuer ainsi la hauteur de la lame déversante à débit égal » (figure 16). Cependant nous ne pouvons absolument pas éliminer la tentative par les bâtisseurs de pallier les destructions successives en mettant en œuvre une construction, différente du premier barrage rectiligne, pour consolider l’ouvrage par une meilleure répartition de ses appuis sur le substrat rocheux19. Le barrage, dans sa complexité actuelle, n’a donc pas encore livré tous ses secrets, qu’une ultime campagne permettrait peut-être de mettre au jour. Nous pouvons néanmoins proposer une chronologie relative de ce monument (figure 17).
19. L’inclinaison des strates de calcaire du sud-ouest vers le nord-est crée une dissymétrie dans la coupe naturelle de cette petite vallée. De ce fait la partie occidentale, la rive gauche, est peu profonde et moins soumise à l’effet dévas-tateur des flots. Nous avons ici une des preuves de l’anté-riorité de la partie droite du barrage sur sa partie courbe.
150 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Figure 15 ‒ Au pied du barrage courbe, la présence de nombreuses concrétions indique la perméabilité de l’ouvrage tout au long de son histoire. [Cliché : C. Darles]
Figure 16 ‒ Les assises du barrage, implantées selon un plan circulaire, s’alignent parfaitement avec les strates rocheuses auxquelles elles étaient liées. [Cliché : C. Darles]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 151
Figure 17 ‒ Proposition d’une chronologie relative des différents états constructifs du monument. 1 : vue vers le sud, le torrent dans son environnement calcaire aux strates inclinées vers l’est. 2 : création d’un premier barrage droit avec captage et approvision-nement de l’aqueduc. 3 : mise en place d’un exutoire permettant le contrôle du trop plein en période normale (le barrage est submersible en cas de crues). 4 : destruction du barrage droit, le torrent retrouve sa place initiale. 5 : construction du barrage courbe dans la zone la plus fragile (est). 6 : mise en place d’un deuxième déversoir pour évacuer les eaux en surplus. 7 : arrachement par le torrent de la partie orientale de ce barrage. 8 : coupe de principe et plan de l’état actuel. [Schémas : C. Darles]
152 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Morphologie de l’ensemble
Cet ouvrage d’art mesure plus de 35 m dans son état actuel. Le mur occidental, parementé en grand appareil, occupe la moitié de la longueur totale alors que le barrage-voûte occupe l’autre. Au total, la lon-gueur de l’édifice restitué ne devait guère dépasser 45 m (figure 18). À l’arrière du barrage et transversale-ment à celui-ci, la maçonnerie du canal de l’aqueduc en constitue la partie supérieure. Le fond du conduit est bâti avec des dalles de 2,25 m de long par 0,75 m pour une épaisseur de 0,35 m. Une cunette longitu-dinale est creusée dans son axe. Les extrémités sont taillées de manière à s’emboîter (figure 19). Ces dalles sont posées sur un massif maçonné. Le piédroit arrière de la canalisation a été construit lors de la même phase dans un deuxième temps. Percé en divers endroits, il permettait sans doute d’équilibrer en permanence les niveaux des eaux de la retenue et celui de la canalisation ou, du moins, dans le cas d’un remplissage de la retenue par les alluvions, comme le précise J.-L. Bordes, de permettre la percolation de l’eau20 (figure 20). L’assise no 13 du parement du barrage-voûte continue en profondeur pour consti-tuer la dalle de couverture du canal. La dalle du fond
20. Contrairement à d’autres barrages de l’Antiquité tardive connus en Syrie ou au Yémen, le barrage d’Aïn Jebour ne comporterait pas à sa base de dispositif de vidange néces-saire à l’évacuation des sédiments. Certes la partie orien-tale du monument a disparu et il serait légitime de situer ce regard de vidange à cet emplacement, là où le barrage est le plus haut et où le réservoir est le plus profond.
Figure 19 ‒ Coupe du départ de l’aqueduc C4 montrant les pié-droits maçonnés, la dalle du fond du canal et les concrétions inhérentes au karst calcaire. Ces concrétions indiquent que les eaux qui passent dans le conduit ont déjà été partiellement ou même totalement dégagées. [Cliché : C. Darles]
Figure 18 ‒ Plan topographique et architectural du barrage d’Aïn Jebour. [Mission archéologique tuniso-française, 2003]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 153
Figure 20 ‒ Coupes de principe du barrage d’Aïn Jebour. En haut l’état actuel, en bas le principe de fonctionnement, hors de tout colluvionnement. Selon J.-L. Bordes, le barrage, une fois son bassin colmaté, a pu fonctionner également sans aucun problème par percolation à travers les sédiments accumulés. [Dessins : C. Darles]
154 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
du specus est à la même altitude que le sommet de la septième assise. Le volume situé en-dessous de cette assise permettait la décantation de l’eau destinée à l’approvisionnement de Zama. Le parement du barrage est constitué de grandes dalles de longueur variable, parfois plus de 2 m et de 0,75 à 0,85 m de profondeur pour une hauteur d’assise de 0,30 m environ. Ces dalles sont fortement érodées, partiel-lement desquamées, et leur tranche visible conser-vait initialement un bossage d’économie entre deux ciselures horizontales. Elles sont très légèrement inclinées vers l’arrière, se mettant, de par la pression de l’ensemble, en situation autobloquante.
Quelques remarques sur le barrage et sa conservation
Les deux trop-pleins au sud semblent bien corres-pondre aux deux états successifs et hypothétiques du barrage. Le premier est en étroite liaison avec les blocs de grand appareil du mur droit et paraît se déverser dans un exutoire qui récupère également une source secondaire. Le deuxième déversoir, sous forme de canal tangent à la composition architectu-rale du barrage-voûte, présente des concrétions de type lagunaire qui indiquent bien un rôle dans l’évacuation laminaire des eaux (figure 21). Le volume de la rete-nue est faible et ne représente que 6 % au maximum des apports moyens d’une seule année ; la grande majorité de l’eau est de ce fait dérivée vers l’aqueduc soit directement soit par l’intermédiaire du piédroit amont dont le mortier serait poreux. Un débit de quelques litres par seconde pourrait être collecté ainsi sans difficulté. La surface drainante serait de l’ordre de 40 m2 soit pour 10 l/s (un maximum du débit des sources), 0,30 l/s/m2 (données J.-L. Bordes).
L’aqueduc c4 en provenance d’aïn jebour, versant nord du djebeL massouge
Le tracé repéré de l’aqueduc C4 se résume principa-lement à quelques tronçons et ouvrages d’art. À 20 m du barrage une portion encore voûtée est visible et on trouve, plus loin encore, le fond monolithe d’un regard circulaire de près de 1,50 m de diamètre qui permettait un changement de direction à 90°.
Le franchissement d’un torrent à 150 m du captage
Le pont est installé au dessus d’un petit torrent qui coule dans un thalweg escarpé et fortement pentu. Une grande pile (pile 6), partiellement détruite, est visible de la piste qui passe en contrebas. Située sur la rive gauche, elle possède un arrière bec (figure 22).
De nombreux blocs taillés et des ensembles maçonnés jonchent le fond du ravin. Trois autres vestiges de piles (piles 7, 8 et 9), conservées sur quelques assises, sont fortement inclinés. Celle de la rive droite repose sur un substrat rocheux de type marne qui est forte-ment érodé en aval par les remous de l’eau.
Le bâti conservé et son état
Seule, à ce jour, une brève étude a pu être consacrée aux vestiges de cet ouvrage d’art qui, après restitu-tion, devait comporter environ une dizaine d’arches (figure 23). Quatre piles sont conservées partielle-ment. En contrebas, dans le lit du torrent, un massif de cinq assises s’est éboulé en se renversant. Le départ aval de la canalisation (culée nord) est connu comme le niveau de passage de l’eau du torrent enjambé. Le fond du canal est constitué de dalles de pierre de 2,20 m de long, 0,75 m de large et 0,35 m d’épaisseur, avec une cunette longitudinale. Elles sont semblables à toutes celles que nous avons rencontrées aux alen-tours du barrage d’Aïn Jebour ou, plus loin, au fran-chissement de l’oued Krafès par le même aqueduc. Malgré l’absence actuelle de levé topographique, il est possible de reconstituer le monument et sa hauteur initiale qui avoisinait 11 m alors que sa longueur dépassait les quarante mètres.
Morphologie de l’ensemble
Le pont mesure 1,80 m de large, soit 6 pieds romains. Les piles ne sont, elles, larges que de 1,25 à 1,30 m (6 pieds environ) avec un espacement de 2,10 m (7 pieds environ) soit une dimension équivalente à celle des vides entre les piles du pont de Krafès. Les blocs mesurent 0,60 m à 0,65 m de large pour des longueurs variables de 1,30 m à 1,80 m, les assises mesurent 0,35 m de haut en moyenne, cette mesure variant en fonction des matériaux extraits. La pile 9, reconnue la plus en aval, sur la rive droite, ne comporte que deux assises qui correspondent au deuxième niveau du soubassement. La précédente (pile 8) comporte cinq assises fortement inclinées vers le fond du thalweg. Elles correspondent au même deuxième niveau du soubassement. La pile 7, qui borde le torrent sur sa rive droite, comporte six assises du premier niveau de soubassement. L’érosion par le torrent et ses crues a sapé la base de cette pile qui a ripé et qui a tendance à se coucher contre le flanc de la rive. Au dessus, quatre assises du deuxième niveau de soubassement sont encore en place quoique descel-lées. La dimension de ces soubassements est de 1,50 par 2,10 m environ, soit en débord de 0,15 m par rapport à l’élévation des piles. La pile 6, de la rive gauche, est constituée de cinq strates de construction en-dessous de la maçonnerie de la canalisation.
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 155
Figure 21 ‒ Les dépots lagunaires du déversoir correspondant à la deuxième phase (barrage-voûte) semblent indiquer une période durant laquelle le trop-plein fonctionnait épisodi-quement de manière calme. [Cliché : C. Darles]
Figure 22 ‒ La pile 6 du pont-aqueduc près du barrage d’Aïn Jebour. Elle possède un arrière-bec important qui permettait également à l’ouvrage de mieux se stabiliser sur cette
pente raide. [Cliché : C. Darles]
Figure 23 ‒ Restitution du pont d’après les niveaux et l’emplacement de l’arrivée du canal ainsi que son départ. L’ouvrage possédait 10 piles et 11 arches. Il s’élevait à plus de 10 m au-dessus du fond du thalweg. [Dessins : C. Darles]
156 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
De bas en haut, on trouve, au-dessus de la fonda-tion, un premier niveau de soubassement de neuf assises qui constitue ici un arrière-bec, pour protéger la paroi sud du ravin comme au franchissement de l’oued Krafès. Ce soubassement est lié au seuil de passage du torrent qui devait être liaisonné à la pile 7. Au dessus, le deuxième niveau du soubassement, avec quatre assises de 0,50 m de haut. L’assise du bas se compose de six blocs disposés dans le sens longitu-dinal du pont ; les deux suivantes comportent chacune quatre blocs disposés transversalement. L’assise supé-rieure se compose de six blocs longitudinaux. La pile, d’une section de 1,30 m sur 1,80 m, est constituée de seize assises, alternativement de quatre et de six blocs. Elle est couronnée par une assise en saillie faisant sommier pour le départ de l’arc. Il ne reste, sur trois assises, que quelques blocs de l’écoinçon du niveau des arcades. La particularité de cet ensemble consiste dans la présence d’un arrière-bec destiné à protéger la pile de la rive gauche contre la dégradation liée aux tourbillons de l’eau de ruissellement. La pile 7 de la rive opposée ne comporterait pas, en attente de nettoyages et de dégagements, le même dispositif de protection. Faut-il voir là une des causes de la destruction ?
Les techniques de construction
La taille des blocs est semblable à celle décrite ci-dessous pour le pont du franchissement de l’oued Krafès (voir ci-dessous). Le bossage d’économie corres-pond à un simple rafraîchissement des traces d’extrac-tion. On distingue sur chaque bloc les emboîtures des coins qui ont permis de détacher les dalles de pierre sur leur arrière, traces que l’on retrouve également en carrière à quelques centaines de mètres au dessus du site. Il est nécessaire de noter, sur l’ensemble du parcours de l’aqueduc C4, la particularité de la pose
Figure 24 ‒ Le franchissement de l’oued Krafès par le pont-aqueduc. Cet ouvrage avait pour objectif ambitieux de raccourcir la longueur de l’aqueduc avant son arrivée à Zama. [Cliché : C. Darles]
de ces blocs : même s’ils sont convenablement dispo-sés en lit, celui dit d’attente correspond à la sous face des blocs extraits. Le carrier a exécuté une première saignée de 8 cm au fond de laquelle sont réalisées des emboîtures d’une profondeur équivalente. Ainsi il a déjà atteint la moitié de l’épaisseur de la dalle à extraire. Plus tard, à pied d’œuvre, sont ménagées des ciselures périphériques grossières qui seront reprises au ciseau avant la pose définitive des blocs. Le terrain naturel n’est pas suffisamment homogène pour recevoir des charges ponctuelles aussi impor-tantes. De plus le calcaire se desquame, se délite puis se transforme en particules fines qui se mélangent avec les couches de marnes.
Le franchissement de l’oued Krafès : « le Pont de Krafès »
Historique des études et de la connaissance de l’ouvrage
Le premier signalement détaillé de ce pont, dû à P. Gauckler d’une part21, et de l’autre à J. Poinssot, révèle l’état du vestige à la charnière du xixe et du xxe siècles.
Étude architecturale des vestiges archéologiques en élévation
Ce pont est sensiblement orienté ouest-est, au-dessus de l’oued qui coule en provenance du sud (figure 24). Le contexte géologique nous situe dans un environnement essentiellement calcaire avec alternance de couches de marne. La roche est sédi-mentée en strates peu épaisses inclinées vers l’ouest.
21. GauCKler 1902-1912, p. 372-373.
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 157
Figure 25 ‒ Vue depuis l’amont du pont de Krafès.[Cliché : C. Darles]
Elles sont fracturées par un réseau de lithoclases perpendiculaires qui les font ressembler à un dallage carrelé. Le régime torrentiel de l’oued met en danger l’ouvrage qui présente actuellement de nombreux signes de désordre.
L’étude du pont, une question de méthodologie
Cet ouvrage de génie civil ne peut être étudié sans, d’une part, une réflexion typologique sur l’ensemble des édifices liés aux franchissements des vallons, d’autre part une évaluation des techniques construc-tives des ouvrages d’art liés à l’approvisionnement en eau de la ville antique de Zama. Ce travail est égale-ment à resituer dans une approche environnemen-tale et topographique plus vaste (figure 25). Dans un premier temps quatre objectifs majeurs ont été fixés : faire un relevé graphique de l’édifice, étudier les techniques de construction, replacer ce pont dans l’ensemble des structures et autres aménagements hydrauliques de Zama, enfin proposer des scénarios de restauration et de mise en valeur. Un dessin de l’ouvrage restitué a été réalisé en tenant compte de l’emplacement connu de l’arrivée de la canalisation sur le pont et de son exutoire. Cette approche gra-phique a permis de proposer, dans un premier temps, la restitution d’un pont à vingt-trois arches. L’étude des blocs employés dans cet édifice a été commencée
et permet d’avancer quelques hypothèses sur les tech-niques constructives, sur les stratégies de chantier ainsi que sur l’élaboration du projet architectural (figure 26).
Le bâti conservé et son état
Le bâti est conservé sur une hauteur de plus de 18,50 m. Les piles 6 et 7 appuyées sur le versant forte-ment en pente de la rive gauche ne conservent que des vestiges de leurs cinq premières assises (figure 27). La pile 7 est couchée vers l’amont le long du torrent, les blocs sont aisément identifiables et l’ensemble restituable. L’oued passe entre les piles 7 et 8 ; la pile 7 n’a plus que six assises fortement dégradées, alors que la pile 8 mesure encore 9,25 m de haut. Sur 2,75 m les dix dernières assises menacent de s’écrouler d’autant plus que l’ensemble de cet ouvrage s’incline sensible-ment vers l’ouest. Les piles 9 et 10 sont les plus majestueuses et s’élèvent respectivement sur 13,50 m et 13,25 m. Leur hauteur par rapport à la base du pont (niveau du ruisseau) est de 15,60 m et 18,50 m. La pile 11 est conservée sur 4 m de haut et la pile 12, qui semble se détériorer rapidement, ne comporte plus qu’un nucleus de quatre assises sur une hauteur de 1 m. Les autres piles aval sont soit conservées sur une assise soit se laissent deviner par la présence de blocs de construction.
158 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Figure 26 ‒ Le pont-aqueduc à la fin du xixe s. tel que Gauckler nous le présente [GauCKler 1902-1912, fig. XXVII] ; en parallèle son état au début du xxie s. [Dessin : C. Darles]
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 159
Morphologie du pont
Cet ensemble homogène qui ne semble pas avoir connu de phase de réfection importante entre dans une logique territoriale dont le franchissement de l’oued Krafès à cet emplacement précis est dû à plu-sieurs facteurs : le maintien d’une pente régulière et suffisante et la maîtrise du linéaire en tenant compte des altimétries. La chute du specus, en amont, de l’ordre de 0,95 m, fait sans doute partie des dispositifs de contrôle d’écoulement de l’eau, dispositifs assez souvent attestés en amont d’autres ponts-aqueducs (figure 28).La composition et la conception initiales de l’édi-
fice doivent correspondre à des « cartons ». Le pied romain de 0,296 m est sans nul doute l’unité de mesure ; de même, les proportions entre les espace-ments et les hauteurs correspondent à des rapports simples : les piles mesurent 6 pieds sur 8 et l’espace-ment entre deux piles est de 7 pieds. La hauteur de l’arche la plus haute (entre les piles 7 et 8) corres-pond à 47 pieds.La structure se décompose en onze strates : un sou-
bassement de calage de l’édifice avec, ultérieurement, une implantation intermédiaire de plates-formes de raidissement, cinq à sept assises de réglage, un corps de pile de dix-huit à dix-neuf assises, une assise de réglage en léger débord qui fait sommier, huit assises d’un appareil plus sophistiqué percées par les arches basses, deux assises de grand appareil, plusieurs autres dont cinq conservées correspondant aux piles de l’arche supérieure. À cela devaient se superposer : une assise de nivellement, le sommier pour l’arc supérieur, les assises et les claveaux de l’arche supé-rieure, deux ( ?) assises sommitales portant le conduit de l’aqueduc avec son specus, ses pieds droits et sa couverture.
Figure 27 ‒ Restitution du pont-aqueduc dans son état primitif. [Dessin : C. Darles]
Figure 28 ‒ Chute de plus d’un mètre située à l’arrivée de l’aque-duc sur le pont. Elle permettait de calmer le flot en le rendant plus laminaire ; elle témoigne également des difficultés ren-contrées par les topographes et les bâtisseurs de l’Antiquité pour élaborer un ouvrage d’acheminement de l’eau avec une pente régulière et contrôlée. [Cliché : C. Darles]
160 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Les techniques de construction
Les blocs présentent, en parement, des traces d’extraction au moyen de coins et de paumelles métal-liques. Des traces d’outils comme le pic de carrier sont encore visibles sur les faces des blocs mis en œuvre, malgré leur détérioration. D’autres empreintes de marteau taillant et de ciseau de 24 mm sont également perceptibles. L’étude métrologique des blocs reste à faire, mais les principes constructifs de cet ouvrage d’art sont homogènes. Les blocs employés sont des dalles dont la hauteur d’assise correspond aux lits d’extraction. Quelques boutisses sont posées en délit. Elles permettent la maîtrise de la construction en besace. Les pierres utilisées sont en général des mono-lithes faisant la totalité de la largeur des piles. Le bossage d’économie est réalisé à pied d’œuvre par un dégrossissage rapide à la pointe et les ciselures périmétriques (4,5 cm) se font en deux temps : à la pointe (ou au marteau taillant) puis au ciseau de 24 mm. La face visible correspond au plan de détache-ment vertical arrière des blocs en carrière. Les traces des emboîtures d’extraction sont disposées tous les 17 cm et profondes de 3 à 5 cm pour une ouverture de 8 cm et une face arrière de 4,5 cm présentant les traces caractéristiques de l’outillage (fond en W). De nombreux trous de louve nous renseignent sur la présence et l’implantation des engins de levage.
Le temps du chantier
L’approvisionnement en matériaux de construc-tion a été partiellement effectué par l’ouest en ce qui concerne les piles correspondant à la rive droite. Il est plus difficile d’apprécier les travaux sur la rive occidentale vu l’état actuel des vestiges des piles amont. Il est cependant légitime de penser que le chantier a pu fonctionner uniquement avec des infra-structures de chantier installées sur la rive droite de l’oued Krafès, beaucoup plus facile à aménager.La présence de plates-formes de consolidation,
implantées ultérieurement entre les piles 8 et 9, 9 et 10, et 10 et 11, ne peut pas être comprise comme la mise en œuvre d’espaces de travail, de stockage ou de manutention des blocs. Ces plates-formes intermédiaires ont été réalisées après le ravalement des blocs des piles. Il s’agit avant tout d’une mesure conservatoire pour éviter leur glissement et pour les solidariser entre elles afin d’éviter leur affaissement. En aval de l’aqueduc quelques sections de canalisations ont pu être identifiées. L’ouvrage lui même semble se diviser en deux branches au niveau d’un petit col qui surplombe au sud la ville antique. L’une de ces branches paraît passer sous le village actuel alors que l’autre prendrait la direction des grandes citernes toutes proches.
Remarque complémentaire sur la chute de la canalisation
Le rôle de la chute amont reste à définir. Cette chute, détruite récemment entre les deux dernières missions, peut avoir eu plusieurs rôles. Elle peut témoigner d’une modification de l’aqueduc. Elle doit plutôt correspondre à la volonté de calmer et de ralen-tir la vitesse de l’eau dans le canal. Il est pensable, si nous tenons compte de la pente, de la distance et du débouché de la canalisation en aval, que cette chute ait pu être dédoublée.
Reconnaissance du nouveau tracé
L’étude de la carte topographique de 1922-1930 a permis de contrôler de manière précise le tracé de l’aqueduc qui quitte un captage à 750 m d’altitude environ pour arriver aux alentours de 665 m (l’alti-tude de l’arrivée de l’eau dans les citernes reste à contrôler). La prospection et l’enquête orale ont permis de valider l’hypothèse de l’arrivée du canal depuis le nord. Le canal de l’aqueduc C4 a été identi-fié, grâce aux habitants, à l’ouest du village de Ouer-fellah, où la formation d’un profond oued moderne en révèle la coupe. Son parcours est désormais assuré et garanti jusqu’au pont (sans que des vestiges bâtis aient pu être reconnus).
L’arrivée de C4 (et C5) à Zama
Historique des études et de la connaissance de l’ouvrage
Cet historique reste à faire avec précision en reprenant les comptes rendus des premières explora-tions de la fin du xixe siècle. Il permettra de restituer l’évolution de l’ouvrage d’art, c’est-à-dire sa dégra-dation progressive, si apparente lorsqu’on compare les documents de P. Gauckler à ceux d’aujourd’hui. Le même historique donnerait également une idée de la manière dont l’image et l’interprétation du pont-aqueduc ont pu se modifier.
Étude archéologique du bâti et étude architecturale des vestiges des citernes
L’étude préliminaire des citernes de Zama s’est déroulée sur le terrain durant les deux missions d’avril et septembre 2003. Cet ensemble monumen-tal, implanté à l’altitude de 670 m, qui occupe plus d’un tiers d’hectare est connu depuis longtemps. Quatre grands murs définissent trois parcelles en légère déclivité généralement cultivées. L’ensemble est situé, en partie haute de la ville antique, à une des arrivées du système d’approvisionnement en eau
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 161
de Zama, à l’entrée de la ville antique. Quatre objectifs ont été fixés : faire un relevé graphique préliminaire de l’édifice en vue de son étude archéologique à venir, étudier les techniques de construction et les dispositifs architecturaux mis en œuvre, restituer la position de ce bâtiment dans la topographie générale à l’échelle du site et à celle du réseau hydraulique, proposer des scénarios de conservation et de mise en valeur. Après un relevé planimétrique et altimétrique des vestiges visibles de l’ouvrage, l’étude des techniques de construction employées dans cet édifice a été commencée ; elle permet d’avancer quelques hypo-thèses sur les techniques constructives, sur les straté-gies de chantier ainsi que sur l’élaboration du projet architectural. L’étude des vestiges a permis également de proposer, dans un premier temps, deux options de couverture. Les dernières recherches ont permis de mieux affiner la coupe des départs de voûte et ainsi de confirmer que chaque citerne était couverte en deux files.
L’implantation
L’ensemble des trois citernes visibles de Zama est situé à l’entrée de la ville antique à proximité de la maison de fouille. La superficie totale occupée est de 3 200 m2 environ, pour une longueur de 86 m et une largeur totale de 42 m. Les paysans du village cultivent actuellement les trois « parcelles » définies par les quatre grands murs qui constituent les longs pans
visibles des citernes. L’édifice est orienté dans le sens de la longueur dans la direction du nord magnétique avec un angle de 370 grades. Sa capacité a pu, hypo-thétiquement, avoisiner les 20 000 m3.
Le bâti conservé et son état
Les deux murs longitudinaux internes sont parfai-tement visibles et conservés sur une hauteur visible de 4 m environ, c’est-à-dire moins de la moitié de leur hauteur d’origine vraisemblable. Les murs no 3 et no 4 présentent des départs de voûte perpendiculaires significatifs. Les murs extérieurs, no 1 et no 4, ne sont connus que par leurs faces internes, excepté locale-ment pour le mur oriental. Entre les murs 1 et 2, un massif maçonné transversal témoigne de la présence du « mur pignon » méridional. Deux sondages effectués en septembre 2003 ont permis de définir l’emplace-ment du mur pignon nord-ouest. Ils ont également permis la découverte d’un canal d’alimentation appuyé, dans la citerne no 1, contre ce mur pignon à hauteur de la naissance des voûtes de couverture.
Morphologie de l’ensemble
Il s’agit de trois grandes citernes accolées (figure 29), définies par quatre murs, en opus caementicium pare-menté en petit appareil, parfaitement recouverts par un enduit étanche en opus signinum. La restitution de l’ensemble, avec l’étude de la courbure des voûtes,
Figure 29 ‒ Les citernes 1 et 2 à l’entrée de la ville antique de Zama. [Cliché : C. Darles]
162 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Figure 30 ‒ La citerne 3 avec ses 20 réservoirs transversaux servant à la décantation de l’eau amenée par les aqueducs.[Cliché : C. Darles]
permet de proposer une couverture voûtée et une file de points d’appui intermédiaire qui permet la mise en œuvre d’une architrave transversale22. La citerne 3 est différente avec la présence dans les murs 3 et 4 d’arcs, de tympans et de départs de voûtes, rendus étanches par la mise en œuvre de mortier de tuileau. Ces éléments indiquent l’existence de citernes trans-versales juxtaposées, au nombre de 20. Situées à un étage inférieur, ces citernes devaient être en commu-nication par leur sommet avec le grand volume longitudinal et avoir une fonction de décantation. La citerne 3 semble donc avoir un double rôle de stockage et de régulation pour l’approvisionnement en eau de la ville. Nous proposons également (hypo-thèse à vérifier par des fouilles archéologiques) de considérer que ces citernes étaient en communication par un système d’échelonnement qui contribuait à la décantation.
22. L’existence de citernes à piliers est attestée autant à Alexandrie (citerne tardive d’El Nabih, citerne de Yeretaban Sarayi avec ses 336 colonnes), ou dans les citernes de Bararus-Rougga (Slim et al. 2003), que dans la « piscina Mirabilis » de Misène (48 piliers) qui offrait la particularité de posséder un vaisseau plus profond afin de pouvoir vidanger l’ensemble.
Remarques sur leur fonctionnement
- La citerne no 3 (figure 30) :Cette citerne, située à l’arrivée des aqueducs, semble donc bien avoir eu un rôle de décantation. L’intrados des citernes transversales comporte une deuxième couche de mortier étanche, ce qui indique qu’elles étaient noyées et qu’elles commu-niquaient avec la grande citerne longitudinale coupée en deux dans le sens de la longueur pour permettre un effet de décantation. Les citernes transversales devaient correspondre entre elles de manière à répartir l’eau afin d’annuler les effets de surpression.
- La citerne no 2 :Cette citerne comme les deux autres était couverte par un système de doubles voûtes posées sur un mur longitudinal percé de manière à équilibrer les pressions de l’eau.
- La citerne no 3 :Bâtie comme la citerne no 2, elle comporte sur son pignon nord-ouest un conduit, situé en partie haute, au niveau du départ des voûtes parallèles. Il doit s’agir de l’alimentation, en partie haute, de l’ensemble des trois citernes. L’exemple des citernes de Carthage est représentatif de ce mode
L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE ZAMA (TUNISIE). LE BARRAGE D’AÏN JEBOUR • 163
de fonctionnement. L’angle sud-est (qui correspond au point le plus bas du substrat rocheux) pourrait avoir conservé la prise d’eau pour l’alimentation de la cité ainsi que la vidange de l’ensemble, située sensiblement plus bas (figures 31-32).
hypothèses et perspectIves
Brièvement résumés, les apports des campagnes de trois années, en dehors de la mise au jour de l’excep-tionnel barrage d’Aïn Djebour (et de la spectaculaire galerie de captage d’Aïn Ben Ali), ont surtout porté sur les tracés d’aqueducs et l’arrivée de l’un d’eux dans la ville antique. Les principales confirmations et découvertes sont les suivantes : les grandes citernes de Zama étaient à la fois alimentées par l’aqueduc d’Aïn Jebour et par l’aqueduc « haut » (C5) en prove-nance d’Aïn Ben Ali. Ce dernier, au moins en deux points, avait été aménagé en tranchée ouverte dans la roche naturelle. Le conduit C1 est, quant à lui, le premier en date de tous les aqueducs actuellement connus à Zama ; il est nettement antérieur au milieu du iie siècle, moment où son tronçon final est définiti-vement obturé. Si les grandes citernes et les aqueducs qui les alimentent sont bien aménagés, comme il semble, au cours de la première moitié du iiie siècle, cela laisse subsister un hiatus de plus d’un demi-siècle, hiatus dont la raison devra être expliquée par des études ultérieures. Le problème des circonstances de l’aménagement de C2 « doublant » C1 d’une manière très originale, ainsi que celui de son débouché (B1 ?), devra être reposé dans cette perspective. D’autre part, la campagne de 2004 a été particulièrement riche de remarques sur les techniques constructives de ces aqueducs, en particulier du dernier tronçon de C1, à partir du regard R3, l’un et l’autre retrouvés dans un état de conservation exceptionnel.
Figure 31 ‒ Plan des trois grandes citernes connues à l’entrée de Zama. [Dessin : C. Darles]
Figure 32 ‒ Coupe hypothétique sur les trois citernes de Zama. [Dessin : C. Darles]
164 • AHMED FERJAOUI / JEAN‑MARIE PAILLER / CHRISTIAN DARLES / JEAN‑LOUIS BORDES
Bien d’autres problèmes restent posés, sans même parler des grandes citernes, sur le déversoir desquel-les des remarques visuelles ont été faites et des hypo-thèses de restitution architecturale formulées, qui appelleront confirmation. Quelques-unes de ces ques-tions sont les suivantes. Quelle était la provenance, quel fut le devenir de C3 ? S’agit-il d’une canalisation tardive, en provenance d’un secteur non encore exploré, et destiné à alimenter des parties basses de la ville, où les activités artisanales semblent avoir occupé une place importante ? N’existait-il pas un septième aqueduc, encore non repéré, en provenance d’un autre secteur riche en sources ? Quelles sont les conséquences (fondamentales à ce stade préliminaire de l’exploration urbaine) de la chronologie relative
des aqueducs étudiés pour la topographie et l’histoire d’une ville assurément très vaste, très peuplée, très active ?En tout état de cause, des recherches approfondies
s’imposent sur le barrage d’Aïn Jebour, pour lequel une campagne est à prévoir, avec la participation de plusieurs spécialistes, campagne qui doit parvenir à une exégèse d’ensemble. Des questions sont également à poser, des hypothèses à vérifier en ce qui concerne la disposition, le fonctionnement, l’alimentation et le « déversoir » des grandes citernes de régulation situées à l’entrée de Zama, implantée au sein d’un territoire aussi riche que remarquablement maîtrisé par les populations de l’Antiquité.
bIbLIographIe
aGuSta-boularot S., Paillet J.-L.1998 « Le barrage et l’aqueduc occidental de Glanum :
le premier barrage-voûte de l’histoire des tech-niques ? (Saint-Rémy-de-Provence, Bouches-du-Rhône, France », dans P. Gros (dir.), Villes et campagnes en Gaule Romaine, Paris, p. 125-141.
ben HaSSen H., maurin l. (dir.)1998 Oudhna (Uthina) : la redécouverte d’une ville
antique de Tunisie (Collection Mémoires, 2), Bordeaux.
Calvet Y., Geyer B.1992 Barrages antiques de Syrie (Collection de la Maison
de l’Orient méditerranéen, 21), Lyon.
CHouCHane A., texier P.2004 « La reconnaissance des aqueducs d’Oudhna
(1998-2000). Les caractères d’ensemble du réseau », dans H. Ben Hassen, L. Maurin (dir.), Oudhna, Uthina, colonie de vétérans de la XIIIe légion : histoire, urbanisme, fouilles et mise en valeur des monuments (Collection Mémoires, 13), Bordeaux, p. 181-218.
GauCKler P.1902-1912 Enquête sur les installations hydrauliques
romaines en Tunisie, t. II, Tunis, 1902-1912.
GorGeS J.-G., riCo C.1999 « Barrages ruraux d’époque romaine en moyen-
ne vallée du Guadiana », dans J.-G. Gorges, F. G. Rodriguez Martín (dir.), Économie et terri-toire en Lusitanie romaine (Collection de la Casa de Velázquez, 65), Madrid, p. 157-195.
KHanouSSi M., maStino A.1997 Uchi Maius 1. Scavi e ricerche epigrafiche in Tunisia,
Sassari.
leveau P., Paillet J.-L.1976 L’alimentation en eau de Caesarea de Maurétanie
et l’aqueduc de Cherchell, Paris.
mrabet A.1992-1993 « Étude de l’aqueduc de Biia/Aïn Batria :
contribution à l’histoire d’une petite cité antique de Tunisie », dans Revue de l’École Nor-male Supérieure de Sousse (Université du Centre), 2, p. 95-120.
Pailler J.-M., Ferjaoui A., PHiliPPe É., vernHet A.2005 « D’Hannibal et Scipion (202 a.C.) à la “belle
femme de Jama” (2002 p.C.) : le problème de l’eau vu par la légende et par l’archéologie », dans A. Bouet, F. Verdin (dir.), Territoires et paysages de l’Âge du fer au Moyen âge : mélanges offerts à Philippe Leveau (Collection Mémoires, 16), Bordeaux, p. 257-258.
Slim H., maHjoubi A., belKHoDja K., ennabli A.2003 Histoire générale de la Tunisie, t. I : L’Antiquité,
Tunis.
SmitH N. A. F.1971 A History of Dams, Londres.
tixeront J.1953 Introduction à l’alimentation en eau des villes
de Tunisie (Régence de Tunis, Direction des Travaux Publics. Études d’Hydraulique et d’Hydrologie, 1), Tunis.
© Éditions de Boccard - 2013issn 2101-3195
isBn 978-2-7018-0357-9
Là où l’eau est rare, donc précieuse, il s’agit d’en maîtriser le flot pour la diriger où elle est utile, la retenir pour l’accumuler, puis la redistribuer le moment venu de manière efficace. Dans cette perspective, les barrages constituent un outil privilégié, mais d’une grande diversité. Le choix de leur implantation est essentiel, comme celui des techniques de construction mises en œuvre, parfois très simples, des murets de pierre, ou plus élaborées. Des dispositifs permettent alors de rejeter l’eau en excédent, de prélever celle qui est retenue, ou de vidanger l’ouvrage.
En Afrique du Nord, les barrages font partie des installations dont les traces ont été recherchées dès les premières explorations archéologiques, dans la perspective qui était alors celle d’une réactivation des techniques hydrauliques développées par les Romains. Les diverses enquêtes conduites en Algérie et en Tunisie n’ont pas manqué d’en relever les vestiges.
Il a donc paru intéressant, dans le cadre d’un programme de recherche consacré à l’eau dans les villes et les campagnes de l’Afrique du Nord («EauMaghreb») de l’Agence nationale de la recherche, de reprendre ce dossier pour tenter d’apprécier l’état des vestiges et ce que l’on peut savoir des techniques utilisées, sous le regard croisé des archéologues, des historiens et des géographes.
Mais il a également semblé pertinent, pour mieux dégager le caractère de ces aménagements dans le Maghreb antique, de les confronter à ceux d’autres régions dans lesquelles la situation est très favorable : la péninsule Ibérique, mais aussi la péninsule Arabique et les zones arides de Syrie, de Jordanie et d’Israël, qui comptent un grand nombre de barrages antiques ou proto-islamiques présentant une parenté évidente.
Dans ces régions en effet, une vingtaine de barrages, souvent très spectaculaires, sont situés dans le temps de manière précise grâce à une inscription de fondation qui donne une date ou fait mention d’un personnage connu. Ils offrent donc des repères chronologiques très précieux qui manquent ailleurs, notamment pour dater l’apparition de certaines innovations techniques et pour préciser les caractéristiques de ces ouvrages.
Le colloque avait donc rassemblé spécialistes du monde romain occidental, du Levant et de l’Arabie, dont ce volume présente les travaux.