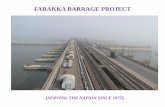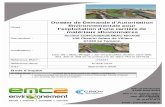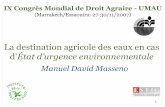Etude environnementale du barrage de Lom-Pangar. Thème 22: Archéologie
Transcript of Etude environnementale du barrage de Lom-Pangar. Thème 22: Archéologie
REPUBLIQUE DU CAMEROUN MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR
THEME 22 : ARCHEOLOGIE
Rapport après consultation Juin 2005
Philippe LAVACHERY
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 3/95
SOMMAIRE
1 RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ....................................................................13
1.1 LE PROJET ET SON IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ......................13 1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT ARCHEOLOGIQUE ...........................................13 1.3 RESULTATS........................................................................................................13 1.4 ANALYSE DE L’IMPACT .......................................................................................14 1.5 MESURES D’ATTENUATION DE L’IMPACT .............................................................14 1.6 RECOMMANDATIONS POUR LE PAE....................................................................14
2 CADRE ET CONTEXTE DE L’ETUDE ...............................................................15
2.1 LE PROJET ET SON IMPACT SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE ......................15 2.2 GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL...................................................................15 2.3 ASPECTS ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES ................................................16 2.4 RECOMMANDATIONS DE LA BANQUE MONDIALE ET DE LA COMMISSION MONDIALE DES BARRAGES...........................................................................................................17 2.4.1 WORLD BANK OPERATIONAL POLICY 11.03 .....................................................17 2.4.2 WORLD BANK TECHNICAL PAPER 62................................................................18 2.4.3 COMMISSION MONDIALE DES BARRAGES .........................................................19 2.5 OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT ARCHEOLOGIQUE ...........................................19
3 METHODE D’INVESTIGATION..........................................................................21
3.1 EQUIPE ..............................................................................................................21 3.2 PROSPECTION....................................................................................................21 3.3 EVALUATION DES SITES......................................................................................22 3.4 ENREGISTREMENT DES DONNEES .......................................................................24 3.5 UTILISATION DES CONNAISSANCES ARCHEOLOGIQUES PREALABLES...................25
4 CALENDRIER .....................................................................................................27
5 LE LOM : RESULTATS DE LA PROSPECTION PRELIMINAIRE....................29
5.1 ZONE COUVERTE ................................................................................................29 5.2 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SITES..............................................................29 5.2.1 LP 01 – OUAMI................................................................................................30 5.2.2 LP 02 – RIVIÈRE MAROUA ...............................................................................31 5.2.3 LP 03..............................................................................................................32 5.2.4 LP 04..............................................................................................................33 5.2.5 LP 05..............................................................................................................33
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 4/95
5.2.6 LP 06..............................................................................................................34 5.2.7 LP 07..............................................................................................................36 5.2.8 LP 08 – RIVIÈRE BARTI....................................................................................37 5.2.9 LP 09..............................................................................................................38 5.2.10 LP 10............................................................................................................38 5.2.11 LP 11............................................................................................................39 5.2.12 LP 12 – KOGBEDI ..........................................................................................40 5.2.13 LP 13 – ANCIEN KOGBEDI..............................................................................41 5.2.14 LP 14............................................................................................................41 5.2.15 LP 15............................................................................................................42 5.2.16 LP 16............................................................................................................43 5.2.17 LP 17 – DONGO ............................................................................................44 5.2.18 LP 18............................................................................................................45 5.2.19 LP 19............................................................................................................46 5.2.20 LP 20............................................................................................................47 5.2.21 LP 21............................................................................................................48 5.2.22 LP 22 – ANCIENT OUAMI I..............................................................................49 5.2.23 LP 23 – ANCIEN OUAMI II ..............................................................................49 5.3 ZONES SENSIBLES..............................................................................................50
6 LE PANGAR : DONNEES DU PIPELINE TCHAD-CAMEROUN ......................51
6.1 ZONE COUVERTE ................................................................................................51 6.2 DESCRIPTION DES SITES.....................................................................................52 6.3 ZONES SENSIBLES..............................................................................................53
7 INTERPRETATIONS CHRONO-CULTURELLES PRELIMINAIRES ................55
8 ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE...................................................................................................57
8.1 IMPACT DANS LA ZONE INONDEE.........................................................................57 8.2 IMPACT DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION..........................................................58
9 MESURES D’ATTENUATION DE L’IMPACT : PLANS DE TRAITEMENT SPECIFIQUES (SITES PRIORITAIRES) ..................................................................59
9.1 DANS LA ZONE INONDEE.....................................................................................59 9.2 DANS LA ZONE DE CONSTRUCTION .....................................................................60
10 RECOMMANDATIONS POUR LE PAE ...........................................................61
10.1 PROSPECTIONS SUPPLEMENTAIRES..................................................................61 10.2 MONITORING DES TRAVAUX ET ROLE DES ENTREPRISES....................................61 10.2.1 SURVEILLANCE DES TRAVAUX ........................................................................61 10.2.2 CONSIGNES AUX ENTREPRISES ......................................................................62 10.3 CONSTRUCTION D’UN MUSEE LOCAL.................................................................63
11 CONCLUSIONS ................................................................................................65
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 5/95
12 ANNEXES .........................................................................................................67
12.1 BIBLIOGRAPHIE................................................................................................67 12.2 ANNEXE A : INVENTAIRE DES SITES ARCHEOLOGIQUES DECOUVERTS SUR LE LOM ........................................................................................................................70 12.3 ANNEXE B : INVENTAIRE DES SITES ARCHEOLOGIQUES DECOUVERTS SUR LE PIPELINE (LOM 1 – MARARABA)...................................................................................72 12.4 ANNEXE C: SITES IMPORTANTS DE L’EMPRISE DU PIPELINE (EXTRAITS DU RAPPORT FINAL) .........................................................................................................75 12.4.1 ECA 163 - LOM I ...........................................................................................75 12.4.2 ECA 171 – PANGAR ......................................................................................76 12.4.3 ECA 177 – LOM I ..........................................................................................76 12.4.4 ECA 185 – LOM I ..........................................................................................77 12.4.5 ECA 199 – PANGAR ......................................................................................77 12.5 ANNEXE D : BUDGET PROVISOIRE POUR L’ARCHEOLOGIE DU PAE....................79 12.6 TERMES DE REFERENCES .........................................................................83
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 6/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 7/95
CARTES
Carte 1 : Zone prospectée, points d’accostage et sites archéologiques le long du Lom ....................................................................................................................29
Carte 2 : Sites archéologiques découverts lors de l’EIE du PLP et sur l’emprise du pipeline (CEP) ....................................................................................................51
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 8/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 9/95
PHOTOS
Photo 1 : Prospection des berges du Lom ................................................................22 Photo 2 : Tesson de poterie, éclats de débitage, molette, outil lithique biface (LP 02)
...........................................................................................................................31 Photo 3 : Tessons de poterie décorés de traçage au bâtonnet (LP 03)....................32 Photo 4 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois (LP 05) .........................34 Photo 5 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois et au peigne (LP 06) ....35 Photo 6 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois, fragment de tuyère (LP
07) ......................................................................................................................36 Photo 7 : Tesson de poterie décoré à la roulette en bois (LP 08) .............................37 Photo 8 : Tessons de poterie décorés à la roulette, fond de vase plat (LP 10) ........39 Photo 9 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois (LP 12) .........................40 Photo 10 : Tessons de poterie décorés au doigt et à la roulette (LP 14) ..................42 Photo 11 : tesson de poterie décoré à la roulette en fibre (LP 15)............................43 Photo 12 : Vue générale du site LP 17 - Dongo ........................................................44 Photo 13 : Tessons de poterie décorés à la roulette (LP 17) ....................................45 Photo 14 : Tessons de poterie décorés à la roulette et au bâtonnet, fragment de pipe
en argile (LP 19).................................................................................................46 Photo 15 : Tessons de poterie décorés à la roulette (LP 20) ....................................47
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 10/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 11/95
TABLEAUX
Tableau 1 : Classement prioritaire des sites découverts...........................................24 Tableau 2 : Calendrier du programme archéologique de l’EIE .................................27 Tableau 3: sites archéologiques découverts en mars-avril 2005 lors de la
prospection de l’EIE (rivière Lom). .....................................................................71 Tableau 4 : sites archéologiques découverts le long de l’emprise du pipeline (février-
avril 2002)...........................................................................................................73
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 12/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 13/95
1 RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT
1.1 Le projet et son impact sur le patrimoine archéologique
Le projet de barrage Lom Pangar doit créer une retenue d’eau d’environ 550 km² sur les cours d’eau inférieurs des rivières Lom et Pangar. Ceci nécessitera la construction de remblais et de routes d’accès et l’utilisation de carrières de latérite.
Toutes les terres situées en dessous d’une altitude de 675 mètres seront inondées durant les périodes de hautes eaux. Alors que la retenue d’eau noiera définitivement des sites archéologiques initialement accessibles aux chercheurs et aux touristes, les travaux de terrassement ont le potentiel de les endommager, voire de les détruire. La particularité de l’impact d’un barrage sur le patrimoine archéologique est double : (1) chaque site étant unique par définition, tout dégât est irréversible par essence et (2) les sites situés dans la zone inondée ne peuvent être contournés par les travaux.
La plus grande partie de la zone d’impact est inconnue du point de vue archéologique. Pourtant, on sait grâce aux travaux du pipeline Tchad-Cameroun (au nord et à l’ouest de la zone inondée) et de la route Bertoua - Garoua Boulaï (à l’est de la zone inondée) que la région est riche en vestiges archéologiques tant de l’Age de la Pierre que de l’Age du Fer.
1.2 Objectifs de l’étude d’impact archéologique
Il s’agissait d’identifier les sites archéologiques dans la zone échantillonnée (le sud du Lom) afin d’en évaluer l’intérêt scientifique et patrimonial, les classer selon leur importance et établir un plan de traitement spécifique pour chacun d’eux.
L’inventaire des sites découverts lors de l’EIE permettra d’évaluer l’impact du projet dans toute la zone (reste du Lom, Pangar, carrières, routes), impact à gérer lors du PAE.
1.3 Résultats
Le Lom Vingt-trois sites archéologiques ont été identifiés lors de la prospection préliminaire de l’EIE. Parmi ces 23 sites, 21 sont des sites de surface et 2 sont des sites en stratigraphie. Dix-neuf d’entre eux sont probablement daté de l’Age du Fer, 4 sont des sites sub-récents ou récents (sites historiques ou anciens villages.) Dix-neuf de ces sites ont livré de la poterie, parfois associée à des débris de débitage lithique ou de métallurgie ; 4 d’entre eux consistaient en restes d’habitation et autres artefacts récents de fabrication occidentale (les anciens villages). Sept de ces sites (30%) présentent un intérêt scientifique certain ou probable mais seulement 5 d’entre eux (22%) doivent être considérés comme prioritaires pour le PAE.
Le pipeline Dix-neuf sites archéologiques ont été identifiés sur les 52 kilomètres de l’emprise du pipeline compris entre les villages de Lom I (KP 537) et Mararaba (KP 485). Cela fait une densité de 1 site/2.7 kilomètres (0,37 sites/km).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 14/95
Quatorze d’entre eux sont des sites de surface et 5 sont des sites stratifiés. Parmi les sites de surface, 11 consistent en concentrations de tessons de poterie et 2 en concentrations d’artefacts divers (poterie, tuyères, meules). Les sites stratifiés comprennent 2 horizons de céramique et 3 horizons d’artefacts divers (poterie, scories, tuyères, éclats de débitage).
Deux dates au radiocarbone ont été obtenues : 240+/-70 BP (1500 et 1950 cal AD) pour ECA 162-Lom et 920+/-120 BP (885-1295 cal AD) pour ECA 199-Pangar
Donc, selon les données de l’EIE et du pipeline il pourrait y avoir entre 250 et 350 sites dans la zone inondée, dont 40 à 80 pourraient être scientifiquement importants (de 15 à 25%.)
1.4 Analyse de l’impact
Dans la zone ennoyée
- L’impact est inévitable
- Il est aussi irréversible, puisque chaque site archéologique est par essence unique et irremplaçable
- Il peut toutefois être atténué
Dans la zone de construction
- L’impact est théoriquement évitable - Comme pour la zone inondée, s’il y a impact, il est irréversible - L’impact peut être atténué
1.5 Mesures d’atténuation de l’impact
Dans la zone ennoyée :
- Fouille des sites importants
Dans la zone de terrassement :
- Contournement (le chantier prévu est déplacé définitivement) - Enterrement volontaire (une couche de terre est déposée sur le site
si les infrastructures prévues sont temporaires) - Fouille des sites importants qui ne peuvent être évités
Les sites fouillés seront étudiés selon les modalités suivantes :
- Inventaire des sites, objets et données collectées - Description des sites et des artéfacts - Datations radiocarbone - Analyse des données - Publication des données (rapport, articles scientifiques)
1.6 Recommandations pour le PAE
- Prospections supplémentaires - Surveillance des travaux - Consignes aux entreprises pour la protection des sites - Construction d’un musée local
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 15/95
2 CADRE ET CONTEXTE DE L’ETUDE
2.1 Le projet et son impact sur le patrimoine archéologique
Le projet de barrage Lom Pangar (ci-après, le Projet)1 doit créer une retenue d’eau d’environ 550 km² sur les cours d’eau inférieurs des rivières Lom et Pangar. Ceci nécessitera la construction de remblais et de routes d’accès et l’utilisation de carrières de latérite (voir rapport du thème 12).
• Toutes les terres situées en dessous d’une altitude de 675 mètres seront inondées durant les périodes de hautes eaux (voir carte 1). Alors que la retenue d’eau noiera définitivement des sites archéologiques initialement accessibles aux chercheurs et aux touristes, les travaux de terrassement ont le potentiel de les endommager, voire de les détruire. La particularité de l’impact d’un barrage sur le patrimoine archéologique est double : (1) chaque site étant unique par définition, tout dégât est irréversible par essence et (2) les sites situés dans la zone inondée ne peuvent être contournés par les travaux.
• La plus grande partie de la zone d’impact est inconnue du point de vue archéologique. Pourtant, on sait grâce aux travaux du pipeline Tchad-Cameroun2 (au nord et à l’ouest de la zone inondée) et de la route Bertoua - Garoua Boulaï3 (à l’est de la zone inondée) que la région est riche en vestiges archéologiques.
• On s’attend à découvrir des sites de l’Age de la Pierre4 (outils lithiques en stratigraphie ou en surface), datant probablement entre 2000 et 50.000 ans (voire plus), ainsi que des sites de l’Age du Fer5 (tessons de poterie, industrie lithique, traces de villages, fourneau de réduction de fer) dont l’ancienneté remonte aux deux derniers millénaires.
2.2 Gestion du patrimoine culturel
• La vocation des opérateurs de grands travaux d’aménagement n’est pas de faire de la recherche scientifique. Par contre l’impact de ces chantiers sur le patrimoine culturel est potentiellement énorme et il s’agit donc de l’atténuer au maximum.
1 Voir « Projet de barrage – réservoir Lom Pangar. Termes de référence des thèmes n°22 – Archéologie. Version n°1 du 27/01/04 » 2 Oslisly et al. 2000 ; Lavachery et al. 2005 ; Lavachery 2005 3 Mbida, Asombang et Delneuf, 2001; Asombang, Mbida et Delneuf, 2003 4 Période de la préhistoire africaine pendant laquelle les populations taillaient la pierre et ignoraient métallurgie et agriculture (>3.000 ans) 5 Période de la préhistoire africaine pendant laquelle les populations maîtrisaient la métallurgie, située entre la fin des âges de la pierre (+/- 3.000 ans) et la colonisation (fin du 19ème siècle)
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 16/95
• La gestion du patrimoine culturel, comme on la comprend actuellement, est issue des recommandations de l’UNESCO telles qu’appliquées dans les projets financés par la Banque Mondiale6.
• Cette notion de gestion est nouvelle au Cameroun. Elle n’a été mise en oeuvre qu’une seule fois, lors du Projet pipeline Tchad-Cameroun (2000-2003)7. Le projet de la route Bertoua - Garoua Boulaï, par exemple, a plutôt consisté en fouilles de sauvetage (fouille des sites découverts lors des travaux)8.
• Différant de la recherche proprement dite ainsi que des fouilles de sauvetage, cette gestion consiste à diminuer l’impact des grands travaux d’aménagement sur le patrimoine culturel. Elle implique donc de connaître ce patrimoine avant les travaux afin de prévoir un plan d’action qui doit être mis en œuvre lui aussi avant les travaux.
• La gestion du patrimoine culturel, telle que définie en Europe et aux USA, demande que les sites importants soient en priorité évités, afin d’annuler l’impact de la construction. C’est bien sûr impossible dans le cadre de ce projet (surtout dans la zone inondée) et les sites importants touchés doivent alors être traités.
2.3 Aspects administratifs et réglementaires
• La gestion du patrimoine culturel (y compris les sites archéologiques) relève de la loi n° 91/008 du 31 juillet 1991 intitulée « Sur la protection du patrimoine culturel et naturel de la nation ». Elle souligne que les opérateurs de travaux d’aménagement ont le devoir de signaler toute découverte importante et que des spécialistes adéquats doivent être contactés pour mettre en œuvre évaluation et protection. Toutefois cette loi n’a jamais fait l’objet d’un décret d’application présidentiel.
• Le Cameroun est aussi signataire des conventions 1709 et 197210 de l’UNESCO ainsi que de la troisième convention ACP-EEC311. Ces conventions concernent la protection du patrimoine culturel et, bien qu’elles n’aient pas force de loi, elles définissent l’usage vers lequel le pays devrait tendre.
• C’est le Ministère de la Culture qui délivre normalement les autorisations officielles pour entreprendre tous travaux concernant le patrimoine culturel de la nation entrepris dans un cadre non universitaire.
6 World Bank 1987, 1991; McIntosh 1993; Mabulla 2000; MacEachern 2001 7 ExxonMobil 1998 8 Mbida, Asombang et Delneuf, 2001; Asombang, Mbida et Delneuf, 2003. 9 UNESCO 170 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 10 UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and National Heritage 11 Third ACP-EEC3 Convention, Rome III. Part II, Title VIII, Chapter 3, Article 127
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 17/95
• Tout le matériel archéologique collecté lors des fouilles appartient à l’état camerounais et devra donc être remis au Ministère de la Culture après finalisation de l’étude.
2.4 Recommandations de la Banque Mondiale et de la Commission Mondiale des Barrages
2.4.1 World Bank Operational Policy 11.03 Etant donnée la carence des lois et des règlements applicables au Cameroun en termes de protection effective du patrimoine culturel, il conviendrait de se référer aux recommandations de la Banque Mondiale (établies d’après celles de l’UNESCO12). Il s’agit ici de la « World Bank Operational Policy 11.03. » Cette dernière définit le patrimoine culturel comme tel13:
« Le terme “patrimoine culturel”, pour les Nations Unies, inclus les sites ayant une valeur archéologique, paléontologique, historique, religieuse et même ceux possédant un intérêt paysager unique. Le patrimoine culturel inclus donc aussi les artefacts laissés par les hommes du passé (par exemple leurs fosses détritiques, leurs autels, leurs champs de bataille) et les paysages naturels uniques (tels les chutes d’eau et les canyons.)»
La politique de la Banque Mondiale au regard du patrimoine culturel est de participer à sa conservation et de chercher à éviter sa destruction. Spécifiquement :
a) La Banque Mondiale refuse normalement de financer des projets qui endommageront de façon significative le patrimoine culturel non renouvelable. Le patrimoine archéologique est, par essence, non renouvelable.
b) La Banque Mondiale assistera les projets qui assurent la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel.
• Dans certains cas, il est recommandé que le projet se déplace pour préserver les sites de façon à ce qu’ils puissent être étudiés, intacts, sur place.
• Dans d’autres cas les artefacts et les structures peuvent être déplacés et restaurés ailleurs pour être préservés et étudiés.
• Souvent une étude scientifique, un sauvetage sélectif et la conservation dans un musée avant la destruction sont des mesures suffisantes.
• La plupart des projets devraient inclure la formation des cadres locaux ainsi que le renforcement des institutions responsables de la protection et de la conservation du patrimoine culturel national.
c) La gestion du patrimoine culturel d’un pays est de la responsabilité du gouvernement. Avant d’aller de l’avant avec un projet :
12 UNESCO 170 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property et UNESCO 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and National Heritage 13 Traduction de l’auteur
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 18/95
• La Banque Mondiale doit “déterminer ce qui est connu du patrimoine culturel dans la zone potentiellement affectée par le projet.
• L’attention du gouvernement devrait être attirée spécifiquement sur ces aspects et les institutions appropriées (ONG et universités) devraient être consultées
• Dans l’hypothèse où des questions concernant le patrimoine culturel seraient soulevées dans la région concernée, une prospection rapide devrait être menée sur le terrain par un spécialiste”.
2.4.2 World Bank Technical Paper 62 Le chapitre 5 de l’article décrit les types de projet qui nécessitent un programme de protection du patrimoine culturel. Parmi ceux-ci figurent les chantiers incluant des terrassements à grande échelle ainsi que ceux qui impliquent l’ennoiement de grandes surfaces. Les différents types de programme de protection du patrimoine culturel incluent :
1) Changement de la conception ou de l’emplacement du projet, 2) Sauvetage et étude archéologique ou paléontologique, 3) Restauration et conservation des structures historiques et religieuses, 4) Conservation des sites sacrés indigènes, 5) Conservation des sites naturels uniques, 6) Formation du personnel et renforcement des institutions.
Dans cette optique l’article décrit le processus d’atténuation d’impact et de sauvetage sur le patrimoine archéologique en termes généraux14:
1) “…Analyse de la littérature scientifique, prospection régionale préalable, cartographie et échantillonnage de tous les sites …
2) Evaluation des sites situés dans la zone affectée ou proche d’elle pour déterminer leur importance scientifique relative et leur potentiel pour une conservation éventuelle, incluant potentiellement un sondage pour dater les collectes de surface. Cette évaluation peut prendre la forme d’un tri dans lequel (a) certains sites peuvent être abandonnés sans être étudiés sans qu’il y ait perte significative pour la nation, (b) certains sites sont enregistrés, étudiés et puis abandonnés et (c) certains sites méritent des mesures de protection spéciales, voire d’être déplacés.
3) Détermination de l’impact que les travaux d’aménagements auront sur ces sites.
4) Conservation en place des sites significatifs dans la mesure des possibilités autorisées par la conception du projet ou permises par des modifications de cette conception.
14 Traduction de l’auteur
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 19/95
5) Fouilles et collecte des données sur les sites qui seront affectés.
6) Entretien, conservation et étude des sites significatifs et d’un échantillon représentatif d’artefacts.
7) Préparation, publication et diffusion de rapports scientifiques...”
2.4.3 Commission Mondiale des Barrages La Commission Mondiale des Barrages (CMB), après avoir étudié de nombreux projets dans le monde, a constaté que le patrimoine archéologique n’était qu’exceptionnellement pris en compte15. Pour améliorer cet état de fait, elle propose :
1. De réaliser une étude d’impact pour chaque projet concernant l’héritage culturel (y compris le patrimoine archéologique).
2. De proposer, dans un plan spécifique, des mesures d’atténuation d’impact, voire d’élimination totale de l’impact.
3. Que le temps nécessaire ainsi que des ressources financières propres soient alloués à la gestion du patrimoine archéologique.
4. Que l’équipe chargée de l’évaluation de l’impact comprenne toujours des archéologues.
5. Que le plan d’atténuation d’impact inclue des mesures de préservation des sites (contournement) ou de collecte et traitement des données (fouilles, étude, curation).
6. Un rapport final spécifique doit être produit à l’issue du programme
2.5 Objectifs de l’étude d’impact archéologique
Afin de répondre à la fois aux exigences de la loi et à celles d’une bonne gestion de l’environnement culturel, une étude d’impact préalable est nécessaire. Du point de vue archéologique une étude d’impact doit suivre les objectifs suivants :
• L’étude ne cherche pas à examiner la zone d’impact dans son intégralité (les 550 km²) mais plutôt à évaluer l’impact potentiel du projet sur le patrimoine archéologique sur la base d’un échantillon prospecté de façon contrôlée.
• Il s’agit donc d’identifier les sites archéologiques dans la zone échantillonnée (le Sud du Lom) afin d’en évaluer l’intérêt scientifique et patrimonial, les classer selon leur importance et établir un plan de traitement spécifique pour chacun d’eux.
• L’inventaire des sites découverts lors de l’EIE permettra d’évaluer l’impact du projet dans toute la zone (reste du Lom, Pangar, carrières, routes), impact à gérer lors du PAE.
15 Commission Mondiale des Barrages 2000
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 20/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 21/95
3 METHODE D’INVESTIGATION La place de la présente étude thématique dans l’ensemble de l’EIE est illustrée sur la figure suivante :
3.1 Equipe
La prospection des berges du Lom a été réalisée par une équipe de 4 personnes :
• Un docteur en archéologie (Dr Philippe Lavachery). • Un licencié en archéologie (M. Pierre Kinyock). • Deux piroguiers et guides (chef Joseph Mbom Youmbi et M. Ayatou).
3.2 Prospection
La prospection de la zone échantillonnée dans le cadre de cette étude a été basée sur deux principes :
1. L’expérience des archéologues impliqués (connaissance des signes
anthropiques et géographiques indicatifs d’anciens établissements humains).
2. L’exploitation des traditions historiques des populations locales (toponymie, emplacement des anciens villages…).
La prospection des berges du Lom a été effectuée en pirogue, en remontant la rivière à la rame. Comme une prospection systématique était impossible étant données les limitations du calendrier, seules les zones « stratégiques » ont été ciblées : zones d’érosion, plages, îlots, sommets de colline, campements de
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 22/95
pêcheurs, villages anciens et modernes. Ces zones étaient visitées à pied et n’ont pas fait l’objet de sondages.
Photo 1 : Prospection des berges du Lom
Des techniques de prospection plus poussées (quadrillage systématique avec carottage de toute la zone affectée, voire même utilisation de photos aériennes pour repérer les configurations géographiques favorables) devraient être appliquées lors du PAE (voir point 9).
3.3 Evaluation des sites
Dans le but d’organiser les recherches archéologiques après les prospections (lors du PAE), les sites identifiés sont classés selon (1) leur importance scientifique (la quantité d’informations qu’ils peuvent livrer) et (2) l’intervention requise (dépendant de leur importance et de leur emplacement par rapport aux plans de construction).
• Sites importants : prioritaires (intervention obligatoire selon le plan de traitement)
• Sites d’importance incertaine : prioritaires (évaluation supplémentaire requise)
• Sites non importants : non prioritaires (intervention non requise)
Le classement prioritaire d’un site n’est pas une mesure définitive de son importance scientifique mais plutôt une étape temporaire qui permet de tenir compte de son potentiel scientifique et des mesures à prendre dans le cadre de la construction. De cette manière un site classé « important » à sa découverte peut être ré-évalué plus tard comme tant sans importance après étude. De la même manière des sites dont
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 23/95
l’importance est incertaine peuvent être classés importants ou pas par la suite et être ou fouillés ou abandonnés.
Les critères utilisés pour définir la valeur scientifique d’un site sont multiples et complexes. Toutefois, puisqu’un archéologue cherche à comprendre à la fois l’histoire du peuplement d’une région et les modes de vie des populations disparues, ces critères peuvent être résumés de la façon suivante :
• Ancienneté du site • Densité et/ou variété des découvertes. • Contexte des découvertes. • Signification sociale des découvertes. • Connaissances archéologiques préalables.
• L’Age est un critère qui s’explique de lui-même : plus un site est ancien, plus
il est important. Ceci se justifie par la rareté des sites anciens comparés aux sites récents. En trouver un est donc une opportunité exceptionnelle de comprendre le passé distant d’une région. De plus, les sites de plus de 10.000 ans d’âge ne sont, pour la plupart, trouvés que lors de grands travaux d’infrastructure nécessitant beaucoup de terrassement parce qu’ils sont enterrés profondément.
• Pour être considéré comme important, un site doit aussi (le plus souvent) présenter une relativement grande densité et/ou variété d’artefacts. Les trouvailles isolées sont difficiles à interpréter parce qu’un échantillon représentatif du matériel est nécessaire (1) pour décrire valablement une culture matérielle et (2) pour comprendre les activités menées sur le site par ses occupants.
• Les artefacts doivent aussi reposer en contexte primaire (comme les préhistoriques les ont laissés) pour être exploitables scientifiquement (stratigraphie et paléo-ethnographie). Si des phénomènes naturels (érosion, activité animale…) ou anthropiques (piétinement, nettoyage, terrassement…) ont perturbé le site de manière trop profonde, l’association et la position des artefacts ne peuvent plus être interprétées. Bien sûr les sites archéologiques sont pour la plupart découverts lorsque qu’une partie de leur surface a été mise au jour par l’érosion ou le terrassement: l’intervention archéologique devra donc se focaliser sur les zones non encore perturbées.
• Des sites récents (tombes, monuments, aires sacrées…) peuvent posséder une signification sociale très importante pour les populations locales et, dans ce cas, ils ne doivent être endommagés ni par les activités de construction, ni par les archéologues, sans qu’une compensation adéquate n’ait été négociée. Dans cette optique, les sites funéraires, même récents, sont toujours considérés comme importants. Une attention particulière doit dès lors être accordée aux anciens villages qui peuvent contenir des tombes16.
16 Toutefois les tombes récentes doivent être prises en charge par la compensation socio-économique et non pas traitées par les archéologues
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 24/95
• Les connaissances archéologiques locales préalables dans la zone où un site a été identifié est aussi un critère important: dans une région inexplorée, des sites d’importance moyenne peuvent être considérés comme prioritaires car ils représentent les premières informations disponibles.
La façon dont ces critères se combinent et mènent à un classement provisoire de l’importance d’un site archéologique est illustrée dans le tableau suivant (tableau 1):
ANCIENNETE CONTEXTE PRIMAIRE
DENSITE/VARIETE D’ARTEFACTS
SIGNIFICATION SOCIALE PRIORITE
Oui Oui Oui Oui Haute
Oui Oui Oui Non Haute
Non Oui Oui Oui Haute
Oui Oui Non Non Haute/Basse
Non Non Non Oui Haute/Basse
Non Oui Non Oui Haute/Basse
Non Non Oui Non Basse
Non Oui Non Non Basse
Non Non Non Non Basse
Tableau 1 : Classement prioritaire des sites découverts
3.4 Enregistrement des données
Les données suivantes ont été enregistrées pour chaque site archéologique découvert :
• Coordonnées GPS (UTM wgs 84). • Date de découverte. • Extension approximative du site. • Contexte géomorphologique. • Artefacts/structures observées. • Photographie d’un échantillon d’artefacts. • Photographie générale du site.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 25/95
3.5 Utilisation des connaissances archéologiques préalables
A ce stade les données collectées directement sur le terrain sont minimes par rapport au potentiel archéologique de la zone d’impact du Projet. Toutefois, on peut compléter ces informations en consultant les données publiées par deux projets qui ont touché des régions très proches, voire même contiguës :
• Le Projet Pipeline Tchad-Cameroun.
• Le Projet de la route Bertoua-Garoua Boulaï.
L’auteur de ce rapport est en possession des rapports finaux de ces deux projets.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 26/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 27/95
4 CALENDRIER
La prospection préliminaire de l’EIE a duré 25 jours, dont 5 ont été consacrés à la préparation logistique, trois aux déplacements longue distance, 8 à la prospection sur zone proprement dite et 7 à la préparation du rapport (tableau 2) :
Tableau 2 : Calendrier du programme archéologique de l’EIE
17 Philippe Lavachery 18 Pierre Kinyock 19 Joseph Mbom Youmbi (chef de Ouami) 20 Ayatou
Jour Activité Personnel 21-3-05 Préparation terrain PL17 + PK18 22-3-05 Préparation terrain PL + PK 23-3-05 Voyage Yaoundé - Ngaoundéré PL + PK 24-3-05 Préparation terrain PL + PK 25-3-05 Voyage Ngaoundéré - Bertoua PL + PK 26-3-05 Voyage Bertoua - Ouami - Bertoua
Engagement de deux piroguiers PL + PK
27-3-05 Pâques 28-3-05 Préparation terrain
Voyage Bertoua – Ouami PL + PK
29-3-05 Prospections sur le Lom PL + PK + JM19 + AY20 30-3-05 Prospections sur le Lom (aller) PL + PK + JM + AY 31-3-05 Prospections sur le Lom (aller) PL + PK + JM + AY 1-4-05 Prospections sur le Lom (aller) PL + PK + JM + AY 2-4-05 Prospections sur le Lom (aller) PL + PK + JM + AY 3-4-05 Prospections sur le Lom (aller) PL + PK + JM + AY 4-4-05 Prospections sur le Lom (retour) PL + PK + JM + AY 5-4-05 Prospections sur le Lom (retour) PL + PK + JM + AY 6-4-05 Voyage Ouami – Bertoua PL + PK 7-4-05 Voyage Bertoua – Yaoundé PL + PK 8-4-05 Préparation du rapport PL + PK 9-4-05 Préparation du rapport
Voyage Yaoundé – Bruxelles PL
11-4-05 Préparation du rapport PL 12-4-05 Préparation du rapport PL 13-4-05 Préparation du rapport PL 14-4-05 Préparation du rapport PL 15-4-05 Préparation du rapport PL
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 28/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 29/95
5 LE LOM : RESULTATS DE LA PROSPECTION PRELIMINAIRE
5.1 Zone couverte
Le Lom et sa vallée ont été prospectés sur une distance, en ligne, d’environ 52 kilomètres entre les villages de Ouami (UTM 33 N – E 341508, N 579702) et de Doué (UTM 33 N – E 367378, N 590185). Une douzaine de kilomètres ont été parcourus sur terre et une quarantaine sur la rivière. Les berges du Lom ont été accostées 44 fois.
Cette distance représente environ 70 % du kilométrage perpétuellement inondé (basses eaux) le long du Lom et 35 % du kilométrage perpétuellement inondé du Lom et du Pangar réunis. L’échantillon de la zone d’impact prospectée peut donc être considéré comme représentatif de la totalité de la zone qui sera toujours sous eau mais pas de la surface inondée lors des hautes eaux.
Lom Pangar
Doué
DongoKogbedi
Ouami
575000
580000
585000
590000
595000
330000 335000 340000 345000 350000 355000 360000 365000 370000
Eastings (UTM 33 N)
Nor
thin
gs (U
TM 3
3
Sites archéologiques Points d'accostage Lom prospecté Localités modernes
Carte 1 : Zone prospectée, points d’accostage et sites archéologiques le long du Lom
5.2 Inventaire et description des sites
Vingt-trois sites archéologiques ont été identifiés lors de la prospection préliminaire de l’EIE. Les sites découverts dans le cadre du Projet ont été codés avec les lettres LP (pour Lom Pangar) suivies du chiffre correspondant à l’ordre de découverte (de 01 à 23). Les sites identifiés lors du PAE devraient suivre la même codification (de LP 24 à LP xx).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 30/95
Parmi ces 23 sites, 21 sont des sites de surface21 et 2 sont des sites en stratigraphie. Dix-neuf d’entre eux sont probablement datés de l’Age du Fer, 4 sont des sites sub-récents ou récents (sites historiques ou anciens villages.) Dix-neuf de ces sites ont livré de la poterie, parfois associée à des débris de débitage lithique ou de métallurgie ; 4 d’entre eux consistaient en restes d’habitation et autres artefacts récents de fabrication occidentale (les anciens villages).
Sept de ces sites (30 %) présentent un intérêt scientifique certain ou probable mais seulement 5 d’entre eux (22 %) doivent être considérés comme prioritaires pour le PAE.
5.2.1 LP 01 – Ouami
Description Le site LP 01 est situé dans l’actuel village de Ouami (UTM 33 N – E 341508, N 579702 – alt. 738 m22) et a été identifié le 29 mars 2005. Les artefacts ont été découverts en surface, sur le sommet de la colline où sont installées les maisons modernes, où ils sont dégagés du sol par l’érosion pluviale. Il s’agit d’un riche assemblage de tessons de céramique décorée à la roulette23 en fibre (KPR24, TGR25) et d’éclats de débitage en quartz. La surface totale du site n’a pas été investiguée mais elle semble importante : la poterie et les éclats sont éparpillés sur au moins 100 x 50 mètres (5.000 m²) mais il est évident que de plus amples recherches (en surface et en stratigraphie) révèleraient que le site est beaucoup plus vaste encore.
Interprétation Il s’agit manifestement d’un ancien village de l’Age du Fer. Le mélange de poterie décorée à la roulette et d’éclats de débitage est une constante de la région et des assemblages comparables ont été datés entre 2.000 et 200 BP26 dans les environs lors d’autres programmes archéologiques comme le pipeline Tchad-Cameroun27 et le projet BGB28, avec une probabilité élevée que l’âge soit postérieur à 1.000 BP. Une première analyse de la poterie sur le terrain, toutefois, montre des affinités avec la céramique Gbaya moderne, ce qui plaide pour un âge situé dans les derniers siècles de notre ère29.
Importance et priorité LP 01 – Ouami est un site important scientifiquement : il est riche et étendu et il est situé dans une région encore peu connue archéologiquement. Il est fort probable que des fouilles mettent à jour des niveaux en stratigraphie qui permettraient d’établir une chronologie et un échantillon contrôlé de l’assemblage. Toutefois, le site se trouve hors de la zone inondable et n’est donc pas prioritaire pour le Projet. 21 Les artefacts observés lors de la prospection étaient en surface mais une étude plus poussée pourrait révéler un horizon en stratigraphie 22 Altitude prise avec le GPS (précision faible) 23 Selon la terminologie de Soper 1985 24 Knotted Strip Roulette 25 Twisted String Roulette 26 BP = Before Present (1950) 27 Lavachery et al. 2005 28 Asombang et al. 2003 29 Burnham 1981
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 31/95
5.2.2 LP 02 – Rivière Maroua
Description LP 02 est situé le long de la rivière Maroua, à quelques 200 mètres de la berge du Lom (UTM 33 N – E 351336, N 584466), sur une colline escarpée aujourd’hui située en pleine forêt (approx. 638 m d’altitude). Il a été découvert le 30 mars 2005. Les artéfacts apparaissent sur les flancs érodés de la colline : il s’agit d’un assemblage de tessons de poterie décorée à la roulette (TGR), de débris de taille (éclats, nucléus de quartz) et de meules et de molettes. Le site s’étend sur une surface de 100 x 100 mètres au moins (10.000 m²) mais est certainement plus étendu que cela.
Photo 2 : Tesson de poterie, éclats de débitage, molette, outil lithique biface (LP 02)
Interprétation Le site de la rivière Maroua est un village de l’Age du Fer établi le long d’un cours d’eau permanent. Comme à Ouami, le mélange de poterie décorée à la roulette et d’éclats de débitage répond à une tradition régionale qui a déjà été décrite30 et des assemblages comparables ont été datés entre 2.000 et 200 BP dans les environs. D’autre part le site était inconnu des villageois de Ouami et n’est donc pas lié à la dernière phase de peuplement Gbaya31 et Peule de la région.
30 Asombang et al. 2003 ; Lavachery et al. 2005, Lavachery 2005 31 Burnham 1981
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 32/95
Importance et priorité LP 02 est un site scientifiquement important : il s’agit d’un vaste village de l’Age du Fer, probablement ancien, situé dans une zone où les données archéologiques sont encore très lacunaires. Il sera inondé et doit donc être traité de façon prioritaire (voir section 6) pour préserver les informations qu’il peut livrer sur la vie des populations pré-Gbaya de la région.
5.2.3 LP 03
Description Le site LP 03 a été identifié le 30 mars 2005. Il est situé sur un îlot de gravier et de sable, sur le cours du Lom (UTM 33 N – E 351999, N 585826). Cet îlot, d’environ 50 x 150 m (7.500 m²) et situé approximativement à 665 m d’altitude, est certainement au moins partiellement inondé chaque année à la saison des pluies lorsque le niveau de l’eau monte. Des tessons de poterie décorée de traçages au bâtonnet ont été découverts en surface, sur la plage. Ils sont érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau. Toutefois, le degré d’usure du matériau démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur de grandes distances.
Photo 3 : Tessons de poterie décorés de traçage au bâtonnet (LP 03).
Interprétation LP 03 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 33/95
Les décors de la céramique, bien que peu distinctifs, ne sont pas comparables à la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 03 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.4 LP 04
Description Le site LP 04 a été découvert le 30 mars 2005. Il se trouve sur un îlot temporaire de gravier et de sable situé sur le cours du Lom (UTM 33 N – E 351779, N 586741 – alt. 651 mètres). Des tessons de poterie décorée de traçages au bâtonnet ou au peigne sont visibles en surface. Ils sont érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau. Toutefois, le degré d’usure du matériau démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur de grandes distances.
Interprétation Tout comme LP 03, le site LP 04 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
Le décor de la céramique, bien que peu caractéristique, n’est pas comparable à la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 04 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.5 LP 05
Description LP 05 a été identifié le 31 mars 2005. Des tessons de poterie décorée à la roulette (CWR32, KPR) ont été découverts en surface sur un îlot saisonnier de gravier et de sable situé sur le cours du Lom (UTM 33 N – E 351399, N 587283 – alt. 655 m).
32 Carved Wooden Roulette
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 34/95
Ils sont légèrement érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau mais n’ont certainement pas été transportés sur de grandes distances.
Photo 4 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois (LP 05)
Interprétation Le site LP 05 peut être interprété de deux manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière et/ou (2) d’un campement temporaire de pêcheurs. La fraîcheur des tessons (érosion très limitée) démontre qu’il ne peut s’agir d’un dépôt secondaire.
Le décor de la céramique est cette fois très caractéristique et n’a rien à voir avec celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 05 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.6 LP 06
Description Le site LP 06 a été découvert le 31 mars 2005. Il se trouve sur un îlot de gravier et de sable situé sur le cours du Lom (UTM 33 N – E 351945, N 587438 – alt. 649 m) où des tessons de poterie décorée à la roulette (CWR, KPR) et de traçages et
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 35/95
d’impressions au peigne ont été identifiés en surface. Certains d’entre eux sont érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau, d’autres semblent plus frais. Toutefois, le degré d’usure du matériau démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur de grandes distances.
Photo 5 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois et au peigne (LP 06)
Interprétation Le site LP 06 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
Le décor de la céramique est très différent de celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 06 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 36/95
5.2.7 LP 07
Description Le site LP 07 a été découvert le 31 mars 2005. Il se trouve sur un îlot de gravier et de sable séparant le Lom en deux bras (UTM 33 N – E 353181, N 586235 – alt. 641 m). Des tessons de poterie décorée à la roulette (CWR) et de traçages au peigne ont été observés en surface. Ils sont érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau, toutefois le degré d’usure du matériau démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur de grandes distances. On peut encore aisément décrire les motifs décoratifs : le plus caractéristique étant un rang de petits zigzags horizontaux superposés. Plus exceptionnel, un morceau de tuyère33 a aussi été découvert
.
Photo 6 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois, fragment de tuyère (LP 07)
Interprétation Le mélange de tessons et d’un fragment de tuyère soulève des questions : des artefacts typiquement domestiques et ceux liés à la réduction du minerai de fer ne se retrouvent que très rarement associés en Afrique centrale. En effet la production de métal est considérée comme une activité magique dangereuse réservée aux initiés et, encore aujourd’hui, prend souvent place dans des lieux cachés, loin des villages34. Il semble que c’était le cas aussi dans le passé. Toutefois les travaux de forge pouvaient très bien se dérouler dans un quartier spécialisé et entraîner un mélange d’outils domestiques et métallurgiques. Ici encore, la question de l’homogénéité de l’assemblage est posée.
Le site LP 07 peut donc être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants
33 Tuyau de céramique servant à ventiler un fourneau 34 Van Der Merwe and Avery 1987; Miller and Van Der Merwe 1994; David and Kramer 2001
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 37/95
d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs, (3) d’une aire de production de fer (réduction, forge) ou encore (4) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les différents artefacts (tessons, tuyère) ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne sont exclusives.
Des fourneaux de réduction de fer ont été datés entre 2.000 et 250 BP au nord et à l’ouest de la zone d’impact du Projet, lors de l’étude des sites archéologiques découverts le long du tracé du pipeline35. Ici pourtant les décors de la céramique sont très différents de ceux de la poterie Gbaya moderne et il est probable que le site puisse être antérieur aux deux derniers siècles.
Importance et priorité La présence de traces de métallurgie et les questions que cela pose font de LP 07 un site important scientifiquement. Comme il sera certainement inondé par la retenue d’eau, il doit être classé comme prioritaire pour être étudié prochainement.
5.2.8 LP 08 – Rivière Barti
Description Le site LP 08 a été découvert le 1er avril 2005, sur les berges du Lom, dans un campement temporaire de pêcheurs (UTM 33 N – E 353181, N 586235 – alt. 646 m) établi au confluent de la rivière Barti. Des tessons de poterie décorée à la roulette en bois ont été identifiés en surface et dans le profil érodé de la berge. Le site n’a manifestement jamais été inondé et la céramique est fraîche. Les mêmes décors de zigzags horizontaux identifiés à LP 07 sont présents.
Photo 7 : Tesson de poterie décoré à la roulette en bois (LP 08)
35 Lavachery et al. 2005 ; Lavachery 2005
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 38/95
Interprétation LP 08 – Rivière Barti apparaît comme un village de l’Age du Fer, établi le long du Lom. Les décors de la céramique sont très différents de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le fait que les tessons de céramique aient été identifiés en stratigraphie établi l’importance scientifique du site : comme LP 02, son étude permettrait de collecter des données sur les caractéristiques des villages de l’Age du Fer (matériel archéologique, âge, organisation spatiale). Il doit être considéré comme prioritaire.
5.2.9 LP 09
Description LP 09 a été découvert le 1er avril 2005. Il est situé environ à un kilomètre des berges du Lom (UTM 33 N – E 354551, N 585790 – alt. 658 m), dans une savane incluse. Il s’agit d’un campement sub-récent d’orpailleurs. Il a livré des restes d’habitations et des artefacts de facture européenne.
Interprétation Ce campement a été occupé par les Allemands et abandonné par ces derniers, probablement durant ou juste après la première guerre mondiale. La tradition orale prétend que la plupart des outils ont été jetés dans le Lom à leur départ. Il a été récemment réoccupé par des orpailleurs locaux et abandonné ces dernières années suite à un décès inexpliqué.
Importance et priorité LP 09 est un site récent : il est d’une importance scientifique limitée et peut être inondé sans perte pour le patrimoine historique national.
5.2.10 LP 10
Description Le site LP 10 a été découvert le 1er avril 2005. Il se trouve sur un îlot de gravier et de sable situé sur le cours du Lom (UTM 33 N – E 356906, N 587037 – alt. 647 m) où des tessons de poterie décorée à la roulette (CWR, KPR ou TGR) ont été identifiés en surface. La poterie présente un fond plat. Certains tessons sont érodés et ont manifestement subi des séjours répétés dans l’eau. Toutefois, le degré d’usure du matériau démontre qu’ils n’ont pas été transportés sur de grandes distances.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 39/95
Photo 8 : Tessons de poterie décorés à la roulette, fond de vase plat (LP 10)
Interprétation LP 10 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
Le style de la céramique est très différent de celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 10 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.11 LP 11
Description LP 11 a été découvert le 1er avril 2005. Il se trouve sur une plage de gravier et de sable sur la berge du Lom (UTM 33 N – E 359069, N 588187 – alt. 643 m) où des tessons de poterie non décorés ont été identifiés en surface. Ils sont tous très érodés et ont manifestement subi des séjours répétés et prolongés dans l’eau.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 40/95
Interprétation Le site LP 11 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
Le style de la céramique est non diagnostique et il est impossible de le rattacher à une tradition régionale quelconque, encore moins de le dater même approximativement.
Importance et priorité La pauvreté et le contexte incertain du matériel de LP 11 en font un site peu important scientifiquement. Il peut être inondé sans perte pour le patrimoine archéologique du pays. Toutefois il est possible qu’il signale un site plus intéressant quelque part sur la même berge, voire en amont.
5.2.12 LP 12 – Kogbedi
Description LP 12 est situé le long de la rivière Kogbedi, à quelques 500 mètres au sud de la berge du Lom (UTM 33 N – E 351481, N 587851 – alt. 659 m), sur un plateau aujourd’hui en savane. Il a été découvert le 2 avril 2005. Les artéfacts apparaissent dans les champs de la famille qui habite le hameau de Kogbedi : il s’agit d’un assemblage de tessons de poterie décorée à la roulette en bois (CWR). Les décors montrent les mêmes rangs de zigzags horizontaux présents à LP 07 et LP 08 mais ce motif semble ici omniprésent bien qu’il soit figuré sous de nombreuses variantes. Le site s’étend approximativement sur une surface de 100 x 100 mètres au moins (10.000 m²) mais est certainement plus étendu que cela.
Photo 9 : Tessons de poterie décorés à la roulette en bois (LP 12)
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 41/95
Interprétation Le site de la rivière Kogbedi est un village établi le long d’un cours d’eau permanent. La présence d’une riche céramique est encore un indice de la durée de l’établissement. Le site était inconnu des villageois et n’est donc pas lié à la dernière phase de peuplement de la région.
Importance et priorité LP 12 – Kogbedi est un site scientifiquement important : il s’agit d’un vaste village de l’Age du Fer, probablement ancien, situé dans une zone où les données archéologiques sont encore très lacunaires. Il sera inondé et doit donc être traité de façon prioritaire pour préserver les informations qu’il peut livrer sur la vie des populations pré-Gbaya de la région.
5.2.13 LP 13 – Ancien Kogbedi
Description LP 13 se trouve à 1,3 km au sud-est du village de Kogbedi à l’intérieur des terres (UTM 33 N – E 362079, N 587438 – alt. 698 m). Il a été découvert le 2 avril 2005. Le site a été indiqué par les villageois : c’est leur ancien village, aujourd’hui situé en forêt. Il s’agit d’une clairière anthropique où des traces de maisons sont encore visibles. Le site s’étend approximativement sur une surface de 50 x 50 mètres au moins (2.500 m²).
Interprétation Il s’agit de l’ancien village des habitants actuels de Kogbedi. Deux familles y vivaient avant de se séparer à cause de disputes internes. Le village a été abandonné il y a une dizaine d’années.
Importance et priorité Le site LP 13 est sans importance scientifique et n’est pas prioritaire.
5.2.14 LP 14
Description Le site LP 14 est situé sur une plage de gravier et de sable, sur la berge du Lom (UTM 33 N – E 361337, N 588331 – alt. 646 m). Il a été découvert le 2 avril 2005. Quelques tessons de poterie décorée de traçages au bâtonnet ou au doigt et d’impressions à la roulette (CWR, KPR) ont été identifiés en surface. Les artefacts sont très érodés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau, voire été déplacés sur une distance significative.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 42/95
Photo 10 : Tessons de poterie décorés au doigt et à la roulette (LP 14)
Interprétation LP 14 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ces hypothèses ne s’excluent pas l’une l’autre.
Les décors de la céramique sont très différents de celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte comme la pauvreté du site LP 14 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.15 LP 15
Description Le site LP 15 est situé sur un îlot de gravier et de sable au milieu du Lom (UTM 33 N – E 361344, N 588598 – alt. 653 m) et a été découvert le 2 avril 2005. De nombreux tessons de poterie décorée de traçages et d’impressions au bâtonnet ou au peigne et d’impressions à la roulette (CWR, KPR) ont été identifiés en surface. Les poteries présentent des fonds concaves et plats. Les artefacts sont érodés à divers degrés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau, voire été déplacés sur une distance significative pour certain.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 43/95
Photo 11 : tesson de poterie décoré à la roulette en fibre (LP 15)
Interprétation LP 15 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ce qui semble le cas, ces hypothèses ne sont évidemment pas exclusives.
Les décors de la céramique sont très différents de celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte apparemment perturbé et hétérogène du site LP 15 en fait un site de moindre importance scientifique malgré la richesse du matériel. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.16 LP 16
Description Le site LP 16 est situé sur un îlot de gravier et de sable sur le Lom (UTM 33 N – E 364270, N 590559 – alt. 645 m) et a été découvert le 2 avril 2005. Quelques tessons de poterie non décorés ont été identifiés en surface. Les artefacts sont très érodés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau, voire été déplacés sur une distance significative.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 44/95
Interprétation LP 16 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ce qui semble le cas, ces hypothèses ne sont évidemment pas exclusives.
La céramique étant non diagnostique, il n’est pas possible d’attribuer une affiliation culturelle, encore moins un âge, à ce site.
Importance et priorité La pauvreté et le contexte non stratifié du site LP 16 en font un site de moindre importance scientifique. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.17 LP 17 – Dongo
Description LP 17 est situé le long de la rivière Dongo, à quelques 300 mètres au sud de la berge (UTM 33 N – E 366831, N 588399 – alt. 674 m), au sommet d’une colline encerclée par un méandre du Lom. Il a été découvert le 3 avril 2005. Les artefacts apparaissent dans les champs de la famille qui habite le hameau de Dongo : il s’agit d’un assemblage de tessons de poterie décorée à la roulette (CWR, KPR, TGR). Les motifs en zigzag très fréquents dans le sud semblent ici absents. Ils sont remplacés par une variété de motifs comme les « grains de riz », des damiers ou des rangs de cercles. Le site s’étend approximativement sur une surface de 200 x 100 mètres (20.000 m²) mais est probablement plus étendu que ça.
Photo 12 : Vue générale du site LP 17 - Dongo
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 45/95
Interprétation Le site de la rivière Dongo est un grand village établi le long d’un cours d’eau permanent. La présence d’une riche céramique aux décors variés est encore un indice de la durée et de l’ampleur de l’établissement (présence de nombreux artisans sur place ?). Le site était inconnu des villageois actuels et n’est donc pas lié à la dernière phase de peuplement de la région. Il date manifestement de l’Age du Fer et son âge doit être compris entre 2.000 et 500 BP.
Photo 13 : Tessons de poterie décorés à la roulette (LP 17)
Importance et priorité LP 17 - Dongo est un site archéologique important : il s’agit d’un vaste village de l’Age du Fer, probablement ancien, situé dans une zone où les données archéologiques sont encore très lacunaires. Il sera très probablement inondé et doit donc être traité de façon prioritaire pour préserver les informations qu’il peut livrer sur la vie des populations pré-Gbaya de la région.
5.2.18 LP 18
Description LP 18 est situé à quelques 1.300 mètres au sud-est de Dongo (UTM 33 N – E 367949, N 588066 – alt. 680 m), dans les terres. Il a été découvert le 3 avril 2005. Les artéfacts ont été signalés par les habitants de Dongo et apparaissent dans d’anciens champs préparés par les occupants d’un camp d’orpailleurs. Quelques rares tessons de céramiques décorées à la roulette en fibre (KPR), une meule et une molette ont été identifiés. Le site s’étend approximativement sur une surface de 200 x 200 mètres (40.000 m²) mais est probablement plus étendu que ça.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 46/95
Interprétation LP 18 est un grand village établi le long d’un cours d’eau permanent. La présence de meules est un indice de la durée de l’établissement. Les producteurs de la poterie sont inconnus des villageois actuels et ne sont donc pas liés à la dernière phase de peuplement de la région. L’âge du village doit être situé quelque part entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité LP 18 est un site archéologique dont l’importance n’est pas encore évaluée avec précision. Si l’on en croit les villageois, ils trouvaient de très nombreux tessons à cet emplacement mais les archéologues du Projet n’en ont identifié que quelques-uns. Toutefois il semble que le site se trouve en dehors de la zone inondable (à en croire les indications GPS) et ne doive pas être considéré comme prioritaire.
5.2.19 LP 19
Description Le site LP 19 est situé sur un îlot de gravier et de sable au milieu du Lom (UTM 33 N – E 361344, N 588598 – alt. 651 m), non loin en aval de Dongo et a été découvert le 3 avril 2005. De nombreux tessons de poterie décorée de traçages au bâtonnet et d’impressions à la roulette (CWR) ont été identifiés en surface. Le motif en zigzag omniprésent dans les sites plus au sud est présent ici, organisé en bandes horizontales et diagonales sur la panse d’un récipient. La poterie est associée à un fragment de pipe en argile. Comme d’habitude, les artefacts sont érodés à divers degrés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau.
Photo 14 : Tessons de poterie décorés à la roulette et au bâtonnet, fragment de pipe en argile (LP 19)
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 47/95
Interprétation LP 19 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche (peut être Dongo) venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage) ces hypothèses ne sont évidemment pas exclusives.
Les décors de la céramique sont très différents de celui de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP. Toutefois, si l’assemblage est homogène, la présence de la pipe indique un âge postérieur au 16ème siècle (date de l’introduction du tabac en Afrique).
Importance et priorité Le contexte apparemment perturbé du site LP 19 en fait un site de moindre importance scientifique malgré la richesse du matériel. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine.
5.2.20 LP 20
Description Le site LP 20 est situé sur un îlot de gravier et de sable au milieu du Lom (UTM 33 N – E 367155, N 589934 – alt. 648 m) et a été découvert le 4 avril 2005. De nombreux tessons de poterie décorée de traçages et d’impression au bâtonnet ou au peigne et d’impressions à la roulette en fibre (TGR et/ou KPR) ont été identifiés en surface. Un type de roulette mérite d’être mentionné : il s’agit d’une roulette réalisée à partir de l’épi d’une plante (peut être Blepharis). Les artefacts sont érodés à divers degrés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau, voire été déplacés sur une distance significative pour certain.
Photo 15 : Tessons de poterie décorés à la roulette (LP 20)
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 48/95
Interprétation LP 20 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ce qui semble le cas, ces hypothèses ne sont évidemment pas exclusives.
Les décors de la céramique sont très différents de ceux de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte perturbé du site LP 20 en fait un site de moindre importance scientifique malgré la richesse du matériel. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
5.2.21 LP 21
Description Le site LP 21 est situé sur un îlot de gravier et de sable au milieu du Lom (UTM 33 N – E 352002, N 586415 – alt. 650 m) et a été découvert le 4 avril 2005. Quelques tessons de poterie décorée d’impressions à la roulette en fibre (TGR) et en bois (CWR) ont été identifiés en surface. Le motif en zigzag caractéristique de la zone est présent. Les artefacts sont érodés à divers degrés et ont certainement séjourné à plusieurs reprises dans l’eau, voire été déplacés sur une distance significative pour certain.
Interprétation LP 21 peut être interprété de différentes manières à ce stade de l’étude : il peut s’agir (1) d’un emplacement visité épisodiquement où les habitants d’un village proche venaient à la rivière, (2) d’un campement temporaire de pêcheurs ou encore (3) d’un dépôt secondaire d’artefacts amenés par l’eau (en provenance d’un site érodé situé en amont). Au cas où les tessons ne feraient pas partie d’un ensemble homogène (provenant tous d’un même assemblage), ce qui semble le cas, ces hypothèses ne sont évidemment pas exclusives.
Les décors de la céramique sont très différents de ceux de la poterie Gbaya moderne. Ce matériel peut avoir n’importe quel âge entre 2.000 et 200 BP.
Importance et priorité Le contexte perturbé du site LP 21 en fait un site de moindre importance scientifique malgré la richesse du matériel. Il n’est donc pas prioritaire en vue d’un traitement futur et peut être inondé sans perte pour le patrimoine. Toutefois, il indique à coup sûr la présence d’un site plus important dans les environs, non encore identifié (quelque part sur les terres).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 49/95
5.2.22 LP 22 – Ancient Ouami I
Description LP 22 est situé le long de la piste qui mène de Ouami au Lom, à quelques 2 kilomètres au sud-ouest de la berge (UTM 33 N – E 344632, N 581932 – alt. 669 m). Il a été découvert le 5 avril 2005. Il s’agit de l’ancien village de Ouami, déplacé par le Projet il y a déjà 20 ans. Le site s’étend approximativement sur une surface de 300 x 300 mètres au moins (90.000 m²) mais aucune structure n’est visible sous le couvert végétal (la forêt a déjà repoussé).
Importance et priorité LP 22 – Ancien Ouami I est un site récent. Il peut être inondé sans perte pour le patrimoine archéologique du pays. Toutefois, dans le cas où des tombes seraient présentes elles doivent être prioritairement prises en charge par l’équipe socio-économique du PAE.
5.2.23 LP 23 – Ancien Ouami II
Description LP 23 est situé le long de la piste qui mène de Ouami au Lom, à quelques 3 kilomètres au sud-ouest de la berge (UTM 33 N – E 343778, N 581718). Il a été découvert le 5 avril 2005. Il s’agit de l’ancien village de Ouami, déplacé par le Projet une seconde fois il y a déjà 15 ans. Le site s’étend approximativement sur une surface de 200 x 400 mètres au moins (80.000 m²) mais aucune structure n’est visible sous le couvert végétal (la forêt a déjà repoussé).
Importance et priorité LP 24 – Ancien Ouami II est un site récent. Il peut être inondé sans perte pour le patrimoine archéologique du pays. Toutefois, dans le cas où des tombes seraient présentes elles doivent être prioritairement prises en charge par l’équipe socio-économique du PAE.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 50/95
5.3 Zones sensibles
Tous les sites archéologiques ne peuvent pas être découverts lors de la prospection préliminaire. Toutefois, sur base d’indices géographiques et archéologiques, il est possible d’établir des zones potentiellement riches archéologiquement alors même qu’aucun site important n’a encore été formellement identifié. Cette démarche vise à rationaliser les interventions des archéologues lors du PAE (avant les travaux et lors de la surveillance.)
La prospection préliminaire le long des berges sud du Lom a permit d’identifier une zone particulièrement sensible : elle est située entre les points GPS UTM 33 N – E 351999, N 585826 et E 353996, N 586240 (voir carte 2). Ce coude très accentué de la rivière est singulièrement riche en sites archéologiques de peu d’importance mais ils sont certainement l’indice de la présence de sites beaucoup plus grands et plus riches dans l’intérieur des terres, non loin de la.
Le partie non prospectée du Lom doit être considérée comme une zone sensible dans son ensemble. En effet, sur base des données collectées lors de l’EIE, il est prouvé que la rivière présente une très grande densité de sites archéologiques : la section de la rivière située entre les villages de Doué et de Touraké doit donc être prospectée prioritairement.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 51/95
6 LE PANGAR : DONNEES DU PIPELINE TCHAD-CAMEROUN
6.1 Zone couverte
Le Pangar n’a pas pu être prospecté pour l’EIE étant données les contraintes du calendrier. Toutefois nous pouvons déjà avoir une idée assez précise du patrimoine archéologique potentiel de la zone grâce aux données collectées par le Projet du Pipeline Tchad-Cameroun36. En effet l’emprise du pipeline coupe la zone inondable au nord-est du barrage en plusieurs points.
A la différence de la prospection de l’EIE pour le Projet Lom Pangar, l’emprise du pipeline dans la zone a été contrôlée à plusieurs reprises par les archéologues: une prospection préalable avant la construction (comprenant un programme de carottage systématique) et une surveillance des travaux (lors du terrassement et lors du creusement de la tranchée.) Il faut tenir compte de cette différence lors des comparaisons entre les résultats des deux projets.
Carte 2 : Sites archéologiques découverts lors de l’EIE du PLP et sur l’emprise du pipeline (CEP37)
36 Lavachery et al. 2005 ; Lavachery 2005 37 Chad Export Project
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 52/95
6.2 Description des sites
Dix-neuf sites archéologiques ont été identifiés sur les 52 kilomètres de l’emprise du pipeline compris entre les villages de Lom I (KP 537) et Mararaba (KP 485) (voir inventaire et descriptions, annexes B et C)38. Cela fait une densité de 1 site/2.7 kilomètres (0,37 sites/km).
Quatorze d’entre eux sont des sites de surface et 5 sont des sites stratifiés. Parmi les sites de surface, 11 consistent en concentrations de tessons de poterie et 2 en concentrations d’artefacts divers (poterie, tuyères, meules). Les sites stratifiés comprennent 2 horizons de céramique et 3 horizons d’artefacts divers (poterie, scories, tuyères, éclats de débitage).
Cinq (ou six) de ces sites ont été classés importants : ECA 163, ECA 171 - Pangar, ECA 173 – Pangar, ECA 177 – Lom I, ECA 185 – Lom I et ECA 199 – Pangar.
ECA 163 – Lom I est une concentration de tessons, de scories et de fragments de tuyères situés sur un sommet de colline (400 m²). La poterie est de facture Gbaya et le matériel a livré une date radiocarbone assez récente (240+/-70 BP) située entre 1500 et 1950 cal D. Le site est manifestement un ancien village Gbaya, habité dans les derniers siècles de notre ère.
ECA 171 et 173 sont peut être un seul et même vaste site de surface livrant de la poterie décorée à la roulette (CWR) et des fragments de meule. Les artefacts sont répartis sur une surface de 350.000 m² sur un vaste sommet de colline (approx. 754 m d’altitude).
ECA 177 – Lom I est une trouvaille isolée : une hache polie en dolérite. L’outil n’était associé à aucun autre artefact ni structure mais la rareté de ce type d’objet et la possibilité qu’il suggère la présence d’un site à proximité de l’emprise du pipeline a justifié son classement.
ECA 185 – Lom I consiste en une concentration de tessons de poterie décorée à la roulette (KPR) répartie sur une centaine de mètres le long de l’emprise du pipeline (2.500 m²), sur un sommet de colline (altitude 704 m).
ECA 199 – Pangar est un site majeur de la région : il s’agit d’un horizon de tessons de poterie et de débris de débitage lithique, enfoui à 50-60 cm sous la surface et répartis sur une distance de 200 mètres le long de l’emprise du pipeline. La surface totale du site est évaluée à quelque 40.000 m², peut être plus. La céramique est décorée principalement à la roulette (CWR, TGR, KPR). Le site a été sondé dans l’emprise du pipeline et un échantillon de charbon de bois a été daté de 920+/-120 BP (885-1295 cal AD). Il semble que ECA 199 soit situé dans la zone inondable.
38 Lavachery 2005
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 53/95
6.3 Zones sensibles
La carte 3 montre qu’a ce stade de l’étude où que l’on cherche et quelle que soit la méthode de prospection utilisée (prospection de surface, carottage systématique, surveillance des travaux), des sites archéologiques sont identifiés. L’intégralité de la zone du Pangar doit donc être considérée comme une zone sensible à ce stade et faire, prioritairement, l’objet d’une prospection.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 54/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 55/95
7 INTERPRETATIONS CHRONO-CULTURELLES PRELIMINAIRES
La zone inondable du barrage Lom Pangar recèle un riche patrimoine archéologique. Etant donnée la densité de sites identifiés le long des berges du Lom (environ un site tous les deux kilomètres) comparée à celle de l’intérieur des terres au nord du Pangar (environ un site tous les trois kilomètres) il semblerait même que les grandes rivières de la région entraînaient une concentration de l’habitat. Il n’est pas impossible, au vu de l’extension des sites anciens comparés aux hameaux actuels, que la zone ait été beaucoup plus peuplée par le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui.
En l’absence de datations absolues, il est difficile de donner un âge précis aux occupations humaines identifiées le long du Lom. Le seul indice chronologique utilisable pour le moment est la typologie de la poterie. Les populations actuelles de la zone (principalement Gbaya) produisent (ou produisaient encore récemment) une céramique typique, polie et noircie au graphite et assez peu décorée39. Les décors sont le plus souvent limités à des bandes étroites d’impressions à la roulette (en bois ou en fibre) au niveau du col. Les fonds sont systématiquement convexes. Or la poterie archéologique du Lom semble très différente : les décors d’impressions à la roulette en bois et en fibre apparaissent beaucoup plus couvrants et plus variés et les fonds de vase sont souvent plats, voire concaves. Il est difficile de qualifier les traitements de surface de la poterie découverte sur les berges du Lom étant donné les séjours répétés que les tessons on fait dans l’eau, mais la céramique des trois sites situés dans les terres confirme l’absence de polissage et de graphitage.
La céramique du nord de la zone, par contre, montre à la fois des caractéristiques comparables à celles décrites sur le Lom (comme à ECA 199 – Pangar) ou des types proches de la céramique Gbaya actuelle ou sub-actuelle (comme à ECA 163 – Lom I). Rappelons que l’assemblage de ECA 199 a été daté les 9ème et 13ème siècles de notre ère et que celui de ECA 163 – Lom I date des deux derniers siècles : il semble donc qu’on soit en présence de deux ensembles culturels, bien divergent chronologiquement et typologiquement. Il n’est pas impossible, si l’on en croit les études ethno-historiques40, qu’il s’agisse de l’illustration, dans la culture matérielle, de deux phases de peuplement distinctes.
La profondeur chronologique du peuplement de la région pourrait même être plus ancienne encore : deux sites archéologiques découverts un peu plus loin de la zone d’impact du Projet ont été datés aux environs de 2.000 BP : ECA 47 – Djaoro Mbama (sur l’emprise du pipeline)41 et Wélé-Maroua (dans le sud de la route Bertoua – Garoua Boulaï)42. ECA 47 est un groupe de fourneau de réduction de fer – qui prouvent que la métallurgie était déjà connue il y a deux millénaires à 150 km
39 Gosselain 1995 40 Burnham 1981; Burnham et al. 1986; Faraut 1981 41 Lavachery et al. 2005 42 Asombang et al. 2003
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 56/95
au nord de la zone – alors que Wélé Maroua est un ensemble de fosses détritiques typiques de la zone forestière, représentant un vaste village de l’Age du Fer à 70 km au sud-est de la zone. De nombreux sites de l’Age de la Pierre (plus anciens que 3.000 BP) ont aussi été identifiés sur l’emprise du pipeline au nord de la zone du Projet.
Il n’est pas possible pour l’instant d’attribuer les différences stylistiques dans les décors observées dans la poterie le long du Lom à une hétérogénéité synchronique ou à une variation diachronique. Tout au plus peut-on penser que la diversité culturelle dans la zone, tant dans l’espace que dans le temps, était beaucoup plus grande dans le passé qu’actuellement.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 57/95
8 ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Nous avons vu que toute la zone d’impact du Projet semble riche en patrimoine archéologique : l’impact négatif du barrage et de la retenue d’eau sur ce patrimoine est indubitable. Toutefois l’impact du Projet diffèrera dans la zone inondée et dans la zone de construction.
8.1 Impact dans la zone inondée
Les caractéristiques de l’impact du Projet sur le patrimoine archéologique dans la zone inondée sont les suivantes :
• Il est inévitable. • Il est aussi irréversible, puisque chaque site archéologique est par essence
unique et irremplaçable. • Il peut toutefois être atténué (voir section 8.1).
Le patrimoine archéologique de la zone inondée (550 km²) n’est pas encore connu de façon exhaustive mais il peut être évalué grâce aux données collectées lors de l’EIE et du pipeline Tchad-Cameroun.
• Dix-neuf sites ont été identifiés dans l’emprise du pipeline43 (52 km de long x 30 m de large) entre les villages de Lom I et de Mararaba, sur une surface de 16 km². En ligne cela équivaut à une densité de 1 site/2,7 km. Ces sites présentaient un diamètre variant entre 10 et 700 mètres et 5 d’entre eux ont été classés importants (26 %.)
• Nous avons vu que 23 sites ont été identifiés sur les 52 km de berges du Lom. Cela équivaut à 1 site/2,3 kilomètres. Six d’entre eux ont été classé prioritaires (26 %.)
• Selon ces données, il pourrait y avoir entre 250 et 350 sites dans la zone inondée, dont 40 à 80 pourraient être scientifiquement importants (de 15 à 25 %.)
L’impact du Projet sur le patrimoine archéologique de la région sera donc considérable en termes quantitatifs. En terme qualitatif aussi il apparaît, grâce aux études des sites de l’emprise du pipeline, que des sites anciens (au moins millénaires) pourront être perdus.
43 Lavachery 2005
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 58/95
8.2 Impact dans la zone de construction
La zone de construction comprend :
• Le barrage lui-même. • Les carrières de latérite. • Les routes d’accès (temporaires et permanentes). • La ligne de haute tension.
Les caractéristiques de l’impact dans les zones de construction sont les suivantes :
• L’impact est théoriquement évitable. • Comme pour la zone inondée, s’il y a impact, il est irréversible. • L’impact peut être atténué (voir section 8.2).
Etant donné l’ignorance de l’ampleur de la surface concernée par les travaux à ce stade de l’étude archéologique, il n’est pas possible de chiffrer le potentiel archéologique qui sera touché.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 59/95
9 MESURES D’ATTENUATION DE L’IMPACT : PLANS DE TRAITEMENT SPECIFIQUES (SITES PRIORITAIRES)
9.1 Dans la zone inondée
Tous les sites prioritaires identifiés à ce stade sont situés dans la zone inondée perpétuellement par la retenue d’eau (proches des berges de la rivière et à une altitude inférieure à 675 mètres.) Il est impossible de les contourner, il faut donc sauver les données scientifiques avant l’impact de la construction (qui ne peut résulter qu’en une destruction totale.) Le sauvetage des données scientifiques ne peut se faire que par la fouille du site et l’étude du matériel collecté. Celles-ci devraient procéder comme suit :
a) Cartographie du site (échelle 1/20). b) Ouverture d’un pourcentage adapté de la surface totale du site. c) Décapage par couches artificielles de 10 cm d’épaisseurs. d) Tamisage tous les sédiments à travers une maille de 0,5 cm. e) Pendant les fouilles, tous les artefacts comme les tessons de poterie,
l’outillage lithique et les débris de débitage sont collectés. f) Au cours du décapage les grands artefacts ou les structures sont laissés en
place le plus longtemps possible pour être cartographiés et photographiés. g) Les ossements, coquillages, charbon de bois sont collectés
systématiquement pour datation radiocarbone. h) Des échantillons de sol sont collectés pour analyse par flottation. i) Les couleurs des sédiments sont identifiées selon le Munsell Soil Color
Chart. j) Prise de note complètes et précises des procédures de terrain et des
résultats, avec illustration par photo, plans, profils et dessins. k) Les artefacts et les données associées seront étudiés en laboratoire. l) Les résultats des fouilles et des études de laboratoire seront publiés.
A ce stade, les sites suivants déjà identifiés lors de l’EIE et lors des travaux du pipeline Tchad-Cameroun, devraient être fouillés :
• LP 02 – Maroua • LP 07 • LP 08 • LP 12 – Kogbedi • LP 17 – Dongo • ECA 199 - Pangar
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 60/95
9.2 Dans la zone de construction
Ici l’impact du Projet peut théoriquement être évité grâce aux mesures suivantes (souvent plus rapides et moins onéreuses que les fouilles) :
• Contournement (le chantier prévu est déplacé définitivement)
• Enterrement volontaire (une couche de terre est déposée sur le site si les infrastructures prévues sont temporaires)
Dans les cas où l’impact ne peut être évité, il peut être atténué (comme dans la zone inondée) en récupérant les données archéologiques par une fouille systématique. Les données archéologiques collectées (artefacts, plans, cartes, échantillons, photos, etc.) doivent ensuite faire l’objet d’une étude scientifique dans les normes internationales :
• Inventaire des sites, objets et données collectées.
• Description des sites et des artefacts.
• Datations radiocarbone.
• Analyse des données.
• Publication des données.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 61/95
10 RECOMMANDATIONS POUR LE PAE
L’étude d’impact environnemental avait pour objectif d’évaluer le potentiel archéologique de la zone d’impact du barrage Lom Pangar. En aucun cas les résultats produits ici ne peuvent être considérés comme suffisants pour servir à une intervention adéquate lors du plan d’action.
10.1 Prospections supplémentaires
La plus grande partie de la zone d’impact du Projet reste à prospecter. Cette prospection, qui seule permet de connaître le patrimoine archéologique avant la construction, doit être réalisée dans le cadre du PAE :
• L’EIE a prouvé la richesse des berges du Lom. Le reste des berges du Lom (entre Doué et Touraké et entre Ouami et Lom Pangar) devrait être prospecté, ainsi que celles du Pangar dans leur totalité (entre Lom Pangar et l’emprise du pipeline).
• L’intérieur des terres recèle aussi un riche patrimoine archéologique : il doit être évalué. Un transect devrait être réalisé tous les 500 mètres partant des berges de la rivière jusqu’à la limite de la zone inondée (si possible).
• Les carrières de latérite ainsi que les routes d’accès au chantier devraient aussi être prospectées dans le cadre du PAE. Pour ce faire, les archéologues doivent être en possession au plus vite de plans de construction précis localisant les zones de terrassement.
• Ces études supplémentaires combineront prospection de surface et carottages à la tarière.
• L’étude des photos aériennes disponibles peut être :
o utile pour les configurations géographiques favorables à l’établissement des populations anciennes
o et/ou indicatives de l’établissement de ces populations (savanes incluses, cours d’eau, collines, abris sous roche, etc.)
10.2 Monitoring des travaux et rôle des entreprises
10.2.1 Surveillance des travaux
La surveillance des travaux est une phase essentielle de tout plan de gestion du patrimoine archéologique. Elle ne s’applique évidemment qu’aux chantiers impliquant du terrassement (barrage, carrières, routes, lignes de haute tension, etc.) et doit impérativement faire partie du PAE:
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 62/95
• On estime qu’entre 45 et 55% (selon le couvert végétal) des sites présents dans une zone donnée sont découverts lors de la surveillance des travaux (données du pipeline)44.
• Les travaux de terrassement devraient donc être surveillés afin de permettre l’identification des sites qui n’auraient pas été découverts lors de la prospection préliminaire.
• La présence d’archéologues est, idéalement, nécessaire tout au long des travaux, en particulier dans les zones où des sites importants ont été identifiés ou dans les zones déclarées sensibles lors de l’EIE.
• Les sites identifiés lors de la surveillance des travaux sont traités de la même manière que ceux découverts lors de la prospection préliminaire.
10.2.2 Consignes aux entreprises
Au cas où les archéologues ne seraient pas présents physiquement sur le chantier pendant les travaux, certaines procédures peuvent être imposées aux entreprises (et aux archéologues) en cas de découverte fortuite d’un site archéologique45 :
• Formation préalable rapide (un ou deux jours) de certains employés à la reconnaissance d’un site archéologique important.
• Notification immédiate de l’équipe chargée de la gestion environnementale. • Les archéologues doivent arriver sur place dans les 24 heures afin d’évaluer
l’importance du site. • Un plan de traitement du site doit être rédigé et transmis à la direction de
l’équipe environnementale le jour même afin d’être diffusé aux entreprises concernées le lendemain au plus tard.
• En attendant la mise en œuvre du PTS, on demandera aux sociétés de construction de contourner le site ou d’attendre.
44 Lavachery et al. 2005, Lavachery 2005 45 ExxonMobil 1998
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 63/95
10.3 Construction d’un musée local
La Banque Mondiale comme la CMB favorisent les projets comportant un volet de renforcement des institutions locales (« capacity building »)46. Dans cet ordre d’idée il est envisageable (bien que non obligatoire) de mettre sur pieds un petit musée local qui exposerait les trouvailles archéologiques faites d ans le cadre du Projet Lom Pangar. Les remarques suivantes doivent impérativement être prises en compte :
• Le musée doit être mis sur pieds en accord et en collaboration avec le Ministère de la Culture, sauf s’il s’agit d’un musée privé
• Il faut prévoir, outre le budget initial (construction ou rénovation, équipement), des fonds de fonctionnement pour les années futures (entretien, personnel…)
• Le bâtiment devrait être idéalement situé à Bertoua ou à Belabo, afin d’être accessible aux écoles de la Province
• Deux options de gestion sont envisageables: (1) Le MinCult gère le budget et est responsable de la bonne marche des travaux (avantageux en terme de temps et de logistique) ou (2) le Projet s’occupe de tout et livre un musée « clés sur porte » au Ministère (avantageux en terme de garantie de résultat).
46 World Bank 1987, 1991; CMB 2000
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 64/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 65/95
11 CONCLUSIONS
La prospection préliminaire de l’EIE n’a porté que sur une partie de la zone d’impact du Projet. Vingt-trois sites archéologiques ont été découverts dans les 40 kilomètres du cours du Lom en amont du village de Ouami, parmi lesquels 5 sont déjà considérés comme prioritaires en vue de mesures d’atténuation d’impact. Toutefois, en se basant sur les résultats de cette prospection et sur les données publiées par les projets CEP47 et BGB48, on peut évaluer de façon précise le patrimoine archéologique potentiel de la zone.
Il est certain à ce stade que l’impact du Projet sur le patrimoine archéologique de la région concernera au moins une quarantaine de sites importants. Il faut s’attendre à ce que l’ennoiement de la zone ainsi que les travaux provoquent la perte de sites datés entre 1.000 (voire 2.000) ans et 200 ans d’âge. La présence de sites de l’Age de la Pierre (plus anciens que 3.000 ans) n’est pas exclue. Il s’agira principalement de villages de l’Age du Fer, mais il est très probable que des sites de réduction de fer ou des stations de débitage de la pierre puissent aussi être concernés.
La plus grande partie de cet impact est totalement inévitable et irréversible, mais peut être atténuée. Alors que les sites qui seront identifiés dans la zone des travaux de construction pourront théoriquement être contournés (annulant ainsi l’impact), ceux qui se trouvent dans la zone inondée seront perdus. La fouille de ces sites atténuera les conséquences de cette perte grâce à la récolte des artefacts et des données archéologiques.
47 Chad Export Project 48 Route Bertoua - Garoua Boulaï
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 66/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 67/95
12 ANNEXES
12.1 Bibliographie
[1] ASOMBANG, R., C. MBIDA et M. DELNEUF (2003). Surveillance archéologique de
l’axe routier Bertoua - Garoua Boulaï – Rapport final. Paris : IRD.
[2] BURNHAM, P. (1981). Notes on Gbaya History. In Contribution de la recherche ethnologique à l’histoire des civilisations du Cameroun. (ed. Tardits, C.) : pp. 121-130. Paris: CNRS.
[3] BURNHAM, P., E. COPET-ROUGIER et P. NOSS (1986). Gbaya et Mkako: contribution ethno-linguistique à l’histoire de l’Est-Cameroun. Paideuma 32 : 87-128.
[4] DAVID, N. et KRAMER, C. (2001). Ethnoarchaeology in Action. Cambridge: Cambridge University Press.
[5] EXXONMOBIL (1998). Chad Export Project – Environmental Management Plan – Cameroon Portion. Vol. 1. Houston : ExxonMobil.
[6] FARAUT, F. (1981). Les Mboum. In Contribution de la recherche ethnologique à l’histoire des civilisations du Cameroun. (ed. Tardits, C.) : pp. 159-169. Paris: CNRS.
[7] GOSSELAIN, O. (1995). Identités techniques. Le travail de la poterie au Cameroun méridional. Thèse de Doctorat: Université Libre de Bruxelles.
[8] LAVACHERY, Ph. (2005). Chad Export Project. Archaeological Impact Mitigation Plan: Final Report. COTCO et EEPCI
[9] LAVACHERY, P., S. MacEACHERN, T. BOUIMON, P. KINYOCK, B. GOUEM, O. NKOKONDA, J. MBAIRO et C. MBIDA (2005). From Komé to Ebomé. Archaeological Research for the Chad Export Project 1999-2003. Journal of African Archaeology.
[10] MABULLA, A.Z.P. (2000). Strategy for Cultural Heritage Management (CHM) in Africa: A Case Study. African Archaeological Review, 17 (4), 211-233.
[11] MacEACHERN, S. (2001). Cultural resource management and Africanist archaeology. Antiquity, 75, 866-871.
[12] MBIDA , C., ASOMBANG, R. et DELNEUF, M. (2001). Rescue archaeology in eastern Cameroon. Antiquity, 75, 805-6.
[13] McINTOSH, S. K. (1993). Archaeological heritage management and site inventory systems in Africa. Journal of Field Archaeology, 20, 500-504.
[14] MILLER, D.E. et VAN DER MERWE, N.J. (1994). Early metal working in sub-Saharan Africa: a review of recent research. Journal of African History 35: 1-36.
[15] OSLISLY, R., TUECHE, R., KINYOCK, P. et NKOKONDA, O. (2000). Archaeological reconnaissance studies, Tchad Export Project: Kribi, Bipindi/Ndtoua, Lolodorf, Ngaoundal, Boforo and Ngan-Hi. Yaoundé, COTCO.
[16] SOPER, R. (1985). Roulette decoration on African pottery: technical considerations, dating and distributions. The African Archaeological Review 3: 29-51.
[17] VAN DER MERWE, N.J. et AVERY, D.H. (1987). Science and magic in African technology: Traditional iron smelting in Malawi. Africa 57(2): 143-72.
[18] WORLD BANK (1987). The Management of Cultural Property in World Bank-Assisted Projects. Archaeological, Historical, Religious and Natural Unique Sites. World Bank Technical Paper Number 62. The World Bank: Washington D.C.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 68/95
[19] WORLD BANK (1991). Environmental Assessment Sourcebook. Volume III: Guidelines for Environmental Assessment of Energy and Industry Projects. World Bank Technical Paper Number 154. The World Bank: Washington D.C.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 69/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 70/95
12.2 Annexe A : inventaire des sites archéologiques découverts sur le Lom
Site Date Nom Eastings (UTM 33 N)
Northings (UTM 33 N)
Type Artefacts Age probable Intérêt scientifique Priorité
LP 01 29-mars-2005 Ouami 341508 579702 Site de surface Poterie décorée, éclats de débitage
Age du Fer Haut Basse
LP 02 30-mars-2005 Rivière Maroua
351336 584466 Site en stratigraphie Poterie décorée, éclats de débitage, nucléus, meules, molettes
Age du Fer Haut Haute
LP 03 30-mars-2005 351999 585826 Site de surface Poterie décorée Age du Fer Bas Basse
LP 04 30-mars-2005 351779 586741 Site de surface Poterie décorée Age du Fer Bas Basse
LP 05 31-mars-2005 351399 587283 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR) Age du Fer Bas Basse
LP 06 31-mars-2005 351945 587438 Site de surface Poterie décorée (CWR, KGR, peigne)
Age du Fer Bas Basse
LP 07 31-mars-2005 353181 586235 Site de surface Poterie décorée (CWR, peigne), tuyères
Age du Fer Haut Haute
LP 08 1-avr-2005 Rivière Barti 353996 586240 Site en stratigraphie Poterie décorée (CWR) Age du Fer Haut Haute
LP 09 1-avr-2005 354551 585790 Site de surface Camp d'orpailleurs allemands Sub-récent Bas Basse
LP 10 1-avr-2005 356906 587037 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR, KGR)
Age du Fer Bas Basse
LP 11 1-avr-2005 359069 588187 Site de surface Poterie Age du Fer Bas Basse
LP 12 1-avr-2005 Kogbedi 361481 587851 Site de surface Poterie décorée (CWR) Age du Fer Haut Haute
LP 13 2-avr-2005 Ancien Kogbedi
362079 587438 Site de surface Meules Sub-récent Bas Basse
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 71/95
LP 14 2-avr-2005 361337 588331 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR, doigt, bâtonnet)
Age du Fer Bas Basse
LP 15 2-avr-2005 361344 588598 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR, doigt, peigne, bâtonnet)
Age du Fer Bas Basse
LP 16 2-avr-2005 364270 589680 Site de surface Poterie non décorée Age du Fer Bas Basse
LP 17 3-avr-2005 Dongo 366831 588399 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR, TGR)
Age du Fer Haut Haute
LP 18 3-avr-2005 367949 588066 Site de surface Poterie décorée (KPR), meule, molette
Age du Fer Bas Basse
LP 19 3-avr-2005 366603 588514 Site de surface Poterie décorée (CWR), pipe en argile
Age du Fer Bas Basse
LP 20 4-avr-2005 367155 589934 Site de surface Poterie décorée (CWR, KPR, blepharis)
Age du Fer Bas Basse
LP 21 4-avr-2005 352002 586415 Site de surface Poterie décorée (CWR, TGR) Age du Fer Bas Basse
LP 22 5-avr-2005 Ouami 1 344632 581932 Site de surface Ancien village Sub-récent Bas Basse
LP 23 5-avr-2005 Ouami 2 343778 581718 Site de surface Ancien village Sub-récent Bas Basse
Tableau 3: sites archéologiques découverts en mars-avril 2005 lors de la prospection de l’EIE (rivière Lom).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 72/95
12.3 Annexe B : Inventaire des sites archéologiques découverts sur le pipeline (Lom 1 – Mararaba)
Num. ECA Nom J M A Easting
(UTM 33 N)
Northing
(UTM 33 N)
Etendue
(m x m)
Contexte Artefacts/structures observées
Période Traitement Importance Date radiocarbone
159 Lom I 13 2 2002 323399 590646 10x30 Surface Poterie, tuyères Age du Fer Néant Non important
161 Lom I 13 2 2002 331691 597203 25x30 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
163 Lom I 13 2 2002 332741 597539 20x20 Stratifié Poterie, tuyères, scories, briques
Iron Age/Recent Fouilles Non important 240+/-70 BP
165 Pangar 6 3 2002 340938 611131 Surface Poterie Récent Néant Non important
169 Pangar 6 3 2002 341872 614160 30x80 Stratifié Poterie Age du Fer Surveillance de la construction
Non important
171 Pangar 8 3 2002 345933 617024 30x600 Surface Poterie Age du Fer/Récent Réduction de l'emprise
Important
173 Pangar 8 3 2002 346715 617331 500x30 Surface Poterie, meule Age du Fer/Récent Réduction de l'emprise
Important
175 Lom I 11 3 2002 322932 591852 30x50 Stratifié Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
177 Lom I 11 3 2002 323328 592208 30x10 Surface Hache polie isolée Néolithique/Age du Fer
Fouilles Important
179 Lom I 11 3 2002 324032 592831 30x100 Surface Poterie Récent Néant Non important
181 Lom I 12 3 2002 328361 595591 30x700 Stratifié Poterie, scories, éclats de débitage
Age du Fer Surveillance de la construction
Non important
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 73/95
185 Lom I 18 3 2002 338468 602355 30x100 Surface Poterie Age du Fer/Récent Enterrement intentionnel
Important
187 Lom I 19 3 2002 340012 604678 30x150 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
189 Lom I 19 3 2002 340317 608313 30x50 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
191 Lom I 22 3 2002 341935 614208 30x600 Surface Poterie Récent Néant Non important
193 Pangar 3 4 2002 345072 616676 30x20 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
195 Pangar 3 4 2002 347243 617534 30x50 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
199 Pangar 4 4 2002 357720 623683 30x200 Stratifié Poterie, éclats de débitage Age du Fer Réduction de l'emprise etfouilles
Important 920+/-120 BP
201 Mararaba 4 4 2002 358197 624111 Surface Poterie Age du Fer/Récent Néant Non important
Tableau 4 : sites archéologiques découverts le long de l’emprise du pipeline (février-avril 2002)
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 74/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 75/95
12.4 Annexe C: Sites importants de l’emprise du pipeline (extraits du Rapport Final49)
12.4.1 ECA 163 - Lom I
Site description ECA 163 - Lom I (UTM 33 N – E 332741, N 597539 - KP 524) was discovered on February 13, 2002 during monitoring of construction activities, right after the clearing operations. The site is situated on top of a steep hill, in a very hilly but open environment of the semi-deciduous forest zone (see map 1). Some furnace fragments, slag and a few potsherds were found scattered in a 20 x 20 meter area (400 m²). Two small iron-working furnaces as well as potsherds and slag were identified out of the ROW as well, and the site appeared as a large and diffuse surface site (about 60.000 m²). ECA 163 was accorded high priority for further work because of the presence of the iron-working features.
Site treatment Three 1-m² test pits were excavated to assess the importance of the buried material in the right-of-way on February 15 and 16, 2002. A few more furnace fragments, some small slag and 3 potsherds were unearthed between 0 and 15 cm below surface. The site was determined to be a recent surface site (less than 200 years old) and downgraded to low importance.
Artifact Collected Fifteen potsherds, decorated with knotted strip roulette, and a few slag pieces were collected at the surface and in the test pits.
Chronology To verify the recent age hypothesis, a charcoal sample was dated. The sample was collected below the main archaeological layer, between 20 and 30 cm below surface. It gave an age of 240 BP, or 1500-1950 AD. The calibration curve indicates that the most probable age of the sample should be situated between 1650 and 1800 AD, or between the 17th and the 19th century. The main occupation phase of the village probably post-dates the 17th century.
Interpretation Lom I site appears like a late Iron Age settlement site, installed on top of a steep hill. Artifact density is low and artifacts are mostly at the surface. The presence of two small iron-working furnaces at the surface outside the pipeline easement and slag
49 Lavachery 2005
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 76/95
scattered all over the hill indicates that some blacksmith activities took place in the village. ECA 163 is probably an old Gbaya village.
12.4.2 ECA 171 – Pangar
Site Description ECA 171 – Pangar (UTM 33 N – E 345933, N 617024 – KP 498) was found during pre-construction survey, on March 8, 2002. The site is a vast surface ceramic scatter of low density, located on a hilltop (altitude 754m) in the wooded savanna zone (see Map 1). Potsherds, decorated with roulette impressions, are dispersed over 600 meters along the pipeline easement, which is 25 meters wide. Potsherds were also visible outside the right-of-way over several hundred of meters. The total surface area of the site approximated 350.000 m², and clearing impacted less than 5% of the site. Given its extent and the fact that the region is very poorly known archaeologically, the site was accorded medium priority for further treatment.
Site Treatment The site treatment plan called for avoidance of the non-impacted parts of the site on the pipeline easement. No further earth-moving was permitted on the edges of the graded area in the site’s perimeter.
Interpretation ECA 171 was a large Iron Age village site. The fact that pottery was found exclusively at the surface suggests a sub-recent age.
12.4.3 ECA 177 – Lom I
Site Description ECA 177 (UTM 33 N – E 323328, N 592208 – KP 536) was discovered on March 11, 2002 during monitoring of the trenching activities. It is located in the vicinity of Lom I village, on the north bank of the Lom River, in the semi deciduous forest zone (between the towns of Belabo and Mararaba) (see Map 1). A single polished stone axe was found at the surface next to the trench, on a flat plateau (altitude 740m). Although ECA 177 is technically an isolate, it could indicate the presence of an important site not far from the right-of-way. Polished stone tools are also very rare and, as such, the location was accorded high priority for further treatment.
Site Treatment The ground stone tool was collected. Very careful surface survey in the area (graded surface of the right-of-way, trench, immediate area around ROW limits) and a systematic auguring program in the pipeline easement could not identify other associated artifacts.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 77/95
Interpretation No significant information can be extracted from an isolate except the age of the artifact: polished stone tools are usually dated to the Neolithic or the early Iron Age (from 5.000 to 1.000 BP) in comparable sites in Central Africa50.
12.4.4 ECA 185 – Lom I
Site Description ECA 185 (UTM 33 N – E 338468, N 602355 – KP 517) was discovered on March 23, 2002, during monitoring of the ditching operations. It is situated near Lom I village, between the towns of Belabo and Mararaba, in the semi deciduous forest zone (see map 1). The site consists of a low-density ceramic scatter, spread over 100 meters on the right-of-way, on a hilltop (altitude 706 m). Potsherds were decorated, among other techniques, by knotted strip roulette impressions. Some more potsherds were identified in the trench profile. The site was accorded medium priority for further work, because the region is very poorly known from an archaeological standpoint.
Site Treatment About 25% of the site surface was impacted by grading operations, but only 1.5% was removed by trenching. Site treatment plan called for protection of the non-impacted part of the site by careful backfill of the trench.
Interpretation ECA 185 appears to be a small late Iron Age settlement site of unknown age.
12.4.5 ECA 199 – Pangar
Site Description ECA 199 (UTM 33 N – E 357720, N 623683 - KP 485) is a buried archaeological layer, spread over 200 meters on the ROW, discovered during construction monitoring on April 4th, 2002. The site is located near the town of Pangar, in the wooded savanna zone (see map 1). The assemblage, identified in a well-defined archaeological layer situated between 50 and 60 cm below initial surface (before grading operations), consists of decorated pottery, stone flakes and clusters of charcoal. The site was accorded high priority for further treatment.
50 Zangato 1999, 2000; Lavachery 2001; Assoko 2002; Mbida 2002
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 78/95
Site Treatment The Site Treatment Plan recommended narrowing of the ROW (avoidance of the non-impacted part of the site) and limited data recovery. A test excavation of 1m x 2m was opened, to a depth of 80 cm; sterile soil was reached at –60cm.
Artifacts Collected Some 4 kilos of pottery were unearthed in the test pit (222 potsherds). Pottery is mostly decorated with carved wooden roulette impressions. The stone industry consists of large un-retouched quartzite flakes and cores.
Chronology A single charcoal sample was dated with the radiocarbon technique and an age of 920+/-120 BP was obtained. Because of the poor quality of the sample (the standard error is significant), once calibrated at 2 sigma, the probable age of the sample become rather imprecise: 885-1295 AD.
Interpretation ETA 199 – Pangar was an Iron Age settlement site that was inhabited sometime between the 9th and the 13th centuries AD. The association of stone tools and rouletted pottery in so recent a site is apparently not uncommon in the region north of the Lom River (see section 5.2.2.2).
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 79/95
12.5 Annexe D : Budget provisoire pour l’archéologie du PAE
Le budget présenté ici est basé sur l’hypothèse selon laquelle une cinquantaine de sites importants serait découverte dans la zone d’impact du Projet et que 20 à 30 d’entre eux seraient fouillés. Les sites trouvés en dehors de la zone d’ennoiement seraient préférentiellement contournés ou enterrés.
Les différentes phases du programme de gestion du patrimoine archéologique chiffrées ici sont les suivantes :
• Prospection et surveillance : prospection préalable de la zone inondable et des aires de terrassement (zones d’emprunt, routes d’accès, camps, ligne de haute tension…) et surveillance des chantiers
• Réduction de l’impact (contournement, enterrement ou fouilles des sites importants)
• Etude et rapport : étude des données archéologiques collectées (artefacts, stratigraphie, datations…) au Cameroun et production du rapport final au Cameroun et en Europe
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 80/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 81/95
Personnel Homme / jour
Coût / jour €
Coût / jour cfa
Prospections et
surveillance (# jours)
Réduction de l'impact (fouilles) (# jours)
Musée local
(# jours)
Etude et rapport (# jours)
Total Total € Total CFA
Archéologue senior (Ph.D) 1 320,0 209 600 45 60 15 80 200 64 000,0 41 920 000 Archéologue junior (MA) 3 120,0 78 600 90 120 40 250 90 000,0 58 950 000 Chauffeur/mécanicien 1 25,0 16 375 90 120 40 250 6 250,0 4 093 750 Piroguier 1 15,0 9 825 90 120 210 3 150,0 2 063 250 Guide 2 5,0 3 275 90 90 900,0 589 500 Manœuvre local 8 5,0 3 275 120 120 4 800,0 3 144 000 Total personnel (h/j) 16,0 490,0 320 950,0 405 540 15 160 1 120 169 100,0 110 760 500 Total 16 490,0 320 950 169 100,0 110 760 500 Logistique Quantité Prix / unité
€ Prix / unité
cfa Prospections
(# jours) Réduction de l'impact (fouilles) (# jours)
Etude et rapport (# jours)
Total Total € Total CFA
Location véhicule 1 70,0 45 850 60 120 30 210 14 677,6 9 628 500 Location pirogue 1 15,0 9 825 60 120 180 2 695,9 1 768 500 Location laboratoire 1 100,0 65 500 40 40 3 993,9 2 620 000 Carburant véhicule (plein) 40 55,0 36 025 1 2 196,6 1 441 000 Carburant pirogue (plein) 60 20,0 13 100 1 1 198,2 786 000 Per Diem archéologue senior 1 40,0 26 200 45 60 105 4 193,6 2 751 000 Per Diem archéologue junior 3 30,0 19 650 90 120 210 18 871,2 12 379 500 Billet avion BXL-YDE (AR) 4 900,0 589 500 1 3 594,5 2 358 000 Datations 20 200,0 131 000 1 3 993,9 2 620 000 Musée local 1 20 000,0 13 100 000 1 19 969,5 13 100 000 Total logistique (u/j) 132 21 430 14 036 650 75 384,9 49 452 500 Total 75 384,9 36 352 500 Total € Total CFA TOTAL GENERAL 244 484,9 147 113 000
5% frais imprévus 256 709,2 154 468 650,0
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 82/95
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 83/95
12.6 TERMES DE REFERENCES
Projet de barrage – réservoir de LOM PANGAR
TERMES DE REFERENCES DES THEMES N° 22 ARCHEOLOGIE (Version n° 01 du 27/01/04)
SOMMAIRE
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA PROBLEMATIQUE 2. OBJECTIFS DE L’ETUDE THEMATIQUE ET TERMES DE REFERENCES DE CELLE-CI 2.1 Connaissances déjà acquises
2.2 Objectif général de l’étude thématique
2.3 Contenu détaillé de la mission 2.3.1 Balayage préliminaire
2.3.2 Examen de l’état initial du site
2.3.3 Examen des impacts liés aux activités découlant du thème
2.3.4 Examen des mesures compensatoires
2.4 Produits de l’étude
2.5 Place de cette étude dans l’étude globale
2.6 Validation des impacts, des mesures compensatoires et des projets
3. ELEMENTS DE METHODE 3.1 Aspects techniques propres au thème
3.2 Méthodes spécifiques envisagées pour étudier les impacts et éventuellement mesures compensatoires
3.3 Productions intermédiaires non mentionnées aux TDR avec leur contenu précis
3.4 Chronogramme de mise en œuvre de l’étude avec mention des dates des productions intermédiaires et finales
4 EXPERTS PROPOSES POUR REALISER CHQUE TACHE DE LA MISSION 5. PLAN-TYPE DU RAPPORT A LIVRER PAR THEME 6. CONSIGNES POUR CONDUIRE LES ETUDES ET REDIGER LE RAPPORT 7. RAPPEL DES PRIORITES DE LA COMMISSION MONDIALE DES BARRAGES
1. Rappel du contexte et de la problématique
Le thème archéologie peut être compris comme étant une explication du passé. Il se rapporte à des sites, à des édifices, et à des restes pouvant posséder une valeur historique, religieuse, culturelle ou esthétique, qu'ils soient ou non utilisés actuellement par les populations locales.
Le projet de Barrage de Lom Pangar va créer une retenue d'environ 610 Km2. Même si la zone touchée par le projet ne présente pas a priori de vestiges connu en tant que tel, il est probable qu'au moins des sites à valeur religieuse ou sacrée soient inclus dans ce périmètre. Le projet concerne donc potentiellement des terrains pouvant représenter une valeur susceptible d'être ennoyée ou touchée (détruits ou endommagés) par les différents chantiers mis en oeuvre.
A cette acception de base du thème sera intégrée l'analyse de différents usages des zones étudiées. Sur ces aspects aussi, le projet de barrage est susceptible de générer des impacts négatifs.
La convention 170 de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;
La convention 1972 de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
Cet arsenal réglementaire vise la protection du patrimoine culturel contre toute forme de dégradation, de destruction de transformation, d'aliénation, d'exportation, de pollution ou d'exploitation illicites ou toute forme de dévalorisation. Il souligne le devoir de signaler toute découverte et la nécessité de faire, appel aux spécialistes adéquats pour examiner l'ampleur et évaluer le degré de conservation.
Les grands travaux (routes, barrages, pipelines, bâtiments, mines, etc.) mettent en danger le patrimoine culturel enfoui ou non. Jusque là au Cameroun, nous n'avions aucune idée précise du degré des dommages que ce genre d'activités cause aux sites historiques et archéologiques, même si depuis les années 1940 (JAUZE) l'aménagement de routes à Yaoundé signale déjà des dommages pour les sites archéologiques. La première tentative d'évaluation de l'impact et d'allègement de tels dommages issus des travaux publics a été faite lors du projet d'aménagement de la route Bertoua – Garoua - Boulaï (BGB) en 1999 - 2001, financé par l'Union Européenne.
Les résultats de cette étude ont montré un niveau relativement élevé de fréquence de sites archéologiques le long des 248 km de BGB, comprenant des sites d'habitation et de métallurgie de fer. L'ancienneté de l'occupation humaine de la région est remontée grâce aux datations radiocarbone au début de notre ère (MBIDA, ASOMBANG et DELNEUF: 2001).
Depuis lors, l'Union Européenne a financé d'autres opérations de surveillance archéologique à l'exemple des travaux de réhabilitation de l'axe routier Lolodorf – Bipindi - Kribi - Campo en 2000 -2001.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 85/95
2. Objectifs de l'étude thématique
2.1 Connaissances déjà acquises
A part quelques données assez détaillées sur la chasse dans les villages du territoire et sur l'exploitation artisanale de la forêt, les différentes études déjà réalisées sur le projet et sa zone immédiate (Etude socio - économique d'impact du barrage de Lom Pangar de 1997, Etude d'impact sur l'environnement du projet de Lom Pangar de 1998) n'apportent pas d'information sur l’archéologie proprement dite.
2.2 Objectif général de l'étude thématique
L’étude devra permettre :
- de mettre en évidence l'existence d’éléments archéologiques qui pourraient exister sur le territoire du projet,
- d'évaluer les impacts potentiels du projet sur l’archéologie, - d'établir des recommandations en terme de mesures de conservation en cas
de découverte fortuite durant les travaux et en terme de mesures compensatoires relatives à ces thèmes.
Comme pour les autres thèmes d'étude. ces impacts identifiés ainsi que les mesures compensatoires seront présentés aux populations et autorités locales et validés avec elles.
2.3 Contenu détaillé de la mission
2.3.1 Balayage préliminaire
Cette phase visera à arrêter les limites de l'étude dans l'espace et dans le temps, ainsi que celles des travaux étudiés.
Le projet pipeline Tchad-Cameroun a également prescrit une opération de sauvetage du patrimoine archéologique dans le cadre du programme de gestion environnementale de ses travaux.
Ces études confirment de plus en plus que l'ensemble du territoire camerounais regorge d'une grande richesse de patrimoine culturel varié, menacé ou endommagé par les grands travaux. Ces quelques exemples indiquent une prise de conscience par rapport à la protection du patrimoine culturel au niveau de quelques investisseurs, entrepreneurs et professionnels des travaux publics en activité au Cameroun. Si l'on peut se réjouir de ces avancées positives, de nombreux autres exemples sont malheureusement encore courants où ce patrimoine continue d'être endommagé par des bulldozers et autres engins mécaniques.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 86/95
La présente proposition de surveillance et de sauvetage du patrimoine archéologique dans le projet de retenue d'eau de Lom Pangar est conforme aux textes réglementaires en vigueur au Cameroun car les travaux du projet constituent une menace pour le patrimoine d'une région qui a connu de nombreuses vagues de peuplements depuis des temps anciens et des cours d'eau qui ont à ce titre servi de voies de communication et d’échanges.
Dans le cadre de l'aménagement de le retenue d'eau de Lom Pangar, les impacts liés à l'aménagement du site prévoient l'utilisation de 3 millions de m3 de terres latéritiques pour la construction des remblais, la construction de routes d'accès au chantier et aux carrières et la retenue d'eau qui ennoiera une étendue estimée à 70 000 ha de forêt et de savane.
Il est envisagé de mettre en oeuvre un projet de surveillance et de sauvetage du patrimoine archéologique visant à repérer les sites archéologiques ou paléontologiques menacés ou mis au jour par ces grands travaux. On étudiera récoltera ou conservera en priorité les sites ou les vestiges qui courent le risque d'être endommagés par les déblais et les lacs artificiels.
- faire un classement des sites en fonction de leur importance a priori, - préparer/concevoir une stratégie de recherche (sélection des sites à visiter,
planning, détail de la méthode de travail... ). - mener une seconde enquête de terrain sur les sites les plus importants ; cette
enquête détaillée pourra donner lieu suivant les sites rencontrés à la mise en oeuvre de différentes techniques d'investigation : il s'agira généralement d'enquête locale et de relevé simples de terrain y compris repérage au GPS. Si des investigations plus poussées de type excavation (y compris le relevé et remise en place) s'avèrent nécessaires, elle seront limitées à des travaux simples d'exploration permettant d'apprécier globalement les caractéristiques du patrimoine considéré (intégrité, importance, origines, usages ... ). Les recherches plus lourdes et les sauvetages ne font pas partie de la présente mission. La nature et le budget nécessaire à leur réalisation seront identifiés par les consultants pour report dans le contenu du PAE.
- établir les premiers éléments de recommandation sur les éventuelles conditions de sauvetage protection, souhaitables ou nécessaires,
- enfin, si le site fait l'objet d'une utilisation actuelle liée au patrimoine identifié, une analyse devra être réalisée, permettant de prendre en compte l'éventuel impact (économique ou autre) de l'ouvrage sur cette activité. Ces éléments devront être transmis au thème 19 « Indemnisation ».
Le détail de ces interventions dépendra du terrain, des types de sites considérés, de leur importance et de leur état.
L'analyse au final mettra en évidence et hiérarchisera les différents enjeux en terme de patrimoine archéologique dans la perspective du développement du projet. Elle les localisera sur une carte d’enjeux.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 87/95
2.3.3 Examen des impacts liés aux activités découlant du thème
A partir du balayage des impacts réalisés précédemment, seront menées les étapes :
d'identification - prévision des impacts (éventuellement avec comparaison de variantes).
d'évaluation des impacts (de la variante retenue)
Selon le modèle présenté dans le guide d’évaluation des impacts commun à tous les lots aux § 631 et 632 dans l'annexe 1 du PAQ.
Dans les situations où le patrimoine archéologique contribue actuellement ou potentiellement à l'économie nationale ou locale. une analyse devra être réalisée pour estimer les coûts économiques des impacts, du projet. L'évaluation des impacts se fera en priorité et à chaque fois que ça sera possible à partir des données quantitatives recueillies précédemment. En cas d'impossibilité, il faudra utiliser le Meilleur Jugement Professionnel (Best Professional Judgment) des spécialistes de l’équipe technique EIE.
A ce stade peuvent apparaître de nouveaux domaines d'investigation, pour lesquels des études complémentaires, non identifiées à l'origine et non couvertes par le présent thème, peuvent s'avérer nécessaires pour finaliser l'évaluation des impacts. Il faudra dans ce cas que le responsable du thème en définisse la nature et le coût, et qu'il examine avec le maître d'ouvrage les conditions de leur éventuelle réalisation.
2.3.4 Examen des mesures compensatoires
Ce travail comportera l'examen des mesures proposées pour éliminer, atténuer ou compenser les impacts du projet sur le patrimoine ainsi que l'établissement de la liste des impacts résiduels à traiter par le Plan d'Action Environnemental (PAE). Il sera composé des étapes suivantes :
Recommandations / Propositions de modifications du projet ou de choix de solutions alternatives pour minimiser les impacts les plus graves sur le patrimoine. Chaque fois que cela sera possible, l'équipe technique chargée de la réalisation de l’EIE conseillera le maître d'ouvrage sur les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts les plus néfastes, en particulier les impacts majeurs, directs et irréversibles. Ces mesures devront être justifiées. Il peut s'agir d'une redéfinition plus ou moins importante du projet, d'un sauvetage sélectif, ou d'un simple relevé détaillé de données avec cartographie du site. Les mesures de réduction peuvent être de natures variées (excavation, récupération, ou au contraire enterrement du site, restauration des éléments structuraux, déplacement de trafic, contrôle de l'érosion, contrôle du niveau des eaux souterraines, stabilisation de la végétation, etc.).
Proposition de mesures compensatoires. Dans les cas où ces impacts ne pourront être minimisés, des mesures compensatoires pourront être attribuées par le maître d'ouvrage, sous des formes diverses à étudier au cas par cas. Le consultant aura pour mission de proposer ces mesures et de les étudier.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 88/95
Etude de la faisabilité (y compris réglementaire) des propositions concrètes à intégrer au PAE y compris les aspects :
- techniques, - réglementaires : conformité au cadre législatif voire très exceptionnellement
cadre législatif à modifier, etc.), - financiers : première approche du coût des mesures d'atténuation
proposées, - organisationnels : une analyse des éventuels besoins en planification,
formation, surveillance et renforcements institutionnels, liés aux mesures (Cf point "Renforcement..." ci-dessous).
A ce stade peuvent apparaître de nouveaux domaines d'investigation, au-delà des TDR des thèmes, pour lesquels des études complémentaires, non identifiées à l'origine peuvent s'avérer nécessaires pour finaliser l'évaluation des mesures compensatoires. Il faudra dans ce cas que le responsable du thème, en définisse la nature et le coût et qu'il examine avec le maître d'ouvrage, les conditions de leur éventuelle réalisation.
Analyse des éventuels effets négatifs des mesures proposées, couplée avec une analyse des éventuels conflits avec d'autres thématiques. Des réponses aux effets négatifs (si effets) devront être proposées.
Renforcement des capacités en matière de découvertes fortuites en cours de chantier
En cas d'absence ou d'insuffisance de la réglementation nationale en terme de procédures à mettre en oeuvre en cas de découvertes fortuite de site ou de matériaux, il est nécessaire que l'équipe de consultants établisse des recommandations en la matière.
Ces procédures doivent en particulier indiquer au commanditaire du projet et à l'entrepreneur :
- comment avertir les autorités chargées de la culture, - la période d'attente exigée avant que le travail puisse reprendre après qu'une
découverte imprévue se soit produite, - les mesures de protection des objets trouvés.
Il est en effet important qu'en l'absence de ce type de procédure, les autorités préparent des procédures spécifiques pour le projet de barrage si le risque de rencontrer des sites enterrés s'avère possible. Ces procédures seront alors incluses dans les dispositions standard des contrats de construction. Les dispositions prises lors de la construction du pipeline Tchad Cameroun devront être étudiées en détail avant de produire les recommandations.
Indicateurs de suivi et plan de gestion
Le consultant proposera des indicateurs permettant de suivre l'évolution des impacts dans le temps pour les incorporer au dispositif de suivi scientifique du projet. Les directives dans ce domaine seront fournies par le pilote du thème 18 : " Suivi scientifique".
En ce qui concerne le suivi, dans le cas de l'identification d'un ou de plusieurs sites significatifs pouvant être affecté par le projet, un plan de gestion archéologique et historique du site devra être prépare et indiquer les types les mesures de conservation qui devraient être prises pour chaque site examiné. Ce plan pourra être intégré dans le PAE.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 89/95
Le résultat final opérationnel des travaux de cette phase sera produit sous la forme de fiches-actions décrivant les objectifs recherchés par l'action, les tâches à effectuer, les partenaires financiers et techniques, la répartition des rôles, les coûts estimatifs, les contraintes pressenties...
2.4 Produits de l'étude
L'étude devra permettre l'élaboration des rapports validés présentés ci après. Le PAQ précise la procédure de validation des rapports. Ces rapports seront illustrés. autant que de besoin de photographies, schémas, tableaux :
- Rapport de phase 1 : Objectifs, méthode, finalisation de la zone d'étude, synthèse du balayage et analyse de l'état initial de l'environnement,
- Rapport de phase 2 : Description des éventuelles variantes étudiées, prédiction et évaluation des impacts,
- Rapport de phase 3 : Recommandations et mesures compensatoires et résultats de la consultation publique, et projet de rapport final et rapport final.
Liste des cartes qu'il est prévu de faire produire par ce thème avec l'échelle et la thématique abordée :
Thématique de la carte Echelle Sources
Localisation de la ou des zones d’étude 1 / 500 000 Produite par le thème
Localisation des enjeux patrimoniaux de la zone en lien avec le projet, et des impacts identifiés,
1 / 250 000 Produite par le thème (pouvant éventuellement être couplée avec la précédente)
Carte de synthèse des mesures compensatoires localisées
1 / 250 000 Produite par le thème
2.5 Place de cette étude dans l'étude globale
Chronogramme relatif de l'étude L'étude du thème 22 peut commencer rapidement (février) car un certain nombre de tâches, dont le balayage, peuvent être faites sans attendre. Les éléments de méthode (questionnaires), doivent être préparés assez tôt afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de la mission préalable d'information réalisée par le thème 4 " Consultation du public".
Le thème doit ensuite fournir un nombre significatif d'informations au thème 4 "Consultation du public" pour validation lors de la consultation publique en avril. La synthèse de tous ces travaux doit être faite fin mai début juin, pour transmission au thème 17 " Synthèse-PAE ".
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 90/95
Fournitures de données, valorisation ou échanges avec d'autres thèmes, y compris étude principale.
Le schéma ci-dessous synthétise les relations les plus importantes avec les autres thèmes :
- les thèmes en colonne de gauche fournissent des informations au thème 22 : Patrimoine Archéologie,
- les thèmes au centre traitent et valident des informations avec le thème 22, - le thème 22 transmet au thème "Svnthèse-PAE" les informations validées
avec les autres thèmes.
Thème 1 Alternatives Pour projet
définitif
Thème 4 Consultation
publique Pour validation
Propositions
Thème 12 EIE retenue
pour synthèse des impacts
Thème 4 Consultation
du public Pour éléments
d’enquête mission
d’information
Thème 22 Archéologie
Thème 19
Indemnisations Pour validation
propositions
Thème 22 Archéologie
Thème 17 Synthèse
PAE pour
synthèse finale
2.6 Validation des impacts, des mesures compensatoires et des projets
Il s'agit d'une exigence forte des standards internationaux dont ceux de la CMB. Afin de limiter le nombre d'ateliers et d'avoir une meilleure vision globale, cette étape de communication - concertation à laquelle chaque thème apportera sa contribution, sera organisée et coordonnée par les consultants chargés du thème n°4 "Consultation publique", selon le schéma général suivant :
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 91/95
Afin que cette étape de communication - concertation soit efficace, chaque pilote de thème devra veiller à la bonne mise en oeuvre ou réalisation :
- des documents de présentation nécessaires à la préparation des ateliers (en particulier : identification des impacts, leur évaluation, identification des mesures compensatoires, description précise des éventuels projets de développement et de leurs effets attendus, etc.).
- de la participation des consultants du thème (en particulier des homologues camerounais) à la préparation et à la tenue des réunions et communications nécessaires pour atteindre les standards d'information (voir aussi § 631 et 64),
- d'un bilan relatif à la prise en compte, des points de vue des populations affectées, des autorités et des ONG concernées pour le thème.
- des comptes-rendus des consultations, ateliers, points presse et réunions avec liste des invités et des participants, les thèmes abordés, les propositions validées.
- d'une évaluation des éventuels besoins complémentaires en consultations tout au long du projet (populations locales, ONG locales) et des propositions de calendrier au chef de projet pour synchronisation avec les autres lots,
- d'une révision des rapports thématiques pour prendre en compte les résultats de ces ateliers.
Préparation des ateliers
coordonnée par le thème
Ateliers avec présence des homologues par thème
Synthèse des adaptations du
projet par le lot 17
Prise en compte par les thèmes des résultats de la consultattion
Document de présentation par thème
Information sur le projet final par le
thème 4 Information sur le projet
par le thème 4
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 92/95
3. Eléments de méthode
3.1 Aspects techniques propres au thème Ce lot comporte peu de méthodes qui ne soit déjà décrites dans le § 2.3 "Contenu détaillé de la mission" ci-dessus et dans l'annexe 1 du PAQ relative à la manière d'évaluer les impacts et de rédiger les EIE.
Une validation auprès des intéressés sera utilisée pour valider les impacts identifiés par les experts, leur ampleur et proposer des mesures compensatoires adaptées.
3.2 Méthodes spécifiques envisagées pour étudier les impacts et éventuellement les mesures compensatoires Il n'y a pas de méthode particulière originale mise en oeuvre. Les travaux consisteront principalement à des enquêtes de terrain auprès des institutions ressource et sur les sites identifiés pour en décrire les caractéristiques. Les méthodes de travail envisagé à ce stade sont exposés ci-dessus au § 2.3, et seront conformes aux annexes 1 et 2 du PAQ.
3.3 Productions intermédiaires non mentionnées aux TDR avec leur contenu précis Celles-ci sont détaillées au chronogramme des activités décrit au § suivant.
3.4 Chronogramme de mise en oeuvre de l'étude avec mention des dates des productions intermédiaires et finales 1
Activités D J F M A M J J A S O N Expert2 Durée
(hm)
1 – Balayage préliminaire et état initial du site 1.6
Première visite de la zone du projet et atelier de lancement
** Equipe de direction
Christophe MBIDA
Définition de la zone d’étude et finalisation de la méthode
**
Christophe MBIDA
Description des travaux et activités concernés par le thème
**
Christophe MBIDA
Identification des impacts attendus (balayage)
**
Christophe MBIDA
Recherche bibliographique et identification du contexte réglementaire applicable au thème
**** Socio-
anthr.adjoint
1 responsable de la tâche repérée en caractères gras 2 les noms figurant italique repèrent les tâches pour lesquelles les consultants internationaux feront une mission au Cameroun
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 93/95
Christophe MBIDA
Première enquête d’information (Cf. thème 4)
****
Christophe MBIDA
Préparation de l’enquête, choix des sites
*
Christophe MBIDA
Enquête détaillée de terrain ** ****
Christophe MBIDA
G. Koppert
Rapport de phase 1 (interne)3
**
Christophe MBIDA
0,96
Total phase 1
Socio-anthr.adjoint
1,00
Activités D J F M A M J J A S O N Expert2 Durée
(h/m)
2- Evaluation des impacts 0.35
Christophe MBIDA
Identification prévision des impacts
**** **
Coordination avec les autres thèmes (1er débriefing)
** Christophe MBIDA
Christophe MBIDA
Evaluation des impacts **** ***
2ème débriefing avec les autres thèmes
** Christophe MBIDA
Christophe MBIDA
Rapport de phase 2 (externe)3
**
Christophe MBIDA
0,31
Total phase 2
3 « interne » = rapport interne à l’équipe de consultants. « externe » = rapport transmis au maître d’ouvrage
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 94/95
Activités D J F M A M J J A S O N Expert 45 Durée
(h/m)
3- Evaluation des mesures, validation, suivi, projet de rapport final et rapport final 0.60
Christophe MBIDA
Examen des mesures compensatoires
** ****
Christophe MBIDA
Validation des impacts et des mesures
compensatoires avec les publics affectés
**
Christophe MBIDA
Etude de faisabilité des mesures compensatoires
**
Fourniture des données pour PAE et plan de suivi
** Christophe MBIDA
Christophe MBIDA
Rapport de phase 3 et projet de rapport final
(externe)6
**
Christophe MBIDA
Rapport final (externe)6
**
Christophe MBIDA
0,48 Total phase 3
0,12
Christophe MBIDA
1,75
Durée totale par consultant
1,00
Durée totale experts nationaux 2,75
*= 1 semaine
4 responsable de la tâche repérée en caractères gras 5 les noms figurant italique repèrent les tâches pour lesquelles les consultants internationaux feront une mission au Cameroun 6 « interne »= rapport interne à l’équipe de consultants, « externe » = rapport transmis au maître d’ouvrage
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BARRAGE DE LOM PANGAR Etude du thème Archéologie
ISL – OREADE-BRECHE – SOGREAH 95/95
Récapitulatif du temps passé prévisionnel par expert et par phase
Phases Experts 1 2 3
Total par expert (h/m)
Christophe MBIDA 0,96 0,31 0,48 1,75 Socio-Anthropo adjoint 1,00 0 0 1,00
Total par phase (h/m) 2,31 0,35 0,60 2,25