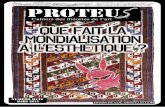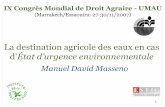Les enjeux éthiques de l'esthétique environnementale
Transcript of Les enjeux éthiques de l'esthétique environnementale
LES ENJEUX ÉTHIQUES DE L'ESTHÉTIQUE ENVIRONNEMENTALE
Mémoire de seconde année de master en Philosophie présenté sous la direction de la
professeur Émilie HACHE
par
Louise MÉLIN
Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense (Paris X)UFR PHILLIA
Année académique 2013-2014
Remerciements
Je tiens à remercier tout d'abord Émilie Hache pour la confiance qu'elle m'a accordée et
pour sa bienveillance tout au long de l'année. Ses conseils et ses critiques m'ont permis d'éviter de
nombreux écueils et de valoriser au mieux le fruit de mes recherches. Un grand merci également à
Valérie, pour sa présence et ses encouragements réconfortants, mais surtout pour son
accompagnement méthodologique rigoureux qui m'a été précieux. Merci à Stéphane pour sa
connaissance fine de Félix Guattari et pour les relectures attentives qu'il a bien voulu m'accorder.
Enfin, un immense merci à mon conjoint pour sa patience et son support de tous les jours.
Sommaire
I – Le cognitivisme esthétique, quelles perspectives éthiques ?....................11
a) De l'art à l'environnement, ruptures et continuité de l'esthétique environnementale.....................13
b) Les sources du cognitivisme, entre philosophie de l'art et et esthétique environnementale..........19
c) Une esthétique environnementale cognitiviste...............................................................................23
d) Les perspectives éthiques du cognitivisme....................................................................................28
II – Vers une alternative non-cognitive...........................................................36
a) Changer de postulats : la critique écoféministe..............................................................................38
b) Quelle éthique écoféministe ?........................................................................................................47
c) Les affinités entre éthique écoféministe et esthétique non-cognitive.............................................55
d) Entre altérité et continuité, l'éthique comme équilibre relationnel................................................62
III – L'esthétique comme pratique et politique..............................................74
a) Vers un pragmatisme esthétique, le paradigme de l'expérience chez John Dewey........................75
b) Quelle politicité pour l'expérience esthétique ?.............................................................................80
c) Réparer, soigner : le rôle de l'esthétique dans la prise en charge de la blessure écologique..........89
d) Réinventer, recréer: le jardin urbain comme figure de réappropriation esthétique et politique.. 105
Conclusion..................................................................................................................................105
Bibliographie.............................................................................................................................111
Introduction
"Everyone needs beauty as well as bread, places to play and pray, where nature heals and give strength to
body and soul alike."
John Muir.
En 1892, John Muir fonde la première organisation non-gouvernementale de protection de
l'environnement, le Sierra Club. La mission de cet organisme se focalise alors sur la protection des
joyaux de la wilderness1 américaine tels que le parc du Yosemite ou de Yellow Stone, dont John
Muir vante l'incommensurable beauté tout au long de ses écrits2. Splendeur, pureté, harmonie,
beauté des sons et des formes, ces remarques sont récurrentes dans les réflexions de Muir sur la
nécessité de sauvegarder les espaces sauvages. Cette beauté trouvait sa plus pure expression dans la
nature vierge et sauvage des réserves, qu'il s'agissait alors de protéger du pâturage, des brûlis, et de
toute pollution humaine3. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis la glorification exaltée de la
wilderness par John Muir. Ce siècle a vu naître une prise de conscience globalisée de la
détérioration de l'environnement ainsi que de la nécessité urgente d'agir pour sa préservation. Si la
parole de John Muir nous parvient depuis une époque et un contexte désormais lointains,
l'importance qu'il accordait aux qualités esthétiques de la nature n'a rien perdu de son acuité et n'a
d'ailleurs cessé d'accompagner le développement de la parole écologiste. L'association entre la
beauté d'une entité naturelle et l'injonction à la protéger est en effet devenu un lieu commun de
l'environnementalisme contemporain, et l'on en trouve des exemples nombreux et récurrents dans
les campagnes de sensibilisation à la crise écologique. Cette association procède d'un mécanisme
relativement simple, qui consiste à articuler la reconnaissance d'une valeur esthétique à l'édiction de
1 La wilderness est un concept difficilement traduisible en français, il désigne l'ensemble des régions estimées « sauvages » et non entachées par la présence de l'homme. Le Wilderness Act de 1964 la définit comme suit : « A wilderness, in contrast with those areas where man and his works dominate the landscape, is hereby recognized as an area where the earth and its community of life are untrammeled by man, where man himself is a visitor who does not remain. », Wilderness Act, Public Law 88-577, 88th Congress, Second Session, 3 septembre 1964.
2 Cf. John Muir, Our National Parks, The Riverside Press, Cambridge, 1901. The Yosemite, Century Co, New York, 1912. My first summer in Sierra, The Riverside Press, Cambridge, 1911.
3 Plusieurs ouvrages abordent l'impact des populations indiennes sur les écosystèmes des parcs nationaux, voir notamment : Alfred Runte, Yosemite, the Embattled Wilderness, University of Nebraska Press, Lincoln, 1990, Kenneth R. Olwig, « Reinventing Common Nature, Yosemite and Mount Rushmore – A Meandering Tale of a Double Nature. »
1
certaines normes comportementales (par exemple : la forêt de Fontainebleau est belle, donc nous
devons la préserver). La valeur esthétique est reconnue comme une propriété de l'objet qui mène à
l'observance de devoirs moraux. Un tel schéma s'oppose explicitement à la tradition esthétique
occidentale, encore largement tributaire de l'héritage kantien. Pour Kant en effet, l'émotion
esthétique est indifférente à la réalité intrinsèque de l'objet qui la cause4, et il ne peut donc être
question de l'accoler à un souci moral. Mais dans le contexte de la défense de l'environnement, le
recours à la gratification esthétique n'en demeure pas moins récurrent, et constitue le point de départ
de toute réflexion sur la nature de l'association entre esthétique et écologie. En effet, si cette
association est factuelle, est-elle satisfaisante ? Pour répondre à cette question, il convient d'analyser
les termes en jeu : l'esthétique d'une part, et l'écologie d'autre part. L'acceptation commune du terme
esthétique la consacre comme étude du beau ; les mécanismes de création, perception, et jouissance
de la beauté semblent en ce sens relever de son domaine. En revanche, si l'on en revient à son
étymologie et au traitement récent qui en est fait par une partie de la philosophie anglo-saxonne,
l'esthétique désigne plus largement notre expérience sensible du monde. Celle ci peut être
remarquable comme dans le cas de la beauté, ou plus diffuse, à travers la perception d'atmosphères
singulières, de détails, de sensations fragmentaires. Ces deux niveaux d'appréhension de l'esthétique
sont diversement impliqués dans la protection de l'environnement, mais l'on peut déjà relever que
c'est la première acceptation qui l'emporte largement dans l'association courante qui est faite entre
écologie et esthétique. La prégnance d'images spectaculaires, de paysages exotiques et de mises en
scènes sensationnelles est caractéristique de l'esthétique dont se nourrit un pan de
l'environnementalisme contemporain. Il s'agit classiquement d'accomplir une mission de
sensibilisation, qui consiste à rendre des individus réceptifs à une question pour laquelle ils ne
manifestaient pas d'intérêt. Comment convertir le désintérêt pour l'environnement en intérêt ? La
diffusion d'informations fait partie intégrante de ce processus ; on peut par exemple montrer les
ravages de la surpêche en s'appuyant sur des chiffres et des données scientifiques explicites ; mais
l'on peut aussi montrer en quoi un écosystème, une espèce, est précieux et digne de sauvegarde à
l'aide d'images ou de films. Cette seconde approche est particulièrement intéressante dans le cadre
de notre enquête, puisqu'elle montre comment une réaction esthétique peut générer un intérêt plus
vaste, voire engendrer un engagement pratique. Aux États-Unis, de puissantes associations comme
le Sierra Club ou la Audubon Society organisent des campagnes photographiques destinées à mettre
en valeur la splendeur des écosystèmes en danger, et à mobiliser un intérêt citoyen à ce sujet. En
France, les célèbres photographies de Yann-Arthus Bertrand ou encore le film Home qu'il réalisa en
2009, manifestent l'union singulière qui s'instaure entre une esthétique du spectaculaire et un appel à
4 « Il ne faut pas se soucier le moins du monde de l'existence de la chose, mais y être totalement indifférent (...) », in Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, coll. Folio essais, Gallimard, 1985, p.131.
2
l'engagement écologique. Véritable « célébration de la nature », « ode à l'environnement », le film a
été vu par 8.3 millions de français le soir de sa diffusion sur petit écran, poussant même certains
journalistes à émettre des conjectures sur son impact électoral5. La diffusion d'images plaisantes
mettant en scène des paysages exotiques, ou au contraire d'images « choc » exhibant les effets
désastreux de la pollution, jouerait donc un rôle dans le degré d'investissement des populations dans
la gestion des questions environnementales.
Ce constat doit nous inviter à plusieurs interrogations : d'une part, une telle association entre
l'esthétique et la protection de l'environnement est-elle légitime, souhaitable ? D'autre part, peut-on
confondre « protection de l'environnement » et « écologie » sans plus d'investigation ? Si l'écologie
est spontanément perçue comme une science de la nature enrichie d'un discours politique visant à sa
protection, elle ne peut cependant s'y réduire. Son étymologie nous indique qu'elle est avant tout
une science de l'οἶκος, de l'habitat, de la maison. Plus qu'une étude de la nature, il s'agit d'une étude
de notre façon de l'habiter, de coexister avec d'autres entités au sein de l'habitat commun qu'elle
constitue. En ce sens, l'écologie a moins à voir avec la santé des seuls espaces sauvages qu'avec la
santé de nos relations et interdépendances envers l'environnement. Partant de cette définition de
l'écologie, il apparaît que l'esthétique du spectaculaire dont se nourrit une partie de
l'environnementalisme contemporain échoue à informer correctement les problématiques qui lui
sont attachées. En insistant sur l'idée d'une nature originelle qui nous est extérieure et que « nous »
mettons en péril, cette esthétique manque la dimension relationnelle et éthique de l'écologie, elle
sublime et exalte une dichotomie au lieu d'informer les relations complexes qui attachent l'humain
au non-humain. Enfin, l'inconvénient majeur que comporte une telle association entre l'esthétique et
l'écologie, c'est qu'elle manque précisément la dimension éthique de l'écologie. En effet, l'écologie
ne ne se réduit pas à la simple gestion des effets du développement anthropique, mais appelle au
contraire une prise de conscience éthique de la valeur du non-humain. Or, l'association esthétique-
écologie que venons de décrire fonctionne comme la production mécanique d'un comportement, elle
s'apparente en cela au fonctionnement d'un dispositif publicitaire. En effet, si par publicité on
entend la somme des moyens employés pour inciter une cible à adopter un comportement
déterminé, alors il n'est pas absurde de soutenir qu'un certain nombre d'associations de défense de
l'environnement font usage d'une publicité esthétique de l'écologie. Il s'agit de miser sur
l'association entre un stimulus (une image du produit) et une réponse déterminée (l'achat du
produit). Dans le cadre de l'esthétique mise en avant par les associations de défense de
5 Cf. « La diffusion du film "Home" a-t-elle avantagé Europe Écologie ? » in Le Monde, 07-06-2009. D'après cet article, la diffusion du film Home deux jours avant le scrutin européen aurait favorisé les listes d'Europe Écologie.
3
l'environnement et les acteurs publics, il s'agit de susciter une attitude déterminée (l'économie
d'énergie, l'engagement associatif, etc) par l'instrumentalisation d'émotions esthétiques ciblées. En
ce sens, cette association entre l'esthétique et l'écologie mérite d'avantage d'être éclairée par une
discipline comme le neuromarketing, que par une quelconque approche éthique. Ce qui constitue le
caractère éthique d'un acte, ça n'est pas le fait qu'il soit conditionné par un stimulus extérieur, mais
qu'il procède d'une sensibilité relationnelle qui opère entre l'agent et le patient moral. L'acte moral
émerge toujours d'une sensibilité morale, or cette sensibilité – bien qu'elle puisse être cultivée et
encouragée – vient de notre propre fond et ne saurait constituer une réponse automatique à un
certain signal.
Le second défaut de cette approche dite publicitaire consiste en son caractère
intrinsèquement discriminatoire. Elle demeure en effet tributaire d'un goût esthétique arbitraire qui
ne recoupe pas systématiquement les intérêts écologiques. L'exemple des parcs de l'Ouest américain
évoqué précédemment peut certes être perçu comme le résultat d'une connexion forte entre la
beauté de la nature et les moyens mis en œuvre pour la préserver, mais une analyse informée permet
d'y voir, à la lueur du contexte politique et esthétique de l'époque, le symptôme de tendances
contestables et de bifurcations historiques qui n'ont à première vue rien à voir avec l'écologie6
(valorisation patriotique d'une identité paysagère américaine, goût pour le spectaculaire des
montagnes au détriment des vallées, etc). Les canons occidentaux, s'ils permettent de sensibiliser à
la détérioration de certains écosystèmes, risquent donc également de causer la négligence à l'égard
de zones jugées esthétiquement peu gratifiantes. On constate ainsi que les milieux d'aspect répulsif
(marais, landes, etc) souffrent régulièrement d'un déficit d'intérêt et de prise en charge, en dépit de
leur richesse écologique7. La même problématique apparaît au cœur de la défense d'espèces
animales menacées. Si le blanchon, de par son apparence, suscite la sympathie et les mobilisations
pour sa protection, que dire des requins ou des chauves-souris8 ? De la même façon, exhiber la
magnificence de forêts lointaines pour nous rendre plus sensibles à leur surexploitation risque
d'avoir pour effet collatéral de détourner notre attention des écosystèmes moins spectaculaires mais
tout aussi vulnérables qui nous entourent9.
On peut donc dire qu'il existe d'ores-et-déjà une liaison explicite entre l'esthétique et
6 Cf. Yuriko Saito, Everyday Aesthetics, Oxford University Press, 2007, p.72-77.7 La destruction des zones marécageuses aux États-Unis est un exemple de ce type d'attitude abondamment documenté. Voir notamment : Thomas E. Dahl, Wetlands Losses in the United States, 1780's to 1980's, U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, 1990. Ann Vileisis, Discovering the Unknown Landscape, a History of America's Wetland, Island Press, Washington, 1999.8 Cf. Yuriko Saito, op.cit., p.61. Voir également, Edward O. Wilson, « The Little Things that run the World » in Conservation Biology, Vol. 1, N°. 4, Dec. 1987.9 Neil Evernden constate ainsi, au sujet de la déconsidération de la Prairie aux États-Unis : « Any use of prairie would be acceptable, because no one cares about viewing the prairie ». Cf. Neil Everden, « Beauty and Nothingness : Prairie as Failed Resources », Landscape 27, N°8, Vol.1, 1983.
4
l'écologie, mais que cette liaison se réduit le plus souvent à une promotion publicitaire de la cause
écologique10, et non à un approfondissement éthique de la sensibilité envers le non-humain. Le
propos de notre enquête sera dès lors d'esquisser et de comprendre les alternatives qu'il est possible
d'apporter à ce premier modèle. Comment l'étude de nos émotions esthétiques en lien avec
l'environnement peut-elle nourrir notre approche de l'écologie ? Quelle association est-il possible
d'envisager entre esthétique et éthique environnementale ? Pour mener à bien cette entreprise, il
s'agira de partir des réflexions riches et multiples menées depuis une trentaine d'années dans le
champ de l'esthétique environnementale.
L'esthétique environnementale est un domaine théorique à la fois ancien et nouveau.
Ancien, parce que le thème des réactions esthétiques à la nature est présent très tôt dans les théories
esthétiques, et plus particulièrement dans les développements modernes du XVIIIe siècle. Nous
sommes, de fait, familiers de l'attention que Kant portait à la contemplation du ciel étoilé, au chant
des oiseaux ou à l'océan déchaîné. Mais l'esthétique environnementale constitue également un
champ académique spécifique, né dans les années 1970 en réaction à la polarisation récente de
l'esthétique par la philosophie de l'art. Cette charnière chronologique est importante dans la mesure
où la naissance de l'esthétique environnementale coïncide avec la prise de conscience du désastre
écologique. La mise en péril de l'environnement constitue un motif récurrent des réflexions menées
depuis lors dans le champ de l'esthétique environnementale, qui ne s'attache pas à décrire de façon
isolée l'expérience esthétique de la nature, mais bien à étudier la façon dont cette expérience peut
apporter des outils de compréhension à la crise que nous traversons. Lier de la sorte l'esthétique à
des enjeux éthiques et politiques peut sembler contre intuitif. Il est en effet coutumier de considérer
la région de nos émotions esthétiques comme un champ autonome et détaché des normes morales
autant que des trivialités pratiques de la vie humaine. Mais l'on a également vu qu'il n'est plus
possible d'abstraire nos goûts esthétiques des conséquences concrètes qu'ils possèdent, ni d'ignorer
les discriminations écologiques qu'ils entraînent. L'esthétique environnementale se donne
précisément pour tâche d'étudier ces phénomènes discriminatoires, d'en comprendre les rouages afin
de pouvoir éventuellement les corriger et les insérer dans une approche plus saine du rapport à
l'environnement. Or, pour avancer que certaines appréciations esthétiques de la nature sont moins
légitimes que d'autres, il faut déjà se fonder sur une conception de ce qui est juste d'un point de vue
du rapport à l'environnement. En ce sens, l'esthétique environnementale, lorsqu'elle s'attache à
guider l'expérience esthétique dans une perspective écologique, nécessite une véritable réflexion sur
les fondements et les objectifs d'une éthique de l'environnement. Si l'esthétique peut constituer une
10 Daniel Harris développe ce point dans son Esthétique du consumérisme. Selon lui, les mécanismes publicitaires de mise en valeur esthétique des produits ainsi que les réflexes de consommation qui s'en suivent, typiques des sociétés capitalistes, ont contaminé notre appréhension esthétique du monde. Cf. Daniel Harris, Cute, Quaint, Hungry and Romantic, The Aesthetics of Consumerism, Da Capo Press, 2001.
5
grille d'intelligibilité riche des problématiques écologiques, c'est donc au prix d'une explicitation
claire de ses prétentions éthiques.
Dans le petit essai qui conclu son almanach d'un comté des sables, Aldo Leopold insiste
sur la dimension affective de l'éthique : « Nous ne sommes potentiellement 'éthiques' qu'en relation
à quelque chose que nous pouvons voir, sentir, comprendre, aimer d'une manière ou d'une autre.11 »
Cette assertion est importante dans la mesure où elle postule une connexion entre les émotions et la
morale qui n'est pas accidentelle, mais au contraire intime et intrinsèque. Si nous sommes amenés à
respecter les êtres qui nous entourent, ça n'est pas seulement parce que nous devons le faire, mais
aussi parce que nous sommes attachés à ces êtres sur un mode affectif. Ces émotions passent par le
« voir » et le « sentir », elles constituent donc une première zone d'hybridation entre l'expérience
esthétique du monde et notre inclinaison à une attitude éthique. Mais si Leopold insiste à plusieurs
reprises sur la dimension affective et incarnée de l'éthique, rappelant qu'elle est un processus
« intellectuel autant qu'émotionnel12 », ou encore qu'elle appelle un « remaniement intime de nos
affections13 », il ne précise cependant jamais les modalités d'une telle association entre l'affect et la
morale. Les théoriciens de l'esthétique environnementale se sont abondamment penchés sur la
nature de cette association, et sur la possibilité de faire de l'esthétique l'artisan d'une éthique de
l'environnement plus complète. Il convient ici de s'arrêter un instant, car la façon dont se conçoit la
portée éthique de l'expérience esthétique dépend avant tout de ce que l'on entend par éthique.
En effet, la détérioration de la planète n'est pas seulement un problème sanitaire,
économique ou politique, c'est également le symptôme d'une faillite morale. Le déni de la valeur
intrinsèque des entités non-humaines avec qui nous partageons le monde a débouché sur une crise
majeure qui interroge aujourd'hui la somme de nos partis-pris moraux. La discipline de l'éthique
environnementale essaie de répondre à ce défaut moral en conceptualisant plusieurs alternatives
(conséquentialistes, déontologiques, pragmatiques...)14. Ces alternatives se pensent en premier lieu
comme autant de réponses à une conception anthropocentrée de la morale, dans laquelle l'humain
constitue une classe ontologique supérieure au sein de la hiérarchie des êtres, le consacrant comme
le référent ultime de toute valeur morale. L'éthique environnementale appelle moins à destituer la
valeur morale de l'humain qu'à la réinscrire dans la trame des relations complexes qui font que
l'habitation du monde est toujours une co-habitation, dans laquelle des êtres hétérogènes sont
engagés et liés. La crise environnementale ne peut donc être résolue par de simples palliatifs
technico-politiques, car elle appelle plus fondamentalement un redéploiement de ce que Kenneth
11 Aldo Leopold, Almanach d'un comté des sables, Flammarion, Paris, 2000, p.271.12 Aldo Leopold, op.cit., p.284.13 Aldo Leopold, op.cit., p.265.14 Pour une vue d'ensemble des différentes voies empruntées par l'éthique environnementale, cf. Hicham-Stéphane
Afeissa, Éthique de l'environnement, Nature, valeur, respect, Vrin, Paris, 2007.
6
Goodpaster appelle la considérabilité morale15 : Quelles entités sont dignes d'être considérées
moralement, d'être respectées pour ce qu'elles sont ? Quelles sont celles qui ont été négligées,
comment les prendre en compte dans un enracinement concret de la morale au cœur des pratiques ?
Cette approche permet de mettre en lumière des relations qui ont été occultées ou étouffées sous des
procès d'instrumentalisation. Elle invite, selon l'expression de Goodpaster, à interroger jusqu'où
nous devons « jeter le filet moral16 ». Cette métaphore spatialise le problème moral et assimile ce
dernier à un enjeu extensionniste : Quelle frontière ontologique devons nous fixer à notre
considération morale, à notre capacité à nous soucier de ? En réponse à cela, la définition d'un
critère (le rationnel, le vivant, le sensible, etc) permet de fixer le filet moral. Une telle conception de
l'éthique environnementale semble opérer un changement d'objet tout en laissant intacte la forme et
la nature de l'attitude morale. Le topos déontologique du respect du non-humain comme dépositaire
d'une valeur intrinsèque est en effet récurrent chez les théoriciens classiques de l'éthique
environnementale. Mais on voit mal comment une telle appréhension de l'éthique pourrait se
connecter aux recherches entreprises par l'esthétique environnementale ; la définition d'un critère de
considérabilité morale nous invite en effet à fixer rationnellement un système d'obligations
indépendant de nos inclinaisons personnelles et affectives. Dans le cas du biocentrisme, par
exemple, il s'agit de respecter tous les êtres vivants quelles que soient par ailleurs les émotions
esthétiques qu'ils suscitent. Si les émotions esthétiques sont versatiles, subjectives et dépendantes
des goûts propres à une époque ou à un contexte social, alors il n'est pas souhaitable de les intégrer
à une éthique supposément neutre et objective. Cette impasse constitue le point de départ de toute
réflexion qui souhaite lier l'esthétique environnementale aux prétentions éthiques de l'écologie.
Comment sortir de l'aporie qui consiste à opposer le caractère subjectif et partiel de l'esthétique aux
prétentions objectives et universelles d'une éthique de l'environnement ?
Afin de répondre à ce paradoxe, deux mouvements conceptuels sont possibles : le
premier consiste à redéfinir l'esthétique de telle sorte qu'elle satisfasse les critères d'objectivité et
d'universalité sur lesquels se fonde l'éthique, le second invite quant à lui à mettre en question ces
critères-mêmes et à souligner le caractère problématique du type de moralité qu'ils véhiculent. L'on
peut donc soit tenter d'accorder nos émotions esthétiques à des exigences éthiques par ailleurs
inquestionnées, soit au contraire analyser en quoi ces exigences sont problématiques et appellent
des redéfinitions plus profondes. La première voie est celle qu'empruntent une partie des théoriciens
de l'esthétique environnementale en tentant d'extirper l'émotion esthétique de son statut relatif et
partiel pour en faire un outil d'enrichissement et de renforcement d'une éthique environnementale de
type déontologique. Cette position, qualifiée de cognitiviste, consiste à trouver des stratégies
15 Kenneth E. Goodpaster, « De la considérabilité morale » in S.H Afeissa, op.cit.16 Ibid.
7
d'objectivation de l'émotion esthétique, notamment en la soumettant à une connaissance scientifique
supposée neutre. Une telle stratégie se base précisément sur l'idée que l'éthique environnementale
procède d'un simple extensionnisme moral, et n'appelle pas de refonte de la façon dont nous
concevons la morale elle-même. Or, cette approche est profondément contestée depuis une trentaine
d'années, et fait l'objet de critiques que nous ne pouvons ignorer si l'on veut comprendre la façon
dont les émotions esthétiques peuvent être associées à une éthique de l'environnement. En effet,
répondre à l'anthropocentrisme moral par l'adoption d'un modèle extensif qui englobe la nature
semble insuffisant, en ce qu'il maintient inchangé les présupposés méta-éthiques qui structurent la
pensée occidentale et sont à l'origine de notre insensibilité morale. Parmi ces présupposés, on
retrouve le schème dualiste qui structure notre appréhension du monde et de la moralité : bien/mal,
sujet/objet, nature/culture, raison/passion, etc. On peut en ce sens se demander si, outre les facteurs
historiques amplement décrits17, il ne convient pas de questionner le canevas conceptuel qui a
permis l'étouffement de notre sensibilité morale à l'égard de la nature: insularisation du sujet,
réification de l'environnement physique, réduction des interdépendances à une causalité mécaniste
etc. Dans cette perspective, il serait bénéfique de penser une éthique qui, au lieu de reconduire les
traditionnelles topiques de la pensée morale, les déjoue et leur substitue une nouvelle appréhension
pratique et théorique du monde. Plutôt que de penser un sujet autonome qui traite les entités non-
humaines comme dépositaires d'une valeur intrinsèque appelant certaines obligations, il s'agit de
mettre en question l'idéal même d'autonomie et de rationalité qui motive les conceptions modernes
de l'éthique.
Ce geste critique a été richement entrepris par les théoriciennes de l'écoféminisme depuis
les années 1980. Le cœur de leur critique a consisté à mettre au jour la structure dualistique des
appréhensions déontologique et conséquentialiste de l'éthique environnementale, et à en souligner le
caractère oppressif. Réduire la vie éthique à une série de dilemmes axiologiques, c'est du même
coup négliger les chemins de traverse que nous empruntons tous les jours pour prendre en charge la
souffrance et la vulnérabilité. Cette négation mime les contours d'une dépréciation plus large : celle
du travail continu assumé par les groupes sociaux minorés (femmes, pauvres, immigrés etc), travail
domestique qui ordonne le quotidien, prend soin des êtres et des choses vulnérables et qui s'attache,
plus largement, à « maintenir, perpétuer et réparer notre « monde18» selon l'expression de Joan
17 Une littérature abondante s'est penchée sur les racines historiques du rapport occidental à la nature, et de sa responsabilité dans la crise écologique que nous traversons. L'article de L.White Jr a donné naissance à une exploration approfondie des rapports entre Christianisme et nature. Cf. L.White Jr., « The Historical Roots of Our Ecological Crisis », Science, 1967, p.1203-1207. Voir également l'essai de David Abram qui postule un lien intéressant entre l'apparition de l'alphabet dans le bassin méditerranéen et le désenchantement du monde naturel. David Abram, The Spell of the Sensuous : Perception and Language in a More-Than-Human-World, Vintage Books, New York, 1997.
18 Joan Tronto, Un monde vulnérable, pour une politique du care (Moral Boundaries : a Political Argument for an Ethic of care, 1993), La Découverte, 2009, 238 p.
8
Tronto. En réponse aux modélisations abstraites des enjeux moraux proposées par une partie de la
tradition analytique, la critique écoféminisme invite à considérer les engagements moraux depuis le
contexte relationnel dans lequel ils s'inscrivent et de prendre en considération la trame des
attachements et des sensibilités qui les soutiennent. Il ne s'agit plus de simuler in abstracto des
dilemmes moraux pour les projeter sur la matière du réel, mais au contraire de partir de cette
matière même et d'étudier la façon dont nous démêlons les tensions qui l'habitent, dont nous
prenons en charge les failles de vulnérabilité qui la lézardent. Il ne peut y avoir de morale sans
monde, sans relations, sans texture sensible des êtres et des choses. Nos engagements et nos actes
ne sont pas réductibles à un faisceaux d'arguments rationnels, ils s'inscrivent dans un réseau
d'affects et d'interdépendances qu'il convient de sonder afin d'envisager les potentielles affinités
esthétiques dont il est porteur. Il s'agit de considérer que la sensibilité à l'autre, les attitudes de souci
et de soin, irriguent l'ensemble de nos rapports aux humains ainsi qu'aux non-humains et ne sont pas
le simple résidu sentimental de rouages moraux systématisés. L'idéal d'un sujet autonome porteur
d'une voix morale droite et objective semble donc partiellement déconnecté des pratiques et des
motivations réelles des acteurs. Il s'agit alors de déterminer, à l'aune des déplacements conceptuels
engagés par l'écoféminisme, le type de connexion que l'on peut envisager entre l'esthétique
environnementale d'une part, et une éthique de l'environnement libérée de ses dualismes d'autre
part.
Nous l'avons dit, l'esthétique ne consiste pas en la seule étude du beau et des émotions
paroxystiques qu'il suscite, mais éclaire au contraire toute la trame sensorielle de notre expérience
du monde. L'attachement sensible que nous éprouvons à l'égard des objets et des environnements
familiers, le régime d'attention que suscite l'expérience esthétique sont autant de phénomènes qui ne
peuvent être ignorés dans l'étude des attitudes morales de souci et de soin. De la même façon, la
rupture de l'intégrité esthétique d'un milieu (marée noire, projet industriel etc) incarne parfois
l'élément déclencheur d'une prise de conscience collective de la nécessité de sauvegarder un
paysage, un écosystème, un lieu de vie. Plutôt que de prendre pour point de départ la structure
normative d'une éthique déontologique et de voir comment l'émotion esthétique peut y être intégrée,
il s'agit donc au contraire de partir de cette dernière, de la façon dont elle maille notre quotidien et
informe nos attachements, afin de voir comment elle peut constituer la trame de l'attitude éthique.
Mais si l'on cesse de normer l'émotion esthétique et de la soumettre à un arbitre objectif, ne risque-t-
on pas de verser dans un relativisme nocif ? Comment éviter que mes goûts personnels n'entraînent
des comportements partiaux à l'égard de l'environnement, m'amenant à mépriser ce que je trouve
laid et à me soucier de ce que je trouve beau ?
Afin de départager les deux arguments qui s'opposent au sein de l'esthétique
9
environnementale, nous tâcherons de les mettre à l'épreuve des faits et de voir comment ils peuvent
informer les problématiques écologiques et esthétiques concrètes que rencontrent les populations. Il
s'agira de voir comment s'articulent effectivement les expérimentations esthétiques et l'engagement
éthique au contact de l'environnement. Comment la répétition de certaines émotions sensibles nous
pousse-t-elle à nous engager pour préserver les entités non-humaines ? Comment réagissons-nous
quand l'intégrité visuelle de notre milieu de vie est altérée ? Comment la créativité esthétique
s'inscrit-elle au sein de micropolitiques de réappropriation des territoires et de dissolution de la
frontière public/privé ? Ces questions doivent nous amener à nous confronter aux pratiques
concrètes engagées par les habitants de différents milieux pour préserver leur environnement, lutter
contre la sérialisation de ce dernier, mais aussi à prendre en compte le contexte social d'un tel
engagement. Comme le rappelle Arnold Berleant, l'immense majorité des individus vit fort loin des
« temples de la nature19 », il s'agit dès lors de comprendre comment agissent les minorités et les
populations vulnérables pour faire face aux enjeux éthiques et esthétiques de la dégradation
environnementale. Ces interrogations nous amèneront à étudier des situations concrètes de prise en
charge de cette dégradation, et à comprendre en quoi l'esthétique peut être considérée comme le
dénominateur commun voire le moteur de différents engagements éthiques et politiques. Comment
la mobilisation après une marée noire, l'association d'habitants pour la réhabilitation d'un quartier
pollué, l'entretien d'un jardin, ou encore la lutte pour la préservation d'espaces verts peuvent ils
s'articuler autour de la notion de sensibilité esthétique ? Et comment cette sensibilité se manifeste-t-
elle à travers un engagement pratique et des activités de soin ? L'analyse de ces articulations
synergiques est indispensable pour repenser le rapport traditionnel entre esthétique et éthique. Parce
qu'il n'est pas satisfaisant de convoquer la splendeur d'un paysage pour justifier sa protection, il
devient nécessaire d'observer – à l'échelle des pratiques quotidiennes comme des mobilisations
ponctuelles – comment nous nous engageons pour sauvegarder la beauté, créer de nouveaux
paradigmes esthétiques, lutter contre les processus de dégradation et de dépossession. C'est à partir
de cette confrontation au réel qu'il deviendra possible d'envisager la façon dont ces pratiques
ordinaires peuvent être encouragées, stimulées, voire suscitées là où elles tendent à disparaître. Les
implications d'une telle articulation sont en cela éminemment politiques : il s'agit de comprendre
comment notre environnement, à travers ses manifestations esthétiques, peut devenir le foyer d'une
réappropriation collective des enjeux écologiques.
19 « These temples of nature are rarely a part of the ordinary landscape of daily life... » in Arnold Berleant, Living in the Landscape : Toward an Aesthetics of Environment, University Press of Kansas, Lawrence, 1997, p.16.
10
CHAPITRE I
LE COGNITIVISME ESTHÉTIQUE, QUELLES PERSPECTIVES ÉTHIQUES ?
« Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty20 », l'article fondateur de
Ronald Hepburn, s'ouvre sur un constat : alors que les travaux esthétiques du XVIIIe siècle
accordent la part belle à la nature, les études contemporaines tendent à réduire l'esthétique à la
philosophie de l'art, occultant presque totalement la beauté naturelle. L'expérience esthétique de la
nature, pourtant bien réelle, est devenue « off-the-map », et par là même ignorée par la théorie. Ce
constat que formule Ronald Hepburn appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, si l'esthétique
environnementale est née en réaction à un courant académique largement polarisé par la question de
l'art, il faut d'emblée préciser que cette discipline ne résulte pas d'un simple changement d'objet. Il
ne s'agit pas de passer d'une esthétique de l'artefact à une esthétique de la nature sans plus
d'aménagements conceptuels. L'esthétique environnementale, à travers la diversité des courants qui
la constituent, impose avant tout de repenser la notion même d'expérience esthétique. Elle se nourrit
en cela d'une rupture engagée par les théories pragmatistes de l'expérience esthétique et qui ouvre
de nouveaux champs de réflexion sur l'esthétique du quotidien et le rapport entre esthétique et vie
pratique.
À première vue, l'essence de l'esthétique se dévoile dans son étymologie, aesthesis, qui
renvoie aux sens et plus largement à l'expérience sensible du monde. Est esthétique tout ce qui
relève a priori de la saisie sensorielle de notre environnement. On pressent cependant qu'un tel
critère est insuffisant, puisqu'il impliquerait la dissolution du champ esthétique dans l'immensité de
nos perceptions les plus insignifiantes. L'esthétique n'est donc pas réductible à la sensorialité, elle
incarne plutôt une saillie dans le flot confus des sensations et se distingue par l'émotion qu'elle
suscite. Une première façon d'aborder la complexité de cette émotion a consisté à se tourner vers
l'étude de l'objet qui la suscite. Cette approche fameuse est celle que privilégie Platon, et qui
l'amène à penser l'objet esthétique comme le réceptacle d'une essence idéale, le Beau. L'idée d'une
beauté qui transcenderait la somme des belles choses est richement développée dans des dialogues
comme le Phèdre, le Banquet ou l'Hippias Majeur, elle permet de rendre compte du plaisir
esthétique comme tension vers le Beau, et non comme seule jouissance des belles choses. Selon
cette approche, l'émotion esthétique n'est pas une fin en soi, elle n'est pas la simple satisfaction de
20 Ronald Hepburn, « Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty », Wonder and Other Essays, Edimburgh University Press, Edimburgh, 1984.
11
l’œil, elle nous aiguille au contraire vers un dépassement du sensible. C'est en cela que la beauté
diffère de l'agréable ; sa manifestation dans un objet particulier, nécessairement partielle et
imparfaite, nous charme mais nous invite surtout à remonter à la cause première de cette
manifestation : le Beau en soi (auto to kalon). Le phénomène se trouve ainsi emprisonné dans une
dette infinie à l'égard de l'Idée, il en est l'écho et la trace, n'ayant de valeur qu'en tant que tension
vers son propre dépassement21.
Une seconde façon d'aborder l'émotion esthétique consiste, à partir du XVIIIe siècle,
à se détourner de l'objet et des rapports de transcendance pour se concentrer sur l'expérience du
sujet. Cette voie, largement explorée par Kant, invite à cesser d'hypostasier le beau pour le replacer
dans le contexte de son émergence subjective. Selon cette approche, l'expérience esthétique se
caractérise par la rupture qu'elle crée dans la rumeur des gestes quotidiens, elle naît de la mise en
échec de l'usage courant du jugement déterminant avec lequel nous «cartographions» le monde qui
nous environne. La considération esthétique d'un objet s'en tient alors toujours à l'effet que ses
qualités sensibles produisent sur mon esprit, toute considération pratique ou conceptuelle venant
interrompre la vibration esthétique. De cette caractéristique découle celle, fameuse et vouée à une
longue postérité, du désintéressement. L'expérience esthétique est désintéressée en ceci qu'elle
consiste en un libre jeu de l'esprit, lequel cesse dès lors que le sujet se place dans une posture de
désir ou de catégorisation cognitive de l'objet.
Ces deux appréhensions de l'expérience esthétique, bien que profondément différentes,
véhiculent cependant un rapport au sensible problématique. Il s'agit, dans les deux cas, de définir
l'esthétique comme une rupture dans l'ordre du sensible et comme une fuite vers un autre régime
d'expérience. Chez Platon, la matérialité du sensible est évacuée dans la quête de l'Idée et
l'expérience esthétique n'est à aucun moment destinée à se fondre dans le contexte de notre vie ici
bas. Chez Kant, le jugement de goût constitue également une sortie hors de l'ordinaire et des
pratiques cognitives et volitives qui lui sont attachées. En somme, l'esthétique semble extérieure à
ce qui constitue la vie humaine, elle en est retranchée et en constitue l'acmé tout à la fois. Dans le
cadre de l'établissement d'une esthétique environnementale, cette appréhension est problématique à
plusieurs titres. Tout d'abord, nous l'avons dit, l'esthétique environnementale n'est pas simplement
une esthétique de l'environnement qui tiendrait lieu de sous-domaine de la discipline esthétique,
21 Cette conception possède un héritage riche dans la tradition esthétique chrétienne, selon laquelle la beauté du monde ne nous émeut que relativement à la présence divine qui s'y manifeste. C'est en ce sens que l'art iconique, par exemple, incarne le lieu privilégié d'une rencontre avec le divin, d'une théophanie, par opposition à un art des idoles qui ne renvoie qu'à lui-même et s'enferme dans une auto-référence du sensible. L'expérience esthétique de la nature elle-même est alors imprégnée par le divin : les paysages pastoraux témoignent de l'harmonie créée par Dieu, tandis que les espaces sauvages et les montagnes sont perçues comme le refuge d'entités diaboliques. Sur l'évolution de l'appréciation esthétique des montagnes, voir Marjorie Hope Nicolson, Mountain Gloom and Mountain Glory : The Development of the Aesthetics of the Infinite, Cornell University Press, 1997.
12
mais elle constitue un champ théorique nouveau. La référence à l'environnement est double, il s'agit
non seulement d'étudier les réactions esthétiques que suscite l'environnement physique, qu'il soit
naturel ou urbain, mais aussi de comprendre ce que signifie mener une expérience esthétique dans
un environnement : en quoi le fait de saisir le sujet comme situé et environné modifie-t-il notre
appréhension de l'esthétique ?
a) De l'art à l'environnement, ruptures et continuités de l'esthétique environnementale.
S'interroger sur les modalités d'une esthétique proprement environnementale implique
d'étudier la spécificité de l'environnement comme objet et contexte esthétique. Si l'environnement,
dans son acceptation la plus large, englobe aussi bien les contextes urbains que les zones naturelles,
la discipline de l'esthétique environnementale s'est pour l'heure largement focalisée sur ces
dernières, bien que cette tendance évolue22. Il est possible de ne pas distinguer l'expérience suscitée
par un artefact de celle éprouvée au contact de la nature, une sculpture et un coucher de soleil
pouvant susciter des émotions similaires. Cependant, cette distinction s'impose dès que l'on tente de
rapatrier au sein de l'esthétique des objets qui en sont traditionnellement exclus, tels que les outils
ou les scènes du quotidien. Si ces objets sont à première vue perçus comme non-esthétiques, c'est
moins du fait de leurs qualités propres que du fait d'une théorie esthétique encore largement
polarisée par le paradigme artistique. En quoi consiste ce paradigme, et quel lien entretient-il avec
l'esthétique environnementale ? Un premier axe de réponse s'esquisse si l'on considère la genèse de
l'objet artistique. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote décrit le statut ontologique de l’œuvre
sous l'angle de son origine. Lors que l'artiste façonne un matériau pour en faire une sculpture, il
engendre un nouveau type d'être en vertu d'une décision contingente.
S'appliquer à un art, c'est considérer la façon d'amener à l'existence une de ces choses qui sont
susceptibles d'être ou de ne pas être, mais dont le principe d'existence réside dans l'artiste et non
dans la chose produite.23
A la différence des choses naturelles et des choses qui doivent arriver nécessairement, l’œuvre d'art
est contingente – elle aurait pu ne pas être – et le principe de son existence se situe dans un agent
extérieur, l'artiste ou l'artisan. L'objet d'art introduit donc un nouveau régime de devenir, bifurquant
22 Des philosophes comme Pauline von Bonsdorff, Arto Haapala ou encore Yuriko Saito ont par exemple développé des réflexions esthétiques ciblées sur les environnements anthropisés comme la ville ou les territoires agricoles. Nous aborderons la question des expériences esthétiques en milieu urbain dans le dernier chapitre.
23 Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 4, 1140 a 10-14.
13
hors du règne de la nécessité et de la nature. Kant insiste sur cette différence entre l'art qui produit
des œuvres (opus), et la nature qui ne produit que des effets (effectus)24. Contrairement à la structure
parfaite de la ruche qui n'est que l'effet de l'instinct des abeilles, la perfection de l’objet d'art est une
œuvre engendrée par le libre arbitre de l'artiste. Cette œuvre possède une « cause efficiente
accompagnée de la pensée d'un but auquel l'objet doit sa forme25 », en ce sens, elle est
génétiquement marquée du sceau de l'intention. A l'inverse, cette marque est absente de la
construction de la ruche et nous ne pouvons, de fait, apprécier le travail d'un insecte qui ne
s'accompagne d'aucune intention consciente de la même façon qu'une œuvre d'art. Pour cette
dernière, l'appréciation peut prendre la forme d'une herméneutique de l’œuvre ; il s'agirait de
dévoiler l'intention du créateur qu'exprime le matériau artistique. Par opposition à ces artefacts
expressifs, la nature posséderait quant à elle une téléologie interne. Toutefois, nous ne l'apprécions
pas, selon Kant, en vertu de cette téléologie. Lorsque nous contemplons l'océan sur un mode
esthétique, nous ne réfléchissons pas, par exemple, à la façon dont l'évaporation des océans
engendre les nuages ou à la façon dont la mer peut servir des fins commerciales, mais nous
jouissons des pures qualités formelles de la scène. Cela ne signifie pas que nous ne décelons aucune
fin dans ce spectacle, mais plutôt que nous éprouvons un régime téléologique autre. Ce régime ne
concerne pas la fin objective de l'objet mais la forme d'une finalité que nous apprécions
subjectivement. L'agencement complexe de l'orchidée, la finesse de ses pétales, se présente à nous
comme la manifestation de quelque dessein dont elle incarnerait la finalité. C'est comme si la nature
exhibait, à travers ses qualités sensibles, la tension vers une fin. Cette tension n'aboutit cependant
pas, et l'expérience esthétique de la nature vibre dans cet écart infini entre la forme de la finalité et
l'absence de fin qui la caractérise. L’œuvre d'art, à l'inverse, s’appréhende d'après la fin que l'artiste
lui a impulsé. L'art peut en effet être dit symbolique, en ceci qu'il permet la monstration d'idées d'un
genre particulier, les idées esthétiques26. L'artiste peut voir l'arbre comme symbole de la vie, la
chandelle comme symbole de la raison, le bleu comme symbole du repos et de la profondeur, etc.
L'art manifeste ces idées sans les réduire à une intelligibilité stricte, il les donne à penser à travers
une forme qui les symbolise. Il semble donc que nous ne puissions apprécier esthétiquement l'objet
d'art et l'environnement naturel de la même façon, et que chacune de ces deux régions de
l'expérience esthétique fonctionne selon ses normes propres.
Pour juger d'une beauté naturelle comme telle, je n'ai pas besoin de disposer au préalable d'un
24 Emmanuel Kant, op.cit., §43 De l'art en général. 25 Ibid26 « Par idée esthétique, j'entends cette représentation de l'imagination qui donne beaucoup à penser sans pour autant
qu'aucune pensée déterminée, c'est-à-dire sans qu'aucun concept, ne puisse lui être approprié et, par conséquent, qu'aucun langage ne peut exprimer complètement ni rendre intelligible. » Emmanuel Kant, op.cit., §49, p.269.
14
concept de la sorte d'objet que doit être cette chose. (…) Mais si l'objet est donné comme
production de l'art et, en tant que tel, déclaré beau, il est nécessaire, puisque l'art présuppose
toujours un but dans la cause (et dans sa causalité), qu'il y ait d'emblée, au principe du jugement,
un concept de ce que la chose doit être27.
Pourtant, chez Kant même, l'esthétique de la nature semble empreinte des codes d'appréciation de
l’œuvre d'art. Les exemples auxquels il se réfère font la part belle à la vue et à l'ouïe, selon un biais
qui caractérise l'esthétique occidentale dans son entier28. La posture du sujet y est également
assimilée à celle du spectateur contemplatif, laquelle semble minorer les expériences engagées et
actives que nous faisons de notre environnement. Il convient ici de préciser que Kant inscrit ses
réflexions sur le beau naturel dans une tradition spécifique qui joua un rôle majeur aussi bien dans
la théorie de l'art que dans l'esthétique du paysage. Cette tradition, que les français nomment
pittoresque et les anglais picturesque29, prend son essor au XVIIIe siècle. Elle coïncide avec les
premiers grands tours d'Europe et inaugure une nouvelle expérience de l'environnement naturel,
impulsant chez les riches voyageurs une façon inédite d'apprécier les paysages. La nature est alors
éprouvée selon des codes importés de la peinture paysagère : unité dans la diversité, posture
contemplative du spectateur, présence mesurée d'éléments humains, etc. Le paysage est apprécié
esthétiquement au regard de sa proximité avec la norme picturale, et le rapport de l'homme à la
nature est corrélativement pensé sur un ton contemplatif. Cette posture est illustrée par l'usage
répandu du miroir Claude Lorrain, petit miroir convexe dont la surface sombre adoucit les contours
et met en valeur le paysage comme scène picturale. Le poète anglais Hugh Sykes Davies ironisait
ainsi, au sujet des amateurs de cet instrument : « Il est bien typique de leur attitude envers la Nature
que de lui tourner le dos puisse leur paraître souhaitable30 ».
L'esthétique environnementale prend le contre-pied de cette démarche et va en ce sens
plus loin que l'esthétique kantienne de la nature ; il s'agit de libérer définitivement l'environnement
naturel des canons de l’œuvre d'art auxquels il est encore rapporté, et d'étudier le plus fidèlement
possible l'expérience que nous faisons de notre environnement. Yuriko Saito illustre ce changement
de référentiel à l'aide d'une image ordinaire, celle de la pluie. Lors que nous apprécions la pluie, le
27 Emmanuel Kant, op.cit., §48, p.266.28 Yuriko Saito souligne ainsi que, dans la tradition esthétique japonaise, les odeurs et le sensations tactiles jouent un
rôle tout aussi important que la vision ou l'ouïe. Le thème de la hiérarchie entre les sens a également été développé par Emily Brady dans son chapitre « multi-sensuous engagement », op.cit., et le philosophe Yi-Fu Tuan leur consacre un chapitre entier dans lequel il décrit le rôle que chacun de nos sens joue dans notre rapport à l'environnement, « common traits in perception, the senses », in Topophilia, A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, Columbia University Press, New York, 1990.
29 Le terme « pittoresque » est dérivé de l'italien pittore qui signifie le peintre. L'équivalent anglais, picturesque, évoque l'idée du paysage comme picture-like. Dans tous les cas, la norme d'une nature « ressemblant à la peinture » est manifeste.
30 James Buzard, "The Grand Tour and after 1660-1840", in The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge University Press, 2002.
15
bruit des gouttes qui s'écrasent contre la fenêtre, l'odeur qu'elle soulève dans les rues, l'aspect qu'elle
donne aux choses, nous ne nous plions à aucune norme d'appréciation. Notre présence au monde
nous engage dans l'expérience intime d'une série de qualités sensibles, sans que cette expérience ne
se déroule selon des codes préétablis31. En ce sens l'esthétique environnementale implique à la fois
un changement d'objet et un changement de structure. Ce nouveau modèle implique de penser le
rapport du sujet à son environnement différemment du rapport du spectateur à l'œuvre d'art. La
nouvelle autonomie de l'esthétique de l'environnement relativise le postulat d'une distance entre le
sujet et l'objet, en ceci que l'environnement n'est pas un contenant, un cadre avec lequel le sujet agit
et vis-à-vis duquel il est indépendant. Comme le rappelle Merleau-Ponty : « Mon corps est pris dans
le tissu du monde32 », j'expérimente à travers lui un contact immédiat avec les choses. Ainsi,
apprécier esthétiquement un paysage ce n'est pas seulement l'embrasser d'une vue comme on le
ferait d'une peinture, mais c'est également l'arpenter, le découvrir à différentes périodes de l'année,
en cultiver la terre, apprécier le chant des oiseaux qui le peuplent, le parfum de l'air, etc. Emily
Brady, esquissant les divergences fondamentales entre paradigme artistique et paradigme
environnemental, écrit : « Nous pouvons marcher, escalader, voler, plonger, nager et même ramper à
travers un environnement.33 » A l'inverse, l'expérience de l’œuvre d'art demeure limitée par certaines
conventions, ainsi ;
Notre expérience d'un concert de jazz est limitée par le fait que nous soyons assis à distance des
musiciens, les écoutant et les regardant. Nous ne pouvons pas monter sur scène et nous asseoir
parmi eux pour éprouver plus intimement la musique, ou regarder de plus près la façon dont ils
jouent de leurs instruments et fonctionnent comme un groupe.34
L'attitude du sujet constitue donc une autre différence majeure permettant de distinguer l'esthétique
de l’œuvre d'art de l'esthétique de l'environnement. L'esthétique environnementale n'intègre pas
l'investissement pratique de l'agent comme un paramètre accessoire, mais elle en tire au contraire
son essence même. C'est parce que nous manipulons, touchons, sillonnons notre environnement et
les objets qui le peuplent que des expériences esthétiques singulières peuvent voir le jour.
L'expérience esthétique de l'environnement semble donc se fonder sur une série de
singularités qui la distinguent du paradigme artistique tel que l'a théorisé une grande partie de la
tradition occidentale. Mais ces deux pôles esthétiques s'excluent-ils nécessairement ? Les
31 Yuriko Sait, op.cit., p.21. Yuriko Saito est par ailleurs consciente que certaines normes culturelles filtrent dans notre appréciation de la nature, mais cette normativité demeure moins prégnante que celle qui régit l'appréciation d'une œuvre d'art.
32 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l'Esprit, coll. Folio essais, Gallimard, Paris, 1964, p.19.33 Emily Brady, Aesthetics of the Natural Environment, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2003, p.65.34 Ibid.
16
spécificités de l'expérience artistique ne peuvent-elles pas informer ou structurer notre expérience
de l'environnement, et inversement, l'esthétique environnementale ne peut-elle pas renouveler notre
appréhension de l'art ? Afin de répondre au mieux à ces questions, il convient de contextualiser
d'avantage ces deux paradigmes. Ainsi, le concept d’œuvre d'art que nous avons présenté jusqu'à
maintenant ne tient pas suffisamment compte des évolutions profondes qui ont travaillé le champ
artistique depuis un siècle. Le Land Art, les happenings, les installations éphémères donnent autant
d'exemples de la variété qui affecte la sphère de l'art depuis quelques décennies. On peut dire en un
sens qu'une partie de l'art s'est environnementalisée, c'est-à-dire a engendré des œuvres susceptibles
d'être vécues et expérimentées comme des environnements. La distance sujet-objet assurée par
l'attitude contemplative s'efface alors au profit d'une invitation à arpenter les installations, à en
éprouver les singularités sur le mode d'une proximité esthétique nouvelle. Ainsi, le Land Art (ou art
environnemental), court-circuite la limitation spatiale et temporelle qui est traditionnellement
imposée à l’œuvre d'art. Certaines installations comme le Ash Dome de David Nash qui s'appuie sur
la lente croissance des arbres, ou encore le Tree Moutain d'Agnes Denes, intègrent des temps longs
à leur structure. D'un point de vue spatial, les limites de l’œuvre éclatent également et convoquent
l'échelle de l'infiniment grand au cœur même de leur dispositif : on évoquera ici le Lighting Field de
Walter de Maria, qui crée un champ électrique sur une vaste aire à l'aide de pilonnes métalliques
destinés à attirer la foudre, ou bien le monumental Roden Crater de James Turrell, dont la structure
minérale orchestre une appréhension singulière du ciel et des astres. Ces quelques exemples doivent
nous conduire à reconsidérer certains primats de l’œuvre artistique en tenant compte des récentes
mutations qui ont affecté le champ de l'art. De la même façon que les frontières spatio-temporelles
de l'objet d'art tendent à se disloquer pour déboucher sur la notion d'environnement d'art, les sens
usuellement négligés comme l'odorat et le toucher recouvrent une nouvelle dignité. Ainsi, certaines
œuvres mettent en scène des parfums35, ou invitent les visiteurs à expérimenter l'installation au
moyen d'un investissement sensori-moteur complet36. De fait, l'attitude du sujet change et la
position contemplative du spectateur se mue en attitude exploratrice et expérimentale. Il convient
donc, à l'aune de ces évolutions, de relativiser la rupture entre expérience esthétique de l’œuvre d'art
et expérience de l'environnement.
Enfin, on remarquera que la porosité des paradigmes artistique et environnemental
peut opérer en sens inverse, les conventions générées par l'expérience de l'art pouvant informer ou
modifier notre expérience de l'environnement. Nous avons vu précédemment que cette influence a
été particulièrement vive au XVIIIe siècle, la naissance d'un tourisme aristocratique nourri des codes
35 C'est le cas de la Earth Room de Walter de Maria.36 L'artiste Meg Webster construit des installations, comme la Stick Spiral, qui doivent être parcourues pour être
pleinement appréciées.
17
de la peinture paysagère ayant engendré une certaine normativité de l'appréciation esthétique de la
nature. Mais cette influence nous est apparue comme néfaste, en ceci qu'elle n'appréhende pas la
nature selon ses propres termes, mais selon des critères qui lui sont extérieurs et ne lui rendent pas
pleinement justice. Pour autant, il est possible de concevoir des ponts entre l'esthétique de l'art et
l'esthétique de l'environnement qui ne se contentent pas d'assimiler l'une à l'autre, mais permettent
au contraire des va-et-vient conceptuels féconds. En quoi notre rapport à l'art peut-il informer notre
expérience esthétique de l'environnement ? Un tel rapprochement est-il légitime, souhaitable ? Afin
de répondre à ces questions, il convient de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit l'esthétique
environnementale. Outre les réflexions variées qui ont porté sur l'esthétique de la nature depuis
plusieurs siècles, l'esthétique environnementale englobe avant tout un champ de recherche
spécifique dont l'essor est contemporain des travaux sur l'éthique environnementale. L'étude de nos
réactions esthétiques à l'environnement ne soulève pas uniquement des enjeux théoriques, elle
s'inscrit au contraire dans un contexte scientifique et politique identifié: celui d'une crise
environnementale sans précédent. Ce contexte confronte l'esthétique environnementale à un certain
nombre d'enjeux, à commencer par celui d'un lien éventuel avec les enjeux éthiques de l'écologie.
En effet, on sait que certains parti pris esthétiques ont des conséquences écologiques concrètes, et, à
l'inverse, il apparaît que certaines qualités esthétiques de la nature sont parfois convoquées à des
fins de protection de l'environnement. Rapprocher l'expérience de la nature de l'expérience de l'art
permettrait ici d'importer certains codes d'appréciation à même d'orienter et de guider l'esthétique
environnementale. Il incombe donc à l'enquête philosophique de comprendre non seulement
comment se déroule l'expérience esthétique de l'environnement, mais aussi la façon dont elle
engendre des jugements, ménage des préférences, voire oriente des actions. Il s'agit enfin de
considérer la possibilité d'une esthétique qui ne hiérarchise pas les environnements mais les
appréhende avec une égale attention et puisse, de la sorte, déboucher sur un respect de la nature
dans sa globalité. Le parti d'un subjectivisme pur paraissant difficile à soutenir dans le contexte d'un
péril environnemental, certains penseurs dit « positivistes » ou « cognitivistes » se sont attachés à
penser des critères objectifs d'appréciation esthétique de la nature. Le but de leur réflexion est
d'ancrer l'esthétique dans un socle objectif et universellement valable afin de rendre nos
appréciations esthétiques compatibles avec une éthique de l'environnement.
b) Les sources du cognitivisme, un pont entre philosophie de l'art et esthétique environnementale.
18
Nous l'avons vu, ce qui distingue chez Kant l'appréciation esthétique de la nature de celle
des œuvres d'art, c'est le régime téléologique qui les caractérise. Ainsi, le tableau ou la sculpture
sont appréhendés comme le fruit d'une intention humaine tandis que l'objet naturel résulte d'une
téléologie immanente aux effets de la nature. Lorsque nous contemplons le ciel étoilé, il n'est donc
pas question d'imaginer que les étoiles constituent les soleils d'autres mondes peut-être habités, mais
« il faut simplement considérer le ciel comme on le voit, c'est-à-dire comme une vaste voûte qui
englobe tout.37 » De la même façon, l'océan doit être contemplé pour ses seules qualités sensibles, et
non pas « comme nous le pensons, enrichi de toutes sortes de connaissances (que l'intuition
immédiate ne saisit pas)38 ». Kant opère une rupture, vouée à une longue postérité, entre l'esthétique
et le cognitif, entre le jugement de goût et le jugement logique, entre le jugement réfléchissant et le
jugement déterminant. Cette rupture apparaît d'autant plus audacieuse qu'elle opère parallèlement à
un essor de la critique d'art, des salons et des musées engagés une dans démarche explicative des
œuvres. Or, pour Kant, l’œuvre s'éprouve mais ne s'explique pas. Le jugement de goût opère sans
concept. Il en va de même pour la nature, qui doit être appréhendée indépendamment de ce que la
science nous en apprend.
Cette position peut sembler problématique dans la mesure où l'expérience esthétique de la
nature ne fait pas systématiquement l'objet d'un consensus béat. La contemplation de la voûte
étoilée permet certes au sujet de sentir la portée universelle de la vibration intime qu'il éprouve,
mais elle demeure faible dans le cadre de la constitution d'une esthétique proprement
environnementale. Le touriste britannique qui déplore la monotonie des Rocheuses39, les lycéens
dakotiens qui martèlent leur dégoût pour la grande plaine et son manque d'arbres40, les montagnes
jadis jugées laides et aujourd'hui admirées41, constituent autant d'exemple des dissensus esthétiques
récurrents dont font l'objet les entités naturelles. Ces dissensus nous imposent de penser de façon
plus lucide et pragmatique la question des émotions esthétiques en lien avec la nature. Cette
entreprise est en outre rendue nécessaire par le fait, comme nous l'avons dit, que l'esthétique
environnementale se place explicitement dans la perspective des enjeux éthiques liés à la crise
écologique. A l'heure ou des dizaines d'hectares de marais disparaissent quotidiennement du fait de
37 Emmanuel Kant, op.cit., p.214.38 Ibid.39 « A British visitor to the Rocky Mountains, despite the fact that his Denver hosts had urged him, 'You'll love the
Rockies', complained that there were too many trees of too few kinds, mostly the same monotonous evergreens, too many rocks, too much sun too high in the sky, not enough water, the scale was too big and there were not enough signs of humans, no balanced elements of form and colour, nothing like the Lake District or the Scottish lochs. » in Holmes Rolston III, « Does Aesthetic Appreciation of Landscapes need to be Science Based ? », British Journal of Aesthetics, Vol. 35, No. 4, Oct.1995.
40 Cf. Shaunanne Tangney, « But What is There to See? An Exploration of a Great Plains Aesthetic », Great Plains Quarterly, vol.24, 2004.
41 Cf. Marjorie Hope Nicolson, op.cit.
19
leur faible intérêt paysager42, certains penseurs de l'esthétique environnementale ont tenu à analyser
nos expériences esthétiques de la nature sous un angle à la fois objectif et normatif. Objectif tout
d'abord, en ceci qu'ils refusent de laisser l'expérience esthétique hors de la portée du concept, ce
dernier pouvant constituer dans le cadre des sciences naturelles une assise neutre et universelle à
l'appréciation esthétique de la nature. Normative enfin, parce que la connaissance scientifique est
destinée à corriger et à redresser les jugements esthétiques erronés et les conséquences pratiques qui
s'en suivent parfois (par exemple : « ces marais sont laids »). Mais comment se défaire de la rupture
kantienne entre jugement esthétique et jugement logique ? N'apparaît-il pas contre-intuitif de fonder
conceptuellement une expérience qui se détermine initialement comme mise en échec du concept ?
Le cognitivisme esthétique n'implique-t-il pas, purement et simplement, une sortie hors de
l'esthétique ?
Afin de répondre à ces questions et de surmonter éventuellement les réticences kantiennes
qui les accompagnent, nous tâcherons dans un premier temps d'étudier les sources du cognitivisme
au sein de l'esthétique environnementale. L'article de Kendall Walton Categories of Art43 pose les
jalons d'une esthétique enrichie par la connaissance conceptuelle et incarne une des sources les plus
importantes du cognitivisme esthétique soutenu par des auteurs comme Allen Carlson, Marcia
Eaton ou Holmes Rolston III ; il conviendra donc d'en expliciter les thèses avant d'étudier plus en
détail la teneur du cognitivisme appliqué à l'esthétique environnementale proprement dite. Ces
développements devront nous permettre dans un dernier temps d'aborder la portée éthique d'une
telle esthétique. Le fait de fonder l'appréciation esthétique de la nature est en effet destiné à
homogénéiser les jugements esthétiques que portent les hommes sur leur environnement, il s'agit de
faire du beau l'objet d'un consensus collectif afin de normer collectivement les conduites humaines.
Mais la valeur esthétique d'un paysage ou d'une entité naturelle implique-t-elle des obligations
morales ? Si tel est le cas, comment se traduisent ces obligations d'un point de vue pratique ?
L'esthétique, comme nous l'indique son étymologie, concerne avant toute chose
l'aesthesis, la perception sensible. A ce titre, ce qui compte dans un objet que nous appréhendons
sur un mode esthétique, c'est la façon dont sa forme, sa couleur, les sons qu'il produit, son odeur, sa
texture etc, affectent nos sens et se trouvent sublimés par notre entendement. C'est ainsi que pour
Kant, seules les qualités formelles de l’œuvre comptent dans l'expérience esthétique du sujet. La
connaissance, les désirs, l'intérêt particulier du sujet se trouvent expulsés du champ de l'esthétique,
au profit d'un libre jeu entre les traits sensibles de l'objet d'un côté, et les facultés de l'esprit qui les
42 « In the two hundred years between the 1780s and the 1980s, more than 60 acres of wetlands were lost every hour. » William Shutkin, The Land that could be, Environmentalism and Democracy in the Twenty-First Century, MIT Press, Cambridge, 2001, p.66.
43 Kendall Walton, « Categories of Art », Philosophical Review, n°79, vol.3, 1970.
20
accueillent de l'autre. Plus qu'à une centralité du sensible, nous aurions donc affaire à un formalisme
exclusif. Dans son article célèbre Categories of Art, Kendall Walton conteste l'exclusivité du
sensible dans le déroulement de l'expérience esthétique. Cette contestation s'appuie sur le fait que
l'expérience esthétique du sujet n'est jamais pure au sens où Kant l'entend, mais est au contraire
continuellement traversée et habitée par des considérations non-esthétiques. A ce titre, l'idéal du pur
jugement réfléchissant semble théoriquement viable, mais peu consistant en pratique.
L'idée que les œuvres d'art devraient être jugées simplement d'après ce qui peut être perçu en
elles est sensiblement trompeuse, bien qu'il y ait du vrai dans l'idée que ce qui compte
esthétiquement dans une peinture ou une sonate, c'est son aspect ou sa mélodie44.
Il s'agit donc de faire des caractéristiques sensibles de l’œuvre le centre l'expérience esthétique, tout
en reconnaissant que ce centre est constitué et entouré de considérations non-sensibles, comme par
exemple la connaissance du contexte culturel et artistique de l’œuvre. L'argument le plus solide en
faveur de ce postulat est que, dans les faits, nous ne jugeons quasiment jamais une œuvre d'après la
seule perception sensible que nous en avons, bien que cette dernière demeure au centre de notre
attention.
Le cœur de l'argument de Walton consiste à soutenir que l'appréciation esthétique se
déploie toujours à l'intérieur de catégories déterminées. Lorsque nous apprécions un objet d'art,
nous l'intégrons spontanément aux catégories adéquates dont il relève : nous ne jugeons pas une
peinture d'après les canons de la sculpture (ce que Walton nomme le standard), de la même façon
que nous n'attendons pas d'une peinture cubiste qu'elle représente le monde comme le ferait un
tableau impressionniste (variation à l'intérieur du standard). Nous n'attendons pas d'une peinture
qu'elle possède du volume ou soit mobile, de la même façon que nous n'attendons pas des
compositions de Kandinsky qu'elles soient figuratives, sans quoi l'expérience que nous en faisons
risque d'être décevante. Ces distinctions font écho à la réplique célèbre de Matisse qui, répondant à
la remarque selon laquelle la femme qu'il avait peinte ne ressemblait à aucune femme, affirma « Ce
n'est pas une femme, c'est un tableau. » En disant cela, Matisse rappelle simplement que juger son
tableau d'après sa ressemblance avec une femme réelle, c'est l'appréhender selon la mauvaise
catégorie. Il y aurait donc des appréciations esthétiques incorrectes, c'est-à-dire des jugements de
goût opérant sur le mauvais plan catégoriel : trouver disharmonieuse une pièce de Schoenberg parce
que nous la jugeons d'après les conventions de la musique tonale à laquelle nous sommes habitués,
c'est former un jugement esthétique erroné. On pourrait répondre à cela que ces erreurs relèvent
44 « The view that works of art should be judged simply by what can be perceived in them is seriously misleading, though there is something right in the idea that what matters aesthetically about a painting or a sonata is just how it looks or sounds. » in Kendall Walton, art.cit.
21
d'avantage de la critique d'art que de l'expérience esthétique à proprement parler, mais Walton
insiste sur le fait que la considération d'une œuvre d'après la mauvaise catégorie affecte l'intensité
même du plaisir esthétique. Il ne s'agit pas d'utiliser son érudition pour reconnaître les œuvres et les
classer d'après les catégories qui leur sont adéquates, car ce faisant, on entrerait dans le cadre du pur
jugement déterminant où le sensible est reconnu plus qu'éprouvé45. La distinction entre bonne et
mauvaise catégorie est interne à l'esthétique :
Posons le fait que W soit meilleur, ou plus intéressant (...) ou vaille plus le détour quand il est perçu dans
C que quand il est perçu d'autres manières. La bonne façon de percevoir une œuvre est donc susceptible
d'être celle par laquelle elle ressort le mieux.46
Le fait d'appréhender correctement les qualités de l’œuvre d'art permet non seulement d'émettre un
jugement esthétique plus juste, mais également de vivre une expérience esthétique plus intense et
plus gratifiante. Le biais catégoriel se fond dans l'expérience esthétique en impulsant une
gratification supérieure, et inversement, la considération d'une œuvre selon une mauvaise catégorie
rend l'expérience esthétique désagréable et étriquée. Mais l'intensité et le caractère plaisant de
l'expérience suffisent-ils à déterminer la catégorie dans laquelle l’œuvre doit être appréhendée ? On
touche ici à la dimension normative du cognitivisme de Walton. Dire que l'objet d'art doit être perçu
dans la bonne catégorie, c'est dire qu'il existe des critères objectifs d'après lesquels on peut
déterminer la catégorie et le standard qui conviennent à cette œuvre. Le premier critère, nous
l'avons évoqué, consiste à souligner que quand l’œuvre est perçue dans la bonne catégorie,
l'expérience esthétique est améliorée. Mais ce critère est insuffisant et Walton lui en ajoute deux
autres : l'intention de l'artiste au moment où l’œuvre a été produite (c'est-à-dire la catégorie dans
laquelle il voulait qu'elle soit perçue), le fait que la catégorie en question s'inscrive dans un contexte
où elle est culturellement reconnue par les contemporains de l'artiste47. De la sorte, apprécier une
œuvre selon des canons qui sont totalement éloignés du contexte d'émergence de l’œuvre, c'est
formuler un jugement esthétique qui peut être considéré comme faux ou incorrect48.
En quoi cette réflexion peut-elle informer notre expérience esthétique de l'environnement ?
Si nous comprenons intuitivement l'importance que jouent les catégories de l'art dans notre
45 « Recognition is a momentary occurrence, whereas perceiving a quality is a continuous state which may last for a short or a long time. » in Kendall Walton, art.cit.46 «The fact, if it is one, that W is better, or more interesting, or pleasing aesthetically, or more worth experiencing when perceived in C, than it is perceived in alternative ways. The correct way of perceiving a work is likely to be the way in which it comes off best.» in Kendall Walton, art.cit.47 « The categories in which a work is correctly perceived, according to this condition, are generally the ones in which the artist's contemporaries dis perceived or would have perceived it. » in Kendall Walton, art.cit.48 « It cannot be correct, I suggest, to perceive a work in categories which are totally foreign to the artist and his society, even if it comes across as masterpiece in them. » in Kendall Walton, art.cit.
22
appréciation d'une œuvre, il semble qu'un tel schéma soit inopérant dans notre considération de la
nature. Cette considération se caractériserait au contraire par sa liberté et sa spontanéité et l'on
perçoit mal comment, d'une part, on pourrait contraindre cette expérience à se plier à certains
critères, et, d'autre part, quels critères ou quelles catégories pourraient s'appliquer à notre expérience
de la nature. Walton lui-même précise dans son article que l'application de ces principes à
l'esthétique des éléments naturels est possible mais limitée. En effet, s'il est possible de dire quelles
sont les catégories propres à une œuvre, il semble que dans le cadre d'un environnement naturel, le
choix de telles catégories soit voué à l'arbitraire. Certains estimeront que l'on peut apprécier un
paysage selon l'histoire et les mythes dont il est emprunt, d'autres que les références aux souvenirs
personnels du sujet sont plus pertinentes, d'autres encore que l'imagination doit être laissée libre
pour une appréciation esthétique optimale etc. Walton illustre cette difficulté de la sorte : si nous
découvrions un artefact dans les dunes de mars, sans aucune indication sur son origine, son utilité
ou sa destination, nous serions incapable de produire un jugement esthétique correct à son endroit.
Cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas en faire l'expérience esthétique, mais simplement
que cette expérience demeurerait soumise à la relativité des catégories que les individus se
proposeraient de projeter sur lui. Il en va de même pour les entités naturelles. Comme le soulignait
déjà Kant, elles ne sont que des effets et se distinguent de l’œuvre en ceci qu'elles ne procèdent
d'aucune intention à travers lesquelles nous pourrions les interpréter. Il semble donc à première vue
difficile si ce n'est vain de chercher à régler notre expérience esthétique de la nature sur la définition
de catégories objectives.
c) Une esthétique environnementale cognitiviste.
Cet héritage étant posé, il est possible d'aborder plus frontalement la question du
cognitivisme appliqué à l'esthétique environnementale. Bien que Walton reconnaisse l'inopérativité
de sa thèse dans le cadre d'une esthétique de la nature, Allen Carlson propose une reconversion des
catégories de l'art par le biais de son natural environmental model. Dire que la nature peut être
appréhendée selon n'importe quelle catégorie, voire indépendamment de toute catégorie, pose des
problèmes éthiques et écologiques auxquels le cognitivisme tente de répondre. En effet, cette
équivalence des catégories est problématique dans la mesure où elle empêche de distinguer une
appréciation esthétique correcte d'une appréciation incorrecte de la nature. Alors que dans le cadre
de l'appréciation esthétique d'une œuvre il est possible de croiser plusieurs données pour aboutir à
un jugement correct (intensité de l'expérience, intention de l'artiste, contexte culturel), il semblerait
23
que dans le cadre de la nature seul le plaisir esthétique du sujet puisse compter. Mais si tout se vaut,
alors nous ne pouvons pas critiquer le jugement esthétique selon lequel ces marais sont laids et
doivent être asséchés, par exemple, ou que tel complexe hôtelier rehausse la beauté du littoral. On
entrevoit ici la visée normative du cognitivisme tel que le défend Allen Carlson : il s'agit de trouver
des catégories objectives en vertu desquelles l'appréciation esthétique de la nature est non seulement
intensifiée, mais puisse en outre être compatible avec une éthique de l'environnement. Il apparaît en
effet que les jugements esthétiques que nous portons sur la nature possèdent un impact concret sur
la protection ou la dégradation de cette dernière. Un des principaux enjeux de l'esthétique
environnementale consiste donc à comprendre comment opèrent ces jugements, et comment les
rectifier – si cela est possible – lorsqu'ils portent atteinte à l'environnement. La solution proposée
par Allen Carlson, et qui s'inspire en partie des catégories de l'art énoncées par Walton, consiste à
soutenir que la connaissance scientifique de la nature constitue la catégorie à travers laquelle cette
dernière doit être apprécié esthétiquement49. Ainsi, si l'on apprécie esthétiquement une baleine
d'après la catégorie 'poisson', nous risquons de la trouver difforme et monstrueuse. En revanche, si
nous l'apprécions d'après la catégorie qui lui est propre, ses qualités esthétiques seront magnifiées et
le jugement qui en découlera sera dit correct. Cette thèse est délicate à soutenir dans la mesure où
elle risque constamment de déboucher sur un excès du conceptuel par rapport au sensible. En effet,
si le sujet focalise son attention sur la considération de données scientifiques plus que sur les
qualités sensibles de l'objet, il devient difficile de parler de jugement esthétique. Mais l'argument
d'Allen Carlson est plus subtil, puisqu'il s'agit de dire que la connaissance scientifique modifie la
texture même de notre expérience esthétique. Cette distinction est formulée avec clarté par Patricia
Matthews : il ne s'agit pas d'ajouter un concept à l'expérience esthétique (thinking with concepts)
mais de percevoir à travers le concept (perceiving under concepts)50. Lorsque je contemple une fleur
en haute altitude, j'admire non seulement ses qualités esthétiques, mais également le rapport entre
ses qualités esthétiques et l'hostilité du milieu dans laquelle la fleur s'épanouit, le froid qu'elle doit
combattre, les roches dans lesquelles elle enfonce ses racines etc. Ce que je sais de la fleur modifie
ma façon de la voir, et de l'apprécier esthétiquement. L’œuvre du célèbre géographe Élisée Reclus
offre un exemple intéressant de la façon dont la connaissance scientifique (en l'occurrence
botanique) et l'appréciation esthétique s'entremêlent. Décrivant les caractéristiques des plantes de
haute altitude, il écrit
49 « To appropriately appreciate natural objects or landscapes (...) aesthetically (...) it is necessary to perceive them in their correct categories. This require knowing what they are and knowing something about them. In general, it requires the knowledge given by the natural sciences. » in Allen Carlson, Aesthetics and the Environment: The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Routledge, 2005, p.90.
50 Patricia Matthews, « Scientific Knowledge and the Aesthetic Appreciation of Nature », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol.60, n°1, hiver 2002.
24
Là, du reste, l'éclat des corolles est incomparable. (…) Pressées de vivre et de jouir, les plantes
se font plus belles ; elles s'ornent de couleurs plus vives, car la saison de la joie sera courte ;
après l'été qui s'enfuit, la mort les surprendra.51
Puis,
Parmi ces herbes aux fleurs éclatantes, il en est que n'effraient nullement le voisinage de la
neige et de l'eau glacée. Elles ne sont point frileuses ; tout à côté des cristaux du névé, le flux de
la sève circule librement dans les tissus de la soldanelle qui penche au dessus de la neige sa
corolle d'une nuance si tendre et si pure ; quand le soleil brille, on peut dire d'elle, mieux que du
palmier de l'oasis, qu'elle a les pieds dans la glace et la tête dans le feu.52
Ces quelques réflexions manifestent un lien étroit entre des considérations objectives et érudites et
l'appréciation esthétique proprement dite. Nous apprécions d'autant plus la finesse des pétales d'une
fleur lorsque nous connaissons les conditions qu'elle doit affronter pour vivre, le contraste entre le
froid et le chaud qu'elle supporte, etc. De la même façon, la vivacité des couleurs de telle autre fleur
nous paraît rehaussée lorsque nous savons à quel point elle est éphémère. On songera également aux
descriptions émues qu'Aldo Leopold fait des cortèges d'oies et de grues migratrices53, dont il
apprécie d'autant mieux le cri qu'il sait qu'il résonne à travers les âges et incarne le produit et
l'expression d'une lente évolution. L'appréciation esthétique de la nature gagne donc à être, sinon
érudite, du moins informée.
La connaissance scientifique permet d'intensifier le plaisir que nous avons à
contempler une entité naturelle. Le cri de la grue est d'autant plus majestueux et émouvant que nous
savons les kilomètres qu'elle a parcouru pour arriver ici, l'ancienneté de son espèce etc. Mais les
données scientifiques peuvent également jouer un rôle d'aiguillage, en nous aidant à discriminer les
traits sensibles d'un paysage ou d'un objet naturel. La connaissance scientifique canalise et intensifie
l'expérience sensible tout à la fois. Un spectateur non-informé risque par exemple de percevoir une
forêt récemment brûlée comme un lieu de désolation esthétiquement répulsif. Son attention se
focalisera sur la cendre, la noirceur des souches, l'absence des feuillages verts attendus etc. A
l'inverse, un spectateur au fait du bénéfice écologique des brûlis tendra à se concentrer sur les
indices de régénération que comporte le paysage. La connaissance guide le regard, elle trie le trop-
plein du sensible et oriente l'attention sur des qualités esthétiques écologiquement signifiantes que
51 Élisée Reclus, Histoire d'une montagne, Actes Sud, 1998, p.130.52 Ibid.53 « Lorsque nous entendons son appel, ça n'est pas un simple oiseau que nous entendons, mais la trompette de
l'orchestre de l'évolution. » Aldo Leopold, op.cit., p.129.
25
le sujet ne parvient pas à convertir en expérience54. En l'absence de cette connaissance, l'immersion
multi-sensorielle dans un environnement naturel peut vite se traduire par une saturation de données
que le sujet ne parvient pas à apprécier tout simplement parce qu'il ne parvient pas à les ordonner. Il
en découle une succession confuse d'impressions esthétiques fugaces. Les catégories proposées par
la science permettent de structurer et d'intensifier ces impressions. Elles opèrent de la même façon
que les catégories de l'art qui nous aiguillent et nous amènent, comme le montre Walton, à ne
considérer que les qualités sensibles centrales de l’œuvre. Ainsi, nous ne prenons pas la blancheur
d'un buste de marbre pour un défaut ou un manque de couleur, parce que la blancheur du matériau
constitue un standard de la catégorie dans laquelle nous apprécions le buste. Dans le cadre de
l'appréciation esthétique de la nature, la catégorie adéquate nous évite ainsi les déceptions parfois
liées au fait que nous attendons de certains paysages des propriétés qui ne sont pas en accord avec
leur fonctionnement écosystémique (des falaises spectaculaires pour un marais, des plages de sable
blanc pour un littoral rocheux etc). En somme, la connaissance canalise l'expérience esthétique et la
renforce tout à la fois55. Il ne s'agit pas de déclasser l'impression esthétique au profit d'une
connaissance conceptuelle de l'objet, mais de réinscrire les qualités sensibles de ce dernier dans la
trame des savoirs scientifiques.
Cette thèse s'oppose explicitement à la conception kantienne du jugement de goût. Là
où Kant avançait la nécessité d'exclure toute téléologie objective (soit les sciences naturelles
convoquées par Allen Carlson) du jugement de goût au profit d'une téléologie subjective (soit la
perception de la forme d'une finalité), Allen Carlson opère deux renversements. Tout d'abord, il
polarise la sphère esthétique autour de l'objet, là où Kant faisait de l'expérience du sujet le cœur de
son système. L'on passe donc d'une esthétique subjectiviste à une esthétique expressément
objectiviste. Ce positivisme débouche sur une seconde opposition portant sur la nature du jugement
esthétique. Tandis que Kant distingue rigoureusement le jugement réfléchissant, qui est à l'origine
de l'expérience esthétique, du jugement déterminant, qui est projection du concept sur l'objet ; Allen
Carlson, comme Kendall Walton, fait de ce dernier la condition d'une expérience esthétique
pertinente. Il est intéressant à ce sujet de noter qu'il délaisse le vocable d'expérience esthétique au
profit de celui d'appréciation esthétique, qui laisse une plus large place à la composante objective
du jugement. De fait, il paraît absurde de dire qu'une expérience est fausse ou incorrecte, tandis
qu'une appréciation peut être viciée ou inexacte. Mais doit-on pour autant dire que la personne qui
54 Dewey distingue ainsi la sensation, qui est centrée sur l'organe récepteur, de la sensibilité, qui est un effort de concentration et d'attention à l'objet esthétique. La sensation est immédiate et superficielle, à l'inverse de la sensibilité qui convertit le sensible en expérience. Cf. John Dewey, L'art comme expérience, , Gallimard, Paris, 2005, p.218-219.
55 « Scientific information and redescription make us see beauty where we could not see it before, pattern and harmony instead of meaningless jumble. » Allen Carlson in Allen Carlson, Sheilo Lintott, Nature, Aesthetic Value and Environmentalism : From Beauty to Duty, Columbia University Press, 2008, p.56.
26
admire la fleur de haute-montagne qu'évoquait Élisée Reclus sans le moindre bagage botaniste, fait
une appréciation erronée de la fleur ? La réponse d'Allen Carlson rejoint ici celle de plusieurs autres
penseurs de l'esthétique environnementale. Le promeneur qui admire une fleur dont il ignore les
particularités, les conditions de développement et l'écosystème, ne fera qu'une expérience
superficielle de la fleur. Allen Carlson distingue, comme Ronald Hepburn et Holmes Rolston, une
appréciation esthétique sérieuse et dense (thick), d'une appréciation formelle et sommaire (thin).
Ronald Hepburn écrit :
Supposons que les contours d'un cumulus ressemblent à un panier de linge, et que nous nous
amusions à insister sur cette ressemblance. Supposons qu'en une autre occasion, nous
n'insistions plus cet aspect insolite, mais essayions à la place de prendre conscience des
turbulences internes au nuage, des vents qui le balaient et déterminent sa structure et sa forme
visible. Ne devrions nous pas déclarer que cette expérience est moins superficielle que la
première, qu'elle est plus véritable et fidèle à la nature, et, pour cette raison, plus digne d'être
menée ? S'il peut y avoir un passage, en art, entre une beauté facile et une beauté plus difficile et
sérieuse, il doit également y avoir de tels passages dans la contemplation esthétique de la
nature.56
L'expérience esthétique de la nature qui se déroule dans l'ignorance totale des objets considérés et se
contente de s'en remettre à leurs seules qualités sensibles, manque donc de profondeur et de sérieux.
Mais cela présuppose que les connaissances que nous apporte la science sur la formation des
nuages, par exemple, ont plus de valeur dans l'établissement d'une expérience sérieuse que
l'imagination ou la référence à la mythologie. Le problème des approches non-scientifiques est
qu'elles n'abordent pas la nature pour ce qu'elle est, mais à travers le filtre des intérêts humains.
L'expérience esthétique qu'Allen Carlson appelle de ses vœux est souhaitable en ceci qu'elle nous
apprend à voir les entités naturelles comme elles sont, et pas uniquement comme elles
apparaissent57.
Le critère scientifique proposé par Allen Carlson semble donc fécond à plusieurs titres.
Sur le plan esthétique, il permet de canaliser les données sensibles et d'intensifier l'expérience du
56 « Suppose the outline of our cumulus cloud resembles that of a basket of washing, and we amuse ourselves in dwelling upon this resemblance. Suppose that on another occasion we do not dwell on such freakish aspects, but try instead to realize the inner turbulence of the cloud, the winds sweeping up within and around it, determining its structure and visible form. Should we not be ready to say that this latter experience was less superficial than the other, that it was truer to nature, and for that reason more worth having? If there can be a passage, in art, from easy beauty to difficult and more serious beauty, there can also be such passages in aesthetic contemplation of nature. » Ronald W.Hepburn, “Aesthetic Appreciation of Nature,” in H.Osborne, Aesthetics in the Modern World, Thames and Hudson, Londres, 1968.
57 « That any of such descriptions are aesthetically relevant in the way suggested before is all that need to be the case in order to establish the importance of perceiving an object in the category of what it is as opposed to what it appears to be. » Allen Carlson, op.cit., p.66 .
27
sujet, exactement de la même façon que les catégories de Kendall Walton rendent l'appréciation de
l’œuvre d'art plus gratifiante. Parallèlement à cela, l'expérience esthétique informée suscite une
relation plus juste entre le sujet et son environnement naturel, elle appelle à considérer ce dernier
pour lui-même (for its own sake) et non simplement à travers le filtre des désirs et des fantaisies
humaines. A cet égard, la connaissance scientifique doit nous aider à nous défaire de nos préjugés et
à cesser de hiérarchiser esthétiquement les paysages, attendu que pour celui qui possède les
connaissances adéquates, « tout est beau dans la nature58». Cela nous reconduit aux prétentions
éthiques du cognitivisme d'Allen Carlson. Il ne s'agit pas d'étudier nos réactions esthétiques pour
elles-mêmes, mais de les replacer dans la trame des conséquences pratiques qu'elles engendrent. On
sait en effet que l'appréciation esthétique du paysage joue un rôle important dans sa conservation et,
parfois, dans sa destruction. A ce titre, la discipline de l'esthétique environnementale n'est jamais
totalement décorellée d'un souci éthique pour l'intégrité de l'environnement. Tâchons donc à présent
de voir comment ce souci se manifeste, et comment le cognitivisme esthétique permet d'y répondre.
d) Les perspectives éthiques du cognitivisme esthétique.
La vision d'une forêt récemment brûlée, nous l'avons dit, peut susciter des réactions
esthétiques fort différentes. Pour le citadin peu informé, elle risque d'entraîner du dégoût et une
sensation désagréable de désolation. A l'inverse, pour le naturaliste ou le forestier, l'expérience
promet d'être plus nuancée et moins négative, les cendres apparaissant comme la promesse du
renouveau ou comme une étape positive dans un cycle de régénération esthétiquement gratifiant.
Mais de ces deux expériences esthétiques, laquelle 'l'emporte' ? Cette question est particulièrement
importante dans la mesure où la beauté de la nature, la gratification qu'elle est censée apporter aux
promeneurs par exemple, est intégrée à des politiques concrètes de gestions du paysage. Ainsi,
comme le souligne Marcia Eaton :
La volonté de protéger les forêts du feu parce que les zones brûlées sont généralement jugées
laides a impliqué que des plantes dont la croissance était stimulée par les sols noircis qui se
réchauffent plus vite sous le soleil printanier, sont devenues plus rares.59
58 Allen Carlson, op.cit., p.126.59 « The concern to protect forests from fires because burned out areas are usually seen as ugly has meant that plants
whose growth is stimulated in burned and blackened soil that warms more quickly in the spring sun have be-come rarer. » Marcia Muelder Eaton, « Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 56, No. 2.
28
C'est-à-dire qu'une réaction esthétique (le fait de trouver une forêt brûlée laide) a entraîné
insensiblement une modification de certains équilibres écosystémiques (prévention des feux,
raréfaction des arbres qui bénéficiaient des sols calcinés). De la même façon, Emily Brady souligne
que l'esthétique joue un rôle certain dans la délimitation de parcs naturels protégés. En Écosse, par
exemple, la NSA (National Scenic Area) rassemble une série de zones et de paysages valorisés pour
leur valeur récréative. Le scénique et le spectaculaire sont privilégiés sur d'autres qualités
esthétiques parce qu'ils sont censés plaire d'avantage aux touristes et aux citadins venus se divertir
le week-end60. Aux États-Unis, la région marécageuse des Everglades n'a été officiellement
préservée qu'en 1974, soit près d'un siècle après la créations des Parcs Nationaux emblématiques du
Yosemite et du Yellow Stone. L'appréciation esthétique de la nature possède donc un impact concret
sur la gestion du territoire et la protection des environnements naturels, c'est la raison pour laquelle
elle ne doit pas être abandonnée aux variations du goût mais doit au contraire être sanglée dans une
connaissance scientifique rigoureuse des écosystèmes concernés. S'il n'y a aucune raison valable de
privilégier le spectacle visuel sur d'autres qualités esthétiques de l'environnement, alors la science
doit fournir un cadre d'appréciation esthétique autant qu'un cadre d'action et de gestion
environnementale.
Cette position est partagée par Marcia Eaton. En effet, cette dernière ne nie pas que
nous éprouvons régulièrement des émotions esthétiques qui ne tiennent absolument pas compte de
données scientifiques. L'imagination, les souvenirs, la pure jouissance formelle suffisent parfois à
façonner notre expérience esthétique et il ne doit pas être question de hiérarchiser ces facteurs. Pour
autant, lorsqu'il s'agit de planification du territoire et de sauvegarde écologique, seul un jugement
esthétique basé sur une connaissance objective du milieu concerné doit être considéré comme
légitime :
Si nous voulons développer une base pour l'évaluation rationnelle de la pérennité écologique
d'un paysage, je suis convaincue que nous devons privilégier le cognitif. Une bande de salicaires
pourpres, avec ses couleurs vives, peut causer beaucoup de plaisir... Une vaste étendue de gazon
d'un vert profond peut entraîner d'apaisantes envolées de l'imagination. Mais tous ces objets
menacent certains écosystèmes, et seule une personne dont la réponse esthétique est basée sur la
connaissance agira en retour de façon responsable et durable.61
60 Emily Brady, Aesthetics of the Natural Environment, The University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2003, p.226.61 « If we want to develop a basis for rational evaluation of a landscape's ecological sustainability, I am convinced that
we must stress the cognitive. A patch of purple loosestrife, with its brilliant color, may cause a lot of pleasure... A large expanse of closely clipped, deep-green grass may cause soothing flights of imagination. But all of these objects threaten certain biosystems, and only someone whose aesthetic response is based on knowledge will act in ways that are sustainable », Marcia Eaton, « The Beauty that Requires Health » in Allen Carlson, Sheilo Lintott, Nature, Aesthetic Value and Environmentalism : From Beauty to Duty, p.343.
29
Dans son essai « The Beauty that Requires Health62 », elle tente de connecter la santé écologique63 à
la gratification esthétique. Ce projet fait écho à la fameuse maxime leopoldienne : « une chose est
juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. 64» Il
s'agit de lier le caractère sain d'un environnement au plaisir esthétique que nous en retirons, lequel
devrait nous amener par la suite à vouloir préserver cet environnement ; de sorte qu'une boucle
vertueuse s'installerait entre l'émotion esthétique et l'attitude de protection.
L'équilibre écologique et l'équilibre esthétique seront perçus simultanément. Il en découlera,
j'espère, que la santé et la beauté seront amenées à se développer ensemble. Si ceci arrive, alors
une soutenabilité à la fois esthétique et écologique en résultera.65
Il convient donc de se défaire des préjugés esthétiques qui nous amènent à n'apprécier que la
« beauté facile » que pointait Ronald Hepburn, afin d'approfondir notre appréhension esthétique du
monde naturel à travers une connaissance plus juste et plus objective de ce dernier. La jouissance
esthétique seule ne semble donc pas pouvoir fonder la considération éthique du non-humain.
Comme le souligne avec justesse Holmes Rolston, il lui semblerait étrange de soutenir qu'il respecte
sa femme parce que celle-ci est belle. La beauté fait certes partie de l'identité de sa femme, mais il
la respecte avant tout pour la valeur intrinsèque qu'elle possède, et il ne cesserait pas de la respecter
si elle était défigurée par un accident de voiture66. Fonder le respect de la nature sur sa beauté paraît
donc peu satisfaisant, en ceci que la beauté n'est jamais intrinsèque au sujet (ou au paysage) mais
résulte d'une appréhension extérieure souvent versatile. Holmes Rolston le reconnaît, si la beauté
n'est pas nécessairement réductible à l’œil du spectateur, elle n'en est pas moins éminemment
relationnelle67. Or, si l'on veut fonder une éthique de l'environnement, nous devons être capable de
respecter les entités non-humaines pour ce qu'elles sont indépendamment de nous, et non
simplement du fait qu'elles nous procurent un plaisir esthétique. Pour ce faire, Rolston distingue les
propriétés esthétiques de l'environnement (aesthetic properties) des capacités esthétiques du sujet
62 Marcia Muelder Eaton, « The Beauty That Requires Health », in Joan Nassauer, Placing Nature: Culture and Landscape Ecology, Island Press, Washington, D.C, 1997.
63 On peut se référer ici la définition que donne Aldo Leopold de la santé : « La santé, c'est la capacité de la terre à se renouveler elle-même. L'écologie, c'est notre effort pour comprendre et préserver cette capacité. » in Aldo Leopold, op.cit., p.279.
64 Aldo Leopold, op.cit., p.283.65 « Aesthetic and ecological soundness will be perceived simultaneously. The upshot will be, I hope, that health and
beauty begin to come together. If this happens, then both aesthetic and ecological sustainability may result. », Marcia Eaton, op.cit., p.358.
66 Cet exemple est tiré de son essai « From Beauty to Duty, Aesthetics of Nature and Environmental Ethics » in Arnold Berleant, Environment and the Arts, Ashgate Pub Ltd, Hampshire, UK, 2002.
67 « Well, if not exactly in the eye of the beholder, beauty in nature is always relational, arising in the interaction between humans and their world. » Holmes Rolston III, « From Beauty to Duty, Aesthetics of Nature and Environmental Ethics » in Arnold Berleant, op.cit.
30
qui les appréhende (aesthetic capacities). Les propriétés esthétiques sont inhérentes à l'objet et
indépendantes de la saisie sensible que nous en faisons. Ainsi, la synthèse de chlorophylle qui rend
les feuilles vertes et agréables à l’œil est indépendante du fait que nous les contemplions ou pas. La
science permet de comprendre le fonctionnement autonome des entités naturelles et donne en ce
sens accès à une beauté sérieuse et profonde (thick) qui n'implique pas de dommages pour notre
environnement. Le regard actualise une qualité latente du paysage ou de l'animal ; la beauté. Cette
dernière est découverte dans la nature et non projetée sur elle. Il s'agit de « laisser nos critères de
beauté être réformés par les standards de la communauté biotique68 », c'est-à-dire d'accueillir plus
que de projeter, de rencontrer plus que de déformer. Le fait que les mathématiques aient été
inventées par les hommes n'empêche pas que le monde soit régit par des lois mathématiques
indépendamment des hommes ; de la même manière, l'équilibre, la symétrie, l'harmonie, la diversité
des formes et des couleurs existaient dans le monde naturel avant que nous les trouvions belles. Le
lien entre l'esthétique environnementale et l'éthique est alors plus complexe que celui véhiculé par
l'imagerie romantique des associations de défense de l'environnement. Certes, nous sommes inclinés
à préserver ce que nous trouvons beau, mais dans ce cas la préservation dépend précisément de nos
goûts, ce qui n'est pas acceptable en vue d'une appréhension éthique du non-humain. Holmes
Rolston, pour conclure son essai, résume ainsi :
L'esthétique peut-elle constituer un fondement adéquat à l'éthique environnementale ? Cela
dépend du degré de profondeur de votre esthétique. Non là où la plupart des esthéticiens
débutent, c'est-à-dire de façon relativement superficielle (bien qu'esthétiquement sophistiquée).
Oui, de plus en plus, là où l'esthétique en vient à se fonder sur l'histoire naturelle, et où les
hommes se donnent une place appropriée dans le paysage. Est-ce que l'éthique a besoin d'une
telle esthétique pour être adéquatement fondée ? Oui, en effet.69
Deux éléments ressortent de cette conclusion : Tout d'abord nos émotions esthétiques ont un rôle
important à jouer dans le développement d'une éthique de l'environnement. Il est manifeste que
nous tendons à conserver et protéger ce que nous trouvons beau, et que l'expérience sensible de la
nature ne peut être oblitérée ou négligée dans la fondation de pratiques respectueuses à l'égard des
entités non-humaines. Mais ce lien ne doit pas en rester au stade de l'esquisse naïve, il doit au
contraire faire face aux problématiques inhérentes à l'insertion de l'esthétique dans le giron de
68 « (…) let our criteria for beauty be reformed by the standards of biotic community. », Holmes Rolston III, op.cit.69 « Can aesthetics be an adequate foundation for an environmental ethic? This depends on how deep your aesthetics
goes. No, where most aestheticians begin, rather shallowly (even though they may be aesthetically rather sophisticated). Yes, increasingly, where aesthetics itself comes to find and to be founded on natural history, with humans emplacing themselves appropriately on such landscapes. Does environmental ethics need such aesthetics to be adequately founded? Yes, indeed. » Ibid.
31
l'éthique : il s'agit, pour échapper aux caprices du goût et à la versatilité de la mode, de fonder
l'esthétique sur les sciences naturelles. Alors seulement, il est possible de parvenir à un paradigme
esthético-éthique viable. Ce paradigme devra également permettre de prévenir des pratiques
écologiquement nocives souvent réalisées à des fins esthétiques. Les exemples de telles pratiques
abondent et doivent inciter à une forte vigilance quant à l'association entre éthique et esthétique.
Yuriko Saito évoque ainsi le « Augusta National Syndrome » soit le phénomène, particulièrement
manifeste aux États-Unis, qui consiste pour certains particuliers à vouloir façonner leur jardins
d'après les canons esthétiques du terrain de golf70. Ces transformations, qui ont un motif
explicitement esthétique, n'en sont pas moins écologiquement dévastatrices : les étangs sont arrosés
de colorants aquatiques destinés à les rendre turquoises, les pelouses sont saturées d'engrais et
tontes quotidiennement, en somme, l'environnement naturel est plié à des canons artificiels qui ne
respectent aucunement le fonctionnement et l'équilibre propre des écosystèmes concernés.
Inversement, certains phénomènes écologiquement négatifs comme l'apparition d'espèces invasives
qui réduisent la biodiversité et appauvrissent les sols font parfois l'objet d'appréciations esthétiques
positives. C'est le cas du Rhododendron Ponticum qui conjugue des couleurs chatoyantes et un effet
dévastateur sur son environnement71, c'est le cas également des cerfs, emblème d'une faune
charismatique que le public ne souhaite pas voir tués même lorsqu'ils déséquilibrent les
écosystèmes forestiers72, c'est le cas enfin des salicaires pourpre précédemment évoquées par
Marcia Eaton... En somme, les exemples de conflits entre la gratification esthétique et la santé
écologique sont nombreux, et le modèle cognitiviste présente l'intérêt de refuser la superficialité
d'une esthétique non-informée. Il promeut ainsi la science au rend d'arbitre des émotions
esthétiques, disqualifiant celles qui procèdent d'intérêts subjectifs et partiaux, et valorisant celle qui
s'appuient sur une connaissance de la nature de l'objet considéré.
On peut néanmoins émettre une réserve sur l'efficience d'une telle association entre
l'esthétique et l'éthique : la personne qui trouve belles les trouées colorées de salicaires pourpres
risque de continuer à les trouver belles, quand bien même elle apprendrait que ces fleurs possèdent
une influence néfaste sur les écosystèmes qu'elles colonisent. Nous pouvons nous empêcher de
considérer esthétiquement un phénomène que nous estimons moralement condamnable (une parade
militaire, par exemple), mais c'est alors notre conscience morale qui s'oppose à notre appréciation
esthétique, et non notre appréciation esthétique qui est à proprement parler modifiée par notre
70 Le terrain de golf du Augusta National constitue le parangon de cette esthétique aseptisée. 71 Emily Brady, op.cit., p.247.72 « Even in the presence of trees ravaged by deer who in their own way do indeed fight for food we continue to think
of all deer as Bambis, the consequence being that forest man-agers find it difficult to convince the public that their numbers should be severely decreased in some areas. » Marcia Eaton, « Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature », art.cit.
32
conscience morale. A cela, Patricia Matthews répond que la connaissance scientifique n'est certes
pas performative, elle ne bouleverse pas nos goûts esthétiques instantanément mais doit faire l'objet
d'un travail continué. Elle précise ainsi que « percevoir à travers une catégorie scientifique demande
du temps et de l'expérience. Nous devons apprendre à voir la salicaire pourpre comme dangereuse
dans certains contextes.73 » Elle illustre cet argument à l'aide de l'exemple d'un bleu sur le visage
d'un enfant. Les nuances bleutées et violacées qui se diffusent sur la peau de l'enfant peuvent être
dites belles lorsqu'elles sont abstraites de tout contexte. Elles possèdent des propriétés esthétiques
manifestes, mais il nous est malgré tout difficile de prendre du plaisir à les contempler lorsque nous
savons qu'elles découlent d'actes de maltraitance : « Ça n'est pas seulement que le bleu est vu
comme triste et beau à la fois, mais la tristesse imprègne la beauté et modifie sa qualité
esthétique.74» Il s'agit donc d'appréhender esthétiquement les blessures écologiques comme nous
appréhenderions les blessures d'un humain. Là où la surface des choses peut être trompeuse et ne
receler qu'une beauté artificielle et nocive, la connaissance scientifique doit nous permettre
d'éduquer notre œil à une appréhension à la fois plus juste et plus profonde des entités non-
humaines.
La science semble donc fournir les catégories sous lesquelles nous pouvons nous
rapporter de façon objective et respectueuse aux entités naturelles. Grâce à elle nous cessons de
projeter sur le faon l'image de Bambi, d'attendre de chaque paysage des qualités scéniques
stéréotypées ou encore de nous émerveiller devant des phénomènes explicitement nuisibles et
nocifs. Mais dans ce cas pourquoi ne pas ne pas fonder une éthique de l'environnement sur les
seules sciences naturelles et délaisser l'émotion esthétique, si prompte à nous fourvoyer et à nous
éloigner des réalités écologiques ? Deux remarques répondent partiellement à cette interrogation.
Celle de Holmes Rolston tout d'abord, qui évoque au début de son essai From Beauty to Duty le rôle
de plus en plus important de l'esthétique dans notre rapport à la nature75, et celle d'Aldo Leopold qui
décline à plusieurs reprises dans son Almanach l'importance de l'émotion dans le développement
d'une éthique de l'environnement : « Nous ne sommes potentiellement 'éthiques' qu'en relation à
quelque chose que nous pouvons voir, sentir, comprendre, aimer d'une manière ou d'une autre.76 »
L'émotion esthétique, le plaisir que nous prenons à voir, sentir, toucher les entités naturelles est co-
extensive au souci éthique que nous éprouvons pour nos compagnons non-humains. Ce souci n'est
73 « Perceiving under the scientific category take time and experience. We have to learn to see the loosestrife, in certain context, as harmful. » Patricia Matthews, art.cit.
74 « It is not just that the bruise is viewed as both sad and beautiful, but the sadness pervades the beauty and changes its aesthetic quality. » Ibid.
75 « Aesthetic experience is among the most common starting points for an environmental ethic. Ask people, 'Why save the Grand Canyon or the Grand Tetons, and the ready answer will be, 'Because they are beautiful. So grand!' » in Holmes Rolston III, art.cit.
76 Aldo Leopold, op. cit., p.271.
33
jamais purement rationnel mais possède une texture affective irréductible, ce qui fait dire à Aldo
Leopold que « L'évolution d'une éthique de la terre est un processus intellectuel autant
qu'émotionnel77 ». Cela signifie qu'il faut composer avec l'émotion et non la rejeter. Le rôle de la
connaissance scientifique est précisément de canaliser cette émotion, de la corriger lorsqu'elle se
fourvoie et d'engendrer une « compréhension critique de la terre78 ». Holmes Rolston formule un
constat similaire : l'émotion esthétique est d'ores et déjà au cœur de notre rapport à l'environnement,
c'est un donné avec lequel il nous faut travailler si l'on veut bâtir une éthique viable. Attendu qu'elle
joue un rôle parfois néfaste dans la gestion des entités naturelles, cette émotion doit être informée,
corsetée par une connaissance attentive du fonctionnement des écosystèmes.
Résumons ce premier développement. Depuis le XVIIIe siècle, l'émotion esthétique est
traditionnellement perçue comme une émotion spontanée, libre et non-conceptuelle. Faire
l'expérience esthétique d'un objet, ce serait jouir de ses qualités formelles sans les rattacher à
quelque intérêt pratique ou catégorie conceptuelle que ce soit. Cet héritage formaliste est contesté
par le mouvement cognitiviste qui s'attache, à partir de l'article de Kendall Walton, à démontrer que
nos émotions esthétiques font continuellement écho à des connaissances, vraies ou fausses, au sujet
de l'objet que nous contemplons. Ces connaissances peuvent rendre l'expérience esthétique tantôt
vibrante et profonde, tantôt étriquée et désagréable. Le recours à un cadre conceptuel permet alors
de juger du caractère approprié de l'appréciation esthétique : de la même façon qu'il n'est pas correct
de dire du dodécaphonisme qu'il est inaudible tout en se référant aux canons de la musique tonale, il
n'est pas non plus satisfaisant de mépriser les marais parce qu'ils ne rassemblent pas les traits
dramatiques attendus par la tradition paysagère romantique. Ce postulat permet à Allen Carlson de
proposer un modèle d'appréciation esthétique de la nature qui tienne compte des caractéristiques
propres aux entités non-humaines considérées. Les sciences naturelles doivent fournir un cadre
conceptuel à même de canaliser l'émotion esthétique, c'est-à-dire non pas de l'annuler ou de
l'écraser sous des considérations intellectuelles, mais de l'orienter tout en l'intensifiant. Cette
canalisation est d'autant plus importante que les émotions esthétiques sont déjà mobilisées dans le
cadre de nos rapport à la nature mais qu'elles le sont le plus souvent de façon inconséquente.
L'expérience esthétique doit permettre de renforcer une relation éthique entre l'humain et le non-
humain, c'est-à-dire une relation de respect qui ne soit pas basée sur un plaisir esthétique contingent
et versatile, mais sur un plaisir fondé objectivement par les sciences. Dans cette perspective, éthique
et esthétique ne se confondent pas mais peuvent s'intensifier mutuellement avec le concours de la
77 Ibid.78 Ibid.
34
connaissance scientifique. Cette association n'implique pas un recouvrement mutuel : l'émotion
esthétique n'est pas indispensable au comportement éthique et inversement. On peut par exemple
militer pour le respect de la valeur intrinsèque des animaux sans faire l'expérience esthétique de ces
derniers, et il existe un certain nombre d'engagements éthiques qui n'appellent pas de paramètre
esthétique. Pour autant, l'esthétique constitue un champ d'expérience particulièrement influent dans
nos vies ; elle contribue souvent à intensifier nos relations à la nature et incarne à ce titre un
puissant levier pour le développement d'un souci éthique pour le non-humain. Mais ce souci n'est-il
légitime qu'une fois passé le filtre de la connaissance scientifique ? Toute expérience esthétique
non-cognitive est-elle nécessairement vaine au regard d'une éthique de l'environnement ?
35
CHAPITRE II
VERS UNE ALTERNATIVE NON-COGNITIVE.
Peut-on penser une association féconde entre l'esthétique et l'éthique sans référence aux
critères cognitifs énoncés par Allen Carlson ? Une telle association semble à première vue périlleuse
dans la mesure où, nous l'avons vu, la connaissance scientifique est précisément ce qui permet à
l'esthétique de s'accorder aux perspectives éthiques de l'écologie. L'esthétique, domaine
traditionnellement perçu comme subjectif et relatif, serait adaptée aux impératifs d'objectivité et
d'universalité réclamés par l'éthique à travers l'intégration d'une structure conceptuelle fournie par
les sciences naturelles. Cette structure, censée faire l'objet d'un consensus entre les hommes,
permettrait d'harmoniser les diverses appréciations esthétiques de l'environnement et de les rendre
conformes aux exigences écologiques des environnements concernés. Mais cela implique aussi que,
par contraste avec ce premier modèle, les théories esthétiques qui ne se fondent pas sur la science se
trouvent automatiquement boutées hors du giron de l'éthique environnementale, condamnés à ne
donner corps à aucun concept opérant dans le cadre de notre relation à l'environnement.
Or, le modèle proposé par Allen Carlson ne va pas sans soulever un certain nombre de
critiques qu'il convient d'aborder si l'on souhaite esquisser des alternatives viables au cognitivisme.
Ces critiques se polarisent autour d'une ligne argumentative dite non-cognitive au sein de
l'esthétique environnementale. Il convient toutefois de préciser que l'esthétique environnementale ne
se divise pas en blocs homogènes et opposés, que seraient le courant cognitiviste d'un côté et le
courant non-cognitif de l'autre. Il existe, dans le spectre qui relie ces deux pôles, une pluralité de
théories intermédiaires qui synthétisent des éléments de réflexion variés. Les tenants d'une
esthétique cognitiviste ne s'accordent pas tous sur la place que doit tenir la connaissance
scientifique, et, inversement, les auteurs qui soutiennent une approche non-cognitive ne rejettent pas
en bloc le rôle du savoir dans le déroulement de l'expérience esthétique. Plusieurs postulats
soutenus par des auteurs dits non-cognitivistes, comme Arnold Berleant, Emily Brady ou encore
Yuriko Saito, s'opposent en revanche explicitement au modèle carlsonien de l'appréciation
esthétique. Ces oppositions sont de plusieurs ordres. La plus massive concerne l'exclusivité du
schème scientifique et la discrimination des expériences esthétiques selon ce schème. Ce qui semble
36
en effet irréaliste et réducteur, c'est moins la reconnaissance de la connaissance scientifique comme
guide de l'expérience esthétique, que l'exclusion des autres paramètres extra-esthétiques dans le
déroulement de cette dernière (imagination, mythes, habitudes, souvenirs, etc). Dans les faits, il est
manifeste que nous convoquons toutes sortes de pensées lorsque nous faisons l'expérience
esthétique de notre environnement et que ces dernières ne répondent pas toutes aux critères de
scientificité réclamés par Allen Carlson. Les remarques les plus récurrentes adressées à ce dernier
consistent donc à pointer son réductionnisme : l'expérience esthétique telle qu'elle est réellement
vécue procède d'influences multiples et ne saurait être qualifiée d'illégitime lorsqu'elle n'intègre pas
de données scientifiques.
Cependant, on se souvient que l'argument des cognitivistes ne consiste pas à nier l'existence
factuelle d'expériences esthétiques non-informées mais à les placer dans la perspective d'une norme
éthique : il n'est ni correct ni juste d'appréhender un faon à travers l'image de Bambi, ou un marais à
travers les canons de la peinture romantique. Ces appréhensions sont inappropriées dans la mesure
où elles ne considèrent pas l'objet pour ce qu'il est en lui-même. Comme le dit Holmes Rolston79,
nous devons baser l'éthique environnementale sur la valeur intrinsèque du non-humain, c'est-à-dire
sur l'environnement compris comme ce qui existe vraiment (what is actually there) et
indépendamment de nous (independently from human encounter). Rappelons ici que l'enjeu éthique
posé par Allen Carlson se construit de la façon suivante : ou bien nous parvenons à faire de
l'esthétique une discipline objective, auquel cas elle peut légitimement appuyer une éthique de
l'environnement ; ou bien l'esthétique demeure le propre du subjectif et du relatif, et dans ce cas elle
perd toute opérativité dans le champ éthique et politique de l'écologie. Ce dilemme s'appuie sur
deux postulats que nous souhaiterions ici discuter : (1) que l'éthique environnementale doit se
fonder sur des postulats strictement rationnels et universalisables pour être légitime, (2) que
l'objectivité éthique est idéalement accomplie et atteinte grâce aux sciences naturelles. Ces postulats
devront être appréhendés de façon critique afin de voir s'il est possible de penser une esthétique
personnelle et située qui puisse malgré tout informer et nourrir nos engagements éthiques.
Ceci nous amènera dans un premier temps à appréhender les alternatives proposées par les
tenants d'une esthétique non-cognitive, tels Arnold Berleant et Emily Brady. Il s'agit de penser
l'expérience esthétique indépendamment du schème scientifique sans pour autant abandonner la
perspective éthique de cette expérience. Faire l'expérience esthétique du monde qui nous entoure
permettrait selon certaines perspectives de créer une relation au non-humain favorable à
l'épanouissement d'une attitude éthique, sans nécessairement passer par le geste épistémique
carlsonien. Il s'agira donc d'appréhender la profondeur de cette relation, ainsi que le degré et la
79 Holmes Rolston III, « From Beauty to Duty », art.cit.
37
nature du renfort qu'elle apporte à l'éthique environnementale. Cette approche nous amènera en
outre à observer les déplacements conceptuels qu'elle engendre aussi bien dans le champ de
l'éthique que dans celui de l'esthétique, les deux étant solidaires de certains postulats sur lesquels il
conviendra de revenir. Cependant, les alternatives non-cognitives ne consistent pas non plus à
rejeter en bloc le rôle du savoir dans l'expérience esthétique, mais bien plutôt à interroger sa place,
son fonctionnement mais aussi son partage. Que révèle l'objectivisme convoqué par Allen Carlson ?
De quelle objectivité se réclame-t-il ? Qui possède la connaissance scientifique et qui en est
dépourvu ? Qui est légitime pour apprécier esthétiquement le non-humain et qui ne l'est pas ?
Comment cette connaissance est-elle produite ? Il s'agira de montrer que le paradigme de la
connaissance scientifique, ainsi que le type d'objectivité qui lui est attaché, sont loin de constituer
des prétentions neutres, et insèrent un biais contestable dans l'établissement d'une association entre
éthique et esthétique environnementale. Le cognitivisme esthétique pose en outre un problème
épistémologique ; Allen Carlson ne précise jamais réellement ce qu'il place derrière la notion de
'connaissance scientifique', affirmant à plusieurs reprises que le contenu cognitif de l'appréciation
esthétique se distribue dans un spectre allant du sens commun (common knowledge) à l'érudition
scientifique. L'émotion esthétique n'est-elle valide que lorsqu'elle s’appuie sur une connaissance
strictement scientifique ? Que révèle la volonté de se départir des composantes subjectives de cette
émotion ? Il s'agira de voir ce que trahit cette pulsion d'affranchissement du local et du particulier, si
elle est nécessaire ou s'il est possible de penser d'autres façons de répondre aux enjeux éthique de
l'écologie.
a) Changer de postulats : la critique écoféministe.
L'opposition insistante au sein de l'éthique environnementale entre l'émotion, prétendument
subjective et inconséquente, et la raison, faculté salvatrice d'analyse et d'abstraction, a fait l'objet
depuis une trentaine d'années d'une critique incisive et riche de la part des théoriciennes de
écoféminisme. L'écoféminisme, vocable né en 1974 sous la plume de la féministe française
Françoise d'Eaubonne, peut désigner deux réalités distinctes : il s'agit à la fois d'un ensemble de
pratiques militantes – environnementalistes, antimilitaristes, anti-nucléaires – assumées par des
groupes de femmes en résistance aux oppressions patriarcales qui affectent à la fois les femmes et la
nature ; et d'un champ théorique qui s'attache à questionner les fondations conceptuelles de
l'environnementalisme contemporain. Il existe donc un écoféminisme activiste et un écoféminisme
académique, les deux constituant des champs d'opérativité distincts bien que complémentaires.
38
Dans le cadre de notre enquête, nous nous concentrerons sur le versant théorique de l'écoféminisme,
qui constitue à lui seul un courant de réflexion hétérogène et pluriel dont nous ne pourrons résumer
ici la diversité de façon exhaustive. Nous tâcherons néanmoins d'analyser les lignes argumentatives
développées par certaines écoféministes qui permettent d'enrichir et de complexifier la critique de
cognitivisme esthétique qui nous occupe.
Tout d'abord, il convient de rappeler les fondations conceptuelles de l'écoféminisme, sur
lesquelles s'accordent une majorité de courants par ailleurs divergents. A la base de la réflexion
écoféministe se trouve la dénonciation d'une double logique de domination : celle des hommes sur
les femmes d'une part, et celle des hommes sur le monde naturel d'autre part. Le développement
d'une société patriarcale apparaît comme coextensif à l'instrumentalisation et à la réification de la
nature. De la même façon que l'homme objectifie et domine la femme, il s'arroge la maîtrise de la
nature. Plus récemment, la critique écoféministe s'est élargie en établissant que la domination de
l'homme ne s'exerce pas seulement sur la figure de la femme et de la nature, mais qu'elle est aussi
une domination du blanc sur le colonisé, du riche sur le pauvre. A ce titre, l'écoféminisme constitue
un courant de réflexion riche et habilité à mettre en lumière les mécanismes de domination aussi
bien symboliques qu'économiques, à un niveau inter-personnel aussi bien que systémique. Partant
de cette structure de domination réticulaire et des phénomènes de renforcement interne qui la
caractérisent, l'écoféminisme s'attache aussi bien à expliciter et à mettre au jour cette structure, qu'à
lui trouver des alternatives. Ces deux moments de l'analyse écoféministe nous intéressent, puisqu'il
s'agit non seulement de voir si le cognitivisme esthétique tombe sous la coupe des critiques
écoféministes mais aussi de voir en quoi l'écoféminisme fraie de nouvelles pistes de réflexion
susceptibles d'informer le rôle de l'esthétique dans la refonte de nos rapports à la nature.
En guise de rappel, on se souvient qu'une dichotomie franche entre l'émotion et la raison
semble à l’œuvre chez les cognitivistes, mais n'est jamais en tant que telle questionnée. C'est
précisément ce genre d'opposition dualiste que l'écoféminisme s'attache à déconstruire. Il s'agit de
montrer que ce que nous tendons à opposer de façon apparemment spontanée et naturelle, procède
en réalité de structures conceptuelles oppressives fondées sur des bifurcations historiques définies.
Il apparaît que le statut privilégié de la raison, c'est-à-dire de la capacité à raisonner de façon
objective en s'abstrayant des conditions particulières au sein desquelles nous évoluons, s'est
constitué par opposition à une série de qualités-repoussoir : le naturel, le féminin, l'animal, le
corporel, l'émotionnel etc. La raison est donc le pôle depuis lequel peut être discriminé et
subordonné tout ce qui ne s'assimile pas à l'homme blanc autonome et raisonnable. La femme,
l'homme de couleur, l'entité non-humaine, se définissent dès lors par une série de défauts : manque
39
d'autonomie, manque de rationalité et d'objectivité... Ils sont ce que l'homme occidental n'est pas80.
La puissance de ce réseau de dualisme réside dans sa capacité à échapper à la pensée tout en la
structurant : il est invisible parce qu'il est omniprésent. Dès lors, on comprend bien le caractère
problématique d'un recours à la raison, à la science, à l'objectivité et à l'universalité, au cœur même
d'une réflexion sur l'éthique environnementale. L'écoféministe Marti Kheel souligne à juste titre
cette faiblesse des approches contemporaines de l'éthique environnementale qu'elle nomme
ironiquement « savior theories81 ». Le défaut de ces théories, c'est précisément qu'elles ne sortent
pas des logiques de domination qui hiérarchisent et subordonnent l'émotionnel aux « muscles » de
la raison. Leurs débats restent enclavés dans un topos conquérant et héroïque peu en phase avec ce
que nécessiterait un nouveau rapport au monde naturel. Il s'agit de sauver « la » nature, assimilée à
une demoiselle en détresse (damsel in distress) à l'aide d'une théorie morale équipée du glaive de la
raison. Mais elle pointe très justement le paradoxe suivant :
Cette même raison qui avait été utilisée pour ôter toute valeur à la nature (à travers
l'objectivation et l'imposition d'une hiérarchie) est désormais convoquée pour lui donner à
nouveau une valeur. Une bonne éthique, selon cette conception, doit transcender le domaine de
la contingence et de la particularité, se fondant non pas sur des instincts douteux, mais plutôt sur
des principes et des règles abstraites rationnellement développés. Elle doit tenir par elle-même,
comme une construction autonome, distincte de nos inclinaisons personnelles et de nos désirs,
qu'elle est destinée à contrôler. L'éthique est prévue pour opérer comme une machine. Les
sentiments sont au mieux considérés comme sans intérêt, au pire comme de dangereuses
intrusions qui entravent la « machinerie éthique »82.
Si Allen Carlson ou Holmes Rolston valorisent malgré tout l'émotion esthétique, c'est à la condition
qu'elle se moule dans les canaux de la connaissance scientifique et se déprenne de son caractère
situé et personnel. L'émotion esthétique est tantôt considérée comme un outil au service de
l'éthique, tantôt comme un donné incompressible avec lequel il faut de toute façon composer. Mais
son rôle demeure limité par les postulats ratio-centrés d'une telle éthique : là où Holmes Rolston,
reconnaissant le caractère plaisant et vivifiant de l'esthétique, avance qu'elle pourrait engendrer un
80 Pour le dire dans les mots de Val Plumwood : « Nature includes everything that reason excludes. » in Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London, 1993, p.20.
81 Marti Kheel, « From Heroic to Holistic Ethics : The Ecofeminist Challenge » in Greta Gaard, Ecofeminism : Women, Animals, Nature, Temple University Press, Philadelphia, 1993.
82 « The same reason that was used to take value out of nature (through objectification and the imposition of hierarchy) is now asked to give it value once again. A sound ethic, according to this view, must transcend the realm of contingency and particularity, grounding itself not in our untrustworthy instincts, but rather in rationnaly derived principles and abstract rules. It must stand on its own as an autonomous construct, distinct from our personal inclinations and desires, which is designed to control. Ethics is intended to operate much like a machine. Feelings are considered, at best, as irrelevant, and at worst, as hazardous intrusions that clog the « ethical machinery ». Marti Kheel, op.cit.
40
« joyful caring83 » et rendre le devoir moral moins austère, Allen Carlson aboutit à un repli similaire
sur la rationalité scientifique et l'objectivisme éthique. Mais ce repli est insatisfaisant précisément
parce qu'il mobilise un modèle de pensée et d'action qui porte en lui le germe de la domination,
comme le souligne Marti Kheel. Partant de là, on comprend mieux qu'il est problématique de rejeter
la domination de l'homme sur la nature d'un côté, et de reconduire la domination du rationnel sur
l'émotionnel de l'autre, de l'expert sur le profane, de l'universitaire sur la « petite dame en
baskets84». Dans le cadre de cette domination, la reconnaissance de la valeur du non-humain devrait
demeurer purement cognitive et indépendante des inclinaisons émotionnelles promptes à fourvoyer
notre jugement. Nous devrions respecter les entités non-humaines de façon désintéressée et selon
des principes rationnels et universels. Cette position, ainsi que le recours récurrent à l'image de
l'agent moral rationnel-autonome85 est problématique dans la mesure où, comme le souligne Val
Plumwood, « La raison et l'émotion, comprises de cette façon, forment un dualisme imbriqué dans
un ensemble qui protège et renforce le dualisme humain/nature.86 » Il est en effet important de
relever que les dualismes qui sont à la racine de la pensée occidentale ne sont pas indépendants les
uns des autres, mais s'entre-répondent et se consolident mutuellement. Ainsi, la dépréciation de la
femme par rapport à l'homme fait écho à celle de la nature par rapport à l'humain, et de l'émotion
par rapport à la raison. Fonder l'esthétique sur un paradigme scientiste et objectiviste sans prendre le
temps de questionner ce qui nous amène à penser ce type d'objectivité comme supérieur est donc
insatisfaisant. Dans son essai précédemment cité, Marti Kheel dresse un parallèle entre les « savior
theories » et la médecine allopathique87. Cette dernière peut certes guérir le mal qui entame un
organisme, mais elle échoue à percevoir et à enrayer les causes globales qui ont mené à la maladie.
Si l'on veut soigner d'avantage que les symptômes de la crise environnementale, il convient donc de
passer au crible de la critique les oppositions binaires qui sous-tendent et justifient
l'instrumentalisation de la nature. Pourquoi une réponse émotionnelle et personnelle serait-elle
moins légitime qu'une réponse cognitive et objective ? En disqualifiant l'amour, l'empathie, la
sollicitude comme attitudes morales, ne reproduisons-nous pas les antinomies nocives que cultive
une partie de la tradition occidentale ?
83 « Logically, one ought not to destroy beauty; psychologically, one does not wish to destroy beauty. Such behavior is neither grudging nor reluctant, never constrained by disliked duties to an other; rather, this is joyful caring, pleasant duty, reliable and effective because of the positive incentive. » Holmes Rolston III, « From Beauty to Duty », art.cit.
84 Nous faisons ici référence à l'anecdote que rapporte Marti Kheel dans son essai: « In a nationwide march on Washington for animal rights held on June 10, 1990, one (male) speaker boasted that 'we are no longer a movement of little old ladies in tennis shoes, ours is a movement with intellectual muscle.' » Marti Kheel, op.cit.
85 La notion d'agent rationnel-autonome est particulièrement présente, par exemple, dans la pensée biocentriste de Paul Taylor.
86 « Reason and emotion so understood form a dualism, part of the interwoven set which protects and strengthens human/nature dualism. » in Val Plumwood, op.cit, p.168.
87 « Just as Western allopathic medicine is designes to treat illness, rather than maintain health, Western ethical theory is designed to remedy crisis, not maintain peace. » Marti Kheel, op.cit.
41
Il apparaît, à la lumière de cette première introduction de la critique écoféministe, qu'il est
problématique de poser comme un donné l'opposition de l'affectif et du rationnel, du subjectif et de
l'objectif. En outre, un second problème émerge avec l'usage que font les cognitivistes de cette
opposition. Attendu que, selon ces derniers, l'expérience esthétique est a priori trop personnelle et
partiale, il convient alors de l’enchâsser dans un cadre neutre et impartial : la science. On s'étonne
ici de ce que le recours à la science se fasse sans véritable recul critique de la part des cognitivistes :
est-il certain que les sciences naturelles soient exemptes de biais culturels ? échappent-elles aux
logiques de domination que s'attachent à pointer les écoféministes ? Qu'est-ce que les cognitivistes
placent sous le label scientifique ? Ces questions nous placent d'emblée dans le champ de
l'épistémologie féministe, et des déplacement conceptuels qu'elle entraîne. Le questionnement porte
principalement sur l'usage problématique qui est fait du concept d'objectivité: pourquoi l'objectivité,
pensée comme affranchissement du particulier et du situé, doit-elle être considérée comme
supérieure dans le champ épistémologique et éthique ? De quelle objectivité parle-t-on, lors que l'on
oppose l'objectif au partiel et au singulier ? Pour y répondre, il convient de se référer à ce que
Holmes Rolston développe dans son essai « Does the aesthetic appreciation of landscape need to be
science based ? ». Le point de départ du cognitivisme, on s'en souvient, consiste à lier la valeur
esthétique (le beau) à la valeur intrinsèque, censée déboucher sur le devoir moral. Mais le principal
problème que rencontre une telle liaison, c'est précisément que nous ne trouvons pas toujours la
nature belle. Elle regorge en réalité de phénomènes que sommes spontanément portés à trouver
repoussants ou esthétiquement négatifs. La science apparaît alors comme ce qui permet de corriger
ces jugements, en inscrivant les dits phénomènes repoussants à l'échelle des flux et des équilibres
écosystémiques. L'exemple le plus célèbre à ce sujet dans le champ de l'esthétique
environnementale est celui de la carcasse de cerf grouillante de vers88. L'odeur, la prolifération de
larves blanchâtres et la vision des chairs pourrissantes nous poussent à formuler un jugement
esthétique négatif ; mais si nous parvenons à voir, à travers ces traits sensibles, les phénomènes
naturels qui œuvrent à une échelle plus large, alors nous cesserons d'être dégoûtés. De la même
façon, la vue d'une gazelle se faisant dévorer sera considérée comme belle si nous parvenons à voir
dans ce festin l'expression de lois naturelles immuables. En somme, le particulier doit être
transcendé afin d'être correctement apprécié, il doit être considéré comme l'instanciation sensible de
processus systémiques, et c'est à ce titre que la considération sera dite objective. Cette acceptation
de l'objectivité comme point de vue général est réitérée par Holmes Rolston à travers la référence au
god's-eye-view89. Ce qui semble laid depuis notre perspective limitée, humaine, est beau depuis la
88 « If hikers come upon the rotting carcass of an elk, full of maggots, they find it revolting. But this momentary ugliness is shot in an ongoing motion picture » in Holmes Rolston III, Environmental Ethics, Temple University Press, Philadelphia, 1988, p.239.
89 Allen Carlson décèle dans cette expression une réponse théologique analogue à celle qui suit la question du mal :
42
vue englobante que Dieu a du monde. Le god's-eye-view incarne alors un idéal régulateur qui nous
guide vers une perspective totale permettant d'embrasser la beauté absolue du monde naturel à
travers la considération des équilibres et des forces systémiques qui le constituent. Cette idée est
illustrée à travers un autre exemple que mobilise Holmes Rolston, celui du lien esthétique étroit qui
liait ses parents à leur région90. Comme il l'indique, ces derniers étaient attentifs à des détails et à
des nuances qualitatives qui auraient probablement échappé à un visiteur occasionnel. Mais cette
étroitesse est justement perçue à travers la bivalence sémantique du mot : l'étroitesse définit à la fois
l'intensité et la limite de la relation. La relation intime, affective et familière que ses parents
entretenaient avec leur terre était une relation partiale. Il précise ainsi que c'est en vertu de cette
partialité que ses parents auraient été amenés à juger que les terres du Dakota sont pauvres et
laides, par exemple91. Or, ce jugement est biaisé et ne procède pas de catégories objectives, mais
d'habitudes esthétiques subjectives. Les sciences naturelles constituent donc un outil de
dépassement de la partialité et de transcendance des points de vue particuliers, l'objectivité
apparaissant comme l’accomplissement de ce dépassement. Difficile ici de ne pas faire de parallèle
entre le god's eye view esthétique de Rolston et la critique que fait Donna Haraway du « gaze from
nowhere ». Dans son manifeste sur les Savoirs situés92, Donna Haraway souligne le dilemme dans
lequel sont prises une grande partie des féministes, les écoféministes y compris. En critiquant
l'objectivité scientifique masculine et conquérante du XXe siècle, et en lui opposant un savoir plus
intuitif et incarné dont les femmes seraient dépositaires, les féministes ont tout bonnement tendu à
s'exclure des prétention à l'objectivité et à s'interdire toute prise de pouvoir au sein des sciences. Or,
l'enjeu de l'épistémologie féministe n'est pas de renier tout appel à l'objectivité, mais de penser
autrement l'objectivité. Donna Haraway emploie, pour illustrer cet enjeu, la métaphore de la vision.
La vision a souvent été considérée comme le plus objectif et le plus spirituel des cinq sens, celui qui
permet une distance entre l'observateur et l'objet de son observation, et à ce titre elle a souvent été
rejetée par l'épistémologie féministe qui y voyait la rémanence d'un modèle d'objectivité abstrait et
détaché. Pourtant, Haraway souligne que la vision peut constituer une bonne allégorie pour la
constitution d'une nouvelle objectivité en ceci que la vision est toujours incarnée, située, partielle.
La vision comme métaphore de la connaissance pose une multiplicité de questions : avec quoi
« The reply to what appears to be evil from our view is in fact not evil from god's-eye view. » Il s'agit d'apprendre à voir la nature comme entièrement belle, même si certains de ses détails apparaissent laids depuis des perspectives restreintes. Allen Carlson, « 'We see beauty now where we could not see it before' : Rolston's aesthetics of Nature », in Christopher J.Preston et Wayne Ouderkirk (ed.), Nature, Value, Duty, Life on Earth with Holmes Rolston III, Springer, Dordrecht, 2007.
90 Holmes Rolston, « Does the aesthetic appreciation of landscape need to be science based ? », art.cit.91 « Science helps us to see the landscape as free as possible from our subjective human preferences. Science corrects
for truth. There are, for example, no 'badlands',as my parents might have reacted to the western Dakotas. » Ibid.92 Donna Haraway, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege
of Partial Perspective », Feminist Studies 14, N°3.
43
voyons-nous ? D'où voyons-nous ? Comment voyons-nous ? Avec qui voyons-nous ? En ce sens,
l'objectivité féministe consistera moins à renoncer à rendre compte du monde réel, qu'à se
positionner explicitement dans des foyers de visions localisés, situés, et pour cela même objectifs. Il
ne s'agit donc pas d'opposer une objectivité masculine à une subjectivité féminine, mais de penser
des « situated knowledges », alternative à l'objectivité pensée comme « gaze from nowhere ». La
vision de nulle part, transcendante et détachée du monde constitue donc la principale cible de la
critique féministe. C'est précisément lorsque l'on tend à s'abstraire de la situation particulière depuis
laquelle nous voyons le monde que l'on perd en objectivité. En ce sens, l'appel que fait Holmes
Rolston à un point de vue de Dieu depuis lequel toute la nature est belle paraît problématique. Il
s'agit toujours de s'affranchir de notre expérience particulière pour la subsumer sous la
compréhension de lois naturelles immuables et universelles ; en somme, Rolston semble soutenir
que l'objectivité se conquiert verticalement. A l'inverse, la critique épistémologique que fait Donna
Haraway nous invite à penser une objectivité qui naît de la situation des savoirs, et non de leur
abstraction. Il s'agit de passer du god's-eye-view au standpoint, au point de vue. Ce dernier n'est pas
un renoncement à comprendre la réalité des choses, mais constitue au contraire une réponse forte à
ce que Haraway désigne comme « les appels aux mondes réels » (appeal to real worlds). A ce titre,
l'épistémologie féministe qu'esquisse Haraway récuse le relativisme autant que l'objectivité
transcendante :
Le relativisme est une façon d'être nulle part en prétendant être partout également. « L'égalité »
du positionnement est un déni de la responsabilité et de l'enquête critique. Le relativisme est le
miroir parfait de la totalisation dans l'idéologie de l'objectivité ; les deux nient les risques de la
localisation, de l'incarnation et de la perspective partielle ; les deux rendent impossible de bien
voir.93
Il s'agit donc de constituer la connaissance des mondes réels depuis la reconnaissance critique de
notre situation et de la partialité de notre perspective. Cette partialité n'invite pas à affirmer
l'équivalence et l'interchangeabilité neutre de tous les points de vue, mais à tisser une toile de
visions hétérogènes et interconnectées qui implique la « solidarité politique » et « des discussions
partagées en épistémologie94 ». L'objectivité telle que la redéfinit l'épistémologie féministe semble
donc s'éloigner de l'idéal qu'en donne Holmes Rolston lors qu'il la décrit comme connaissance de ce
93 « Relativism is a way of being nowhere while claiming to be everywhere equally. The 'equality' of positionning is a denial of responsibility and critical inquiry. Relativism is the perfect mirror of totalization in the ideologies of objectivity ; both deny the stakes in location, embodiement, and partial perspective ; both make it impossible to see well. » Donna Haraway, art.cit.
94 « The alternative to relativism is partial, locatable, critical knowledges sustaining the possibility of webs of connections called solidarity in politics and shared conversations in epistemology » Donna Haraway, art.cit.
44
qu'est la chose « independantly from human encounter » d'une part, et comme affranchissement du
caractère local et partial de la situation du sujet à travers la vision totalisante d'un dieu d'autre part.
Tâchons d'illustrer ce mouvement en nous référant à un cas de rejet esthétique bien connu, et
auquel Holmes Rolston fait d'ailleurs référence lorsqu'il évoque l'attachement esthétique de ses
parents à leur terre : celui de la Grande Plaine. On se souvient que Rolston soulignait que
l'affection que ses parents avaient pour leur région les auraient probablement amenés à juger laide et
pauvre la plaine du Dakota, et que seules les sciences naturelles auraient pu corriger ce jugement.
De fait, les grandes plaines du centre des États-Unis sont régulièrement dépréciées pour leur
monotonie, leur absence d'arbres et de montagnes, en un mot, leur vide. La littérature a proposé des
descriptions riches et poignantes du malaise lié à la plaine95, l'oppression lié au vide, le harcèlement
du vent, l'éloignement de tout. Ce qui peut sembler frappant, c'est que ces jugements dépréciatifs ne
sont pas le fait d'immigrants récents ou de personnes extérieures à la Plaine, mais qu'ils sont parfois
partagés par les habitants eux-mêmes. Dans son article « But what is there to see ?96 », Shaunanne
Tangney évoque son désemparement face au dégoût que ses élèves, souvent natifs du Dakota,
formulent au sujet de la Plaine : ennuyeux, vide, monotone, sont des adjectifs récurrents lors des
discussions qu'elle engage avec eux. Il résulte de ce rejet esthétique, comme le conclut Neil
Evernden dans son essai sur la Plaine, que « n'importe quel usage de la Plaine serait acceptable,
parce que personne ne se soucie de voir la Plaine.97 » Et de fait, il a été d'usage de dire que la Plaine
devrait être rentabilisée, voire devenir le théâtre d'essais nucléaires, attendu que personne ne
« regarde » la Plaine. Mais la solution que propose Holmes Rolston est-elle adaptée à ce dégoût
paysager ? La connaissance scientifique peut-elle annuler la dépréciation esthétique dont souffre la
Plaine ? Rien n'est moins sûr. Pour comprendre, il convient d'analyser plus en détails la réaction
esthétique des habitants de la Plaine, car celle ci s'avère plus complexe qu'un simple rejet. Dans son
article « Women's Sense Of Place On The American High Plains98 », Cary DeWit analyse les
jugements que les habitants de la Grande Plaine formulent au sujet de leur environnement. A travers
une série d'entretiens durant lesquels elle interroge aussi bien des femmes que des hommes, des
immigrés que des natifs, elle aboutit à une conclusion nette : les femmes, qu'elles soient originaires
ou non de la région, manifestent un dégoût beaucoup plus vif et marqué pour le paysage de la Plaine
95 Le roman Giant in the Earth du norvégien Ole Edvart Rølvaag, narre l'histoire d'une famille de pionniers norvégiens qui s'installe dans la Plaine du Dakota et lutte, jusqu'à la mort, contre ce paysage hostile. Centennial, de James A. Michener, évoque l'histoire d'une femme rendue folle par le vent qui balaie la Plaine, et qui en vient à tuer son enfant. D'autres romans, comme Great Plains de Ian Frazier qu'évoque Shaunanne Tangney dans son article, proposent une approche plus nuancée du paysage, insistant sur sa majesté et son caractère mystique.
96 Shaunanne Tangney, art.cit.97 Neil Evernden, « Beauty and Nothingness: Prairie as Failed Resource », Landscape 27, N°3, 1983. 98 Cary DeWit, « Women's Sense Of Place On The American High Plains », Great Plains Quarterly, Vol. 21, No. 1,
Hiver 2001.
45
que les hommes. Là où ces derniers évoquent des notions comme la liberté, la promesse
d'aventures, la sérénité des grands espaces ou la richesse d'une terre à exploiter, les femmes insistent
quant à elles sur l'aspect oppressif des grandes distances, sur le vide, l'absence d'arbres et de pli du
relief, et sur le sentiment de vulnérabilité qui en découle. En somme, les mêmes traits esthétiques
génèrent des réactions tranchées qui semblent recouper les divisions de genre. Pour comprendre la
raison de cette rupture, Cary DeWit s'est penchée sur le mode de vie et les habitudes des
populations interrogées ; il ressort de son enquête que les communautés rurales de la Grande Plaine
sont particulièrement conservatrices quant à la division du travail, et que les femmes sont
majoritairement cantonnées aux travaux domestiques tandis que les hommes travaillent presque
exclusivement en extérieur. Cette division du travail se reflète dans les différents loisirs assignés à
chaque sexe, les hommes privilégient invariablement la chasse, la pêche et le golf, tandis que les
femmes s'orientent majoritairement vers des loisirs d'intérieur, et optent plutôt pour le bowling ou
les réunions amicales. Que peut-on conclure de cet exemple ? Tout d'abord, qu'il convient toujours
de contextualiser la réception esthétique qui est faite d'une entité naturelle pour en comprendre les
mécanismes et les ressorts. Deuxièmement, cela nous indique surtout que la façon dont nous
apprécions esthétiquement un paysage ne dépend pas seulement de nos connaissances à son sujet,
mais aussi de la façon dont nous vivons au sein de ce paysage, du contexte social et culturel dans
lequel nous nous plaçons, des champs d'action qu'il nous autorise. Pour les femmes interrogées,
l'immensité de la Plaine cause l'éparpillement et l'isolement des communautés, pour les hommes
elle incarne au contraire un espace excitant d'aventure et de conquête. Il n'est alors pas absurde de
postuler que si les femmes étaient d'avantage encouragées au travail de la terre, par exemple, leur
jugement esthétique au sujet de la Plaine évoluerait. A ce titre, dépasser le rejet esthétique passerait
moins par l'adoption d'un cadre conceptuel scientifique, que par le développement de nouvelles
formes d'expérimentation du paysage, le partage de nouvelles façons de le voir et de s'y projeter.
Comment voit-on la Plaine lorsque l'on en cultive le sol, lorsque l'on y chasse ? Comment les
indiens percevaient-ils l'immensité herbeuse dans laquelle ils traquaient les bisons ? Comment le
vent est-il ressenti selon que l'on est homme ou femme99 ? On retrouve ici la métaphore de la vision
située, incarnée, que mobilisait Donna Haraway. Pour résoudre le problème d'une Plaine dépréciée
esthétiquement, et corrélativement négligée sur le plan environnemental, il convient selon
Shaunanne Tangney d'éduquer l’œil et de pluraliser les points de vue. Son article foisonne
d'expressions qui insistent sur la vision. La dépréciation esthétique de la Plaine est ainsi pensée
comme un « échec de la vision », auquel doit répondre un travail : « nous devons apprendre à voir
99 Cary DeWit souligne que le vent, omniprésent dans l'expérience que les habitants font de la Plaine, est expérimenté de façon radicalement opposée par les hommes et par les femmes. Les hommes soulignent son caractère grisant, vivifiant et purificateur ; à l'inverse, les femmes en font un vecteur de stress, d'agacement, il désordonne les coiffures, rend impossible les promenades.
46
la Grande Plaine », « acquérir de nouvelles façon de voir ». Cette éducation passe moins par la
connaissance scientifique que par des stratégies de détour et de décentrement du regard, par la
création de nouveaux points de vue qui sont autant de points d'ancrage et d'attachement : il s'agit de
voir à travers les yeux du fermier, mais aussi à travers les vers du poète, ou à travers l'histoire des
indiens. En somme, la conjonction de points de vue hétérogènes a peut-être plus à apporter à
l'esthétique environnementale que leur homogénéisation sous l'égide d'une science au dessus de tout
scrupule.
Plusieurs éléments se distinguent de ce premier développement. Tout d'abord, nous avons vu
que la tendance à opposer l'émotionnel au rationnel au sein de certains courants de l'éthique
environnementale était problématique dans la mesure où cette opposition procède d'un réseau de
dualismes en partie responsable de la domination de la nature. Ce dualisme est particulièrement
présent au sein des approches déontologiques de l'éthique environnementale, a fortiori à travers la
figure de l'agent moral rationnel-autonome. Mais une telle critique, principalement formulée par les
écoféministes, n'implique pas un renversement des dualismes. Il ne s'agit pas de prôner le recours à
une subjectivité idéalisée par opposition à une objectivité froide et réifiante, pas plus que de
glorifier un savoir féminin supposé intuitif et incarné ; il s'agit bien au contraire de repenser les
conditions de l'objectivité à travers la référence au standpoint. Ce détour par l'épistémologie
féministe permet deux choses : tout d'abord, de contester l'usage peu critique que font les
cognitivistes des sciences naturelles, oblitérant les biais culturels et genrés qui l'affectent et tendant
à en donner une vision a-politique et anhistorique. Dans un second temps, le versant positif de la
critique féministe, et plus précisément la théorie de l'objectivité que propose Donna Haraway,
permet de penser la situation du sujet comme un atout à approfondir et à complexifier plus qu'un
défaut à dépasser dans la saisie esthétique de notre environnement. La perspective partielle
l'emporte sur les god's trick. Mais on se souvient également que le recours à la science se justifie
chez les cognitivistes par la nécessité de trouver un point fixe depuis lequel révéler la valeur
intrinsèque du non-humain, source de devoir moral. Dès lors, avancer que ce point fixe n'est ni
nécessaire ni souhaitable dans l'établissement d'une éthique de l'environnement impose d'étudier les
alternatives éthiques que propose l'écoféminisme, ainsi que la façon dont ces alternatives se
connectent avec l'expérience esthétique.
b) Quelle éthique écoféministe ?
Quelles alternatives les écoféministes proposent-elles à une éthique environnementale
47
encore largement polarisée par les schèmes déontologique et conséquentialiste, et comment
permettent-elles, corrélativement, de libérer l'esthétique environnementale du modèle cognitiviste ?
Comment une conception refondée de l'éthique peut-elle nous aider à repenser la place de
l'esthétique dans nos engagements éthiques ?
L'écoféminisme, nous l'avons dit, s'attache à dénoncer et à déconstruire les logiques de
domination qui oppressent non seulement la nature, mais également les femmes et plus largement
les populations vulnérables. Mais le recoupement de ces dominations a eu pour effet corrélatif de
laisser entendre que les femmes seraient de facto plus habilitées à résoudre les problématiques
environnementales et qu'elles bénéficieraient en quelque sorte d'un contact privilégié avec la nature.
A ce titre, l'écoféminisme a parfois été accusé de véhiculer un essentialisme nocif qui assignerait les
femmes aux rôles stéréotypées dans lesquelles elles étaient déjà enfermées par le patriarcat (soin,
maternage, réparation, nettoyage). Cependant, cette critique semble d'avantage viser un discrédit
global de l'écoféminisme, et méconnaître les tactiques conceptuelles en jeu dans la définition d'un
lien privilégié entre les femmes et la nature. L'écoféministe Ynestra King résume le problème ainsi :
Même si l’opposition nature/culture est un produit de la culture nous pouvons néanmoins
consciemment choisir de ne pas rompre les connections entre femme et nature en rejoignant la
culture masculine. Plutôt on peut utiliser cela comme une position privilégiée (a vantage point)
pour créer une culture et une politique différentes.100
Cela signifie que la mise en valeur d'attitudes non masculino-centrées peut procéder d'un
positionnement stratégique de décentrement et de subversion des normes morales actuelles.
L'écoféminisme consiste alors moins à dire que seules les femmes sont capables de certains
comportements moraux, que de souligner l'importance éthique et la consistance politique d'attitudes
pour l'heure assumées par les femmes.
Comment penser l'éthique environnementale depuis une perspective écoféministe ? On peut
répondre à cette question en deux moments, l'un évoquant le changement formel et méthodologique
auquel invite une éthique l'écoféminisme, l'autre traitant des attitudes et des pratiques concrètes
qu'encourage l'écoféminisme. D'un point de vue méthodologique il s'agit de passer, comme nous y
invite Marti Kheel, d'une éthique héroïque à une éthique holistique, c'est-à-dire de quitter le
paradigme d'une loi morale universelle, d'une image unique, pour accueillir la diversité et la
particularité des situations dans lesquelles les agents moraux agissent effectivement. Une métaphore
fréquemment employée pour définir les principes d'une éthique écoféministe est celle de la
100 Ynestra King, citée par Chiara Bonfiglioli, « L'éco-féminisme, entre matérialisme et utopie », Congrès Marx International V - Section Études Féministes Atelier 5 : Mouvements féministes et mondialisatio, oct. 2007.
48
tapisserie ou du patchwork. Selon cette image, les enjeux éthiques sont constitués de voix mêlées,
de récits et d'expériences situées qui s'entrelacent et tissent collectivement la réponse aux enjeux
pratiques de l'écologie.
L'éthique écoféministe est une étoffe en train de se faire (quilt-in-process), constituée de pièces
fournies par des personnes situées dans différents contextes socio-économiques, culturels,
historiques. Comme ces pièces reflètent les histoires de différents tisseurs, il est impossible de
trouver deux pièces qui soient rigoureusement identiques.
Ce patchwork inclura des pièces qui rendront visibles et questionneront les formes locales et
globales du dommage environnemental, les effets disproportionnés de la pollution sur les
femmes, les enfants, les pauvres, les indigènes déracinés, et les populations de ces pays dits
moins développés ; des pièces qui fourniront des alternatives actuelles à l'exploitation
environnementale (...)101
Les pistes éthiques tracées par l'écoféminisme invitent à rebrousser le chemin de l'abstraction et de
la généralisation. Il ne s'agit pas de fonder une éthique en dépit du particulier, mais par et avec le
particulier. Il ne s'agit pas de produire une homogénéité morale par le truchement de référents
universels, par ailleurs souvent biaisés, mais de connecter des réalités hétérogènes. L'éthique
écoféministe consiste donc, comme l'illustre la métaphore de la tapisserie, à tisser ensemble la
multiplicité des voix plutôt que de les réduire à une norme unique. En cela, elle s'oppose
explicitement aux morales d'inspiration kantienne. Il est d'ailleurs notable de relever les usages
opposés de la notion de voix que font Kant d'une part, et les féministes d'autre part. Pour Kant, la loi
morale est une voix d'airain, absolue et inflexible ; nous devons lui obéir quelles que soient nos
inclinaisons ou le contexte dans lequel nous évoluons. La voix d'airain est interne à l'instance
rationnelle du sujet, elle le rend autonome. A l'inverse, la notion de voix dans le cadre des enjeux
éthiques du féminisme est explicitement pensée dans un régime éthique hétéronome. L'attitude
éthique peut alors être pensée comme réponse à des voix extérieures, comme prise en considération
d'appels, et comme capacité à répondre à ces appels. Nous passons d'une voix unique et verticale,
pure comme l'airain, à un enchevêtrement de voix multiples qui se connectent dans le commun de la
vie et les dilemmes pratiques d'une existence partagée. En expulsant du champ de la morale la
101 « Ecofeminist ethics is a quilt-in-process, constructed from « patches » contributed by persons located in different socio-economic, cultural, historical circumstances. Since these patches will reflect this histories of the various quilters, no two patches will be just the same. (…) These will include patches that make visible and challenge local and global forms of environmental abuse, the disproportionnal effects of environmental pollution on women, children, the poor, dislocated indigenous persons, and people in so-called less developed countries ; patches that provide present-day alternatives to environmental exploitation (…) », Karen Warren and Jim Cheney, « Ecological Feminism and Ecosystem Ecology », Hypatia, vol.6, n°1, printemps 1991.
49
particularité des situations et la singularité des agents et des patients moraux, les morales
généralistes risquent de manquer ce qui constitue le cœur et la texture de l'engagement moral. Seyla
Benhabib pointe ce défaut dans son article « The generalised and the concrete other102 ». Elle y
démontre que les mécanismes de valorisation de l'agent moral rationnel-autonome procèdent d'une
culture masculino-centrée qui définit l'idéal moral par contraste avec une nature féminine inférieure,
et qu'en outre la tendance à abstraire l'agent moral de son histoire et des situations singulières dans
lesquelles il agit condamne la théorie morale à la stérilité et aux paradoxes.
La critique que font les écoféministes des morales ratio/masculino-centrées nous semble
ici coïncider avec les travaux d'un autre champ académique, celui de l'éthique du care.
L'écoféminisme et le care sont deux courants théoriques autonomes, s'appuyant chacun sur des
corpus distincts. Pour autant, il existe des zones de recouvrement partiel de leurs ambitions
théoriques et de leurs motivations politiques, et il n'est pas arbitraire de souligner les points
communs qui les rapprochent. En effet, les deux s'attachent à déconstruire les postulats dualistes à
l’œuvre dans les approches déontologiques et conséquentialistes de l'acte moral, et à leur opposer
des alternatives. De leur côté, les écoféministes comme Karen Warren et Val Plumwood font
explicitement référence au care dans leurs tentatives d'esquisser une éthique écoféministe. Val
Plumwood écrit ainsi :
Sous des conditions appropriées, l'expérience du soin (care) et de la responsabilité pour des
animaux, des arbres, des lieux et des écosystèmes particuliers qui sont bien connus, que nous
aimons et connectons de façon appropriée au moi, renforce plutôt que diminue un souci plus
général pour l'environnement global.103
Le mouvement que l'éthique du care nous invite à opérer est un mouvement de recontextualisation,
de complexification des « truncated narratives » que Marti Kheel déplore. En effet, l'acte moral est
toujours individué et façonné par un tissu narratif, un contexte social et culturel singulier, et ne peut
être pleinement appréhendé hors de ces composantes104. Le dilemme de Heinz105 mobilisé par
Lawrence Kohlberg souffre de cet excès d'abstraction : les histoires personnelles des protagonistes y
102 Seyla Benhabib, « The Generalized and the Concrete Other: The Kohlberg-Gilligan Controvers and Feminist » Theory, Praxis international, n°4, 1985.
103 « Under appropriate conditions, experience of care and responsibility for particular animals, trees, rivers, places and ecosystems which are known well, are loved and are appropriately connected to the self, enhance rather than hinder a wider, more generalised concern for the global environment. » Val Plumwood, op.cit., p.187.
104 Seyla Benhabib vise également, à travers cette critique, la théorie rawlsienne du voile d'ignorance, selon laquelle certains choix doivent être effectués abstraction faite de tout ce qui constitue notre individualité.
105 Le dilemme de Heinz fait partie des dilemmes dont s'est servit le psychologue américain Lawrence Kohlberg pour développer sa théorie du développement moral. Il se structure comme suit : «La femme de Heinz est gravement malade. Elle peut mourir d’un instant à l’autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu’à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz ? Laisser mourir sa femme ou voler le médicament ? »
50
sont totalement oblitérées, et le cadre social du problème est absent du dilemme. Pourtant, tout
enjeu moral prend sa consistance à la croisée de ces données, il semble donc peu pertinent de le
réduire à l'observance d'un devoir abstrait. Ainsi :
Carol Gilligan remarque que l'épistémologie morale implicite des dilemmes de Kohlberg
frustrent les femmes qui veulent formuler ces dilemmes hypothétiques dans un langage plus
contextuel et attentif au point de vue concret de chaque protagoniste106.
Cela signifie que non seulement l'idéal de l'agent moral rationnel-autonome est politiquement
oppressif, mais qu'en outre il existe des alternatives, souvent étouffées, à cet idéal.
L'accomplissement moral proposé par Kohlberg recoupe la distinction que Kant fait entre minorité
et majorité : les femmes sont moralement défaillantes car elles raisonnent et agissent dans un réseau
de liens et d'affects dont elles ne parviennent pas à s'abstraire, à l'inverse, l'homme majeur est celui
qui parvient à exercer son jugement rationnel de façon autonome. L'écoféminisme et l'éthique du
care invitent précisément à valoriser cette minorité et à faire entendre les voix, réprimées par
l'impératif d'universalité objective des morales rationalistes, qui s'efforcent de prendre en compte la
singularité des point de vue et des situations. Ces voix disqualifient la prépotence du devoir moral
abstrait en exhibant le caractère central des particularités narratives et contextuelles. Comme le
résume Sandra Laugier :
Il n'y a pas de concepts moraux univoques qu'il ne resterait qu'à appliquer à la réalité, mais nos
concepts moraux dépendent, dans leur application même, de la narration ou de la description
que nous donnons de nos existences, de ce qui est important (matter) pour nous107.
Cette approche doit permettre de nous affranchir des concepts excessivement généraux (l'homme, la
nature) qui brouillent l'intelligibilité des situations concrètes et singulières. Ça n'est pas « l'homme »
qui prend en charge la pollution d'une rivière, la désertification d'une région, la sauvegarde d'une
espèce, mais bien un ensemble d'individus particuliers, attachés à un contexte social, culturel et
environnemental spécifique. De la même façon, ça n'est pas « la nature » qui doit être sauvée, mais
une multiplicité d'entités et de bulles écologiques enchevêtrées dans le tissu de l'activité
anthropique. Cette approche particulariste et contextuelle tend à déplacer l'accent mis par les
penseurs de l'éthique et de l'esthétique environnementale sur la wilderness et à revaloriser les enjeux
106 « Gilligan also note that the implicit moral epistemology of Kohlbergian dilemmas frustrates women who want to phrase these hypothetical dilemmas in a more contextual voice, attuned to the standtpoint of the concrete other. » in Seyla Benhabib, art.cit.
107 Sandria Laugier et Patricia Paperman (ed.), Le souci des autres, éthique et politique du care, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 2011, p.27.
51
environnementaux du quotidien. Elle permet également d'offrir une place différente à l'émotion
esthétique, en ceci que l'émotion n'est plus pensée comme un « blocage » dans la machinerie
éthique – pour reprendre le mot de Marti Kheel – mais comme un élément à part entière de ce qui
nous lie et nous attache au monde.
Le rôle des affects dans l'établissement d'une éthique écoféministe est donc double : il est
tout d'abord critique, en ceci qu'il destitue le monopole de la raison qui prévaut dans les savior
theories, mais il est également positif en ceci qu'il pose les linéaments d'une nouvelle éthique qui
intègre pleinement la texture affective des attitudes morales. Il est désormais possible de revenir à la
réflexion laissée en suspens par Holmes Rolston dans son article « From Beauty to Duty », au sujet
de la distinction entre une éthique du devoir et une éthique du care. On se souvient que pour les
cognitivistes, l'éthique est conçue comme la réponse à une valeur : là où il y a valeur intrinsèque, il
y a devoir de respect. Mais dans l'article où il tente de connecter la beauté au devoir, Holmes
Rolston semble laisser une telle définition de l'éthique en suspens, il écrit ainsi : « Peut-être que
l'éthique n'est pas toujours liée au devoir, mais est logiquement et psychologiquement plus proche
du souci et du soin (caring)108 », il maintient cette question ouverte dans la conclusion de son article
« Cette esthétique étendue inclut des devoirs, si vous souhaitez le formuler de cette façon ; ou bien
cette esthétique agrandie se transforme en souci (caring), si telle est votre préférence
linguistique.109» Mais la différence entre une éthique du devoir et une éthique du souci (care), n'est-
elle que rhétorique ? Nous avons vu que la notion de soin était fréquemment valorisée par les
théories éthiques écoféministes, lesquelles s'opposent explicitement au topos déontologique ; il
semble donc que la divergence des deux approches soit plus profonde. Cette différence peut être
illustrée par les deux acceptations qu’Émilie Hache distingue du concept de responsabilité morale.
D'un côté, la responsabilité morale peut être pensée comme « répondre de » certaines obligations
morales, de l'autre il est possible de penser la responsabilité éthique comme un « répondre à » un
patient moral110. La première se pense comme obédience à une instance interne, tandis que la
seconde met en lumière la relation entre le sujet et ce qui le sollicite dans le monde et à quoi il est
poussé à répondre. Cette « réponse à » implique deux choses : tout d'abord, elle inclut un versant
perceptif, c'est-à-dire que la réponse-à ne peut exister sans une réceptivité-à. Enfin, la réponse-à
implique une activité, un engagement du sujet dans la constitution de solutions pratiques. On notera
que ce double sens fait écho à la polysémie propre au vocable anglais du care : il implique d'une
part l'attitude de souci et de sollicitude par laquelle nous tendons à être attentif à quelque chose ou à
108 « Perhaps ethics is not always tied to duty either, but is logically and psychologically closer to caring. » Holmes Rolston III, From Beauty to Duty, art.cit.
109 « This expanded aesthetics includes duties, if you wish to phrase it that way; or this enlarging aesthetics transforms into caring, if that is your linguistic preference. » Ibid.
110 Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons, Éditions La Découverte, Paris, 2011, p.25.
52
quelqu'un, et d'autre part l'idée du soin, soit les actions que nous effectuons pour réparer, protéger et
maintenir l'intégrité des entités vulnérables. Le double sens du répondre-à fait donc écho aux deux
versants du care : Un versant constitué par la réceptivité et la sensibilité à l'égard du vulnérable (to
care about, se soucier de), et un second versant constitué par les actions que nous menons pour
traiter cette vulnérabilité (to take care of, prendre soin de). L'éthique du care ne cherche pas à
établir une réponse formelle et générale aux enjeux de la vie pratique, elle consiste bien plutôt en
une analyse contextuelle des relations et des équilibres en jeu, à partir de laquelle il est possible de
comprendre et de renforcer les attitudes de care que sont la sollicitude et le soin. En somme, il ne
s'agit pas de s'en tenir à la légalité formelle d'un respect de la nature, mais de faire apparaître les
liens singuliers qui nous attachent à cette dernière pour comprendre la façon dont ils peuvent être
renforcés et stimulés. La connexion entre éthique du care et écoféminisme appelle cependant la
vigilance ; elle n'implique pas qu'une éthique écoféministe se réduise à une éthique du soin,
déléguant aux femmes les tâches de réparation, de nettoyage et de maintenance auxquelles elles
sont déjà assignées, mais elle invite plutôt à questionner le monopole des schèmes déontologiques
et conséquentialistes dans le champ de l'éthique environnementale et à contester la division inique
du travail moral qu'elles sous-tendent. L'écoféministe Karen Warren appelle précisément à la
promotion d'une éthique de l'environnement qui soit care-sensitive, c'est-à-dire qui se fonde moins
sur l'observance de devoirs et sur la légalité formelle de l'acte moral, que sur la sensibilité à l'autre,
la capacité à lui répondre et à prendre en charge sa vulnérabilité.
La revendication écoféministe ne consiste pas à dire que les femmes ont un privilège pour le
soin (care), alors que les hommes sont intrinsèquement agressifs et destructeurs. L'argument de
Warren est plutôt que le patriarcat procède d'une logique de domination oppressive et que la
société pourrait fonctionner sur la base d'une logique favorable à la vie, plutôt que sur une
logique destructrice. Les hommes aussi bien que les femmes peuvent penser selon cette
logique.111
En soi, l'écoféminisme spiritualiste ne se destine pas à assujettir les femmes à leur rôle de
soignantes (caretaker), mais il a plutôt le potentiel d'étendre ce rôle pour y inclure les hommes,
de la sorte, elle ne réduit pas les femmes au naturel, mais il s'agit plutôt d'un cadre conceptuel
dans lequel l'être humain abandonne son désir de séparation d'avec le monde naturel dans la
fausse économie de l'immortalité de la raison universelle.112
Nous reviendrons plus en détail sur les modalités d'association entre le care et l'écoféminisme, mais
111 Trish Glazebrook, « Karen Warren's Ecofeminism », Ethics & the Environment, N°7, vol.2, 2002.112 Ibid.
53
il est d'ores et déjà utile de relever que cette alternative nous permet de penser autrement le rôle de
l'esthétique dans le renforcement de l'éthique en ceci qu'elle considère moins l'émotion comme un
obstacle que comme un adjuvant de l'acte moral. Là où les cognitivistes, s'appuyant explicitement
sur une structure éthique déontologique, pensent l'émotion esthétique comme un phénomène trop
subjectif et situé pour déboucher sur des décisions morales justes, et appellent donc à transcender
cette émotion par la science ; l'écoféminisme nous invite à penser un réseau d'affects à la fois
singuliers, situés, et connectés, entrelacés.
La critique écoféministe, lorsque nous la tenons en tension avec la nécessité d'une éthique de
l'environnement réformée d'une part, et l'intégration de nos émotions esthétiques à cette éthique
d'autre part, engendre des déplacements conceptuels féconds. Elle invite à réhabiliter des pratiques
traditionnellement rejetées à l'angle mort des théories éthiques, enfermées dans l'invisibilité du
domestique et du privé par une division du travail moral inique et oppressive. A la lumière de ces
éléments, il apparaît que le terme d'inclusivité peut définir de façon privilégiée les déplacements
opérés. Une éthique écoféministe est inclusive à plusieurs titres : Tout d'abord, elle rejette la
structure dualiste qui hiérarchise et subordonne a priori les différents pans de l'expérience humaine
ainsi que les différentes classes d'êtres qui constituent la société. Ce rejet du dualisme doit être
pensé comme une déconstruction des logiques de domination que certaines écoféministes voient à
l’œuvre dans les versions traditionnelles de l'éthique environnementale. A cette déconstruction
répond une éthique qui peut être qualifiée de holistique, pour reprendre le mot de Marti Kheel, c'est-
à-dire une éthique qui prend en compte la variété et la pluralité de ce qui constitue la vie morale. Il
s'agit de rejeter les histoires tronquées, les truncated narratives113, dont s'alimentent les morales
rationalistes, pour réapprendre à penser à partir de la complexité affective, mais aussi sociale, qui
constitue les enjeux moraux. A un second niveau, une éthique écoféministe sera dite inclusive en
ceci qu'elle ne se donne pas pour objet la protection de « la » nature, comprise comme ce qui est
extérieur à la culture humaine, mais plutôt la réforme des relations qui lient l'humain et le non-
humain, ainsi que le contexte concret de ces relations. A ce titre, les populations urbaines
défavorisées ou les paysans paupérisés des pays du sud sont aux cœur des enjeux éthiques
écoféministes autant que le sont les espèces animales ou le réchauffement climatique. Enfin, le
caractère inclusif d'une éthique écoféministe nous intéresse plus spécifiquement en ceci qu'il invite
à ne pas considérer l'expérience esthétique comme un domaine qui serait par nature exclu du champ
de la morale, et qui nécessiterait pour sa réintégration de passer par le filtre de la connaissance
113 Cette accusation porte typiquement sur l'usage des dilemmes pour éclairer la nature de la vie morale. Ces dilemmes incarnent la quintessence des narrations tronquées, en ceci qu'ils nous placent devant la nécessité d'un choix binaire qui oblitère le contexte de la décision et la singularité des entités qu'elle implique.
54
scientifique. Notre attachement à l'apparence des choses, à la façon dont elles affectent nos sens,
nous émeuvent ou au contraire nous rebutent, trouve une nouvelle place et une nouvelle légitimité
grâce au développement d'une éthique écoféministe. Il nous reste à présent à entrer dans le détail de
cette alliance rénovée entre l'éthique et l'esthétique environnementale.
c) Quelles affinités entre l'écoféminisme et une esthétique non-cognitive ?
Marti Kheel ouvre sa proposition d'une éthique écoféministe sur le constat suivant :
« La crise environnementale est, par dessus tout, une crise de la perception.114 » Ce constat fait écho
à celui que formule Aldo Leopold dans son Almanach, lorsqu'il évoque l'urgence de « promouvoir
la perception115 » chez les américains, ou encore à ce qu'Arnold Berleant conclut dans son ouvrage
The Aesthetics of Environment : « Nous avons besoin d'apprendre la perception
environnementale116 ». L'éthique environnementale apparaît à travers ces trois remarques comme
une affaire de sensibilité et de réceptivité. Pour respecter son environnement, il faut être capable de
le voir, de le sentir, d'en percevoir les singularités et les nuances. Un des enjeux de l'écologie
consiste donc moins à trouver un critère fixe et universel de considérabilité morale, qu'à stimuler et
cultiver une perception de l'environnement qui place l'individu à l'intersection de l'éthique et de
l'esthétique. Il s'agira de voir au cours de ce développement et à partir des déplacements conceptuels
que permet la critique écoféministe, quel type d'embranchements une esthétique non-cognitive peut-
elle créer avec l'éthique environnementale telle que nous l'avons redéfinie. Il ne s'agit plus de
soutenir que, sous l'égide de la science, nos jugements esthétiques nous amènent à reconnaître à la
nature une valeur esthétique qui génère des devoirs éthiques, mais de voir ce qui, au cœur de
l'expérience esthétique elle-même, fait signe vers une éthique. Il conviendra, pour répondre à cet
enjeu, d'esquisser les approches non-cognitives soutenues par les penseurs de l'esthétique
environnementale et de les mettre en dialogue avec les postulats éthiques écoféministes. En quoi
l'expérience esthétique pensée comme un mode d'interaction spécifique avec l'environnement
permet-elle de stimuler une sensibilité éthique à l'égard de ce dernier ?
Allen Carlson, tout comme Holmes Rolston et Marcia Eaton, reconnaissent l'existence
majoritaire d'expériences esthétiques qui ne se fondent pas sur la science. Mais ces expériences,
bien qu'elles puissent être fortes et intenses, sont selon eux biaisées et entraînent parfois des
attitudes non respectueuses envers l'environnement naturel. De ce fait, elles devraient être
114 « Environmental crisis is, above all, a crisis of perception » Marti Kheel, op.cit. 115 Aldo Leopold, op.cit., p.221.116 « We need to learn environmental perception », Arnold Berleant, The Aesthetics of Environment, Temple University
Press, Philadelphia, 1992, p.185.
55
considérées comme inférieures aux expériences « science-based ». C'est cette hiérarchisation
normative des expériences esthétiques qui entraîne le plus de critiques de la part des tenants d'une
esthétique non-cognitive. Nous pouvons certes contempler le vol automnal des oies migratrices en
nous émerveillant de la distance qu'elles s'apprêtent à parcourir, songeant à l'instinct parfait qui les
oriente ; mais l'on peut également s'émouvoir parce que ce vol nous rappelle ceux dont nous avons
été témoins durant notre enfance, parce qu'il strie le ciel de lignes gracieuses, ou encore parce qu'il
nous évoque un poème que nous avons lu récemment. La pluralité des moteurs de l'expérience
esthétique est importante dans la mesure où elle ne réduit pas le réel à l'observance d'une norme et
ne hiérarchise pas les différents modes d'appréciation de l'environnement. Selon cette approche,
l'expérience esthétique de la nature d'un poète comme Rimbaud est tout aussi légitime que celle
d'un naturaliste érudit comme Aldo Leopold. Il ne s'agit pas pour autant de disqualifier la
connaissance scientifique mais de l'insérer dans une appréhension plurielle et pragmatique de
l'expérience esthétique et des enjeux écologiques et politiques qui lui sont attachés. Ce pragmatisme
invite à considérer l'expérience esthétique comme plurielle, située, et enracinée dans un
environnement non seulement physique, mais aussi social, culturel, symbolique.
Chez les tenants du cognitivisme la norme scientifique se manifeste, nous l'avons vu, à
travers la prépondérance du concept d'appréciation esthétique. Dans cette perspective, l'expérience
esthétique s'apparente avant tout à une expérience de jugement et d'évaluation. L'esthétique serait,
comme l'éthique, une affaire de valeurs qu'il s'agit de bien apprécier117. De fait, le cognitivisme
esthétique, depuis l'article de Kendall Walton, insiste d'avantage sur la validité de l'appréciation
esthétique que sur l'intensité de l'expérience subjective118. Cette validité accroît certes la qualité et la
profondeur de l'expérience esthétique, mais cet accroissement n'en est ni le centre ni la destination
(puisqu'une expérience esthétique intense peut aussi se baser sur un jugement faux). On comprend
que dans une approche cognitiviste de l'esthétique environnementale ce qui compte avant tout c'est
la rectitude du jugement que nous formulons au sujet de l'objet esthétique. C'est en cela que
l'esthétique peut renforcer une norme du comportement, c'est-à-dire une éthique. Mais la
compréhension de l'expérience esthétique elle-même, en dehors des normes auxquelles le
cognitivisme l'assigne, ne peut-elle esquisser d'autres types de connexion avec l'éthique ?
Pour répondre à cette question, le travail d'Arnold Berleant constitue une piste
privilégiée. Ce dernier développe une approche phénoménologique et holistique de l'expérience
esthétique et de la sensibilité à l'environnement. Alors que le recours aux sciences naturelles donnait
aux cognitivistes le sentiment de pouvoir mettre à distance l'environnement afin de le contempler
117« In both aesthetics and ethics something of value is at stake. » Holmes Rolston III, From Beauty to Duty.118 Sur ce point, voir Allen Carlson « Appreciation and the natural environment », Journal of Aesthetics and Art
Criticism, n°37, vol.3, 1979.
56
dans la lumière d'une connaissance objective, c'est-à-dire d'une connaissance qui ob-jectere, qui
place devant ; Arnold Berleant rappelle que ce projet est illusoire du fait de la nature même de
l'environnement. L'environnement n'est pas donné comme un cadre objectif à l'intérieur duquel le
sujet agirait de façon autonome, mais il est au contraire le lieu d'une interpénétration continue par
laquelle le sujet expérimente ce qui l'environne et s'expérimente lui-même. Arnold Berleant rejette
ainsi l'acceptation courante du concept de nature du fait de l'extériorité qu'elle laisse présumer, et du
jeu de dualismes qu'elle entraîne (nature/culture, corps/esprit). En lieu et place de ce modèle, il
développe une appréhension inclusive de l'environnement :
L'environnement, tel que je l'entends, est le processus naturel tel qu'il est vécu par les gens,
quelle que soit la façon dont ils le vivent. L'environnement est la nature vécue, la nature
expérimentée.119
Il ne s'agit pas d'essayer de plier la rencontre esthétique à la reconnaissance de ce qui est « actually
there », pour reprendre les mots d'Holmes Rolston, attendu que l'environnement n'est tout
simplement pas connaissable sous ce mode, et que nous demeurons sans cesse pris dans la toile des
interactions qui nous lient à lui. Ainsi que le formule Merleau-Ponty, « mon corps est au nombre des
choses, il est l'une d'elles, il est pris dans le tissu du monde et sa cohésion est celle d'une chose120 ».
Une telle conception amène à revoir les prétentions épistémologiques du cognitivisme ;
l'environnement n'est pas un pur objet, ni même une collection d'objets, qu'il est possible de
connaître et de considérer pour lui-même et d'embrasser par un « gaze from nowhere », en dehors
des interactions que nous entretenons avec lui. Nous rejoignons en cela la critique épistémologique
menée par Donna Haraway, selon laquelle l'objectivité est toujours située, partielle. En outre, il n'est
pas souhaitable pour Arnold Berleant de mobiliser ce genre d'objectivité transcendante, ou d'en
faire un idéal régulateur, puisqu'il s'agit alors encore et toujours de comprendre l'environnement
comme ce qui est indépendant et retranché du monde humain, renforçant par là l'idée que l'écologie
serait le souci d'un monde dont nous serions idéalement absents. Pour bien comprendre la nature de
l'expérience esthétique, il conviendrait donc de minimiser le recours à la notion d'extériorité121, qui
objectifie l'environnement et biaise notre compréhension de l'esthétique. Il s'agit de penser
l'esthétique environnementale dans ce qu'elle a de fondamentalement interactif et engagé. Cette
option ouvre une troisième voie entre une esthétique illusoirement centrée sur la connaissance
119 « Environment, as I want to speak of it, is the natural process as people live it, however they live it. Environment is nature lived, nature experienced. » in Arnold Berleant, op.cit., p.10.120 Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l'Esprit, Gallimard, Paris, 1964, p.19.121 « There is no outside. Nor there is an inner sanctum in which I can take refuge from inimical external forces. The
perceiver (mind) is an aspect of the perceived (body) and conversely ; person and environment are continuous. » Arnold Berleant, op.cit., p.4.
57
objective de l'objet esthétique, et une esthétique formaliste dans laquelle seul l'effet sensible de
l'objet sur le sujet compte. L'environnement, tel qu'Arnold Berleant le conçoit, doit être pensé
comme une maison, un oïkos. Mais une maison ne se réduit pas à l'agencement matériel des murs et
des fenêtres, une maison consiste également en une série de gestes, d'habitudes, d'ambiances, de
traits sensibles et d'émotions qui créent une épaisseur existentielle et une continuité entre l'individu
et son environnement. A ce titre, l'écologie n'est pas l'étude et la protection de ce qui est extérieur à
l'humanité, mais la compréhension et l'enrichissement des relations et des pratiques habitantes qui
mêlent des espèces et des espaces hétérogènes. C'est à partir de cette définition élargie de
l'environnement comme maison qu'Arnold Berleant pense une expérience esthétique de
l'environnement qu'il nomme « integrated aesthetics » ou encore « aesthetics of engagement ».
Selon ce modèle, aucun cadre privilégié n'oriente l'expérience du sujet et cette dernière demeure
ouverte à tous les stimuli que recèle notre environnement physique, qu'il soit naturel ou urbain. Il en
résulte que cette approche est d'avantage descriptive que prescriptive ; il s'agit de comprendre
comment, dans chaque contexte particulier, se développe notre expérience esthétique du monde122.
Cette dernière n'est jamais purement formelle ou superficielle (thin, pour reprendre un vocable
commun aux théoriciens de l'esthétique environnementale), mais toujours alimentée par un substrat
de références collectives et personnelles qui l'enrichissent et la complexifient. Cela implique que
nos souvenirs et croyances intimes aussi bien que le cadre social et culturel dans lequel elles
s'insèrent ne sont a priori pas moins légitimes que la connaissance scientifique. Une telle position
implique des complications que les cognitivistes ont bien souligné : doit-on en revenir à l'idée que
la beauté est simplement « dans l’œil de celui qui la contemple » ? Comment résoudre les prises de
position conflictuelles, si ce n'est en invoquant une valeur objective qui fasse consensus ?
L'esthétique d'Arnold Berleant paraît, au vu de ces critiques, hautement relativiste et incapable de
fournir un appui solide à une éthique de l'environnement. L'accent qu'il met sur les milieux
anthropisés et urbains laisse en outre penser qu'il s'agit moins pour lui de fournir un levier
esthétique aux politiques de conservation de l'environnement, que de rendre compte de notre
expérience esthétique hors de toute considération écologique.
Pourtant, la position d'Arnold Berleant est plus complexe. Elle ne consiste pas à se
défaire de toute normativité, mais à pluraliser la valeur environnementale et à la décliner en valeurs
esthétique, écologique, sociale, symbolique, etc. Ce qu'il dénonce, c'est un « single-value
thinking123 », c'est-à-dire un certain monisme moral qui amène à ne considérer l'environnement que
sous l'angle des qualités illusoirement intrinsèques que lui attribue la science, et à réduire l'éthique
122« We need not to invent or justify such experience, its occurrence and identification are our starting point. » in Arnold Berleant, op.cit., p.15.
123 Arnold Berleant, op.cit., p.184.
58
aussi bien que l'esthétique à cette dernière. Ce modèle repose sur « la croyance que la possession
d'une valeur particulière pourra résoudre de façon satisfaisante les problématiques normatives en
jeu.124 » A la norme monolithique proposée par les cognitivistes, Berleant préfère des « clusters of
value125 », c'est-à-dire des ensembles de valeurs hétérogènes et convergentes à la fois, à
l'intersection desquelles il invite à considérer la notion d'environnement. Ainsi, la valeur écologique
d'un parc urbain recoupe sa valeur sociale, laquelle est en retour nourrie et fortifiée par la valeur
esthétique des lieux126 et ainsi de suite. Là où les cognitivistes pointent une forme de relativisme,
Arnold Berleant opère en réalité un mouvement de complexification horizontale des besoins
normatifs de l'éthique environnementale. Il s'agit moins de projeter sur nos relations à la nature un
devoir unique et absolu, que de résoudre des problématiques concrètes situées dans un
enchevêtrement de valeurs hétérogènes. On notera ici qu'un tel schéma fait écho au patchwork
éthique proposé par les écoféministes, qui invite à greffer sur une trame commune des points de vue
distincts. Ce qui pose le plus de problème, dans cette perspective, c'est donc moins la conflictualité
des valeurs que l'imposition d'une valeur supérieure destinée à l'emporter sur toutes les autres.
Ainsi, la valeur économique tend de nos jours à réduire au silence la considération des valeurs
esthétiques et affectives propres aux environnements dégradés par le développement capitaliste.
Arnold Berleant prend l'exemple d'un propriétaire terrien du Maine qui déciderait unilatéralement
d'abattre un arbre dans lequel des hérons cendrés nichent. Des groupes de protection animale
peuvent s'opposer à ce projet, mais du fait de la valeur absolue que confère au paysan le droit de
disposer de sa propriété, la pluralité même des valeurs est niée et la délibération à leur sujet est
annulée127. Un des enjeux de l'éthique environnementale telle que la pense Arnold Berleant consiste
donc à intégrer une variété d'intérêts et de points de vue sans les soumettre à une hiérarchisation
abstraite. Il s'agit alors de ne pas faire du modèle scientifique l'artisan d'un nouveau monisme
éthique, au regard duquel toutes les valeurs non scientifiquement fondées se trouveraient dépréciées
ou délégitimées.
Il reste désormais à spécifier le rôle explicite que l'esthétique, selon la description non-
cognitive qu'en fait Arnold Berleant, pourrait jouer dans le développement d'une éthique de
l'environnement. Car si les cognitivistes ont régulièrement tenté d'expulser hors du champ de
l'éthique les théories non-cognitives, force est de constater que les arguments d'Arnold Berleant sont
maillés de références à la portée morale, pratique et politique de l'expérience esthétique. Il est ici
nécessaire de rappeler les trois remarques convergentes que nous citions au début de ce
124 Ibid.125 Ibid.126 « A city park, for example, may embody the social value of group recreation and the political value of providing a
harmless outlet for energies, a locus of ethnic observances, and perhaps historical and geographical recognition of a distinctive place. » Arnold Berleant, op.cit., p.183.
127 Arnold Berleant, op.cit., p.187.
59
développement, selon lesquelles l'écologie est essentiellement une affaire de perception. La
perception renvoie de prime abord à l'aesthesis, mais elle peut également nourrir l'intelligibilité des
attitudes éthiques. Ceci nous amène à sortir du schéma déontologique de l'éthique comme respect
d'un devoir envers les entités à qui nous reconnaissons une valeur intrinsèque, pour revenir à une
éthique écoféministe pensée comme sensibilité au vulnérable et sollicitude attentive à l'égard de
ce/ceux qui nous environnent. Mais le problème est alors le suivant : la crise environnementale et la
détérioration galopante des milieux dans lesquels nous vivons semblent justement traduire un échec
de cette sensibilité, une faillite de la perception et de la sensibilité éthique à l'environnement. C'est
précisément parce que cette perception s'est émoussée qu'Aldo Leopold, Marti Kheel et Arnold
Berleant pointent une crise du percevoir, et évoquent la nécessité d'entreprendre un réapprentissage
de la perception. Marti Kheel écrit :
Le monde naturel ne sera pas « sauvé » par le glaive de la théorie éthique, mais plutôt à travers
une conscience transformée à l'égard de la vie dans sa totalité. L'insistance sur le
développement de nouvelles façons de percevoir le monde est en lien avec beaucoup des
travaux récents de la théorie morale féministe. Les théoriciennes d'une morale féministe ont
commencé à montrer que l'éthique n'est pas tant une affaire d'obligations et de droits, mais de
développement naturel de la façon dont nous voyons le sujet, ainsi que les relations que nous
avons au reste du monde. Avant de pouvoir changer la relations destructive que nous
entretenons avec la nature, nous devons, par conséquent, comprendre la vision du monde sur
laquelle cette relation repose.128
Ce constat fait écho à celui que formule Arnold Berleant à propos du caractère éthique de
l'expérience esthétique :
L'esthétique environnementale ne concerne pas seulement les bâtiments et les lieux. Elle traite
des conditions sous lesquelles nous participons de façon intégrée à une situation. Du fait de la
centralité du facteur humain, une esthétique de l'environnement affecte profondément nos
conceptions des relations humaines et de la justice sociale.129
Qu'est-ce qui relie ces deux remarques, a priori formulées dans des contextes et à des fins
128 « Feminist moral theorists have begun to show that ethics is not so much the imposition of obligations and rights, but rather a natural outgrowth of how one views the self, including one's relation to the rest of the world. Before one can change the destructive relation to nature, we must, therefore, understand the world view upon which this relations rests. » in Marti Kheel, op.cit. Nous soulignons.
129 « Environmental aesthetics, therefore, does not concern buildings and places alone. It deals with the conditions under which people join as participant in an integrated situation. Because of the central place of the human factor, an aesthetics of environment profoundly affects our moral understanding of human relationships and our social ethics. » Arnold Berleant, op.cit., p.14-15.
60
différentes ? La première nous indique que la résolution de la crise environnementale ne pourra
passer que par un questionnement et une refonte de la perception que nous avons de notre monde.
La seconde invite à considérer les enjeux éthiques et esthétiques de l'écologie sous l'angle de
l'expérience que nous faisons de notre environnement. Comment ces deux constats se connectent-
ils ? Tout d'abord, les deux opèrent une rupture avec la conception déontologique de l'éthique
environnementale : l'éthique de l'environnement doit moins être pensée comme l'institution d'un
cadre moral universel imposant des obligations de respect, que comme un ethos, un mode de vie,
une disposition grâce à laquelle nous sommes sensibles à ce qui se passe dans notre environnement.
Dans les deux cas, il s'agit de se concentrer sur les conditions sous lesquelles nous développons une
attitude éthique, et pas simplement sur les postulats théoriques aptes à ériger telle ou telle obligation
pratique. Fonder l'éthique sur l'observance de devoirs paraît superficiel en ceci que ce sont nos
dispositions mêmes à protéger, soigner, percevoir, qui font défaut. Or, ces dispositions ne
s'enracinent pas dans la seule compréhension rationnelle du monde (le fait de savoir que nous
dépendons de l'air que nous respirons, par exemple), mais aussi dans l'expérience sensible et dans la
conscience intime, viscérale, de nos liens à ce dernier. L'expérience esthétique constitue pour
Arnold Berleant une façon de ressentir le monde, de s'y investir et d'y devenir sensible. Il écrit :
En percevant pour ainsi dire l'environnement de l'intérieur, non pas en le regardant mais en
regardant en lui, la nature devient quelque chose d'assez différent. Elle est transformée en un
domaine dans lequel nous vivons en tant que participants, non en tant qu'observateurs.130
L'expérience esthétique du monde est l'occasion de développer une disposition à se sentir
immédiatement concerné par ce qui s'y passe, à ressentir de façon plus aiguë à quel point nous
sommes pris dans le tissu des choses, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty. A cette
immédiateté du saisissement esthétique répond le caractère engagé et actif du sujet qui est invité à
participer et à s'investir dans l'environnement.
On perçoit ici les premières connexions que l'esthétique non-cognitive opère avec
l'éthique environnementale, ainsi que les divergences notables qui séparent l'éthique déontologique
dont se réclament les cognitivistes, et l'éthique contextuelle et holistique que privilégient les
écoféministes et dont Arnold Berleant semble se rapprocher. Les premiers insistent sur la nécessité
de trouver, par le truchement d'une esthétique fondée sur la science, une valeur intrinsèque des
entités naturelles débouchant sur des devoirs et des obligations morales ; les seconds privilégient le
130« Perceiving environment from within, as it were, looking not at it but being in it, nature becomes something quiet different. It is transformed in a realm in which we live as participant, not as observers. » in Arnold Berleant, op.cit., p.170.
61
rôle que l'expérience esthétique peut jouer dans le développement d'une sensibilité
environnementale, elles consistent à pointer qu'une relation éthique à notre environnement dépend
moins d'obligations transcendantes que de dispositions cultivées qui renforcent notre réceptivité.
d) Entre altérité et continuité : L'éthique comme équilibre relationnel.
Nous avons vu que la critique écoféministe dénonce les « savior theories » qui se contentent
de faire de l'éthique environnementale une extension des morales rationalistes, et ne remettent pas
en question les postulats dualistes qui en sont à l'origine. L'écoféminisme ouvre en ceci de
nouveaux axes de réflexion sur l'éthique, en mettant par exemple en lumière le caractère
éminemment relationnel de l'attitude éthique. L'importance de la relation à l'objet, de ce à quoi
nous répondons et de la façon dont nous y répondons, permet de jeter un pont entre l'expérience
esthétique et l'attitude éthique. Marti Kheel insiste ainsi sur le fait qu'il ne s'agit pas de se doter d'un
nouvel arsenal de lois morales, mais de réinventer et de stimuler une nouvelle relation à la nature,
une nouvelle façon de se rapporter à l'environnement. Une telle exigence invite à penser un
équilibre relationnel susceptible de nous rendre sensibles au sort des entités non-humaines, c'est-à-
dire de renforcer notre réceptivité à l'environnement sur un mode non seulement cognitif mais
encore affectif. Pour sortir des logiques de domination que dénoncent les écoféministes, il s'agit
donc de repenser le caractère relationnel de nos attitudes éthiques. L'éthique du care que nous avons
abordée précédemment se définit en partie comme une capacité à percevoir les qualités singulières
des êtres qui nous entourent, perception par laquelle s'instaure un lien affectif et intime à l'objet. Ce
lien et cette connaissance ont un caractère éthique dans la mesure où ils nous invitent à reconnaître
l'objet pour ce qu'il est, et à engager des actions destinées à le préserver lorsqu'il est menacé. Une
reconnaissance appropriée du patient moral est importante dans la mesure où le statut de la nature a
souvent oscillé entre deux extrêmes : d'une part, le rejet dualiste du naturel dans une extériorité
purement mécanique a empêché une juste relation aux entités non-humaines ; d'autre part, et en
guise de remède à cette première attitude d'exclusion, certains penseurs comme Arne Naess ont fait
la promotion d'une conception étendue et inclusive de l'individualité dans laquelle le naturel n'est
plus l'Autre de l'homme, mais une partie de ce dernier. Ainsi, défendre la nature, ce serait ni plus ni
moins défendre ses propres intérêts, étant entendu que la nature fait partie de nous au même titre
que nous faisons partie d'elle. Ces deux conceptions semblent, chacune à leur façon, faire obstacle à
une juste appréhension des entités naturelles. La première, par excès d'exclusion, et la seconde, par
62
excès d'inclusion, peinent à trouver l'équilibre à partir duquel nous reconnaissons l'autre comme
autre, c'est-à-dire comme distinct de nous et irréductible à nos fins, tout en maintenant une certaine
continuité relationnelle avec lui. Val Plumwood définit le juste milieu en ces termes :
Le respect des autres implique de reconnaître leur différence et leur distinction, et de ne pas
essayer de les réduire ou de les assimiler à la sphère humaine. Nous devons reconnaître la
différence aussi bien que la continuité pour dépasser le dualisme et établir une relation non-
instrumentale à la nature, dans laquelle la connexion et l'altérité constituent la base de
l'interaction131.
Jean Grimshaw souligne également l'importance de cet équilibre dans la définition d'une éthique du
souci : « Le care et la compréhension requièrent une sorte de distance qui est nécessaire afin de ne
pas voir l'autre comme une projection du moi, ou le moi comme une continuation de l'autre.132»
Plutôt que de penser l'individu comme tantôt exclu de la nature, tantôt dissous dans la nature, il
s'agit de penser une relation qui ne réduit pas la continuité à l'assimilation, ni la différence à
l'exclusion. Nous avons dit précédemment qu'une éthique écoféministe pouvait être qualifiée
d'éthique inclusive, mais il convient de ne pas confondre inclusion et fusion. Comme le résume
parfaitement Trish Glazebrook dans l'article qu'elle consacre à l'éthique écoféministe de Karen
Warren133 :
Son éthique de l'inclusion reconnaît l'Autre comme originairement indépendant, différent,
dissemblable, et résiste à l'unité dans l'uniformité qui est un effacement des différences.134
De fait, une éthique écoféministe appelle un régime relationnel bien précis, dans lequel l'altérité est
reconnue sans être ni assimilée, ni rejetée. Il s'agit de construire une relation sur la double
reconnaissance de la ressemblance et de la différence, c'est-à-dire sur une certaine connectivité
(connectedness) éthique. Il s'agit, « d'oser voir nos ce que nous avons en commun (commonalities)
avec 'l'autre' qui est si différent de nous.135»
131« Respect for others involve acknowledging their distinctness and difference, and not trying to reduce or assimilate them to the human sphere. We need to acknowledge difference as well as continuity to overcome dualism and to establish non-instrumentalising relationship with nature, where both connection and otherness are the basis of interaction. » in Val Plumwood, op.cit., p.174.
132« Care and understanding require the sort of distance that is needed in order not to see the other as a projection of self, or self as a continuation of the other. Grimshaw » Jean Grimshaw, Philosophy and feminist thinking, University of Minnesota Press, 1986, p.182.
133 Trish Glazebrook, art.cit.134 « Her ethics of inclusivity acknowledge the Other « at the outset as independent, dissimilar, different », and resist
« unity in sameness which is an erasure of diffrences », Trish Glazebrook, art.cit.135 « daring to see our commonalities with 'the other' who is so different from us » Karen Warren, in Karen Warren,
Ecofeminist Philosophy : A Western Perspective on What It Is and Why It Matters , Rowman and Littlefield, New
63
La question est alors : comment reconnaissons nous cette unicité et cette singularité de
l'autre ? Nous avons vu que l'attention au particulier constitue la disposition fondamentale depuis
laquelle l'activité du soin et du souci éthique peut émerger. Dans le cadre des relations
interhumaines, cette attention porte sur le caractère propre de la personne, son histoire ou encore le
contexte commun que nous partageons avec elle ; mais dans le cadre de nos relations à
l'environnement, il apparaît que l'expérience esthétique constitue une façon privilégiée d'accéder à
l'équilibre relationnel que réclame une éthique écoféministe. Nous avons vu que pour Arnold
Berleant, l'esthétique est éthique en ceci qu'elle nous invite à cultiver une conscience du monde
physique plus intime et plus viscérale. Là où Marti Kheel estime qu'il faut susciter un nouvelle
conscience, une nouvelle vision de l'environnement, qu'il faut en somme réapprendre à le
percevoir ; Arnold Berleant montre que l'expérience esthétique peut constituer le vecteur d'un tel
réapprentissage. En effet, lors que nous sommes happés par la rencontre esthétique d'un objet, nous
prenons conscience de sa singularité à travers l'expérience sensible que nous en faisons. Nous
éprouvons hic et nunc l'unicité d'une existence distincte, dont l'altérité fondamentale se manifeste à
travers un série de traits sensibles propres. Appréhender esthétiquement un objet, ça n'est donc pas
le déformer sous la projection de nos propres désirs et fins, mais l'accueillir pour ce qu'il est en lui-
même. Cette idée recoupe les principes clefs de l'esthétique japonaise telle que la décrit Yuriko
Saito. Ainsi, la célèbre maxime de Bashō, poète japonais du XVIIe siècle, semble pouvoir
s'appliquer aussi bien à l'art qu'à notre expérience de l'environnement: « Ce qui concerne le pin,
l'apprendre du pin; ce qui concerne le bambou, du bambou.136 » Il convient de ne pas travestir les
objets selon nos désirs et nos inclinaisons mais d'être attentif à leurs besoins propres. Yuriko Saito,
en évoquant l'art des jardins japonais, précise ainsi qu'il ne s'agit pas de plier l'arbre à nos désirs ou
d'en faire un simple mobilier décoratif du jardin, mais d'en respecter les qualités intrinsèques. Cette
réflexion prend place dans un cadre esthétique, mais on notera qu'elle possède une portée éthique en
ceci que l'activité de soin du jardin incarne une activité attentive à la singularité de l'objet :
A la différence de l'art topiaire des jardins à la française, dans lequel les formes sont imposées
sans égard pour les caractéristiques de la plante utilisée, la forme désirée d'un arbre dans un
jardin japonais est définie par la forme particulière de l'arbre individuel lui-même137.
L'art du jardin et les pratiques de soin que nous mettons en place pour entretenir une plante
York, 2000, p.203.136 Bashō, cité par Yuriko Saito in Yuriko Saito, op.cit., p.113-114.137« Unlike topiary in European formal gardens, where shapes are designed regardless of the characteristics of the
plant material used, the desired shape of a tree in a japanese garden is defined by the particular form of the individual tree itself. » in Yuriko Saito, op.cit., p.112.
64
consistent donc à être à l'écoute des singularités propres à la plante, et à la débarrasser de ce qui est
superflu et adventice afin de favoriser son épanouissement. De la même façon, le cas complexe de
la restauration écologique mobilise notre capacité non pas à retrouver l'état originel d'un
écosystème, mais à être fidèle à ses qualités essentielles en lien avec un contexte modifié138. En ce
sens, il ne s'agit pas seulement de prendre soin en vue de notre seul plaisir (nettoyer une plage afin
de rendre la baignade plus agréable, par exemple) mais bien en vertu d'une sollicitude à l'égard de
l'objet en lui-même et pour lui-même. Ce principe élémentaire de l'esthétique japonaise éclaire et
enrichit le lien qui unit l'esthétique à l'éthique. Ce lien réside ici dans la relation singulière qui
s'instaure entre un sujet attentif et un objet esthétique, relation au cours de laquelle l'objet est
appréhendé dans son unicité irréductible. L'esthétique incarne en ce sens un domaine de
l'expérience humaine depuis lequel nous pouvons appréhender la singularité de notre
environnement de façon privilégiée, et accéder à l'équilibre relationnel qu'évoquent Val Plumwood
et Karen Warren. La présence esthétique des choses nous provoque, nous happe dans une relation au
monde qui sollicite notre sensibilité et notre souci. Baldine Saint-Girons, dans l'ouvrage qu'elle
consacre à l'acte esthétique, insiste sur les vertus éthiques de l'émotion esthétique:
L'éthique de l'acte esthétique consiste à s'ouvrir tout entier à l'altérité dont nous provenons, dans
laquelle nous sommes immergés et par laquelle nous serons inévitablement absorbés (…) Conçu
de la sorte, l'acte esthétique nous éduque à l'Autre, nous donne une imagination que nous
n'aurions pas eu sans lui et nous civilise en profondeur.139
L'expérience esthétique nous fait bifurquer hors du régime de l'utilitaire et du standardisé et permet
la vibration d'une rencontre singulière avec l'objet esthétique, elle « éduque à l'Autre » en ceci
qu'elle nous apprend à nous y rapporter de façon appropriée. Le chêne noueux que je vois tous les
jours depuis ma fenêtre n'est pas un chêne parmi d'autres, et il y a fort à parier que s'il était abattu,
ma relation à mon environnement proche en serait affectée. Ce chêne dont j'apprécie les qualités
esthétiques au fil des mois et des saisons n'est pas interchangeable ; son histoire, son aspect, la vie
qu'il accueille en font une entité unique. C'est à partir de l'importance de ces proches singuliers que
naît la sensibilité éthique ; nous ne prenons pas en charge « le vivant » ou « le sensible » de manière
générale, mais des vivants particuliers, des entités irremplaçables.
Cette considération nous amène à penser l'expérience esthétique non seulement comme
138 Cette fidélité au milieu fait écho à ce qu'Emily Brady évoque sous l'expression d'intégrité diachronique. Préserver l'intégrité d'un milieu ne consiste pas à chercher à lui rendre son aspect originel, mais à maintenir son équilibre écosystémique en accord avec son histoire, son évolution et les entités diverses qui partagent ses transformations. Emily Brady, op.cit., p.243.
139 Baldine Saint-Girons, L'acte esthétique, Klincksieck, 2008, p.33-34.
65
expérience de l'altérité, mais aussi comme expérience de ce qui est unique, de ce qui ne peut être
remplacé. L'émotion esthétique causée par un lieu, un objet ou une atmosphère se caractérise par la
singularité de ce qui n'est pas reproductible ou généralisable. Là où les cognitivistes invitaient
justement à dépasser la perspective située et partielle du sujet sur son environnement esthétique,
l'éthique du care souligne au contraire que nous agissons pour préserver des entités uniques,
particulières, et non des instances de phénomènes supérieurs. Deux exemples très différents
illustrent ce constat. Lorsque l'indienne Cecilia Blacktooth refusa le déplacement de sa tribu dans
une autre réserve, elle s'appuya essentiellement sur le caractère irremplaçable de sa région actuelle :
« C'est notre maison... Nous ne pouvons vivre nulle part ailleurs. Nous sommes nés ici et non pères
sont enterrés ici... Nous voulons cet endroit et aucun autre140.» Aucun autre endroit, si luxuriant soit-
il, ne peut remplacer la maison. L'importance du lieu se manifeste ici à travers la conscience d'un
passé inscrit dans des rituels de narration, et s'infiltre jusqu'au cœur de la langue avec les noms
singuliers que chaque particularité du paysage endosse (« Eagle-Nest moutain », « Rabbit-hole
mountain », « valley with ellongated red bluffs »). Keith Basso, un linguiste et anthropologue qui
travailla avec les apaches de l'ouest pendant plusieurs décennies, relate ainsi l'exceptionnelle
richesse de leur vocabulaire toponymique : dans les 104 kilomètres carrés qui constituent le secteur
de la Cibecue, les apaches nomment pas moins de 296 lieux d'après leurs traits distinctifs141. La
maison et le paysage singulier qui l'entoure sont appréhendés esthétiquement et intégrés à une trame
narrative qui engendre à la fois un attachement affectif et des normes comportementales. Dans un
tout autre contexte culturel, la géographe Nathalie Blanc évoque le déplacement, en 2003, du
village portugais de Luz à l'occasion de la mise en eau du barrage de l'Alqueva. Le village originel a
été rasé, puis reconstruit à l'identique quelques kilomètres plus loin. Pourtant, les habitants évoquent
une gêne suite à leur installation dans ce nouveau village. Ils s'y sentent étrangers et ne
reconnaissent plus l'ambiance esthétique (les oliviers et les arbres fruitiers, le pli du relief, la rivière)
qui faisait autrefois le caractère de ce dernier142. Dans ces deux exemples, habiter un milieu semble
impliquer à la fois d'en ressentir la singularité sur un mode esthétique, et d'éprouver corrélativement
un souci éthique pour sa protection et son maintien. Ces exemples illustrent surtout le fait que les
attitudes de souci et de soin que nous pouvons engager en faveur d'une entité naturelle sont des
attitudes situées qui prennent consistance à la confluence de l'affectif (l'attachement esthétique) et
du normatif143 (la tendance à rejeter les comportements qui nuisent à ce lieu). Sous cet angle,
140 « This is our home... We cannot live anywhere else. We were born here and our fathers are buried here... We want this place and no other. » Cecilia Blacktooth, citée par Val Plumwood in Val Plumwood, op.cit., p.182.
141 David Abram, The Spell of the Sensuous, First Vintage Book Edition, 1997, p.154.142 Nathalie Blanc, Vers une esthétique environnementale, Éditions Quae, Versailles, 2008, p. 81.143 David Abram démontre par exemple que l'importance du paysage incline et façonne les pratiques elles-mêmes chez
les apaches. La répétition d'histoires narrant le viol des coutumes et des normes apaches est toujours accompagné d'une précision sur le lieu exact de l'événement : « The land itself is the ever-vigilant guardian of right behavior
66
l'expérience esthétique que nous faisons de notre environnement contribue à nous en faire ressentir
l'unicité, et donc la nécessité de nous en soucier. Aldo Leopold souligne ainsi que la fréquentation
assidue et attentive d'un milieu ou d'une entité naturelle permet de prendre conscience de leur
importance. En ce sens, la science ne saurait selon lui suffire à nous faire comprendre et sentir la
valeur d'une entité naturelle :
Que la qualité de vie sur une rivière puisse aussi dépendre de la possibilité qu'on a d'en
percevoir la musique, et de la perpétuation d'un peu de musique qu'on puisse percevoir, voilà
une forme de doute non encore pratiquée par la science.144
D'une certaine manière, ce qui est interchangeable du point de vue de l'objectivité scientifique (le
fait que tel arbre disparaisse plutôt que tel autre, par exemple), ne l'est pas depuis les perspectives
partielles et situées à partir desquelles nous expérimentons un souci éthique pour notre
environnement. La stricte connaissance théorique du fonctionnement d'un écosystème ne saurait
nous faire éprouver la nécessité de participer à sa sauvegarde, et l'appréhension esthétique de la
rivière joue un rôle majeur dans notre sensibilité aux menaces qui pèsent sur elle. De la même
façon, connaître une plante d'après sa description livresque est insuffisant :
Nous ne pleurons que ce qui nous est proche. La disparition du silphium de l'ouest du comté de
Dane n'est pas cause de deuil si l'on en connaît que le nom, entrevu dans un livre de botanique.
Le silphium est devenu une personnalité pour moi, le jour où j'essayais d'en déterrer un pour le
ramener à la ferme.145
Le silphium n'est pas juste un membre du genre Ferula, il est aussi une personnalité qui se
manifeste à travers la vigueur de ses racines, sa longévité et son histoire (« peut-être fut-t-il témoin
de la retraite de Black Hawk? »146). C'est en le fréquentant, en étant attentif à ses qualités
esthétiques et à la trame narrative dans laquelle notre imagination l'insère qu'un véritable souci
éthique peut naître.
L'expérience esthétique de l'environnement enrichit donc notre approche de l'éthique à
plusieurs titres : Premièrement, la rencontre esthétique nous rend réceptifs au « sentiment poignant
de la présence des choses147», elle nous extirpe de la cartographie utilitaire que nous projetons sur le
monde et nous installe dans un régime d'attention à l'autre. En ce sens, elle ménage les conditions de
within traditional Apache culture. » in David Abram, op.cit., p.156.144 Aldo Leopold, op.cit., p.198.145 Aldo Leopold, op.cit., p.73-74. Nous soulignons.146 Ibid.147 Baldine Saint-Girons, op.cit., p.24.
67
l'équilibre relationnel qu'appellent Karen Warren et Val Pluwood pour l'établissement d'une éthique
écoféministe, à savoir le juste milieu entre la reconnaissance de l'autre comme autre et la sensation
d'être lié à cet autre, qui constituent les fondements d'une attitude éthique.
Un exemple paradigmatique de cet équilibre se trouve dans le récit que Karen Warren fait de
son ascension d'une falaise. Dans son essai « The power and the promise of ecological feminism »,
elle décrit une expérience au cours de laquelle elle estime avoir atteint une disposition intérieure
favorable au développement d'une sensibilité éthique à l'égard du non-humain. Ayant entrepris de
s'initier à l'escalade, elle raconte sa relation à la falaise au cours d'une ascension. A l'inverse d'une
escalade pensée sur le mode de la conquête et de la fierté virile, elle apprend au contraire à ressentir
le caractère unique de cet entité naturelle qu'elle découvre au fil de son ascension. Elle écrit :
Je pris une profonde inspiration. Je regardai autour de moi – je regardai vraiment – et j'écoutai.
J'entendis une cacophonie de voix – des oiseaux, la rigole d'eau sur le rocher devant moi... Je
fermai les yeux et commençai à ressentir la roche sous mes mains. A ce moment, j'étais emplie
de sérénité.... J'éprouvais un irrésistible sentiment de gratitude pour ce que la roche m'avait
offert : la chance de la connaître et de me connaître moi-même différemment, d'apprécier des
miracles inattendus comme les minuscules fleurs poussant dans les fissures encore plus petites
de la roche, d'en venir à connaître la sensation d'être liée à l'environnement naturel. J'ai eu le
sentiment que la roche et moi-même étions les partenaires d'une conversation silencieuse
prenant place au sein d'une vieille amitié. J'ai alors réalisé que je venais de me soucier de cette
falaise (to care about) qui était si différente de moi (…). Je me suis sentie prendre soin de cette
roche (caring for) et ressentir de la gratitude face à l'opportunité que cette ascension m'avait
donné de mieux me connaître, et de mieux connaître la falaise elle-même148.
Ce récit est remarquable en ceci qu'il concentre plusieurs traits fondamentaux d'une éthique du
souci, et les manifeste à travers une expérience esthétique. Si l'on énumère ces traits, voici ce que
nous apprend l'extrait sus-cité : Tout d'abord, le récit de cette escalade débute sur un mode
esthétique, l'auteur est attentive aux qualités sensibles de son environnement, le chant des oiseaux,
le bruit de l'eau, l'aspect de la falaise, les fleurs minuscules. A travers cette attention se développe
dans un second temps la conscience d'une relation avec la falaise. Cette relation s'instaure sur un
148 « I took a deep cleansing breath. I looked all around me – really looked – and listened. I heard a cacophony of voices – birds, trickles of the water on the rock before me... I closed my eyes and began to feel the rock with my hands... at that moment I was bathed in serenity. (…) I felt an overwhelming sense of gratitude for what it offered to me – a chance to know myself and the rock differently, to appreciate unforeseen miracles like the tiny growing in the even tinier cracks in the rock's surface, and to come to know a sense of being in relation with the natural environment. I felt as if the rock and I were silent conversational partner in a longstanding friendship. I realized then that I had come to care about this cliff which was so different from me (…). I felt myself caring for this rock and feeling thankful that climbing provided the opportunity for me to know it and myself in this new way. » in Karren Warren, « The power and the promise of ecological feminism », Environmental Ethics, Vol.12, été 1990.
68
mode singulier, qui ménage l'altérité de ce qui est relié (l'auteur, la falaise), tout en cultivant une
forme de continuité (exprimée ici par la référence à l'amitié). De ce caractère relationnel – et non
fusionnel – naît en dernier lieu la référence à un souci pour la falaise (to care about, to care for),
souci qui rend manifeste la dimension proprement éthique de l'expérience que relate Karren Warren.
Il est à noter ici que le récit qui est fait de cette escalade n'est pas sans rappeler la façon dont Ronald
Hepburn illustre l'expérience esthétique : expérience au cours de laquelle nous nous expérimentons
nous-mêmes autant que nous expérimentons l'objet esthétique, et qui débouche sur une conscience
plus intense et plus profonde de ce dernier (Ce que Hepburn illustre par le verbe to realize). Nous
sommes donc ici en présence d'un exemple qui met en lumière la façon dont l'expérience esthétique
des entités naturelles s'articule très concrètement à un souci éthique.
Enfin, l'esthétique ne nous fait pas seulement sentir l'altérité et l'unicité des êtres qui nous
entourent, mais elle nous fait également prendre conscience de ce que nous sommes
irrévocablement liés à ces êtres. On se souvient que chez Dewey, comme chez Merleau-Ponty,
l'expérience esthétique est visio-motrice : Nous ne voyons pas le paysage comme une surface plane,
mais comme un réservoir de potentialités motrices. Ainsi, le sujet n'est pas « dans » un
environnement, comme préservé de ce dernier par une certaine distance qui en permettrait la
contemplation détachée, mais il est existentiellement conditionné par cet environnement.
L'expérience animale donne le modèle de cette relation au monde dans laquelle tout bruit, toute
vision sollicite l'organisme et engendre une réponse, une harmonisation entre l'être et son milieu149.
L'expérience esthétique constitue le paroxysme de cette relation : « Elle signifie un commerce actif
et alerte avec le monde. A son plus haut degré, elle est synonyme d'interpénétration totale du soi
avec le monde des objets et des événements.150». Cet argument, nous l'avons vu, est largement
mobilisé par Arnold Berleant dans sa réflexion sur l'esthétique environnementale : Selon lui, ça n'est
pas tant l'esthétique qui nous fait sentir l'interdépendance de l'humain et des entités naturelles, que
la sensation de cette interdépendance qui peut être dite esthétique151. Lors que nous faisons
l'expérience du chêne noueux évoqué précédemment, nous ne le contemplons pas comme une
image dont nous serions détachés, mais nous sentons sous nos pieds la terre grasse dans laquelle il
plonge ses racines, l'ombre qu'il projette sur notre peau, le parfum de l'écorce qui emplit nos
poumons etc. Ce qui est important dans le cadre d'une esthétique environnementale, c'est que « nous
149 « L'animal vivant est pleinement présent, il est là tout entier, dans la moindre de ses actions : dans ses regards circonspects, son flair perspicace, ses oreilles brusquement redressées. Tout ses sens sont sur le qui-vive. En l'observant, on voit le mouvement se fondre avec les sens, et les sens avec le mouvement, pour former cette grâce animale que l'homme a tant de mal à égaler. » John Dewey, op.cit., p.54.
150 John Dewey, op.cit., p.55.151« This act of perception, this process of integrated experience, because it is perceived, has an aesthetic dimension. »
in Arnold Berleant, op.cit., p.10.
69
sommes sur le même plan, dans le même espace que la fleur ou l'arbre que nous regardons.152»
Toute expérience esthétique d'un environnement est donc corrélativement l'expérience d'une
interpénétration et d'une appartenance à un 'il y a' commun. En cela, l'expérience esthétique
dépasse la simple compréhension intellectuelle de ce que nous sommes liés à notre environnement,
puisqu'elle génère la sensation et la conscience intime de cette liaison.
On a vu que l'expérience esthétique que nous faisons de notre environnement nous invite
non seulement à reconnaître et à accueillir la singularité des objets qui le peuplent, mais en outre à
ressentir l'interdépendance qui relie ces éléments entre eux et nous relient aussi à eux. A ces deux
axes s'ajoute une troisième dimension proprement collective. Il convient de prendre en compte le
caractère collectif et communautaire d'une esthétique environnementale pensée comme
renforcement d'un ethos. En effet, l'environnement n'est pas seulement ce qui est offert à l'intuition
individuelle, c'est aussi un commun, un espace que nous avons en partage et habitons à plusieurs.
Les qualités esthétiques de cet environnement, leur évolution dans le temps, et, parfois, leur
détérioration sont appréhendées et vécues collectivement autant qu'individuellement. Telle plage ne
fait pas écho à mes souvenirs les plus personnels sans en même temps faire vibrer la toile des
sentiments collectifs, des narrations, des souvenirs et des familiarités qui lui sont liées. Emily
Brady, dans son ouvrage Aesthetics of the Natural Environment, évoque un exemple paradigmatique
de cet attachement collectif : celui d'un projet de carrière géante sur l'île de Harris, dans l'archipel
des Hébrides. Dans les années 90, l'entreprise Lafarge projetait d'extraire l'anorthosite d'une
montagne au sud-est de l'île. Le projet impliquait l'ouverture d'un cratère d'un kilomètre de large et
des travaux sur plus de 60 ans. Corrélativement, cette super-carrière menaçait l'intégrité paysagère
de l'île, la tranquillité des oiseaux marins qui y séjournaient, et bouleversait toutes les qualités
esthétiques de ce biotope unique : vibrations, bruit, pollution nocturne, destruction d'un pan entier
de l'écosystème de l'île, etc. Les habitants se sont massivement opposés à ce projet, arguant non
seulement de sa nocivité écologique, mais également de la rupture esthétique qu'il engendrerait. Ce
qui était inacceptable, ça n'était pas seulement la perturbation de l'hivernage des oiseaux ou la
pollution liée au va et vient des bateaux, mais c'était aussi l'immense balafre paysagère que
constitueraient une telle carrière, la rupture totale de la continuité et de l'intégrité esthétique qu'Aldo
Leopold plaçait au fondement de toute éthique de l'environnement. L'important est ici de noter que
la dégradation d'un environnement esthétique fait l'objet d'une réaction collective ; la singularité
esthétique d'un lieu ou d'une région étant aussi ce à travers quoi une communauté se reconnaît et
s'identifie, et peut, en dernière instance, se soucier. Là où la forme du jugement de goût kantien
jetait un pont entre la subjectivité et l'universalité, entre le moi et le tout un chacun ; l'esthétique
152 « … We are on the same plane, in the same space as the blossom or tree we are regarding. » in Arnold Berleant, op.cit., p.164.
70
environnementale permet de décrire à une échelle intermédiaire les liens qui unissent une
communauté à son habitat, le réseau des référents esthétiques, symboliques et narratifs dans
lesquelles la collectivité se reconnaît. Théoriser, comme l'a fait Dewey, l'expérience esthétique
comme paroxysme de l'interaction sujet-milieu, c'est aussi reconnaître la portée politique et
collective de ce milieu. L'individu n'habite jamais seul son environnement, ce dernier est au
contraire l'objet d'un souci et d'une attention collective. En ce sens, si les qualités esthétiques
(couleurs, formes, parfums, sons...) sont accessibles à tous, le paysage et l'habitat sont en droit une
préoccupation pour tous. Enfin, si la texture esthétique de l'habitat est un problème collectif, cela
implique donc aussi qu'outre ses implications éthiques, elle est d'emblée un problème politique153.
Dire que l'environnement esthétique sollicite des attitudes éthiques partagées et un souci collectif
est insuffisant tant que l'on n'a pas dit qui habite où, et selon quelles dynamiques spatiales se
distribue cette habitation. Quelles populations possèdent un accès à l'environnement naturel ?
Comment celui-ci se partage-t-il, et selon quelles failles politiques cette distribution évolue-t-elle ?
Ces questions sont fondamentales si l'on veut que les affinités précédemment définies entre
l'expérience esthétique et la sensibilité éthique ne restent pas condamnées à la spéculation
théorique, mais engendrent des pratiques effectives et des déplacements politiques féconds au
regard de la crise écologique.
Nous pouvons donc désormais appuyer notre enquête sur plusieurs fronts de convergence
entre l'esthétique et l'éthique. Cette convergence diffère cependant substantiellement de celle que
proposent les tenants d'un cognitivisme esthétique comme Allen Carlson ou Holmes Rolston. Chez
ces derniers en effet, il semble que l'expérience esthétique soit étudiée car elle peut être utile à
l'éthique environnementale, notamment en rendant le devoir moral moins austère et abstrait.
Attendu selon eux que l'esthétique incarne une dimension incompressible de notre rapport à
l'environnement, elle constitue un paramètre avec lequel il faut composer, et qu'il convient en tout
cas de discipliner et de rationaliser. De la sorte, le rapport entre expérience esthétique et attitude
éthique demeure un rapport d'extériorité pensé sur le modèle de l'articulation mécanique, dans
lequel l'esthétique sert les fins bien comprises d'une éthique fondée sur la science. A l'inverse, les
affinités que nous venons de décrire entre l'expérience esthétique et l'attitude éthique s'apparentent à
des affinités internes et organiques. Nous avons au préalable montré que, suite à la critique
écoféministe, il n'était plus possible ni souhaitable d'opposer l'émotion et la raison au sein d'une
éthique de l'environnement, et que celle-ci prenait justement racine dans un substrat affectif qui en
constitue à la fois la texture et la raison d'être. En maintenant inchangée la forme et le mécanisme
153 Nous nous appuyons ici sur le sens originel de la politique, à savoir la gestion d'un groupe humain dans un espace collectif, la polis.
71
de l'attitude morale d'inspiration kantienne, certains penseurs de l'éthique environnementale
reconduisent en réalité les schémas dualistiques qui sont à l'origine de l'instrumentalisation du non-
humain. Ainsi que l'ont montré Val Plumwood, Karren Warren ou Marti Kheel, le projet d'une
éthique de l'environnement est inséparable d'un projet de destitution des normes traditionnelles de la
pensée morale (devoir, obligation, universalité etc). Un tel déplacement invite à considérer
l'émotion esthétique sans chercher à la rabattre sur la connaissance scientifique, mais plutôt à voir
ce qui, à l'intérieur même de l'expérience esthétique, fait signe vers une éthique. Si l'attitude éthique
implique une dimension perceptive, si elle est une réceptivité à l'appel de ce/ceux qui nous
environnent, alors on peut dire que l'expérience esthétique constitue un vecteur privilégié de cette
réceptivité. Elle est ce qui impulse un régime d'attention à l'autre, et l'on peut en ce sens soutenir
que la nature même de l'expérience esthétique nous invite au souci éthique. L'expérience esthétique
est également, ainsi que l'a démontré Arnold Berleant, ce qui nous permet de ressentir plus
intensément notre dépendance à l'égard du monde naturel et notre intégration profonde dans le
monde physique que nous habitons. Outre la compréhension intellectuelle que nous avons de cette
dépendance, l'expérience esthétique permet d'en développer la sensation : C'est lorsque nous
sommes baignés par les odeurs, pénétrés par la fraîcheur de l'air (ou par la pollution!), happés par la
puissance visuelle d'un environnement, que nous prenons le plus intimement conscience de notre
appartenance à un monde commun. En ce sens, on peut soutenir que l'expérience esthétique cultive
une disposition, active une sensibilité, renforce un ethos. Il est d'ailleurs important de noter
qu'Arnold Berleant insiste beaucoup sur la notion de culture esthétique. Dans le chapitre qu'il
consacre à l'esthétique urbaine, il emploie l'expression « cultivating an urban aesthetics », et précise
peu après : « La métaphore agricole est délibérée. Elle suggère la nécessité de façonner sciemment
l'environnement urbain, y compris sa dimension esthétique, de telle sorte qu'il offre les conditions
permettant aux gens de s'y développer et de s'y épanouir.154 » Nous retrouvons ici le thème
important d'une disposition qui se cultive à travers un certain nombre d'actions, ainsi que celui de
l'éthique comme condition de développement de certaines attitudes. Il ne sert à rien d'attendre des
individus le respect d'une loi morale à l'égard du non-humain, si dans le même temps les conditions
d'un véritable souci pour le non-humain ne sont pas présentes.
Enfin, une troisième dimension, celle d'un commun esthétique qui esquisse les contours
d'une communauté éthique, nous amène à interroger le caractère proprement politique de la
réflexion que nous avons engagée. En effet, nous avons jusqu'à présent convoqué des réflexions qui
partent du rapport à la nature comme d'un donné, d'un immédiat de l'expérience. Aldo Leopold sort
154 « The agricultural metaphor of my title is deliberate. It suggests the need to deliberately shape the urban environment, including its aesthetic dimension, so that it offers conditions for people to grow and flourish. » Arnold Berleant, op.cit., p.98.
72
de sa maison et se trouve d'emblée plongé dans la profusion de l'environnement naturel, ses
animaux, ses forêts, ses marais. Mais Arnold Berleant souligne justement qu'à l'heure actuelle, très
peu de gens vivent encore au sein du « temple de la nature », ils sont au contraire dans leur grande
majorité confrontés à des problématiques urbaines qui mêlent discrimination et pollution,
appauvrissement esthétique et raréfaction du contact avec le non-humain. Partant de ce constat, la
discipline de l'esthétique environnementale ne peut se contenter de promouvoir une sensibilisation
abstraite des enjeux pratiques et politiques de l'écologie. La question qui se pose devient à la fois
plus spécifique et plus pragmatique : comment l'esthétique peut-elle informer les luttes concrètes
qui polarisent la vie urbaine ? peut-on penser une politicité propre de l'esthétique ? Sous quelles
modalités l'esthétique comme politique et comme pratique se manifeste-elle sur les fronts multiples
de l'écologie ?
73
CHAPITRE III
L'ESTHÉTIQUE COMME PRATIQUE ET COMME POLITIQUE.
L'expérience esthétique a longtemps été considérée comme une expérience contemplative,
désengagée des trivialités de la vie pratique. Cette conception a été fortement contestée dès le XXe
siècle, notamment par la philosophie pragmatiste qui a proposé une appréhension de l'expérience
esthétique à la fois engagée à l'échelle du sujet, et signifiante à l'échelle de la communauté. Nous
avons vu que le tournant conceptuel qu'opère l'esthétique environnementale fait signe vers une
reconnexion similaire entre l'esthétique et le pratique, mais cette entreprise reste en suspens et il
nous reste à détailler la façon dont l'expérience esthétique motive des actions, nourrit des praxis. Ce
pan de notre enquête est majeur puisqu'il s'agit de montrer que non seulement nous nous rapportons
régulièrement à notre environnement sur un mode esthétique, mais qu'en outre ce mode est engagé,
participatif, et qu'il informe la façon dont nous modelons notre milieu. Nous tâcherons donc
d'étudier dans un premier temps le caractère actif de l'expérience esthétique, en nous appuyant sur la
riche enquête que John Dewey nous a léguée à ce sujet. Si l'esthétique doit se situer au cœur d'une
approche plurielle et inclusive de l'écologie, c'est précisément parce qu'elle articule des
connaissances, des affects et des pratiques. Ces pratiques constituent en outre l'achèvement de
prétentions éthiques de l'écologie, puisque la conceptualisation de principes moraux reste sans effet
si elle ne s'accompagne pas de mises en œuvre concrètes. Quelles sont ces pratiques ? Lorsque l'on
cherche à associer au domaine esthétique un certain type d'activité, on songe spontanément aux
pratiques artistiques. Le peintre qui étale des pigments sur une surface, le sculpteur qui façonne la
pierre et le bois, le musicien qui arrange des souffles, ou, plus récemment, l’artiste qui effectue une
performance éphémère, tous produisent un certain travail par lequel de nouveaux types d'êtres sont
engendrés. Mais l'esthétique ne se retreint pas à ces activités, et nous tâcherons de voir si des
pratiques plus anodines ne peuvent être intégrées à une esthétique de l'environnement : jardiner,
soigner, réparer, embellir, nettoyer, sont autant d’activités qui procèdent d’intérêts esthétiques, et
qui méritent à ce titre d’être pleinement intégrées à une réflexion sur l’esthétique environnementale.
Ces pratiques permettent en outre d'articuler l'esthétique à l'éthique de façon plus concrète. En effet,
nous avons soutenu – de concert avec les tenants d'une éthique écoféministe – qu'il n'était pas
souhaitable d'abstraire les agents moraux des particularités de leurs situations en les subsumant dans
74
des catégories à la fois universalisantes et exclusives (l'humain rationnel autonome, par exemple),
mais qu'il convenait de saisir le problème de leur engagement moral 'par le milieu', c'est-à-dire
depuis les problématiques concrètes qu'ils avaient à gérer. Or, il nous manque pour l'heure,
précisément, une approche contextuelle de cet agent. Qui est-il ? Ou plutôt : qui sont-ils ? La
pluralisation du concept d'agent moral va ici de pair avec une politisation de l'éthique
environnementale. Il convient en effet de définir le théâtre – nécessairement multiforme – des
attitudes éthiques qui ont trait aux entités non-humaines, et de voir comment les affinités que nous
avons précédemment esquissées entre éthique et esthétique sont affectées par cette épreuve du réel.
Analyser l'expérience esthétique détachée de son contexte d'émergence et théoriser l'attitude éthique
hors des conditions sociales, économiques ou politiques des acteurs en jeu est donc insatisfaisant.
Afin de palier à cette faiblesse, nous tâcherons d'analyser la dimension politique qui caractérise en
propre l'expérience esthétique en tant qu'expérience située, mais aussi les attitudes de soin, dont
nous avons montré qu'elles étaient au cœur d'une approche renouvelée de l'éthique
environnementale. Cette politicité étant définie, il sera alors possible d'observer comment elle opère
in concreto, c'est-à-dire comment elle permet de créer de nouvelles réponses à la détérioration
écologique là où elle est rencontrée, et comment elle déjoue la verticalité qui caractérise
traditionnellement la gestion politique de l'environnement. A cet effet, nous analyserons deux
exemples de pratiques que l’on peut situer à l’intersection de l’esthétique et de l’éthique ; celui de la
réaction à la pollution d’une part, la façon dont cette pollution se manifeste esthétiquement et incite
certains groupes d’acteurs à entreprendre des activités de soin et de réparation, et d’autre part le
domaine de l’agriculture urbaine et des jardins communautaires, dont l’expansion actuelle manifeste
des dynamiques d’enrichissement social, environnemental et esthétique majeures.
a) Vers un pragmatisme esthétique, le paradigme de l'expérience chez John Dewey.
Considérer l'esthétique comme un compartiment de l'expérience qui peut être abstrait des
enjeux de la vie quotidienne et qui aurait en lui sa propre fin pose plusieurs problèmes : tout
d'abord, cette interprétation se base sur une vision insularisée de l'expérience esthétique, cette
dernière, ponctuelle et désengagée des trivialités pratiques, se caractériserait par son caractère extra-
ordinaire. Cette vision contemplative et formaliste néglige cependant les paramètres infra-
esthétiques qui sont au fondement de toute expérience esthétique et semble pour cette raison
manquer de réalisme. Deux méthodes s'affrontent en effet lorsqu'il s'agit d'analyser fidèlement
l'expérience esthétique : on peut soit tenter de l'isoler du tumulte de l'ordinaire, la soumettant à un
75
examen critique censé la restituer dans sa pureté, soit au contraire l'appréhender à l'aune des liens
qu’elle entretient avec les autres domaines de l'expérience humaine. Cette seconde méthode entre en
résonance avec l'intuition que l'esthétique ne saurait être totalement détachée des enjeux pratiques
de l'existence, et qu'elle s'amalgame au contraire intimement avec les autres pans de la vie
individuelle et collective. Il ne s'agit pas tant de relativiser et de corrompre la pureté du concept
d'esthétique, que de saisir ce qui fait précisément l'essence de cette dernière en relevant les
influences dont elle procède. John Dewey, dans son ouvrage L'art comme expérience, restitue les
enjeux de cette intuition en employant la métaphore qui suit :
Les sommets des montagnes ne flottent pas dans le ciel sans aucun support ; on ne peut pas non
plus dire qu'ils sont tout simplement posés sur la terre. Ils sont la terre même, dans un de ses
modes de fonctionnement visible.155
Il appartient donc à celui qui voudrait mener l'analyse de l'expérience esthétique de restituer la
continuité fondamentale qui unit cette dernière au socle de l'expérience ordinaire dont elle est une
manifestation. Dewey critique par ce biais une certaine posture intellectuelle qui consiste à idéaliser
l'esthétique et à la retrancher dans la sphère des « choses éthérées156», idéalisation qui s'accompagne
d'une conception muséale de l'art et de beau plus largement. Or, les œuvres que nous admirons dans
les galeries des musées sont pour la plupart coupées du contexte de leur émergence. Le bouclier
étrusque dont nous admirons les détails et la finesse derrière une vitrine n'est finalement que l'ombre
de ce qu'il a été, à savoir un objet esthétique signifiant et organiquement relié à la vie sociale et
religieuse de son époque. La posture consistant à jouir des seules qualités formelles de la chose
manque donc la complexité esthétique qui faisait la richesse de cet objet pour ceux qui l'ont produit.
Afin de rétablir la continuité entre l'expérience esthétique et ce que Dewey nomme « les processus
normaux de l'existence157 », il faut en revenir à l'aisthenomai, la perception sensible. Cette dernière
n'opère pas entre un sujet rationnel et une qualité formelle; si l'on aborde la perception selon une
méthode pragmatiste, il apparaît que cette dernière est avant tout fonctionnelle, ancrée dans les
échanges primitifs et vitaux que nous entretenons avec notre environnement. Nous ne sommes pas
dotés d'yeux pour contempler des paysages, mais parce que nous vivons originellement au sein de
ces paysages et que nous sommes portés à interagir avec les entités qui les peuplent. L'appréhension
pragmatiste de l'esthétique opère donc un renversement dans l'analyse traditionnelle qui est faite de
l'esthétique. Cette dernière n'est pas tant conditionnée par nos récepteurs sensoriels que par l'usage
155 John Dewey, L'art comme expérience, Gallimard, coll. Folio essais, Paris, 2005, p.30.156 Cf. « L'être vivant et les choses éthérées » in John Dewey, op.cit., p.56.157 John Dewey, op.cit., p.41.
76
quotidien que nous en faisons lorsque nous interagissons avec le milieu habité158. Dès lors,
l'esthétique ne se pense plus en rupture avec l'engagement pratique, mais en référence à ce dernier.
Il s'agit donc, pour comprendre l'expérience esthétique, de partir du substrat quotidien depuis lequel
elle émerge ou, pour reprendre la métaphore chère à Dewey, d'étudier les assises de la montagne
pour remonter jusqu'à son sommet. Cette méthode fait écho à une conception pragmatiste des liens
entre sensibilité et réalité, que William James illustrait de la sorte : « Le courant de vie qui entre
dans nos yeux ou nos oreilles est destiné à ressortir par nos mains, nos pieds ou nos lèvres159. »
C'est-à-dire que la perception est indissociable de l'action, que le sensible ne peut se penser sans
référence à l'engagement pratique qu'il informe et impulse. Notre expérience sensible est donc avant
tout une expérience située qui n'a pas l'environnement pour cadre ou « scène » de déroulement, mais
qui est au contraire entièrement constituée par les interactions avec ce dernier. En ce sens, le sujet
n'entretient pas un rapport à son milieu fondé sur l'extériorité et la séparation, mais est plutôt saisi
dans l'intimité d'un engagement constant avec celui-ci. Dewey souligne ainsi qu'à un strict niveau
corporel, il est impossible de distinguer définitivement le sujet de son environnement, ce dernier
étant pénétré par l'air qui l'entoure, les nourritures qu'il ingère, la gravité qu'il subit etc160. L'homme,
plongé comme tout animal dans un milieu tantôt hostile tantôt propice au développement de la vie,
expérimente une alternance de frustration et d'harmonisation dans son rapport à l'environnement.
Cette alternance crée une rythmique, un jeu de tension-libération, systole-diastole, flux-reflux qui
est le moteur de toute expérience161. Le sujet ne subit pas passivement les méandres d'une existence
jetée dans le monde, mais il s'investit au contraire dans la recherche active d'un équilibre avec ce
dernier, recherche ponctuée de résistances et de satisfactions. Ces expériences qui maillent notre
quotidien sollicitent notre attention sensible au cours d'activités a priori insignifiantes (tisonner un
feu, jardiner, écouter l'orage, partager un repas...), lesquelles n'accèdent au statut d'expérience
esthétique que sous certaines conditions. En l'absence de ces conditions, le risque d'amalgamer
l'esthétique à la multiplicité de nos expériences sensibles les plus infimes risque en effet de
réapparaître. Quelles sont ces conditions ?
Si l'on se réfère au déroulement de l'expérience esthétique, il apparaît que non seulement
celle-ci se distingue du cours des affaires quotidiennes, mais qu'elle constitue en outre un tout
consistant et complet. Dewey exprime cette idée – distinction par rapport à l'expérience ordinaire,
cohérence interne – en employant l'expression « une expérience ». L'article « une » exprime ici à la
fois une distinction de degré par rapport aux autres expériences, fragmentaires et confuses, et la
158 « L'existence se déroule dans un environnement ; pas seulement dans cet environnement, mais aussi à cause de lui, par le biais de ses interactions avec lui. » in John Dewey, op.cit., p.45.
159 William James, cité par Stéphane Maldérieux, in William James, Le Pragmatisme, Flammarion, Paris, 2010, p.35.160 John Dewey, op.cit., p.45.161 John Dewey, op.cit., p.50-51.
77
spécificité de l'expérience esthétique qui déploie exhaustivement son intensité et est vécue par le
sujet comme un moment unique. Ainsi, la visite d'un musée au cours de laquelle nous passons en
revue divers tableaux peut ne receler aucune expérience esthétique :
Ces œuvres peuvent être « vues » au sens littéral du terme ; on peut les regarder, éventuellement
les reconnaître, et les identifier correctement. Il n'en reste pas moins que, par manque
d'interaction continue entre l'organisme dans son entier et ces œuvres, celles-ci ne sont pas
perçues, ou, en tout cas, elles ne le sont pas sur le plan esthétique162.
La perception sensible de l’œuvre ne saurait donc constituer à elle seule l'expérience esthétique. Ce
qui fonde cette dernière c'est une rencontre totale entre le sujet et l'objet qui opère par le biais de la
perception sensible, rencontre qui se déploie dans le temps et se parachève en une harmonie
dynamique entre le sujet et l'objet. Il convient aussi de relever la précision « l'organisme dans son
entier », nous éprouvons notre environnement sensible de tout notre corps et ce que l’œil parcourt,
le reste du corps le parcourt virtuellement. La perception est éminemment active, elle ne mobilise
pas seulement l'entendement du sujet mais aussi son corps, ses expériences passées et le contexte
collectif dans lequel il s'insère. En ce sens, l'expérience esthétique est le fruit d'une attention
engagée et exploratrice, elle résulte d'une impulsion qui nous projette à la rencontre de l'objet et
trouve son accomplissement dans la convenance mutuelle entre ce dernier et le sujet. Cette
expérience ne diffère pas en nature de l'expérience pratique, elle en constitue plutôt l'aboutissement
naturel. Le régime de l'expérience quotidienne, rythmé de tensions et d'apaisements, de
désynchronisations et d'harmonisations avec l'environnement, offre comme nous l'avons dit le
modèle originel de l'expérience esthétique. Mais cet ordre demeure confus, les expériences que l'on
y mène sont souvent étouffées sous la répétitivité de l'habitude et ne sont pas menées jusqu'à leur
terme, on ne peut pour cette raison les qualifier d'esthétiques.
Cette appréciation de l'esthétique ébranle plusieurs piliers de l'héritage esthétique kantien.
Tout d'abord, le concept de beauté semble avoir été évacué de l'expérience esthétique, tout du moins
apparaît-il superflu pour définir cette dernière. En effet, si la beauté est le nom que nous donnons à
l'émotion qui nous envahit lorsque nous vivons une expérience esthétique, elle ne renseigne en rien
sur la nature et les modalités de cette expérience. Au contraire, en donnant l'illusion de pouvoir
réduire la diversité des émotions ressenties sur un mode esthétique à une catégorie fixe, la beauté se
mue en hypostase et fait manquer le foyer même de l'expérience163 ; soit les conditions spécifiques
162 John Dewey, op.cit., p.110.163 « Malheureusement, elle [la beauté] a acquis le statut d'un objet particulier ; l'extase émotionnelle a été assujettie à
ce que la philosophie nomme une hypostase, et le concept de beauté a acquis le statut d'une essence offerte à l'intuition. Lorsque ce terme est utilisé, théoriquement parlant, pour désigner la qualité esthétique globale d'une
78
de la rencontre entre un sujet et un objet. Ces rencontres gagnent à être saisies dans leur singularité
et il apparaît illusoire à Dewey de vouloir les subsumer sous une seule émotion. Il découle de cela
un élargissement du champ de l'esthétique, qui n'est plus cantonnée aux sens nobles tels que l'ouïe
ou la vue, comme c'est souvent le cas depuis la philosophie moderne. De la même façon, les musées
ne sont plus les lieux privilégiés de l'esthétique, le pragmatisme nous invitant à considérer les arts
populaires et les environnements non-artistiques comme égaux face à l'expérience.
En second lieu, ces changements semblent déséquilibrer une autre clef de voûte de
l'esthétique kantienne : le désintéressement. Ce célèbre prérequis esthétique a souvent été victime
de mésinterprétations; il ne s'apparente pas au désintérêt, mais à l'absence d'intérêt spécifique pour
l'objet en dehors de ses qualités sensibles. Nous serions supposés jouir des propriétés formelles d'un
objet sans nous soucier ou sans éprouver le moindre intérêt à l'égard de l'objet en question, de son
contexte ou de son utilité. Cette définition, qui ménage une partie de la communicabilité de
l'émotion esthétique, semble procéder de plusieurs confusions. Tout d'abord, l'attention sensible ne
flotte pas dans l'éther de l'entendement, mais procède d'abord d'un intérêt pratique pour l'objet.
Selon Dewey, nous allons à la rencontre de notre environnement parce que des besoins concrets
nous y poussent, et c'est à partir de ces interactions vitales que se constitue la possibilité d'une
expérience esthétique aboutie. L'art et la vie, l'esthétique et le pratique appartiennent au même
substrat empirique. L'expérience esthétique est donc une expérience sensori-motrice avant d'être
une expérience contemplative, l'action étant toujours le revers de la perception164.
Mais ces différences entre l'esthétique kantienne et l'esthétique comme expérience de Dewey
sont à relativiser. En effet, si le jugement de goût se déploie chez Kant indépendamment de tout
concept déterminé et de tout intérêt pour l'objet, l'expérience du beau joue néanmoins un rôle
existentiel profond pour le sujet. Lorsque je fais l'expérience de la beauté, je n'éprouve pas
seulement un plaisir sensible, mais aussi une adéquation avec le monde165. Le beau kantien est donc
dans une certaine mesure, lui aussi, le produit d'une harmonie entre le sujet et son environnement.
Là où ces deux théories esthétiques divergent en revanche, et où Dewey semble proposer une
appréhension plus riche de l'expérience esthétique, c'est à l'aune des liens qu'entretient l'esthétique
avec les autres aspects de l'existence. Tandis que Kant cloisonne et autonomise la sphère du beau,
expérience, il vaut certainement beaucoup mieux s'attacher à l'expérience elle-même et aux conditions du processus dont cette qualité est solidaire. » in John Dewey, op.cit., p.224.
164 La continuité de l'esthétique et du pratique au sein du vivant est développé dans le chapitre « L'être vivant » in John Dewey, op.cit.
165 Ce point est essentiellement développé dans l'analytique du sublime. Là où le sublime fait éprouver à l'homme le sentiment d'un excès, d'une difformité déchirante, le beau à l'inverse se définit comme le moment d'une réconciliation avec le monde, d'un accord, d'une harmonie avec la nature. Ainsi, le beau est ce « langage chiffré dont se sert la nature pour nous parler », cette « trace que laisse la nature (…) témoignant qu'elle contient en soi un quelconque principe qui permette de supposer qu'il existe un accord (…) entre ses produits et notre satisfaction indépendante de tout intérêt. » in Emmanuel Kant, op.cit., p.253-255.
79
Dewey l'enracine au contraire dans le procès de l'expérience pratique et dans la rythmique des
événements collectifs. L'art joue en ce sens une fonction sociale explicite, il n'est pas retranché dans
une sacralité spirituelle mais participe de l'intensification et de l'enrichissement des expériences
menées au sein de la communauté. De ce fait, l'esthétique telle que l'appréhende Dewey semble
revêtir un rôle politique plus riche que l'universalité du jugement kantien. En puisant dans le
réservoir des références collectives (mythes, pratiques de la ville, arts populaires, design...), le
pragmatisme esthétique revalorise l'utilité sociale de l'art et des pratiques esthétiques. Ces
déplacements conceptuels nous permettent en outre de ré-ancrer l'esthétique dans l'arène de la vie
publique et des tensions qui la parcourent. Si l'expérience esthétique est dynamique et collective,
comment informe-t-elle les dissensions politiques qui constituent toute communauté ?
b) Quelle politicité pour l'esthétique environnementale ?
Depuis Platon qui appelle à chasser les imitateurs de la cité, jusqu'aux publicitaires
contemporains qui usent d'images séduisantes pour conditionner des pratiques, en passant par les
glorifications patriotiques du paysage, il est manifeste que l'émotion esthétique possède un pouvoir ;
c'est-à-dire qu'elle oriente des comportements, qu'elle produit des conduites, qu'elle incline des
sensibilités. Peut-on pour autant en conclure que l'expérience esthétique possède, en elle-même, une
dimension politique ? Une première réponse spontanée consiste à souligner que nous disons parfois
de l'art qu'il est engagé ; c'est-à-dire qu'une œuvre pourrait manifester par sa forme un message
politique, dénigrant ou au contraire glorifiant un certain idéal collectif. Mais dire que le réalisme
socialiste exalte un projet politique en se donnant le prolétariat pour sujet, ou que la peinture de
Gustave Courbet dénonce la misère sociale, ça n'est toujours rien dire sur la politicité propre de
l'esthétique. Cette politicité est commune à toute les expériences esthétiques, qu'elles soient
artistiques ou non. Le développement le plus célèbre à ce sujet, nous l'avons évoqué, est celui que
formule Kant. L'expérience esthétique pourrait être dite politique en ceci qu'elle ménage un
commun entre les hommes. Plus précisément, l'expérience de la beauté se parachève en un jugement
qui embrasse potentiellement tous les hommes en tant que subjectivités susceptibles de partager ce
jugement. En ce sens, l'expérience esthétique n'est pas seulement l'expérience d'un sujet atomique et
solitaire saisi dans un face-à-face avec l'objet esthétique, mais elle est aussi dans un second temps la
prise de consistance d'un jugement sur le fond d'un commun inter-subjectif. Cette première réponse
permet d'esquisser le caractère politique de l'expérience esthétique dans ce qu'elle a de générique et
de commun à tous les hommes. Elle rappelle également que Kant, à la fin de sa vie, avait esquissé
80
une esthétique de l'événement pour illustrer le bouleversement de la révolution française. La
déflagration politique de1789, en traçant autour d'elle une communauté de spectateurs désintéressés,
faisait signe vers une communion morale et politique de l'humanité. Les jugements portés sur la
révolution française ne procédaient pas d'intérêts individuels ou de partisanneries locales, mais
manifestaient une exaltation désintéressée face à la pure forme de la rupture historique. Ce qui
compte, dit Kant, c'est « la manière de penser des spectateurs qui se traduit publiquement à
l'occasion de ce jeu des grands bouleversements166». C'est ici la révolution en tant que spectacle qui
permet de penser le caractère esthétique de l'enthousiasme qui se répandit en Europe. Ce spectacle,
en plaçant les hommes face à leurs dispositions originelles, aurait permis le renforcement d'une
conscience commune. Mais on peut alors se demander si l'universalité du jugement de goût ne
dessine pas un commun trop large, et si le pont qu'il jette entre le jugement individuel et l'humanité
toute entière suffit à créer le sens d'une communauté qui soit proprement politique. Entre l'individu
et l'humanité, entre le moi et le tout autre, n'y a-t-il pas un gouffre d'avantage qu'un lien ?
La difficulté de lier l'individu à un ensemble trop vaste nous invite à l'analyse d'un
moyen terme, d'une échelle intermédiaire entre le sujet et l'humanité qui le subsume. L'expérience
esthétique, bien qu'universelle de par sa forme, est avant tout une expérience partagée par une
communauté restreinte dans un lieu donné. La politique est ce qui caractérise la gestion de cette
communauté en tant qu'elle partage un espace commun, la polis. On se souvient que pour Dewey,
l'art est ce qui permet de resserrer les liens entre les membres d'un même groupe en rendant
l'expérience collective plus intense et en multipliant les référents symboliques et esthétiques à
laquelle ses membres se rapportent. Ainsi, les rituels auxquels certaines tribus s'adonnent procèdent
moins d'une croyance en leur efficacité effective, que d'une conscience de leur rôle social :
Ces rites et ces cérémonies possédaient bien sûr cette visée magique, mais nous pouvons être
certains du fait que, s'ils étaient accomplis de façon durable, en dépit d'échecs dans la pratique,
c'est parce qu'ils enrichissaient de façon immédiate le vécu.167
L'expérience esthétique est donc le liant qui maintient et renforce la cohésion d'un groupe humain.
Elle est à la fois ce par quoi nous interagissons individuellement avec notre environnement, et ce
qui renforce « le flot normal des services sociaux168». Cette double-dimension qui harmonise le
personnel et le collectif englobe aussi bien les artefacts que les supports naturels de l'expérience.
Une communauté de pêcheurs peut ainsi puiser des références esthétiques à la fois dans ses outils de 166 Emmanuel Kant, « d’un événement de notre temps qui prouve cette tendance morale de l’humanité » in Emmanuel
Kant, Le conflit des facultés, Librairie philosophique Vrin, Paris, 2000.167 John Dewey, op.cit., p.71.168 John Dewey, op.cit., p.39.
81
travail et dans le paysage qui encadre le groupe, entraînant chez ses membres le partage d'un réseau
d'affects communs. Mais on perçoit vite les limites d'une telle position : tout d'abord, elle se fonde
sur le modèle d'une cellule politique restreinte et harmonieuse : la tribu, la communauté locale, la
cité. Les membres y vivent dans une configuration de face-à-face169, et il existe une continuité
nourrie entre le singulier et le collectif. Or, force est de constater que la structure des grandes
démocraties administratives modernes est en rupture avec un tel schéma, et que la densité du tissu
relationnel local s'est relativement distendue. Comme le rappelle Dewey dans Le public et ses
problèmes, il s'agit de convertir la Grande Société en Grande Communauté170, c'est-à-dire de rétablir
les conditions sous lesquels le public se reconnaît comme tel et prend conscience de lui-même.
Cette nécessité indique que nous sommes précisément sortis d'une configuration communautaire, et
il semble donc peu pertinent de se référer à cette seule configuration pour penser la politicité de
l'esthétique. Enfin, on notera que l'idéal d'un petit groupe humain uni et harmonisé par un ensemble
de pratiques esthétiques socialement signifiantes demeure teintée d'un irénisme naïf peu en phase
avec les discriminations politiques, spatiales et écologiques qui divisent les groupes humains. Que
signifie 'partager un commun esthétique' à l'heure où les plus pauvres sont cantonnés aux quartiers
désaffectés et aux friches industrielles, tandis que les plus aisés jouissent d'un accès privilégié à la
vie citoyenne et aux espaces naturels ? On ne peut oblitérer ces termes du débat dans la mesure où
ils constituent le cœur de l'expérience que les habitants font de leur environnement. Si, comme le
soutient William Cronon, la crise écologique est une crise de l'habiter qui commence « at home », et
non dans les vastes espaces éloignés de la wilderness, alors l'esthétique environnementale doit être
capable de prendre en compte le caractère éminemment politique et conflictuel de l'habitation.
Jacques Rancière voit dans les problèmes de répartition, de distribution des lieux et
d'agencement de l'espace public l'essence même du politique. Il écrit :
La politique en effet, ça n'est pas l'exercice du pouvoir et la lutte pour le pouvoir. C'est la
configuration d'un espace spécifique, le découpage d'une sphère particulière d'expérience,
d'objets posés comme communs et relevant d'une décision commune, de sujets reconnus
capables de désigner ces objets et d'argumenter à leur sujet.171
La politique définit la res publica, la chose publique, c'est-à-dire ce qui est posé comme commun.
Elle distingue ce dont on peut débattre collectivement et ce qui doit rester privé ou tabou, ce qui
invite à la participation de tous et ce qui demeure propre à chacun. Mais cette répartition n'est pas
169 Pour reprendre les termes employés par Dewey au sujet des relations intracommunautaires.170 John Dewey, Le public et ses problèmes, Gallimard, Paris, 2005, p.235.171 Jacques Rancière, Malaise dans l'esthétique, Galilée, Paris, 2004, p.37.
82
neutre, elle est le fruit de choix qui opèrent à la manière de canaux ou de bifurcations dans la
gestion de la communauté. La politique définit la spatialité et la temporalité propre à chaque groupe
et à chaque activité, elle assigne aux choses et aux êtres un temps et un lieu, elle est un partage du
sensible. Dès lors, la question est moins de savoir qui a le pouvoir, que d'analyser de façon critique
la façon dont ce pouvoir découpe des zones d'intelligibilité collective, trace des frontières dans le
commun et occulte des champs d'action potentiels. Du fait que ce partage institue « un système
d'évidences sensibles172», il est également ce qui restreint l'éventail des possibles :
Le partage du sensible fait voir qui peut avoir part au commun en fonction de ce qu'il fait, du
temps et de l'espace dans lequel cette activité s'exerce. (…) Cela définit le fait d'être visible ou
non dans un espace commun, doué d'une parole commune, etc.173
Ce partage se manifeste de façon très concrète à travers des processus de ségrégation urbaine174,
d'invisibilisation des marges et de hiérarchisation des prises en charge de l'environnement. Il est
qualifié par Rancière d'esthétique dans le sens premier que lui donne Kant, c'est-à-dire comme « le
système des formes a priori déterminant ce qui se donne à ressentir »175. Mais Rancière ajoute que
c'est aussi par l'esthétique que ce partage peut être bousculé voire redistribué. L'expérience
esthétique ré-apparaît ici non plus comme le liant d'une communauté humaine harmonieuse, mais
comme la mise en tension d'un découpage politique, comme foyer de subversion des formes de
l'expérience collective. Les pratiques esthétiques sont politiques non pas parce qu'elles se donnent
un objet politique, mais parce qu'elles engendrent de nouvelles façons de sentir, d'expérimenter le
monde et de sillonner ses potentialités, et qu'elles court-circuitent en cela la répartition orthodoxe de
l'espace commun. L’œuvre engendre ce que Jacques Rancière nomme un sensorium176, c'est-à-dire
qu'elle projette autour d'elle un « milieu sensible »177 qui appelle un nouveau régime d'expérience.
Lorsque Kant évoque le libre jeu de nos facultés, il implique la sortie hors du jugement déterminant
et la rupture du mode d'expérimentation ordinaire du monde et des réflexes cognitifs qui
l'accompagnent. L'esthétique introduit un libre jeu qui se soustrait au partage traditionnel du
sensible, des manières de sentir, de dire, de connaître et d'occuper un espace. Nous pouvons donc
172 Jacques Rancière, Le partage du sensible, La Fabrique, Paris, 2000, p.12.173 Ibid.174 Jacques Rancière évoquait lors d'une conférence à la Columbia University les émeutes qui eurent lieu dans les
banlieues françaises en 2005, montrant que les banlieusards revendiquaient un droit à la ville tout en se prévalant de leur marginalité, reconduisant ainsi le partage du sensible à l'origine de leur frustration. Cf : Jacques Rancière « Conversations with Jacques Rancière », 2nd annual radical philosophies & education seminars, Columbia University.
175 Jacques Rancière, op.cit., p.13.176 Jacques Rancière, Malaise dans l'esthétique, p.41.177 Ibid.
83
provisoirement avancer ce qui suit : l'expérience esthétique est politique en ceci qu'elle ménage des
interstices subversifs et polémiques dans la distribution conventionnelle du commun.
Il reste alors à déterminer comment opère concrètement cette subversion, et quel est
son pendant positif. Quel ordre conteste-t-elle au juste, et comment parvient-elle à en créer un
nouveau ? Pour répondre à ces questions, les concepts que mobilise Félix Guattari en faveur d'une
écosophie nous semblent éminemment pertinents. L’écosophie peut être définie comme une
écologie transversale, qui articule trois perspectives : une perspective environnementale, une
perspective sociale et politique, une perspective subjective et psychique. Son argument s'ouvre sur
le constat suivant : le monde contemporain est en grande partie infiltré par l'esprit du capitalisme et
nous sommes presque unanimement soumis à l'ubiquité de ses rouages178. La rationalité économique
en vient à noyauter les relations humaines, les problématiques urbaines et environnementales sont
appréhendées selon un biais fonctionnaliste, et la singularité irréductible que recèle la texture de
l'expérience esthétique est traitée comme un résidu accidentel de la vie collective. Guattari oppose
ainsi deux paradigmes esthétiques : Le premier s'apparente à un modèle publicitaire abêtissant, il
incarne « l'imagerie sensationnaliste et en réalité banalisante et infantilisante que les médias
confectionnent à partir de l'actualité »179. Il consiste en un agrégat d'images sérielles, répétitives, qui
homogénéisent le subjectif180 et arasent le singulier. Le second, en s'opposant au premier, arrime au
contraire la subjectivité à des dynamiques de re-singularisation. Guattari écrit :
C'est dans le maquis de l'art que se trouvent les noyaux de résistance parmi les plus conséquents
au rouleau compresseur de la subjectivité capitalistique, celle de l'unidimensionnalité, de
l'équivaloir généralisé, de la ségrégation, de la surdité à l'altérité vraie.181
La référence au maquis est spatiale et politique à la fois. Le maquis est un interstice qui désamorce
le partage du sensible en instituant un lieu radicalement autre depuis lequel des foyers de subversion
politique peuvent naître. Cette résistance opère contre « l'équivaloir » capitalistique, c'est-à-dire
contre le processus au sein duquel tout peut être ramené à un opérateur d'échange ; où toute
singularité est réduite à un tiers terme uniformisant, où le différent est rabattu sur le semblable, le
qualitatif sur le quantitatif. L'esthétique capitalistique introduit de la conformité et de l'homogénéité
178 Ce que Guattari désigne sous le terme de Capitalisme Mondial Intégré.179 Félix Guattari, Chaosmose, Galilée, Paris, 1992, p.165.180 La subjectivité telle que la pense Guattari n'est pas une instance strictement individuelle, elle peut être
transpersonnelle et collective. Il la définit comme « l'ensemble des conditions qui rendent possible que des instances individuelles et/ou collectives soient en position d'émerger comme Territoire existentiel sui-référentiel, en adjacence ou en rapport de délimitation avec une altérite elle-même subjective. ». Félix Guattari, op.cit., p.21.
181 Félix Guattari, op.cit., p.126-127.
84
sérielle là où un art maquisard produit de la différence et de l'irréductibilité182. Dans un monde où le
libre jeu de l'esprit ne sert aucune rationalité économique, l'expérience esthétique peut donc être
considérée comme subversive. Il convient alors de se demander : qui participe à cette subversion et
quelles strates de la société affecte-t-elle ? La réponse de Guattari est claire : l'art n'est pas le
privilège des artistes et des musées, et ne saurait se trouver confisqué par une élite d'experts. Il
caractérise au contraire « toute une créativité subjective qui traverse les générations et les peuples
opprimés, les ghettos, les minorités (…) »183. La création subjective est indissociablement une
création de subjectivité qui modifie aussi bien l'ordre de la production matérielle que celui des
univers incorporels, l'un étant toujours en prise sur l'autre. Le rap, les « marches dans la ville » que
décrit Michel de Certeau184, l'art environnemental, la valorisation collective d'une friche urbaine
sont autant de canaux d'expression d'une esthétique qui re-singularise ce que la subjectivité
capitalistique avait arasé. Ce qui transparaît ici, c'est la transversalité fondamentale de ces
pratiques ; elles court-circuitent le cloisonnement traditionnel entre l'esthétique et le politique, entre
le musée et la place publique, entre l'artiste et l'homme du peuple, entre le privé et le public, entre la
nature et la culture185. Enfin, ce caractère transversal recoupe une seconde distinction qui apparaît
féconde au regard de la dimension politique de l'esthétique, celle du molaire et du moléculaire.
Guattari emprunte ce couple conceptuel à la chimie, laquelle distingue le niveau de la molécule et
celui du mole. Ainsi, l'agencement de molécules H2O fini par former un mole, lequel donne
consistance à une matière aqueuse visible et palpable. Le moléculaire n'est donc pas opposé au
molaire, mais il en constitue une dimension, un seuil. Appliqué au politique, ce couple permet de
distinguer les prises de positions constituées qui opèrent à l'échelle des institutions macropolitiques
(le vote, par exemple), et celles qui opèrent à une échelle infra-molaire. Parcellaires, inconscientes,
elles constituent un magma intensif d'affects et de désirs qui travaillent souterrainement le politique.
Cette échelle que Guattari nomme moléculaire permet d'impulser des processus de subjectivation
qui échappent à la logique capitalistique186, c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'assigner à
l'art un rôle normé et défini, ni d'en faire une sorte d'outil surplombant qu'il suffirait de projeter sur
les contextes particuliers. Bien plutôt :
A partir d'entreprises fragmentaires, d'initiatives quelques fois précaires, d’expérimentations
182 Guattari oppose ainsi l'homogenèse capitaliste à l'hétérogenèse que permet l'art.183 Félix Guattari, op.cit., p.127.184 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, arts de faire, Gallimard, Paris, 1990.185 « Moins que jamais la nature ne peut être séparée de la culture et il nous faut apprendre à penser 'transversalement'
les interactions entre écosystèmes, mécanosphère et Univers de référence sociaux et individuels. » in Félix Guattari, Les Trois Écologies, p.34.
186 Cf. Félix Guattari, Le Capitalisme Mondial Intégré et la révolution moléculaire, contribution présentée aux journées du CINEL - Centre d’Information sur les Nouveaux Espaces de Liberté, 1981.
85
tâtonnantes, de nouveaux agencements collectifs d'énonciation187 commencent à se chercher.
D'autres façons de voir et de faire le monde, d'autres façons d'être et de mettre à jour des
modalités d'être viendront à s'ouvrir et à s'irriguer, s'enrichir les unes les autres.188
Il ajoute dans les Trois Écologies,
La révolution que réclame l'écosophie ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de
force visibles à grande échelle mais également des domaines moléculaires de sensibilité,
d'intelligence et de désirs.189
Le rôle de l'expérience esthétique dans la prise de consistance d'une écologie politique est donc
notable à plusieurs titres. Tout d'abord, l'esthétique ne se contente pas de décorer un projet politique
traditionnel – en cela elle ne s'assimile pas à une esthétisation de la politique190 – mais elle refonde
la forme même de l'engagement politique. Elle constitue un levier de resingularisation qui place la
production de subjectivité au cœur des enjeux publics et disqualifie le monopole des paradigmes
rationaliste et scientifique. En second lieu, les foyers de resingularisation que permettent les
expériences esthétiques prolifèrent à un niveau moléculaire, elles peuvent être prises en charge par
des minorités marginalisées, et prennent consistance à un niveau individuel aussi bien que collectif.
Enfin, le paradigme esthétique que Guattari appelle de ses vœux brouille le compartimentage
conventionnel qui isole le pratique de l'artistique, le subjectif du rationnel, le public du privé. En
cela, il ouvre des canaux d'expérimentation riches et stimulants à de nouvelles praxis politiques.
Ce décloisonnement permet enfin d'intégrer pleinement les pratiques esthétiques aux
enjeux éthiques de la relation au non-humain. Si, comme le définit Jacques Rancière, « la politique
porte sur ce qu'on voit et ce qu'on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour
dire »191, alors il apparaît que les attitudes de care que nous avons esquissées en amont sont
inséparables de l'invisibilité sociale qui est la leur dans le partage du sensible actuel. Le soin comme
travail moral est absent de l'espace public en tant qu'espace au sein duquel des pratiques sont
exposées aux yeux de tous et encouragées ; il est aussi absent du discours politique, encore
largement polarisé par le modèle de l'accomplissement du devoir et du respect de la loi. Dès lors,
attribuer aux actes de soin une valeur publiquement morale, mettre en lumière, comme nous y invite
187 L'agencement collectif d'énonciation désigne ici une énonciation affranchie du paradigme moniste de l'auteur, elle n'est pas assignable à un sujet d'énonciation mais incarne au contraire une production collective et polyphonique de l'énonciation. L'énonciation prend toujours consistance dans un agencement de corps et de signes en perpétuelle évolution.
188 Félix Guattari, Chaosmose, p.166-167.189 Félix Guattari, Les Trois Écologies, p.14.190 Jacques Rancière, Le partage du sensible, p.13.191 Jacques Rancière, Le partage du sensible, p.14.
86
Karen Warren, des attitudes traditionnellement cantonnées à l'univers domestique, encourager et
renforcer des relations de sollicitude à l'égard du non-humain, c'est redistribuer la division
traditionnelle du travail moral (division qui recoupe les divisions de genre, la justice publique
relevant du masculin, tandis que les pratiques affectives du soin échoient aux femmes). C'est
également tracer des lignes de prise en charge du naturel qui ne se confondent ni avec la gestion
institutionnelle, ni avec l'entretien personnel de la sphère privée. Certaines pratiques artistiques font
écho à ce projet. On songera par exemple à l'artiste américaine Mierle Laderman Ukeles qui, au
début des années 70, réalise une série de performances au cours desquelles elle s'attache à nettoyer,
réparer, colmater, repeindre l'espace public. Ce qu'elle nomme « Maintenance Art » consiste à
exhiber aux yeux de tous les actes ordinaires de care que les femmes et les minorités sociales
accomplissent au quotidien. Ce projet, initialement destiné à faire l'objet d'une exposition baptisée
« care », a surtout été diffusé et apprécié grâce aux photographies qui ont été faites de l'artiste en
train de réparer, laver, soigner le monde extérieur. L'intérêt de ces images est qu'elles ne réduisent
pas la performance à son évanescence temporelle et symbolique, mais au contraire la font vivre et la
transmettent dans le temps et dans l'espace. Les photographies ainsi exposées donnent une véritable
visibilité aux activités de care et en soulignent l'importance à travers la mise en scène
photographique. Il s'agit en outre de contester l'invisibilité du monde domestique à travers une
exhibition publique du travail du soin, dans laquelle les communautés et les individus peuvent
puiser des références et des inspirations, poussant ainsi à reformuler le care dans le tissu même de
l'espace public. En ce sens, les pratiques esthétiques et artistiques ménagent un jeu dans l'espace
collectif, elles brouillent des frontières et « reconfigurent matériellement et symboliquement le
territoire du commun.192 » De la même façon, les attitudes de care ouvrent une brèche dans le
traitement traditionnel qui est fait de l'éthique environnementale, ainsi que dans la manière dont
cette éthique est intégrée aux enjeux de la vie urbaine, de la démocratie locale et de la justice
environnementale.
Si nous récapitulons le développement que nous venons de mener, plusieurs traits
saillants apparaissent. Tout d'abord, il est manifeste que l'esthétique possède un pouvoir, mais
l'esthétique « verte » que nous avons évoquée au début de notre enquête demeure enclavée dans un
certain nombre de topoï figés: sensationnalisme, exaltation romantique d'une wilderness éloignée,
privilège de l'image sur les autres modes d'expérimentation esthétique, réappropriation des
mécanismes publicitaires. Face à ce modèle, plusieurs alternatives s'esquissent et permettent de
penser un autre pouvoir et une autre politicité de l'esthétique. Ainsi, chez Kant, le jugement de goût
192 Jacques Rancière, Malaise dans l'esthétique, p.35.
87
débouche sur l'épreuve à première vue oxymorique d'une subjectivité universalisante. L'expérience
du beau, opérant sans concept et de manière désintéressée, trace dans autour d'elle les contours
d'une communauté virtuelle entre les hommes ; elle connecte le moi à l'universel. La seconde voie
dégagée par Dewey réduit quant à elle cet écart des échelles tout en soulignant le rôle politique de
l'expérience esthétique. Celle-ci se trouve intégrée à l'espace pluriel et déterminé que partage une
communauté humaine, et à travers laquelle ses membres renforcent la vivacité de leur expérience
collective. Ces deux premières acceptations de la politicité de l'esthétique insistent donc sur sa
fonction de liant et en font un vecteur de cohésion. L'expérience esthétique serait ce qui engendre
une « communauté consensuelle, c'est-à-dire non pas une communauté où tout le monde est
d'accord mais une communauté réalisée comme communauté du sentir.193» Mais nous avons
également vu que cette vision pacifiée d'une esthétique qui resserre les liens intracommunautaires
n'était pas satisfaisante, et qu'elle ne tenait pas suffisamment compte des conditions actuelles sous
lesquelles les humains cohabitent (contexte social, discrimination urbaine, préjudice écologique,
etc). Une seconde façon de saisir la politicité de l'esthétique a donc été de comprendre le rôle qu'elle
pouvait jouer dans la lutte pour une plus juste répartition du commun en passant par une refonte des
modes d'habitation. Il est apparu que, par son essence même, l'expérience esthétique subvertit les
formes ordinaires de l'expérience et invite à un redécoupage du sensible. Ainsi, l'art peut être dit
« engagé » même lors qu'il n'aborde pas explicitement un thème social ou politique, et cela du fait
que l’œuvre engendre un champ d'expérience qui modifie l'ordre du commun194. Chez Guattari, les
pratiques esthétiques sèment des foyers de résistance aux processus homogénéisant de la
subjectivité capitaliste, elles injectent du singulier dans les expériences individuelles et collectives.
A ce titre, elles ne sont pas réservées à une certaine catégorie de personnes, mais constitue une
énergie qui traverse aussi bien les marges urbaines que les minorités sociales et les artistes patentés.
L'expérience esthétique semble donc posséder une dimension doublement politique : Elle peut être
le vecteur d'une politicité à la fois consensuelle (re-densifier le tissu social, dynamiser les pratiques
collectives), et dissensuelle (court-circuiter un partage du sensible inique, subvertir les formes de
l'expérience capitalistique). Il s'agit maintenant de voir comment cette conception de l'esthétique
s'incarne dans des pratiques effectives, et comment ces pratiques nourrissent et enrichissent une
sensibilité proprement écologique.
193 Jacques Rancière, Malaise dans l'esthétique, p.56.194 Jacques Rancière écrit ainsi : « En quoi une certaine 'politique' est-elle consubstantielle à la définition même de l'art
dans ce régime ? La réponse, dans sa forme la plus générale, s'énonce ainsi : parce qu'elle définit les choses de l'art par leur appartenance à un sensorium différent de celui de la domination. » in Jacques Rancière, op.cit., p.46.
88
c) Réparer, soigner ; la prise en charge de la blessure écologique.
Les écrits écoféministes sont parcourus de références à la nécessité de réparer,
recoudre, guérir le monde et les relations qui le constituent195. L'importance du soin dans la
constitution d'une éthique environnementale non-déontologique nous invite à considérer deux
moments de l’acte éthique : premièrement, le moment qui suscite et motive le soin, et
deuxièmement, la façon dont ce soin se traduit par des pratiques concrètes et situées. La nécessité
de réparer et de veiller le milieu dans lequel nous vivons peut se manifester sur un mode
immédiatement esthétique. Si l'esthétique environnementale a, à ses débuts, largement insisté sur
l'expérience d'entités naturelles retranchées de la vie humaine (les baleines, les Grands Tétons, la
carcasse de l'élan, les forêts pluviales, le chenal d'une rivière, sont autant d'exemples devenus
célèbres dans le domaine), force est de constater que la sollicitation esthétique de notre
environnement intervient souvent dans des contextes urbains et émane d’entités hybrides qui sont
intégrées aux réseaux anthropiques sans être pour autant se réduire à une pure artificialité humaine.
Si l’on observe le spectre des réactions esthétiques des plus anodines aux plus frappantes que nous
sommes susceptibles de faire au cours de notre vie quotidienne, il apparaît que les réactions
esthétiques négatives occupent une place importante. A ce titre, il est permis d’avancer que la
détérioration écologique d'un milieu peut se manifester à ses habitants sur un mode esthétique. S'il
existe des pollutions invisibles (les radiations, le plomb contenu dans les peintures...), une grande
partie des pollutions auxquelles sont confrontées les populations se manifestent sur un mode visuel,
olfactif mais aussi sonore. La dégradation de l’environnement n'est pas simplement quelque chose
dont nous prenons connaissance, c'est également quelque chose dont nous développons la
sensation. La pollution de l'air modifie les ambiances urbaines et amène l'individu à formuler des
appréciations esthétiques négatives ; le rejet viscéral de la saleté, de l’impureté, ou de la noirceur est
récurrent. La pollution émanant tantôt du trafic routier, tantôt des complexes industriels, débouche
également sur un rejet des agressions visuelles (cheminées, tours, barbelés), et sonores liées à ces
infrastructures. De la même façon, les pollutions brutales et cataclysmiques comme les marées
noires soulèvent généralement des réponses esthétiques massives, que nous tâcherons d'analyser. En
somme, la dégradation environnementale peut se manifester sur des modes esthétiques qui motivent
des actions réparatrices ou contestataires.
S'interroger sur l’esthétique de l’environnement, c’est donc s’interroger sur
195 Nous pensons ici à des ouvrages comme Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism de Irene Diamond et Gloria Orenstein, et Healing the wounds : the Promise of Ecofeminism de Judith Plant et Petra Kelly. Plus généralement, l'importance du soin et de la réparation est manifeste dans les écrits éthiques écoféministes.
89
l’esthétique de tous les environnements, ainsi que sur les enjeux politiques qui leur sont liés. Ceci
fait écho à la remarque d’Andrew Light selon laquelle « une éthique pleinement environnementale
doit inclure tous les environnements, non pour des raisons théoriques, mais parce que les espaces
urbains peuvent représenter, et représentent effectivement, des connexions importantes entre les
humains et le monde naturel.196 » Cela signifie que pour aborder de façon complète et juste
l’esthétique environnementale, nous devons être capable de reconnaître que l’environnement
constitue pour une majorité d’individus un espace à la fois physique et symbolique, polarisé par des
luttes de pouvoir, et affecté par des inflexions esthétiques plus ou moins plaisantes. Cela veut
également dire que l'esthétique environnementale doit se déprendre du monopole de la wilderness si
elle veut être à la hauteur des enjeux écologiques contemporains. Comme le formule Yuriko Saito :
Cette prédominance de l'esthétique de la wilderness dans le discours environnemental éclipse
corrélativement l'importance, égale voire supérieure, des réactions esthétiques suscitées par nos
proches environs, ou par les objets et activités du quotidien, qui n'engendrent généralement pas
d'expériences mémorables ou d'occasions de réflexion. Nous tendons ainsi à négliger le rôle
étonnamment important qu'elles jouent en affectant et parfois en déterminant notre sensibilité
écologique, notre attitude et finalement nos actions, qui, au sens propre, changent le monde.197
Il convient donc d'accorder un réel crédit à l'expérience esthétique de l'environnement en tant que
milieu dans lequel nous évoluons quotidiennement. Face au déplaisir esthétique, nous tacherons de
voir quelles populations et quelles dynamiques sociales sont à l’œuvre dans la prise en charge de la
détérioration environnementale, mais aussi esthétique de leur milieu de vie. Il s'agit ici de se
confronter à la question de la justice environnementale, c'est-à-dire à la façon dont les ségrégations
urbaines et sociales s'accompagnent d'une inégale répartition des préjudices écologiques et
esthétiques, les groupes défavorisés étant souvent les plus exposés à la pollution et à la destruction
des ressources naturelles. Il s'agira ensuite de voir comment ces populations luttent contre la
dégradation de leur environnement. Quelles tactiques élaborent-elles, quelles alternatives
développent-elles ? Ces pratiques peuvent-elles être assimilées à des attitudes de soin ? De quelle
sensibilité esthétique procèdent-elles ?
196 « A fully “environmental” ethic ought to include all environments, not for theoretical reasons, but because urban spaces like Esperanza can and do represent an important connection between humans and the natural world. » Andrew Light, « Elegy for a Garden: Thoughts on an Urban Environmental Ethic », Philosophical Writings, Vol.14, 2000.
197 « This dominance of wilderness aesthetics in environmental discourse consequently eclipses the equally, or even more, crucial signifiance of our aesthetic reactions to our backyard as well as to everyday objects and activities, which generally do not provide memorable experiences or occasions for reflection. We thus tend to overlook their unexpectedly significant role in affecting, and sometimes determining our ecological awareness, attitude, and ultimately actions, thus literally transforming the world. » in Yuriko Saito, op. cit., p.57.
90
Dans l'ouvrage qu'elle consacre à l’esthétique du quotidien, Yuriko Saito souligne un
aspect de l’esthétique souvent délaissé par la recherche académique, celui des réactions esthétiques
négatives formulées dans l’ordinaire de la vie pratique. Ces réactions jouent pourtant un rôle
constant dans l’interaction entre le sujet et son environnement, et les expériences esthétiques
négatives s’avèrent en réalité tout aussi importantes dans la gestion de notre quotidien que les
expériences gratifiantes198. C'est parce que les choses sont sales, désordonnées, qu'elles se cassent
ou vieillissent, que nous sommes amenés à entrer dans des relations de soin avec elles. Les
phénomènes d'entropie, d'usure, de corruption, se traduisent par des expériences esthétiques
négatives qui nous invitent à entreprendre des actions réparatrices. Les processus de détérioration
permanents avec lesquels l’homme est en prise ne doivent cependant pas être considérés comme
neutres et universels. Dire que la saleté suscite des actions de la part du sujet ne doit pas occulter
des questions fondamentales au sujet de la répartition de cette saleté, de la division du travail de
prise en charge de cette saleté, et des luttes de pouvoirs qu’elle implique. Dans le cadre de la
détérioration environnementale, on constate que les préjudices écologiques et esthétiques ne sont
pas répartis de façon indifférente entre les hommes, mais trahissent au contraire des processus de
différenciation iniques. Dès lors, réfléchir à la façon dont la dégradation d’un milieu est perçue
esthétiquement et entraîne des activités de soin et de réparation, implique d’appréhender avec
lucidité le contexte économique et social de ces activités et de cette dégradation.
L'ouvrage de William Shutkin The Land that could be199 s'ouvre sur un constat sans
appel : la crise environnementale n'est pas une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, elle est
d'ores et déjà présente et affecte tous les jours la vie des communautés les plus vulnérables. La
pollution de l'air frappe de plein fouet les populations urbaines défavorisées, la terrible marée noire
qui toucha le golfe du Mexique en 2010 bouleversa les pêcheries souvent modestes de Louisiane,
les friches industrielles toxiques maillent les quartiers pauvres ; en somme, les préjudices
écologiques causés par le développement humain ne sont pas équitablement répartis et contribuent à
renforcer une rupture sociale et urbaine déjà présente. A titre d'exemple, 60% des populations noires
et latinos vivent dans les quartiers pauvres des centres villes américains, tandis que seul un quart
des populations blanches partage ces conditions de vie200. L'environnement est donc à la fois ce que
nous avons en partage, ce qui nous est commun, et ce qui est sujet à la discrimination, aux
forclusions et aux cloisonnements. Ces processus sont particulièrement visibles dès lors que
198 Cf. « Clean, dirty, neat, messy, organized, disorganized » in Yuriko Saito, op.cit.199 William A. Shutkin, The Land That Could Be, Environmentalism and Democracy in the Twenty-First Century, the
MIT Press, Cambridge, 2001.200 William A. Shutkin, op.cit., p.35-36.
91
l'environnement est dégradé ou pollué par l'activité humaine. Les plus riches ont alors les moyens
de fuir cette dégradation (installation dans des banlieues épargnées par le trafic, par exemple), ou de
s'en préserver quand elle les affecte (meilleur accès aux soins). On assiste ainsi aux États-Unis à une
résurgence des gated communities201 et à une accélération des logiques de différenciation sociale à
mesure que l'environnement urbain se dégrade. Ces mouvements se conjuguent à une désaffection
économique qui se traduit par des vastes séries de délocalisations laissant des villes comme Detroit
émaillées de friches industrielles toxiques, les brownfields. La détérioration environnementale est
donc indissociablement un problème écologique, un problème social et un problème de santé
publique202. Cette vulnérabilité se répercute également dans le rapport à l'eau et à la terre des
communautés de couleur. La pollution massive des cours d'eau américains affecte essentiellement
les personnes pauvres qui pêchent quotidiennement dans ces fleuves, et les plus démunis sont
condamnés à côtoyer des zones industrielles toxiques. Il ne s'agit pas de faire la liste exhaustive des
dégradations environnementales qui affectent les communautés défavorisées, mais de montrer que
la question de l'écologie ne peut être décorrélée des problématiques d'habitation, et des phénomènes
de ségrégation urbaine et sociale qui en découlent. Comme le rappelle William Shutkin :
L'injustice environnementale qui découle de l'impact disproportionné des dommages
environnementaux sur les communautés de couleur est solidaire d'un cycle de dégradation à la
fois environnemental et social. L'inégalité raciale encourage le préjudice environnemental,
lequel perpétue les luttes et les polarisations raciales, qui conduisent à leur tour à exacerber les
inégalités.203
Les réponses institutionnelles de type top-down qui sont apportées à ces problèmes, si elles sont
utiles et importantes, demeurent partiellement inadaptées dans la mesure où elles n'enrayent pas les
processus discriminatoires qui mêlent l'écologique et le social. En faisant majoritairement pression
sur les entreprises, elles manquent les ruptures et les replis communautaires qui empêchent les
populations locales de réagir et de prendre en charge la dégradation de leur milieu de vie. De la
même façon, les puissantes associations de défense de l'environnement comme le Sierra Club ou la
Audubon Society manifestent une perception de l'écologie largement indifférente aux questions
201 William A.Shutkin, op.cit., p.81.202 William Shutkin rappelle ainsi qu'aux États-Unis, les afro-américains ont six fois plus de risques de mourir
d'asthme, la concentration de leur habitat autour de zones routières congestionnées les rendant de fait beaucoup plus vulnérables à la pollution de l'air. En Californie, les populations de couleur sont trois fois plus susceptibles de respirer des particules fines. William A.Shutkin, op.cit., p.69-70.
203 « Environmental injustice stemming from the disproportionate impacts of environmental harms on communities of color is integral to a degenerative social and environmental cycle. Racial inequality invites environmental harm, which perpetuates racial strife and polarization, which in turn exacerbates racial inequality. » in William A. Shutkin, op.cit., p.81.
92
sociales et urbaines qui affectent les communautés défavorisées. Dans son article « Nature as
Community, the convergence of environment and social justice204 », Giovanna Di Chiro relate une
événement révélateur de la rupture entre un environnementalisme largement polarisé par des acteurs
blancs de classe moyenne, et les questions de santé publique et d'habitation portées par des
communautés majoritairement noires et paupérisées. Au milieu des années 80, Robin Cannon, une
habitante du quartier de South Central Los Angeles, s'oppose au projet d'incinérateur d'ordures que
le conseil municipal tente d'imposer aux habitants avec force d'euphémismes quant à l'impact
environnemental de ce dernier, et de promesses quant à la revitalisation de leur quartier (installation
de grands espaces verts, d'aires de pic-niques, etc). En lisant attentivement le rapport de l'EIR
(Environmental Impact Report) au sujet de cet incinérateur, elle réalise que la détérioration
écologique sera bien plus importante que ce que laissait entendre le conseil, chargeant l'air de
dioxydes fortement cancérigènes. Elle se tourne alors vers les associations de défense de
l'environnement, dont le Sierra Club. Mais la réponse de ces dernières est unanime : cet incinérateur
pose des problèmes de santé publique, mais ne concerne pas la protection de l'environnement à
proprement parler. Cette réaction est typique d'une certaine conception de l'écologie qui se focalise
sur la préservation d'espaces sauvages et d'animaux en danger, mais néglige presque totalement les
milieux en constante dégradation dans lesquels les humains vivent en majorité205. Selon cette
conception, il s'agit de défendre la nature en tant que royaume d’où l'homme est absent, ou ne fait
que passer. Ce schéma est doublement néfaste : non seulement il reconduit une dichotomie
artificielle entre nature et culture, mais en outre il condamne l’écologie à l'impuissance à l'heure où
une majorité des dommages environnementaux provient des villes. Ce constat recoupe celui que
formulait Guattari dans Chaosmose : « Si vous interpellez les écologistes sur ce qu’ils comptent
faire pour aider les clochards de leur quartier, ils vous répondent généralement que ce n’est pas de
leur ressort.206». Cette écologie-là échoue à se convertir en écosophie, c'est-à-dire à articuler les
enjeux environnementaux, sociaux et subjectifs de l'écologie. La pollution, qu’elle empoisonne l’air,
les sols ou l’eau, qu’elle soit visuelle, sonore ou olfactive, affecte donc prioritairement des
communautés fragiles et se caractérise par une dégradation sanitaire, mais aussi esthétique des
milieux dans lesquels ces communautés vivent. La réponse apportée à cette dégradation est donc
hautement déterminée par le contexte de discrimination et de ségrégation urbaine dans lequel elle
prend place.
204 Giovanna Di Chiro, « Nature as Community: The Convergence of Environment and Social Justice », In D. Faber, The Struggle for Environmental Democracy: Environmental Justice Movements in the United States, Guilford, New York, 1998.
205 Cette question a été spécifiquement traitée par Warwick Fox dans son ouvrage Ethics and the Built Environment, Routledge, 2000.
206 Félix Guattari, Chaosmose, p.177.
93
En réaction à ces phénomènes, les habitants des quartiers en prise avec de sévères
préjudices environnementaux ont entrepris de structurer leur mouvement au début des années 90.
En 1991 se tenait le premier National People of Color Environmental Leadership Summit, à
l'occasion duquel plusieurs délégations africaines, latinos, asiatiques et indiennes se rencontrèrent
pour échanger et témoigner des problématiques urbaines, sociales et environnementales auxquelles
elles faisaient face. Il s'agissait non seulement d'aborder de façon transversale la question de
l'écologie urbaine, mais en outre de s'approprier cette question à travers une voix propre,
subvertissant ainsi les approches paternalistes des environnementalistes blancs. Paul Ruffin, un
journaliste afro-américain qui couvrit ce premier sommet, relate ainsi :
Bien des environnementalistes africains se définissent par leur préoccupation pour
l'environnement urbain. Nous avons vigoureusement attaqué les environnementalistes blancs
pour leur attention à la sauvegarde des oiseaux, des forêts et des baleines, tandis que les enfants
des villes souffraient d'empoisonnement au plomb.207
Un argument récurrent dans la tentative de définition d'une écologie urbaine et sociale consiste à
avancer que l'homme, au même titre que d'autres animaux, est une espèce en danger. La pollution de
l'air, de l'eau et de la terre affecte non seulement les espèces non-humaines, mais aussi les humains
eux-mêmes, leur habitat, leurs pratiques de la ville, leur sens de la communauté208. Nous pourrions
transposer la critique de Paul Ruffin à la façon dont certains penseurs de l’esthétique
environnementale se soucient, en effet, plus des forêts et des baleines que des banlieues polluées qui
constituent pourtant un enjeu esthétique majeur. Le courant de la justice environnementale
encourage pour cela une prise de parole et une prise de pouvoir des communautés directement
concernées. Il s'agit d'accorder à l'expérience des habitants une légitimité et un poids dans les
décisions collectives (l'installation d'un incinérateur, par exemple), ainsi que dans les techniques de
prévention ou la réparation d'un dommage environnemental. Cette intervention de la parole de
l’habitant est importante dans la mesure où elle intègre souvent un paramètre esthétique à ce qu’elle
décrit et promeut. Ce qui n’est pas visible ou palpable pour l’expert l’est pour l’habitant qui
fréquente un quartier quotidiennement, et est habilité à en saisir les nuances qualitatives. Cette prise
de pouvoir prend donc consistance en réaction à deux phénomènes. Le premier est celui, cinglant,
de la détérioration d'un quartier ou d'un milieu de vie qui s'impose à ses habitants comme une
207 « Many African environmentalists define ourselves by our concern for the urban environment. We have vigourously attacked white environmentalists for their concern with saving birds and forests and whales, while urban children were suffering from lead paint poisoning. »Paul Ruffins, cité par Giovanna Di Chiro, art.cit.
208 Ce constat fait écho à celui que formule Guattari dans Les Trois écologies : « Non seulement les espèces disparaissent mais les mots, les phrases, les gestes de la solidarité humaine » in Félix Guattari, Les Trois écologies, p.35.
94
situation intolérable exigeant des réponses concrètes. Ici, la manifestation esthétique de la
détérioration environnementale est importante, en ce qu’elle contribue à rendre une situation
immédiatement désagréable, répulsive, hostile, et appelant des entreprises de réparation. Le second
phénomène est celui de l'indifférence des associations de défense de l'environnement qui renforcent
l'idée que la vie urbaine, son lot d'entités humaines et non-humaines, n'est pas digne de
considération au regard de ce qu'est l'écologie. Il s'agit d'ouvrir une troisième voie qui ne sépare pas
artificiellement les problématiques environnementales et les problématiques d'habitation,
l'écologique et le social, le naturel et l'urbain. En se regroupant, en échangeant entre membres d'une
même communauté, mais aussi entre personnes de différents horizons209, en connectant des points
de vue situés et incarnés au sein d’un patchwork commun, les habitants réunis autour d'un même
préjudice environnemental ont permis de renouveler non seulement la conception traditionnelle de
l'écologie, mais aussi celle de la communauté et de l'environnement : « les militants de la justice
environnementale définissent l'environnement comme ‘le lieu où vous travaillez, le lieu où vous
vivez, le lieu où vous jouez.’210 » Cette définition bouscule les postures surplombantes qui
caractérisent usuellement la gestion de la ville. Comme l'écrit Nathalie Blanc :
C'est ainsi que le jugement de l'expert, seul légitime dans l'espace public, se trouve mis à mal et
que d'autres types de jugements interviennent ; ils sont nés de la pratique des lieux, de la
reconnaissance de ce qui fait un lieu, non pas une donnée objective, mais un espace de vie.211
De fait, l'approche de la justice environnementale permet non seulement de résister aux processus
systémiques d’oppression, mais aussi de valoriser la texture esthétique des milieux dégradés, la
singularité du vécu des habitants, leur attention à des détails que les experts ne prennent pas en
compte.
Les dégradations frappent parfois un environnement majoritairement naturel, comme
c'est le cas lors d'une marée noire. Mais le littoral est rarement dénué de présence humaine, il est au
contraire intégré aux réseaux des communautés humaines qui le bordent, sillonné par des
promeneurs, des pêcheurs, des naturalistes etc. Lorsqu’un tel milieu est frappé de plein fouet par la
pollution, les habitants sont parmi les premiers à réagir. Cet environnement est celui qu'ils
reconnaissent comme leur habitat, et auquel ils confèrent un certain nombre de valeurs
209 « This sentiment is reflected in remarks made by Robin Cannon during the battle against LANCER, when Concerned Citizens was joined by other women activists from different racial and class background all across Los Angeles :'I didn't know we all had so many things in common... Millions of people had something in common with us... the environment. » in Giovanna Di Chiro, art.cit.
210 « Environmental justice activist define environment as « the place you work, the place you live, the place you play » in Giovanna Di Chiro, art.cit.
211 Nathalie Blanc, Vers une esthétique environnementale, op.cit., p.41.
95
symboliques, affectives et collectives. La détérioration de cet habitat, outre le préjudice
environnemental qu'il entraîne, se manifeste à travers un choc esthétique. Dans le cadre des marées
noires, les habitants confrontés à la violence de la pollution pétrolière expriment souvent leur
expérience sur un mode esthétique. Cette expérience est décrite comme un choc, un traumatisme lié
à des images, des odeurs, des ruptures de l'équilibre esthétique habituel. Le 12 décembre 1999, un
pétrolier – l'Erika – fait naufrage au large des côtes bretonnes et cause ce qui restera dans les
mémoires locales comme une des pires catastrophes environnementales de l'histoire de la Bretagne.
Les témoignages des habitants et des bénévoles sont marqués par le recours fréquent aux images et
aux métaphores pour exprimer leur expérience de la marée noire. Un bénévole relate :
C'était la première fois que je n'entendais pas la mer. Je suis allé sur la côte sauvage, à Donnant,
tout seul au petit matin. Il y avait une drôle d'odeur. J'ai été le premier à ramasser un oiseau
mazouté. C'était un guillemot. Je l'ai mis sur le bord d'une poubelle. Ce jour-là, 748 oiseaux ont
été ramassés.212
La nappe de pétrole bouleverse l'expérience sensible que les habitants font de leur milieu. Anaïs
Lelièvre, une artiste plasticienne qui travaille sur le traumatisme lié à la marée noire, explique ainsi
que ses entretiens avec les habitants qui ont été témoins de la catastrophe sont marqués par des
thèmes esthétiques récurrents213. Ces thèmes montrent que les habitants ont une expérience
immersive et multisensorielle de leur environnement ; ils évoquent à la fois l'ouïe (« Le silence !
Pendant une semaine, on n’a pas entendu une seule mouette. Jamais je n’avais vécu un tel silence au
Croisic »), la vue (« c'était tout noir ! », « tout ce noir », « c'était noir partout... »), mais aussi les
odeurs âcres qui défigurent totalement l'expérience habituelle qui est faite du littoral. La marée
noire constitue l'exemple d'une détérioration environnementale qui implique directement les
populations locales par la manifestation esthétique d'une rupture bouleversant le rapport des
habitants à leur milieu. Cette rupture est d'autant plus forte que les populations locales possèdent
une connaissance intime de leur milieu et de ses variations, elles sont liées à lui sur un mode à la
fois pratique et affectif. La détérioration brutale du littoral qui constituait pour des milliers
d'habitants un milieu de vie quotidien, a corrélativement entraîné une implication de ces habitants
dans la réparation du préjudice environnemental : de longs mois de nettoyage, de filtrage, de
grattage ont été nécessaires pour faire retrouver aux plages et aux criques une partie de leur
équilibre écologique, mais aussi de leur intégrité esthétique. Ce que nous pouvons décrire comme
212 Michel Le Hébel, Erika, la colère intacte des bénévoles, La Bretagne.com [en ligne], <http://www.bretagne.com/fr/culture_bretonne/histoire_de_bretagne/histoire_contemporaine/erika/colere_des_benevoles>213 Anaïs Lelièvre, Autour de la marée noire, <http://www.anaislelievre.com/words.html>
96
des attitudes de soin, de care, s'articule donc ici à des réactions esthétiques manifestes.
Plusieurs éléments importants sont ici à noter. Tout d'abord, la détérioration de
l'environnement n'est pas une catastrophe qui plane indistinctement sur l'avenir de l'humanité, mais
un processus graduel déjà enclenché qui affecte quotidiennement des millions d'êtres humains et
non-humains vulnérables. Or, il apparaît que les outils de gestion traditionnels du péril
environnemental (institutions, associations de défense de l'environnement) peinent à appréhender
l'interpénétration du naturel et de l'humain, ainsi que la façon dont les problématiques sociales et
urbaines s'articulent aux détériorations environnementales. En réponse à ce défaut, les
communautés directement affectées par ces détériorations ont décidé de prendre la parole et le
pouvoir sur la gestion de leur milieu de vie. Leur expérience, souvent négligée par les experts,
devient un outil de réappropriation collective des problématiques environnementales locales. Cette
prise de pouvoir réhabilite en outre la dimension esthétique de l'habitation, difficilement
objectivable, que les acteurs publics ont jusqu'à présent tendu à expulser des débats. En refusant de
faire de l'environnement un objet neutre laissé à l'appréciation des experts, les communautés locales
contribuent à réinventer le sens de l'écologie et replacent cette dernière à l'intersection d'enjeux
sociaux, environnementaux et esthétiques. Elles permettent également de voir en quoi les attitudes
de souci et de soin constituent une réponse pertinente à la dégradation écologique. La fréquentation
d'un lieu familier, la connaissance intime que l'on en retire, la sensibilité aux changements qui
l'affectent sont autant de facteurs qui invitent les habitants à entreprendre des actions réparatrices et
à donner corps à un véritable care environnemental. Il convient à présent de voir le type d'actions et
d'engagement qui succède à de telles réparations. Si la réparation constitue avant tout la réaction à
un dommage commis, peut-on peut penser une écologie urbaine qui soit par la suite positive et
créatrice ?
d) Réinventer et recréer : le jardin urbain comme figure de réappropriation esthétique et politique.
Nous venons de voir que la crise écologique appelle, en plus des décisions
institutionnelles et macro-politiques, une prise en charge localisée et démocratique des
détériorations environnementales. Cette prise en charge est le fait de communautés le plus souvent
marginalisées (immigrés, femmes, chômeurs...) qui opèrent en tenant compte des dimensions
sociales mais aussi affectives et esthétiques de leur milieu. Il s'agit, dans la majorité des cas, de
réagir et de résister à une détérioration de l'environnement ou de réparer et de soigner ce qui a été
97
détérioré. Mais l'action des populations locales sur leur milieu de vie n'est pas purement réactive,
elle est aussi créative. C'est ce que Giovanna di Chiro met en évidence lorsqu'elle décrit le
mouvement de la justice environnementale aux États-Unis. Lorsque Robin Cannon rassemble les
habitants de South Central pour s'opposer au projet d'incinérateur d'ordures, elle ne fédère pas un
simple mécontentement citoyen destiné à disparaître une fois le projet abandonné. Il s'agit au
contraire de convertir cette résistance en une entreprise de réappropriation collective de la vie du
quartier et, plus largement, de réinventer une nouvelle façon de penser le rapport entre les humains,
la ville et la nature.
Attendu qu'aux États-Unis l'immense majorité des communautés afro-américaines, latinos et
asiatiques est urbanisée, le problème de la ville « durable » constitue une des premières
préoccupations des militants de la justice environnementale. En conséquence, une autre
réinvention majeure de la nature sur laquelle ces militants insistent est celle de la relation entre
la ville et la nature.214
En somme, il ne s'agit pas de s'opposer sporadiquement aux nuisances environnementales
occasionnées par l'industrie ou le trafic, mais de repenser à la racine la façon dont nous vivons la
ville, la place de la nature dans cette dernière, le rôle des communautés locales dans sa gestion etc.
Il convient donc de distinguer la justice environnementale comme réponse située aux détériorations
environnementales inscrite dans un projet de refonte des modes d'habitation, et l'effet NIMBY (Not
in my back yard, littéralement, « pas dans mon arrière-cour ») souvent assimilé à des actions
purement réactives et individualistes. Giovanna Di Chiro montre au contraire que le courant de la
justice environnementale possède une dimension positive et non simplement réactive. Il s'agit, au-
delà de la lutte contre les pollutions, de penser collectivement une nouvelle façon d'habiter le
monde. Cette démarche ne peut se dispenser d'une véritable réflexion sur la ville, attendu qu'une
majorité des hommes évolue aujourd'hui dans un contexte urbain. Malheureusement, la ville est
encore considérée comme l'antithèse de la nature, elle incarne le revers embarrassant d'une écologie
majoritairement dévouée à la protection des derniers lots de nature intacte. Comment l'intégrer
positivement à une conception transversale de l'écologie ?
Ces questions impliquent de penser une nouvelle répartition, un nouveau partage entre
le naturel et l'urbain, entre l'humain et le non humain. Une telle démarche est rendue nécessaire,
nous l'avons vu, par les faiblesses du partage actuel qui est à la fois non-démocratique,
214 « Because the overwhelming majority of African American, Latino, and Asian American communities in the United States are urbanized, the predicament of the « sustainable » city becomes one of the primary concerns of environmental justice activists. Consequently another one of the essential reinventions of nature that environmental justice activists highlights is the relationship of nature to the city. » in Giovanna Di Chiro, art.cit.
98
écologiquement nocif et inapte à saisir la texture affective de l'expérience habitante. Dans son
ouvrage consacré à l'esthétique environnementale, Nathalie Blanc s'attache à décrire la place qui est
accordée à la nature en ville, et la dimension esthétique qui est lui est reconnue par les pouvoirs
publics. Le constat qu'elle formule est explicite : les éléments naturels sont insérés dans la ville à
titre décoratif et peinent à se convertir en lieu de convivialité collective et à susciter une véritable
rencontre entre l'humain et le non-humain. La perception du non-humain en ville est encore
largement tributaire d'une conception de l'urbanisme qui réduit l'habitant à un « être urbain type »215,
porteurs de besoins universels et neutres. L'individu singulier, constitué par un faisceau
d'attachements affectifs irréductibles, se trouve enfoui sous une typologie abstraite de l'habitant et
de l'humain. Elle cite cette réflexion emblématique du Corbusier:
Rechercher l'échelle humaine, la fonction humaine, c'est définir les besoins humains. Ils sont
peu nombreux ; ils sont très identiques entre tous les hommes, les hommes étant tous faits sur le
même moule depuis les époques les plus lointaines que nous connaissons.216
La nature s'insère alors dans la ville sous l'avatar de « l'espace vert », intervalle végétal qui aère la
ville et scinde les blocs d'immeubles. Nathalie blanc oppose cette figure aseptisée de la nature en
ville à la notion de jardin urbain, foyer d'activités collectives et de soin du non-humain. Si
« L'espace vert n'est pas un lieu, mais une portion de territoire indifférencié dont les limites se
décident sur l'univers abstrait du plan, 217 » comment quitter cette configuration désincarnée pour
aboutir à celle du jardin urbain comme foyer de rencontres et de créativité ?
L’agriculture urbaine et sa figure emblématique, le jardin communautaire, semblent
constituer une réponse pertinente à ces interrogations. Elle incarne un exemple limpide de la triple
écologie – à la fois sociale, environnementale et psychique – que Guattari appelait de ses vœux.
L’agriculture urbaine répond en effet à un besoin alimentaire de base, elle implique en cela des
bénéfices sociaux et économiques certains pour les personnes concernées. Elle contribue également
à cultiver des réserves de biodiversité et des couloirs de circulation pour les espèces végétales et
animales au sein même de la ville, ce qui atteste de son utilité environnementale. Enfin, elle crée de
nouvelles formes d'expérience esthétique et de nouveaux modes de relation au non-humain qui
affectent et modèlent la subjectivité des individus qu’elle implique. L’agriculture urbaine est donc
sociale dans la mesure où elle est souvent à l'initiative de groupes marginalisés qui s’approprient
collectivement les enjeux liés à leur milieu et parfois à la détérioration de ce dernier ; et elle est
215 Nathalie Blanc, Vers une esthétique environnementale, op.cit., p.51.216 Le Corbusier, cité par Nathalie Blanc in Nathalie Blanc, Ibid.217 Denise et Jean-Pierre Le Dantec, cités par Nathalie Blanc, op.cit., p.87.
99
esthétique parce que l'insertion dans le théâtre urbain d'interstices végétalisés tels que les jardins
communautaires permet de créer une nouvelle expérience sensible de la ville. Ainsi que l'exprime
Nathalie Blanc, « Paysages, récits, ambiances sont des cadres d'expérience de la nature qui
traduisent, mettent en scène, dramatisent une idée du 'vivre ensemble' qui se propage sur le mode
sensible, incarné.218 » Nous retrouvons ici la dimension collective de l'esthétique comme liant d'une
communauté que soulignait Dewey. Comment se manifeste concrètement cette « mise en scène » du
vivre-ensemble, et comment passe-t-elle par une « mise en politique » de l'espace commun ? Les
exemples à même d'illustrer ce double mouvement sont nombreux et il n'est pas possible de tous les
citer ici. On peut en revanche observer la façon dont opèrent certaines réappropriations
emblématiques. Dans son ouvrage sur l'environnementalisme civique, William Shutkin consacre
plusieurs chapitres à l'étude détaillée de cas de figure représentatifs de ce mouvement. L'exemple de
Roxbury, une agglomération pauvre de la banlieue de Boston, est intéressant à plusieurs titres.
Roxbury est une commune ancienne du Massachusetts ; fondée en 1630, elle a été progressivement
absorbée par la ville de Boston. La commune qui à l'origine attirait les Bostoniens blancs de classe
moyenne pour son calme et sa tranquillité, se mua au fil des décennies en une zone désaffectée.
Dans le quartier de Dudley, la population noire passa de 5% à 50% entre les années 50 et les années
90, à quoi s'ajouta une vague d'immigration Cap-Verdienne au milieu des années 60. Ce phénomène
acheva de faire fuir les derniers blancs installés à Roxbury et la commune se retrouva dans une
situation de dépérissement économique et de détérioration environnementale criante. En 1985, après
plusieurs vaines tentatives de revitalisation du quartier, la DSNI (Dudley Street Neighborhood
Initiative) est créée et se donne pour objectif de réparer l'environnement du quartier (prise en charge
des brownfields, nettoyage des graffitis, prévention des déversements illégaux d'ordures), mais aussi
de recréer un lien fort et positif entre les membres du voisinage autour d'un projet commun. Avec
près d'un quart des terrains en friche et une forte culture agraire chez beaucoup d'immigrés présents
dans le quartier, l'idée de faire du quartier une sorte de « village urbain » se fait jour.
L'agriculture urbaine apparu au fil des séances comme une stratégie clef dans l'effort pour
restaurer non seulement une économie locale saine et dynamique, mais aussi un environnement
propre et de qualité, les deux étant centraux au projet de village urbain de la DSNI.219
L'agriculture urbaine ou «urbagriculture » donne corps à une écologie qui conjugue les dimensions
environnementales, sociales et esthétiques de l'habitation. Cette écologie implique une réparation et 218 Nathalie Blanc, op.cit., p.25.219 « Urban agriculture emerged from the visioning sessions as a key strategy in the effort to restore not only healthy,
vibrant local economy but a clean, high-quality environment, each central to DSNI's urban village. » in William A. Shutkin, op.cit., p.155.
100
un soin de l'environnement urbain, qui se manifeste à travers le nettoyage – lors que cela est pos-
sible – des friches industrielles toxiques et la prévention des pollutions avec le concours des habi-
tants eux-mêmes220. Elle est également sociale en ceci qu'elle implique la participation de commu-
nautés vulnérables ainsi que la valorisation de leur savoir-faire propre221 ; enfin, elle est esthétique
dans la mesure où elle réinvente l'expérience sensible de la ville par la création de nouvelles formes
urbaines (jardins, serres, vergers...). La dimension esthétique de l’expérience du jardinage est évo-
quée de façon récurrente dans les enquêtes réalisées à ce sujet, elle constitue d’ailleurs un ressort
important des recherches consacrées aux bénéfices psychologiques des jardins communautaires. Les
personnes interrogées évoquent souvent la douceur de l’air qui atténue l’âcreté de la pollution, le
chant des oiseaux qui remplace le bourdonnement du trafic, en somme, l’apparition de nouveaux
traits esthétiques qui enrichissent et améliorent leur expérience quotidienne. La beauté du jardin
communautaire apparaît également comme un facteur collectif, dont les jardiniers apprécient de
parler en groupe et qu’ils aiment partager avec des personnes extérieures au jardin. Il est ici impor-
tant de noter que la valeur esthétique du jardin urbain n’est pas une mono-valeur, pour reprendre
l’expression d’Arnold Berleant, mais elle s’articule au contraire à une multiplicité de valeurs hétéro-
gènes qui agissent en synergie : la gratification esthétique recoupe le gain alimentaire, lequel im-
plique un enrichissement cognitif à travers la meilleure compréhension des cycles naturels, enfin
elle se développe autour d’une dynamique collective qui renforce et enrichit les liens entre les per-
sonnes du quartier. Un collectif de sociologues et de psychologues qui a interrogé une multiplicité
de personnes engagées dans l’agriculture urbaine décrit le jardin communautaire comme « un es-
pace dans lequel les processus biophysiques et socio-émotionnels se développent main dans la
main 222». Un jardinier résume ainsi : « ça vous donne en quelque sorte, enfin, ça vous rappelle la
nature cyclique des choses, et que vous êtes une partie de tout ça, vous n’en êtes pas séparés.», un
autre évoque la sensation d’être « co-créateur » du monde, soulignant le caractère relationnel et sur-
tout réciproque du jardinage (« it nurtures me as much as I nurture it »).
L’exemple de l’agriculture urbaine que nous venons de développer est riche à
plusieurs titres. Tout d’abord, il constitue une incarnation accomplie de la triple écologie que
Guattari a conceptualisée, et qui nous invite à quitter le « single-value thinking » pour replacer
220 À Roxbury, la DSNI a mis en place un numéro à appeler en cas de déversions illégales de déchets, le 725-DUMP. William A. Shutkin, op.cit., p.148.
221 Giovanna Di Chiro évoque dans son article la relation spécifique de la communauté dominicaine à la nature. Ainsi, les revendications de la Croton Community Coalition, dans le Bronx, débouchent sur le défrichage et la mise en culture de lots immobiliers inexploités. Cette mise en culture permet la recréation d'un contexte agraire proche de la Cibao que connurent beaucoup de dominicains installés dans le quartier (culture de tomates, ail, haricots).
222 « For many, it is a space where biophysical and socio-emotional processes develop hand in hand with being around others in the garden. », James Hale et al. « Connecting food environments and health through the relational nature of aesthetics: Gaining insight through the community gardening experience », Social Science and Medicine, vol.72, 2011.
101
l’écologie à la confluence de trois enjeux : les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux et les
enjeux subjectifs. Les jardins communautaires illustrent richement cette polyvalence puisqu’ils
créent une réponse à la vulnérabilité économique de certaines populations urbaines marginalisées et
ménagent dans le même temps les conditions nécessaires à un épanouissement et à un renforcement
des interactions sociales. Les bénéfices sont également environnementaux dans la mesure où la mise
en culture de lots immobiliers gelés, de toitures, de bordures, de friches, compose un réseau de
bulles écologiques favorables à la biodiversité, et que le fait de produire la nourriture localement
épargne des pratiques écologiquement nocives. Enfin, le jardin urbain joue un rôle majeur dans la
dynamisation du pan subjectif de l’écologie, au sein duquel il est possible de placer l’esthétique
environnementale. Le jardin urbain transforme l’expérience esthétique que les habitants font de leur
milieu de vie, il subvertit les formes traditionnelles de l’espace urbain et crée de nouvelles
atmosphères et de nouvelles façons d’expérimenter la ville. Cette transformation est réciproque et
plurilatérale, puisque les individus modifient leur environnement par un certain travail, et se
trouvent en retour modifié par lui. Ainsi, le jardin urbain suscite des expériences esthétiques qui
cultivent une sensibilité, renforcent un réseau d’affects et entretiennent une disposition au souci
pour l’environnement. L’exemple de l’agriculture urbaine illustre donc avec clarté la notion de
pratique esthétique connectée à des pratiques sociales et écologiques.
Les études de cas que nous venons de mener, sur les attitudes de réparation et de soin
en réponse à la pollution d’une part, et sur les jardins communautaires d’autre part, permettent
d’enrichir notre compréhension de l’esthétique environnementale et des liens que cette dernière
entretient avec les enjeux plus larges de l’écologie. Il apparaît tout d’abord, à la lumière des
déplacements conceptuels introduits par le pragmatisme de Dewey, que l’expérience esthétique est
une expérience active et engagée. A ce titre, nous avons tenu à étudier les pratiques esthétiques qui
peuvent informer notre rapport à l’environnement de façon concrète et située. Une des faiblesses de
l’esthétique environnementale telle qu’elle a été théorisée par les cognitivistes a précisément été de
minorer ces pratiques. Comme l’écrit Jennifer Foster :
Carlson sous-estime le rôle que joue l’engagement esthétique pour donner du sens à la vie des
gens et inspirer des actions, mais aussi le potentiel de combinaison entre l’engagement et les
approches cognitives afin d’apprécier le rôle complexe que joue l’esthétique dans la médiation
des relations humain/nature.223
223 Jennifer Foster, « Environmental aesthetics, ecological action and social justice », in Liz Bondi, Laura Cameron, Joyce Davidson and Mick Smith (eds), Emotion, Place and Culture, Ashgate Press, Aldershot, 2009.
102
Foster souligne ici le manque de crédit accordé par les cognitivistes à la réalité de l’expérience
esthétique telle qu’elle est menée et vécue par les individus dans le cours de leur vie ordinaire. Cette
faiblesse les amène à considérer l’expérience esthétique hors de son contexte d’émergence, et ils
peinent en conséquence à articuler l’esthétique à des pratiques socialement signifiantes et
écologiquement riches. A l’inverse, une approche plus située permet de réinscrire l’esthétique dans
la perspective des enjeux pratiques, politiques, sociaux, et subjectifs de l’écologie. Nous avons par
exemple vu que la façon dont les humains répondent à la pollution de leur environnement gagne à
être éclairée par l’étude de leurs réactions esthétiques, et inversement, l’esthétique
environnementale s’enrichit d’études de cas contextualisées qui lui permettent d’affiner et d’ajuster
ses ambitions théoriques. De la même façon, appréhender le phénomène majeur de l’écologie
urbaine que sont les jardins communautaires permet de préciser l'importance de l’expérience
esthétique dans la relation à ces jardins, son utilité sociale ainsi que la fonction qu’elle peut être
amenée à assumer dans le développement de l’agriculture urbaine. Cette approche, moins normative
et verticale que celle des cognitivistes, ne rejette pas pour autant l’importance de la connaissance
scientifique dans l’orientation de l’expérience esthétique. Comme l’indique justement Forster,
« combiner l’engagement et le cognitif permet de comprendre la façon dont la nature est à la fois
viscéralement sentie et apprise224 », en d'autres termes le cognitif est toujours en prise sur l’affectif,
nous ne percevons jamais les choses comme de purs effets esthétiques mais nous les enracinons
sans cesse dans un terreau de croyances qui les métabolisent et les orientent. A ce titre, la
connaissance du scientifique ou du naturaliste peut enrichir ce terreau, elle produit des points de
vue qui sont utiles aux individus en prise avec des problématiques environnementales et esthétiques.
Mais elle ne dispose en revanche d’aucun privilège a priori, sa légitimité et son utilité se
déterminant toujours à l’aune des situations concrètes qui articulent des valeurs esthétiques, sociales
et environnementales. Le scientifique peut s’avérer insensible à la dégradation de certaines
ambiances urbaines, auxquelles seront beaucoup plus réceptifs les habitants. Inversement,
l’entomologiste peut créer un point de vue sur les insectes à travers lequel une gratification
esthétique peut naître chez ceux qui n’y étaient pas initialement sensibles. Cette contextualisation
du rôle de la science est parfaitement illustrée par cette remarque d'Aldo Leopold :
N'en concluons pas hâtivement que Babbitt doit soutenir un doctorat en écologie avant de
pouvoir « voir » son pays. Au contraire, le docteur peut devenir aussi insensible qu'un
entrepreneur de pompes funèbres aux mystères de son office. (…) Les mauvaises herbes d'un
224 « Combining the engagement and cognitive yields an understanding of how natures are both viscerally felt and learned (...) » Ibid.
103
lotissement urbain sont porteuses du même enseignement que les séquoias ; un fermier peut
découvrir dans son pré ce qu'il ne sera pas accordé de voir au scientifique parti en expédition
dans les mers du sud.225
A une échelle institutionnelle, l’expertise scientifique peut guider les politiques de conservation du
paysage, mais cette expertise ne doit pas couvrir la voix des personnes qui vivent et interagissent
quotidiennement avec ce paysage. L’appréhension non-cognitive de l’esthétique environnementale,
lorsqu’on la connecte à des exemples concrets, amène donc moins à nier la pertinence du critère
scientifique, qu’à le réinsérer dans le patchwork polyphonique des voix engagées dans l’expérience
de l’environnement.
Ce développement nous a également permis de mettre en lumière la double politicité
de l’expérience esthétique. Nous avions en effet déterminé que l’expérience esthétique pouvait jouer
un rôle à la fois consensuel et dissensuel dans la gestion de la vie collective. Elle peut être
consensuelle en ceci qu’elle renforce les liens sociaux et crée un commun esthétique auquel se
réfèrent les membres de la communauté ; c’est ce que manifeste l’expérience collective qui est faite
des jardins urbains, les jardiniers démontrant un intérêt certain pour le partage et la diffusion des
qualités esthétiques de leur parcelle. Mais elle peut également être dissensuelle, en ce qu’elle crée
des zones subversives dans la répartition orthodoxe de l’espace urbain. La performance artistique, le
jardin urbain, peuvent constituer des figures de contestation du partage du sensible qu'évoque
Rancière, et suscitent des fronts de reconquête démocratique du traitement de l'écologie urbaine.
225 Aldo Leopold, op.cit., p.222.
104
CONCLUSION
Choisir d'appréhender la crise écologique depuis la dimension esthétique de notre expérience
du monde est à la fois périlleux et nécessaire. Cette entreprise est périlleuse dans la mesure où, nous
l'avons montré, les associations courantes qui sont faites entre la beauté de la nature et l'injonction à
la protéger procèdent de mécanismes superficiels peu enclins à susciter un véritable souci éthique
pour le non-humain. De plus, la quête de gratifications esthétiques se fait parfois au détriment de
l'intégrité environnementale, et les cas de conflits explicites entre attentes esthétiques et intérêt
écologique sont nombreux. Il convient donc d'aborder la dimension esthétique de notre expérience
avec précaution, sans préjuger de sa valeur et de son rôle dans la résolution des problématiques
environnementales. Mais si l'étude des connexions entre esthétique et écologie est périlleuse, elle
est également rendue nécessaire par l'omniprésence des émotions esthétiques dans notre rapport à
l'environnement. Ce constat a été richement développé par les penseurs de l'esthétique
environnementale, et appelle plusieurs réponses. Tout d'abord, si nous réagissons esthétiquement à
notre environnement, si ses qualités sensibles nous affectent et orientent nos pratiques, nous devons
en conséquence être capables de prendre en considération ce pan de notre expérience dans l'analyse
des problématiques environnementales. Le premier argument en faveur d'une lecture esthétique des
enjeux de l'écologie consiste donc à reconnaître l'omniprésence du fait esthétique dans nos vies. Il
s'agit alors de voir comment cette omniprésence doit être traitée. Chez les tenants d'une esthétique
cognitiviste, elle apparaît comme un donné incompressible qui doit être canalisé et éduqué, sous
peine de déboucher sur des attitudes écologiquement nocives. Puisque la relation à notre
environnement possède irrémédiablement une dimension esthétique, alors il convient non pas de
rejeter cette dimension sous prétexte de sa partialité, mais de l'intégrer à une éthique de
l'environnement scientifiquement informée. Cette première modalité de connexion entre l'esthétique
et les enjeux éthiques de l'écologie semble appréhender l'esthétique comme une région par nature
extérieure aux enjeux éthiques et pratiques de l'écologie, appelant des stratégies d'objectivation. A
l'inverse, il est possible de considérer l'expérience esthétique comme intimement connectée à une
sensibilité relationnelle, et comme un régime d'expérience dans lequel nous sommes amenés à
considérer le monde qui nous entoure dans son altérité et sa connectivité fondamentale. Cette
105
approche, principalement portée par les tenants d'une esthétique non-cognitive, insiste sur les
dispositions éthiques que l'expérience esthétique développe chez ceux qui la vivent. Si ces deux
approches semblent s'opposer explicitement, l'une se basant d'avantage sur une instrumentalisation
raisonnée de l'émotion esthétique, l'autre insistant sur le caractère éthique de l'expérience esthétique
elle-même ; il n'est pas satisfaisant de les opposer binairement.
En effet, les approches cognitivistes et non-cognitives se construisent sur des postulats qui
sont majoritairement compatibles et complémentaires. Le point commun le plus important consiste
en un abandon commun du formalisme : l'expérience esthétique n'est jamais l'expérience de la pure
forme sensible, mais émerge toujours d'un substrat cognitif déterminé. La façon dont nous jouissons
esthétiquement d'un objet dépend donc majoritairement de ce que nous savons de cet objet, de ce
que nous projetons sur lui, et des connotations que la société lui assigne. Ce postulat constitue un
dénominateur commun des positions cognitivistes et non-cognitives. Les deux s'accordent en effet à
distinguer des expériences esthétiques thin, superficielles, concentrées autour du seul plaisir
sensoriel ; et les expériences thick, profondes et enrichies par un contenu cognitif : croyances,
souvenirs, attentes, visées pratiques, etc. Pour Arnold Berleant comme pour Allen Carlson,
l'expérience esthétique n'est donc pas réductible à un plaisir sensible, et nous devons prendre en
considération les paramètres qui l'enrichissent et la complexifient. Si l'expérience esthétique est
toujours parcourue de croyances, c'est la nature de ces croyances qui divise les penseurs de
l'esthétique environnementale. Pour les cognitivistes, elle doit parvenir au statut de croyance
justifiée (justified belief), par le truchement des sciences naturelles, tandis que pour les partisans
d'une esthétique non-cognitive, la science ne dispose d'aucun privilège dans l'établissement d'un
paradigme esthético-éthique. Ce dernier prend consistance à la croisée de points de vue hétérogènes
et situés qui informent chacun une problématique esthétique et environnementale concrète.
L'importance des connaissances et des croyances dans le déploiement de l'expérience esthétique est
donc maintenue, mais n'opère pas de manière verticale et dogmatiste, elle s'accomplit plutôt par la
mise en réseau horizontale et critique des points de vue esthétiques. A ce titre, il est important de
noter que l'esthétique non-cognitive est explicitement plus inclusive que l'esthétique cognitiviste.
Cette dernière en effet rejette explicitement les connaissances « non-scientifiques », tandis que la
première intègre la science à la polyphonie des voix engagées dans l'écologie. Certains penseurs de
l'esthétique environnementale comme Noël Carroll226 soulignent d'ailleurs que les positions
cognitivistes et non-cognitives peuvent coexister de façon cohérente au sein de l'esthétique
environnementale, et se complètent plus qu'elles ne s'annulent. On peut en effet distinguer différents
niveau d'opérativité de l'esthétique environnementale. Les cognitivistes se sont par exemple 226 Cf. Noël Carroll, « On being moved by Nature : Between religion and natural history », in Salim Kemal and Ivan
Gaskell, Landscape, Natural Beauty and the Arts, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
106
majoritairement penchés sur l'expérience de la wilderness et sur la question de la conservation des
espaces sauvages. Ces espaces ayant souvent fait l'objet d'idéalisation politiques et touristiques
biaisées, il n'est pas absurde de soutenir que le recours à un cadre conceptuel scientifique
permettrait une meilleure gestion de leurs écosystèmes, ainsi qu'un moyen de se déprendre des
images d’Épinal qui leur sont à tort associées. Mais le risque est alors de confisquer la légitimité de
l'émotion esthétique aux habitants et de faire de l'expertise scientifique le monopole du bon usage
de l'esthétique. Comme le souligne Emily Brady, l'exclusivité du cognitivisme esthétique pose des
problèmes politiques et démocratiques :
Le point de vue des profanes est moins pris au sérieux et n'a de fait qu'un faible impact sur la
planification et les politiques du paysage. Leurs vues sont perçues comme des opinions
personnelles contrastant avec l'évidence scientifique ou économique offerte par des experts qui
sont supposés avec crédulité être pleinement objectifs dans leur approche. Ceci est regrettable
dans la mesure où les habitants et les visiteurs réguliers bénéficient souvent d'une saisie fiable et
solide de la valeur esthétique d'un lieu, basée sur une expérience qui s'est développée dans le
contexte d'un environnement dynamique, parfois sur plusieurs années.227
Si l'écologie se situe à la confluence d'enjeux environnementaux, sociaux et subjectifs, alors
l'esthétique ne saurait devenir le privilège d'une élite décisionnaire coupée de la réalité de
l'habitation d'un environnement. En ce sens, l'approche non-cognitive a le mérite de ne pas
reconduire un schéma de gestion politique vertical qui oppose l'expert au profane et renforce des
dualismes (objectivité scientiste / point de vue partial) dont nous avons montré la nocivité.
L'expérience esthétique du scientifique constitue un point de vue qui peut être partagé, mis en
commun, elle peut servir de levier de décentrement du regard ou d'outil de subversion d'une norme
esthétique superficielle. Mais elle ne saurait incarner une référence absolue en vertu de laquelle les
expériences du fermier, du citadin, du jardinier, du retraité ou du sportif pourraient être dévaluées. A
ce titre, son utilité et l'ampleur de son rôle doivent être déterminées et ajustées en fonction des
manifestations concrètes de la détérioration environnementale, qu'il s'agisse de la préservation
d'espaces sauvages, de la lutte contre la pollution dans les quartiers défavorisés, ou de la proposition
de réponses créatives à la place de la nature en ville.
Le détour par l'éthique écoféministe que nous avons entrepris en amont prend ici tout son
227« The view of non-experts are taken less seriously and so have little impact in planning and policy. Their views are perceived as personnal opinion and are contrasted with the scientific or economic evidence offered by experts who are uncritically assumed to be wholly objective in their approach. This is unfortunate given that inhabitant (where relevant) and frequent visitors often possess solid, reliable grasp of the aesthetic value of a place based on experience that has developed in the context of a dynamic environment and in some case over many years. » Emily Brady, op.cit., p.230.
107
sens. L'écoféminisme n'invite pas à destituer la science, puisque cette dernière peut parfaitement
s'intégrer à notre rapport à l'environnement ainsi qu'à la façon dont nous l'expérimentons
esthétiquement, s'ajoutant en cela à la somme des connaissances qui approfondissent et densifient
notre expérience. En revanche, la connaissance scientifique perd son primat et sa supériorité
hiérarchique, l'écoféminisme invitant à un double mouvement de réintégration : réintégration du
« gaze from nowhere » épistémologique et du « god's-eye view » esthétique à la particularité des
perspectives, réintégration de la voix scientifique au patchwork éthique à partir duquel il s'agit de
penser des réponses pratiques à des problématiques situées. Ça n'est donc pas l'association de
l'esthétique et du scientifique en tant que telle qui pose problème au regard des nouveaux éléments
que nous avons mis en lumière, mais c'est plutôt les motivations et les modalités de cette association
qui sont problématiques dans une perspective écoféministe. Les cognitivistes font de la science un
critère destiné à systématiser et à objectiver le rôle de l'expérience esthétique dans le respect d'un
devoir éthique, peinant à reconnaître le caractère situé et contextualisé de toute attitude éthique. Or,
en préjugeant de ce qui doit compter dans la résolution de problèmes environnementaux, les
cognitivistes reconduisent une conception dogmatique de l'éthique environnementale. A l'inverse,
l'écoféminisme invite à penser une éthique in process qui s'actualise dans des contextes particuliers
et s'ajuste à des problématiques concrètes.
Choisir d'aborder la crise écologique sous l'angle de l'expérience esthétique permet enfin
d'éclairer les inégalités sociales et les tensions politiques qui caractérisent la détérioration
environnementale. Dire que nous sommes sensibles aux qualités esthétiques de notre milieu de vie
implique de souligner que ces qualités sont inégalement réparties, que la laideur et la pollution
esthétique affectent majoritairement les populations marginalisées. Qui habite près des décharges,
des brownfields, des incinérateurs d'ordures ? Qui a accès aux paysages époustouflants du
Yosemite ? Qui subit des dégradations visuelles, sonores, olfactives de son milieu de vie ? Ces
questions amènent à approfondir l'esthétique environnementale en la contextualisant et en
reconnaissant les enjeux politiques dont elle est porteuse. Elle permet également de mettre en
lumière la façon dont la prise en charge des entités enlaidies, cassées ou salies constitue un mode
d'investissement écologique riche. L'expérience esthétique que les habitants font de leur
environnement direct se manifeste donc également à travers des pratiques, par lesquelles des entités
ou des zones endommagées sont réparées, nettoyées, soignées. Ces pratiques sont porteuses d'une
créativité collective riche qui amène à la formation de nouvelles expériences esthétiques, et à la
subversion des formes traditionnelles de l'espace habité. Au cours de notre enquête nous avons
insisté sur l'exemple de l'agriculture urbaine, mais il convient de noter que cet exemple appartient à
un faisceau plus large de pratiques qui lient l'esthétique à l'écologie. Parmi ces pratiques, il serait
108
pertinent d'accorder du crédit au rôle des actes artistiques dans le traitement des problématiques
écologiques en tant que problématiques d'habitation. L’œuvre d'art donne vie à des expériences
inédites, à une nouvelle façon d'expérimenter le monde. Ces expériences qui subvertissent l'ordre
des « évidences sensibles » que pointait Rancière, ouvrent des possibles et éclairent de nouvelles
manière de se rapporter au non-humain, de penser l'habitation du monde et le vivre-ensemble. De la
même façon que le jardin urbain renverse le rapport au végétal institué par l'espace vert en
privilégiant l'investissement et le contact sur le spectacle, l'affectif sur le décoratif ; l’œuvre d'art
permet quant à elle un renversement des formes conventionnelles de l'expérience. Ici non plus, il ne
s'agit pas de faire de l'esthétique le porte-voix d'une écologie superficielle, mais d'inventer de
nouveaux supports d'expérience, de nouveaux vecteurs de subjectivation ; en somme, de créer des
œuvres qui ménagent les conditions sous lesquelles un souci éthique pour le non-humain peut
naître.
Ces quelques exemples ne constituent qu'une esquisse des potentialités éthiques, politiques
et pratiques de l'expérience esthétique. Ils invitent à de plus amples enquêtes sur la façon dont
l'esthétique environnementale peut aider à la résolution des problématiques écologiques, informer
des activismes et constituer un réservoir d'alternatives créatives à la détérioration croissante des
environnements urbains. L'esthétique environnementale semble à ce titre constituer une incarnation
prometteuse des trois écologies convoquées par Guattari : elle connecte les enjeux subjectifs de
l'écologie à des pratiques socialement signifiantes, et favorise le développement d'un souci éthique
pour les entités non-humaines. L'importance de l'expérience esthétique dans la définition du
nouveau paradigme écologique semble donc manifeste, et doit pour cette raison même
s'accompagner d'une vigilance critique quant à son instrumentalisation. C'est précisément parce que
l'expérience esthétique ne débouche pas mécaniquement sur des attitudes éthiques que cette
association constitue à la fois un défi théorique et critique, et une tâche destinée à s'actualiser dans
des pratiques situées.
109
BIBLIOGRAPHIE
ABRAM David, The Spell of the Sensuous, Vintage Books, New York, 1997.
AFEISSA Hicham-Stéphane, Éthique de l'environnement, Nature, valeur, respect, Vrin, Paris, 2007.
BENHABIB Seyla, « The Generalized and the Concrete Other: The Kohlberg-Gilligan Controvers and Feminist Theory », Praxis international, N°4, 1985.
BERLEANT Arnold, The Aesthetics of Environment, Temple University Press, Philadelphia, 1992._______ Living in the Landscape : Toward an Aesthetics of Environment, University Press of Kansas, Lawrence, 1997.
BERQUE Augustin, Écoumène, introduction à l'étude des milieux humains, Éditions Belin, Paris, 1987.
BLANC Nathalie, Vers une esthétique environnementale, Éditions Quae, Versailles, 2008.
BONFIGLIOLI Chiara, « L'éco-féminisme, entre matérialisme et utopie », Congrès Marx International V, Section Études Féministes Atelier 5 : Mouvements féministes et mondialisation, oct. 2007.
BRADY Emily, Aesthetics of the Natural Environment, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 2003.
CARLSON Allen, Aesthetics and the Environment: The Appreciation of Nature, Art and Architecture, Routledge, 2005._______ and Lintott Sheila, Nature, Aesthetic Value and Environmentalism : From Beauty to Duty, Columbia University Press, 2008._______ « Appreciation and the natural environment », Journal of Aesthetics and Art Criticism, N°37, vol.3, 1979.
DE CERTEAU Michel, L'invention du quotidien, arts de faire [1980], Éditions Gallimard, Coll. Folio Essais, Paris, 1990.
DESCOLA Philippe, L'écologie des autres, l'anthropologie et la question de la nature, Éditions
111
Quae, Versailles, 2011.
DAHL E. Thomas, Wetlands Losses in the United States, 1780's to 1980's, U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, Washington, 1990.
DEWEY John, Le public et ses problèmes [1927], trad. Joëlle Zask, Gallimard, coll. Folio Essais, Paris, 2005. _______ L'art comme expérience [1934], trad. Jean-Pierre Cometti, Gallimard, coll. Folio Essais, Paris, 2005.
DEWIT Cary, « Women's Sense Of Place On The American High Plains », Great Plains Quarterly, Vol. 21, N° 1, Hiver 2001.
DI CHIRO Giovanna, « Nature as Community: The Convergence of Environment and Social Justice », in D. Faber, The Struggle for Environmental Democracy: Environmental Justice Movements in the United States, Guilford, New York, 1998.
EATON MUELDER Marcia, « Fact and Fiction in the Aesthetic Appreciation of Nature », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 56, N° 2.
_______ « The Beauty That Requires Health », in Joan Nassauer, Placing Nature: Culture and Landscape Ecology, Island Press, Washington, D.C, 1997
EVERNDEN Neil, « Beauty and Nothingness: Prairie as Failed Resource », Landscape 27, N°3, 1983.
FOSTER Jennifer, « Environmental Aesthetics, Ecological Action and Social Justice », in Liz Bondi, Laura Cameron, Joyce Davidson and Mick Smith (eds), Emotion, Place and Culture, Ashgate Press, Aldershot, 2009.
FOX Warwick, Ethics and the built environment, Taylor & Francis, 2002.
GANDY Matthew, « Marginalia : Aesthetics, Ecology, and Urban Wastelands », Annals of the Association of American Geographers, vol. 103, N°6, Nov. 2013.
GLAZEBROOK Trish, « Karen Warren's Ecofeminism », Ethics & the Environment, N°7, vol.2, 2002
GRIMSHAW Jean, Philosophy and feminist thinking, University of Minnesota Press, 1986.
GUATTARI Félix, Les trois écologies, Galilée, Paris, 1989.
112
_______ Chaosmose, Galilée, Paris, 1992._______ Le Capitalisme Mondial Intégré et la révolution moléculaire, contribution présentée aux
journées du CINEL - Centre d’Information sur les Nouveaux Espaces de Liberté, 1981.
HACHE Émilie, Ce à quoi nous tenons, Éditions La Découverte, Paris, 2011.
HALE James et al., « Connecting food environments and health through the relational nature of aesthetics: Gaining insight through the community gardening experience », Social Science and Medicine, vol.72, 2011.
HARRIS Daniel, Cute, Quaint, Hungry and Romantic, The Aesthetics of Consumerism, Da Capo Press, 2001.
HEPBURN Ronald, « Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty », Wonder and Other Essays, Edimburgh University Press, Edimburgh, 1984.
_______ « Aesthetic Appreciation of Nature » in H.Osborne, Aesthetics in the Modern World, Thames and Hudson, Londres, 1968.
HOPE NICOLSON Marjorie, Mountain Gloom and Mountain Glory : The Development of the Aesthetics of the Infinite, Cornell University Press, 1997.
JAMES William, Le Pragmatisme, trad. Nathalie Ferron, Flammarion, Paris, 2010.
KANT Emmanuel, Critique de la faculté de juger [1790], trad. A.J.L Delamarre et al., Éditions Gallimard, Paris, 1985._______ Réponse à la question :Qu'est-ce que les Lumières [1784], Éditions Gallimard, Paris,
1985._______ Le conflit des facultés [1798], trad. J. Gibelin Librairie philosophique Vrin, Paris, 2000.
KHEEL Marti, « From Heroic to Holistic Ethics : The Ecofeminist Challenge » in Greta Gaard, Ecofeminism : Women, Animals, Nature, Temple University Press, Philadelphia, 1993.
KING Roger J.H, « Caring about Nature, Feminist Ethics and the Environment », Hypatia, vol.6, N°1, 1991.
LAUGIER Sandra et PAPERMAN Patricia (dir.), Le souci des autres, éthique et politique du care, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, coll. Raisons pratiques, Paris, 2011._______ Tous vulnérables ? Le care, les animaux et l'environnement, Éditions Payot et Rivages,
Paris, 2012.
113
LEOPOLD Aldo, Almanach d'un comté des sables [1949], trad. Anna Gibson, Flammarion, 2000.
LIGHT Andrew, « Elegy for a Garden: Thoughts on an Urban Environmental Ethic », Philosophical
Writings, Vol.14, 2000.
MATTHEWS Patricia, « Scientific Knowledge and the Aesthetic Appreciation of Nature », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol.60, N°1, hiver 2002.
MERLEAU-PONTY Maurice, L’Œil et l'Esprit, Éditions Gallimard, Coll. Folio Essais, Paris, 1964.
MUIR John, Our National Parks, The Riverside Press, Cambridge, 1901. _______ My first summer in Sierra, The Riverside Press, Cambridge, 1911.
PLUMWOOD Val, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London, 1993.
PORTEOUS J. Douglas, Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, Routledge, Londres, 1996.
RANCIÈRE Jacques, Le partage du sensible, esthétique et politique, La Fabrique Éditions, Paris, 2000._______ Malaise dans l'esthétique, Galilée, Paris, 2004._______ « Conversations with Jacques Rancière », 2nd annual radical philosophies & education
seminars, Columbia University.
RECLUS Élisée, Histoire d'une montagne, Actes Sud, 1998.
HARAWAY Donna, « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial Perspective », Feminist Studies, vol. 14, N°3, automne 1988.
ROLSTON III Holmes, « Does Aesthetic Appreciation of Landscapes need to be Science Based ? », British Journal of Aesthetics, Vol. 35, N° 4, Oct.1995.
_______ Environmental Ethics, Temple University Press, Philadelphia, 1988._______« From Beauty to Duty, Aesthetics of Nature and Environmental Ethics » in Arnold Berleant, Environment and the Arts, Ashgate Pub Ltd, Hampshire, UK, 2002.
OUDERDIRK Wayne PRESTON J. Christopher (ed.), Nature, Value, Duty, Life on Earth with Holmes Rolston III, Springer, Dordrecht, 2007.
114
SAINT-GIRONS Baldine, L'acte esthétique, Klincksieck, coll. 50 questions, Paris, 2008.
SAITO Yuriko, Everyday Aesthetics, Oxford University Press, 2007._______ « The Aesthetics of Unscenic Nature », The Journal of Aesthetics and Art Criticism, N°52, vol.2, printemps 1998.
SANTAYANA George, The Sense of Beauty [1896], Project Gutemberg Ebook, 2008.
SHUTKIN William, The Land that could be, Environmentalism and Democracy in the Twenty-First Century, MIT Press, Cambridge, 2001.
SPELMAN Elizabeth, The impulse to restore a fragile world, Beacon Press, Boston, 2002.
TANGNEY Shaunanne, « But What is There to See? An Exploration of a Great Plains Aesthetic », Great Plains Quarterly, vol.24, 2004.
TRONTO Joan, Un monde vulnérable, pour une politique du care [1993], trad. H. Maury, La Découverte, 2009.
TUAN Yi-Fu, Topophilia, A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, Columbia University Press, New-York, 1990.
VILEISIS Ann, Discovering the Unknown Landscape, a History of America's Wetland, Island Press, Washington, 1999.
WARREN.J Karen, Ecological Feminist Philosophies, Indiana University Press, Bloomington, 1996._______« The Power and the Promise of Ecological Feminism », _______ and Jim Cheney, « Ecological Feminism and Ecosystem Ecology », Hypatia, vol.6, N°1,
printemps 1991._______ Ecofeminist Philosophy : A Western Perspective on What It Is and Why It Matters,
Rowman and Littlefield, New York, 2000.
WILSON O. Edward, « The Little Things that run the World », Conservation Biology, Vol. 1, N° 4, Dec. 1987.
Références internet :
115
LE HEBEL Michel, Erika, la colère intacte des bénévoles, La Bretagne.com, <http://www.bretagne.com/fr/culture_bretonne/histoire_de_bretagne/histoire_contemporaine/erika/colere_des_benevoles>.
LELIEVRE Anaïs, Autour de la marée noire, <http://www.anaislelievre.com/words.html>.
116