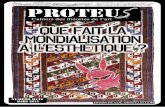L'Esthétique dialectique de Montesquieu
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of L'Esthétique dialectique de Montesquieu
L’esthétique dialectique de Montesquieu
Pierre Truchot*
Il suffi t de lire dans leur succession les titres des dix-neuf petits tex-tes qui composent l’Essai sur le goût pour voir des discontinuités dans la progression des analyses de Montesquieu. Aucune règle de construc-tion ne peut être induite de cette lecture ; il existe certes des suites « naturelles « logiques, mais les ruptures sont telles qu’il faut renoncer à chercher un plan préétabli. Un seul exemple suffi ra pour montrer cette discontinuité : après avoir parlé « De la curiosité » au troisième texte, Montesquieu passe immédiatement aux « Plaisirs de l’ordre », pour revenir quatre textes plus loin aux « Plaisirs de la surprise ». C’est pourtant à la section 4 de cet essai que Montesquieu affi rme que
dans un ouvrage où il n’y a point d’ordre , l’âme sent à chaque instant troubler celui qu’elle veut y mettre. La suite que l’auteur s’est faite, et celle que nous faisons, se confondent ; l’âme ne retient rien, ne prévoit rien ; elle est humiliée par la confusion de ses idées […] c’est pour cela que, quand le dessein n’est pas d’exprimer ou de montrer la confusion, on met toujours de l’ordre dans la confusion même1.
* Université d’Angoulême1. Essai sur le goût , Paris, éditions Payot & Rivages, 1994 (suivi d’un texte de
Jean Starobinski) ; ci-après, EG. Nous préférons citer cette édition qui est la plus récente et la plus facilement disponible. Le texte cité est extrait de la section « Des plaisirs de l’ordre », p. 19.
MEP montesquieu.indd 191MEP montesquieu.indd 191 21/05/07 14:13:2721/05/07 14:13:27
192 Écritures
Ce texte est ambigu, voire ironique, mais suffi samment clair pour le penser comme une invitation pour le lecteur à produire sa propre suite, précisément parce que l’ordre des textes de l’Essai sur le goût étant discontinu et donc confus, si l’âme du lecteur veut retenir quelque chose de l’ensemble de l’ouvrage et ne pas se retrouver humiliée par la possible confusion des idées , elle se doit alors de produire son propre ordre , sa propre suite. De surcroît, cette invitation à produire un ordre à partir de ce désordre apparent, nous la trouvons chez d’Alembert , lequel dans son Éloge de Montesquieu déclarait à propos de L’Esprit des lois : « Le désordre n’est qu’apparent, quand l’auteur, mettant à leur véritable place les idées dont il fait usage, laisse à suppléer aux lecteurs les idées intermédiaires »2. Mais comment produire cet ordre ?
La raison qui ordonne la suite que nous proposons est simple : offrir une succession des textes permettant de dégager les ferments d’une esthétique qui serait propre à la pensée de Montesquieu. Par suite, l’ordre que nous proposons suivra le plan suivant : tout d’abord, un regroupement et une analyse des textes traitant des règles (et de leurs limites) suscitées par l’objet d’art « réussi ». Ensuite, nous nous intéresserons aux textes dévoilant les retombées méthodologiques de cette esthétique. Nous insisterons enfi n sur les fi nalités qui justifi èrent l’intérêt de Montesquieu pour l’art et le déterminèrent à fonder une esthétique originale dont l’intérêt est loin d’être épuisé.
Une esthétique dialectique : les « règles » suscitées par l’objet d’art
Pourquoi l’Essai sur le goût recèle bien les fondements d’une esthétique : le statut privilégié du beau .
Il n’existe pas au XVIIIe siècle de théorie esthétique qui ne soit pas fondée sur une réfl exion concernant le beau 3. Aussi, dès son texte
2. D’Alembert , Éloge de Montesquieu, dans Montesquieu, mémoire de la criti-que, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2003, textes choisis et présentés par Catherine Volpilhac-Auger, p. 269.
3. Même le Laocoon de Lessing qui propose une classifi cation des arts selon le rap-port qu’ils entretiennent avec l’espace et le temps s’ouvre par une réfl exion sur le beau .
MEP montesquieu.indd 192MEP montesquieu.indd 192 21/05/07 14:13:2721/05/07 14:13:27
L’esthétique dialectique de Montesquieu 193
introductif, l’Essai sur le goût accorde-t-il un statut privilégié à la beauté . Pourtant, ce privilège n’est pas évident, il demande une lecture minutieuse du texte car celui-ci s’ouvre sur une considération qui n’est pas spécifi quement esthétique puisqu’elle porte sur les trois sortes de plaisir que l’âme peut connaître. Tout d’abord, l’âme goûte aux plaisirs qu’elle tire du fond de son existence, ensuite les plaisirs qui résultent de l’union de l’âme et du corps , enfi n les plaisirs fondés sur les plis et pré-jugés que certaines institutions, usages et habitudes lui font prendre. Ces trois sortes de plaisir identifi és, Montesquieu ajoute qu’ils forment les objets du goût. Suit alors une longue énumération de ces objets4 : si le beau est bien cité en premier, il ne semble pas avoir un statut particu-lier. Il va cependant implicitement l’acquérir par le biais des exemples car Montesquieu en donne seulement deux : lorsqu’une chose utile produit un plaisir , alors cette chose peut être reconnue comme bonne. Lorsqu’une chose belle produit un plaisir , alors cette chose est belle.
Ces deux exemples portent donc sur l’utile et le beau , d’une part, et sur le bon et le beau , d’autre part. C’est ici que Montesquieu confère au beau une dimension particulière puisqu’il est à la fois un objet du goût (comme le bon) et un plaisir même, le plaisir de jouir de la beauté . Ces deux dimensions du beau sont indissociables, tandis que si le bon est un objet du goût qui apparaît lorsque la chose est utile , le plaisir que suscite cette chose vient de son utilité. Ainsi, le beau est à la fois objet du goût et source de plaisir , il est un objet du goût qui apparaît avec la chose même, lorsque la chose par elle-même procure un plaisir 5. Cette particularité du beau n’est pas soulignée par Montesquieu, elle est pourtant d’autant plus légitime qu’elle réappa-raît – sous une autre forme – dans la suite de son introduction.
Montesquieu poursuit son raisonnement par une déduction suivie d’une annonce : puisque les objets du goût affectent plaisamment notre âme , la source du plaisir ne peut être qu’en nous-même. Il faut donc chercher les raisons de ces sources, c’est-à-dire partir à la recherche des causes des plaisirs de notre âme . Outre l’aspect anti-platonicien
4. Le beau , le bon, l’agréable, le naïf, le délicat, le tendre, le gracieux, le je-ne-sais-quoi, le noble, le grand, le sublime , le majestueux, etc.
5. Il est vrai que la chose bonne ne produit pas d’elle-même son utilité.
MEP montesquieu.indd 193MEP montesquieu.indd 193 21/05/07 14:13:2821/05/07 14:13:28
194 Écritures
de cette thèse, clairement revendiqué par l’auteur6, soulignons à nou-veau le privilège accordé au beau . En effet, si la raison de ces plaisirs est la source du beau , du bon, de l’agréable, etc. et si cette source est en nous et non pas dans la chose, il s’ensuit que nous apportons donc par le plaisir ressenti, la beauté à la chose7. Mais est-ce bien nous qui donnons l’utilité à la chose utile ? Nous pouvons certes lui conférer une utilité qu’elle n’a pas à l’origine, mais l’utilité de la chose reconnue comme telle est une qualité première qui appartient bien à la chose et que nous ne saurions lui apporter. Dans ces conditions, si une chose en elle-même peut être utile indépendamment de son utilisateur, tel n’est pas le cas pour le beau : seule notre âme peut apporter la beauté à une chose, jamais une chose n’est belle en elle-même, tandis qu’elle possède toujours déjà son utilité, que nous nous servions d’elle ou non.
Puisque la beauté d’un objet est le propre relatif à l’âme , le beau a donc bien un statut privilégié dans l’Essai sur le goût , étant à la fois un objet du goût et un plaisir ressenti par notre âme . Par suite, dès la fi n de l’introduction, l’Essai prend une dimension esthétique d’autant plus que Montesquieu souligne que c’est dans les arts (comme la poé-sie , la peinture , la sculpture , l’architecture , la musique et la danse ) que notre âme prend le plus de plaisir . Cette esthétique va donc se déployer entre ces deux bornes que sont les arts et le beau et ce qui permet de mettre en mouvement la liaison entre ces bornes, est l’âme , aussi bien celle de l’artiste que celle de l’amateur d’art.
Les pouvoirs de l’âme : qu’est-ce qu’une esthétique dialectique ?
La fi n de l’introduction de l’Essai sur le goût annonce une recherche : examiner notre âme pour chercher les raisons des sources du beau .
6. « Les anciens n’avaient pas bien démêlé ceci ; ils regardaient comme des qualités positives toutes les qualités relatives de notre âme ; ce qui fait que ces dialogues où Pla-ton fait raisonner Socrate , ces dialogues si admirés des anciens, sont aujourd’hui insou-tenables, parce qu’ils sont fondés sur une philosophie fausse : car tous ces raisonnements tirés sur le bon, le beau , le parfait, le sage, le fou, le dur, le mou, le sec, l’humide, traités comme des choses positives, ne signifi ent plus rien. » EG, texte introductif, p. 10.
7. Dans le même ordre d’idée , nous pouvons reconnaître qu’une chose est bonne ou/et agréable pour nous.
MEP montesquieu.indd 194MEP montesquieu.indd 194 21/05/07 14:13:2821/05/07 14:13:28
L’esthétique dialectique de Montesquieu 195
Afi n de mener à bien cet examen, il faut étudier l’âme là où elle se manifeste le mieux c’est-à-dire dans ses plaisirs, qui apparaissent lors de ses actions et passions. Si Montesquieu parvient à terminer son enquête, il énonce dans ces lignes la fi nalité de sa démarche esthé-tique, fi nalité qu’il a lui-même éprouvée lors de son long voyage en Europe qui lui permit de voir, d’apprécier une multitude d’œuvres et de se doter d’une solide culture artistique. Cette fi nalité légitime à elle seule sa recherche sur le beau : si nous recherchons l’action et la passion , c’est pour ressentir un plaisir qui produit le beau ; mais cette connaissance du plaisir esthétique est aussi la recherche des situa-tions, des conditions au cours desquelles notre âme se manifeste le mieux. Autrement dit, la fi nalité de contempler un objet d’art doit être pour Montesquieu la connaissance de notre âme : ressentir un plaisir incommensurable lorsque nous regardons une Madone de Raphaël est de l’ordre de l’expérience immédiate, mais la fi nalité ulté-rieure de cette expérience est la connaissance de notre âme , car c’est à cette occasion qu’elle se manifeste pleinement. Montesquieu perçoit d’ailleurs cette dimension tout autant heuristique qu’ontologique en énonçant l’avantage que procure sa recherche pour le lecteur : elle contribue « à nous former le goût ». Or, comment cette formation du goût serait-elle possible si elle n’allait pas de pair avec la connaissance de notre âme ? L’être qui commence à s’adonner à la contemplation des œuvres d’art voit donc poindre, germer et se développer en lui un mouvement qui se nourrit de deux composantes : en formant mon goût, à force de regarder des œuvres d’art, j’acquiers une meilleure connaissance de qui je suis ; et en me connaissant mieux, je forme, en retour, mon goût. Ce mouvement dialectique , qui se forme ici à partir de l’objet d’art entre le goût et la connaissance de mon être, est, comme nous le verrons, la marque de toute la pensée esthétique de Montesquieu.
Si nous n’hésitons pas à parler d’une dialectique à l’œuvre dans l’es-thétique de Montesquieu, il nous faut cependant préciser le sens que nous donnons à ce terme. Il ne saurait s’agir d’une dialectique de la contradiction, telle que Hegel la pratiquait, qui consiste à découvrir un principe conceptuel qui unit en les synthétisant des moments différents et contradictoires appartenant à une histoire donnée. Au contraire, nous
MEP montesquieu.indd 195MEP montesquieu.indd 195 21/05/07 14:13:2821/05/07 14:13:28
196 Écritures
décelons dans l’Essai sur le goût une dialectique peut-être moins réputée mais tout aussi enrichissante pour le sens qu’elle produit. Cette dialecti-que , dite de la participation, nous la devons au philosophe français Louis Lavelle , et elle est d’autant plus remarquable qu’elle éclaire parfaitement le rapport que Montesquieu entretenait avec les œuvres d’art, rapport qui est à l’origine de sa pensée esthétique. C’est dans son ouvrage intitulé De l’acte que Lavelle défi nit ce qu’est la dialectique de la participation :
Peut-il y avoir un plus beau principe comme point de départ et comme soutien de toute la méthode dialectique que cette possibilité de soi-même qui permet à chaque être de se réaliser par un acte qu’il dépend toujours de lui d’accomplir, qui éclaire du même coup et par la même opération la nature du monde et sa propre nature et qui le rend toujours indivisiblement créateur de lui-même et collaborateur de l’ouvrage entier de la création8 ?
Or l’esthétique que Montesquieu va développer correspond à cette méthode dialectique puisqu’il s’agit pour chaque individu de se réa-liser en accédant à une connaissance de ses goûts, c’est-à-dire de son être par l’appréhension de ce monde particulier qu’est le monde des œuvres artistiques. L’artiste se crée donc lui-même par l’intermédiaire de ses productions ; quant à l’amateur d’art, il se réalise également puisque, apportant par le plaisir qu’il ressent, la beauté à l’œuvre, il est partie prenante de l’œuvre d’art et, en ce sens, collabore à la création artistique. Tout se passe donc comme si la dialectique de la participa-tion de Lavelle s’incarnait dans le rapport qu’instaure Montesquieu entre l’être et l’art. En effet, chez Lavelle , la relation entre un sujet et un objet (tel un objet d’art) n’est pas de l’ordre d’une opposition de nature entre les deux composants de cette relation. Au contraire, en se réalisant, la relation se justifi e d’elle-même « car le sujet et l’objet apparaissent comme situés dans une unité qui les comprend l’un et l’autre, qui nous montre entre eux une parenté primitive9. » Il reste
8. Louis Lavelle , De l’acte, Paris, Aubier, « Bibliothèque philosophique », 1re éd. 1939, 1992 pour cette édition, p. 47 et 48.
9. Ouvr. cité, p. 48, ainsi que pour les deux citations suivantes. Cette notion de parenté primitive nous apparaît comme riche de sens. Elle permet, en effet, d’ex-
MEP montesquieu.indd 196MEP montesquieu.indd 196 21/05/07 14:13:2821/05/07 14:13:28
L’esthétique dialectique de Montesquieu 197
dès lors au sujet à penser la cause de cette relation car cette dernière n’est pas fortuite, au contraire, elle est « une sorte de création de notre être propre dans laquelle sont impliquées toutes ses conditions d’in-telligibilité. » Autrement dit, c’est dans l’acte même par lequel la rela-tion s’instaure que le sujet trouve à se connaître. Ainsi,
à l’inverse de la dialectique de la contradiction, la dialectique de la participation, au lieu de chercher à conquérir le monde par une série de victoires remportées contre les résistances successives, nous apprend à le pénétrer en faisant jaillir en nous une pluralité de puissances auxquelles le réel ne cesse de répondre.
Ce réel qui fait jaillir en nous une pluralité de puissances permet-tant de nous réaliser, c’est-à-dire de mieux nous connaître est, dans l’Essai sur le goût , l’objet d’art. Si nous ressentons un plaisir face à telle œuvre d’art plutôt qu’une autre, c’est parce que notre goût naturel nous portant vers cette œuvre instaure une attirance qui est de l’or-dre de cette parenté primitive dont Lavelle parle. La réitération de cette expérience va alors nous révéler notre goût et par là même le former. Et, c’est en formant notre goût que nous progressons dans la connaissance de notre être. Cependant, en quoi consiste la formation du goût ?
Montesquieu est très clair sur ce sujet et sa réponse est, à nouveau, empreinte d’une dialectique qui se joue désormais entre le plaisir mesuré et le beau comme objet de goût : contribuer à former le goût « n’est pas autre chose que l’avantage de découvrir avec fi nesse et avec promptitude la mesure du plaisir que chaque chose doit donner aux hommes »10. Cette dialectique peut s’énoncer ainsi : si nous éprou-vons du plaisir face à un bel objet, nous acquérons une connaissance du beau en tant qu’objet du goût. Alors cette connaissance du beau nous permet de mesurer notre plaisir c’est-à-dire d’avoir un repère, une mesure vis-à-vis de nos plaisirs à venir. Cette dialectique a pour
pliquer la raison pour laquelle Montesquieu se passionne pour Raphaël ou Michel-Ange et passe sous silence Giorgione , Titien , Véronèse ou encore le Tintoret .
10. EG, p. 10.
MEP montesquieu.indd 197MEP montesquieu.indd 197 21/05/07 14:13:2921/05/07 14:13:29
198 Écritures
vertu de limiter la thèse initiale déjà établie : si l’âme apporte la beauté à une chose de sorte que cette dernière devienne belle, encore faut-il que le plaisir ressenti soit mesuré.
Mais qu’est-ce qu’un plaisir mesuré ? L’hypothèse d’une possible infl uence et libre interprétation d’Épicure est possible ; nous préfé-rons cependant le défi nir à partir du seizième paragraphe consacré aux « Règles ». Pour Montesquieu, un texte qui parle des règles en art ne saurait porter uniquement sur d’éventuels principes que l’artiste devrait suivre afi n que sa création soit belle puisqu’il est acquis qu’une chose ne peut être belle en elle-même. Montesquieu traite donc des règles pour que l’âme goûte un plaisir mesuré, un plaisir dénué d’ex-cès. Une fi nesse apparaît alors dans l’analyse : il existe bien des règles à suivre pour les ouvrages d’art mais elles portent moins sur les prin-cipes créateurs de beauté que sur la manière de susciter le plaisir . Or en ce domaine, il peut arriver que l’objet créé sans suivre de règles préétablies ou sans respecter les règles des grands maîtres suscite du plaisir . En effet, si l’art peut bien donner des règles de création, celles-ci ne sont pas la garantie de la beauté si le plaisir n’apparaît pas, car ce plaisir de l’âme est une affaire de goût personnel. Et le goût peut surgir là où on ne l’attend pas, dans l’exception.
Ce qui est remarquable est que le texte « pose » d’abord une alter-native : ou bien les objets d’art obéissent à des règles ou bien l’œuvre est exceptionnelle et seul mon goût peut me la révéler ; puis Montes-quieu conserve cette alternative en tant que telle, sans jamais recher-cher à réconcilier, dans une voie moyenne, les deux possibilités. Il faut donc l’accepter comme telle, elle est d’ailleurs d’autant plus acceptable qu’elle est cohérente avec l’ensemble de cette esthétique puisqu’elle suscite un nouveau mouvement dialectique : les œuvres d’art réussies cultivent le goût et lui donnent sa mesure, mais c’est ce même goût mesuré qui peut révéler à l’âme un plaisir inédit de sorte que – en de rares occasions – le goût mesuré peut soumettre la production artisti-que et lui imposer de nouvelles règles .
La justifi cation de cette règle dialecticienne, Montesquieu la trouve dans un domaine qu’il connaît à merveille, celui des lois. La démons-tration est analogique : de la même manière que les lois sont justes en
MEP montesquieu.indd 198MEP montesquieu.indd 198 21/05/07 14:13:2921/05/07 14:13:29
L’esthétique dialectique de Montesquieu 199
général, elles sont souvent injustes dans leurs applications. Par suite, les règles en art sont toujours vraies en théorie et peuvent devenir fausses dans la pratique. L’exemple le plus signifi catif de ce principe est Michel-Ange : « Personne n’a jamais plus connu l’art [que lui] ; personne ne s’en est joué davantage »11. Que ce soit en peinture ou en sculpture (les attitudes expressives des corps ) ou en architecture (ses réalisations ont l’air d’être originales parce qu’elles ne respectent pas les proportions établies), Michel-Ange crée des dérèglements bénéfi ques dans les règles coutumières afi n de susciter du plaisir chez le spectateur12. Cet exemple montre la qualité du regard et du goût que Montesquieu a pu acquérir lors de son long voyage : non seulement Michel-Ange instaure une rupture stylistique avec ses prédécesseurs (notamment en sculpture avec ses fi gures « non-fi nies ») mais ses créations ont suscité de nouvel-les règles , reprises par ses contemporains (on pense ici à Raphaël et à Titien ) qui, à leur tour, les bafoueront pour en créer de nouvelles, etc. Voici donc une nouvelle extension de l’esthétique de Montesquieu : elle intègre dans sa réfl exion une dimension historique ; pour cultiver son goût, il est nécessaire d’acquérir une connaissance esthético-histo-rique des conditions d’apparition d’une œuvre, ne serait-ce que pour apprécier sa dimension « révolutionnaire ». En outre, Montesquieu voit parfaitement que chaque histoire d’un art n’est pas linéaire mais propose des discontinuités qui montrent des moments de rupture avec une tradition, ces moments correspondant à l’émancipation pour un artiste de règles dominantes et à la création de nouvelles.
L’évolution (dialectique ) des règles artistiques étant établies, nous pouvons, avec Montesquieu, continuer notre enquête : qu’est-ce qui cause encore du plaisir à notre âme ?
« À présent, nous n’aimons presque que ce que nous ne connaissons pas »
La réponse à cette interrogation se trouve dans le texte intitulé « Des plaisirs de notre âme », lequel fait suite à l’introduction de
11. EG, p. 47.12. Sur Michel-Ange , voir ci-dessus l’article de M.-P. Chabanne.
MEP montesquieu.indd 199MEP montesquieu.indd 199 21/05/07 14:13:2921/05/07 14:13:29
200 Écritures
l’Essai sur le goût . Ce texte riche et fécond est le premier à penser les règles (et leur évolution) en art et confi rme, comme nous le ver-rons, la dimension historique de l’esthétique de Montesquieu. Après avoir dressé une liste des plaisirs qui causent naturellement les plaisirs de l’âme 13, le texte pose une distinction entre les plaisirs naturels et les plaisirs acquis, lesquels sont faits d’une « certaine liaison avec les plaisirs naturels ». Il serait tentant d’assimiler plaisir acquis et plaisir mesuré, mais Montesquieu s’y refuse car s’il existe bien un goût natu-rel et un goût acquis , il est bon de connaître la source des plaisirs dont le goût est la mesure. Autrement dit, le goût permet de mesurer tous nos plaisirs et, lorsque le plaisir mesuré sera connu par sa source, cette connaissance pourra nous servir à rectifi er notre goût naturel et notre goût acquis .
Voici donc, selon Montesquieu, la manière de cultiver notre goût : en remontant à la source du plaisir qui l’engendre. Par exemple, un plaisir naturel auquel il manque la connaissance de sa cause n’est donc pas nécessairement bon (il ne saurait dévoiler le beau en chaque occasion), il lui manque la mesure, laquelle est une affaire de goût. La méthode de Montesquieu consiste donc à partir de l’état où est notre être et connaître quels sont ses plaisirs, la fi nalité première de cette connaissance étant de parvenir à les mesurer, la fi nalité seconde étant même de parvenir « quelquefois à les sentir » (« Des Plaisirs de notre âme », p. 12). En d’autres termes, lorsque notre plaisir est bien mesuré, alors nous (res)sentons qu’il est légitime. Il y aurait donc comme un redoublement de l’intensité du plaisir , naturel ou acquis, lorsque nous sentons qu’il est mesuré. En ce sens, ce redoublement de l’intensité du plaisir montre que le sentir dans le plaisir n’est pas seu-lement premier mais il est aussi une fi nalité à atteindre qui passe par la connaissance des sources du plaisir . Par conséquent, on sent et goûte mieux un plaisir si sa source est connue, et c’est bien la connaissance
13. Voici ces plaisirs qui sont propres à l’âme : la curiosité , les idées de sa gran-deur, de ses perfections, l’idée de son existence opposée au sentiment de la mort (Beyer, dans son édition critique de l’Essai sur le goût , Droz, 1967, a ici corrigé le texte initial qui disait « nuit »), le plaisir d’embrasser tout d’une idée générale, celui de voir un grand nombre de choses, etc., celui de comparer, de joindre et de séparer les idées . (EG, p. 11).
MEP montesquieu.indd 200MEP montesquieu.indd 200 21/05/07 14:13:2921/05/07 14:13:29
L’esthétique dialectique de Montesquieu 201
des causes des plaisirs qui confère une intensité à tout plaisir . Quelle est la nature de cette connaissance des causes du plaisir ? Et en quoi consiste-t-elle ? Montesquieu ne donne pas de réponse car il s’inter-roge sans transition sur la raison qui fait que cette connaissance des causes n’est pas immédiate. Avant de nous intéresser à cette nouvelle question, nous proposons deux hypothèses quant à la nature de cette connaissance , hypothèses qui demeurent dans le cadre de la pensée de Montesquieu.
La première hypothèse est à nouveau historique et rejoint notre réfl exion précédente. Face à une œuvre qui suscite en nous du plaisir , s’informer et réfl échir sur les conditions d’apparition de cette œuvre et sur la manière dont elle s’inscrit dans l’histoire de l’art, participe nécessairement à la connaissance des causes du plaisir , ne serait-ce que parce que ce travail réfl exif peut intensifi er notre plaisir . Les condi-tions d’apparition de l’œuvre ne visent pas simplement la technique mais également la pensée de l’artiste, laquelle dépasse sa simple sin-gularité. Autrement dit, apparaît ici dans cette esthétique une dimen-sion culturelle et sociologique. La connaissance des divers champs économiques, culturels, politiques, religieux, philosophiques à partir desquels l’artiste crée participe donc à la connaissance des causes de notre plaisir .
La seconde hypothèse se déploie sur le terrain de l’ontologie, terrain plus délicat car il concerne la spécifi cité de chaque individu. Lorsque Montesquieu propose de partir à la recherche des causes du plaisir , cette démarche apparaît fort proche de celle de Spinoza lorsque celui-ci entend se libérer de ses déterminations en recherchant les causes effi -cientes de ses idées inadéquates, elles-mêmes causées par ses désirs. Nous atteignons là ce qui concerne la sensibilité singulière, particulière de chaque sujet, mais d’un point de vue universel il est possible d’affi rmer que si nous sommes affectés par une œuvre plutôt que par une autre (par exemple lors de la visite d’une galerie de peinture ) c’est parce qu’il existe une raison nécessaire qui engendre le plaisir . Partir à la recherche de cette raison , c’est chercher à connaître les causes immédiates mais obscures, voilées et pas nécessairement conscientes de ce plaisir . La seule certitude est que ces causes existent puisqu’elles déterminent notre goût
MEP montesquieu.indd 201MEP montesquieu.indd 201 21/05/07 14:13:3021/05/07 14:13:30
202 Écritures
et, si elles existent, il est donc possible en droit de les connaître. Cette connaissance qui renvoie à la vie intime de chaque sujet est certaine-ment peu aisée, mais comme le souligne Spinoza dans la phrase qui conclut l’Éthique : « Tout ce qui est beau est diffi cile autant que rare. »
Revenons maintenant à la question que nous avions laissée en sus-pens : pourquoi la connaissance des causes du plaisir n’est pas immé-diate ? Si tel est toujours le cas, c’est à cause du corps et de ses affections. La réponse de Montesquieu semble ici confi rmer notre seconde hypo-thèse : le corps est cet organe aux pouvoirs étonnants qui nous déter-minent sans que nous ayons immédiatement conscience de ses raisons. Quoi qu’il en soit, si l’âme avait été seule à goûter un plaisir , elle aurait été immédiatement en mesure de connaître sa cause. Dans ce cas « idéal » où la connaissance serait immédiate, le plaisir serait mesuré et donc aimé. Mais comme le remarque Montesquieu, « à présent, nous n’aimons presque que ce que nous ne connaissons pas »14.
Que signifi e cette formule ? De prime abord, elle apparaît criti-que : ce que nous ne connaissons pas, ce sont des œuvres qui engen-drent des plaisirs dont les causes sont inconnues en raison de notre corps . À présent, il y aurait une tendance à aimer n’importe quelle œuvre parce qu’elle suscite du plaisir , qu’il soit naturel ou acquis. Pre-nons donc garde à une œuvre qui suscite en nous spontanément un plaisir : certes, celui-ci est réel mais n’est pas gage de notre goût, ni de la beauté de l’œuvre. Encore faut-il savoir pourquoi cette œuvre peut générer un plaisir . Mais est-ce à cause des règles qu’elle suit ou qu’elle crée ? Si une œuvre, comme un tableau, montre une originalité telle qu’elle est susceptible d’engendrer de nouvelles règles pour des pein-tres à venir, alors la source du plaisir au moment de la réception est nécessairement inconnue. C’est alors le plaisir qui suscite la curiosité envers ce tableau. Par suite si à présent nous aimons ce que nous ne connaissons pas encore et que nous parvenons à identifi er des causes de notre plaisir (la source de notre curiosité , la perfection inédite par rapport aux tableaux déjà vus), alors c’est un devoir de suivre notre plaisir et notre goût. Par conséquent, cette formule de Montesquieu
14. EG, « Des plaisirs de notre âme », p. 12.
MEP montesquieu.indd 202MEP montesquieu.indd 202 21/05/07 14:13:3021/05/07 14:13:30
L’esthétique dialectique de Montesquieu 203
n’est pas seulement critique car, dans le second cas, le goût est bien la mesure à la fois de notre plaisir et de la beauté du tableau. Cette formule à double sens s’inscrit dans l’esthétique dialectique de Mon-tesquieu et la renforce donc.
Questions de méthode
Une conception dynamique des arts
La troisième section, « Des plaisirs de notre âme », est consacrée au corps , cause principale de l’absence de connaissance de la source du plaisir . Il ne s’agit cependant pas de critiquer l’irréductible présence de ce corps , encore moins de s’apitoyer sur cela. En effet Montesquieu n’est pas platonicien et, de la même manière qu’il n’existe pas de règles éternelles pour créer le beau , il serait vain de s’épancher sur les méfaits du corps pour les décrier. Au contraire, Montesquieu possède une conception très cartésienne du corps à partir de laquelle il va déployer une analyse lui permettant d’asseoir une méthodologie pour l’esthé-tique. Ainsi, en général « notre manière d’être est entièrement arbi-traire »15, puisque nous aurions pu être faits autrement ; notre corps qui fonctionne comme une machine aurait pu avoir un organe de plus ou de moins, de telle manière que nous aurions pu voir autrement, avoir une autre éloquence, une autre poésie . Ces considérations fi cti-ves ont pour fi nalité de montrer que les règles qui « proportionnent la disposition du sujet » sont elles-mêmes arbitraires. En fonction de cet arbitraire, l’apparition de nouvelles règles est toujours du domaine du possible car ces règles sont relatives au sujet. En effet, un être possé-dant un corps -machine différent, aurait des plaisirs autres et, puisque le plaisir peut être source de nouvelles règles , le plaisir aurait engendré d’autres règles . Dès lors, si les règles en art existent et sont nécessaires, elles possèdent néanmoins une validité temporaire, elles sont donc arbitraires c’est-à-dire temporelles et relatives au sujet. Montesquieu affi rme ici l’originalité de son esthétique : ni platonicien puisqu’il
15. EG, p. 12.
MEP montesquieu.indd 203MEP montesquieu.indd 203 21/05/07 14:13:3021/05/07 14:13:30
204 Écritures
n’existe pas de règles , de principes éternels et immuables aussi bien pour l’âme que pour ses productions ; ni cartésien puisque Descartes concède dans une lettre à Mersenne qu’en matière d’art, il n’existe aucune mesure du beau car les goûts sont tous différents16.
L’art est donc relatif à notre goût présent puisque ses règles sont elles-mêmes relatives à notre constitution physiologique et à la péné-tration de notre entendement. Si notre être était l’objet de chan-gements dans ses qualités perceptives (une vue plus faible ou plus distincte, une ouïe similaire à celle des animaux), les rapports entre les choses auraient subsisté, mais les rapports que ces choses ont avec nous auraient changé. Ainsi, les choses qui « dans l’état présent, font un certain effet sur nous, ne le feraient plus »17.
La relativité temporaire des règles étant démontrée, Montesquieu peut alors aborder le problème de la perfection en art : celle-ci n’est pas plus éternelle que les règles , elle est donc également temporaire, mais cette idée de la perfection a surtout pour vertu de montrer que notre goût mesuré est lui-même soumis à une évolution, qu’il n’est jamais acquis de manière défi nitive et que nous devons non seulement le susciter face à chaque œuvre mais plus encore le cultiver. En effet, la perfection des arts n’est pas une confi rmation de la juste mesure de notre goût mesuré en action ; au contraire cette perfection est de nous présenter les choses telles qu’« elles nous fassent le plus de plaisir qu’il est possible »18. Dans ces conditions, que devient le plaisir mesuré lors-que nous goûtons la perfection en art ? Est-il bouleversé en sa mesure ? Ce « plus grand plaisir » donne-t-il une nouvelle mesure ? Avec Mon-tesquieu, nous pouvons répondre par l’affi rmative à ces trois questions car dans ce cas, il y aurait « du changement dans les arts » parce qu’il y en aurait « dans la manière la plus propre à nous donner du plaisir »19.
16. « Pour votre question, savoir si l’on peut rétablir la raison du beau […] ni le beau , ni l’agréable ne signifi ent rien qu’un rapport de notre jugement à l’objet, et pour ce que les jugements des hommes sont si différents, on ne peut dire que le beau ni l’agréable aient aucune mesure déterminée. » Descartes dans Œuvres Com-plètes, Paris, Vrin, éd. Adam-Tannery, tome X, p. 132.
17. EG, p. 13.18. Ibid.19. Ibid.
MEP montesquieu.indd 204MEP montesquieu.indd 204 21/05/07 14:13:3021/05/07 14:13:30
L’esthétique dialectique de Montesquieu 205
La conception dynamique des arts – dynamisme qu’il faut appré-cier dans chaque histoire respective des arts mais aussi qu’il faut avoir à l’esprit lorsque nous sommes face à une œuvre contemporaine – est au fondement de ce que nous pouvons nommer une méthodologie pour l’esthétique.
De l’importance du goût naturel : la méthodologie pour l’esthétique.
Comme nous le savons depuis L’Esprit des lois, Montesquieu est le penseur des rapports entre les choses. C’est donc en termes de rapport qu’il est possible de cerner une méthodologie esthétique, laquelle se joue dans le rapport que tout sujet doit adopter lorsqu’il se trouve confronté à une œuvre d’art. Quel est donc le rapport entre le plaisir , le goût et les règles en art ?
Tout d’abord, ce qui doit être premier dans ce rapport entre l’œu-vre et le sujet, c’est le goût naturel qui ne se constitue pas par une connaissance théorique ; au contraire, il est « une application prompte et exquise des règles »20 suivies ou créées par l’artiste, règles que l’on ne connaît pas nécessairement et que pourtant le goût naturel sait recon-naître. Il ne suffi t donc pas d’identifi er les sources culturelles de nos plaisirs pour posséder ce goût : non seulement ce goût ne s’acquiert pas par une culture, mais il serait insensé de vouloir se doter d’un goût constitué de « ce que la philosophie nous a dit là-dessus » avant même de se confronter à une œuvre. En d’autres termes, si le goût se cultive, la culture (philosophique) ne peut précéder le goût naturel et c’est une fois que le goût s’est affi rmé que la recherche des connais-sances des sources du plaisir a un sens. La mauvaise méthode en art serait de chercher d’abord à acquérir un goût par des lectures philoso-phiques, lesquelles participent néanmoins à la connaissance des sour-ces de notre plaisir . Un tel dispositif conduirait nécessairement à un jugement hardi des ouvrages d’art au cours duquel notre propre goût naturel serait oublié puisque étouffé. Cette hardiesse dans le jugement serait alors dogmatique car, comme Montesquieu l’argumente, dans
20. Ibid.
MEP montesquieu.indd 205MEP montesquieu.indd 205 21/05/07 14:13:3121/05/07 14:13:31
206 Écritures
ce cas, ce serait toujours les mêmes œuvres qui seraient reconnues comme belles. Dans ces conditions aucune nouveauté, aucune excep-tion en art ne serait possible.
La méthode préconisée par Montesquieu entend restituer au goût naturel sa place prédominante dans l’appréhension d’une œuvre d’art. Il serait en effet insensé de se priver de cette faculté naturelle et immé-diate qui nous permet de reconnaître une application prompte et exquise des règles , même celles que l’on ne connaît pas. Il faut donc lui ménager constamment ses conditions d’apparition car, lorsque notre goût naturel s’affi rme, alors le désir d’identifi er les sources de notre plaisir est tout aussi naturel . Le respect de cette double natura-lité, à la fois de notre goût et du désir qui s’ensuit, crée les conditions de possibilité de la connaissance des sources de notre plaisir . Une fois cette connaissance réalisée – connaissance qui, comme nous l’avons vu est non seulement diffi cile mais également exigeante puisqu’elle doit être réactivée face à chaque œuvre d’art –, l’affi rmation d’un goût mesuré est alors légitime. Lorsque ce goût mesuré s’exprime, il est en mesure d’identifi er la beauté des œuvres qui respectent des règles éta-blies ou, mieux encore, il devient capable – cette capacité provenant de sa légitimité – de reconnaître une œuvre d’art à la beauté inédite qui sera à l’origine de nouvelles règles pour les œuvres à venir. Par conséquent, si le goût mesuré peut s’avérer être le goût acquis , il ne l’est jamais défi nitivement puisque la mesure de notre goût doit tou-jours être susceptible d’être perturbée, bouleversée par ce principe qui consiste à se fi er à notre goût naturel .
L’importance accordée au goût naturel dans cette méthodologie esthétique est soulignée par une première analyse de la surprise . Mon-tesquieu rappelle que la surprise procède de la même naturalité que le goût naturel , qu’elle lui est consubstantielle. En effet, « il n’est pas nécessaire de savoir que le plaisir que nous donne une certaine chose que nous trouvons belle, vient de la surprise ; il suffi t qu’elle nous sur-prenne »21. En d’autres termes, la surprise ne se cultive ni se décrète, elle naît dans le même mouvement que le plaisir ; aussi savoir que le
21. Ibid.
MEP montesquieu.indd 206MEP montesquieu.indd 206 21/05/07 14:13:3121/05/07 14:13:31
L’esthétique dialectique de Montesquieu 207
plaisir vient de la surprise n’augmente ni l’un ni l’autre. En revanche, la connaissance des sources du plaisir peut et doit se développer après l’avènement du goût naturel et, parmi ces sources, la surprise peut être un élément déterminant pour indiquer la voie de cette connais-sance . Mais si nous commençons à vouloir analyser la surprise , si nous analysons a priori quels sont les plaisirs qui font naître la surprise pour connaître ses causes, alors nous chercherons des ouvrages qui doivent faire naître la surprise : ce qui serait une démarche non seulement hardie mais surtout absurde. Par conséquent, la surprise surprend d’abord « autant qu’elle le doit, ni plus ni moins »22. Ainsi, un goût acquis à force de culture philosophique se retrouverait démuni face à une surprise radicale, son seul salut serait alors d’analyser a priori la cause de cette surprise afi n que le goût acquis ne soit plus surpris : non seulement ce serait absurde mais le risque serait de fausser le jugement et de ne plus être en mesure de reconnaître l’œuvre radica-lement inédite et originale.
Le sixième paragraphe des « Plaisirs de l’âme » peut alors conclure : « tous les préceptes […] pour former le goût, ne peuvent regarder que le goût acquis »23, mais celui-ci ne doit jamais venir oblitérer, faire taire ou effacer le goût naturel . Cependant, comme il existe une liaison entre goût naturel et goût acquis , Montesquieu déploie à nouveau un mouvement dialectique en vertu de cette liaison : le goût naturel affecte, change, augmente ou diminue le goût acquis , de la même manière que le goût acquis affecte, change, augmente ou diminue le goût naturel . Qu’est-ce alors que le goût mesuré ? Il peut être acquis ou naturel puisqu’il est relatif au plaisir ressenti et à l’œuvre contemplée. Il serait erroné de faire du goût mesuré un juste milieu, une synthèse entre le naturel et l’acquis. La dialectique posée par Montesquieu doit être tenue comme telle, cette « tension » dia-lecticienne pouvant être exprimée en ces termes : s’il est essentiel, le seul goût naturel n’est pas nécessairement mesuré puisqu’il peut être enrichi par le goût acquis , de même le goût acquis n’est pas nécessaire-ment mesuré car, n’étant jamais défi nitif, il peut, à tout moment, être
22. Ibid.23. Ibid.
MEP montesquieu.indd 207MEP montesquieu.indd 207 21/05/07 14:13:3121/05/07 14:13:31
208 Écritures
bouleversé, modifi é, enrichi par le goût naturel . C’est sans doute pour que ce mouvement dialectique conserve son dynamisme et son statut d’ouverture – la prochaine œuvre d’art peut, en effet, nous surpren-dre et affecter notre goût acquis ou naturel – que Montesquieu donne une défi nition générale, mais non synthétique, du goût : « sans consi-dérer s’il est bon ou mauvais, juste ou non, [le goût] est ce qui nous attache à une chose par le sentiment »24. Le goût peut donc s’appli-quer aussi aux choses intellectuelles car celles-ci peuvent procurer des plaisirs à l’âme 25. Non pas que ces plaisirs soient nécessairement pour Montesquieu ceux de la connaissance , mais lorsque l’âme ressent du plaisir à l’occasion de lectures intellectuelles, ce sentiment participe à la compréhension de ces lectures. Il ne faut donc pas opposer l’idée au sentiment car lorsque l’âme voit une chose intellectuelle, elle la sent également et ce sentir est partie prenante de la pensée pour la chose pensante. En ce sens, Montesquieu est clairement cartésien , le sentir étant l’une des sept facultés de la pensée dans la deuxième des Méditations métaphysiques.
L’esthétique dialectique en acte : « ce qui fait les grandes beautés »
De l’importance de la surprise : un cas d’application
Le bon rapport qu’il s’agit d’instituer entre une œuvre d’art et son spectateur consiste à ce que le goût naturel – qui est toujours pre-mier – ne soit ni négligé, ni oublié. Plus que le goût acquis , c’est essentiellement ce goût naturel qu’il faut constamment tenir en éveil, parce qu’il sait accueillir la surprise , laquelle est un bon critère pour
24. EG, p. 14.25. Ce sentir du plaisir de l’âme goûté à l’occasion de lectures intellectuel-
les montre que Montesquieu retient néanmoins quelque chose du platonisme. En effet, il existe bien une dimension platonicienne dans cette esthétique : la beauté d’un texte est source de plaisir pour l’âme et le Philèbe insiste sur l’idée que ce res-sentir du plaisir est prépondérant dans l’acquisition des connaissances.
MEP montesquieu.indd 208MEP montesquieu.indd 208 21/05/07 14:13:3121/05/07 14:13:31
L’esthétique dialectique de Montesquieu 209
reconnaître la beauté . Mais la plus belle des surprises est celle qui dessine une progression en notre âme , celle qui fait croître notre plai-sir : « Ce qui fait les grandes beautés, c’est lorsqu’une chose est telle que la surprise est d’abord médiocre, qu’elle se soutient, augmente, et nous mène ensuite à l’admiration »26. C’est immédiatement l’œuvre de Raphaël qui est citée par Montesquieu car ses tableaux et ses fres-ques permettent d’analyser ce plaisir de la beauté soutenu, entretenu et augmenté par la surprise que l’artiste sait ménager au spectateur. Cette progression de la surprise dans l’âme du spectateur vient de ce que « les ouvrages de Raphaël frappent peu au premier coup d’œil »27. Cela ne signifi e pas que ses tableaux soient anodins. Au contraire, s’ils frappent peu l’âme , ils la frappent quand même et, s’ils y parvien-nent, c’est parce qu’ils possèdent un « je ne sais quoi », c’est-à-dire un charme réel mais peu aisé à percevoir, une grâce naturelle que le spec-tateur est en peine de défi nir. Ce « je ne sais quoi », précise Montes-quieu, est un effet principalement fondé sur la surprise . Il est donc le premier moment d’apparition de la surprise et appelle sa progression en notre âme . Ainsi les ouvrages de Véronèse sont dénués de ce « je ne sais quoi » car nous admirons immédiatement la majesté de ses drape-ries. En revanche, c’est dans la simplicité des œuvres de Raphaël que s’immisce le « je ne sais quoi », de même qu’il se trouve dans la pureté des images du Corrège . Partant, « Paul Véronèse promet beaucoup, et paie ce qu’il promet : Raphaël et le Corrège promettent peu et paient beaucoup, et cela nous plaît davantage »28.
Il serait cependant excessif d’accorder trop d’importance au « je ne sais quoi » dans l’esthétique de Montesquieu. Sa présence dans l’œu-vre d’art n’est ni suffi sante, ni nécessaire pour faire naître la beauté puisque « Véronèse paie ce qu’il promet ». En ce sens, ce concept n’est qu’un adjuvant de la beauté , il ne saurait la défi nir en propre. La preuve en est que les autres exemples donnés par Montesquieu portant sur le « je ne sais quoi » ne concernent pas spécifi quement la
26. EG, « Progression de la surprise », p. 40.27. Ibid.28. EG, « Du Je ne sais quoi », p. 37.
MEP montesquieu.indd 209MEP montesquieu.indd 209 21/05/07 14:13:3221/05/07 14:13:32
210 Écritures
beauté . Sa dimension esthétique réside donc en ce qu’il est un moyen effi cace pour que la surprise se développe dans l’âme du spectateur.
Par suite, le charme des tableaux de Raphaël vient de ce que ce pein-tre « imite si bien la nature , que l’on n’en est d’abord pas plus étonné que si l’on voyait l’objet même, lequel ne causerait point de surprise »29. De quelle nature s’agit-il ? Avant tout de la nature des corps . En effet, Raphaël n’était pas un peintre de paysages naturels peints pour eux-mêmes (le thème et l’exploitation de la nature naturante n’apparaît d’ailleurs que plus tard en Italie) ; cependant, des paysages apparais-sent comme éléments de décors, notamment dans ses madones. Tel est le cas pour son interprétation de sainte Catherine, peinte vers 1508, à la fi n de son séjour fl orentin, juste avant son départ pour Rome. La question n’est pas de savoir si Montesquieu a eu l’occasion de contem-pler ce tableau lors de son voyage , mais si l’analyse de la progression de la surprise convient parfaitement à cette Sainte Catherine.
En effet, l’image de la Sainte frappe le regard distrait ou rapide : il n’y reconnaîtrait que l’image d’une femme animée d’un léger mou-vement d’ensemble du corps , somme toute fort naturel . D’ailleurs, la silhouette peinte imite effectivement un subtil et fort plausible aban-don d’un corps qui s’appuie sur une rambarde. Mais sur quoi, au juste, Catherine s’appuie-t-elle ? Si cette simple question émerge dans l’es-prit du spectateur, alors sa surprise ne pourra aller qu’en augmentant, jusqu’à la découverte de la pleine signifi cation de cette représentation. Sainte Catherine s’appuie sur une roue, laquelle est – selon l’histoire de la Légende dorée – l’instrument de son martyre. Cette roue est donc non seulement un appui pour le corps de la Sainte mais surtout le signe qui permet au spectateur d’identifi er Catherine. Raphaël fait ainsi subrepticement appel à la culture de son spectateur. Ce dernier, reconnaissant ce signe caractéristique de sainte Catherine – signe qui ne se distingue guère au premier coup d’œil – peut donc d’autant plus s’intéresser au sens de l’image, et cet intérêt croissant augmente en proportion de la progression de la surprise analysée par Montesquieu. Ce qui frappe alors le spectateur est que sainte Catherine regarde vers
29. EG, « Progression de la surprise », p. 40.
MEP montesquieu.indd 210MEP montesquieu.indd 210 21/05/07 14:13:3221/05/07 14:13:32
L’esthétique dialectique de Montesquieu 211
le haut, hors de l’image : « son regard suppose donc une réalité située au-delà de cette image, une réalité qui n’est pas visualisée dans l’espace pictural30. » Porté par sa surprise , l’esprit du spectateur perçoit pro-gressivement la signifi cation de l’image : la vision de la Sainte est une contemplation intellectuelle. Si son corps ne s’abandonne que très légèrement, c’est parce que son âme est accaparée par la contempla-tion du « surnaturel, qui n’est pas visualisé mais évoqué par les rayons d’or » situés dans l’angle supérieur gauche31.
La progression de la surprise , analysée par Montesquieu, atteint ici son acmé puisque l’admiration fi nale de l’image est désormais possi-ble. Celle-ci est obtenue par la manière dont Raphaël a su peindre la contemplation intellectuelle de la Sainte et en rendre compte, par la manière dont il suggère la présence et la vision divine (les fi ns rayons d’or sont pratiquement indiscernables au premier regard). C’est toute cette mise en scène, où ce qui est évoqué compte autant que ce qui est montré, qui permet de comprendre le calme de Catherine alors qu’elle sait que son supplice l’attend. Sous l’apparence de l’imitation d’un corps de femme qui s’abandonne légèrement, se cache l’excel-lence du peintre qui sait suggérer en un instant fécond l’avant, le pendant et l’après de la scène qu’il représente, et c’est par la surprise qu’il sait éveiller et faire croître en l’esprit du spectateur que Raphaël parvient à évoquer la fécondité de cet instant de vie de la Sainte. Pour reprendre le titre d’un paragraphe de l’Essai sur le goût 32, l’instant fécond peint par Raphaël tisse des liaisons en notre âme et c’est l’effet de ses liaisons que notre imagination met, c’est-à-dire applique à cette chose qu’est l’image.
Cette progression de la surprise qui forme notre goût mesuré mais qui n’est possible que si notre goût naturel sait accueillir la surprise , Montesquieu ne la trouve pas (ou la trouve moins) chez les peintres vénitiens. Ce qu’il leur reproche est non pas la faculté d’éveiller la surprise mais l’incapacité de la faire progresser en notre âme . En effet, lorsque nous regardons un tableau vénitien du XVIIe siècle, si nous
30. Daniel Arasse, Les Visions de Raphaël , Paris, Liana Levi, 2003, p. 17.31. Daniel Arasse, ouvr. cité, p. 18.32. « Autre effet des liaisons que l’âme met aux choses ».
MEP montesquieu.indd 211MEP montesquieu.indd 211 21/05/07 14:13:3221/05/07 14:13:32
212 Écritures
sommes saisis dès le premier coup d’œil « par une expression extra-ordinaire, un coloris plus fort, une attitude bizarre »33, ce peintre, selon Montesquieu, est alors moins bon que Raphaël car la surprise s’estompe. Ainsi, les peintres vénitiens frappent « d’abord plus, pour frapper moins ensuite »34.
Cependant, la comparaison de la Sainte Catherine de Raphaël avec celle de Véronèse infi rme quelque peu le jugement de Montes-quieu. En effet, la version de Véronèse – qui se trouve à la Galerie des Offi ces de Florence –, montre des similitudes avec celle de Raphaël , notamment dans l’attitude des corps . Dans les deux versions, le buste est pratiquement de face, une même torsion du cou indique que le regard de la Sainte se dirige vers le ciel. S’il existe des divergences dans les tableaux, elles montrent néanmoins que Véronèse possède égale-ment la capacité de faire naître et progresser la surprise dans l’âme du spectateur. Cette capacité ne se situe cependant pas dans la symboli-que de la roue : Véronèse ne joue d’ailleurs pas avec cette symbolique puisque la roue, située sur la gauche du tableau, est présentée pour ce qu’elle est, c’est-à-dire comme l’instrument essentiel de torture qui attend Catherine. Au contraire, la capacité de faire naître et croître la surprise réside principalement dans le seul regard de la Sainte. Chez Véronèse , pas le moindre rayon lumineux ou coin de ciel qui suggère la présence du surnaturel : il n’est pas donné au spectateur de voir ce que seule Catherine peut voir. Il revient donc à l’imagination du spec-tateur de suppléer sa cécité, ce qui n’est possible que s’il a suffi sam-ment observé le regard de la Sainte. La surprise consiste ici en ce que Véronèse ne donne pas à voir ce que le spectateur pense être en droit de voir ; par suite, c’est la progression de la surprise en son âme quilui permettra d’imaginer le devenir de celle qui bientôt sera sainte.
Il est vrai cependant que ce tableau de Véronèse reste une excep-tion comparée à l’ensemble de son œuvre. Véronèse est d’abord ce peintre au système pictural fort éloigné de la nature et de la réalité, aux corps maniérés qui se multiplient dans de grandes compositions formant un univers poétique . C’est ce Véronèse -là que Montesquieu
33. EG, « Progression de la surprise », p. 40.34. Ibid.
MEP montesquieu.indd 212MEP montesquieu.indd 212 21/05/07 14:13:3221/05/07 14:13:32
L’esthétique dialectique de Montesquieu 213
oppose à Raphaël , et si nous regardons un autre tableau de Véronèse mettant en scène un événement de la vie de sainte Catherine, force est de constater que le jugement de Montesquieu envers la peinture vénitienne possède une certaine légitimité. Véronèse a, en effet, peint un autre moment de la vie de Catherine, un événement entièrement fi ctif ajouté à son existence, à partir du XIe siècle, un mariage mystique de sainte Catherine avec l’enfant Jésus. Si nous reprenons les griefs énoncés par Montesquieu envers les peintres vénitiens, ce tableau est effectivement plus expressif, non seulement en raison du nombre des personnages (trente et un avec les anges), mais surtout à cause de leur expressivité qui permet une liaison entre les silhouettes, de sorte qu’il existe une communication entre le monde sensible où Catherine évolue et le monde surnaturel des anges. En outre, comme Montes-quieu le souligne, la gamme chromatique est déclinée suivant toutes les variations des couleurs primaires ; le mouvement d’ensemble est harmonieux mais le contraste entre les couleurs (par exemple le drap pourpre déployé sur les deux colonnes qui vient couper le bleu du ciel) frappe d’emblée le regard.
Enfi n, il exact de souligner l’attitude « bizarre » des silhouettes, si nous comparons le port de la Sainte Catherine de Véronèse avec celle de Raphaël : autant le léger abandon du corps de la Catherine de Raphaël imite une position familière, autant le maintien – ren-forcé par la robe si somptueuse qu’elle en semble irréelle – que donne Véronèse à sa Sainte apparaît fort éloigné d’une attitude naturelle . Si la volonté de ce peintre d’extraire de ses tableaux tout souci de réalisme surprend dans un premier temps, une fois que l’œil du spec-tateur s’habitue à ce langage pictural, alors le spectateur s’aperçoit que l’image a révélé d’emblée toute sa signifi cation35, atténuant la surprise là où Montesquieu souhaiterait la voir progresser.
Un autre procédé, suscitant la surprise , peut également engen-drer le plaisir de jouir de la beauté . Il concerne surtout le peintre et
35. En ce sens, la représentation des anges est signifi cative : elle montre immé-diatement le monde divin ou tout du moins son omniprésence dans le monde des hommes. Là où Raphaël est dans la suggestion, Véronèse est ici dans l’ostentation du secours que Dieu apporte à sainte Catherine.
MEP montesquieu.indd 213MEP montesquieu.indd 213 21/05/07 14:13:3321/05/07 14:13:33
214 Écritures
l’architecte et est le prolongement de l’analyse menée sur les œuvres de Raphaël . Une autre manière de faire progresser la surprise consiste en ce que « notre âme sent du plaisir lorsqu’elle a un sentiment qu’elle ne peut pas démêler elle-même, et qu’elle voit une chose absolument dif-férente de ce qu’elle sait être », de sorte que, ajoute Montesquieu, cela « lui donne un sentiment de surprise dont elle ne peut pas sortir »36. Ce procédé fait penser à la technique du trompe-l’œil et sans doute Montesquieu aurait-il pu évoquer la voûte de l’église Saint-Ignace-de-Loyola de Rome, peinte par le père Andrea Pozzo . Mais l’exemple cité est architectural, il concerne le dôme de la basilique Saint-Pierre réalisé par Michel-Ange qui, s’inspirant du Panthéon athénien, aurait déclaré qu’il voulait en « faire un pareil, mais qu’il voulait le mettre en l’air. » Bien que les piliers du bâtiment soient fort massifs, ce dôme apparaît comme une montagne « que l’on a sur la tête »37. Il semble donc léger en dépit de son aspect massif.
Ainsi, lorsqu’un mouvement dialectique au sein de l’âme – entre ce qu’elle sait et ce qu’elle voit – s’installe et perdure sans qu’il soit possi-ble que la vue ou le savoir triomphent l’un de l’autre ou se réconcilient, alors l’état d’incertitude entre ce qu’elle voit et ce qu’elle sait fait naître naturellement en elle de la surprise qui va croissant (en raison de l’im-possible réconciliation ou synthèse entre la vue et le savoir). Dans ce cas, l’objet contemplé peut réellement être reconnu comme beau .
Un dernier procédé, qui concerne plus spécifi quement l’architec-ture , est donné par Montesquieu. Il apparaît néanmoins comme un cas d’application du précédent puisqu’il porte sur le décalage entre l’apparence d’un monument et sa taille réelle. Il traite d’ailleurs du même exemple : l’exacte proportion de la basilique Saint-Pierre fait qu’elle ne paraît pas d’abord aussi grande qu’elle l’est en réalité. Au premier regard, la surprise saisit notre âme car nous ne savons quel point de vue adopter pour juger de sa grandeur. Mais plus on exa-mine l’édifi ce, plus la surprise , loin de disparaître, s’accroît car l’œil ne parvient pas à le mesurer, découvrant constamment des points de fuite nouveaux qui font que le regard se perd davantage. À nouveau,
36. EG, « Progression de la surprise », p. 41.37. Ibid.
MEP montesquieu.indd 214MEP montesquieu.indd 214 21/05/07 14:13:3321/05/07 14:13:33
L’esthétique dialectique de Montesquieu 215
la dialectique entre ce que l’âme sait et ce qu’elle perçoit s’installe et le jeu vivifi ant entre la vue et le savoir fait que la surprise augmente et certifi e la beauté de l’édifi ce.
L’inspiration de la nature
Un autre intérêt de l’esthétique de Montesquieu est qu’elle possède le souci constant d’associer dans un même mouvement d’analyse l’ar-tiste et celui à qui l’œuvre d’art s’adresse. Ainsi, c’est le plaisir qui per-met au spectateur, à l’auditeur ou au lecteur de partager le sentiment et la pensée de l’artiste. Outre la surprise , l’Essai sur le goût dégage deux autres procédés capables de susciter le plaisir : tout d’abord la variété que l’œuvre doit présenter et dont le contraste est l’une des catégories, ensuite la symétrie dans la mesure où l’ordre qu’elle crée cause du plai-sir à l’âme . Si la variété , l’ordre et la surprise sont des procédés adéquats pour susciter le plaisir , c’est parce qu’ils entretiennent un rapport avec la nature 38, laquelle devient un modèle dont il s’agit de s’inspirer.
Ainsi, un tableau doit posséder de la variété car si l’une de ses par-ties ressemblait à une autre déjà vue, nous ne goûterions aucun plaisir . Cette variété des parties est à l’œuvre dans ce grand tout qu’est la nature , elle doit par conséquent se retrouver dans les ouvrages d’art ; l’artiste doit donc rendre variée la composition de ses œuvres afi n que le spectateur se les approprie. Chez Montesquieu, c’est la variété des parties d’un tableau qui incite l’âme à voir et le lui permet. Ce « voir » n’est pas que la simple perception visuelle d’un paraître mais doit per-mettre de remonter aux intentions créatrices du peintre. Partant, des choses peuvent paraître variées alors qu’elles ne le sont pas, et inverse-ment. Afi n d’obtenir cette variété dans ses compositions, l’artiste doit toujours revenir à la nature et s’en inspirer. Il est, par exemple, dans la nature des choses qu’une troupe d’individus se scinde en divers petits pelotons composés de trois ou quatre personnes. Le peintre doit alors imiter ce mouvement naturel en veillant à diviser sa troupe de person-nages en groupes de trois ou quatre fi gures.
38. La nature au sens large du terme : la nature naturante mais aussi la nature des corps , des choses.
MEP montesquieu.indd 215MEP montesquieu.indd 215 21/05/07 14:13:3321/05/07 14:13:33
216 Écritures
Tel est le cas chez Guido Reni dans sa composition L’Aurore, peinte en 1609, pour le casino Rospiglioso du palais Pallavicini de Rome. L’une des raisons qui ont fait que Montesquieu a su « voir » et appré-cier cette fresque réside en ce que la petite troupe des femmes qui accompagne le char d’Hélios se scinde en deux groupes composés respectivement de trois et quatre fi gures. En outre, ce qui confère de la variété à la composition est le mouvement d’ensemble de ces sil-houettes féminines, lequel est néanmoins dû aux attitudes contrastées des personnages qui marchent. Ici encore, le contraste, dû au mou-vement, provient d’une connaissance de la nature puisque celle-ci, insiste Montesquieu, ne nous a pas situés seulement sans contrastes ni variétés mais nous a donné également du mouvement39. Guido Reni obtient ainsi de la variété dans sa composition grâce au contraste entre les attitudes des corps en mouvement : celles des silhouettes féminines d’abord puisque chaque mouvement de marche des femmes est diffé-rent ; ensuite par le contraste entre le déplacement aérien d’Aurore et le mouvement d’ensemble formé par les fi gures féminines.
Cependant, ce n’est pas le seul procédé pour obtenir un effet de variété . Guido Reni n’est pas tombé dans le défaut de mettre des contrastes sans ménagement (la diversité prononcée entre chaque corps en mouvement pourrait donner fi nalement quelque chose de semblable, une uniformité des diversités) : un excès de contrastes nuit à la composition d’ensemble car, à partir d’une fi gure, il devient pos-sible de deviner la disposition et l’expression de celles d’à-côté. Abuser du contraste pour un artiste serait enfreindre une loi naturelle :
D’ailleurs, la nature , qui jette les choses dans le désordre, ne montre pas l’affectation d’un contraste continuel ; sans compter qu’elle ne met pas tous les corps en mouvement, et dans un mouvement forcé. Elle est plus variée que cela ; elle met les uns en repos, et elle donne aux autres différentes sortes de mouvement40.
39. « La nature ne nous a pas situés ainsi ; et, comme elle nous a donné du mouvement, elle ne nous a pas ajustés, dans nos actions et dans nos manières, comme des pagodes ; et, si les hommes gênés et ainsi contraints sont insupporta-bles, que sera-ce des productions de l’art ? » EG, « Des contrastes », p. 25.
40. EG, « Des contrastes », p. 26-27.
MEP montesquieu.indd 216MEP montesquieu.indd 216 21/05/07 14:13:3321/05/07 14:13:33
L’esthétique dialectique de Montesquieu 217
En ce sens, Le Triomphe de Bacchus et d’Ariane d’Annibal Carrache dut plus plaire à Montesquieu que L’Aurore de Guido Reni car si tous les corps sont en mouvement chez Reni – excepté, il est vrai, le paysage naturel qui, immobile, semble attendre l’arrivée de l’Aurore –, chez Carrache , la variété de la composition est plus grande en raison du contraste entre les corps statiques et les fi gures animées de divers mou-vements. L’âme du spectateur est alors plus excitée et les esprits ani-maux coulent davantage dans les nerfs, de sorte qu’elle ne peut se lasser de contempler la variété formée par les diverses attitudes des corps .
Il y a enfi n de la symétrie dans la nature , laquelle est cause de plaisir car l’âme l’aperçoit facilement et l’effet provoqué par la symé-trie épargne de la peine au regard. Aussi, « partout où la symétrie est utile à l’âme , et peut aider ses fonctions, elle lui est agréable ; mais, partout où elle est inutile, elle est fade, parce qu’elle ôte la variété »41. Il n’y a donc pas de contradiction entre prôner la variété et défendre l’ordre créé par une symétrie dans une composition . La seule règle à laquelle l’artiste doit se fi er est l’observation de la nature qui doit être sa constante source d’inspiration, de sorte qu’il doit mettre de l’ordre là où la nature en aurait mis et de la variété là où la nature en aurait dispensé.
Conclusion : de la fi nalité de l’esthétique montesquivienne, « Étendre la sphère de notre âme »
Tous les procédés relevés par Montesquieu (la multiplication des points de fuite, la variété ou la symétrie dans les compositions, le tra-vail sur le mouvement) suscitent non seulement de la surprise mais éveillent dans l’âme de la curiosité . À l’instar de la surprise , la curiosité est un sentiment qui participe à la création de la beauté , elle est donc un principe pour l’avènement du beau . Si la surprise et la curiosité peuvent être complémentaires, elles n’en sont pas moins différentes puisque la curiosité ne peut apparaître que lorsqu’un plaisir premier a affecté notre âme ; en ce sens elle consiste à dépasser une première chose aimée pour désirer une autre qui est liée à celle-ci. C’est dans le
41. EG, « Des plaisirs de la symétrie », p. 23.
MEP montesquieu.indd 217MEP montesquieu.indd 217 21/05/07 14:13:3421/05/07 14:13:34
218 Écritures
mouvement même du dépassement qu’apparaît la curiosité ; aussi un ouvrage d’art sera beau s’il pose les conditions de possibilité de ce dépas-sement, s’il sait susciter à la fois un plaisir et son insuffi sance, de telle manière que le plaisir que nous donne un objet suscite, dans le même mouvement, le désir de nous porter vers un autre, lié à celui-ci.
Cette défi nition de la curiosité est suivie d’un exemple aussi curieux que factice, comme si Montesquieu voulait montrer qu’il existe un entraînement à la curiosité , qu’elle se cultive : « Ainsi, quand on nous montre une partie d’un tableau, nous souhaitons de voir la partie qu’on nous cache, à proportion du plaisir que nous a fait celle que nous avons vue »42. La mise en scène de ce dispositif inhabituel – on voit le plus souvent d’abord l’ensemble du tableau pour s’intéresser ensuite à ses parties – révèle une manière de cultiver notre goût en s’exerçant à la curiosité ; ainsi celle-ci n’est possible qu’en fonction d’un plaisir premier et repose sur une mécanique du plaisir . La curio-sité peut donc se cultiver ; ainsi lorsque notre âme est embarquée dans cette mécanique du plaisir , elle ne se repose jamais, recherchant conti-nuellement à « fuir les bornes » des plaisirs déjà ressentis. Comme le souligne Montesquieu dans une formule saisissante, notre âme « vou-drait, pour ainsi dire, étendre la sphère de sa présence »43. Dès lors, si nous désirons cultiver notre goût, jouir du plaisir esthétique d’une œuvre d’art, c’est bien sûr pour le plaisir immédiat ressenti mais par-delà ce plaisir , c’est pour répondre au désir naturel de notre âme , celui de fuir ses propres bornes. En d’autres termes, c’est le désir naturel d’extension de notre âme qui est la fi nalité de la création et de la contemplation artistiques. Le désir de création est donc chez Mon-tesquieu avant tout d’ordre psychologique, il répond à la nécessité ontologique d’extension de notre âme (et non pas à celui de laisser une trace dans l’histoire…)
Cependant, ajoute Montesquieu, comment faire pour étendre cette présence ? À nouveau, seules les créations artistiques peuvent susciter cette curiosité qui en est le moteur. Mais Montesquieu se montre ici d’une précision extrême, opérant une double distinction, d’une part
42. EG, « De la curiosité », p. 16.43. Ibid.
MEP montesquieu.indd 218MEP montesquieu.indd 218 21/05/07 14:13:3421/05/07 14:13:34
L’esthétique dialectique de Montesquieu 219
au sein des arts – entre ce que nous nommerions aujourd’hui l’ar-chitecture décorative des jardins et la peinture –, d’autre part entre la contemplation d’un paysage naturel et la peinture d’un paysage. Reprenons cette démonstration : l’art, en général, vient toujours à notre secours lorsqu’en ville, notre vue est bornée par des maisons ou, lorsqu’à la campagne, elle l’est par mille obstacles naturels. Le secours de l’art consiste en ce qu’il nous permet de découvrir la nature qui se cache elle-même. Comment l’art opère-t-il pour dévoiler la nature , pour nous mettre en contact avec elle ? Et de quel art s’agit-il ?
Lorsque notre vue se trouve bornée par différents obstacles, alors la nature se dérobe à nos yeux ; dans ce cas, nous aimons mieux l’art. Cependant, quand notre vue se retrouve en liberté, quand elle peut voir au loin des prés, des ruisseaux, des collines, elle est plus enchan-tée que de voir les jardins élaborés par Le Nôtre parce que la nature ne se copie jamais elle-même, elle est irrégulière dans ses productions tandis que l’art de Le Nôtre ne produit que de la régularité, de sorte que ses œuvres se ressemblent toutes et ne parviennent pas à déve-lopper notre curiosité . La nature travaillée, façonnée selon des règles d’architecture est donc moins enchanteresse que la nature livrée à elle-même. Il vaudrait alors mieux exercer son œil à contempler des paysages naturels ; mais c’est à ce moment de sa réfl exion que Mon-tesquieu assoit sa distinction : « dans la peinture , nous aimons mieux un paysage que le plan du plus beau jardin du monde ; c’est que la peinture ne prend la nature que là où elle est belle, là où la vue se peut porter au loin et dans toute son étendue, là où elle est variée, là où elle peut être vue avec plaisir »44. L’analyse se situe à deux niveaux et conduit à une même fi nalité, celle de montrer que la peinture de paysage permet au mieux l’extension de la présence de notre âme . Le premier niveau affi rme la supériorité de la peinture de paysage sur l’architecture décorative des jardins, parce que la peinture respecte la diversité, la variété , l’irrégularité des paysages là où la seconde veut instaurer de l’ordre et de la régularité. Le second niveau est d’autant plus intéressant puisqu’il justifi e l’esthétique de Montesquieu : la peinture de paysage est supérieure à la contemplation d’un paysage
44. EG, « De la curiosité », p. 17.
MEP montesquieu.indd 219MEP montesquieu.indd 219 21/05/07 14:13:3421/05/07 14:13:34
220 Écritures
naturel car elle ne conserve de ce dernier que ses beautés. La peinture n’est donc pas l’art de l’imitation de la nature (mimésis) mais de la belle imitation , elle n’est pas non plus l’art de la transfi guration de la nature mais l’art d’extraire les plus beaux points de vue d’un paysage afi n de créer une belle représentation45. Montesquieu donne même les éléments nécessaires pour que la représentation soit belle et soit en mesure d’éveiller la curiosité : la peinture de la nature est belle « là où la vue se peut porter au loin et dans toute son étendue, là où elle est variée, là où elle peut être vue avec plaisir »46.
Une telle précision montre que Montesquieu a su goûter les pein-tures de paysage. Nous avons là un autre aspect de sa culture artis-tique, lequel n’est pas négligeable puisque son esthétique ne défend pas seulement la peinture religieuse et mythologique d’un Raphaël ou d’un Corrège mais également cet aspect moins connu de la peinture italienne, et considéré comme un mode mineur de l’art, ce qui montre à quel point son œil était exercé. Certes, lors de son voyage en Europe, Montesquieu a très bien pu avoir un avant-goût de ce qu’est la peinture de paysages en visitant la Hollande mais, comme le cadre de sa pensée esthétique est le seul art italien47, nous évoquerons à nouveau ce pein-tre italien – Annibal Carrache – dont nous savons que Montesquieu appréciait le travail. En effet, dans son ouvrage Montesquieu critique d’art, Jean Ehrard relève les principales œuvres que Montesquieu a pu contempler lors de son voyage en Italie. Parmi celles-ci, se trouve Le Triomphe de Bacchus et d’Ariane. Dans cette fresque réalisée au palais Farnèse de Rome, le paysage n’est conçu que comme un élément décoratif. Cependant, Annibal Carrache était, à la fi n du XVIe siècle, un peintre apprécié à Rome pour ses paysages qui – s’ils n’étaient pas
45. Trente-six ans plus tard, Kant dans sa Critique de la faculté de juger défen-dra la même idée : « Une beauté naturelle est une belle chose ; la beauté artistique est une belle représentation d’une chose […] Les beaux-arts montrent leur supériorité précisément en ceci qu’ils donnent une belle description de choses, qui dans la nature seraient laides ou déplaisantes. » (Critique de la faculté de juger, § 48, trad. A. Philonenko, Paris, Vrin, 1986, p. 141 et 142 ; souligné par nous).
46. Ibid.47. Sur ce sujet, voir l’ouvrage de Jean Ehrard, Montesquieu critique d’art,
Paris, PUF, 1965, notamment la conclusion, p. 133 et suivantes.
MEP montesquieu.indd 220MEP montesquieu.indd 220 21/05/07 14:13:3421/05/07 14:13:34
L’esthétique dialectique de Montesquieu 221
le thème initiateur de ses tableaux – n’en étaient pas moins le motif principal. Ainsi, La Fuite en Égypte, Le Repos de la fuite en Égypte, La Chasse et La Pêche sont des tableaux où la nature prédomine48. Dans ces quatre œuvres, Carrache peint des paysages idéalisés c’est-à-dire des paysages conçus en fonction d’une pure Idée. Grâce à ce procédé mental, l’artiste se retrouve libre d’organiser son paysage à sa guise, en ne se préoccupant que de la beauté de sa représentation. Il est d’ailleurs frappant de constater que les paysages de Carrache répon-dent aux indications préconisées par Montesquieu. Si, par exemple, nous portons notre attention sur la moitié supérieure gauche de La Fuite en Égypte, le paysage décrit frappe par la richesse de sa variété . Il commence au premier plan, à l’extrême gauche, par un groupe d’ar-bres. Leurs frondaisons sont élevées mais ne dissimulent pas le reste du paysage. Juste derrière ces arbres, une vallée où coule une rivière puis, au second plan, une colline arborée qui ouvre à son tour sur un autre paysage plus lointain où les points de fuite se multiplient, de sorte que le regard se perd dans l’horizon sans fi n dans lequel apparaissent des montagnes. Cette mise en scène de la nature est donc belle non seu-lement en raison de la « variété » du paysage mais aussi parce qu’elle permet à notre âme d’« étendre la sphère de sa présence » jusqu’au plus lointain de ce paysage, c’est-à-dire jusqu’à l’infi ni.
Cette extension de la présence de notre âme n’est évidemment pos-sible que par notre imagination , laquelle est une faculté déterminante pour cultiver notre goût et pour reconnaître le beau . C’est dans un autre texte de l’Essai sur le goût que Montesquieu met en évidence l’importance de l’imagination dans l’appréhension d’une œuvre d’art. Cette dix-neuvième section intitulée « Plaisir causé par les jeux, chu-tes, contrastes » oppose mémoire et imagination : une belle pièce de théâtre vue mille fois reste belle car notre ignorance demeure, puisque nous sommes si touchés que nous ne sentons plus ce qu’on nous dit. Ce que nous connaissons de mémoire ne nous fait plus d’impres-sion mais c’est l’imagination qui nous fait encore apprécier la pièce. Or ce que dit Montesquieu sur le théâtre s’applique parfaitement à
48. Nous pouvons même émettre l’hypothèse inverse : tous ces thèmes peu-vent être pensés comme des prétextes pour peindre la nature .
MEP montesquieu.indd 221MEP montesquieu.indd 221 21/05/07 14:13:3521/05/07 14:13:35
222 Écritures
la peinture en général et aux tableaux de Carrache en particulier : même si notre mémoire croit connaître La Fuite en Égypte, lorsque nous nous retrouvons face à ce tableau, c’est grâce à notre imagination que nous sommes encore émus, parce qu’il permet cette extension de l’âme jusqu’aux confi ns du tableau et même – pourquoi pas ? – d’en sortir pour expérimenter des contrées infi nies accessibles à notre seule imagination .
En somme, la fi nalité qui résulte de la nécessité de former notre jugement de goût est de nous rendre délicats. En effet, si « les gens grossiers n’ont qu’une sensation ; leur âme ne sait composer ni décom-poser ; ils ne joignent ni n’ôtent rien à ce que la nature donne » ; en revanche « les gens délicats sont ceux qui, à chaque idée ou chaque goût, joignent beaucoup d’idées ou beaucoup de goûts accessoires »49. En étendant, grâce à son imagination , la sphère de son âme , l’homme délicat possède et se constitue une infi nité de sensations que les autres hommes n’ont pas. Mais cette délicatesse de l’esprit qui caractérise l’homme de goût n’est pas seulement un don naturel , elle s’acquiert et c’est bien par son esthétique dialectique que Montesquieu entend contribuer à cette acquisition.
49. EG, De la délicatesse, p. 35.
MEP montesquieu.indd 222MEP montesquieu.indd 222 21/05/07 14:13:3521/05/07 14:13:35