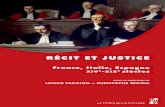Évaluation des apprentissages et analyse des pratiques de ...
La société française à l'épreuve des crises des XIVe et XVe siècles - fascicule de documents...
-
Upload
univ-parisi -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La société française à l'épreuve des crises des XIVe et XVe siècles - fascicule de documents...
1
UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE
U.F.R. S.T.G.I.
2008-2009
Licence
Semestre 6
NEH6MM8
Techniques de l’histoire 2 – médiévale et contemporaine
Histoire médiévale
La société française à l’épreuve des crises des XIVe et XV
e siècles
Bible de Toggenburg, Suisse, 1411
Livret de documents
Cours et travaux dirigés : Matthieu LEGUIL
2
La société française à l’épreuve des crises des XIVe et XV
e siècles
12 travaux dirigés de 1 h 30
Exploitant des sources originales voire inédites, diverses (textes, séries ‘‘statistiques’’, documents
iconographiques...) et tirées de façon privilégiée des fonds d’archives bourguignons et comtois, le
cours porte sur les profondes crises (crise économique, peste, guerre...) qui frappent la France aux
XIVe et XV
e siècles et sur la façon dont la société les subit, les affronte et les surmonte. Sans exclure
un perfectionnement de la méthode du commentaire de texte en histoire médiévale, il se fixe pour
objectif de montrer la complexité des problèmes qui se posent à l’historien pour l’exploitation et
l’interprétation de sources souvent difficiles à ‘‘manier’’.
Lecture obligatoire : DEMURGER, A., Temps de crise, temps d’espoir, XIVe-XV
e siècles, Paris, Seuil,
« Nouvelle histoire de la France médiévale », t. 5, 1990
Table des matières
La société française à l’épreuve des crises des XIVe et XV
e siècles ................................................... 2
Table des matières ................................................................................................................................. 2 Bibliographie .......................................................................................................................................... 3 De l’écritoire du clerc aux pupitres de l’université : itinéraire d’un acte de l’administration
bourguignonne du XIVe siècle .............................................................................................................. 4
La France des XIVe–XV
e siècles : répères ........................................................................................... 6
Dossier 1. La crise économique et ses causes : un grand débat historiographique ....................... 10 Dossier 2. L’impact démographique de la peste : le problème de la mesure en histoire médiévale .... 12 Dossier 3. La guerre et ses misères : les mutations de l’historiographie de la guerre ................... 14 Dossier 4. L’Occident, la peste et les juifs : un problème d’anthropologie historique .................. 16 Dossier 5. Médecins et clercs face à la peste : un problème d’histoire des sciences ...................... 18 Dossier 6. Révolte paysanne et dissensions sociales : exploitation des sources narratives et
histoire des « muets » .......................................................................................................................... 20 Dossier 7. Mortalités et évolution des attitudes devant la mort : un chantier d’histoire des
mentalités ............................................................................................................................................. 22 Dossier 8. L’Etat royal face à la crise : histoire des représentations et renouveau de l’histoire
politique ................................................................................................................................................ 24 Dossier 9. Un nouveau dynamisme économique : exploiter des actes de la pratique .................... 26 Dossier 10. La recomposition de la société, à travers l’exemple de Semur-en-Auxois : l’apport de
la prosopographie à l’histoire sociale ................................................................................................ 28
3
Bibliographie
1. Instruments de travail
1.1. Dictionnaires
FAVIER, J. (dir.), Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993
GAUVARD, C., LIBERA (DE), A., et ZINK, M. (dir.), Dictionnaire du Moyen Age, Paris, P.U.F., 2002
VAUCHEZ, A. (dir.), Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, 2 volumes, Paris, Cerf, 1997
1.2. Atlas
GUYOTJEANNIN, O., Atlas de l’histoire de France, IXe-XV
e siècle, La France médiévale, Paris,
Autrement, 2005
1.3. Recueils de documents et sources éditées
BEAUNE, C. (éd.), Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, Paris, L.G.F., 1990
BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992
GUYOTJEANNIN, O., Archives de l’Occident, t. 1, Le Moyen Age, Ve-XV
e siècle, Paris, Fayard, 1992
1.4. Sites internet (sélection de sites utiles mais de valeur très inégale)
Encyclopédies : Wikipedia, http://www.wikipedia.org, et Imago mundi, http://www.cosmovisions.com
Chronologie : http://www.e-chronologie.org
Localisation : http://www.viamichelin.fr, et http://www.geoportail.fr
Recherche de livres et bibliothèque numérique de Google : http://www.books.google.com
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr
Portail d’histoire du Moyen Age : http://www.menestrel.fr
2. Manuels généraux
*DEMURGER, A., Temps de crise, temps d’espoir, XIVe-XV
e siècles, Paris, Seuil, « Nouvelle histoire de
la France médiévale », t. 5, 1990
FAVIER, J. (dir.), XIVe et XV
e siècles. Crises et genèses, Paris, P.U.F., « Peuples et civilisations », 1996
GAUVARD, C., La France au Moyen Age, du Ve au XV
e siècle, Paris, P.U.F., 2004
3. Manuels thématiques, synthèses et monographies
3.1. Histoire économique
BOIS, G., Crise du féodalisme, Paris, F.N.S.P., 1981
CONTAMINE, Ph., et autres, L’économie médiévale, Paris, Armand Colin, 1993
HEERS, J., L’Occident aux XIVe et XV
e siècles. Aspects économiques et sociaux, Paris, P.U.F., 1963 (et rééd.)
WOLFF, Ph., Automne du Moyen Age ou printemps des temps nouveaux ? L’économie européenne aux
XIVe et XV
e siècles, Paris, Aubier, 1986
3.2. Histoire sociale et démographie historique
DUBY, G., et WALLON, A. (dir.), Histoire de la France rurale, t. 1, La formation des campagnes françaises,
des origines à 1340, et t. 2, L’âge classique des paysans, de 1340 à 1789, Paris, Seuil, 1975
*DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française, t. 1, Des origines à la Renaissance, Paris,
P.U.F., 1988
FOSSIER, R., La société médiévale, Paris, Armand Colin, 1991
LE GOFF, J. (dir.), La ville en France au Moyen Age, Paris, Seuil, 1998
3.2. Anthropologie historique et histoire religieuse
CHELINI, J., Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, Hachette Pluriel, 1991 (rééd.)
MARTIN, H., Mentalités médiévales, XIe–XV
e siècles, Paris, P.U.F., 1996
MARTIN, H., Mentalités médiévales. II, Représentations collectives du XIe au XV
e siècle, Paris, P.U.F., 2001
3.3. Histoire politique
GUENEE, B., L’Occident aux XIVe et XV
e siècles. Les Etats, Paris, P.U.F., 1971 (et nombreuses rééd.)
MOLLAT, M., et WOLFF, Ph., Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe
aux XIVe et XV
e siècles, Paris, Calmann-Lévy, 1970
4
De l’écritoire du clerc aux pupitres de l’université : itinéraire d’un acte de
l’administration bourguignonne du XIVe siècle
Document 1. La pièce cotée HH 3 des Archives municipales de Semur-en-Auxois
Document 2. L’édition : Mandement de Philibert Paillart, bailli d’Auxois, 1355, 25 septembre
A. Original, parchemin, largeur : 220 mm, hauteur : 92 mm, A.M.S.A., HH 3
Philiberz Paillart1, bailli d’Auxois
2, a Guillaume Basin
3 et au prevost de Semur
4 ou son lieutenant
5 et a chascun d’eulx,
salut. Nous avons entandu par la complainte de plusieurs des habitanz de la ville de Semur que il ont ou finage de Genay6
plusieurs vignes et que noble hons li sire de (so) Chastelnuef7 ou ses genz gouvernenz par lui a Genay et a Villoines les
Prostes8 [sic], par aucuns movemens desraisonaubles encontre lesdiz habitanz, entandent et ont en propos et en volunté de
tenir si longuement le ban de venengier les fruz qui a present sont esdictes vignes, pour ayne et pour le domage desdiz
habitanz que, se pour nous n’y est pourveu, lidiz fruz seront es vignes porilluz et gastez et lidiz habitans et autres qui ont
vignes oudit finage de Genay grandement grevez et domagier. Et avec ce, seroit contre le bien et le commun proufit di
païs. Pourquoi nous, a la suplicacion desdiz complaignans, vous mandons et a chascun de vous per soi que vous, audit sire
de Chastelnuef ou en son absence a ses genz par lui gouvernenz audit leu de Genay et de Villoines, requerez de par le roy
nostre seigneur et de par nous que ledit ban mettent, teignent et randent si a point et en temps si convenauble que par eulx
et par leur deffaut lidiz fruz ne pourissent esdictes vignes et que lidiz habitanz et autres cuy sont li heritages n’en soient
grevez ou domagiez, et ycelui ban mis ou a mettre par eulx vous signifient et denomment la randue et ouctroy d’icelui. Et
ou cas ou il en seroient defaillanz ou que par la fame commune et relacion juree de plusieurs proudommes du païs aienz
en ce bonne esperience et vraie cognissance la randue dudit ban estre trop retardee et ou domage des heritiers du païs,
appellez a ce ledit sergent de Villoines ou sesdictes genz se y veullent estre, nous voulons et vous mandons et a chascun
1 Originaire de la ville de Beaune, dont il était bourgeois, Philibert Paillart poursuivit des études de droit civil et devint officier du duc de
Bourgogne et du roi de France. Il fut bailli de Dijon et bailli d’Auxois pour le duc (1352-1358) et chancelier de Bourgogne (1363-1366),
avant de devenir conseiller puis « quart president » au Parlement de Paris, tout en restant conseiller du duc de Bourgogne (1368-1387).
Anobli par le roi Philippe VI en 1341, il épousa la fille du chancelier de France Guillaume de Dormans et acquit au cours de sa brillante
carrière administrative de nombreux fiefs en Bourgogne et ailleurs, devenant en particulier seigneur de la terre de Paillart (Oise). 2 L’Auxois est l’un des cinq bailliages du duché de Bourgogne. 3 Habitant de Semur mentionné comme notaire vers 1350, Guillaume Basin remplit différents offices ducaux de 1348 à sa
mort en 1366 : il fut prévôt de Semur, lieutenant du bailli d’Auxois, procureur au bailliage d’Auxois ou encore receveur au
bailliage d’Auxois de prêts et dons faits au duc et d’impôts consentis au roi. A sa mort, son patrimoine dépassait les
600 florins. On ne sait s’il fut destinataire de ce mandement en tant que lieutenant du bailli ou en tant que procureur au bailliage. 4 Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) était le siège du bailliage d’Auxois et pouvait compter environ 4000 habitants vers 1355. 5 André Le Boiteux, habitant de la ville de Vitteaux (Côte-d’Or), était prévôt de Semur du 24 juin 1355 au 24 juin 1356 ;
cf. A.D.C.O., B 1401, f° 18-18v°. 6 Genay, Côte-d’Or. 7 Pierre, seigneur de Châteauneuf, Villaines-les-Prévôtes et Thorey-sur-Ouche, chevalier, est attesté entre 1316 et 1355.
Important baron bourguignon, il détenait la puissante forteresse de Châteauneuf (Côte-d’Or) et avait figuré au début du
XIVe siècle parmi les seigneurs bourguignons qui avait formé une ligue pour protester contre les abus du pouvoir royal ; cf. le C.D.-
Rom d’H. Mouillebouche in Les maisons fortes..., Dijon, 2002, qui cite le testament de Pierre daté du 31 octobre 1354 et
conservé aux A.D.C.O. sous la cote G 746. Son fils aîné, Gui, chevalier, hérita – entre autres – de Châteauneuf et Villaines. 8 Villaines-les-Prévôtes, Côte-d’Or.
5
de vous par soi que la randue dudit ban vous abrigez et avancissez selon ce que bon et raison vous semblera au consoil et
deliberacion desdis proudommes et autres que bon vous semblera. Et votre abreviacion et avancissement dessusdiz faictes
tenir et garder de par le roy nostre seigneur et de par nous non obstant touz apeaulx frivoles faiz au contraire. De ce faire et
des chauses appartenans, nous vous donnons et a chascun de vous pour soi plain pouvoir et commandement especial.
Donné le mardi devant la feste Saint Remy l’an mil CCCLV.
[Signé :] JEHAN.
Document 3. L’adaptation : Un conflit entre un grand seigneur et des bourgeois en Bourgogne au
lendemain de la peste noire (1355)
Philibert Paillart, bailli d’Auxois, à Guillaume Basin et au prévôt de Semur ou son lieutenant et à chacun
d’eux, salut.
Nous avons entendu la complainte de plusieurs des habitants de la ville de Semur qui disent avoir des vignes au
finage de Genay. Ils disent que noble homme le sire de Châteauneuf ou les gens qui gouvernent en son nom à
Genay et à Villaines-les-Prévôtes, par un mouvement déraisonnable à leur encontre, entendent et ont en volonté de
tenir si longuement le ban de vendanger les fruits qui sont à présent sur les vignes, par haine pour eux et pour leur
dommage que, s’il n’y est pourvu par nous, les fruits pourriront sur les vignes et seront gâtés et les habitants de
Semur et les autres gens qui ont des vignes dans le finage de Genay seront grandement grevés et dommagés1. Et en
plus, cela nuirait au bien et au commun profit du pays.
C’est pourquoi, à la supplication des complaignants, nous vous mandons, et à chacun de vous en tant que cela le
regarde, de requérir, au nom du roi notre seigneur et de nous, du sire de Châteauneuf ou, en son absence, des gens
qui gouvernent en son nom aux lieux de Genay et de Villaines, la mise, tenue et achèvement du ban en temps
suffisamment convenable pour que les fruits ne pourrissent pas sur les vignes par leur faute et que les habitants de
Semur et les autres gens qui ont des héritages2 ne soient pas grevés et dommagés. Nous vous mandons aussi de
requérir d’eux qu’ils vous signifient et vous précisent la date de l’achèvement et octroi du ban qu’ils ont mis ou
qu’ils s’apprêtent à mettre. Et s’ils se montraient défaillants ou s’il apparaissait par notoriété publique et par les
dépositions sous serment de plusieurs prud’hommes du pays ayant une bonne expérience et de vraies connaissances
en la matière que l’achèvement du ban était trop retardé, et ce au dommage des héritiers3 du pays, nous voulons et
vous mandons, et à chacun de vous en tant que cela le regarde, que, ayant appelé le sergent de Villaines ou ses gens,
s’ils veulent être présents, vous abrégiez la durée du ban et avanciez son achèvement de la façon qui vous semblera
bonne et raisonnable, d’après le conseil et la délibération desdits prud’hommes et d’autres gens qu’il vous aura
semblé bon d’appeler pour vous prêter conseil. Et faites tenir et garder votre décision au nom du roi notre seigneur
et de nous, nonobstant tous appels frivoles4.
De faire cela et les choses qui y touchent, nous vous donnons, et à chacun de vous en tant que cela le
regarde, plein pouvoir et commandement spécial.
Donné le mardi avant la fête de saint Rémy en l’an 1355.
[Signé :] JEHAN.
1 Dommagé : victime d’un dommage. 2 Héritage : propriété. 3 Héritier : propriétaire, celui qui détient un héritage. 4 Appel frivole : appel en justice sur la base d’arguments futiles ou réalisé dans le but de gagner du temps.
6
La France des XIVe–XV
e siècles : répères
Document 1. Le royaume de France, 1337-1360 Document 2. La France des principautés, 1407
Source : GAUVARD, C., La France au Moyen Age, du Ve au XV
e siècle, Paris, P.U.F., 2004, p. 386 et 447
Document 3. Le royaume de France de
Louis XI à Charles VIII
Document 4. Paris du XIIIe au XV
e siècle
Source : GAUVARD, C., La France au Moyen Age, du Ve au XV
e siècle, Paris, P.U.F., 2004, p. 502 et 330
7
Document 5. La France urbaine au début du XIVe siècle
Source : BOURIN-DERRUAU, M., Temps d’équilibre, temps de rupture, XIIIe siècle,
Paris, Seuil, « Nouvelle histoire de la France médiévale », t. 4, 1990, p. 306
Document 6. La France urbaine dans la première moitié du XVe siècle
Source : GUYOTJEANNIN, O., Atlas de l’histoire de France, IXe-XV
e siècle, La France médiévale,
Paris, Autrement, 2005, p. 41
8
Document 7. La France dans la Guerre de Cent Ans
1) Première phase (1346-1360)
2) Deuxième phase (1429-1453)
Source : VINCENT, C., Introduction à l’histoire de
l’Occident médiéval, Paris, L.G.F., 1995, p. 211-212
Document 8. L’Etat bourguignon de
l’avènement de Philippe le Hardi (1363) à la
mort de Charles le Téméraire (1477)
Source : GENET, J.-Ph., Le monde au Moyen Age, Paris,
Hachette, 1991, p. 235
9
Document 9. Généalogie des rois de France, XIIIe–XV
e siècle
1) Les Capétiens 2) Les Valois
Source : GAUVARD, C., La France au Moyen Age, du Ve au XV
e siècle, Paris, P.U.F., 2004, p. 532 et 533
Document 10. Généalogie simplifiée des rois d’Angleterre, fin XIIIe–fin XV
e siècle
Source : VINCENT, C., Introduction à l’histoire de l’Occident médiéval, Paris, L.G.F., 1995, p. 201-203
10
La crise économique et ses causes : un débat historiographique
Document 1. La famine en Flandre, 1316
Source : Gilles Le Muisit, abbé de Saint-Martin de Tournai (1272-1352), Chronique, traduction dans GLENISSON, J., et
DAY, J., Textes et documents d’histoire du Moyen Age, XIVe–XV
e siècles, t. 1, Paris, S.E.D.E.S., 1970, p. 8-9
Document 3. Jean le Bon modère les redevances seigneuriales des habitants d’un village de Bourgogne
Jean, par la grâce de Dieu, roi de France, faisons savoir à tous présents et à venir que les habitants de notre ville
de Busseaut1 en Bourgogne nous ont exposé qu’ils sont nos hommes taillables haut et bas et à volonté deux fois
par an, à savoir à la Saint-Rémi et à Carême Prenant2, et qu’il doivent pour leurs labourages certaines corvées et
autres redevances ; qu’ils sont amoindris pour la plus grande partie à cause de la pestilence de la mortalité qui a
couru dans le pays, puisqu’avant la mortalité, ils étaient en la ville de 50 à 60 feux, voire plus, et qu’ils ne sont à
présent pas plus de 10 ou environ ; que néanmoins, on leur a fait payer et l’on veut continuer de leur faire payer
une taille aussi grande qu’auparavant, ce qu’ils ne peuvent faire ni supporter et qui risque de les conduire à fuir
ou partir du lieu et à devenir pauvres et mendiants. Ils nous ont humblement supplié de leur faire grâce sur ces
choses, d’autant qu’à cause des guerres, ils ont été pillés et dommagés par nos ennemis, à tel point que peu leur
est demeuré, que plusieurs habitants ont quitté le lieu et le quittent de jour en jour et que ceux qui sont restés ne
pourront payer les tailles et autres redevances s’il ne leur est pourvu de notre grâce.
Nous, eu regard et considération aux choses susdites et que la ville est moult déchue et qu’une grande partie
des habitations est tombée en ruine faute de manants ou d’habitants et afin que ceux du lieu qui se sont
absentés à cause des grandes charges des tailles et autres redevances puissent revenir et demeurer et vivre sous
nous, en notre joyeux avènement en Bourgogne3, avons octroyé et octroyons par ces présentes, par notre
Document 2. La crise frumentaire au XIVe
siècle, d’après les comptes de recettes des blés
de l’abbaye de Notre-Dame-des-Prés de Douai
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources
d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s.,
Paris, Larousse, 1992, p. 752-755
11
science certaine, puissance plénière et grâce spéciale, aux habitants présents et à venir de la ville que les tailles
qu’ils paient chaque année aux termes de la Saint-Rémi et de Carême Prenant seront réduites à une seule taille
qui se paiera à la Saint-Rémi et qu’ils seront désormais taillés selon leurs facultés du moment et non au regard
des tailles du temps passé si leurs facultés ne le permettent pas. Et en outre, en augmentant notre grâce, nous
avons affranchis et affranchissons pour toujours les habitants de la ville présents et à venir de la morte main
que nous avons sur eux et sur leurs biens, quand nous échoit un cas de mainmorte d’héritage, moyennant
toutefois le paiement des cens et redevances qu’ils nous doivent chaque année.
Ainsi, nous donnons en mandement par ces lettres à notre châtelain d’Aisey et à tous les autres justiciers et
officiers de notre duché de Bourgogne présents et à venir ou à leurs lieutenants, et à chacun d’eux en tant
que cela le regarde, qu’ils entérinent, tiennent et accomplissent notre présente ordonnance, octroi et grâce,
qu’ils en fassent, laissent et souffrent jouir et user paisiblement dorénavant et pour toujours lesdits
habitants, qu’ils ne les empêchent, molestent ou contraignent ou ne supportent qu’on les empêchent,
molestent ou contraignent, et qu’au contraire, que si une chose contraire à notre ordonnance était faite, ils la
ramènent ou la fassent ramener à son état dû sans délai.
Et afin que ce soit chose ferme et stable pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces lettres. Ce
fut fait en ladite ville de Busseaut en l’an de grâce 1362, au mois de février.
Ainsi signé : ‘‘Par le roi, Collors.’’
1 Situé dans le bailliage de la Montagne (Châtillonnais), le village de Busseaut était une seigneurie du duc de Bourgogne administrée
dans le cadre de la châtellenie – cellule de base de gestion du domaine ducal dirigée par un officier, le châtelain – d’Aisey[-sur-Seine]. 2 La Saint-Rémi a lieu le 1er octobre et Carême Prenant – ou Mardi Gras – entre le 3 février et le 14 mars.
3 Jean le Bon reçut le duché de Bourgogne à la mort du dernier duc de Bourgogne capétien, Philippe de Rouvres (21 novembre
1361). Il s’y rendit pour marquer son « joyeux avènement », faisant son entrée à Dijon le 23 décembre et y restant jusqu’au
28 janvier. A cette date, il repartit pour Paris où il fut de retour le 11 février, après être passé par Aignay-le-Duc et Busseaut le 2.
Source : GARNIER, J., Chartes de communes et d’affranchissements en Bourgogne, Dijon, Rabutot, 1868, t. 2, p. 489-490
Document 4. Les interprétations de la crise économique, d’après un manuel récent
On a proposé une explication d’ensemble [des] difficultés et [des] tensions accrues [qui se font jour à la fin du
XIIIe siècle et dans la première moitié du XIV
e siècle], débouchant sur le grippage du moteur de l’économie
occidentale (Guy Bois, Robert Brenner) : il s’agirait d’une « crise du féodalisme », provoquée par une étape
importante à l’intérieur d’un processus constant de baisse tendancielle du prélèvement seigneurial – […] l’une
[de ses] plus importantes causes étant la volonté tenace, ouverte ou insidieuse, des sujets de la seigneurie en vue
d’alléger leurs charges. Pendant longtemps, cette baisse avait été compensée par la mise en valeur de nouveaux
terroirs, la création de nouvelles seigneuries (souvent des coseigneuries). Puis, après le milieu du XIIIe siècle,
cette dilatation […] atteignit ses limites : une classe féodale de plus en plus nombreuse, politiquement sur la
défensive, eut à se partager un profit non seulement stable, mais en recul. A son tour, la diminution du pouvoir
d’achat des maîtres du sol – clercs et laïcs, nobles et non nobles – put avoir des conséquences négatives sur les
secteurs industriel et commercial. […]
Un autre schéma d’explication, mis au point à propos de la situation anglaise (Michael Postan), a rencontré
l’approbation de beaucoup d’historiens : l’explication par la démographie selon un modèle en gros malthusien.
Avec les techniques du temps, et dans le cadre d’un écosystème stable, la production agricole avait atteint son
plafond : la croissance de la population ne pouvait qu’entraîner une baisse progressive du niveau de vie, une
détérioration des conditions d’existence et donc une chute ou un déclin, peut-être voulu mais plutôt subi, de la
démographie.
Il n’est pas sûr toutefois que l’Occident ait alors atteint son maximum de production agricole […]. […] On aurait
pu concevoir dans maint terroir une essor de l’horticulture, une extension de l’irrigation […], une mise en valeur
systématique de la jachère, selon un système de rotation plus souple, plus complexe, d’ores et déjà attesté en
Flandre et ailleurs. Il est vrai que tout cela aurait demandé des investissements supplémentaires (habituellement
un seigneur consacrait nettement moins de 5 % aux investissements proprement dits), peut-être et surtout un
impensable changement de mentalité, dès lors que celle qui dominait visait paresseusement à la simple
reproduction d’un système socio-économique réputé en place depuis des temps immémoriaux. Une très large
portion de la rente foncière se portait vers des dépenses directement improductives […]. En fin de compte,
l’obstacle résultait de deux facteurs : d’une part, le poids majoritaire d’une agriculture d’autoconsommation, ne
visant les excédents que dans certaines limites, d’autre part, l’incapacité des détenteurs de capitaux […] à
entretenir par le réinvestissement une croissance durable, d’abord parce que la consommation somptuaire
primait, ensuite parce que l’origine de leur richesse reposait dans une large mesure sur le prélèvement forcé (de
type seigneurial) et non sur une demande spécifiquement économique (Maurice Aymard).
Source : CONTAMINE, Ph., et autres, L’économie médiévale, Paris, Armand Colin, 1997, p. 296-297
12
L’impact démographique de la peste :
le problème de la mesure en histoire médiévale
Document 1. Evaluations médiévales des pertes démographiques dues à la peste de 1347-1349
1) Selon Guy de Chauliac (v. 1290-1368), médecin du pape Clément VI
La grande mortalité […] apparut en Avignon en l’an de notre seigneur 1348 […]. Elle fut si grande qu’à
peine elle laissa la quatrième partie des gens. […]
2) Selon le poète Guillaume de Machaut (v. 1300-1377), résidant à Reims
Plusieurs alors certainement
Ouïr dire communément
Qu’en 1349
De cent ne demeurait que neuf. […]
3) Selon Jean de Venette (v. 1307-v. 1370), chroniqueur et supérieur pour la France de l’ordre des Carmes Cette année-là [1348], à Paris et dans le royaume de France et non moins, dit-on, dans le reste du monde, et
aussi l’année suivante, il y eut une si grande mortalité d’êtres humains […] qu’à peine pouvait-on les
ensevelir. […] Et très vite, de vingt hommes, il n’en restait pas deux vivants. A l’hôtel-Dieu de Paris, la
mortalité était telle que souvent plus de 500 morts étaient portés chaque jour au cimetière des saints
Innocents pour y être ensevelis. […]
4) Selon un moine anonyme de l’abbaye Saint-Aubin d’Angers
Il régnait alors [en 1349] une grande mortalité, de celle que les médecins appellent épidémie […]. Elle parcourut
tout l’univers mais ne sévit pas dans tous les pays de manière égale car dans quelques contrées, il ne resta que la
dixième partie des hommes, dans d’autres la sixième, dans d’autres il en mourut le tiers, ailleurs le quart. […]
Sources : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s.,
Paris, Larousse, 1992, p. 797-804 (textes 1, 2 et 4), DUPAQUIER, J. (dir.), Histoire de la population française,
t. 1, Des origines à la Renaissance, Paris, P.U.F., 1988, p. 317 (texte 3)
Document 2. La surmortalité engendrée par la peste (XIVe siècle)
1) Sépultures et mariages d’après le compte de la paroisse de Givry en Bourgogne (1334-1357)
Sources : GRAS, P., « Le registre
paroissial de Givry (1334-1357) et la
peste noire en Bourgogne », in B.E.C.,
t. 100, 1939, p. 295-308 (graphiques 1
et 3), et GRESSER, P., La Franche-Comté
au temps de la guerre de Cent Ans,
Besançon, Cêtre, 1989, p. 52
(graphique 2)
2) Les testaments enregistrés à l’officialité de Besançon (1300-1400)
3) La mortalité à Givry de septembre à novembre 1348
13
Document 3. Les populations urbaines et la peste (XIVe-XV
e siècles)
1) La population de Périgueux aux XIVe et XV
e siècles
Source : HIGOUNET-NADAL, A.,
Périgueux aux XIVe et XV
e siècles.
Etude de démographie historique,
Bordeaux, 1978, hors-texte
Source : Archives municipales de
Semur-en-Auxois, CC 33 (1396,
1397, 1400 et 1401), et Archives
départementales de Côte-d’Or,
B 11508-1 et 2 (1404 et 1405)
Document 4. Une démographie historique du Moyen Age semée d’embûches
Le Moyen Age est victime [pour l’histoire de la population des villes] d’un lourd handicap par rapport aux périodes
plus récentes. Il n’existe pas en effet pour la période de documents spécifiques : registres paroissiaux et
recensements véritables. Il a donc fallu rechercher, exploiter et critiquer les documents susceptibles de fournir des
données démographiques. […] Ce sont les documents fiscaux qui constituent la meilleure source. Il faut attendre la
fin du XIIIe siècle et le début du XIV
e pour qu’apparaissent ces archives, constituées pour les besoins des villes et
du gouvernement royal. Il s’agit de listes des chefs de famille soumis à l’impôt ; elles procurent une base qui, certes,
a ses imperfections, puisqu’une partie des habitants échappait à l’impôt, mais qui permet des recoupements lorsque
les noms des contribuables sont mentionnés. […] Ces documents ne fournissent que le nombre minimum des chefs
de familles ; il reste alors à chiffrer le nombre des exemptés, qui a pu être variable. […]
Une partie, souvent importante, de la population n’était pas astreinte à l’impôt, son niveau économique étant trop
bas. Il y avait des exemptés « de droit » : notables et ecclésiastiques en premier lieu. […] Le pourcentage des
exemptés quand il s’agit des plus pauvres […] est presque toujours impossible à chiffrer exactement. Il peut
d’ailleurs varier beaucoup d’une liste à l’autre par suite des variations économiques […]. Les lacunes s’aggravent
en période de crise démographique lorsqu’augmente le nombre des affamés et des errants. […]
La question du chiffre de population des villes doit [donc] être envisagée avec une extrême prudence. On ne peut
pas cependant complètement l’éluder […]. Mais l’opération demeure périlleuse. Les documents utilisés ne
correspondent jamais à notre conception puisqu’ils comptent par feux ou par chefs de famille. […] En outre, le
contenu du feu varie : des différences numériques peuvent exister suivant qu’on est en présence de familles
nucléaires ou de familles larges abritées sous un même toit. L’une et l’autre formule peuvent coexister dans une
même rue, et les données sont, la plupart du temps, insuffisantes pour faire un choix. […]
[Pour] traduire le nombre des feux ou des chefs de famille en nombre d’habitants, [il faut] déterminer la valeur
moyenne du feu médiéval. […] En outre, un seul et même chiffre utilisé sur deux siècles est forcément inexact. Ces
constatations font apparaître la nécessité d’effectuer des analyses nombreuses et approfondies sur les structures
familiales, car les variations du nombre des feux au cours des deux siècles se sont accompagnées de variations dans
la composition de la famille. [Un graphique montre pour le cas de Périgueux que, selon les époques, entre 1245 et
1500, le chiffre moyen du feu a dû varier entre 3,82 et 6.] […]
Que les coefficients familiaux aient beaucoup varié suivant les époques ne fait que rendre plus méfiant à l’égard des
chiffres que certains auteurs ont avancés, en appliquant un multiplicateur moyen.
Source : HIGOUNET-NADAL, A., « La croissance urbaine », in J. Dupâquier (dir.), Histoire de la population française,
t. 1, Des origines à la Renaissance, Paris, P.U.F., 1988, p. 299-303
2) L’impact démographique de la septième peste
(1400), d’après les comptes des impôts
communaux (marcs) de Semur-en-Auxois
14
La guerre et ses misères : les mutations de l’historiographie de la guerre
Document 1. Le récit du début de la bataille de Crécy en 1346 par Jean Froissart
Ce que je sais [de cette bataille], je l’ai surtout su par les Anglais, qui le racontèrent à leur convenance, et aussi
par les gens de messire Jean de Hainaut, qui fut toujours auprès du roi de France.
Les Anglais, qui étaient ordonnés en trois batailles et qui étaient assis paisiblement par terre, se levèrent moult
ordonnément et sans nul effroi et se rangèrent en leurs batailles dès qu’ils virent les Français approcher […]. Vous
devez savoir que ces seigneurs, roi, ducs, comtes, barons français n’arrivèrent pas tous ensemble, mais l’un devant,
l’autre derrière, sans ordre et sans ordonnance. Quand le roi Philippe vint jusque sur la place où les Anglais étaient
arrêtés et ordonnés et les vit, tout son sang reflua, car il les haïssait ; et il ne put alors nullement se réfréner ni
s’abstenir de les combattre ; il dit à ses maréchaux : « Faites passer nos Génois devant et commencer la bataille, au
nom de Dieu et de monseigneur Saint Denis. » Il y avait environ quinze mille de ces Génois arbalétriers et ils
avaient envie de tout sauf de commencer la bataille, car ils étaient durement las et fatigués d’avoir marché ce jour-là
plus de six lieues, tout armés et en portant leurs arbalètes. Ils dirent donc à leurs chefs qu’ils n’étaient pas en état de
faire grand exploit de bataille. Ces paroles volèrent jusqu’au comte d’Alençon, qui en fut durement courroucé et
dit : « Ce ramassis de ribauds qui fait défaut au moment où on en a besoin est un vrai fardeau ! » […]
Pendant que ces paroles étaient prononcées et que les Génois reculaient et se dérobaient, une pluie descendit du ciel,
si grosse et si épaisse que c’était merveilleux, le tonnerre éclata moult grand et moult horrible et le ciel s’assombrit.
Auparavant, au-dessus des armées, d’un côté comme de l’autre, avait volé une grande foison de corbeaux […]. De
sages chevaliers disaient que c’était le signe d’une grande bataille et d’une grande effusion de sang.
Après toutes ces choses, l’air commença à éclaircir et le soleil à luire bel et clair. Les Français l’avaient droit
dans l’œil et les Anglais dans le dos. Quand les Génois furent tous rassemblés et qu’ils durent approcher
l’ennemi, ils commencèrent à crier si fort pour ébahir les Anglais que ce fut merveilleux. Mais les Anglais se
tinrent calmes et ne répondirent pas. Les Génois crièrent une deuxième fois puis avancèrent d’un pas. Une fois
encore, les Anglais restèrent calmes et ne bougèrent pas. Une troisième fois, ils crièrent moult haut et moult clair,
s’avancèrent, tendirent leurs arbalètes et commencèrent à tirer. Quand ils virent la manœuvre, les archers
d’Angleterre avancèrent d’un pas et firent voler leur flèches de grande façon, qui s’abattirent en rangs si serrés
sur les Génois qu’on aurait dit de la neige. Quand ils sentirent ces flèches leur percer les bras, la tête et le visage,
les Génois, qui n’avaient jamais affronté des archers de la trempe de ceux d’Angleterre, se trouvèrent déconfits.
Certains coupèrent les cordes de leur arc, d’autres les jetèrent à terre et ils battirent en retraite.
Entre eux et les Français, il y a avait une grande haie de gens d’armes, montés et parés moult richement, qui les
regardaient, de sorte que, quand ils voulurent fuir, ils n’y parvinrent pas. Quand il vit le désordre des Génois et
s’aperçut qu’ils se dérobaient ainsi, le roi de France, par grand mécontentement, commanda et dit : « Or tôt, tuez
tout ce ramassis de ribauds, car ils nous gênent et occupent la voie sans raison. » Si vous aviez vu alors les gens
d’armes s’élancer dans la confusion sur eux et les frapper ! Plusieurs d’entre eux trébuchèrent et tombèrent, dont
certains ne se relevèrent pas. Pendant ce temps, les Anglais tiraient avec le plus grand empressement et ne
perdaient aucun de leurs traits ; ils empalaient et atteignaient les corps ou les membres des gens et des chevaux
qui trébuchaient et tombaient dans le plus grand malheur ; et ils ne pouvaient être relevés, si ce n’était à grand
déploiement de force et par grande aide de gens. Ainsi se commença la bataille entre la Broyé et Crécy en
Ponthieu, ce samedi à l’heure des vêpres.
Source : BUCHON, J. A. C. (éd.), Les chroniques de sire Jean Froissart, t. Ier, Paris, A. Desrez, 1835, p. 236-238
Document 2. Les ravages des grandes compagnies d’après la plainte d’un prévôt bourguignon (1365)
A monseigneur le duc de Bourgogne, Thibault Le Nain de Villaines[-en-Duesmois], prévôt de Baigneux[-
les-Juifs]1, supplie humblement. Alors qu’il avait retenu à ferme la prévôté de Baigneux pour un an
finissant à la Saint-Jean-Baptiste [24 juin] 1365, il est advenu qu’après la retenue, vers la Madeleine [22
juillet 1364], au moment où le prévôt aurait dû vaqué et chevauché dans le ressort de sa prévôté pour le
visiter, Pierre Dorgueil, Tallebardon [Arnaud de Tallebarde] et plusieurs autres capitaines de Bretons et
Gascons, avec leurs routes2, qui étaient bien 6000 chevaux, vinrent et demeurèrent au ressort de la prévôté
et au pays environnant durant 6 semaines ou plus. Ils gâtèrent tout le pays et dérobèrent blés, vins et fruits.
A cause d’eux, la foire de Baigneux du jour de la Saint-Luc [18 octobre 1364], où le prévôt aurait dû avoir
un grand profit, fut perdue. Item, le dimanche avant les Bordes [23 février 1365], les Navarrais vinrent à
Villaines-les-Prévôtes, où ils sont encore ; ils gâtent tout le pays, prennent les gens et les bêtes grosses et
menues et mettent tout en perdition de jour en jour. Ils ont pris au moins 200 personnes du ressort de la
15
prévôté, qu’ils ont pour la plupart mutilées aux pieds, aux poings ou aux oreilles, de sorte qu’ils ne
gagneront plus jamais leur pain. Et à cause d’eux, la foire du samedi avant Carême Prenant [22 février
1365] est comme perdue, ce qui porte moult grand dommage au suppliant. Mêmement, personne n’ose
s’aventurer dehors ni dans tout le ressort de la prévôté, car elle n’a pas de forteresse où l’on puisse se retirer
ou se réfugier. Et dans cette prévôté, il n’y a point de gros3. Et si personne ne vaquait dans ledit ressort,
monseigneur le duc pourrait perdre sa baronnie4. Ledit prévôt a payé du sien
5 [à la Toussaint 1364] le
premier terme, qui se montait à 45 florins et 100 livres de cire, et il doit autant pour le dernier, qui sera au
mois de Pâques [11 mai 1365]. Veuillez y pourvoir par un bon remède. Ainsi, vous ferez aumône.
1 Prévôt : officier ducal en charge de l’administration d’une prévôté ; depuis le XIIIe siècle, la fonction était affermée. 2 Route : initialement, petit détachement d’hommes armés, au XIVe siècle, compagnie de mercenaires ou de gens de guerre incontrôlés. 3 « Dans cette prévôté, il n’y a point de gros » : la prévôté n’a pas de revenu fixe, si bien que son produit financier provient
essentiellement de revenus qui varient avec la conjoncture – amendes de justices, des droits sur les foires ou les péages, etc. 4 Baronnie : pouvoir, autorité publique du duc. 5 « Le prévôt a payé du sien » : il a payé son fermage sur ses deniers personnels – et non grâce aux profits retirés de la prévôté.
Source : CHARMASSE (DE), A., « Note sur le passage et le séjour des grandes compagnies dans la prévôté de
Baigneux-les-Juifs en 1364 et 1365 », in Mémoires de la Société Eduenne, t. 9, 1880, p. 501-502
Document 3. Deux façons d’écrire l’histoire des Grandes Compagnies (années 1360)
1) Le passage des Compagnies dans la prévôté de Baigneux-les-Juifs d’après Anatole de Charmasse (1880)
Il convient à présent d’opérer en quelques mots l’analyse critique des documents pour établir la chronologie
des événements et mettre en lumière les faits qui s’en dégagent.
La première apparition des compagnies dans la prévôté de Baigneux remonte au 10 juin 1364 et leur présence,
qui durait encore au 26 mai 1365, se prolongea ainsi pendant près d’un an. Il ne s’agissait pas là de quelque
bande errant à l’aventure, mais bien du gros de l’armée des routiers, s’élevant au chiffre de plus de 6000
chevaux. L’importance de ces troupes ressort encore du nom des capitaines qui les commandaient : le célèbre
Arnaud de Tallebarde […], Pierre Dorgueil, un certain Batailler, le même sans doute que Froissart appelle
Batillier, qui luttait contre les troupes royales à la bataille de Brignais, en 1362, et qui, suivant l’expression du
même chroniqueur, appartenait à « la fleur de leurs gens d’armes » […]. Cette occupation paraît se diviser en
deux périodes : la première commençant au 10 juin 1364 et se prolongeant jusqu’à la fin d’octobre […] ; la
seconde commençant à la chandeleur 1365 et durant encore […] en mai 1365 […] : à peine y eut-il entre elles
un court répit, plus apparent peut-être que réel, et qui peut trouver son explication dans le traité conclu à
Autun, au mois de décembre 1365, entre Arnaud de Tallebarde et les agents du duc de Bourgogne. […]
Si quelque doute pouvait encore subsister sur les excès et les actes de barbarie commis par les routiers, la
lecture de ces documents l’aura certainement dissipé : pieds, poings et oreilles coupés ; deux cents personnes
mutilées […] ; blés, vins, fruits pillés ; pays « gâté » ; tout mis « à perdition », tel fut le résultat du passage et
du séjour des Grandes Compagnies dans la prévôté de Baigneux.
Source : CHARMASSE (DE), A., « Note sur le passage et le séjour des grandes compagnies dans la prévôté de
Baigneux-les-Juifs en 1364 et 1365 », in Mémoires de la Société Eduenne, t. 9, 1880, p. 505-506
2) Ce que sont les Compagnies d’après Jean Favier (1980)
Une compagnie, c’est 50 ou 200 hommes aux ordres d’un capitaine qui joue à la fois le rôle d’un entrepreneur
et un administrateur de la société militaire, et celui d’un chef de guerre. Normalement plus nombreuse aux
approches de la campagne annuelle qu’après la dislocation de l’automne, la compagnie grossit et diminue au
fil des opportunités, autour d’un groupe solide et quasi-permanent, fait des compagnons les plus anciens et les
plus fidèles du capitaine, unis à lui pour la fortune et non seulement par la solde.
Gens d’aventure, les capitaines ne sont pas des hors-la-loi. Plus ou moins bien titrés, souvent mieux
apparentés que dotés, beaucoup tiennent à l’ancienne noblesse. Chevaliers ou simples écuyers, ils ont la
guerre pour métier, mais un métier qui ne les empêche nullement de faire leurs les exigences de l’éthique
chevaleresque. Un Mouton de Blainville et un Bertrand du Guesclin dans un camp, un Jean de Grailly dans
l’autre, servent un roi qui les paie mais non n’importe quel roi. Pour mercenaire qu’il soit, leur engagement a
le sens d’un engagement politique. Mais il en est d’autres, qui sont au plus offrant, et qui souhaitent plus
vivement la continuation de la guerre que la victoire définitive. Ils se battent pour leur solde, pour le butin que
l’on amasse au long des chevauchées, pour la rançon que l’on obtient de l’ennemi captif et de la ville
menacée. Et là, tous les moyens sont bons et toute prise est excellente.
Source : FAVIER, J., La guerre de Cent Ans, Paris, Fayard, 1980, p. 301-302
16
L’Occident, la peste et les juifs : un problème d’anthropologie historique
Document 1. Inquiétudes dans le comté de Bourgogne avant l’arrivée de la peste (1348)
Item, 18 deniers furent donnés à un messager le vendredi après l’Ascension [30 mai 1348], pour avoir porté
des lettres envoyées de la part du lieutenant du bailli1 aux prévôts de Dole, de La Loye et de La Ferté, pour
leur faire savoir que l’on avait arrêté à Arbois un homme que l’on appelait Jean de Chambéry en Savoie2,
qui avait reconnu avoir empoisonné les puits de Dole, de La Loye et de La Ferté et de tout le Val de Loue
et disait que les juifs de Lons-le-Saunier leur3 avait donné les poisons, et les inviter à prendre garde et à
nettoyer leur puits et leurs fontaines.
Item, 18 deniers furent donnés au sujet du même fait, pour envoyer des lettres au prévôt de Poligny, car
ledit Jean et un compagnon qui était avec lui disaient avoir empoisonné la fontaine de Poligny par-devers
Arbois, et au châtelain et au prévôt de Lons-le-Saunier pour les informer de l’empoisonnement.
Item, 3 deniers estevenants furent donnés au sujet du même fait, pour faire connaître [à la population] ledit
empoisonnement.
Item, 12 deniers furent donnés au sujet du même fait, pour envoyer des lettres à monseigneur Jean Guillot
et à Renaud Roberçon pour les inviter à prendre garde aux poisons, à faire examiner les fontaines et les
puits à travers toute la châtellenie [de Quingey] et à arrêter toutes gens contrefaites et trépassant4 qui
passeraient par Quingey.
Item, 18 deniers estevenants furent donnés pour faire connaître ce fait à Fraisans, à Chissey et à Liesle et
aviser les gens de ces lieux de nettoyer leurs puits et leurs fontaines.
Item, 6 deniers furent donnés pour envoyer des lettres de restitution au châtelain de Poligny pour qu’il relâche
plusieurs hommes de la châtellenie qui étaient gens de madame [la comtesse] et qu’il avait fait arrêtés pour
avoir pris en chasse d’Arbois à Chamole de Poligny Hugonin de Villemotier5, que Jean de Chambéry avait
dénoncé comme son compagnon pour mettre les poisons, mais qui ne fut finalement pas mis en cause.
Item, 6 deniers furent donnés pour envoyer le mardi avant la Pentecôte [3 juin] bien tard après les vêpres à
Poligny des lettres au sujet de ladite restitution au bailli de Bourgogne de la part d’Emonet de Cridon. 1 Le bailli, le prévôt et le châtelain sont des officiers comtaux locaux chargés de l’administration de la justice, de la défense
et/ou du domaine dans leurs circonscriptions respectives – bailliage, prévôté et châtellenie. 2 Chambéry (Savoie) se situe à environ 200 km d’Arbois, par Bourg-en-Bresse et le piémont jurassien. La peste y était
parvenue durant le premier trimestre de 1348 et s’était accompagnée de persécutions et de massacres à l’encontre des juifs. 3 La suite du document montre que Jean de Chambéry ne voyageait pas seul. 4 Toutes gens contrefaites et trépassant : toute personne qui serait difforme ou mal-formée ou paraîtrait malade ou mourante. 5 Villemotier (Ain) se situe à 20 km au nord de Bourg-en-Bresse et à 80 km au sud d’Arbois.
Source : Compte de messageries de Renaudin de Pupillin, prévôt d’Arbois, pour l’année finissant le 29 septembre 1348,
A. D. Doubs, B 108, f° 4-5 (adapté de l’ancien français d’après une transcription de J. Theurot)
Document 2. La peste, les flagellants, les juifs d’après la Chronique de Jean le Bel (1349)
En ce temps courait une commune et générale mortalité dans le monde entier, provenant d’une maladie
qu’on appelle la bosse ou l’épidémie. […] Si les gens ne savaient que penser ni quel remède donner à
l’encontre, plusieurs pensaient qu’il s’agissait d’un miracle et d’une vengeance de Dieu pour les péchés du
monde, d’où il arriva que certaines personnes commencèrent grande pénitence et grande variété de
dévotions. Entre autres, les gens d’Allemagne commencèrent à aller par le pays à marche forcée et en grand
nombre : ils portaient des crucifix, des gonfanons et de grandes bannières de soie comme on le fait lors des
processions ; ils défilaient dans les rues sur une double file chantant à haute voix des cantiques à Dieu et à
Notre-Dame, puis gagnaient une place où ils se dévêtaient jusqu’à leur linge deux fois par jour et se
fouettaient de coups de lanières et d’aiguilles fichées en elles autant qu’ils le pouvaient si bien que le sang
de leurs épaules coulaient de tous côtés, le tout en chantant leurs cantiques ; puis ils se jetaient trois fois par
terre en signe de piété et par grande humiliation, l’un passait au-dessus de l’autre. […]
Quand certains de ces pénitents et repentants vinrent à Liège, chacun courut les voir, frappé d’étonnement,
s’adonner à leurs afflictions ; chacun leur donnait de l’argent par piété ; […] il semblait à tous qu’ils fussent de
saintes personnes et que Dieu les avait envoyés pour donner l’exemple au commun peuple de faire ainsi
pénitence en rémission des péchés au point que certains habitants de Liège apprirent leurs manières,
traduisirent leurs cantiques et rejoignirent en grand nombre leur troupe […]. Tant de gens en prirent exemple
que chacun voulait les imiter par piété ; mais finalement, la mode s’en développa tellement […] que cette
17
grande humiliation se mua en orgueil et en suffisance. Si le pape ne les avaient pas condamnés par un grave
jugement, ils auraient fini par détruire la sainte Eglise ; ils commençaient déjà à perturber le service et les
offices de la sainte Eglise, certains prétendant par leur sottise que leur cantique et leurs cérémonies étaient plus
dignes que celles de l’Eglise ; on se demandait même si cette folie n’allait pas se développer au point de jeter
bas l’Eglise et de tuer prêtres et clercs par convoitise de leurs biens et de leurs bénéfices.
Pendant que ces flagelleurs cheminaient, se produisit un événement d’un grand étonnement que l’on ne doit
jamais oublier. Quand on s’aperçut que cette mortalité et cette pestilence ne cessait point malgré les actes
de pénitence, naquit une rumeur disant que cette mortalité venait des juifs et que les juifs avaient jeté venins
et poisons dans les puits et les fontaines du monde entier afin d’empoisonner toute la chrétienté pour
s’emparer du pouvoir sur la terre ; c’est pourquoi chacun, puissant ou modeste, fut si remonté contre eux,
que ceux-ci furent tous brûlés et mis à mort par les seigneurs et la justice locale partout où les flagelleurs
passaient : tous allaient mourir en dansant et en chantant aussi joyeusement que s’ils allaient à la noce,
refusant de se convertir ; ni le père ni la mère n’étaient prêts à supporter que leurs enfants reçoivent le
baptême pour peu qu’on leur demandât ; ainsi disaient-ils qu’il avaient lu dans leurs livres des prophètes
que tant que cette secte de flagelleurs courrait de par le monde, toute juiverie serait détruite par le feu et que
les âmes de ceux qui mourraient fermement attachés à leur foi iraient au paradis ; au point que dès qu’ils
voyaient le feu, femmes et hommes pénétraient dedans en chantant et ils y portaient leurs petits enfants de
peur qu’on leur prît pour les convertir.
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992, p. 806-808
Document 3. Persécutions à l’encontre des juifs de Vesoul à la suite de la peste (1349)
[Des] gages [ont été versés] à 12 sergents pour avoir gardé jour et nuit dans des lieux distincts 6 juifs qui avaient été
soumis à la torture et questionnés pour connaître la vérité sur les poudres qu’ils avaient, disait-on, jetées dans les
puits et fontaines.
[Des frais ont été acquittés] pour les dépenses du seigneur de Montbis, de monseigneur Aimé de Velle[-le-Châtel],
de monseigneur Guillaume de L’Isle, du seigneur d’Aroz, de monseigneur Jean de Velle[-le-Châtel], de
monseigneur Othe de Velleguindry, de monseigneur Jacques de Chariez, chevaliers, d’Huguenin de Chariez, de
Guillaume de Vellefaux, de Perrin de Sandrecourt, de Guillaume de La Chapelle, écuyers, faites le mardi après la
Saint-Vincent [23 février 1349] au dîner à Vesoul, où ledit prévôt les avait mandés pour juger les juifs selon les
mérites des confessions qu’ils avaient faites, tant sous la torture qu’autrement, sur le fait des poudres qu’ils avaient
jetées dans les puits et fontaines, disait-on.
[Des] gages [sont versés] à Jacquet, fils du petit sergent de Vesoul, pour avoir conduit à Montbozon deux
jours durant les juifs de Vesoul, que l’on les avait banni de la Comté, afin que l’on ne les tuât pas et que
l’on ne les volât pas.
Source : Compte de la confiscation des biens des juifs de la prévôté de Vesoul rendu par Renaud Joume de Chariez, prévôt de
Vesoul, le 25 novembre 1349, A.D.D. B 151 (extraits adaptés de l’ancien français d’après une transcription de N. Brocard)
Document 4. La recherche des responsables de la peste de 1348, d’après Guy de Chauliac (1363)
Plusieurs hésitèrent sur la cause de cette grande mortalité. En quelques endroits, on crut que les Juifs avaient
empoisonné le monde, c’est pourquoi on les avait tués. En quelques autres, on crut que c’était les pauvres mutilés et
on les chassait. Ailleurs, c’étaient les nobles, aussi craignaient-ils d’aller par le monde. Finalement on en vint à ce
point de tenir les gardes aux villes et aux villages et de ne laisser l’entrée à personne qui ne fût bien connu. Et s’ils
trouvaient des poudres ou onguents sur quelqu’un, craignant que ce fussent des poisons, ils les leur faisaient avaler.
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992, p. 800-802
Document 5. La ségrégation des juifs édictée par le IVe concile du Latran (1215)
Canon 68. – En certaines provinces, juifs ou Sarrasins se distinguent des chrétiens par un habit différent ; en
d’autres, au contraire, règne une telle confusion que rien ne les différencie. D’où il résulte parfois, qu’ainsi
trompés, des chrétiens s’unissent à des femmes juives ou sarrasines ; des Sarrasins ou des juifs à des femmes
chrétiennes. Pour éviter que des unions aussi répréhensibles ne puissent à l’avenir invoquer l’excuse du
vêtement, nous statuons ceci : en toute province chrétienne et en tout temps, ces gens, de l’un ou de l’autre sexe,
se distingueront publiquement par l’habit des autres populations, comme Moïse le leur a d’ailleurs prescrit.
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992, p. 678-679
18
Médecins et clercs face à la peste : un problème d’histoire des sciences
Document 1. La peste en Anjou d’après la Petite chronique de Saint-Aubin d’Angers (après 1351)
En l’année 1349, la huitième du pontificat de Clément VI et la vingt-sixième de l’épiscopat de Foulques de
Mathefelon, évêque d’Angers, Philippe de Valois étant roi de France et Jean, son fils aîné, comte d’Anjou, le
27 septembre mourut Pierre Bonneau, alors abbé de Saint-Aubin, célèbre docteur en décret qui avait été d’abord
moine du nouveau monastère de Poitou puis abbé de Bassac au diocèse de Saintonge, et enfin au monastère de
Saint-Aubin.
Il régnait alors une grande mortalité, de celle que les médecins appellent épidémie ; et succombèrent de cette
mortalité Pierre de Morée, prieur claustral, Pierre Pieferré, armoirier, Guillaume L’Ecuyer, aumônier, Guillaume
Beloceau, infirmier, Pierre de Banne, hôtelier, trois enfants et leur maître frère Robert Guifin. Et en dehors du
monastère, dans les prieurés, les morts furent très nombreux parmi les prieurs et leurs confrères. Elle parcourut
tout l’univers mais ne sévit pas dans tous les pays de manière égale car dans quelques contrées, il ne resta que la
dixième partie des hommes, dans d’autres la sixième, dans d’autres il en mourut le tiers, ailleurs le quart. Et cette
mortalité avait commencé dans les régions de l’Orient, puis elle descendit vers l’Ouest où elle régna moins,
c’est-à-dire qu’elle s’y comporta plus doucement : dans la province de Tours, elle fut moins rigoureuse qu’elle
ne l’avait été communément ailleurs. Et il y avait trois sortes de cette épidémie car quelques-uns crachaient du
sang, d’autres avaient des tâches rouges et brunâtres sur le corps, à la manière du peigne marin ou de la truite, et
aucun ne réchappait de ces deux genres ; les autres avaient des abcès ou des bubons dans l’aine ou sous les
aisselles, et parmi ceux-là quelques-uns en réchappaient. Cette épidémie cessa en Anjou en 1349, vers la
Toussaint. Elle avait commencé l’année précédente vers la Saint-André chez les frères de Saint-Augustin. Et il
faut savoir que ces maladies étaient très contagieuses et que presque tous ceux qui soignaient les malades
mouraient, ainsi que les prêtres qui les confessaient. De même, l’année 1349 et les suivantes, 1350, 1351
jusqu’en août, il y eut une très grande abondance de pluie et il s’ensuivit une énorme famine car en 1351, le
setier de froment atteint deux marcs d’argent, à Brissac, 18 livres de la monnaie en usage et le florin de Florence
valait 40 sous, 50 sous pour une première frappe et 43 en fin de frappe. Et le vin fut aussi cher mais très bon car
la pipe [environ 5 hectolitres] de vin valait 13 florins ou 12 deniers d’or à l’écu des deniers.
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992, p. 803-804
Document 2. La progression
de la peste noire en France
(1347-1351)
Source : GUYOTJEANNIN, O.,
Atlas de l’histoire de France,
IXe-XV
e siècle, La France
médiévale, Paris, Autrement,
2005, p. 59
19
Document 3. La peste de 1348 d’après La grande chirurgie de Guy de Chauliac (1363)
Nous avons manifestement vu les abcès internes être dangereux en la grande mortalité, de façon telle qu’on
n’a jamais entendu parler de semblable : laquelle apparut en Avignon, l’an de Notre Seigneur 1348, en la
sixième année du pontificat de Clément VI, au service duquel j’étais alors, par sa grâce, le serviteur
indigne. Et ne vous déplaise si je la raconte pour sa merveile et afin d’y parer si elle revenait. Ladite
mortalité commença pour nous au mois de janvier de l’an et dura l’espace de sept mois. Elle fut de deux
sortes : la première dura deux mois, avec fièvre continue et crachement de sang ; et on en mourait en trois
jours. La seconde fut tout le reste du temps, aussi avec fièvre continue, abcès et charbons aux parties
externes, principalement aux aisselles et aux aines : et on en mourait dans les cinq jours. Et fut de si grande
contagion – spécialement celle qui était avec des crachements de sang – que non seulement en séjournant
[ensemble] mais aussi en se regardant, l’un la prenait de l’autre : à tel point que les gens mouraient sans
serviteur et étaient ensevelis sans prêtre. Le père ne visitait pas son fils, ni le fils son père : la charité était
morte et l’espérance abattue.
Je la nomme grande parce qu’elle atteint tout le monde ou peu s’en faut. Car elle commença en Orient et
jetant ainsi ses flèches contre le monde, passa par notre région vers l’Occident. Elle fut si grande qu’à peine
elle laissa la quatrième partie des gens. Et je dis qu’elle fut telle qu’on n’a jamais rien entendu de
semblable : car comparées à celles que nous lisons survenues dans une cité de Thrace, de Palestine et autres
du temps d’Hippocrate, citées dans son livre Des épidémies, à celle qui advint au sujet des Romains du
temps de Galien, dans son livre De Euchimia et à celle de la cité de Rome au temps de Grégoire, aucune ne
fut aussi grande que celle-ci. Car celle-là n’occupèrent qu’une région, celle-ci tout le monde ; celles-là
étaient remédiables d’une façon ou d’une autre, celle-ci en aucune. C’est pourquoi elle fut inutile et
honteuse pour les médecins, d’autant qu’ils n’osaient visiter les malades de peur d’être infectés et quand ils
les visitaient, ils n’y pouvaient ni ne gagnaient rien, car tous les malades mouraient, excepté quelque peu
sur la fin qui en échappèrent avec des bubons mûrs. […]
Quoi qu’en dise le peuple, la vérité est que la cause de cette mortalité fut double : l’une active, universelle,
l’autre passive, particulière. L’universelle agente fut la disposition de certaine conjonction des plus grandes,
de trois corps supérieurs, Saturne, Jupiter et Mars, laquelle avait précédé, l’an 1345, le 24e jour du mois de
mars, au 14e degré du verseau. Car les plus grandes conjonctions, ainsi que je l’ai dit au livre que j’ai fait sur
l’astrologie, signifient choses merveilleuses fortes et terribles, tels les changements de règne, l’avènement de
prophètes et les grandes mortalités. Et elles sont disposées selon la nature des signes et l’aspect de ceux selon
lesquels se font les conjonctions. Il ne faut donc pas s’étonner si une si grande conjonction signifia une
merveilleuse et terrible mortalité, car elle ne fut pas seulement des plus grandes mais presque maximale. Et
parce qu’elle fut en signe humain, elle adressa dommage sur la nature humaine ; signe fixe, il signifia longue
durée. Car elle commença en Orient peu après la conjonction et dura encore l’an 1350 en Occident. Elle
imprima une telle forme sur l’air et sur les autres éléments qu’à la façon dont l’aimant attire le fer, elle mit en
mouvement les humeurs épaisses, échauffées et venimeuse ; en les mélangeant au-dedans, cela forma des
abcès desquels s’ensuivirent des fièvres continues et des crachats de sang au commencement ; ladite forme
était si puissante qu’elle brouillait la nature. Puis, quand elle fut atténuée, la nature moins troublée se mit à
rejeter ce qu’elle pouvait au-dehors, principalement aux aisselles et aux aines, causant des bubons et autres
abcès, de sorte que ces abcès extérieurs étaient le produit des abcès internes.
La cause particulière et passive fut la disposition des corps, telle que la cacochymie1, l’affaiblissement et la
fermeture des pores, raisons pour lesquelles mouraient la populace, les laborieux et ceux qui vivaient mal.
On fit porter tout l’effort sur la cure préservative avant l’attaque, curative après l’attaque. Pour la
préservation, il n’y avait rien de meilleur que de fuir la région avant d’être infecté : se purger avec des
pilules aloétiques2, diminuer le sang par phlébotomie
3, purifier l’air par le feu, conforter le cœur de
thériaque4, des fruits, des choses de bonne odeur, conforter les humeurs de bol arménien et résister à la
pourriture par des choses aigres. Pour le traitement curatif, on faisait des saignées et des évacuations, des
électuaires5 et sirops toniques. Les abcès externes étaient mûris avec des figues et des oignons cuits, pilés et
mêlés avec du levain et du beurre, puis ils étaient ouverts et traités à la façon des ulcères. Les bubons
étaient ventousés, scarifiés et cautérisés.
Source : BRUNEL, G., et LALOU, E. (dir.), Sources d’histoire médiévale, IXe-milieu du XIV
e s., Paris, Larousse, 1992, p. 800-802
1 Cacochymie : déficience de la santé, débilité de la constitution. 2 Pilule aloétique : pilule à base d’aloès, plante des régions chaudes désertiques contenant un suc amer. 3 Phlébotomie : incision d’une veine pour provoquer la saignée. 4 Thériaque : étymologiquement, remède contre les morsures des bêtes sauvages ; il s’agit donc d’un contrepoison, qui
remontait à l’antiquité et fut considéré comme une panacée jusqu’au XIXe siècle. 5 Electuaire : préparation pharmaceutique de consistance molle formée de poudres mélangées à du sirop, du miel, des pulpes végétales.
20
Révolte paysanne et dissensions sociales :
exploitation des sources narratives et histoire des « muets »
Document 1. La Jacquerie de 1358 vue par Jean Froissart
Assez tôt après la délivrance du roi de Navarre1, advint une grand’merveilleuse tribulation en plusieurs parties du
royaume de France, notamment en Beauvaisis, en Brie, et sur la rivière de Marne, en Valois, en Laonnois, en la
terre de Coucy et autour de Soissons. Car aucunes gens des villes champêtres, sans chef, s’assemblèrent en
Beauvaisis. Les premiers ne furent pas cent hommes. Ils dirent que tous les nobles du royaume de France,
chevaliers et écuyers, honnissaient et trahissaient le royaume et que ce serait grand bien de les détruire tous. Et
chacun d’eux dit : « […] Honni soit celui qui voudra éviter que tous les gentilshommes soient détruits ! » Alors,
ils s’assemblèrent et s’en allèrent sans autre conseil et sans autres armes que des bâtons ferrés et des couteaux en
la maison d’un chevalier qui demeurait près de là. Ils brisèrent la maison, tuèrent le chevalier, la dame et les
enfants, petits et grands, et brûlèrent la maison. Ensuite, ils s’en allèrent en un autre château fort et firent encore
pire. Ils prirent le chevalier, le lièrent à un poteau bien et fort et violèrent sa femme et sa fille à plusieurs, sous ses
yeux ; puis ils tuèrent la femme qui était enceinte et grosse d’enfant, sa fille et tous les enfants, et enfin ledit
chevalier à grand martyre, et brûlèrent et abattirent le château. Ainsi firent-ils en plusieurs châteaux et bonnes
maisons. Et ils se multiplièrent tant qu’ils furent bien six mille ; et à mesure qu’ils cheminaient, leur nombre
croissait, car chacun de leur semblance les suivait. A tel point que tous les chevaliers, dames et écuyers, leurs
femmes et leurs enfants, les fuyaient ; […] et ils laissaient leurs maisons toutes vagues et leur avoir dedans. Ces
méchantes gens assemblés sans chef et sans armes volaient et brûlaient tout, et tuaient et efforçaient et violaient
toutes dames et pucelles sans pitié et sans merci, comme des chiens enragés. Jamais on ne vit entre Chrétiens et
Sarrasins une forcenerie2 telle que celle dont ces gens se rendaient coupables ; ni homme qui fît de pires maux et
des faits plus vilains et tels qu’aucune créature ne devrait oser penser, aviser ni regarder. Et celui qui en faisait le
plus était le plus prisé et le plus grand maître d’entre eux. Je n’oserais écrire ni raconter les faits horribles et
inconvenables qu’ils faisaient aux dames. Mais entre bien d’autres désordonnances et vilains faits, ils tuèrent un
chevalier qu’ils boutèrent en une broche, et le tournèrent au feu et le rôtirent devant la dame et ses enfants. Puis,
après que dix ou douze eurent efforcé et violé la dame, ils voulurent leur en faire manger par force. Et puis ils les
tuèrent et firent mourir de male-mort. Et ils avaient fait un roi entre eux qui était, disait-on alors, de Clermont-en-
Beauvaisis, et l’élirent le pire des mauvais ; ce roi, on l’appelait Jacques Bonhomme. Ces méchantes gens
brûlèrent au pays de Beauvaisis et aux environs de Corbie, Amiens et Montdidier plus de soixante bonnes
maisons et des châteaux forts. Et si Dieu n’y avait mis remède par sa grâce, le meschef se fût tant multiplié que
toutes les communautés eussent été détruites, ensuite la sainte Eglise et enfin toutes riches gens par tous pays ;
car les gens faisaient tous de la même manière au pays de Brie et de Pertois.
Et toutes les dames et les damoiselles du pays et les chevaliers et les écuyers qui pouvaient leur échapper durent
fuir à Meaux en Brie les uns après les autres […] ; aussi bien la duchesse de Normandie, la duchesse d’Orléans
et foison de hautes dames, que les autres, si elles voulaient se garder d’être violées et efforcées puis tuées et
meurtries.
Les gens se comportaient de semblable manière entre Paris et Noyon, et entre Paris et Soissons et Ham en
Vermandois, et par toute la terre de Coucy. […] Mais Dieu par sa grâce y apporta bon remède, de quoi on doit
bien lui rendre grâce. […]
Quand les gentilshommes de Beauvaisis, de Corbiois, de Vermandois, de Valois et des terres où ces méchantes
gens conversaient et faisaient leurs forceneries virent ainsi leurs maisons détruites et leurs amis tués, ils
mandèrent secours à leurs amis, en Flandre, en Hainaut, en Brabant et en Hesbaye. Alors, il en vint tantôt assez
de tous côtés. Ainsi s’assemblèrent les gentilshommes étrangers et ceux du pays qui les menaient. Ils
commencèrent aussi à tuer et à découper ces méchantes gens, sans pitié et sans merci ; et les pendaient parfois
aux arbres là où ils les trouvaient. De même le roi de Navarre en mit un jour à fin plus de trois mille, assez près
de Clermont en Beauvaisis. Mais ils s’étaient déjà tant multipliés que s’ils s’étaient rassemblés, ils eussent bien
été cent mille hommes. Et quand on leur demandait pourquoi ils faisaient cela, ils répondaient qu’ils ne le
savaient, mais ils le voyaient les autres faire, et ils en faisaient autant et pensaient qu’ils devaient en telle manière
détruire tous les nobles et gentilshommes du monde, de sorte qu’il n’en restât pas un.
Source : BUCHON, J.-A. C. (éd.), Les chroniques de sire Jean Froissart, Paris, Société du Panthéon littéraire,
1853, t. 1, p. 375-377 (adapté de l’ancien français)
1 Selon Les Chroniques de France, la Jacquerie commença le 21 mai 1358. Le roi de Navarre était sorti de prison le 9 novembre 1357. 2 Forcenerie, forsenerie : folie, fureur, délire, brutalité.
21
Document 2. La Jacquerie vue par Jean de Venette
En ce temps-là [1356], les nobles tournant en dérision les paysans et les humbles, les désignaient par le
terme de Jacques Bonhomme. Aussi ceux qui, en cette année, se comportèrent dans la guerre de manière
des campagnards, raillés et méprisés par les autres, prirent ce surnom de Jacques Bonhomme et perdirent
l’appellation de paysans […]. Mais, ô douleur ! beaucoup de ceux qui à ce moment en plaisantaient en
furent victimes par la suite. En effet, beaucoup périrent plus tard misérablement de la main des paysans,
tandis qu’un grand nombre de paysans furent massacrés par quelques nobles et virent en représailles leurs
villages livrés aux flammes. […]
Dans l’été de l’année 1358, les paysans des environs de Saint-Leu et de Clermont au diocèse de Beauvais,
ne pouvant plus supporter les maux qui les accablaient de tous côtés, et voyant que leurs seigneurs, loin de
les défendre, les opprimaient et leur causaient plus de dommages que les ennemis, crurent qu’il leur était
permis de se soulever contre les nobles du royaume et de prendre leur revanche des mauvais traitements
qu’ils en avaient reçus. […]
Aucun noble n’osait se montrer hors des châteaux forts ; car si les paysans l’avaient aperçu ou qu’il fût
tombé entre leurs mains, ou bien il aurait été massacré, ou bien il n’en aurait échappé que fort malmené.
Les paysans prirent tant de force qu’on pouvait les estimer à plus de cinq mille, recherchant les nobles et
désireux de les supprimer avec leurs femmes et leurs enfants. Mais cette entreprise monstrueuse ne dura pas
longtemps ; elle cessa de soi-même, ce n’est pas Dieu qui y mit fin […]. Car, ceux qui au départ s’étaient
lancés dans cette affaire par amour de la justice, et parce que leurs seigneurs, loin de les défendre, les
opprimaient, s’abaissèrent à des actes vils et abominables ; à ce que l’on rapporte, ils se livraient à des
violences contre les nobles dames, massacraient les petits enfants nobles innocents, volaient les richesses,
et s’habillaient, ainsi que leurs paysannes de femmes, avec trop de soin. Ainsi ces mauvaises actions ne
pouvaient se perpétuer longtemps. Ce n’était pas décent. […] Les chevaliers et les nobles refaisant leurs
forces et désirant se venger s’unirent fortement et parcourant les campagnes boutèrent le feu à la plupart
des domaines ; ils égorgèrent misérablement les paysans, les traîtres comme les autres, dans leurs demeures
ou occupés à travailler les vignes ou les champs […].
Source : GERAUD, H. (éd.), Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300 avec les continuations de
cette chronique de 1300 à 1368, Paris, Renouard et Cie, 1843, t. II, p. 237-238 et 263-265 (traduit du latin).
Document 3. La Jacquerie vue par les Grandes chroniques de France
Le lundi 28e jour du mois de mai [1358], plusieurs menues gens de Beauvaisis, des villes de Saint-
Leu-d’Esserent, de Nointel, de Cramoisy et des environs s’émurent et s’assemblèrent par mouvement
mauvais. Et ils coururent sur plusieurs gentilshommes qui étaient en ladite ville de Saint-Leu et en
tuèrent 9 : 4 chevaliers et 5 écuyers. Cela fait, mus de mauvais esprit, ils allèrent par le pays de
Beauvaisis. Et chaque jour, ils croissaient en nombre. Et ils tuaient tous gentilshommes et gentilles
femmes qu’ils trouvaient, ainsi que des enfants. Ils abattaient et brûlaient toutes les maisons de
gentilshommes qu’ils trouvaient, forteresses comme autres maisons. Ils firent un capitaine qu’on
appelait Guillaume Cale.
Source : PARIS, P. (éd.), Les grandes chroniques de France selon que elles sont conservées en l’église de Saint-
Denis en France, t. VI, Paris, Techener, 1838, p. 110 (adapté de l’ancien français)
Document 4. La valeur des sources narratives d’après des historiens des mouvements populaires
Notre exposé […] souffrira de l’état des sources mises à notre disposition. Il y a d’abord la masse des
sources narratives, d’accès le plus immédiat, de lecture la plus aisée. […] La plupart de ces sources
sont hostiles aux ‘‘populaires’’. Certaines colportent contre eux des accusations peu vraisemblables.
D’autres plus subtilement défavorables risquent plus encore de déformer la réalité. Bien rares les
écrivains qui sympathisent vraiment avec les révoltés, recherchent ailleurs que dans une inspiration
diabolique les causes de leurs agitations […]. Cette relative uniformité des attitudes face aux troubles
n’est pas sans intérêt. […] Elle traduit ce que l’on peut appeler le climat social, mais présente un
miroir déformant, dont nous devons nous défier.
Source : MOLLAT, M., et WOLFF, Ph., Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux
XIVe et XV
e siècles, Paris, Calmann-Lévy, 1970, p. 10-11
22
Mortalités et évolution des attitudes devant la mort : un chantier
d’histoire des mentalités
Document 1. L’omniprésence de la mort dans le Journal d’un bourgeois de Paris (1411-1439)
1) La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons et l’exécution d’un traître (1411-1413)
18. Item, le 13e jour d’octobre [1411], les Armagnacs prirent le pont de Saint-Cloud par un faux traître qui
en était capitaine [et] qu’on nommait Colinet de Puiseux, qui [le] leur vendit et livra. Et furent tués moult
de bonnes gens qui étaient dedans et tous les biens perdus, dont il y a avait foison, car tous les villages des
alentours y avaient leurs biens, qui furent tous perdus par le faux traître. […]
25. Item, le jeudi 12e jour de novembre audit an [1411], fut mené le faux traître Colinet de Puiseux [et 6
autres condamnés] aux Halles de Paris. Lui était en la charrette sur une planche, plus haut que les autres,
une croix de bois entre les mains, vêtu comme il fut pris, comme un prêtre. En telle manière, fut mis sur
l’échafaud et dépouillé tout nu, et il fut le 6e à qui l’on coupa la tête et le 7
e fut pendu, car il n’était pas de
leur fausse bande. Et ledit Colinet, faux traître, fut dépecé des quatre membres, et à chacune des maîtresses
portes de Paris, l’un de ses membres [fut] pendu et son corps en un sac au gibet [à Montfaucon], et leurs
têtes aux Halles sur six lances, comme faux traîtres qu’ils étaient. […]
83. Item, le vendredi 15e jour de septembre 1413, fut ôté le corps du faux traître Colinet de Puiseux du
gibet et ses quatre membres des portes […]. Et néanmoins, [il] était mieux digne d’être [brûlé ou] jeté aux
chiens que d’être mis en terre bénite, sauf la chrétienté, mais les faux bandés1 faisaient ainsi à leur volonté.
2) Une épidémie de peste à Paris (1418) 231. Item, cedit mois de septembre, la mortalité était à Paris et aux alentours si très cruelle qu’on eût vu depuis
300 ans par le dit des anciens. Car nul qui fût frappé par l’épidémie n’y échappait, spécialement les jeunes gens
et enfants. Et il en mourut tant vers la fin du mois et si hâtivement qu’il convint faire dans les cimetières [de
Paris] de grandes fosses, où on mettait trente ou quarante [corps], qui étaient rangés comme [des morceaux de]
lards et puis [un peu] poudrés par-dessus de terre. Et toujours, jour et nuit, on ne pouvait sortir dans la rue sans
rencontrer [le corps de] Notre Seigneur qu’on portait aux malades ; et très tôt, ils avaient la plus belle
connaissance de Dieu Notre Seigneur, telle qu’on ne vit jamais des chrétiens en avoir. Mais au dit des clercs, on
n’avait jamais vu ni entendu parler de mortalité qui fût si dévoyée, ni plus âpre, ni dont moins échappèrent de
gens qui en furent frappés, car en moins de cinq semaines trépassa en la ville de Paris plus de 50 000 personnes.
Et tant trépassa de gens d’Eglise qu’on enterrait 4 ou 6 ou 8 chefs d’hôtel à une grand-messe chantée (messe a
notte) et il convenait négocier (marchander) avec les prêtres pour combien ils la chanteraient et bien souvent il
convenait d’en payer 16 ou 18 sous parisis et d’une messe basse 4 sous parisis. […]
233. […] Et fut vrai que les cordonniers de Paris comptèrent le jour de leur confrérie Saint-Crépin et Saint-
Crépinien les morts de leur métier et comptèrent et trouvèrent qu’il était trépassé bien 1800 [personnes],
tant maîtres que valets en ces deux mois [d’octobre et de novembre] en ladite ville.
3) La prédication d’un Franciscain à Paris (1429)
497. […] [Vers le 12 avril 1429,] vint à Paris un cordelier nommé frère Richard, homme de très grande
prudence, savant en oraison, semeur de bonne doctrine pour édifier son prochain. Et il y travaillait si fort
qu’on le croirait difficilement si on ne l’avait vu, car pendant le temps où il fut à Paris, il ne fut qu’une
journée sans faire prédication. Il commença le samedi 16e jour d’avril 1429 à Sainte-Geneviève et le
dimanche suivant, et toute la semaine suivante […] [au cimetière des] Innocents. Il commençait son sermon
vers 5 heures du matin et il durait jusqu’à 10 ou 11 heures. Et il y avait toujours cinq à six mille personnes à
son sermon. Il était monté quand il prêchait sur une haute estrade de près d’une toise et demie de haut, le
dos tourné aux charniers, face à [la rue de] la Charronnerie, à l’endroit de la Danse Macabre2.
4) La famine et ses victimes à Rouen (1439)
761. Item, en ce temps, la vie était si chère à Rouen que le setier de bien pauvre blé coûtait 10 fr. […]. Et
on trouvait tous les jours au milieu des rues des petits enfants morts que les chiens ou les porcs mangeaient.
Et tout [cela] à cause de la cruauté de l’archevêque qui était homme plein de sang et avec lui messire Simon
Morhier, qui avait été prévôt de Paris et avait élevé tant de maltôtes3 que nul ne pouvait vivre en la cité de
Rouen […]. 1 Faux bandés : le terme désigne les Armagnacs qui à ce moment sont à nouveau maîtres de Paris. 2 Il s’agit de la célèbre fresque peinte en 1424-1425 au cimetière des Innocents. 3 Maltôte : impôt.
Source : BEAUNE, C. (éd.), Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, Paris, L.G.F., 1990
23
Document 2. Accord entre un grand officier de
finances du duc de Bourgogne et un prieuré pour la
fondation de trois messes (1419)
Document 3. La danse macabre de l’église
de La Ferté-Loupière en Puisaye (fin du
XVe–début du XVI
e siècle)
Au nom de Notre Seigneur, amen. L’an de son incarnation
1419, le vendredi jour de la fête de saint Ladre, 1er septembre,
je, Renaud Gastellier de Saint-Thibault, conseiller et maître des
comptes de monseigneur le duc de Bourgogne à Dijon, d’une
part, et nous, frère Guillaume Emart, prieur du prieuré de saint
Jean l’Evangéliste fondé au château de Semur-en-Auxois, de
l’ordre de saint Augustin, au diocèse d’Autun, sous l’ordre de
Saint-Maurice en Chablais, au diocèse de Sion, [et quatre]
religieux de ce prieuré, pour nous et nos successeurs, d’autre
part, faisons savoir à tous présents et à venir que nous, de nos
certaines sciences et bon propos et bien avisés sur ce, par la
teneur de ces présentes passons entre nous l’accord suivant.
Je, Renaud, pour la dévotion et singulière affection que j’ai à
Notre Seigneur Jésus-Christ, à la glorieuse Vierge Marie sa
mère et à toute la benoîte cour de paradis, spécialement à
monseigneur saint Jean l’Evangéliste, désirant de tout mon
cœur accroître et augmenter le divin office de Notre Seigneur
en l’église du prieuré de saint Jean fondé au château de Semur,
donne et délivre perpétuellement, par pure et irrévocable
donation faite entre les vifs aux prieur et religieux du prieuré, à
ce présents et acceptant, 20 l. t. d’annuelle rente, à prendre sur
les personnes et héritages ci-après déclarés : [suit la liste des
biens – rentes, cens, immeubles – donnés et de leurs valeurs].
En retour, nous, les religieux et nos successeurs sommes tenus
de célébrer perpétuellement en notre église au grand autel
chaque semaine de l’an pour le salut et remède de l’âme de
maître Renaud et des âmes de Guillemette sa femme et de feu
Pierre Gastellier leur fils et de tous autres auxquels ils peuvent
être tenus trois messes, à savoir le lundi de bon matin une
messe de requiem chantée pour les trépassés, le mercredi une
messe du saint Esprit et le samedi une messe de Notre-Dame.
Et toujours au grand autel et en disant les messes, il y aura deux
cierges avec la torche pour brûler en levant le corps de Jésus-
Christ, lesquelles messes à l’heure où on voudra les dire seront
sonnées à la grosse cloche de notre église de trente coups
chacune. Le tout aux frais et missions de nous, les religieux.
Et nous, les religieux, sommes tenus de mettre et inscrire ces
choses au tableau où sont inscrits nos anniversaires et
recommandations en notre église pour toujours nous en
souvenir et de faire consentir à ces choses monseigneur l’abbé
de Saint-Maurice en Chablais, notre abbé et patron.
En témoignage de ces choses, nous avons requis et obtenu que
le sceau de la cour de monseigneur le duc de Bourgogne soit
mis à ces lettres. C’est fait et passé en présence d’Estienne
Pernot et Jean Sagot, clercs, jurés de cette cour, coadjuteurs de
noble homme Guiot Brandin, tabellion de Semur pour le duc,
présents honorables hommes et sages Jean Brandin, lieutenant
de monseigneur le chancelier de Bourgogne, Guillaume
Flamoinche, bourgeois de Semur, et Perrin de Ravières,
demeurant à Mont-Saint-Jean, témoins à ce appellés et requis
l’an et jour dessusdits. [signé :] E. PERNOT et J. SAGOT.
Source : A. historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice-d’Agaune,
LIB 0/0/13, f° 113-116 (extraits adaptés de l’ancien français)
Source : Galerie de photos de vdbann
sur le site Flickr.com,
http://flickr.com/photos/vdbann/
24
L’Etat royal face à la crise : histoire des représentations et renouveau de
l’histoire politique
« L’histoire de la civilisation doit s’occuper aussi bien des rêves de beauté et de l’illusion romanesque que des chiffres de
la population et des impôts. […] L’illusion même dans laquelle ont vécu les contemporains à la valeur d’une vérité. »
J. Huizinga, cité in Ph. Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours, Paris, Seuil, 1975, p. 99
Document 1. Les cérémonies inaugurales du règne de Jean le Bon (1350)
Après le trépassement du roi Philippe de Valois, régna pour lui Jean, son fils aîné. Il fut couronné en
l’église de Reims le dimanche 26e jour de septembre l’an de grâce 1350. Et aussi, ce jour-là, fut
couronnée la reine Jeanne, femme dudit roi Jean. Et après ce couronnement, le roi fit plusieurs
chevaliers nouveaux, à savoir Charles, son fils aîné, dauphin de Vienne, Louis, son second fils, le
comte d’Alençon, le comte d’Etampes, monseigneur Jean d’Artois, monseigneur Philippe, duc
d’Orléans, frère dudit roi Jean, monseigneur d’Artois, le duc de Bourgogne, fils de la devant dite reine
Jeanne de son premier mari, à savoir de monseigneur Philippe de Bourgogne, le comte de Dampmartin
et plusieurs autres.
Les choses ainsi faites, le roi partit de la ville de Reims le lundi au soir et s’en retourna à Paris par
Laon, Soissons et Senlis. Et lesdits roi et reine entrèrent à Paris à très belle fête, le dimanche 17e jour
du mois d’octobre suivant, après les vêpres, et la fête dura toute la semaine. Et le roi demeura à Paris à
[l’hôtel de] Nesle et au palais jusqu’à la Saint-Martin-d’hiver [11 novembre] suivante ; et il fit
l’ordonnance de son parlement. Et quand le roi entra dans Paris, au retour de son joyeux avènement, la
ville de Paris et le grand pont étaient parés (encourtinés) de divers draps et toutes manières de gens de
métier étaient vêtus, pour chaque métier, de robes pareilles ; et les bourgeois de la ville d’autres robes
pareilles ; et les Lombards qui demeuraient en la ville furent tous vêtus de robes partagées en (partis
de) deux tartares de soie, et chacun avait sur la tête un chapeau haut aigu et partagé (mi parti) de même
que sa robe. Et tous, les uns après les autres, les uns à cheval et les autres à pied, allèrent au devant du
roi qui entra dans Paris à grande joie. Et l’on jouait devant lui de moult de divers instruments.
Source : PARIS, P. (éd.), Les grandes chroniques de France selon que elles sont conservées en l’église de Saint-
Denis en France, t. VI, Paris, Techener, 1838, p. 1-3 (adapté de l’ancien français)
Document 2. La bataille
de Poitiers entre Jean le
Bon et Edouard, prince
de Galles, dit le Prince
Noir (1356)
Source : Jean Froissart,
Chroniques, exemplaire
copié et enluminé à Bruges
(Flandres) vers 1475 pour
Louis de La Gruthuyse,
entré à la Bibliothèque
royale sous Louis XII,
B.N.F., FR 2643, f° 207,
www.bnf.fr/enluminures/
images/jpeg/i3_0028.jpg
25
Document 3. Généraux des finances et trésoriers des guerres à
la fin du XVe siècle
Les généraux des finances, à gauche, ont pour fonction la collecte des
recettes. Ils s’empressent de confier l’argent aux trésoriers des guerres
pour qu’ils effectuent les paiements. Ainsi, le roi ne lève-t-il pas l’impôt
pour accaparer les richesses.
Transcription du quatrain placé sous l’enluminure :
Qui soubmettre veult pays estranger / Par faictz d’armes ou injures venger, /
Des finances doit avoir a suffire / Pour son charroy conduire et arranger / Et a
ses gens tant donner a manger / Que nul par fain les puisse desconfire ; / Ses
tresoriers bons et loyaulx eslire, / Seurs, diligens, bien expers et propices, /
Promptz a payer, gardans bonnes pollices, / Convoitize ne priser deux festuz, /
D’autruy avoir ne porter les pellices. / Avarice corrompt toutes vertuz.
Source : Jean d’Auton, Traité sur le défaut du Garillant, exemplaire
composé pour Louis XII, fin du XVe siècle, B.N.F., FR 5087, f° 5v°,
miniature reproduite in BEAUNE, C., Les manuscrits des rois de France
au Moyen Age. Le miroir du pouvoir, Paris, Bibliothèque de l’image,
1997, p. 110
Document 4. Saint Louis rendant la justice
Après qu’Enguerrand de Coucy eut fait pendre trois nobles
enfants de Flandre, saint Louis enquête et juge le baron
coupable.
Source : Guillaume de Saint-Pathus, Vie et miracles de saint
Louis, exemplaire réalisé par un artiste parisien, second quart
du XIVe siècle, B.N.F., FR 5716, f° 246, miniature reproduite
in BEAUNE, C., Les manuscrits… opus cité, p. 90
Document 5. Le bon gouvernement de
Philippe le Bel et la prospérité du
pays
Philippe le bel, entouré de princes du sang,
de conseillers laïcs, de prélats, de légistes et
d’un bénédictin, se montre attaché au bon
gouvernement. Sur le registre du bas, la
prospérité économique des villes et des
campagnes illustre les effets du bon
gouvernement.
Source : Gilles de Rome, Le régime des
princes, manuscrit exécuté pour la
bibliothèque de l’échevinage de Rouen vers
1450, B.N.F., FR 126, f° 7, miniature
reproduite in BEAUNE, C., Les manuscrits…
op. cit., p. 84
26
Un nouveau dynamisme économique : exploiter des actes de la pratique
Document 1. Le prieur du prieuré de Jouhe fait établir par écrit les revenus de son église (1375)
Au nom de notre Seigneur, amen. Pour cause et raison des guerres qui ont été menées en comté de
Bourgogne par nos seigneurs grands et petits étant en ladite Comté, pour cause des mortalités qui à
plusieurs reprises ont bien abaissé et diminué le peuple et les gagneurs1, par quoi les terres et les meix
2
sont demeurés en ruine et en désert, et aussi pour cause des compagnies qui en ladite Comté ont [fait]
moult de mal et de dommages par plusieurs fois au temps passé, par quoi moult de gens et moult du
peuple de Bourgogne sont morts (ont esté periliés des corps) et moult s’en sont allé hors du pays, et
spécialement du terrain de l’église de Jouhe. Pour ces causes et raisons, qui sont véritables et justes, il a
convenu de nécessité que les rentes, issues et émoluments appartenant au prieuré de Jouhe soient mies en
registre et en forme stable et juste pour ce que moult étaient en péril et incertaines. Et pour ce, je, Jean de
Vautravers, en ce temps humble prieur de Jouhe, par le conseil et rapport des plus anciens prud’hommes
et qui pouvaient le mieux savoir et par grande délibération eue sur ce qui a pu être établi ou fait, je me
suis entremis le plus justement et loyalement et de la façon la plus certaine que j’ai pu et su, ayant Dieu
devant les yeux, pour garder le droit de l’église et celui d’autrui. Considérées les choses ci-dessus dites,
j’ai mis en forme juste et claire et enregistré en ce papier afin de les rendre stables sans contredit les
rentes et les revenus annuels de l’église et appartenant au prieuré de Jouhe par la forme et manière ci-
après écrites. Et ils furent enregistrés [et] déclarés au mois de septembre l’an de grâce courant 1375 sans
gruyse3 ou contredit d’aucun. Et on ne peut ni ne doit leur demander nuls autres rentes ou autres revenus
du temps passé autres que ceux et par la manière ci-après déclarés et non autre chose. 1 Gagneur : actif, travailleur, laboureur. 2 Dans l’espace bourguignon (Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne, Doubs…), le mot meix, qui dérive étymologiquement du
verbe latin manere (demeurer) et du mot manse, désigne la demeure ou l’unité d’exploitation paysanne ; elle comprend non
seulement l’habitation, mais aussi des terres et autres dépendances (étables, abris, puits…). 3 Gruyse, gruse, greuse : querelle, rixe, contestation.
Source : A. D. Doubs, 26 H 75, rentier du prieuré de Jouhe (adapté de l’ancien français d’après une transcription de J. Theurot)
Document 2. Bail à ferme de biens ruraux concédé par une abbaye cistercienne bourguignonne (1409)
Au nom de notre Seigneur amen. L’an de son incarnation 1409, le 15 janvier, nous, Jean Varnier de Fixin et
Gérard, son frère, demeurant à Vitteaux, faisons savoir à tous présents et à venir que nous – et chacun de nous
pour lui et pour le tout – prenons et retenons à titre d’amodiation dès maintenant et pour neuf ans et les neuf
récoltes successives à venir de religieuses personnes et honnêtes les religieux, abbé et convent du monastère de
la Bussière de l’ordre de Cîteaux – s’engageant pour eux et pour leurs successeurs durant lesdites années – toutes
les terres arables, vignes et maisons qu’ils ont et peuvent avoir en la ville, château et finage de Vitteaux et en la
ville et finage de Boussey.
En contrepartie de cette retenue, nous, les preneurs et nos hoirs, sommes et serons tenus de rendre et payer aux
religieux ou à leur commandement certain au porteur de ces lettres chaque année six francs d’or du coin et poids
du roi notre seigneur et une livre de cire au jour de la fête de la Nativité notre Seigneur et, pour une fois, six gros
pour les réparations desdites maisons dans lesquelles nous sommes et serons tenus de demeurer continuellement
durant lesdites années. Et nous sommes et serons aussi tenus de faire sur lesdites vignes quinze centaines de
fossés [et] de pieux durant ledit temps et de faire et cultiver ces vignes chaque année bien et convenablement en
temps et saison dus, à nos frais et dépenses, [en nous chargeant] de tous coûts, façons et administrations de
vigne, au dit et regard d’ouvriers compétents, et de laisser ces vignes en bon état à la fin desdites années.
De cette retenue, nous nous tenons pour bien contents et promettons chacun pour le tout par nos serments pour
ce donnés corporellement aux saints évangiles de Dieu et sous l’obligation de tous nos biens et des biens de nos
hoirs meubles et immeubles, présents et à venir, et spécialement de nos propres corps à mettre, incarcérer et
détenir en prison ferme à nos frais et dépenses [si cela s’avérait nécessaire]. Nous soumettons ces biens et corps,
en ce qui concerne cette retenue, à la juridiction et contrainte de la cour de monseigneur le duc de Bourgogne et à
toutes autres cours aussi bien d’Eglise que séculières, l’une ne cessant pas pour l’autre. Nous voulons être
contraints par ces cours et par chacune d’elles, en ce qui concerne cette retenue, comme s’il s’agissait d’une
chose jugée, à tenir, faire, payer, entériner et accomplir toutes les choses ci-dessus dites et chacune d’elles de la
manière qui est précisée et écrite ci-dessus, à l’exception de rendre et restituer tous coûts et dépenses qui seraient
faits à l’occasion des choses ci-dessus déclarées non tenues et non accomplies, comme il est dit. Toutes et
27
singulières exceptions, déceptions, fraudes, cautèles, cavillations, raisons, défenses et autres aides quelconques
contraires à ce fait cesseront et seront mises en retrait.
En témoignage de cela, nous avons requis et obtenu que soit mis le sceau de ladite cour de monseigneur le duc à
ces présentes lettres faites et passées par-devant Jean de La Combe, clerc, demeurant a Pontonnière, coadjuteur
du tabellion fermier de Vitteaux pour monseigneur le duc, de Huguenin Le Perrier demeurant à Mâlain et
Perrenot Charmerete de ce lieu, témoins appelés à cet effet l’an et jour dessusdits.
[Signé :] J.COMBE. Expédiées par moi [signé :] G.LAPORTE1.
1 Cette deuxième signature est celle du tabellion de Vitteaux, unique notaire ducal en titre de la localité, qui s’est chargé d’expédier
l’acte dressé par le coadjuteur, c’est-à-dire de le vérifier et de le présenter au scellement, l’apposition du sceau de la chancellerie
ducale qui rend les contrats exécutoires. Quant aux coadjuteurs, ils étaient en principe les assistants du tabellion, mais en pratique de
plus en plus ceux qui apparaissaient comme les véritables notaires, cantonnant le tabellion à une fonction de rouage administratif.
Source : A. D. Côte-d’Or, fonds de l’abbaye de La Bussière-sur-Ouche, 12 H 216 (adapté de l’ancien français)
Document 3. Contrat d’engagement d’un clerc auprès d’un boucher dijonnais (1392)
L’an [1392], le vendredi saint avant Pâques [12 avril], Nicolas Péronne de Montsaugeon, clerc,
reconnaît s’être commandé [et] alloué à Thévenin Le Noir alias Le Pitoul de Dijon, boucher, présent et
le retenant, dès maintenant et pour un an entier pour le servir bien et loyalement en l’art et science
d’écriture et en tous autres ouvrages et services licites qu’il pourra et saura faire. En retour, son maître
est et sera tenu de lui prodiguer (soigner) vivres de bouche et gîte bon et convenable selon son état et
la faculté des biens de son maître ledit terme durant. Et avec cela, son maître lui donne de salaire et
loyer pour tout ledit terme la somme de dix francs d’or du coin du roi notre seigneur. De cette somme,
il a eu et reçu de son maître tant en argent comptant qu’en drap quatre francs d’or dont il se tient
content. Et le demeurant qui reste encore à payer de cette somme lui sera baillé et payé par son maître
lorsqu’il fera son service par égale portion ledit terme durant par accord. C’est pourquoi ledit Nicolas
doit et est tenu et a promis de servir bien et loyalement son maître audit art et science d’écriture et en
tous autres ouvrages et services licites qu’il pourra et saura faire, de lui obéir, et de ne pas le quitter
(soy departir de lui) pour servir un autre [maître] ledit terme durant […]. Témoins : Estienne Le Noir
alias Le Pitoul et Hugues Lambelin, bouchers demeurant à Dijon.
Source : A. D. Côte-d’Or, B 11353, registre des minutes de Berthelot Cornu, clerc, coadjuteur du tabellion de
Dijon, f° 89 (adapté de l’ancien français)
Document 4. Un état des relations d’affaires entre un marchand et officier de finances et un
paysan aisé en Bourgogne (1419)
Jean Fraigneau de Gissey-le-Vieil tient à cheptel1 [de maître Renaud Gastellier] 4 bœufs de trait, 1 vache,
1 [autre] vache, [encore] 1 autre vache, 1 veau mâle de 1 an, 5 veaux de 1 an, à savoir 3 mâles et
2 femelles, 2 veaux mâles de 2 ans et 2 génisses (tories) de 2 ans, d’une valeur de 34 fr., et moyennant une
moisson2 de 4 setiers
3 de blé par moitié froment et avoine à la mesure de Saint-Thibault.
Item, il doit par un compte fait le 10 février 1419, la somme de 18,5 fr., ainsi que 7,5 setiers de froment et
3 setiers et 2 boisseaux d’avoine à la même mesure qu’au-dessus pour les moissons du temps passé jusqu’à
la Saint-Martin-d’hiver 1418, ledit terme compris.
Item, il a des bœufs et des vaches qu’il a acheté pour le prix de 50 fr. au Beuvray 14194 pour les engraisser, dont
il doit la moitié du profit, comme il apparaît par des lettres enregistrées au papier des comptes et dont l’original
scellé du sceau de monseigneur le duc se trouve dans la 2e liasse [des baux à cheptel de Renaud Gastellier] : ledit
Jean doit 50 fr. qu’il promet d’employer en bêtes aumailles5 en cette prochaine foire du Beuvray et il doit les
tenir à croît et à cheptel et en rendre compte à maître Renaud Gastellier, etc., par lettres faites et signées par Jean
Sagot au papier signé d’une croix de saint André, feuillet 55, faites le 19 mai 1419. 1 Tenir à cheptel : louer du bétail ; dans le bail à cheptel, la croissance du troupeau permettait d’une part de maintenir sa valeur
initiale (capital), d’autre part de générer un profit (croît) qui était partagé par moitié entre le bailleur et le locataire ; parfois
cependant, notamment en cas d’épizootie, les deux parties pouvaient avoir à supporter – également par moitié – un « décroît ». 2 Moisson : loyer des bêtes. 3 Setier : mesure de capacité ; un setier de blé comportant la moitié de froment et l’autre d’avoine valait de 0,75 à 1 fr. 4 Le Mont-Beuvray, situé à une vingtaine de km à l’ouest d’Autun, était au Moyen Age le théâtre d’une importante foire qui avait
lieu le premier mercredi de mai et les deux jours suivants. 5 Bêtes aumailles : Bêtes à cornes (bœufs, vaches, taureaux).
Source : A. D. Côte-d’Or, B II 356-4, cote 19, pièce II, inventaire des baux à cheptel de Guillemette, veuve de
Renaud Gastellier, f° 19v° (adapté de l’ancien français)
28
La recomposition de la société, à travers l’exemple de Semur-en-Auxois :
l’apport de la prosopographie à l’histoire sociale
Document 1. L’élite urbaine de Semur-en-Auxois : les habitants les plus fortement taxés dans le
rôle de l’impôt communal (marcs) de 1404
N.B. : la cote d’imposition la plus basse est de 12 d., c’est-à-dire 1 s., et la cote moyenne de 6,8 s.
Source : A. D. Côte-d’Or, B 11508-1
Document 2. Acquisitions foncières de riches Semurois (1410 et 1433)
1) Reconnaissance de fief rendue par un officier ducal semurois au seigneur d’Epoisses (1410)
Au nom de Notre Seigneur, amen. En l’an de son incarnation courant 1410, le 16e jour du mois d’avril
après Pâques, je, Jean Brandin de Semur confesse et fais savoir à tous [ceux] qui verront ces lettres, que je
tiens en fief et foi de noble et puissant seigneur monseigneur Guillaume de Mello, seigneur d’Epoisses et
du Vic-de-Chassenay, les héritages qui s’ensuivent, assis et situés dans les finages de Chassenay et de
Torcy, en la justice haute, moyenne et basse de monseigneur d’Epoisses. Ces héritages furent à Arnier de
Cernaisot, écuyer, et après lui à Jeannete, sa sœur, femme de Jehan Voisin de Lucenay. [La reconnaissance
porte sur 16 biens qui tiennent au total en 3/16 des tierces du finage de Cernois, 3 soitures et 1 quartier de
pré, 18 journaux de terre et une redevance de 1 moiton d’avoine due chaque année par Jean Guenin du Vic
sur 1 journal de terre assis derrière sa maison] et généralement [sur] tous les autres héritages que j’ai audit
finage du Vic et de Torcy qui furent à Arnier et à Jeannette sa sœur. Je promets par ma foi et serment, sous
l’obligation desdits héritages et de leurs revenus (fruits), de desservir ou faire desservir ledit fief envers
mon seigneur selon qu’il appartient et que les bons us et coutume de Bourgogne veulent et requièrent en
cas et matière de tel fief. En témoignage, j’ai requis et obtenu que le sceau de la cour de monseigneur le duc
de Bourgogne soit mis à ces présentes lettres de déclaration faites et passées en la présence de Jean
Rigoulet, clerc, demeurant à Semur, juré de ladite cour de monseigneur le duc, coadjuteur du tabellion
fermier de Semur pour le duc, présents messire Thibault Badaut de Semur, prêtre, Jehan Cognot de Nesle,
clerc, et Guillaume d’Autun, pelletier demeurant à Semur, témoins à ce appelés et requis, l’an et jour
dessusdits. [Signé :] RIGOULET.
29
2) Reconnaissance de cens rendue par un boucher semurois au prieuré N.-D. de Semur (1433)
Au nom de Notre Seigneur, amen. Le dimanche jour de Judicame, 29e jour de mars 1433, je, Jacot Pansart de
Semur, boucher, fais savoir à tous que je dois chaque année au mois de mars au prieuré Notre-Dame de Semur
une maille tournois de cens sur la maison où je demeure à présent, qui est assise au Bourg Ranvoisie et qui tient
à la maison de la veuve de Gérard Champ-d’Oiseau, qui m’appartient, d’une part, et à la maison que j’ai acquise
de feu Jacot Abillot, d’autre part. Item, je dois une maille t. sur ladite maison que j’ai acquise de feu Jacot
Abillot, assise audit Bourg Ranvoisie, qui tient à la maison dessusdite, d’une part, et à la maison de feu Jacot Le
Vrais, d’autre part. Item, je dois une maille t. sur une maison que j’ai acquise de feu Henri Le Magnien assise au
Bourg Ranvoisie, qui tient à la maison des héritiers de feu Guiot Le Limonier, d’une part, et à la maison de moi
ledit Jacot, d’autre part. Et je dois aussi une maille t. sur un jardin (curtil) qui m’appartient assis près de la Ruelle
Melot, que j’ai acquis de feu Jacot Abillot, tenant à ladite ruelle, d’une part, et au jardin (curtil) et vigne de feu
Perrenot Le Beau, que tient à présent Guiot de Frôlois. Depuis que je tiens et possède ces biens, j’ai toujours
payé ces cens au receveur des cens du prieuré. Je reconnais que je dois ces 4 mailles de cens et promets de les
payer chaque année. Je promets sur les évangiles sous l’obligation de mes biens et de ceux de mes héritiers.
C’est fait en la présence de Jehan Miget de Semur, clerc, notaire juré de la cour de monseigneur le duc, présents
Jehan Cognage l’aîné, Guiot Panetier, Jehan Peletier demeurant à Semur et autres témoins. [Signé :] J. MIGET.
Source : A. D. Côte-d’Or, E 1453 et G 3300 (extraits adaptés de l’ancien français)
Document 3. Généalogie de la famille Brandin (XIVe–XVI
e siècles)
Document 4. Quand les métiers urbains pavoisent : les vitraux des bouchers et des drapiers de
l’Eglise Notre-Dame de Semur (vers 1460-1470)