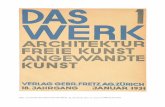Du dialogisme à l'intertextualité: une relecture de la réception de Bakhtine en France (1967-1980)
La sensation visuelle selon Hermann von Helmholtz et sa réception en France
Transcript of La sensation visuelle selon Hermann von Helmholtz et sa réception en France
vers la science de l’art • pups • 2013
117
La sensation visueLLe seLon Hermann von HeLmHoLtz et sa réception en France
Georges Roque
une contemplation attentive des œuvres des grands maîtres sera aussi utile à l’optique physiologique
que la recherche des lois de la sensation et de la perception est profitable à la théorie de l’art 1.
Hermann von Helmholtz
idéalement, ce texte devrait se développer en trois temps : d’abord expliquer quelle est la théorie de la sensation développée par Hermann von Helmholtz et en quoi consiste son apport par rapport aux théories antérieures. ensuite, examiner comment cette théorie s’est diffusée en France. enfin, quel a été son impact sur les artistes. mener à bien un tel programme déborderait largement sur l’espace qui m’est imparti. aussi me contenterai-je d’opérer une synthèse entre ces trois moments, d’autant plus que j’ai déjà développé certains de ces points dans des publications antérieures 2.
tout d’abord, il convient d’évoquer brièvement la question de l’esthétique scientifique. il me semble que la science et l’art ne sont pas des domaines aussi séparés qu’on le dit encore trop souvent. en ce sens, l’esthétique scientifique n’a pas à s’opposer à l’esthétique philosophique ni aux théories artistiques, pas plus que l’art à la science, dès lors que l’on considère cette dernière comme faisant partie de la culture. De ce point de vue, elles peuvent partager, à une époque donnée, une même vision du monde, comme l’a bien exprimé meyer schapiro, qui établira notamment un parallèle entre ernst mach et Georges seurat, les deux ayant justement en commun l’importance qu’ils confèrent aux
1 HermannvonHelmholtz,L’Optique et la Peinture,préfacedeRobertoCasati,Paris,Écolenationalesupérieuredesbeaux-arts,1994,p.21.
2 Voir«Sensaciónalrededorde1880:unanuevarepresentacióndelapercepciónvisualenelarteylaciencia»,dansVariedad infinita: cienciay representación. Un enfoque histórico y filosófico,éd.EdnaSuárezDíaz,Mexico,UNAM/EditorialLimusa,2007,p.131-152;«DasUniversumderEmpfindungen.EineParallelezwischenderphysiologischenOptikundderMalerei»,dansNachbilder. Das Gedächtnis des Auges in Kunst und Wissenschaft,dir.W.BuschetC.Meister,Zürich,Diaphanes,2011,p.155-170.
Arthist science art c1.indb 117 11/04/13 22:59
118
sensations 3. J’ai pour ma part tenté de montrer ailleurs que Helmholtz partage avec les artistes et les critiques de la fin du xixe siècle une même vision du monde que l’on peut qualifier de symboliste 4. De plus, il convient de préciser que Helmholtz ne s’est jamais posé en donneur de leçons, de sorte que loin de moi l’idée que l’optique physiologique apporterait une vérité que l’artiste ne serait pas à même de découvrir seul. Dans sa fameuse conférence « L’optique et la peinture 5 », après avoir rappelé que dans des travaux antérieurs, il s’était efforcé de montrer un parallèle entre la physiologie de l’ouïe et la théorie de la musique, il précise à toutes fins utiles qu’il en va de même concernant la relation entre la physiologie de la perception visuelle et la peinture :
[…] mon intention n’est pas de trouver des préceptes devant servir de règles à l’artiste. J’estime d’ailleurs que c’est une erreur de croire que des recherches esthétiques quelconques puissent jamais fournir de telles règles 6.
La théorie de La perception visueLLe de heLmhoLtz et L’esthétique
Helmholtz était passionné par les questions d’épistémologie et a consacré, après avoir terminé la publication de son monumental ouvrage Optique physiologique 7, divers articles à tirer les conséquences épistémologiques de ses découvertes 8. Dans un très long texte de synthèse, il distingue trois phénomènes différents, relevant chacun d’une approche distincte : d’abord le caractère physique de l’œil en tant qu’instrument d’optique ; ensuite, les processus physiologiques de l’excitation et leur cheminement dans les parties du système nerveux qui lui correspondent ; enfin, la question psychologique de savoir comment tout ce que nous appréhendons mentalement est produit par des changements qui ont lieu dans le nerf optique 9. À ces trois étapes, qui répondent aux trois parties de son Optique physiologique, correspondent trois concepts, respectivement, pour la
3 MeyerSchapiro,Worldview in Painting–Art and Society: Selected Papers,NewYork,GeorgeBraziller,1999,p.40.
4 GeorgesRoque,«SeuratandColorTheory»,dansSeurat Re-Viewed,éd.PaulSmith,UniversityPark(PA),PennsylvaniaStateUniversityPress,2009,enparticulierp.56-59.
5 Pouruneprésentationgénéraledelaproblématiquedecetexte,voirJacquesBouveresse,«Physique,phénoménologieetgrammaire»,dansLangage, perception et réalité,Nîmes,JacquelineChambon,2004,t.II,p.223-247.
6 HermannvonHelmholtz,L’Optique et la Peinture,op. cit.,p.21.7 Lapremièrepartieaparuen1856,lasecondeen1860etladernièreen1866.8 Voirnotamment«ÜberdasSehendesMenschen»(1855),et«DieneuerenFortschrittein
derTheoriedesSehens»(1868),dansVorträge und Reden,Braunschweig,FriedrichViewegundSohn,4eéd.,1896,t.I,respectivementp.85-117etp.265-365;ainsique«DieTatsacheninderWahrnehmung»(1878),t.II,p.213-247.
9 HermannvonHelmholtz,«DieneuerenFortschritteinderTheoriedesSehens»,dansVorträge und Reden,op. cit.,t.I,p.269.
Arthist science art c1.indb 118 11/04/13 22:59
119
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
partie physique, l’impression, pour la partie physiologique, la sensation, et pour la partie psychologique, la perception. résumant ces idées, il expliquera que :
tout ce que nous appréhendons du monde extérieur arrive à notre conscience au moyen de certains changements qui sont produits dans nos organes des sens par des impressions extérieures et qui sont transmises au cerveau par les nerfs. c’est dans le cerveau que ces impressions deviennent d’abord des sensations conscientes, puis sont combinées de façon à produire nos représentations de l’objet (p. 296),
c’est-à-dire nos perceptions. L’importance et la nouveauté de cette conception sont donc, pour aller vite, la dissociation de différents processus jusque-là confondus, et la minimisation conséquente du rôle de l’œil dans la perception visuelle, au profit de processus mentaux qui font que Helmholtz a pu être considéré comme un précurseur des théories cognitives de la perception 10.
avant d’aller plus loin, précisons qu’en ce qui concerne la perception visuelle (à la différence de la perception auditive), Helmholtz n’a pas produit à proprement parler une esthétique scientifique : son travail reste celui d’un savant qui cherche à comprendre les mécanismes de la perception visuelle. aussi convient-il de se demander en quoi une théorie psychophysiologique de la perception visuelle peut intéresser l’esthétique. Le seul texte qu’il a consacré à la peinture, sa conférence « L’optique et la peinture » de 1871, a une visée en apparence modeste :
Dans ces recherches, explique-t-il, il ne s’agit pas d’examiner la mission dernière et le but de l’art, mais uniquement d’expliquer l’influence des moyens élémentaires dont il [le peintre] se sert dans ses œuvres 11.
À quoi tient alors l’importance de ces idées pour l’esthétique ? elles témoignent, me semble-t-il, d’un formidable déplacement d’accent : auparavant, le peintre cherchait à rendre tant bien que mal la réalité extérieure, en essayant d’imiter l’objet. Dorénavant, ce qui importe n’est plus l’objet lui-même mais la façon dont nous le percevons. D’où l’intérêt que porteront les artistes aux phénomènes subjectifs de la perception. il en résulte un bouleversement capital pour l’idée même de représentation picturale.
plus fondamentalement, la théorie psychophysiologique de Helmholtz revient à saper les bases de celle de la mimesis qui recommandait au peintre
10 VoirPascalEngel,introductionaunumérospécialdePhilosophie,«Philosophiedel’esprit»,n°33,hiver1992,p.3.
11 HermannvonHelmholtz,L’Optique et la Peinture,op. cit.,p.21.
Arthist science art c1.indb 119 11/04/13 22:59
120
de représenter le plus fidèlement possible ce qu’il a sous les yeux. précisons toutefois que Helmholtz ne met pas en question directement cette idée.
on pourrait croire, écrit-il, que la tâche du peintre est de chercher […] à produire sur l’œil, à l’aide de son tableau, la même impression que donnerait la réalité. (p. 34)
cependant, s’il prend comme point de départ cette théorie, il démontre de façon éclatante qu’il est rigoureusement impossible de mener à bien une telle prétention, en particulier parce que la luminosité de la nature est incommensurable avec celle de la toile. Dans ses conclusions, il notera que « l’artiste ne peut pas copier la nature, il doit la traduire » (p. 66). on voit donc en quoi la psychophysiologie de la perception visuelle que développe Helmholtz concerne l’esthétique picturale : la théorie de la mimesis contient en effet une conception de la perception visuelle singulièrement naïve, selon laquelle il suffirait au peintre de reproduire sur la toile ce qu’il a sous les yeux en se laissant guider par la sûreté de son œil, et en s’efforçant de fixer le mieux possible tous les détails de son modèle 12.
notons déjà que certains esthéticiens français ont très vite tiré les conséquences des travaux de Helmholtz. tel est notamment le cas de L’Esthétique d’eugène véron, pour qui l’esthétique est tout d’abord définie comme « la science qui traite des sensations ou des perceptions 13 ». or véron est immédiatement conduit à mettre en question l’idée selon laquelle le but de l’art serait l’imitation. et parmi les arguments qu’il donne, l’un est directement tiré de Helmholtz 14, celui qui concerne l’énorme différence de luminosité entre un objet éclairé par le soleil et sa représentation sur une toile 15.
une sémiotique de La sensation
afin d’entrer plus avant dans le détail de la pensée de Helmholtz, on se demandera comment il s’y est pris pour dissocier rigoureusement, dans la perception visuelle, l’impression physique et la sensation physiologique. son
12 C’estcetteattitudequeNormanBrysonajustementcritiquéedanssonlivreVision and Painting. The Logic of the Gaze,NewHaven,YaleUniversityPress,1983.
13 EugèneVéron,L’Esthétique (1878),3eéd.,Paris,C.Reinwald,1890,p.116.14 Celui-ciestbiencité,maisplusloin,auchapitreoùVéronabordelaquestiondelacouleuraux
pages271et280.15 «Orilestscientifiquementconstatéquelalumièredestableauxlespluslumineuxestàpeu
prèsaujourréelcommeunebougieestausoleil.Ilestdoncbienévidentquelepeintrenepeutproduirelasensationdelumièrequeparuneséried’accommodationsetd’artificesqui,del’habiletéseule,feraitdéjàquelquechosedepersonnel»(ibid.,p.128).HelmholtzavaitdéveloppécepointdanslasectiondeL’Optique et la Peintureconsacréeàlaclarté(op. cit.,p.35-39).
Arthist science art c1.indb 120 11/04/13 22:59
121
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
point de départ est une distinction très importante qu’il établit entre deux concepts, image (Bild) et signe (Zeichen), dont il souligne qu’ils ont été trop souvent confondus dans la théorie de la perception. si, dans une image, la représentation (Vorstellung) est du même type que ce dont elle est représentation, il n’en va pas de même pour le signe ou symbole, qui constitue, nous dit-il, un autre type de représentation qui n’est pas fondée sur un lien de ressemblance 16. L’importance de cette distinction est qu’elle permet de rendre compte de la différence entre impression et sensation. si l’impression, phénomène physique, peut encore être pensée comme de l’ordre de l’image, tel n’est plus le cas pour la sensation, phénomène physiologique, qui est de l’ordre du signe ou du symbole. il est intéressant de noter à ce propos que cette sémiotique de la perception visuelle anticipe celle que charles sanders peirce développera quelques années plus tard 17 : la différence que fait Helmholtz entre image et symbole fait fortement songer à celle qu’introduira peirce entre icône et symbole. en effet, comme nous le savons, une icône est un signe dont la principale caractéristique est une relation de ressemblance (p. 144 et 148), tandis que le symbole se définit par un lien conventionnel (p. 161-165).
Helmholtz l’affirmera clairement dans son Optique physiologique : « Je n’ai désigné […] les sensations que comme des symboles des circonstances extérieures et je leur ai refusé toute analogie avec les choses qu’elles représentent 18 ». poussant plus loin sa réflexion, il en tirera des conclusions proprement révolutionnaires qui méritent d’être citées plus longuement, car elles mettent en question la perception visuelle telle qu’on l’envisageait jusque-là :
Les représentations que nous nous formons des choses ne peuvent être que des symboles, des signes naturels des objets, dont nous apprenons à nous servir pour régler nos mouvements et nos actions. […] non seulement il n’existe en réalité aucune autre comparaison entre les représentations et les objets, […] mais encore on ne peut se figurer aucun autre genre de relation : cela ne présenterait absolument aucun sens. (p. 579-580 ; c’est lui qui souligne)
on pourra alors se demander quel est le modèle du signe ou du symbole qu’il avait en tête lorsqu’il les opposait à l’image. La suite du passage qui vient d’être cité nous l’explique :
16 VoirHermannvonHelmholtz,«DieneuerenFortschritteinderTheoriedesSehens»,dansVorträge und Reden,op. cit.,t.I,p.319.
17 D’aprèsDeledalle,c’estàpartirde1867queCharlesSandersPierceliesescatégoriessémiotiques aux types de représentations, dans son ouvrage, Écrits sur le signe(éd.G.Deledalle,Paris,Seuil,1978,p.11).
18 HermannvonHelmholtz,Optique physiologique,trad.E.JavaletTh.Klein,Paris,VictorMassonetFils,1867,p.579;c’estluiquisouligne.
Arthist science art c1.indb 121 11/04/13 22:59
122
L’idée et l’objet qu’elle représente sont deux choses qui appartiennent évidemment à deux mondes tout à fait différents et qui sont aussi peu susceptibles de comparaison que les couleurs et les sons, ou que les caractères d’un livre et le son du mot qu’ils représentent. (p. 580)
autrement dit, le modèle est ici linguistique, soit la relation arbitraire qui existe entre l’écriture et le signifiant verbal 19. une des expressions les plus radicales de cette comparaison se trouvait déjà dans un essai sur Goethe qui date de 1853 :
peut-être que la meilleure façon d’énoncer la relation entre nos sens et le monde extérieur est la suivante : nos sensations sont seulement pour nous les symboles des objets du monde extérieur, et correspondent seulement à eux, d’une certaine façon, comme les caractères écrits ou les mots articulés correspondent aux choses qu’ils dénotent. ils nous donnent certes une information concernant les propriétés des choses qui se trouvent en dehors de nous, mais cette information n’est pas meilleure que celle que nous donnons à un aveugle à partir d’une description verbale de la couleur 20.
Helmholtz insistera sur cette idée fondamentale d’autant plus que, favorable à une approche empirique de la perception, contre la conception innéiste de son maître Johannes müller 21, il liait sa sémiotique perceptive à l’apprentissage, ce qui renforçait encore le lien avec le langage 22.
La transmission des idées de heLmhoLtz en France
Je ne m’étendrai pas sur les courroies de transmission de ces idées en France. ces dernières sont certes présentes dans la traduction française de son monumental traité, Optique physiologique, mais je doute fort que les artistes aient pris connaissance de ce fort volume de plus de mille pages. Quant à sa conférence sur « L’optique et la peinture », elle n’y fait pas directement allusion. J’indiquerai seulement au passage qu’étant donné ce qu’avait de frappant et
19 IlestànoterqueJacquesBouveresseaappeléànuancerlaradicalitédecetteconceptiondelasensationcommesignearbitrairechezHelmholtzdansletomeI,La Perception et le Jugement,desonouvrageLangage, perception et réalité(op. cit.,p.173-175).
20 HermannvonHelmholtz,«ÜberGoethe’snaturwissenschaflischeArbeiten»,dansVorträge und Reden,op. cit.,t.I,p.41-42.
21 Voirsurcepointl’essaitrèsstimulantdeTimLenoir,«TheEyeasMathematician:ClinicalPractise,Instrumentation,andHelmholtz’sConstructionofanEmpiricistTheoryofVision»,dansHermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science,éd.D.Cahan,Berkeley/London,UniversityofCaliforniaPress,1993,p.121sq.
22 VoirHermannvonHelmholtz,«DieneuerenFortschritteinderTheoriedesSehens»,dansVorträge und Reden,op. cit.,t.I,p.363.
Arthist science art c1.indb 122 11/04/13 22:59
123
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
de révolutionnaire cette sémiotique de la perception, il n’est pas étonnant que plusieurs des vulgarisateurs l’aient reprise à leur compte pour mieux mettre en évidence l’apport de Helmholtz. tel est le cas d’auguste Laugel à qui on doit une œuvre importante de chroniqueur scientifique et de vulgarisateur. en 1867, il avait déjà publié La Voix, l’oreille et la musique, d’après la Théorie physiologique de la musique de Helmholtz. il récidive deux ans plus tard, en publiant L’Optique et les Arts, fondé cette fois sur l’Optique physiologique. Dans l’avant-propos de ce dernier ouvrage, il explique : « j’analyse d’abord les sensations visuelles, et je cherche ensuite à tracer les linéaments d’une sorte d’esthétique fondée sur les lois mêmes de l’optique 23 ». Dans la mesure où il considère que, dit-il, « la sensation est l’œuvre, non du nerf optique, mais du cerveau » (p. 17), force est bien de penser que le rapport entre la sensation et l’objet de départ est de l’ordre du signe : « celles-ci [nos sensations] sont les symboles, les signes de certaines réalités qui demeurent éternellement abstraites » (p. 75). or, de quelle nature est ce signe, étant donné la grande différence qui existe entre impression et sensation ? s’impose à nouveau la comparaison avec le mot :
La sensation, sans aucun doute, est toujours en correspondance exacte avec l’impression ; mais elle ne l’est pas autrement que le mot écrit avec la chose qu’il représente. (p. 6)
un an après Laugel, Hippolyte-adolphe taine, qui devait jouer un rôle très important dans la diffusion des idées de Helmholtz en France, adoptera une attitude en tous points semblable dans son livre De l’intelligence 24. abordant la sensation, il distingue bien sa différence de nature avec l’objet, puisque la propriété appartient à l’objet et non à nous, tandis que la sensation nous appartient à nous et non à l’objet. résumant ses acquis à la fin de la troisième partie, il écrivait :
une sensation est un représentant mental, signe intérieur du fait extérieur qui la provoque. [...] ainsi toute sensation normale correspond à quelque fait extérieur qu’elle transcrit avec une approximation plus ou moins grande, et dont elle est le substitut intérieur 25.
en effet, après l’examen des difficultés rencontrées par une aveugle à la suite de son opération afin d’apprendre à voir et organiser les sensations visuelles confuses qu’elle percevait, taine ajoute : « tout ce détail aboutit
23 AugusteLaugel,L’Optique et les Arts,Paris,GermerBaillière,1869,p.V-VI.24 Ilest intéressantdenoteràcetégardque lapremièrepartie,«Lesélémentsde la
connaissance»,secomposedequatrelivresdontlestroispremierss’intitulentrespectivement«Lessignes»,«Lesimages»et«Lessensations».
25 Hippolyte-AdolpheTaine,De l’intelligence(1870),3eéditionrevueetaugmentée,Paris,Hachette,1878,t.I,p.235;c’estluiquisouligne.
Arthist science art c1.indb 123 11/04/13 22:59
124
à la même conclusion : nos sensations visuelles pures ne sont rien que des signes 26 » (t. ii, p. 161 ; souligné par lui) or, de quelle nature sont ces signes ? ici encore, nous retrouvons l’analogie avec les mots :
ainsi nos sensations optiques sont des signes, comme nos mots. comme chaque mot, chaque sensation rétinienne et musculaire de l’œil a son groupe d’images associées ; elle représente ce groupe ; elle le remplace et le signifie. (p. 168 ; souligné par lui)
La réception de L’idée de sensation par Les artistes
ces idées devaient avoir, directement ou indirectement, un grand impact sur les artistes. il apparaît cependant que la distinction entre impression et sensation, telle que l’articule Helmholtz, n’a pas été bien comprise, et que les deux termes sont souvent considérés comme équivalents 27. prédomine encore dans le vocabulaire artistique l’acception de sensation qui sera donnée dans le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle de pierre Larousse : « impression reçue par l’intermédiaire des sens 28 ».
en quoi consiste alors l’apport des idées de Helmholtz ? il est d’abord frappant de constater que le terme sensation se répand très vite dans les ateliers à la fin du xixe siècle. ce qui ressort de son usage par les artistes, qui sont nombreux à l’utiliser, est qu’ils ont bien pris conscience du fait que la sensation est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau bien plus que de l’œil et qu’à ce titre, elle est relativement indépendante des objets qui ont pu la provoquer. D’où le leitmotiv commun à toute une génération : en art, il s’agit non plus d’imiter la nature, mais de rendre ses sensations. ayant signalé ailleurs l’importance de cette nouvelle conception de la sensation visuelle pour des artistes aussi différents que les néo-impressionnistes, pierre Bonnard, ou Frantisek Kupka, je n’y reviendrai pas, car ce qui m’intéresse à présent est de proposer une hypothèse plus générale 29. il me semble en effet que cette nouvelle conception de la
26 Ennote,ilrenvoieàl’Optique physiologiquedeHelmholtz;quelquespagesplusloin,ilciteencore«l’admirablelivredeHelmholtz»,n.1p.166.
27 VoirRichardShiff,Cézanne and the End of Impressionism,Chicago/London,UniversityofChicagoPress,1984,p.17sq.
28 PierreLarousse,Grand Dictionnaire universel du xixe siècle,Paris,1866-1877.29 VoirGeorgesRoque,«SeuratandColorTheory»,art.cit.,p.54sq.ConcernantSeuraten
particulier,onsereporteradanslemêmevolumeautextedeBrendanPrendeville,«SeuratandtheActofSensing:Perception»,p.149-162;Voirlechapitrequej’aiconsacréàlasensationchezBonnarddansmonlivreLa Stratégie de Bonnard. Couleur, lumière, regard,Paris,Gallimard,2006,p.93-112;PourKupka,voirmontexte«Cegrandmondedesvibrationsquiestàlabasedel’univers»,danslecataloguedel’expositionAux origines de l’abstraction,Paris,muséed’Orsay,2003,p.51-52.
Arthist science art c1.indb 124 11/04/13 22:59
125
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
sensation permet de repenser le concept assez critiqué de postimpressionnisme. en effet, de nombreux peintres, soucieux de marquer leurs distances vis-à-vis des impressionnistes, les ont considérés comme un repoussoir parce qu’ils se contentaient de mettre en avant l’impression fugitive qu’ils ressentaient face au motif, en se fiant à leur œil. autrement dit, les peintres postimpressionnistes, ayant très vite assimilé que les sensations se produisent au niveau du cerveau, se sont démarqués des impressionnistes, lesquels ont été associés à une conception de la peinture qui accordait trop d’importance au rendu de « l’impression naïve de la scène », pour citer claude monet qui revendiquait un tel rendu 30.
c’est évidemment le cas de cézanne. même s’il était encore attaché à la nature, il n’en a pas moins insisté sur le fait que « peindre d’après nature, ce n’est pas copier l’objectif, c’est réaliser ses sensations 31 ». il oppose ainsi clairement la réalisation de ses sensations à l’imitation de la nature. La raison en est la différence qu’il fait entre le rôle joué par l’œil et celui dévolu au cerveau, ce dernier étant bien associé à la sensation :
Dans le peintre il y a deux choses : l’œil et le cerveau, tous deux doivent s’entraider : il faut travailler à leur développement mutuel ; à l’œil par la vision sur nature, au cerveau par la logique des sensations organisées, qui donne les moyens d’expression. (p. 36)
s’il plaide en faveur d’une entraide réciproque entre l’œil et le cerveau, il n’en reste pas moins que leur fonction est nettement séparée : si l’œil fournit bien la « vision sur nature », les moyens d’expression, quant à eux, proviennent de la logique des sensations organisées, laquelle relève du cerveau. c’est pourquoi l’œil ne peut se limiter à rendre ce qu’il voit, et c’est justement ce qu’il reproche aux impressionnistes. D’où son éloge ambigu de monet. on connaît sa fameuse boutade : « monet n’est qu’un œil, mais quel œil 32 ! »
si paul cézanne est le peintre moderne le plus souvent associé à l’idée de sensation, lui qui déclarait encore que « peindre, c’est enregistrer ses sensations colorées 33 », il est très loin d’être le seul, le terme étant à l’époque très prisé dans les ateliers. c’est aussi le cas de Henri matisse, vivement frappé par la doctrine de cézanne, telle qu’elle apparaît sous la plume d’émile Bernard en 1904, et dont il recommande la lecture à albert marquet, dès qu’il en prend connaissance, citant
30 LillaCabotPerry,«AnInterviewwithMonet»(1927),dansGustaveGeffroy, Monet, sa vie, son œuvre,Paris,Macula,1980,p.460.
31 PaulCézanne,proposrapportéparÉmileBernard,«PaulCézanne»(1904)reprisdansConversations avec Cézanne,éd.P.M.Doran,Paris,Macula,1978,p.36.
32 CitéparAmbroiseVollard,Paul Cézanne,Paris,G.Grès,1914,p.87-88.33 PaulCézanne,proposrapportéparÉmileBernard,«PaulCézanne»,art.cit.,p.36.
Arthist science art c1.indb 125 11/04/13 22:59
126
en particulier l’idée cézannienne qu’il fera sienne : « organiser ses sensations 34 ». tel est en effet le critère lui permettant de juger si un artiste est bon :
Je crois qu’on peut juger de la vitalité et de la puissance d’un artiste, lorsque impressionné directement par le spectacle de la nature il est capable d’organiser ses sensations 35.
or, c’est justement ce qui, selon lui, fait défaut aux impressionnistes, qu’il critique en jouant sur la proximité des termes impression et impressionnisme :
Le mot impressionnisme convient parfaitement à leur manière, car ils rendent des impressions fugitives. il ne peut subsister pour désigner certains peintres plus récents qui évitent la première impression et la regardent presque comme mensongère. (p. 44-45)
on voit donc que si, au niveau du vocabulaire, les artistes confondent le plus souvent les termes impression et sensation, il n’en reste pas moins, qu’à l’instar de cézanne, ils associent la sensation au cerveau et différencient leur démarche de celle des impressionnistes en reliant ces derniers au rôle de l’œil cherchant à rendre directement ce qu’il voit.
au risque de lasser par un montage de citations, je souhaiterais indiquer que ces idées se retrouvent dans la plupart des mouvements postimpressionnistes ainsi que les avant-gardes historiques. c’était déjà le cas du symbolisme, tel qu’il a été théorisé par Gabriel-albert aurier. même si ce dernier ne fait pas non plus la distinction entre impression et sensation, il critique néanmoins l’impressionnisme comme « la traduction de la sensation instantanée 36 », au nom d’une conception de la peinture dans laquelle les objets n’ont plus de valeur en tant qu’objets, mais en tant que signes :
le but normal et dernier de la peinture […] ne saurait être la représentation directe des objets. […] aux yeux de l’artiste, en effet, […] les objets ne peuvent avoir de valeur en tant qu’objets. ils ne peuvent lui apparaître que comme des signes. (p. 33 ; c’est lui qui souligne)
34 Henri Matisse, Lettre à Marquet, début septembre 1904, dans Matisse – Marquet. Correspondance 1898-1947,éd.C.Grammont,Lausanne,LaBibliothèquedesArts,2008,p.36.Plushautdanslamêmelettre,Matissefaitétatdelanécessitéde«savoircoordonnersessensations»,p.35.
35 HenriMatisse,«Notesd’unpeintre»(1908),reprisesdansÉcrits et propos sur l’art,éd.D.Fourcade,Paris,Hermann,1972,p.51.
36 Gabriel-AlbertAurier,Textes Critiques, 1889-1892. De l’impressionnisme au symbolisme,Paris,Écolenationalesupérieuredesbeaux-arts,1995,p.29;unpeuplusbas,danslemêmeparagraphe,ilajoutequelepublic«s’attendàdesœuvresqueneserontquelafidèletraduction,sans nul au-delàd’uneimpression exclusivement sensorielle,d’unesensation»(c’estluiquisouligne).
Arthist science art c1.indb 126 11/04/13 22:59
127
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
on retrouve à nouveau ici le recours à une sémiotique. en relation avec le symbolisme, les nabis avaient des idées semblables. expliquant les principes qui furent à la base de la formation du groupe, maurice Denis écrit que l’œuvre d’art est « une transposition, une caricature, l’équivalent passionné d’une sensation reçue 37 ». c’est pour cette raison qu’il critique lui aussi les impressionnistes, qui, dit-il, « gâtent la saveur de leur sensation primitive […] par leur dédain de la composition 38 ». on trouve donc déjà chez Denis l’idée de l’importance de l’organisation des sensations, ce qui suppose que l’on s’éloigne de la nature en produisant ce qu’il appelle une déformation subjective, laquelle, écrira-t-il plus tard, « faisait entrer dans le jeu la sensation personnelle de l’artiste 39 ». ailleurs, il précisera que « le symbole d’une sensation devait en être une transposition éloquente 40 ». cette position se trouve confirmée et confortée dans une des définitions de l’art qu’il propose :
L’art n’est plus une sensation seulement visuelle que nous recueillons, une photographie, si raffinée soit-elle, de la nature. non, c’est une création de notre esprit dont la nature n’est que l’occasion 41.
Dans la mesure où Denis a subi l’influence de taine 42, les idées que développe ce dernier à propos de la perception visuelle, en particulier la sensation comme signe, symbole, traduction, substitut jettent un éclairage sur les théories de Denis, notamment sa théorie des correspondances, comme celle de la déformation subjective ou des équivalents. À leur tour, ces idées auront un grand impact sur les artistes du mouvement nabi, et Bonnard en particulier. paul sérusier, un autre théoricien nabi, mettra lui aussi en valeur la sensation en l’opposant au peintre reproduisant simplement les images qu’il perçoit et qui
ne produirait qu’un acte mécanique, auquel ne prendrait part aucune des facultés supérieures de l’homme ; ce serait l’impression notée sans y rien ajouter, travail inintelligent. La nature ainsi comprise n’est plus de la peinture 43.
37 MauriceDenis,«L’influencedePaulGauguin»(1903)dansThéories. 1890-1910,4eéd.,Paris,L.RouartetJ.Watelin,1920,p.167.
38 «Définitiondunéo-traditionnisme»(1890),dansibid.,p.6.39 «L’époquedusymbolisme» (1934),dansDu symbolisme au classicisme. Théories,
éd.O.Revaultd’Allonnes,Paris,Hermann,1964,p.64.40 «DeGauguinetdeVanGoghauclassicisme»(1909),dansThéories. 1890-1910,op. cit.,
p.268.41 Ibid. C’estpourquoi,danssonpremiertexte,ilcritiquaitdéjàlesartistesquienrestentà
leurs«sensationsoptiques»encopiantlanature(«Définitiondunéo-traditionnisme»,p.1.Notonsquepage3,ilseréfèreauxrecherchesdeCharlesHenry).
42 VoirJean-PaulBouillon,«Denis,Taine,Spencer:lesoriginespositivistesdumouvementnabi»,Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français,1999,p.291-309.
43 PaulSérusier,ABC de la peinture. Correspondance(1reédition1921),Paris,Floury,1950,p.7;soulignéparlui.
Arthist science art c1.indb 127 11/04/13 22:59
128
un autre mouvement d’avant-garde qui partage cette même conception générale est le futurisme italien. Dans le « manifeste des peintres futuristes », le tout premier point des déclarations, « 1. il faut mépriser toutes les formes d’imitation » va de pair avec l’exaltation des sensations : « nos sensations en peinture ne peuvent plus être chuchotées 44. » et dans leur manifeste « Les exposants au public », ils iront jusqu’à proclamer l’inséparabilité de la peinture et de la sensation 45. parmi les futuristes italiens, Gino severini est l’un de ceux qui se sont le plus intéressés à cette question. Dans un texte de 1916, « Les arts plastiques d’avant-garde et la science moderne », il écrit que
[l]a sensation s’identifie dans l’idée, car à la vue d’un objet, ou au toucher d’un objet, correspond simultanément une idée-image de cet objet. par conséquent, nous ne donnons pas l’objet, mais l’idée-sensation-image que l’objet provoque en nous 46.
et ailleurs, il développera l’idée de l’indépendance qu’acquiert la sensation visuelle par rapport à l’objet qui en est le point de départ 47.
on en dirait autant des cubo-futuristes russes 48, mais je préfère évoquer pour terminer le cubisme. Dans leur livre pionnier, Du cubisme, albert Gleizes et Jean metzinger opposent, comme le faisait cézanne, l’œil et le cerveau. mieux, plutôt qu’œil, ils utilisent le terme plus technique de rétine par synecdoque particularisante, un terme, on le sait, mis à contribution par marcel Duchamp pour condamner l’art « rétinien ». À propos, une fois encore, de l’impressionnisme, ils écrivent : « ici, plus encore que chez courbet, la rétine
44 Boccioni,Carra,Russolo,Balla,Severini,«Manifestedespeintresfuturistes»(1910),dansFuturisme. Manifestes – Proclamations Documents,éd.GiovanniLista,Lausanne,L’Âged’homme,1973,p.165.
45 «Nousdéclarons,aucontraire,qu’ilnepeutpasyavoirdepeinturemodernesanslepointdedépartd’unesensationabsolumentmoderne,etnulnepeutnouscontredirequandnousaffirmonsquepeintureetsensationsontdeuxmotsinséparables»(Boccioni,Carra,Russolo,Balla,Severini,«Lesexposantsaupublic»[1912],dansibid.,p.168).
46 GinoSeverini,«Lesartsplastiquesd’avant-gardeetlasciencemoderne»(1916)dansArchivi del futurismo,dir.M.DrudiGambilloetT.Fiori,Rome,DeLuca,1958,vol.1,p.202(cetexteserareprisdanssonlivreÉcrits sur l’art,maisdansuneversionincomplète).
47 «Lorsquelasensationproduiteennousparunobjet,aprèsavoirproduituneexcitationdansnosnerfscentripètesousensitifs,setransmet,parlecontactdesprolongements,danslesnerfscentrifugesoumoteurs,l’objet-causedecetravailmécaniqueadéjàperdudesavaleurobjectiveetiln’existeplusqueparnotreorganismephysiqueetpsychiqueauquelilpeutbienavoirimpriméunmouvementoudirection»(GinoSeverini,«Lapeintured’avant-garde»[1917],reprisdanssonlivreÉcrits sur l’art,Paris,Cercled’art,1987,p.83.Ilestànoterqu’àlafindecetarticle,ilseréfèreàCharlesHenryconcernantlasensationvisuelleàlapage94).
48 Faisantl’élogedesélémentsdebasedelapeinture(ligne,surface,couleur,facture),DavidBourliouk,aprèsavoircritiqué,luiaussi,lerapportanecdotiqueàlanature,ajoute:«Ilnefautpasoublierquepourl’Artiste,pourlapeinture,–lanatureapparaîtUniquementcommeunObjectifdelaSensationvisuelle»(«Lecubisme»[1912],dansArt et poésie russes. 1900-1930. Textes choisis,Paris,CentreGeorgesPompidou,Muséenationald’artmoderne,1979,p.59).
Arthist science art c1.indb 128 11/04/13 22:59
129
georges roque LasensationvisuelleselonHerm
annvonHelm
holtzetsaréceptionenFrance
prédomine sur le cerveau » 49, et un peu plus loin : « la seule erreur possible en art c’est l’imitation » (p. 40). une fois de plus, cette critique va de pair avec un éloge de la sensation en tant qu’émanant du cerveau : « il n’est rien de réel hors de nous, il n’est rien de réel que la coïncidence d’une sensation et d’une direction mentale individuelle » (p. 40). De même que pour les autres mouvements, l’éloge de la sensation vaut comme légitimation philosophique et scientifique d’une posture face au réel s’éloignant de l’imitation de la nature et qu’il s’agissait de défendre.
Je dirai en conclusion que le terme sensation, qui a une large histoire comme concept philosophique, réélaboré par la psychophysiologie de la perception visuelle (puis par la psychophysique de Gustav theodor Fechner que j’ai laissée ici de côté, de même que les travaux d’ernst mach), a fini par s’imposer dans le vocabulaire artistique parce qu’il permettait d’accentuer la différence entre deux attitudes face à la réalité : celle qui consiste à tenter de la reproduire telle qu’on la voit, et celle par laquelle l’artiste entend mettre en avant ses propres sensations face à elle. À ce titre, il est frappant de constater combien la plupart des artistes postimpressionnistes, adoptant la seconde attitude, ont associé les impressionnistes à la première pour mieux marquer leur différence vis-à-vis d’eux, et ils l’ont fait, comme nous l’avons vu, en accentuant le clivage entre l’œil et le cerveau. une fois assimilé l’apport des impressionnistes – représenter les choses telles qu’ils les voyaient et non telles qu’ils savaient qu’elles devaient être –, la génération suivante a eu à coeur de mettre l’accent, par contraste, sur le rôle du cerveau dans l’organisation subjective des sensations, ce qu’au seuil de la modernité, un cézanne a su si clairement énoncer.
49 AlbertGleizesetJeanMetzinger,Du cubisme(1912),Sisteron,ÉditionsPrésence,1980,p.40.
Arthist science art c1.indb 129 11/04/13 22:59