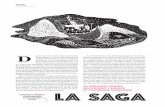La représentation des NUAGES
Transcript of La représentation des NUAGES
La représentation des NUAGES
Résumé
Les nuages qui étaient représentés comme des objets symboliques religieux au début de la Renaissance sont devenus rapidement des composantes des tableaux de paysages d’abord comme simples fonds puis comme élément important tout en restant subordonnés au sujet du tableau. À la fin du 18e siècle, le naturalisme alors dominant les considère à la fois comme phénomènes scientifiques et source d’inspiration poétique. Négligés par la peinture du 20 e siècle, ils reviennent nous hanter sous la forme d’une surveillance de la planète par les satellites. Tant en art qu’en science, ils ont un statut ambigu à cause de la mouvance infinie de leurs formes
Au moyen-âge, les rares nuages sont suggérés. Sur les fresques desmurs d’église, dans les enluminures et avec les sculptures, on raconte l’histoire sainte en juxtaposant des épisodes situés à des lieux et pendant des temps différents. Les nuages sont figurés par des minces bandes dans le ciel, par exemple entre le Christ et les apôtres (vers 820, église Santa Prassede (ref. N.L.Dagen), ou par
des tortillons, des traits un peu renflés(basilique d’Assise vers 1280-90). Une autre présentation, le motif de nuées sert à désigner Dieu, un saint, une intervention divine dans une histoire, un miracle, une vue de l’univers. C’est un procédé conventionnel qui assure un dialogue entre les dieux et les hommes.
Vers 1300 , Saint-François fait accepter l’idée qu’il est bien de contempler la nature , une preuve des bontés de Dieu; avant lui, il était
considéré comme futile et dangereux de se laisser aller à ces sensations qui font oublier le service du Seigneur. Le monde des peintres s’ouvre alors à la présentation du monde visible devant soi, avec des personnages en relief et un mode de représentation quiva un siècle plus tard devenir la « perspective artificielle avec unpoint de vue unique ». Giotto pour indiquer l’élévation du saint conserve le motif de la nuée et suggère ainsi la transcendance maisdoit inventer un artifice pour le placer en perspective : dans l’extase de François, on voit que la nuée flotte sur un fond uniforme ou devant une toile qui suggère un espace en retrait (Damish).
Remarquons que la manière dont Giotto simule le relief et le Saint
concorde avec les pratiques de son époque : les spectacles dans la
rue sont fréquents et utilisent des accessoires de théâtre qui
représentent des éléments naturels: grottes, arbres, nuages, mais
aussi des personnages, des démons, des monstres, des animaux sous
forme de mannequins (Francastel). Un tableau peut alors intégrer ces
accessoires dans la boite de la perspective y compris une toile où
est dessinée une nuée.
Dans la peinture religieuse, la nuée permet le dialogue avec l’au-delà; Lotte dans son Annonciation(1535) utilise habillement la fenêtre pour faire apparaître l’esprit-saint tout en se permettant un peu de liberté irrévérente avec l’effroi de son chat. L ‘ Assomption du Corrège évoque l’infini par une utilisation grandiose de la perspective du dôme; Pozzo, 1694, avec son « Triomphe des jésuites » sera l’apogée de ce type de propagande religieuse qui admet désormais une interrogation sur l’infini dont Pascal se fait l’écho. Dans Zurbaran,1639, une Apparition du Christ , une diagonalesouligne la liaison entre les anges dans les nuées célestes et l’église ancrée dans la terre où intervient le Christ; mais cette diagonale ressemble à une draperie; ce dernier procédé plus encore que la nuée deviendra un simple ornement pictural , parfois un bouche-trou , qui perd toute allusion religieuse même s’il se veut vaguement mythologique comme dans ce triomphe de Venus de Boucher où se retrouvent à la fois nuages et draperie.
Au début du 15è siècle, la peinture flamande conquiert le ciel ; àcette époque peindre les couleurs de l’air, sa luminosité, les formes des nuages ou les rochers et les plantes, c’est dénombrer lesbeautés dont Dieu a entouré les hommes. Cette observation méthodique du milieu (on observe un vrai catalogue des types de nuages dans la Crucifixion de Van Eyck (-Laneyrie-Dagen ) est une première révolution naturaliste dont les effets vont se faire rapidement sentir sur la Renaissance italienne par l’intermédiaire d’Antonello de Messine. Des coins de ciels vont d’abord apparaître dans des fenêtres puis progressivement envahir l’horizon. Il faudra cependant attendre le 19è siècle pour voir une seconde révolution naturaliste.
Vers 1420, le pendant italien de van Eyck par son génie, Masaccio, émerveille Florence par son utilisation d’une construction mentale, la perspective, où des jeux de lumières sur des personnages bibliques les détachent des rues, d’arcades, de bâtiments. Le procédé géométrique adopté s’il convient bien pour desédifices s’adapte mal pout tout ce qui n’a pas d’arête solide en particulier la voûte céleste sans point de fuite et remplie de formes fluctuantes. ( essayez de dessiner en perspective une épluchure de pomme de terre!). Le « plafond » de Masolino, contemporain de Masaccio, montre la difficulté de lier perspective géométrique et perspective atmosphérique mais fait partie de la portion terrestre du tableau alors qu’une nuée isole les dieux des hommes: on voit que le nuage a une triple fonction, illusionniste à la base terrestre, nuée dans la partie céleste et charnière entre les deux. Mantegna une génération plus tard a intégré le modèle flamand et ouvert l’horizon, mais avec des nuages fort conventionnels donnant l’illusion d’une troisième dimension par la diminution de leur taille : c’est le même procédé que celui qu’il emploie pour les rochers, les soldats...
Au 16è siècle, la peinture reste un sermon parfois laïque mais le plus souvent, le sujet d’un tableau est régi par des conventions religieuses (Véronèse a subi un procès en 1573 devant le tribunal del’inquisition pour ses « bouffons », son « chien » etc. dans sa « dernière cène ») ou historico-mythologiques. Cependant, comme la représentation de la nature est considérée comme décorative, elle permet plus de liberté au peintre. Quelques exemples où des nuages se rencontrent dans des coins de tableau: à Venise, Bellini a des ciels lumineux de beaux temps qui reflètent sa poésie et la touche aérée du Titien et son clair-obscur uniformisent sujet et paysage. En Flandre, Le maître des coulisses reste Patinir, un copain de Dürer, avec son arrivée d’un front froid orageux qui souligne les tourments de saint Jérôme. À la même époque, Léonard de Vinci sera un des rares à s’intéresser à la perception des mouvements de l’eau et des nuages bien avant le 18è siècle.
Au 17è siècle l’action se déroule dans monde organisé et rationnel. Qu’il s’agisse de tableau classique ou baroque, le type de ciel est subordonné à son style et à son atmosphère générale et le sujet religieux ou profane valorise le Beau idéal pour la gloire de l’église et du prince. On voit par exemple le temps en mouvement
avec le déplacement en spirale du troupeau qui accompagne l’arc-en-ciel, le retour du soleil et les nuages de pluie chez Rubens, tandisque l’ordonnance majestueuse de Poussin est une véritable proposition d’aménagement du territoire: le berger de l’avant-plan encore dans son monde bucolique et sauvage nous fait pénétrer dans un espace calme, civilisé et humanisé où grondent quelques menaces d’arrière-plan avec des bouffées de cumulus volcaniques , reflets des politiques du moment. Philippe de Champaigne, 1655, fait ressortir l’horreur de la mort avec son ciel noir tout en ajoutant une lueur d’espoir avec la diagonale du soleil qui rappelle celle des bras en croix. Le Lorrain aime les lumières des heures du jour dans la campagne romaine humanisée. Le temps du voyage et de la contemplation, le temps qui passe est présent dans toutes ces œuvres.
À la fin du siècle, le Cours de peinturepar principe de Roger de Piles en 1708montre l’importance de la critique etl’évolution picturale où l’idée de lacréation a cédé le pas devant celle d’unnature encore mythique et l’indépendancedu peintre a augmentée; De Piles parle de« la légèreté du pinceau, l’immatériel estdans le ciel…».Il est très à proposd’étudier les nuages et d’en faire choixd’après nature mais il n’est pas encorequestion d’en faire le sujet du tableau.
Un cas particulier, de courte durée, doit être souligné au 17è siècle. Les peintres ont toujours fait des croquis pour préparer leurs tableaux ( Dürer ) mais vers 1600, en Hollande à Harlem, est née la pratique du dessin de paysage en soi, sans illustration d’histoire et destinée à la vente ou aux futurs tableaux; certains dont ceux de Koninck, Cuyp, Ruysdael…, vont être envahis par un grand ciel et différents types de nuages pour montrer l’étendue, un drame, une fierté en face de la nature conquise: p.ex. le temps est suspendu avec le contraste entre le silence de la campagne et l’orage chez Cuyp ; l’immensité de la plaine est obtenue par les bandes claires et obscures des dunes, des arbres, et des stratocumulus chez Koninck, l’ atmosphère est oppressive et une agitation turbulente atteint à la fois la ville et le ciel du Greco,
une exception en dehors de la Hollande . Ces tableaux restent cependant peu nombreux car la majorité des paysages de l’époque n’ont que des nuages décoratifs, qu’ils montrent des vues locales oudes paysages italianisants. Les historiens ont étudié les influencesmultiples à l’origine du paysage autonome: la coupure par le calvinisme des commandes religieuses aux peintres, le développement local de la cartographie liée à la conquête du pays sur la mer, l’arrivée d’artistes flamands, la mode des tableaux de genre dans une société bourgeoise (Maderuelo). Ce développement va s’estomper avant la fin du siècle mais influencera plus tard les peintres.
Le Cours de peinture par principe de Roger de Piles en 1708 et le Salon de 1765 de Diderot montrent bien l’importance de la critique et l’évolution picturale. Ainsi Diderot sur Vernet: « la mer mugit, les vents sifflent, le tonnerre gronde, la lueur des éclairs…» et Vernet lui-même: «le moyen le plus court et le plus sûrest de peindre et de dessinerd’après nature...».L’attitudeenvers la nature change; lacontemplation d’effets plaisantset conventionnels persiste dansles derniers paysages classiquesd’inspiration italienne ,urbains tel Canaletto à Venise,Bellotto en Allemagne, ou encommandites tels les ports lesroutes de France de Vernet, c.1760; mais la destruction de Lisbonne en 1755 a catalysé l’attention sur le risque local causé par les aléas naturels ( Rousseau, lettre à Voltaire), et le «sublime» va exprimer un malaise, une admiration et une crainte en face des forces de la nature : le volcan (ex : Volaire), l’orage, la tempête,la laideur…( Vernet, c.1770) le dessin classique est altéré par des formes et des couleurs plus accentuées. Du milieu du 18 au milieu du 19 siècle, de Buffon à Darwin en passant par von Humboldt, l’exploration du monde, le développement des collectons, le transformisme et une conception organique des phénomènes naturels renouvelle la science; les artistes sortent des ateliers et voyagent; la pratique du dessin et de la peinture à l’huile sur de petits formats se développent avec le « pleinarisme », dont traite également le traité de Pierre-Hughes de Valenciennes(Riopelle et Bray).
L’invention des nuages avec les principaux noms latins est due aumétéorologiste anglais Luke Howard en 1802. Au même moment le savantfrançais, Lamarck propose un classement basé sur l’altitude (idée reprise par Howard plus tard) avec des noms moins universels qui ne sera pas retenu(Chambaz). Pour la première fois les nuages existent puisqu’ils ont un nom et cette classification qui accompagne de nombreuses autres classifications des sciences naturelles aura un grand succès notamment chez les peintres de paysages: le « nuagisme ». Jusque là le sujet du tableau imposait ses nuages et désormais la « vérité du ciel » s’impose au tableau. Il faudra cependant attendre un siècle pour inventer un modèle du dynamisme des nuages. C’est le front polaire norvégien, ainsi nommé après la guerre de 14-18, qui montre la succession des types de nuages pour différents fronts et qui sera peu modifié jusqu`aux années 70-80.
Partout les artistes s’intéressent aux sciences d’observation. Le poète allemand Goethe va adhérer totalement aux idées de Howard sur les nuages et considérer sa classification comme une avancée importante dans les sciences; von Humboldt également souligne l’importance du peintre pour faire ressortit les « climats » des paysages terrestres; Ruskin propose d’étendre la perspective aux nuages et pense que le « service des nuages » a rendu la peinture contemporaine de paysages bien supérieure aux œuvres antérieures; Constable estime faire œuvre scientifique en peignant; pour Carus, la connaissance de la botanique et de la géologie est nécessaire au peintre(Recht).
Le « nuagisme » du 19 siècle est un bel exemple d’évolution scientifique et artistique. Le mouvement prend de l’importance d’unepart par l’attrait pour l’observation et la classification des phénomènes naturels qui reste pleine de respect et de crainte enversles forces d’une Nature pétrie de divin.(Carus) et d’autre part parla pratique de la peinture de petit format à l’aquarelle ou à l’huile qui favorise la transcription immédiate des changements de lumière et de couleurs, le non-fini ,l’inachevé qui caractérisent les nuages par opposition au dessin qui s’attache aux contours
Les représentations dites topographiques, sans exclure un certainpittoresque, vont prendre de l’extension surtout en Angleterre et plaire à une clientèle bourgeoise. Il reste cependant difficile d’isoler dans leurs nuages la part d’observation presque tatillonne
du ciel et la part d’innovation picturale. Mais une simple vision naturaliste ne suffit pas aux peintres romantiques pour qui la sensation, le mystère, les symboles doivent dépasser le pittoresque.Valencienne avait montré la voie, David Friedrich s`oppose à une représentation trop précise des nuages qui restent pour lui des formes imprécises, emblèmes de liberté. Même s’il admet la nécessitéd’une représentation objective, fidèle de la nature, pour lui cettedernière n’existe que comme révélation d’un ordre divin et le tableau est le reflet de la sensibilité du peintre; David Cox s’attarde à suggérer les phénomènes atmosphériques et des impressions fugitives du contact des gouttes d’eau ou du souffle duvent. J.M.Turner le grand aquarelliste anglais peint la fureur des éléments, l’eau, le feu, la tempête mais aussi des ciels extraordinairement lumineux. Les taches colorées de ses nuages ont contribué à briser les formes et les dessins issus de la Renaissance; il devance son temps, influencera les impressionnistes et même l’art abstrait. : les romantiques, s’ils continuent à se partager en mystiques, pittoresques, sublimes, sont généralement individualistes, en rupture avec le passé, ambigus dans l’utilisation de la perspective; les brumes ou les nuages permettent le flou, le non-fini, qui rappelle aux spectateur leur propre incomplétude.
Les ciels, les nuages, l’atmosphère caractéristique d’une région vont imprégner le réalisme issu de l’école de Fontainebleau. Les peintures de paysages régionaux se répandent à peu près partout dansle monde. En Europe, après 1850, à la suite du mouvement romantique,après Delacroix ou Constable et Turner, la peinture d’avant-garde valorise les taches colorées et le mouvement aux dépens du dessin des formes, dans un contexte scientifique empirique qui parle d’énergie et de lumière aux peintres. Les nuages contribueront à la liberté des peintres, le pinceau balayant la toile comme les nuages le ciel. Le sursaut de l’impressionnisme et du fauvisme qui se consacrent aux vues locales pourraient faire croire à un renouveau naturaliste sous la forme de paysages régionaux dans le monde entier avec la mer, la montagne, l’exotisme. Le genre surabondant devient vite secondaire, montre des nuages assez conventionnels et se concentre sur des points de vue de plus en plus focalisés, qui seront rapidement repris par les photographes. Signalons cependant l’importance du « sublime américain » qui a renouvelé le paysage
européen en sacralisant une nature immense dont les beautés seraientles pendants des monuments antiques.
En réaction à. la figuration photographique, après Gauguin , les Fauves, Munch et des scandinaves- un énorme cumulus de Prince Eugene symbolise la menace de la Nature- un vaste mouvement qu’on pourrait qualifier de « paysage expressionniste» se développe dans les années 1920-30; il se caractérise par l’abandon de la perspective fuyante, l’assemblage hérité du cubisme d’objets reconnaissables, le recours au symbolisme, l’importance accordée à la sensibilité personnelle, une approche spirituelle de la nature annonciatrice de l’écologie. On les retrouve chez les Nabis,, mais surtout dans la peinture nordique, pensons pour les nuages, aux strato-cumulus de Nolde qui se mêlant aux vagues, font penser au chaos du ciel de Tolède du Greco, ou au Canada, le Groupe des Sept :l’avion traverse les alignements de cumulus du ciel de Johnson et fait ressortir la vastitude de la forêt nordique non sans d’ailleursrappeler les premières tentatives de perspective céleste de Masolino.
Oublions la perspective et le désir de ressemblance qui vont se réfugier dans les photographies. La surface de la toile se suffit àelle-même depuis Cézanne. Cependant certaines œuvres abstraites conservent encore une résonnance avec le monde des sensations et lenuage peut encore apparaître, intriguer, montrer un infini aux consonances religieuses. Ces signes de nuages sont à rapprocher des nuées mais cette fois la représentation du monde terrestre est vide et la nature nous devient étrangère. Dans le pop-art, le surréalisme ou la nouvelle figuration, c’est la critique, l’ironie ou l’interrogation qui l’emporte. Magritte insiste sur l’artificialité d’une représentation qui se confond avec le réel :« ceci n’est pas un paysage». Tancey se moque de la spontanéité du peintre et sur les relations entre l’instant de la photo et celui dela peinture qui pourrait prétendre représenter le temps. Turrel , 1982, enferme son public pour l’obliger à contempler le ciel : la nature est-elle devenue si artificielle qu’il faille en isoler un morceau pour l’apercevoir ? Est-ce une réserve écologique, un genre de « land-art » pour essayer d’englober le ciel ? Une ouverture comme les nuées vers une tentative de transcendance? L’art contemporain refuse la nature, se vautre dans ses déjections ou la circonscrit précautionneusement par le Land Art ou l’écologie. Ce
qui coïncide parfaitement avec notre environnement devenu totalementartificiel, avec des réserves ou des musées du patrimoine pour se souvenir de temps en temps, à distance par prudence.
Et les nuages? Ils ont été récupérés par la photographie. Dans cedomaine, il faut distinguer d’abord les daguerréotypes à prise lente (Le Gray) encouragés par von Humboldt qui y voyait un moyen degarder la mémoire du monde, puis les photos d’art ou documentaires (Japon, le désastre atomique, 1945) souvent manipulées ou retouchées, très prisées dans les reportages et performances contemporaines. Sans compter les clichés d’amateurs attirés par les couchers de soleil, purs produits marchands rendus aisés mais uniformisés par le numérique, et enfin les photos scientifiques particulièrement précieuses pour capter les transformations de nuages donc la durée elle-même, ou étudierleurs organisations au moyen desatellites. Dans le cas des avions ou des
satellites, lesclichés obtenussont reliés à unmodèle physique,très éloignés duréel visible àl’œil et sontprésentés en
fausses couleurs (teneur en vapeur d’eaupar exemple, ou vue GMS). La météorologiea fait de grands progrès depuis les années60, date des premiers satellites météo. Les nuages ont été confisques par la science. Mais quelle présentation en a-t-elle faite? Si la plupart des clichés d’amateurs sont encore imprégnés du plaisir de collectionner des moments de mémoire parfois chanceux,les documents montrés à la télé nous montrent des ciels envahis par des nuages de pluie, des cyclones, des éclairs, des inondations avec un arrière fond de changement climatique catastrophique (qui neconnaît le pétrole albertain!).Où est l’idée du bonheur par la science?.
En bref, les nuages sont un signe de l’air du temps ; ils suivent les modes en espiègles, marginaux, difficiles à saisir. Autrefois messagers des dieux, ils sont devenus ceux des humeurs de la planète, et tout aussi inconstants. C’est l’infini , le religieux, celui de Pascal et des coupoles des églises jésuites , celui des mathématiques du calcul différentiel et de la turbulence ,que les représentations des nuages ont aidé à percevoir, par les fenêtres vers le ciel de la Renaissance, par les nuées des dômes baroques et par tous les peintres qui ont opposé les taches, la couleur, les mouvements libres des pinceaux imitant la turbulence duciel , au dessin et à la rigidité du monde fini de la perspective . Les nuages ont quitté le domaine de l’art de l’image fixe, et ont été annexés par la science. Les nuages sont cosmiques, éphémères, inconstants, sans formes précises semblables au flux incessant de lamode, des informations, des nouvelles techniques; pour cela, ils devraient retenir l’attention de quelques artistes actuels et peut-être renaître et jouer un rôle dans le mouvement et la turbulence ducinéma et des vidéos.
Quelques références :
R.Scorer and H.Wexler, a colour guide to clouds, Pergamon Press, 1963
H.Damish, théorie du nuage, Seuil, 1972
P.Francastel, peinture etsociété, Denoël-Gonthier,1977
R.Recht, la lettre deHumboldt, ChristianBourgeois, 1989
J.Lichtenstein éd., lapeinture (textes), Larousse,1995
J.Maderuelo, el paisaje,Abada, Madrid, 1995
L.Castelfranchi Vegas, Italie et Flandres : primitifs flamands et Renaissance italienne, L’Aventurine,1995
J.E Thornes, John Constable’Skies, Birmingham University Press, 1999
C.Riopelle and X.Bray ,a brush with nature, National Gallery, London, 1999
P.Loth, peinture de paysage et esthétique de la dé-mesure, L’Harmattan, 2000
R.Hamblyn, l’invention des nuages, J.C.Lattès, 2003
B.Chambaz, des nuages, Seuil, 2006
G.Pretor-Pinney, le guide du chasseur de nuages, J.C.Lattès, 2007
A.Hufty, les nuages dans la peinture occidentale, AIC, actes du XXIème
colloque, Montpellier, 2008
N.Laneyrie-Dagen, l’invention de la nature, Flammarion, 2008
M.Tabaud, éd., le nuage, Géographie et Culture, n85, 2013
à titre indicatif, photos :
- Giotto 1300 L'extase de Saint François,fresque,basilique d'Assise
-Turell 1982 Skispace Israel Mus.,Jerusalem
de Champaigne 1655 Crucifixion,Mus.Grenoble
Vernet 1770 Un naufrage,Mus.Favre,Montpellier
Tancey 1984 Action Painting,Mus.Beaux Arts,Montreal
-Turell 1982 Skispace Israel Mus.,Jerusalem
André Hufty, 2014