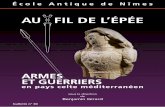Discrimination des styles d'écriture des manuscrits médiévaux pour la Paléographie
La scénographie des préfaces
Transcript of La scénographie des préfaces
1
in : Ioana Galleron (éd.), Pré-textes (Actes du colloque de Lorient, novembre 2005), Rennes,
PU, 2006, p.29-46..
La scénographie des préfaces
JAN HERMAN
1.
« Est-ce qu’on lisait les préfaces ? » La question a été souvent posée, par les sceptiques
qui, au sein même de nos institutions universitaires, remettent en doute la pertinence et le
bien-fondé du discours préfaciel comme objet d’étude légitime. A cette question, certes très
pertinente, on en ajoute souvent une autre : est-ce que la préface est amovible ? Est-elle
indispensable à la bonne entente du texte préfacé ? Ne voit-on pas, en effet, des textes
republiés sans la préface que leur adjoignait l’édition originale ?
Un des romans les plus lus du XVIIIe siècle, et des plus commentés, fournit à cette
double question une réponse intéressante. Il s’agit des Liaisons dangereuses. Au beau milieu
de la « Préface du rédacteur », après l’exposé sur l’origine du manuscrit et les corrections
que le rédacteur y a apportées, nous lisons ceci :
Cependant ceux qui, avant de commencer une lecture, sont bien aise de savoir à peu
près sur quoi compter, ceux-là dis-je, peuvent continuer : les autres feront mieux de
passer tout de suite à l’ouvrage même ; ils en savent assez1.
Ce propos, placé au milieu de la préface du rédacteur, permet de faire deux remarques, en
réponse à nos deux questions. Il semble que le rédacteur des Liaisons dangereuses partage le
lectorat en deux groupes : ceux qui veulent savoir « sur quoi compter » quand ils ouvrent un
livre, et les autres. Les premiers sont censés continuer la lecture de la préface, les autres
peuvent sauter ce qui reste à lire. Lire une préface dépend dès lors d’une attitude, d’un
réflexe de lecture. La préface dans son ensemble ne s’adresse qu’à un type particulier de
lecteur, dont elle donne aussi le profil. Parallèlement, le propos du rédacteur partage la
préface en deux parties. Les premiers paragraphes sont destinés à tous et semblent
indispensables. Ces paragraphes prolongent le récit des Liaisons en retraçant l’histoire de la
composition du livre : le manuscrit, donné pas les héritiers de Mme de Rosemonde au
rédacteur pour qu’il y mette de l’ordre et en corrige les fautes les plus manifestes, est à
présent devenu un livre plus ou moins sortable. Cette histoire du manuscrit est inamovible.
Quant au reste, c’est-à-dire les réflexions sur le mérite de l’ouvrage, sur sa qualité poétique
et son utilité, tout cela peut être sauté.
Le propos du rédacteur révèle toute l’ambiguïté de la préface comme discours inaugural
au XVIIIe siècle : elle est amovible en partie et, prise dans son ensemble, elle n’est pas
destinée à tous les lecteurs. S’il est vrai que le livre même, l’Histoire des Liaisons, ne plaira
pas aux « esprits forts », ni aux « dévots », ni même aux « personnes d’un goût délicat », la
deuxième partie de la préface où tout cela est déclaré n’est elle-même destinée qu’à ceux qui
veulent savoir « sur quoi compter ». Cette partie amovible de la préface sépare l’histoire du
1 Laclos, Les Liaisons dangereuses (1782), Préface du rédacteur.
2
manuscrit de sa version remaniée, qui est le livre préfacé. Histoire dans le livre et histoire du
livre sont dès lors présentées comme faisant corps, mais séparées l’une de l’autre par un bout
de préface qui scinde le lectorat en deux. Par-delà le passage dont le lecteur pourrait
éventuellement se passer, s’institue l’association entre le texte et l’histoire de sa
provenance.
La préface du rédacteur des Liaisons dangereuses est emblématique du discours préfaciel
au XVIIIe siècle. Une énorme quantité de préfaces de roman est composée de deux volets :
volet narratif d’une part et volet que j’appellerais rhétorique d’autre part. Alors que le volet
rhétorique porte sur le produit final qui est le livre, le volet narratif concerne un état antérieur
du texte, manuscrit le plus souvent. Le volet rhétorique mérite cette étiquette dans la mesure
où il vise à capter la bienveillance du lecteur, à préparer sa réaction, à plaider la cause de
l’ouvrage par l’aveu de ses défauts, etc.. Mais par delà ce volet rhétorique, qui prépare
l’entrée dans le monde du texte en tant que livre, une dimension narrative relie la préface à
l’univers fictionnel du récit dont elle retrace le devenir-livre. Roman et préface sont donc
subsumés dans une entité textuelle narrative, que j’appellerai ici le « romanesque ».
2.
C’est de ce « romanesque », de cette unité narrative subsumant roman et préface, qu’il
faudra étudier ici les avatars, les modalités et les raisons d’être.
Risquons une première hypothèse, à partir d’une distinction genettienne : celle entre
préface assomptive (où un auteur assume le texte en s’en avouant l’auteur) et préface
dénégative (où l’instance préfacielle déclare que le texte n’est pas d’elle)2. Or, la narration
préfacielle semble être essentiellement l’affaire de la préface dénégative. Quand un préfacier
se met à narrer l’histoire de son texte, c’est le plus souvent pour déclarer qu’il n’en est pas
l’auteur et pour déconnecter l’écriture du texte préfacé de sa propre activité de rédacteur,
traducteur, éditeur. Cette prédilection de la narration préfacielle pour les préfaces
dénégatives devra nous retenir dans la suite. Le cas de La Vie de Marianne dont il sera
question dans ce colloque peut nous servir d’exemple d’un roman, désattribué dans sa
préface par une narration qui fait remonter le texte à un manuscrit trouvé par hasard, édité
par le préfacier qui n’en est donc pas l’auteur. Bélisaire, d’autre part, peut fournir un
exemple de roman assumé par son auteur Marmontel, qui déclare avoir trouvé son sujet dans
Procope. La partie narrative est très réduite dans cette préface, qui privilégie au contraire
l’aspect rhétorique en prenant la défense de Procope contre ses calomniateurs, garantissant
ainsi la fiabilité de sa source3.
En dépit de cette régularité, et de la nature essentiellement dénégative du récit
préfaciel, on ne peut aller jusqu’à voir dans la narration un mécanisme de désattribution. Les
2 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, 1987, p.169. 3 Marmontel, Bélisaire, in : Œuvres de Marmontel, Paris, Belin, 1819, tome III, p.209 : « Sur
tout le reste, à peu de choses près, j’ai suivi fidèlement l’histoire, et Procope a été mon
guide. Mais je n’ai eu aucun égard à ce libelle calomnieux qui lui a été attribué, sous le nom
d’Anecdotes, ou d’Histoire secrète. Il est pour moi de toute évidence que cet amas informe
d’injures grossières et de faussetés palpables n’est point de lui, mais de quelque déclamateur
aussi maladroit que méchant. »
3
choses ne sont pas aussi simple4. Voyons d’abord quelques avatars du « romanesque », cette
unité narrative subsumant récit préfacé et récit préfaciel.
a. L’on connaît des exemples où le « romanesque » se développe dans la préface et y
prend des proportions telles qu’il finit par étouffer le récit préfacé où à l’intégrer. C’est ce
qui arrive dans Angélique de Nerval. Ce premier récit des Filles du feu commence par le
topos de la trouvaille d’un livre, à la foire de Francfort, par le journaliste Nerval. C’est
l’« Histoire de l’abbé de Bucquoy », que Nerval trouve trop cher pour l’endroit et qu’il
n’achète pas ; décision qu’il regrettera fort par la suite car rentré à Paris, il trouve le monde
littéraire en émoi suite à l’application de l’amendement Riancey, qui interdit aux journalistes
de publier des « feuilletons-romans ». Nerval, chargé précisément du feuilleton, voit toutes
les ressources qu’aurait pu lui fournir l’« Histoire de l’abbé de Bucquoy », qui n’est pas un
roman et qui est suffisamment intéressant pour être donné en feuilleton au journal. Il part à la
4 Voir De l’usage des romans de Gordon du Percel (Lenglet Dufresnoy) où, dans une préface
attributive, le préfacier raconte comment l’ouvrage a été composé pendant un voyage en
mer, pour échapper à l’ennui. L’enjeu de la préface narrative n’est pas de désattribuer le
texte mais de le définir en quelque sorte ex negativo et d’en éloigner l’écriture, autant que
possible, de celle d’un livre savant :
« Un voyage de long cours que je fis il y a quelque temps à deux mille pas du lieu de ma
naissance m’ayant procuré quelques mois de loisir, je me suis appliqué à diverses choses,
mais surtout à cet ouvrage.
[…] Je me dis à moi-même, ceci peut durer ; taillons-nous de l’ouvrage pour du temps, six
mois, un an, qu’importe. Je fis une chose puis une autre, enfin je m’engageai à cet ouvrage.
S’il est bon, tant pis ; ce serait une preuve que les voyages de long cours me seraient utiles.
S’il est mauvais, j’en suis ravi, d’autres chercheront à mieux faire. En ce cas, je leur
abandonne ce qui peut être de mon fond, remarques, pensées, observations : qu’ils en fassent
comme de leur propre bien, sans me citer ; car ce n’est pas mon régal. Si quelque auteur
charitable me voulait critiquer, il est bon de l’avertir qu’il y a plusieurs contradictions dans
mon ouvrage, même dès le premier chapitre. J’ai hasardé certaines choses, mais non pas des
faits. Je me suis laissé aller à quelques bizarreries ; peut-être un jour les regardera-t-on
comme des choses bien raisonnables, si l’on n’a soin de les reprendre de bonne heure : enfin,
j’ai fait flèche de tout bois. C’en serait assez pour me désoler si j’ambitionnais la gloire
d’être auteur dans les formes.
Je sais bien cependant à quoi tiennent mes contradictions : je n’ai pas fait mon ouvrage en un
jour, et comme heureusement mon esprit n’est pas tous les jours monté sur le même ton, je
travaillais au jour la journée, sans trop m’embarrasser le matin de ce que j’avais écrit la
veille : et je crois que c’est là comme on fait ces sortes d’ouvrages, sans quoi ils ne valent
rien. Tous les gens tirés et empesés sont d’ennuyeux personnages : c’est ce que j’ai évité.
J’ai encore à dire que je n’ai travaillé que de mémoire : je n’ai vérifié mes citations qu’au
retour de mon voyage, qui a fini le 20 juin 1726. C’est encore là matière pour la critique. Je
dis tout ce que je puis contre moi-même : mais je serai content, pourvu qu’on approuve ma
franchise, c’est peut être la meilleure de mes pièces. J’abandonne tout le reste.
A force d’écrire j’ai remarqué que cet ouvrage s’est mis sur le ton sérieux, et qu’il devient un
livre dans les formes, avec préface, Table des chapitres, Table d’auteurs, citations marginales
qui tirent au savant, preuves trop recherchées, envie de montrer de l’esprit, raisonnement
faux, endroits ennuyeux, d’autres trop joyeux et même hors de propos : quelques bonnes
choses cependant, et surtout certains faits qui ne sont pas indifférents ; c’est là tout mon
livre. Il ne faudrait plus qu’une épître dédicatoire pour le rendre complet de tout point4.
4
recherche du livre à Paris – à la Bibliothèque impériale, à l’Arsenal et ailleurs – mais en
vain. Ce n’est qu’au bout d’un long parcours et de nombreuses péripéties, rapportées dans
douze lettres écrites à son rédacteur en chef, qu’il trouvera le livre. Et voici la manière
laconique dont la quête de ce livre s’achève :
On peut lire l’histoire de l’abbé de Bucquoy dans mon livre intitulé : Les Illuminés
(Paris, Victor Lecou). On peut consulter aussi l’ouvrage in-12 dont j’ai fait présent à
la Bibliothèque impériale5.
C’est la fin d’Angélique. Ce récit, en douze lettres, se présente comme la recherche d’un
livre que cependant on ne lira pas une fois qu’il aura été retrouvé. Angélique est un récit
préfaçant un livre escamoté. Mais entre-temps, chemin faisant, la préface aura intégré un
autre récit : celui d’Angélique, manuscrit qu’on ne cherchait pas, mais qu’on trouvait par
hasard, en cherchant un livre introuvable.
b. Un romancier qui adjoint à son récit l’histoire de son origine peut aussi se tromper. Le
cas du chevalier de Mouhy est plaisant. La préface de La Mouche (1736) raconte comment
un maçon trouve une boîte, à Rome, dans les fondements d’une maison qu’il était en train de
démolir. L’espoir de l’ouvrier de se voir riche par la découverte d’un trésor est vite déçu par
le constat que la boîte ne contient que des paperasses :
il donna de colère plusieurs coups dans le manuscrit avec l’outil dont il s’était servi
pour ôter le couvercle ; et c’est ce qui a occasionné quelques lacunes dont le lecteur
s’apercevra dans la suite de cet ouvrage6.
De ces lacunes si plaisamment annoncées dans la préface, on ne trouve cependant aucune
trace dans le roman même, La Mouche. En revanche, un roman entamé un an avant La
Mouche (1736) intitulé Lamekis (1735) – et dont la publication s’étale, comme celle de La
Mouche, sur plusieurs années – présente quant à lui plusieurs trous. Mathieu Brunet en
déduit l’intéressante hypothèse que le chevalier de Mouhy a pu se tromper de manuscrit dans
le montage « romanesque » de ces préfaces7.
c. L’avatar du « romanesque » qui devra le plus nous intéresser dans le cadre de ce
colloque est l’emplacement d’un récit préfaciel en tête d’ouvrages qui ne sont pas des
romans. La narration préfacielle peut être déconnectée du roman et exporté à d’autres types
de discours, avec lesquels elle peut former une unité « romanesque ». A l’inverse donc du
cas nervalien, où la narration préfacielle absorbe le roman même, la narration peut aussi
investir le discours du savoir, philosophique ou autre, et s’y intégrer. On aura sans doute
souvent l’occasion de parler de scènes romanesques de ce genre, qui constituent les franges
du discours du savoir. Mon exemple tire sa force persuasive du fait qu’il s’est élaboré dans
les marges du domaine francophone, témoignant pourtant d’une pratique discursive dont on
voit de très nombreux exemples en France au XVIIIe siècle. Il s’agit de l’Avertissement
5 Nerval, Les Filles du Feu, GF, éd. par Léon Cellier, 1965, p. 107. 6 Christian Angelet et Jan Herman, Recueil de Préfaces de romans du XVIIIe siècle, volume
I : 1700-1751, Saint-Etienne, PU et Leuven, PU, 1989, p.177. 7 Mathieu Brunet, « Un manuscrit peut en cacher un autre… Autour de deux romans de
Mouhy (Lamekis, 1735-38, La Mouche, 1736-42) », in : Jan Herman et Fernand Hallyn, Le
Topos du manuscrit trouvé. Hommages à Christian Angelet, Leuven-Paris, Peeters, 1999,
p.139-157.
5
précédant L’Aveugle de la Montagne. Entretiens philosophiques (Amsterdam-Paris, 1789) de
Corneille-François de Nélis, qui fut un authentique représentant des Lumières dans les Pays-
Bas autrichiens. Natif de Malines, bibliothécaire de l’Université de Louvain, Corneille-
François Nélis fut plus tard évêque d’Anvers et laissa plusieurs œuvres dont un miroir du
prince, Alexis (1763). A la page IX de l’Avertissement qui précède les entretiens
philosophiques publiés sous le titre de L’Aveugle de la Montagne, on lit ce qui suit :
[…] l’ouvrage dont je donne la traduction, paraît avoir été originairement écrit en
grec, quoique ma traduction ne soit faite que d’après le latin, le seul texte que j’aie
recouvré. Je ne dirai pas si c’est parmi les manuscrits de la bibliothèque d’Oxford ou
du Vatican ; ou bien parmi ceux de M.Askew que je connaissais, et qui se sont
vendus il y a quelque temps, à Londres. Tout cela ne fait rien pour le mérite de
l’ouvrage et ferait très peu de chose pour la satisfaction de mes lecteurs. J’ose les
prier en conséquence de vouloir bien respecter pendant quelque temps au moins, mon
secret. Je ne le ferais pas si l’ouvrage dont il s’agit était un ouvrage d’histoire8.
Cet écrit théologico-philosophique, qui porte l’adresse d’Amsterdam-Paris fut en réalité
publié à Anvers en 1789-‘90. Il fut très tôt traduit en allemand (Der Blinde vom Berg,
Zürich, 1791) et édité avec une préface de Lavater, qui ne supprime pas l’Avertissement. Il
fut ensuite complété d’autres entretiens, en 1792-93. Nous avons cité le texte de 1795, publié
à Parme, par Bodoni, où l’Avertissement figure toujours. Cet Avertissement ne sera en fait
jamais supprimé, ni dans l’édition parue en 1797 à Rome, chez Vincent Poggiolo, ni dans
celle éditée à Paris, chez Nicolle en 1798-99, ni dans celle de la même année parue chez
Delance, à Paris également. L’édition de 1837, parue à Bruxelles, reprend encore
l’Avertissement de 17899. Le paratexte, dont on aura pu constater l’aspect narratif, n’est
donc a aucun moment considéré comme un para-texte, comme un accessoire amputable.
Mise en scène romanesque et écrit philosophique sont considérés au fil des éditions et des
traductions comme formant corps.
Nous avons affaire à une préface où l’auteur adopte une posture dénégative moyennant
une narration qui déconnecte le texte par rapport au préfacier. Le récit précaciel fait
remonter le texte à un manuscrit dont l’original grec restera à jamais introuvable et dont la
traduction latine est conservée dans une bibliothèque dont on ne saura ni le nom ni le lieu.
Le manuscrit est sine nomine, sine dato, sine loco.
Peut-on admettre que le public ait été dupe de cette mise en scène éditoriale et que celle-
ci ait été conçue pour avoir un quelconque effet de tromperie ? En dépit de quelques cas très
intéressants d’erreur d’attribution10, il faut postuler qu’aucun désir de tromper ne présidait à
8 Corneille-François de Nélis, L’Aveugle de la Montagne. Entretiens philosophiques, 1795. 9 Ces différentes éditions de l’ouvrage de Nélis se trouvent décrites dans Carlo De Clercq,
Corneille-François de Nelis : œuvres complètes, Bruxelles, Editions culture et civilisation,
1979. 10 Dans le domaine du roman, nous avons le cas de Sophie de la Roche, Histoire de Sophie
de Sternheim, dont la préface narrative signée Wieland est mal interprétée par la traductrice
Mme de Lafitte, qui attribue préface et ouvrage à Wieland ; dans le domaine du discours du
savoir nous avons celui de Voltaire qui attribue à Diderot une lettre de Boulanger donnée
comme préface à son ouvrage Les recherches sur l’origine du despotisme oriental (1761) par
d’Holbach.
6
cette manœuvre de désattribution narrative. Le « jugement de l’abbé Fontenay », paru dans
L’esprit des journaux, en septembre 1793 est très illustratif à ce sujet :
Il paraît, par un Avertissement du traducteur, que cet ouvrage aurait été
originairement écrit en grec, quoique la traduction, dit-il, ne soit faite que d’après le
latin, le seul texte qu’il ait recouvré ; mais il est aisé de voir que ce n’est qu’une
fiction. L’ouvrage a été écrit originairement en français. C’est encore une fiction,
quand on suppose qu’un philosophe pythagoricien, vieux et aveugle, chrétien même
et vivant dans les premiers siècles de l’Eglise, s’entretient paisiblement avec un jeune
disciple de la vérité, nommé Théogène, loin du bruit des académies et de l’écho des
villes, assis à l’ombre d’un platane solitaire, sur une colline élevée ; ce qui lui a fait
donner le nom de l’Aveugle de la Montagne. On voit que ce n’est qu’un cadre
heureux pour jeter du dramatique dans cet ouvrage, c’est-à-dire ce vif intérêt qui
résulte toujours de l’entretien des interlocuteurs, à l’exemple de ces conversations si
intéressantes que nous ont laissées les anciens, surtout Cicéron, pour qui l’auteur
montre une prédilection particulière. Il imite en effet ce grand génie de Rome. Il
prouve, comme lui, qu’il est vraiment homme de bien et grand philosophe. Il a la
force de ses raisonnements, l’élévation de ses pensées, les grâces de son style. Mais
un mérite qui lui est propre, c’est qu’il allie partout le sentiment aux images, et
qu’ainsi, quoiqu’écrivant en prose, il est très souvent poète. C’est une remarque
qu’on lit dans l’avertissement, et dont le lecteur connaîtra la justesse11.
Il y a beaucoup à dire sur cette lecture de l’Avertissement de Nélis par l’abbé Fontenay.
(a) La mise en scène narrative dont s’entoure l’écrit philosophique de Nélis semble
empruntée au roman, où il n’est pas rare que le texte soit ramené à un manuscrit de
l’Antiquité. La préface de Séthos, de l’abbé Terrasson12 par exemple, raconte comment le
manuscrit grec, conservé à la Bibliothèque d’Alexandrie, est passé par différentes mains
avant d’être traduit par le préfacier. Ou Mysis et Glaucé de l’abbé Séran de la Tour qui offre
un bel exemple de la traduction relais13, le texte étant présenté comme la traduction d’un
manuscrit italien traduit d’un manuscrit grec trouvé dans les ruines d’Herculanum.
11 L’Aveugle de la Montagne. Entretiens philosophiques par C.F. de Nélis, Bruxelles, publié
par la Société nationale, 1837, appendices, p.171-72. 12 « Je présente au Public la Traduction d’un Manuscrit grec qui s’est trouvé dans la
Bibliothèque d’une Nation étrangère, extrêmement jalouse de cette espèce de trésor. Ceux
qui m’ont procuré la lecture de ce Manuscrit, ne m’ont permis de le publier qu’en le
traduisant, sans indiquer la bibliothèque à laquelle appartient l’Original. L’Auteur ne s’est
nommé nulle part : mais quelques endroits du Livre même font connaître que c’était un Grec
d’origine, vivant à Alexandrie sous l’Empire de Marc-Aurèle. » (Jean Terrasson, Séthos,
1731) 13 L’éditeur au lecteur : « Tout ce que je puis apprendre de certain au public sur cet ouvrage,
c’est qu’il m’a été remis par une personne sûre, afin que je le fisse imprimer. Comme l’on
m’avait permis d’en savoir davantage si je le pouvais, je me suis adressé à Paris à plusieurs
personnes au fait de toutes les nouveautés. C’est par ce moyen que j’ai appris que ce poème
est une traduction de l’italien. Les copies manuscrites, rares d’abord, en sont communes
aujourd’hui à la cour du Roi des deux Siciles. Le nom de l’auteur, ajoutait-on, est inconnu,
mais sa versification est comparée dans beaucoup d’endroits à celle des plus fameux poètes
italiens.
Je fis part de ces particularités à l’imprimeur. Il écrivit sur le champ à son correspondant de
Naples, pour apprendre quelque chose de positif. C’est un homme aussi connu par son goût
7
(b) La narration ne se localise par seulement dans la préface, mais investit également le
discours philosophique même, qui se présente comme un dialogue, sur un modèle
platonicien, ou cicéronien, mettant en scène un vieillard aveugle s’entretenant avec un jeune
disciple à l’ombre d’un arbre. Le discours théologico-philosophique s’orne donc d’une
double frange. La narration de l’avertissement se prolonge dans le discours philosophique
même qui se moule lui aussi dans le scénario narratif, à vrai dire bien connu, du dialogue
entre maître et élève. Préface et marges du discours du savoir sont dès lors subsumées dans
une unité narrative que nous avons appelée le « romanesque ».
(c) Ce romanesque, qui conjugue l’histoire d’un manuscrit et le dialogue entre un vieillard
et un jeune situé dans un cadre bucolique, est évidemment un lieu commun. Mais qu’est-ce
qu’un lieu commun ? Pour certains savants interlocuteurs avec qui nous avons eu le plaisir
de discuter de cette matière, tout est dit par le constat que nous avons affaire avec des
clichés. Mais que dit-on exactement quand on relève l’aspect récurrent, ‘déjà-vu’, topique de
scènes narratives comme celles-ci ?
Les « lieux communs » foisonnent dans les préfaces, ils en constituent l’ossature.
L’éloignement dans le temps nous retient de saisir le croisement dynamique de ces topoï, de
réactiver immédiatement les lois discursives auxquelles obéissent les textes du XVIIIe
siècle. Leur force s’est amenuisée avec le temps. Le « commun », cet élément constitutif de
la discursivité classique, a perdu son sens noble de partage et de sentiment communautaire et
a été minoré par l’usure du temps, dévalué au sens péjoratif d’idée reçue ou banale14. Or, le
sens rhétorique du topos est diamétralement opposé au concept péjoratif de « cliché » : il
signifie les mille et une manières de traiter un sujet, qui visent l’efficacité du discours
argumentatif, antinomique donc à l’inanité et repoussant tout cliché. Il convient dès lors de
raviver ces arguments. Et raviver l’argumentation véhiculée par les lieux communs implique
qu’on voit dans l’arsenal de topoï, infiniment ressassés au fil des siècles dans la culture
occidentale, des signaux d’une « reconnaissance ».
pour les belles lettres que par son attention à fournir aux savants de son pays tous les
ouvrages nouveaux que produit l’Europe. Voici la réponse traduite littéralement.
‘Il est vrai, Monsieur, que nous avons ici plusieurs copies du poème de Mysis et Glaucé.
Mais quoiqu’il soit en vers italiens, il n’appartient pas à l’Italie. L’original ignoré pendant
tant de siècles est écrit en vers grecs. C’est une de ces restitutions heureuses que le temps et
le hasard nous ont faite dans les trésors des ruines d’Héraclée, source féconde des plus
précieuses richesses de l’Antiquité, dont notre auguste souverain enrichit chaque jour ses
palais et sa capitale.’
Plusieurs autres ouvrages, tous en grec, ont été trouvés dans le même cabinet : mais le
poème de Mysis et Glaucée est le seul qui soit traduit. L’auteur de cette traduction est connu
de tout le monde. Il craint l’impression autant que le public la désire, etc. » (Abbé Séran de
la Tour, Mysis et Glaucé, 1748, « L’éditeur au lecteur »). 14 Ecoutons à ce sujet Bernard Dupriez, « Où sont les arguments ? », in : Etudes françaises
n°13/1-2 (1977) : Le lieu commun, p.37: « On dit qu’un médicament est topique lorsqu’il
agit à un endroit déterminé du corps et, de même, Gide par exemple parle d’une citation
topique, c’est-à-dire pertinente. En jouant un peu sur les mots, nous dirons que si les lieux
communs ont cessé d’être ‘des topiques’, c’est parce qu’ils avaient cessé, de plus en plus
souvent, d’être topiques, c’est-à-dire pertinents. »
8
Les topoï sont l’héritage de la rhétorique classique et consistent en un legs de règles
réservées à entériner les réminiscences qui sous-tendent une civilisation. L’art de la narration
enfile des images qui constituent le soubassement d’une culture et les agence autour de
pivots fixes fonctionnant comme des figures mémorielles et des signalisations
emblématiques. Aristote appelle « lieu », « les vérités probables sous leur forme la plus
générale considérées comme éléments constitutifs de tout raisonnement dialectique »15. A
l’instar de la sentence, le lieu commun universalise un contenu. Inscrit dans un réseau de
relations intertextuelles, il réfère à un déjà-dit, à un fait de culture hors-texte, élevant le
particulier au rang du commun. Le « lieu » commun devient ainsi une scène langagière où
tous reconnaissent l’image qui renvoie à un bagage collectif.
(d) Le récit préfaciel n’est donc pas essentiellement un lieu de désattribution, destiné à
induire en erreur le lecteur quant à la véritable origine du texte. La topicité de ce genre de
récits, c’est-à-dire la récurrence des mêmes lieux communs, va à l’encontre d’une telle
hypothèse. Les configurations topiques sur lesquelles reposent les récits préfaciels
fonctionnent davantage comme des éléments révélateurs que comme des voiles. Avant d’être
un lieu de désattibution, le récit préfaciel est un discours qu’on reconnaît, à son aspect
topique, et c’est de cette reconnaissance que doit partir notre réflexion sur sa raison d’être.
(e) Reconnaissance de quoi ? Le texte entouré ou précédé d’une scène narrative
reconnaissable peut apparaître, au travers de la reconnaissance de sa topicité, comme un
texte partagé culturellement, comme un objet familier, inscrit dans une culture livresque
partagée. La scène reconnaissable interpelle le lecteur, fait appel à sa bibliothèque intérieure,
qu’il a en commun avec d’autres. La reconnaissance se traduit par la sym-pathie du lectorat,
par l’effet de connivence que crée la scènographie : connivence entre les lecteurs,
connivence du lecteur et du texte, qui sont placés, par la reconnaissance, de plain-pied.
(f) Ces scénarios reconnaissables, que nous avons appelées « romanesques », sont dits
« dramatiques » par l’abbé Fontenay. Le discours philosophique est dramatisé, dans
plusieurs sens simultanément. Le texte apparaît dans un décor – la montagne, le platane, la
solitude de l’ombre – qui le visualise. En outre, le locuteur n’apparaît plus comme un
individu identifiable assumant le discours, mais comme une « figure », comme une
« persona », au sens dramatique du terme. Cette « persona », cette « figure » de l’auteur
véritable, est le garant du texte. Garant du texte, il l’est en tant que vieillard et en tant que
aveugle ; deux figures auxquelles la tradition partagée par les lecteurs attribue les qualités de
sagesse, d’expérience, de fiabilité. Le désintérêt du vieillard pour les choses terrestres
renforce sa crédibilité dans la quête de la vérité. Sa cécité lui donne, traditionnellement, une
clairvoyance qui n’est pas donnée aux voyants. Ce qui se joue dans cette figuration
dramatique, c’est l’Ethos, la posture éthique que prend celui qui parle, comme garantie de
son dire. Ce n’est pas la persécution par les autorités – qui aurait été un motif politique de
s’escamoter – qui oblige l’auteur de ces entretiens philosophiques à se retrancher derrière
une scénographie romanesque. En 1795 le déisme implicite de Nélis ne choque plus
personne. Le préfacier cite son double, sa figuration aveugle :
Pour ce qui est des philosophes dont je contredis les opinions, et qu’il faut craindre,
ce me semble, de voir s’élever contre moi, non Théogène, ce n’est pas là ce qui
m’épouvante. Mon obscurité et le silence sont mes retranchements, où je défie de me
forcer. D’ailleurs quel intérêt prendraient-ils aux discours d’un pauvre aveugle, dont
15 Aristote, La Topique, traduction par J.Tricot, paris, Vrin, 1990.
9
l’intention ne saurait être de calomnier leur gloire, et qui ne va pas d’une main
audacieuse briser leurs statues ? Loin du bruit des académies et de l’écho des villes,
assis à l’ombre d’un platane solitaire, il s’entretient paisiblement avec un jeune
disciple de la vérité ; il parle comme il pense, et des objets auxquels il a pris tant de
fois plaisir à penser. C’est à peu près le seul plaisir qui lui reste. Serait-on assez
barbare que de le lui défendre ? (p.VI)
Qui aurait peur d’un tel homme ? Qui oserait persécuter un aveugle qui récuse si
ouvertement le mythe du grand homme, et qui se place si humblement à l’ombre de son
grand modèle, Cicéron :
Il imite en effet ce grand génie de Rome. Il prouve, comme lui, qu’il est vraiment
homme de bien et grand philosophe. Il a la force de ses raisonnements, l’élévation de
ses pensées, les grâces de son style16.
L’escamotage de l’auteur chez Nélis n’est pas d’ordre politique, c’est-à-dire qu’il ne
constitue pas de menace pour le bon fonctionnement de la polis ; il est d’ordre éthique dans
la mesure où tout le travail de l’Avertissement repose sur la création d’ un « Ethos » du
locuteur, sur une image de soi qui est celle de l’innocent, du paisible et de l’humble. Il est,
en outre, d’ordre poétique dans la mesure où la poésie fera son effet, comme le dit Fontenay
dans son commentaire : « un mérite qui lui est propre, c’est qu’il allie partout le sentiment
aux images, et qu’ainsi, quoiqu’écrivant en prose, il est très souvent poète ».
(g) Le récit préfaciel, qu’il apparaisse en tête d’un roman ou d’un discours philosophique,
n’a rien d’original et peut être ramené à un dispositif topique à fonction signalétique. Ce
dispositif établit une sym-pathie entre le texte et les lecteurs et une connivence au sein du
lectorat, qui dépendent de sa reconnaissance culturelle. La topique préfacielle reconnue
pourra dès lors libérer l’argumentation qu’elle véhicule. Celle-ci est de l’ordre de la
dramatisation dont la figure centrale est l’auteur, la « persona » de cette dramaturgie. Les
figurations éditoriales, les dramatisations préfacielles donc, sont des manières de
l’auteur de s’absenter et, en quelque sorte, de « briller » par son absence. Ce qui se
développe dans les préfaces dramatisantes, c’est une dialectique de la présence et de
l’absence, du visible et de l’invisible. Être absent de son texte ne signifie pas forcément en
disparaître. La figuration auctoriale inscrit dans le discours préfaciel, comme on l’a vu dans
l’exemple de Nélis, des dimensions éthique et poétique, bien plus que politique.
4.
On ne saurait trop insister sur l’aspect familier des topiques préfacielles. Avant d’investir
le discours du savoir, elles ont été empruntées au roman. Avant que le romantisme ne fonde
l’esthétique de l’originalité, le roman s’élabore à partir de ce qui est familier. Sa plus grande
originalité réside sans doute dans son aspect parodique, mais il est essentiellement topique,
c’est-à-dire qu’il est fondamentalement une mise en commun d’un réservoir de thèmes
communs pour le commun. C’est la topicité du roman qui le rapproche de la collectivité, qui
peut s’y reconnaître. Le récit préfaciel, qui emprunte au roman même sa structure
reconnaissable, est plus topique encore. Le récit préfaciel, c’est le roman raccourci, endurci
et réduit à sa topicité même. Le récit préfaciel est la reconnaissance romanesque même ;
c’est le signal bien reconnaissable d’une connivence entre le texte et le public. Il n’y a pas de
discours plus stéréotypé que le récit préfaciel : on ne compte pas le nombre de manuscrits
16 C’est l’abbé Fontenay qui parle.
10
trouvés au XVIIIe siècle, dont la seule originalité est l’extravagance parfois délirante. Quand
le récit préfaciel est ensuite exporté au discours du savoir, il ne manque pas d’imposer à
celui-ci la logique du « commun ».
La « persona » dramatique que le « romanesque » inscrit en son centre est une figure de
dispersion, radicalement opposée à la figure unificatrice de l’auteur, qui est censée
assigner à l’œuvre une unité, une cohérence, une origine. Au rebours de cette unité, de cette
cohérence ou de l’assignation d’une origine, le texte préfacé est présenté comme sans unité,
sans cohérence et sans origine dans les scènes dramatiques qui le précèdent. Dans un
Avertissement qui n’a rien d’agressif, de contestataire ou d’iconoclaste, Nélis demande au
lecteur de bien vouloir accepter que l’origine de son discours reste obscure. On ne saura pas
à quelle bibliothèque le double relais de la traduction reconduit le discours. Son œuvre
n’aura pas l’unité d’un traité, mais sera composée sous forme d’entretiens et au fil de
conversations, sans plan fixé au préalable. La dramatisation préfacielle a la vertu de
transformer le discours philosophique en un discours commun, c’est-à-dire qu’on lui donne
un « milieu », une scène d’énonciation reconnaissable et commune ; c’est-à-dire aussi qu’il
occupe une position mitoyenne dans le paysage discursif de l’Âge classique, entre le
discours du logos – articulé, cohérent et unifié – et la parole désarticulée de l’opinion, du
bruit. Le discours philosophique se développe au fil d’entretiens, la vérité n’apparaît pas
comme une essence à dire, mais comme une réalité à chercher.
C’est ce discours, commun grâce à la dramatisation, que les philosophes du XVIIIe siècle,
de Fontenelle à Diderot, ont affectionné. Y a-t-il des œuvres de Diderot qui ne miment pas le
décousu de l’entretien, le désordre de l’oral ou le spontané de l’épistolaire ? L’adoption
d’une scénographie du décousu, du fragmentaire et du désordre répond sans aucun doute au
refus du dogme et du système. C’est pour la même raison – le refus du système et du traité
philosophique articulé – que d’aucuns ont pu déclarer que le XVIIIe siècle n’a pas produit de
vraie philosophie.
La préface, et en particulier le récit préfaciel, emprunté au roman comme sa forme la plus
radicalement topique, et exporté au discours du savoir, remplit une fonction cruciale dans la
discursivité classique. Elle ramène le discours au commun. Au mode spécifique de parole
qui s’y développe répond un mode spécifique de savoir. Dans le recours au récit préfaciel et
à la scénographie romanesque, il y a à la fois un refus et une revendication. Refus de la
discursivité officielle, logique, unifiée et autoritaire et du mythe du Grand Homme.
Revendication de la possibilité de connaître la vérité par d’autres voix que le logos,
revendication de la parole et de la pensée errante, revendication d’une discursivité qui se
protège par la fiction et se fait reconnaître comme de la fiction. Une discursivité qui oppose à
la voix pleine du philosophe la voix errante du penseur. Ou l’agréable prend la place du bien
et la vraisemblance celle du vrai.
Une discursivité qui ne se développe pas le long des sentiers battus de la logique et de la
rhétorique n’a aucune chance de convaincre si elle ne met pas en œuvre d’autres ressources
que celles de la causalité. Aussi la discursivité que l’on voit à l’œuvre dans les exemples
étudiés n’est-elle pas axée sur la persuasion mais sur la séduction. Autrement dit sur
l’adhésion du lecteur à un univers de parole qui, au travers d’une figuration fictionnelle de la
fonction d’auteur met en scène un Ethos susceptible de garantir et d’authentifier la parole.
Moyennant les scénographies préfacielles, le discours apparaît dans un « milieu », dans un
espace-temps qui est à même d’exercer une force persuasive non pas logique mais émotive,
pathétique, on pourrait dire. Ethos et Pathos constituent les deux pôles d’une contre-
11
rhétorique de la séduction, de l’adhésion à ce qui ne peut être prouvé, à ce qui n’est peut-être
pas vrai. Faute de pouvoir convaincre d’une vérité, la scénographie préfacielle
vraisemblabilise le discours préfacé par l’interaction d’une ethique et d’une pathétique qui
lui sont propres. Le public n’est pas dupe, mais n’acceptera d’entrer dans la fiction que si la
mise en scène le séduit, si d’une manière ou d’une autre, elle est perçue, émotivement,
comme un monde possible, vraisemblable. Et la vraisemblance n’est en cela qu’une modalité
de la reconnaissance rassurante d’une topique.
Dans l’intersection de ce refus du dogme et de la discursivité logique, et de cette
revendication d’une rhétorique de la séduction se trouve, encore une fois, la notion d’auteur.
L’auteur est une catégorie appartenant à la discursivité officielle : elle existe avant l’œuvre,
qu’elle crée et qu’elle assume dans une préface assomptive. Dans le roman et dans les
scénographies que la préface lui emprunte pour ensuite l’exporter au discours du savoir, en
revanche, l’auteur est refusé au départ de l’œuvre. Le roman est l’ouvroir d’une discursivité
autre, qui fabrique au sein de sa propre fiction une figure d’auteur, dramatisation et
figuration de l’autre. Une telle discursivité ne peut être que dénégative, non assomptive.
L’œuvre n’est pas attribuée au départ ; bien souvent même la scénographie ne semble
consister qu’à brouiller les pistes. Au public de l’attribuer.
5.
On n’a sûrement pas tout dit. De nombreuses questions restent sans réponse.
Quels motifs l’auteur peut-il avoir de s’absenter de son texte ? Est-ce que la raison politique,
la persécution et la peur de la censure, n’ont pas pu jouer un rôle après tout ? Cela me paraît
incontestable et il ne serait pas difficile de le montrer.
Dans l’Avertissement qui précède les Œuvres philosophiques de Voltaire17, Condorcet,
porte-parole des éditeurs de Kehl, déclare ceci:
Toutes les fois qu’un écrivain ne peut pas dire sous son nom tout ce qu’il croit être la
vérité, sans s’exposer à une persécution injuste, les ouvrages qu’il publie doivent être
lus et jugés comme des ouvrages dramatiques. Ce n’est point l’auteur qui parle, mais
le personnage sous lequel il a voulu se cacher.
L’anonymat, car c’est bien de cela qu’il s’agit ici, est une forme minimale de
dramatisation. Condorcet et Nélis ne résonnent cependant pas à l’unisson à cet égard. La
dramatisation est nécessaire, pour Condorcet, quand l’auteur risque la persécution en
s’avouant. Il ne peut pas se montrer. Pour Nélis, au contraire, comme on l’a vu, l’absence de
l’auteur, ou sa figuration sous la forme d’un traducteur-éditeur, est une ressource à la fois
poétique et éthique, dans la mesure où elle permet de mêler à l’aride philosophie la poésie
dont elle a besoin pour être assimilée avec agrément. Nélis ne veut pas se montrer, même s’il
le pourrait sans risquer d’être persécuté. Â l’âge classique l’évasion auctoriale peut,
troisièmement, être liée aux bienséances : un auteur ne doit pas trop se montrer. Il vaut
mieux qu’il abandonne au public le soin d’attribuer l’œuvre. Celui a qui un ouvrage
appartient ne doit pas trop ressembler à une personne, à un individu, mais plutôt à une figure,
à une « persona » au sens dramatique, précisément, c’est-à-dire à une figure fictive.
17 Œuvres complètes de Voltaire, De l’imprimerie de la Société littéraire typographique,
1784, « Avertissement des Editeurs » au tome 32, p.10.
12
Au désaveu par prudence « politique » fait pendant un désaveu par respect du code de
savoir-vivre dicté par l’opinion publique. La pression de l’opinion publique semble imposer
à l’auteur une certaine réserve quant à l’aveu de son œuvre. Il n’est pas donné à tout le
monde de pouvoir avouer son oeuvre : quand il n’a pas déjà l’autorité obtenue par des
œuvres agréées du public, l’auteur ne doit pas avouer son œuvre, c’est-à-dire qu’il ne doit
pas se l’attribuer avant que le public n’en ait jugé. Cette pression sur les auteurs par
l’opinion publique a été bien réelle. Les attestations se trouvent cachées dans les œuvres
mêmes. On en trouve une belle occurrence dans Les Confessions de Rousseau, au livre XI,
où il est question du désastre de la publication de l’Emile, en 1762 :
On me reprochait d’avoir mis mon nom à l’Emile, comme si je ne l’avais pas mis à
tous mes autres écrits18.
A l’imprudence de Rousseau d’avoir écrit une œuvre audacieuse sans avoir pris au moins
quelques précautions face aux Autorités se joint son audace de l’avoir signée, passant outre à
un code social. En publiant l’Emile, Rousseau choque certes de plusieurs manières les
Autorités, mais il froisse en même temps l’opinion publique, qui s’en prend moins à son
œuvre qu’à sa personne. C’est dans ce refus de toute précaution que l’énonciation
rousseauiste est mal-séante. Rousseau va à l’encontre d’un code de bienséance implicite, qui
demande à l’auteur de laisser au lecteur le soin d’attribuer l’œuvre avant de la signer.
Rousseau ne prend pas ces précautions, il signe, au rebours du code social qui exige de la
réticence. Refusant de s’effacer devant l’œuvre, Rousseau parle de lui. Sa faute est d’avoir
osé se montrer comme sujet écrivant, d’avoir dérogé à ce qu’on serait tenté d’appeler le
« tabou de l’auctorialité ».
Les modalités de l’évasion auctoriale répondent donc aux trois verbes modaux – pouvoir,
vouloir et devoir – dans la mesure où l’absence de l’auteur dépend de paramètres politique,
poétique ou éthique.
6.
Parmi les voies qui demanderaient à être explorées à partir de ces hypothèses, j’en
emprunterai une, pour finir, qui me reconduira au roman et à la perspective historique de
notre problématique. Il me faut dire deux mots de Cervantès et de Don Quichotte, qui me
semble être une figure pivotale de la problématique ébauchée ici.
Le personnage de Don Quichotte est absent de plus d’un tiers de la première partie du
roman. Deux lieux se partagent le devant de la scène, la Sierra où ont lieu les aventures, la
Taverne où on se les raconte. C’est dans la taverne que tous les héros de la première partie
vont se retrouver et tous les fils narratifs se dénouer : Cardenio y retrouvera sa Lucinde,
Dorothée son don Fernand ; Don Louis, déguisé en berger, y retrouvera sa bien-aimée Claire.
Le curé et le barbier qui s’étaient mis à la recherche de Don Quichotte l’y gardent à vue.
Lieu de la rencontre, la taverne est aussi lieu de narration19. Dans la taverne aura lieu une
des grandes discussions sur le roman de chevalerie. Au beau milieu d’un de ces débats, le
tavernier sort une malle, oubliée par un voyageur et contenant trois romans de chevalerie en
manuscrit :
18 Rousseau, Les Confessions, livre onzième, GF, édition par Michel Launay, 1968, p.345. 19 C’est dans la taverne que le captif raconte son évasion d’Alger et son amour pour la fille
de son maître qui, voulant se faire chrétienne, lui inspire les desseins d’évasion.
13
« lorsque c’est au temps de la moisson » dit le tavernier, « il s’assemble ici aux jours
de fête un grand nombre de moissonneurs, parmi lesquels il s’en trouve toujours
quelqu’un qui sait lire et qui prend un de ces livres ; et nous nous mettons plus de
trente autour de lui, et l’écoutons avec tant de plaisir qu’il nous ôte mille cheveux
blancs »20.
Dans la taverne donc, lieu de la rencontre, surgit le livre, en manuscrit, qui vient de nulle
part : d’une malle oubliée par quelque voyageur. Cette malle contient en outre le magnifique
récit du « Curieux impertinent ». Le curé en fera la lecture devant les autres. Mais cette
malle contient encore un autre récit, dans sa doublure. On ne le découvre que quand le
groupe se remet en route et au moment des adieux. Ce récit n’est autre qu’une des Nouvelles
exemplaires de Cervantes, « Riconete et Cortadillo ». Nous avons affaire ici, sans aucun
doute, à une mise en abyme, à une scène emblématique qui nous parle de la narration et de
son apparition ex nihilo dans une communauté d’auditeurs, tout sexe et tous états sociaux
confondus.
Cette mise en abyme doit nous ouvrir les yeux sur la conception quichottesque du roman,
dont les définitions fourmillent surtout à la fin de la première partie du chef d’œuvre de
Cervantes. En voici une, dont nous pouvons dire d’ores et déjà qu’elle nous semble
correspondre au programme du roman moderne. C’est le chanoine, rencontré sur le chemin
de retour au village, qui parle :
Car l’écriture décousue de ces livres donne lieu à un auteur de se pouvoir montrer
épique, lyrique, tragique, comique, avec toutes ces parties que comprennent et
contiennent en soi les très douces et agréables sciences de la poésie et de l’art
oratoire : car la composition épique se peut aussi bien se traiter en prose qu’en vers.
(p.475)
Le roman c’est tous les discours, tous les genres en un. C’est ensuite à Don Quichotte lui-
même qu’est réservé l’honneur de rétablir le roman de chevalerie et de livrer une des plus
belles métaphores de ce qu’est la lecture du roman. Le chanoine restera « ébahi de si
harmonieuse rêveries ». On entend en effet un Don Quichotte qui tout à coup est d’une
lucidité épatante :
Que votre grâce se taise, qu’elle ne prononce pas un tel blasphème et qu’elle me
croie, car je lui conseille en cela ce qu’elle doit faire comme prudente ; sinon, qu’elle
lise, et elle verra le contentement qu’elle en tirera. Ou bien, dites-moi, y a-t-il plus
grand contentement que de voir, comme qui dirait : voici à cette heure qu’il se
présente devant nous un grand lac de poix, bouillant à gros bouillon, couleuvres et
lézards, qui y vont nageant à tort et à travers, ensemble plusieurs autres espèces
d’animaux farouches et épouvantables ; et du milieu du lac il sort une voix fort triste
qui dit :
« toi, chevalier, qui que tu sois, qui es à contempler cet épouvantable lac, si tu veux
acquérir le bien qui est caché sous ces noires eaux, montre la valeur de ton cœur
intrépide et te jette au milieu de leur liqueur noire et enflammée : car, si tu ne fais
20Cervantes, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, 1949, p.308
14
ainsi, tu ne seras pas digne de voir les hautes merveilles qu’enserrent et contiennent
les sept châteaux des sept fées qui gisent sous cette noirceur ! »
Et à grand peine le chevalier a-t-il ouï la voix épouvantable que, sans plus réfléchir,
sans égard au danger où il se met, voire même sans se dépouiller ni décharger de la
pesanteur de ses fortes armes, mais se recommandant à Dieu et à sa maîtresse, il
s’élance au milieu de ce lac bouillant. Et, au moment qu’il n’y pense pas ni ne sait ce
qu’il doit devenir, il se trouve parmi les champs fleuris auxquels les champs Elysées
ne sont aucunement comparables. (p.492)
On est arrivé, à deux chapitres près, à l’extrême fin de la première partie du Quichotte : au
chapitre 50.
Les hypothèses que ces quelques épisodes finaux du premier Quichotte permettent
d’évoquer sont nombreuses.
(a) Il apparaît que la topique du manuscrit trouvé, qui constituera le noyau dur des récits
préfaciels, est d’abord une topique romanesque, à l’œuvre dans le roman même. Il y a bien
sûr dans le Quichotte même la valise trouvée dans la Sierra Morena, contenant les tablettes
de Cardenio, où ce dernier a griffoné quelques poèmes. Les livres tirés de la malle
abandonnée à l’auberge est plus emblématique. La présence d’une nouvelle de Cervantès
dans la même caisse, à côté des trois romans de chevalerie, dit assez le voisinage entre la
conception cervantine de la narration et la quête chevaleresque. L’attitude lectorale requise
par ces livres, auxquels l’œuvre de Cervantès est désormais associée, est ensuite mise en
abyme dans la magnifique métaphore du lac de poix. Le lecteur devra s’y plonger, malgré
tous les dangers et menaces auxquelles ce plongeon l’expose ; il devra tout oublier et se
lancer la tête la première dans cet univers au fond duquel il trouvera des merveilles.
L’association de l’acte de lecture et de l’acte de prouesse du chevalier est hautement
significative de la conception cervantine du roman, qui inaugure l’ère moderne : le lecteur
devra ressembler au chevalier errant ; la vérité n’est pas à trouver toute faite, mais au bout
d’une quête. Entreprendre cette quête est plus importante que trouver la vérité. Cette idée est
centrale dans le roman de chevalerie médiéval. Elle trouve son expression la plus idéalisée
dans la quête du saint Graal, ce réceptacle de la vérité suprême. Et dans la version ultime du
mythe du Graal, chez Wagner, n’est-ce pas au fou, au « reiner Tor », Parzifal, qu’il est donné
de trouver cette vérité suprême ? La vérité est dans la quête, dût-elle mener à la folie. Don
Quichotte, lecteur de romans, m’apparaît comme la figuration du lecteur moderne.
(b) Par le topos du manuscrit trouvé dans la caisse abandonnée qui en est l’emblême, le
roman moderne est relié à la tradition antérieure du roman médiéval. Le roman de chevalerie
médiéval apparaît dès le XIIIe siècle comme un discours subversif, qui transforme la sûreté
de la Foi contenue dans les écrits divins en quête de la vérité. Le roman rivalise avec les
écrits évangéliques, cela est bien connu.
L’un des mécanisme de transmission des écrits bibliques est la logophagie, dont le
prophète Ezéchiel fournit un magnifique exemple :
Et toi, fils de l’homme, écoute ce que je vais te dire : « Ne sois pas rebelle comme la
maison de rebellion ; ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai,
et voici qu’une main se tendait vers moi et dans cette main il y avait un rouleau écrit
15
au recto et au verso. […] Je le mangeai et il devint dans ma bouche aussi doux que le
miel21.
A ce livre divin, ingurgité par le prophète pour ensuite être restitué par l’écriture destinée
aux humains, Robert de Boron a substitué le livre de la quête, composé au fur et à mesure,
sous la dictée de Merlin, enfant d’une vierge et du diable, qui connaît le passé, le présent et
l’avenir.
(c) Avec le topos du manuscrit composé au sein même du récit, celui-ci conserve le lien
avec une origine. L’auteur, cependant, ne se montre plus avant l’œuvre, sa figure existe dans
l’œuvre, qui s’écrit sous sa dictée. Le lien sera coupé avec le topos du manuscrit trouvé, sine
loco, sine dato, sine nomine. Le manuscrit trouvé est aux antipodes du livre ingurgité par le
prophète.
On n’y insistera pas davantage. Contentons-nous ici et pour l’heure d’arguer que la
topique éminemment romanesque du manuscrit trouvé constituera le point focal
d’innombrables récits préfaciels qui en forment l’endurcissement, le raccourci et, de plus en
plus, la parodie. Loin de vouloir induire en erreur leurs lecteurs quant au statut ontologique
des textes préfacés, les préfaces topiques me semblent réactiver la logique quichottesque : le
texte est donné pour un écrit dont l’origine n’est pas garantie par une source autoritaire, mais
peu sûre. L’autorité du texte se construit sur la figuration d’un Ethos. Sa crédibilité s’obtient
au travers d’une contre-rhétorique du Pathos. Sa lecture est une mise en commun.
6.
Et la préface ? Que conclure ?
« Tout honnête homme doit avouer les livres qu’il publie. Je me nomme donc à la tête de ce
recueil, non pour me l’attribuer, mais pour en répondre », déclare Rousseau dans la première
préface de La Nouvelle Héloïse. Voilà le prototype de la préface assomptive, où l’auteur se
nomme en s’avouant le père de l’œuvre. L’injonction de Rousseau montre bien que la
préface assomptive est un lieu où se joue la dimension morale du métier d’écrivain : c’est le
lieu d’un aveu, où l’auteur, en se nommant s’accuse de l’œuvre. Reconnaissance à la fois
nominative et accusative, si l’on veut.
La préface dénégative, au contraire, n’est pas un lieu moral, mais pragmatique. En
refusant de se nommer à la tête de son livre, l’auteur se montre sous une figure qui lance le
discours sur l’orbite de l’Ethos et du Pathos, d’une contre-rhétorique de la séduction, de
l’agrément et de la vraisemblance. Il refuse la posture en tête de l’œuvre. Il récuse la
discursivité logique en laissant une marge de négociation avec le public, qui le reconnaîtra
ou ne le reconnaîtra pas, qui lui attribuera l’œuvre ou l’attribuera à un autre.
A rebours de cette discursivité pragmatique, Rousseau. C’est dans l’œuvre de Rousseau
que s’articulent le plus visiblement les deux discursivités dont il a été question ici :
discursivité assomptive et discursivité dénégative. La première répond à la logique de la
causalité, de l’origine et de l’unicité, qui antépose l’auteur à l’œuvre. La deuxième équivaut
à une contre-discursivité du discours commun et décousu, qui postpose l’auteur à l’œuvre et
qu’on peut enfin appeler, avec Anne Cauquelin, qui nous accompagne depuis en moment
déjà dans notre raisonnement : la doxa.
21 cité dans Ruth Reichelberg, Don Quichotte ou le roman d’un juif masqué, Seuil, 1999, p.9.
16
La doxa : une autre pensée, non pas le double honteux de la raison mais une manière
différente de raison, un processus singulier par lequel une errance trouvait son lieu
dans le mouvement, processus qui transportait des images et des mots colonisés par
les canaux de l’information, et par lequel, aussi, s’éprouvaient des comportements
non planifiés22.
Dans cet exposé, j’ai eu jusqu’à présent la part belle. Il s’agit ici d’un travail réalisé en
équipe, à Louvain, avec Nathalie Kremer, Géraldine Henin et Mladen Kozul. Si je me
nomme à la tête de cette contribution, ce n’est pas pour me l’attribuer, mais pour en
répondre.
22 Anne Cauquelin, L’art du lieu commun. Du bon usage de la doxa, Seuil, 1999, p.12.