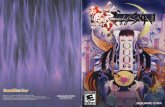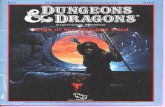La saga des ficelles
-
Upload
nonesuchunivesity -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La saga des ficelles
Jef KlaK Bout d’ficelle Coudre / En découdre
epuis que les continents ont dérivé, l’Amérique se trouve physiquement séparée de l’Europe, et leurs rapports culturels n’ont commencé qu’à la faveur de la traversée de l’Océan. Les livres d’histoire racontaient encore
il y a peu que l’honneur d’avoir relié pour la première fois Espagne et Caraïbes devait revenir à Christophe Colomb. Ils passaient trop vite sur les légendes qui pré-sentent les premiers voyages transatlantiques comme l’œuvre d’évangélisateurs irlandais, les compagnons de saint Brendan, dont il est fait mention dans les récits hagiographiques 1 centrés sur ce personnage à la popu-larité toujours renouvelée.
On ne mentionnait les sagas nordiques que pour étoffer la liste, mais on attendait fort peu de ces his-toires traitées comme de vulgaires romans d’aventures pour pillards assoiffés, réunis pendant les longs hivers nordiques autour du récit d’exploits imaginaires. Des trois sources historiques qui nous informent sur ce qu’a pu être la première rencontre avec les Amériques, il faut se contenter de peu, dans le style synthétique des scaldes 2. Pour cela, l’archéologie n’a aucun rival, elle qui par vocation se limite à interpréter les gise-ments d’établissements et d’objets anciens.
Aux États-Unis, cela fait longtemps que les Scan-dinaves-Américains cherchent à faire reconnaître leur antériorité, et donc une certaine préséance sur les Anglo-saxons, les Hollandais et autres locuteurs de langues germaniques. Au XIXe siècle, l’archéolo-gie fut un moment mise au service de la fierté scandi-nave, comme en atteste la célébration du Leif Erikson’s Day 3, concurrent du Columbus Day. Si l’on songe à la Tour de Newport (Rhode Island), à la Pierre runique de Kensington (Minnesota) ou au Rocher de Digh-ton (Massachusetts), l’interprétation de découvertes nord-américaines à travers le prisme scandinave a tou-jours eu un certain succès populaire, puis médiatique. En 1958, Kirk Douglas, cheveux au vent, à la proue de son drakkar n’y fut pas pour rien, et le héros danois Ragnar Lothbrok lui succède aujourd’hui, popularisé par la série TV Vikings. Mais qu’en est-il des marins sans nom qui ont tenté leur chance au-delà d’une Europe féodale en guerre, et qui ont choisi la vie libre de chasseur de morses, de phoques et de baleines ?
D
la saga
De quelques corDes qui unirent l’europe et l’amérique norDiques
Laboratoire autonome d’anthropologie et d’archéologie
(LAAA)
257
Peut-être le voyage inaugural fut-il celui du naviga-teur Bjarni Herjólfsson en 985. Il raconta à son retour au Groenland avoir vu des îles qu’il n’avait pas voulu aborder. Quinze ans plu-s tard, ayant grandi avec le souvenir de l’expédition de Bjarni, l’explorateur Leif le Chanceux, fils d’Eirik le Rouge, se décida à ten-ter les dieux. Il fut le premier à poser le pied sur le continent nouveau. Puis vinrent ses frères ; Thorvald fut le premier noble tué au combat par des guerriers indiens venus venger la mort de plusieurs de leurs camarades assassinés la veille, et il reçut la première sépulture chrétienne attestée par les sources écrites. Thorsten, moins belliqueux, partit à son tour avec sa femme Gudrid pour retrouver la tombe de son frère et emmener sa dépouille en terre sanctifiée. Son pro-jet fut déjoué par une mer furieuse qui fit dériver ses bateaux jusqu’au début de l’hiver, et il mourut de ces fatigues à peine rentré. Remariée, Gudrid repartit avec son nouvel époux Thorfinn et ses compatriotes islan-dais, et ce couple fut parent du premier WISC (White
Islando-Scandinavian Catholic, néologisme) à naître en Amérique, Snorri. Ces expériences inaugurales tou-chaient à leur fin : les batailles rangées entre Indiens et Nordiques, puis le massacre des colons islandais par leurs camarades groenlandais sur les ordres de Frey-dis, sœur de Leif, lors de la quatrième expédition, mit fin aux tentatives d’installation en Vinland que nous racontent les sagas. Il ne restait plus qu’à abandonner le continent, dont l’existence même devait se perdre dans la mémoire des Européens.
L’histoire en restait là, heureuse d’avoir trouvé dans les années 1960 au Canada, à l’Anse-aux-Meadows, la preuve de l’existence d’un site nordique, identifié comme les « cabanes de Leif » mentionnées dans les sagas. Tout le monde se contenta de cette avancée significative mais isolée, et seuls de très rares archéo-logues se mirent en tête de trouver l’éléphant blanc que représentaient les traces de contacts interculturels dans les îles et sur les côtes Arctiques du Canada.
Des ficelles
1. Les deux témoignages médiévaux sur saint Brendan sont le récit de sa vie Vita Brendani et de son voyage miraculeux Navigatio Sancti Brendani abbatis conservés en langue latine et irlandaise, et ayant pour origines des textes datant entre le VIIIe et le Xe siècle CE.
2. Les scaldes tiennent lieu de bardes et de poètes chez les Scandinaves et dans leurs colonies comme l’Islande et le Groenland. Dépositaires de traditions légendaires et historiques sur la fin de l’Antiquité germanique, ils sont les auteurs originaux des récits transmis ultérieurement dans les sagas médiévales.
3. Instauré par le pré-sident L.B. Johnson à la date du 9 octobre, il reste toujours proche du Columbus Day fixé au second lundi d’octobre.
Jef KlaK Bout d’ficelle Coudre / En découdre
Les découvertes suivantes devaient être l’œuvre de chercheurs canadiens et français, Thomas Lee et Patrick Plumet, travaillant ensemble puis séparé-ment, sur les sites de « maisons longues » de la baie d’Ungava. Ils se déchirèrent sur l’attribution cultu-relle des restes découverts. Alors que Lee donnait pour nordiques un arc, une hache métallique et un bol d’une forme typique aux îles Shetland, ainsi que quelques sculptures d’ivoire, Plumet récusait la vali-dité de ces objets pour dater l’occupation des maisons longues et mettait directement en doute l’hypothèse d’une présence scandinave dans la baie. En collè-gues rompus aux us et coutumes scientifiques, ils se menèrent une guerre à outrance, se dissimulant des preuves et remettant en question systématiquement les progrès des théories du camp adverse 4. À l’issue de cette polémique, aucune hypothèse précédemment avancée à propos d’une rencontre entre Européens et chasseurs polaires ne trouvait de défenseur et plus personne n’avait les idées claires et sereines à ce pro-pos. Le dossier était tellement embrouillé qu’il fallait reprendre au début les investigations et réexaminer les découvertes qu’on pouvait clairement associer à un contact précolombien.
Ce travail fut l’œuvre d’un couple de chercheurs, les époux Sutherland, tous deux archéologues, employés par le Musée canadien des civilisations (devenu Musée d’histoire du Canada depuis), et chargés de responsa-bilités académiques par diverses institutions universi-taires. Comble de déveine, leur exigence scientifique et humaine s’est retournée contre eux et ils ont fait l’ob-jet d’une procédure en 2012 pour harcèlement moral sur leurs collègues, qui a coûté à Patricia Sutherland son poste de conservatrice pour l’archéologie arctique au musée, et son éméritat universitaire à son mari. Une telle condamnation a rapidement été associée au fait que le Musée qui les employait connaissait un recentrement sur l’histoire de la colonisation anglaise du Canada et s’opposait en principe à la théorie du contact scandinave médiéval, choisissant une inter-prétation historique en vogue en Amérique du Nord mais jugée conservatrice et peu crédible hors de ce continent. Cette mésaventure a privé les chercheurs de l’accès aux données scientifiques récoltées depuis 1999 sur le site de Nanook 5, et a mené à une campagne de soutien internationale – qui a atteint le rédacteur de cet article et lui a fourni le sujet ici traité.
Sur le plan scientifique, ce fut leur collègue Robert Park qui mena l’opposition à leur théorie du contact interculturel en 2008 dans la prestigieuse revue Antiquity. Il remettait en question les conclusions de Patricia Sutherland à propos de l’attribution culturelle et de la datation des sculptures sur bois et ivoire, sur l’originalité technique des cordelettes tissées et sur les éléments en bois, f lotté ou non, découverts à Nanook ou réexaminés dans les collections du musée. La polé-mique rebondissait, laissant le mystère entier.
4. Personnages secondaires de cette polémique, Carl B. Compton et Albert A. Dekin y apportèrent leurs opinions, approfondissant le problème et par là même les divisions.
5. Ce site canadien est situé dans la vallée de Tanfield, au sud de l’île de Baffin
259
Mais les dernières découvertes de Sutherland sur le site de Nanook obligèrent à rouvrir le dossier. L’ar-chéologue et son équipe y a mis au jour, en plus des éléments contestés (cordes tressées, éléments de bois, sculptures miniatures), du matériel typiquement européen : une pelle en os de baleine ayant pu ser-vir à couper du gazon pour en recouvrir les maisons longues (mise en œuvre typique de l’architecture nor-dique), un ensemble de rigoles d’évacuation des eaux
cernant un bâtiment (trait inusité dans l’architecture locale), des éléments de fourrures de rats européens, des pierres à aiguiser qui n’ont d’utilité que pour des populations employant le métal (que ne maîtrisaient pas les Indiens) et un fragment de creuset pour la fonte du bronze d’après les traces de métal restées fixées à la paroi du récipient. L’ensemble de ces découvertes est daté par Sutherland entre la fin du IXe et le début du XIe siècle.
Jef KlaK Bout d’ficelle Coudre / En découdre
Quant à la ficelle tressée en poils de lapin arctique mêlés de laine caprine, l’histoire est sur le point de se retourner : alors que Sutherland la prenait pour un artéfact clairement nordique, en la comparant avec une ficelle du XIVe siècle découverte au Groenland en contexte nordique, Park semble à même de prou-ver que les Indiens Dorset 6 en avaient déjà l’usage plusieurs siècles avant toute rencontre possible avec des Scandinaves. De cet état de fait, on pourrait tirer une nouvelle hypothèse, que je vous confie en primeur avant qu’elle ne soit embarquée dans la tourmente :
est-il possible que les Groenlandais aient échangé du bois, du textile ou autre chose contre de la ficelle façonnée par des Indiens Dorset ? Est-ce que ce sont les colporteurs Dorset qui entrèrent en contact avec les nouveaux arrivants plutôt que l’inverse ? Les pre-mières rencontres n’ont-elles pas pu être pacifiques et relever de l’échange plutôt que du conflit ? Les premiers liens entre Européens et Américains ont-ils été noués par un bout de ficelle ?
261
Dans l’article, j’utilise plusieurs mots pour parler des groupes culturels en contact.
Pour les populations locales indiennes, les civilisa-tions archéologiques successives ont pour noms Dor-set, Thulé puis Inuit. Les deux derniers mots n’ont pas été utilisés, car il n’a pas été nécessaire de mentionner ces groupes de chasseurs arctiques postérieurs à la période dont nous discutons. Le mot Eskimo (Esqui-mau) nous ayant semblé d’un usage malaisé et compre-nant des connotations négatives, nous avons renoncé entièrement à son emploi.
En ce qui concerne la composante scandinave des populations arctiques, les mots « Nordique » et « Groenlandais » ont été utilisés comme synonymes, au lieu de préciser systématiquement la valeur du terme et de rendre de la sorte le texte indigeste. De la même manière que le mot « Eskimo » a été tenu hors du texte, le terme « Viking » n’a pas été utilisé au vu de l’imprécision avec laquelle il est reçu.
En ce qui concerne les dates, elles sont données selon le calendrier de l’ère commune, marqué CE pour Common Era. Cette notation remplace avantageuse-ment la référence à un personnage mythique comme J.-C. (Jésus-Christ) ou une quelconque A.D. (Anno Domini – Année du Seigneur) à la validité culturelle universelle très contestable. Elle ne change néanmoins rien en regard du comput, et les dates historiques ne s’en trouvent pas modifiées. La bataille de Marignan s’est donc produite en 1515 CE, qui équivaut à 1515 Apr. J.-C. ou 1515 A.D. mais nous épargne la référence reli-gieuse inopportune.
Stéphane Adam, 2004, « Adaptations et interactions entre les cultures Dorset, Thulé et Viking : mécanismes d’une transition culturelle » Commu-nication au colloque international sur la Nordicité, Rouen, 2004/2005, publié sur <academia.edu>.
Thomas E. Lee, 1971, « Archaeologi-cal investigations of a Longhouse, Pamiok Island, Ungava, 1970 », Centre d’études nordiques de l’Université Laval (UL).
Robert Park, 2008 « Contact between the Norse Vikings and the Dorset culture in Arctic Canada », Antiquity, Vol. 82, Issue 315, March 2008.
Patrick Plumet, 1985, « Archéologie de l’Ungava : le site de la Pointe aux Belougas (Qilalugarsiuvik) et les maisons longues Dorsetiennes », Montréal, Laboratoire d’archéologie de l’université du Québec à Montréal.
Patricia Sutherland, 2000, « Éléments de contact culturel : Interactions dor-sétiennes-nordiques dans l’Arctique de l’Est canadien », Appelt, Berglund et Gulløv (éd.), Identities and Cultural Contacts in the Arctic : Proceedings
from a Conference at the Danish National Museum, Copenhagen, November 30 to December 2, 1999, Copenhague, Danish National Museum et Danish Polar Center, 2000, avec des révisions de l’auteur (corrections apportées sur le site internet <civilisations.ca>).
Patricia Sutherland et al., 2014 « Evidence of Early Metalworking in Arctic Canada », Geoarchaeology, n°30, December 2014.
Bibliographie Addendum
Dans l’article « Murabitun » (numéro précédent de Jef Klak, « Marabout »), une note de bas de page renvoyant à un texte du sociologue malien Naffet Keita s’est glissée malencontreusement à l’insu des auteurs qui tiennent à exprimer vivement leur désaccord avec les positions de ce chercheur. Ce personnage fort médiatisé dans les domaines les plus divers et auteur de déclarations belliqueuses telles que « Il faut un gouvernement de guerre au Mali. » ou tautologiques comme « On ne naît pas jihadiste, on le devient. » ne mérite aucunement qu’on le cite aux yeux des auteurs de l’article.
Erratum6. Le groupe culturel Dorset (connu uniquement par l’archéologie) occupait le nord du Canada et le Groenland jusqu’aux environs du XIIe siècle CE. Ce faciès archéologique se perd au profit de la culture Thulé, migrant vers le Nord-Ouest depuis les confins de l’Alaska et les Grands Lacs. Les groupes Thulé laisseront eux-mêmes la place aux Inuits vers le XVIIIe siècle, culture occupant à présent la région.