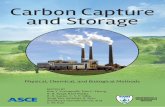La question berbere : quand le politique capture l'identitaire
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of La question berbere : quand le politique capture l'identitaire
LA QUESTION BERBÈRE : QUAND LE POLITIQUE CAPTUREL’IDENTITAIRE
Arezki Metref
La Documentation française | « Maghreb - Machrek »
1996/4 N° 154 | pages 25 à 30 ISSN 1241-5294DOI 10.3917/machr1.154.0025
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-maghreb-machrek1-1996-4-page-25.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour La Documentation française.© La Documentation française. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
La question berbère : quand le politique capture l'identitaire Arezki Metref *
Et août 1988, quelques mois avant l'explosion d'octobre, le chef de daïra (sous-préfet) de Aïn-Turk, sur la corniche oranaise, prend une initiative iconoclaste : organiser des journées de poésie. Plus iconoclaste encore, il invite des poètes qui s'expriment dans les trois langues utilisées en Algérie : berbère, arabe et française. Parmi les invités, le groupe de Tazmalt (dans la vallée de la Soummam) était original puisqu'il réunissait des poètes écrivant collectivement dans les trois langues. Dans la salle des fêtes où se déroulaient les lectures, seul le passage du poète berbère a suscité des remous. Un groupe de personnes 1 'a chahuté pour le simple fait gu' il écrivait dans sa langue maternelle. Il venait, d'une certaine manière, de violer un tabou et de faire apparaître la question berbère.
• La dénégation
L' indépendance du pays aurait dû être le moment pour lui de se réapproprier toute sa mémoire historique. Or, elle s'est manifestée au contraire par une répression du fait berbère (1)- interdiction de l'enseignement du berbère, obstacles mis à l'expression culturelle berbère (il a fallu attendre 1993 pour que soit réalisé un film en berbère), occultation d'éléments de son histoire- et par une politique d'uniformisation du pays basée sur le modèle arabo-musulman. « Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes», s'était écrié M. Ben Bella au lendemain de l'indépendance, dans l'un de ses premiers discours . Et les ulémas, avant le début de la lutte de libération, proclamaient déjà « l'Algérie est mon pays, l' arabe ma langue, l'islam ma religion ». Ces orientations ont été inscrites dans la Constitution (art. 2 : « L'Islam est religion d'Etat »; art. 3 : « L'arabe est langue nationale et officielle ») et mises en pratique à travers une politique systématique d'arabisation du pays.
L'interdiction de l' enseignement de la langue berbère n'a pas été le seul signe de la volonté du pouvoir nationaliste de l'Algérie indépendante d'amputer le pays d' une partie de sa mémoire historique. Le comportement des élites politiques ct intellectuelles issues du mouvement national a procédé aussi de cette stratégie. La répression qui a frappé n'a pas été seulement l'apanage de la direction politique du mouvement national et du pouvoir nationaliste de 1' Algérie indépendante. Le martèlement de l'identité arabo-musulmane de l'Algérie, sans tenir compte de l'histoire, a fini par conditionner des générations entières d'Algériens dans 1' idée que le simple fait de revendiquer sa berbérité était ipso facto un appel à la sécession, donc une
* Journaliste à Algérie Actualité, puis à l' Hehdo Libéré, fondateur en j anvi er 1993 avec Tahar Djaout et Abdelkrim Djaad de l'hebdomadaire Ruptures. ( 1) Par fait berbère, nous entendons à la foi s l'histoire, la culture, l' identité ainsi que l'implication de ces troi s éléments dans le présent politique.
Monde arabe Maghreb Machrek N° 154 oct.-déc. 1996
Etudes
25
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Monde arabe Maghreb Machrek
N"154 oct.-déc. 1996
La question berbère : quand le politique
capture l' identitaire
26
atteinte à l'unité nationale. Même les intellectuels de l'Algérie indépendante, formés pourtant dans la complexité du débat sur l'identité nationale et censés compendre que la question berbère était, plus qu'une problématique « culturaliste » à laquelle on a voulu la réduire, un enjeu de pouvoir, manifestaient souvent une réaction de rejet devant une question qui perturbe le confort idéologique. Cette attitude se retrouvait aussi chez des Berbères qui servaient de caution au pouvoir, à sa périphérie ou au sein de forces politiques lui étant acquises : le modèle arabo-musulman suffisait à définir l'identité unique exigée par l'unité nationale. Or, qu'il s'agisse ou non de l'Algérie, il est évident qu 'un pays, au sens moderne du terme, c'est-à-dire une entité nationale inscrite dans un territoire reconnu internationalement, est le produit d'une sédimentation historique. Comme tous les pouvoirs nationalistes, le pouvoir algérien s'est contenté d'offrir à l'histoire du pays, en guise de passé, le sien propre. Tewfik el Hakim, le grand dramaturge égyptien, ne disait-il pas, avec son humour caustique habituel : « L'ennui avec Gamal Abdelnassar, c'est qu'il croit que l'Egypte, qui a plus de quatre mille ans d'histoire, a commencé avec lui».
- Le combat des années 1980 : la démocratie
Or, malgré tout, le fait berbère a survécu, à travers la langue, la culture, et surtout l'organisation sociale traditionnelle, à des siècles et des siècles d'invasions, de conquêt_çs, d'acculturation. Trahie dans ses espoirs d'une indépendance qui serait aussi restitution de toute l' identité algérienne, la cause berbère a été prise en charge par une nouvelle génération de militants pugnaces à partir des années 70 (2) . Les « berbéristes » n'étaient plus alors, comme dans les années 40, des militants d'une indépendance nationale au sein de laquelle ils exigeaient la reconnaissance de l'identité berbère sous le slogan « Algérie algérienne » en opposition à l' « Algérie arabo-islamique »de la direction du PPA (Parti du Peuple algérien). C'était plutôt une jeune élite intellectuelle, se situant à distance des appareils politiques, qui va entreprendre une lutte patiente pour la reconnaissance par 1 'Etat national d'une de ses composantes : la culture berbère. Le travail de cette élite trouvera un retentissement populaire lors du printemps berbère de 1980 qui a vu, dans les principales villes de Kabylie ainsi qu'à Alger, des soulèvements contre un pouvoir qui entretenait l'amnésie sur cette question et à qui était demandée la reconnaissance d'un fait ancré dans la réalité. Les manifestations ont été réprimées mais leur ampleur, et surtout leur détermination, ont projeté de façon brutale la question berbère sur le devant de la scène nationale. La patience de l'élite berbère qui s'était investie dans ce combat a été payante. Désormais, le pouvoir ne pourra plus occulter cette question.
Le pouvoir va alors changer de stratégie et accuser la Kabylie- qui, pour des raisons historiques évoquées plus loin, s'est trouvée à l'avant-garde de la revendication berbère- de vouloir monopoliser «le patrimoine culturel national». Dans l'une des grands-messes de l'unanimisme institutionnel affectionnées par le pouvoir algérien , au Palais des Nations du Club des Pins, le président Chadli Bendjedid déclarait le 17 avril 1980, alors que les manifestations sur la renaissance de la culture berbère battaient leur plein : 1 'Algérie est « un pays arabe, musulman, algérien » ; et il ajoutait : «La culture algérienne constitue l'acquis de vingt millions de citoyens. Nous disons non à ceux qui veulent exploiter ce thème à des fins politiques». En octobre 1994, Moqdad Sifi, chef du gouvernement, ne dira pas autre chose, affirmant que la revendication berbère « ne peut pas et ne doit pas être monopolisée ou instrumentalisée à des fins politiques ».
(2) Cf. ce qu ' en dit Saïd Sadi : Algérie, l'heure de vérité, Paris, Flammarion, 1996.
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Autre argument employé par le président Chadli Bendjedid toujours dans le même discours de 1980 : « Le monde arabe a confiance en 1 'Algérie, nous ne devons pas le décevoir » (3). Il était, en effet, plus facile, de décevoir une population vis-àvis de laquelle on disposait de moyens de répression, qui furent d'ailleurs mis en œuvre.
La victoire militaire remportée alors par le pouvoir s'accompagnera, cependant, d' une défaite politique : à partir de cette date, la population algérienne dans son ensemble va être sensibilisée à la question berbère. En outre, un pas venait sans doute d'être franchi dans le sens du pluralisme, et peut-être même de la démocratie. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, un thème était proposé à la réflexion sans être imposé par le pouvoir : il émergeait même contre lui. La revendication berbère, exprimée jusque-là par une élite, trouvait désormais des relais dans la population, et les émeutes avaient posé un problème aux dimensions multiples : au premier niveau, il y avait bien sûr la revendication berbère; mais était apparu également un thème nouveau, celui de «la liberté d'expression», que le président Chadli Bendjedid lui-même avait dû évoquer dans son discours du 17 avril 1980 en référence aux événements qui secouaient la Kabylie. Ce n'est pas un hasard - et le pouvoir politique de l'époque l'a peut-être mieux compris que les intellectuels - si les animateurs (et les thèmes) du printemps berbère de 1980 vont trouver des prolongements, au cours des années 80, dans la défense des droits de l'homme, du pluralisme et de la démocratie. Il y aura lieu de souligner, un jour ou l'autre, le lien existant entre la revendication berbère, telle qu'elle a été exprimée dans 1 'Algérie indépendante, et la défense de ces thèmes encore présents aujourd'hui dans un pays où le conservatisme gagne du terrain . La réflexion de Mouloud Mammeri prévoyant que « la question démocratique au Magheb ne sera résolue qu'avec la question berbère» paraît plus que jamais d'actualité.
La Kabylie a fourni sans conteste les éléments les plus dynamiques et les plus intransigeants dans la défense de la cause berbère. Pour déconsidérer celle-ci, il est d'usage d'accuser la Kabylie de régionalisme. Cette culpabilisation met sur la défensive l'élite politique et intellectuelle kabyle, mise en demeure de prouver son attachement à l'unité nationale. Malgré la volonté des animateurs du combat berbère de lier leur revendication à celle de la citoyenneté, le terrain idéologique et politique est toujours prêt à les faire suspecter de vouloir nuire à l'Etat national et de servir des intérêts étrangers. Ainsi, une dépêche d'Algérie Presse Service (APS), du 21 avril 1980, accusait les animateurs des manifestations d'être« en contact permanent avec l'étranger», sans autre précision. Le 12 avril 1980, l'Union nationale de la Jeunesse algérienne (UNJA) reprochait aux grévistes d'être «manipulés par des forces réactionnaires liées aux intérêts impérialistes néo-colonialistes » et de chercher à saper «l'unité nationale, l'arabité du peuple algérien, son attachement aux idéaux de l'islam et son engagement à édifier une société socialiste». Lors d'un meeting de «soutien au chef de l'Etat» (4), organisé par les «autorités locales» (5) à TiziOuzou, le 11 avril 1980, un orateur condamnait « les troubles suscités par les ennemis intérieurs et extérieurs de la révolution», s'en prenant plus particulièrement à «ceux qui peuplent les salons parisiens ».
C'est une tradition bien établie chez le pouvoir algérien que d'imputer toute contestation à des manœuvres de l'étranger pour déstabiliser le pays. L'indépendance ayant été acquise contre J'étranger- la France en J'occurence - l'opinion algérienne est sensible à l'argument du «complot contre la révolution», martelé depuis
(3) Le Monde. 19 avril 1980. (4) Expression typique de la langue de bois officielle. (5) Ibid.
Monde arabe Maghreb Machrek W154 oct.-déc. 1996
Etudes
27
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Monde arabe Maghreb Machrek
N" 154 oct. -déc. 1996
La question berbère : quand le politique
capture l'identitaire
28
l'indépendance. L'appel de I'UNJA n'était pas dicté par le pouvoir, mais était probablement une réaction spontanée de sa direction, qui illustre cette culture du complot inoculée aux Algériens dans leur ensemble, et a fortiori à ceux d'entre eux qui touchent de près à la poli tique, un domaine quadrillé.
- Le printemps berbère, un rôle moteur
Pour Salim Chaker, il « est maintenant clair que l'explosion de 1980 n' a pas éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein : elle résultait d' un long processus de maturation qui a traversé la Kabylie et les populations kabyles expatriées (principalement en France) dont il est tout à fait possible d ' identifier les condi tions et déterminations, les principaux moments et les acteurs » (6).
On ne peu t, en effet, comprendre en quoi la question berbère a changé de contenu après 1981 - notamment en se dotant d ' un prolongement politique - sans fa ire un rapide retour en arrière pour saisir comment la Kaby lie a été amenée à jouer un rôle moteur dans cette revend ication.
Ainsi Azzedine, un des animateurs du Mouvement culturel amazigh (Aurès) attire l'attention sur ce rôle de la Kabylie. Se demandant (7) « comment inscrire notre revendication dans la dynamique du combat pour l'amazighité, comment inscrire le travail revendicatif et politique entamé par le mouvemen t national amazigh dans la permanence de notre patrimoi ne>> , il déclare que ces questions sont « au cœur du débat >> pour son mouvement « car finalement, le travail fait par les Kabyles nous interpell e et nous oblige à nous décider >>, ajoutant :<< Pour peu que l' on prenne conscience des enjeux, on comprendrait vite qu'on ne saurait vi vre ce siècle amputé d 'un aspect de notre personnalité algérienne ... Au-delà de la revendication identi taire, le MCA des Aurès a réaffirmé son attachement indéfectible aux libertés démocratiques et aux droi ts de l'homme >> _ Le printemps berbère de 1980 a aussi permis, dans les Aurès, de poser le problème de la berbérité d' une autre façon, comme en témoigne Mohamed Merd aci, président de la Ligue des Aurès pour la culture amazigh (8), lorsqu ' il contredit l'idée reçue d'une arabisation totale des Aurès : « La grande arabisation nous est parvenue à partir des années 40 par les ulémas de Ben Badis. Nous regrettons beaucoup cela, car ils nous ont trahis. Le peuple était croyant et de bonne foi. Il adhérait à tout ce qui provenait de l'Islam. Seulement l' intention des ulémas n'était pas vraiment saine. Il y avait déjà nai ssance du nationali sme islamique. Dans les Aurès, les premières vagues formées et culti vées étaient celles des ulémas part is vers l'uni versité de la Zi touna en Tunisie et El Azhar en Egypte. A leur retour, il s diffu saient leurs idées. ( ... ) Malgré cela, et dans leur grande majorité, les habitants des Aurès ne s'étaient pas arabisés. Pour preuve, lorsque on était enfants, dans nos vill ages , on ne savait pas l' arabe ni son écriture. On apprenait le Coran mais on ne savait pas l' arabe, tout comme les Pakistanais >>.
- Un long processus de maturation
Pour comprendre ce rôle pionn ier de la Kabyl ie, il faut remonter au Mouveme nt nati onal au se in duquel s'exprimaient, face aux tenants d'une Algérie qui « marche sur un seu l pied >>, l'arabo-islamisme, les partisans d' une Algérie tout simplement algérienne, c'est-à-dire assumant l'ensemble de son passé, autrement dit de son identité. « La laïcisati on relative, écrit Charles-Robert Ageron, fut la conséquen-
(6) Salim Cha ker : « La questi on berbère dans l' Algérie indépendante : la fracture inévitable ·)» in Demain, l 'Algérie. Pari s. Syros. 1995. (7) Algérie Actualité n" 1489, semaine du 26 avri l au 2 mai 1994. (8) El \\latan. 17 oc tobre 1994.
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
ce de l'émigration kabyle en France. Mais, dans une perspective historique, l'émigration fut surtout une école politique. Les ouvriers kabyles, soumis d'abord à la prédication du Parti communiste français, devinrent les premiers nationalistes algériens. Ce furent eux qui formèrent les troupes de l'Etoile nord-africaine, puis du Parti du peuple algérien (PPA). A leur retour au pays ces travailleurs, conscients d'être politiquement en avance, affirmèrent avec fierté leur nationalisme. Mais bientôt, face aux Algériens arabophones, ils se découvrirent aussi régionalistes » .
C'est alors que la direction du PPA de Messali Hadj, ce nationaliste araboislamique (9), prit conscience d'une possible dérive berbériste et bloqua dès 1945 l'action des militants kabyles. Ceux-ci en vinrent à revendiquer, face au slogan de l'Algérie arabe et musulmane, celui d'une «Algérie algérienne» rassemblant tous les Algériens . Certains tentèrent en vain en 1948 de créer un mouvement populaire berbère. Leur «comité d ' opposition» fut brisé sous l'accusation de « berbéromatérialisme », puis le parti PPA-MTLD et surtout sa Fédération de France furent épurés des «éléments-diviseurs saboteurs berbéristes >> (10). Puis, c'est le silence. « Il faut attendre le Il mars 1954 pour qu'une association pour le développement de la langue berbère, dite Tiwizi tmazi, voie le jour à Paris >> (11). Le combat, interrompu, pour la revendication berbère est réamorcé à partir de la question de la langue qui tiendra en permanence une place centrale. En subordonnant tout à 1 'objectif de 1' indépendance, la guerre de libération sera une trêve qui n'empêche pas <<la berbérité (de) chemine (r) in petto>>, comme l'écrit Ramdane Redjala : « Elle est particulièrement malmenée pendant la guerre de libération. Dans les maquis comme dans les organisations urbaines et dans les camps d'internement, les berbérophones renoncent, au nom du patriotisme, à 1 'usage de leur langue maternelle. Les rivalités et les luttes de factions prennent parfois une tournure dramatique mais à aucun moment la question linguistique et culturelle ne sert de clivage ou de pôle de regroupement. Certains paieront de leur vie cet attachement à la berhérité >> ( 12). Après 1 'indépendance, la revendication berbère continua à cheminer avec des moments forts, la création du FFS (Front des Forces socialistes) en 1963, par exemple. Dans les années qui suivent, la répression contraint toute activité touchant à la revendication berbère à s'expatrier. Ce sera la création de l'Académie berbère en France, le groupe d'études berbères de l'université de Paris VIII , l'apparition d'associations.
Tout ce travail effectué à partir de la France où l'émigration kabyle est dominante en nombre, conjugué au combat clandestin mené sur le terrain par une élite d'étudiants et de lycéens, réussit à provoquer cette prise de conscience qui fera du printemps berbère de 1980 une action de masse et contribuera à inscrire la revendication berbère dans la problématique des libertés démocratiques. Les années 80 connaîtront un véritable boom d'associations en Algérie, dont notamment celles qui composent le mouvement culturel berbère actuel, que malheureusement les circonstances politiques , à partir de 1990, diviseront.
« Durant toute la décennie 1980, 1 'option centrale du "mouvement culturel berbère"(sans majuscules !), a été de construire une "ligne autonome". Autonomie vis-à-vis du Pouvoir et de ses instances idéologiques, mais également autonomie par rapport aux partis d'opposition clandestins, notamment le FFS (Front des Forces socialistes). Sans développer d ' hostilité radicale à l'égard de ce parti (par lequel la grande majorité des militants berbères sont passés et au sein duquel ils ont acquis l'essentiel de leur expérience politique), après 1980, le cordon ombilical avec le FFS
(9) Qui transita par le Parti communiste (note de A. M). (10) Charles-Robert Ageron, << Naissance et reconnaissance kabyles "• Lihération,16 novembre 1994. (Il) Ramdane Redjala : " Le long chemin de la revendication culturelle berbère >>, in Hommes et migration\', n" 1179, septembre 1994. ( 12) Ramdane Redjala : Ibid.
Monde arabe Maghreb Machrek N° 154 oct.-déc. 1996
Etudes
29
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)
Monde arabe Maghreb Machrek
N° 154 oct. -déc. 1996
La question berbère : quand le politique
capture l'identitaire
30
se distend; progressivement, un grand nombre d'acteurs s'éloignent de cette organisation » (13).
Aujourd'hui, si des progrès ont été obtenus, notamment la création de deux départements universitaires d'études berbères à Tizi-Ouzou et Bejaia en 1990, c'est grâce à l'action des partis politiques. Mais le pouvoir continue à refuser la reconnaissance officielle de la langue berbère comme celle des libertés démocratiques. Et si la révision de la Constitution soumise à référendum en novembre 1996 admet la berbérité comme élément de l'identité algérienne de même que l'islam et l'arabité, elle ne satisfait toujours pas la revendication de reconnaissance du berbère comme langue nationale.
( 13) Salem Chaker, op. ci t.
Kamel Yahiaoui
Objets trouvés, objets à usage domestique, Kamel Yahiaoui utilise ces compagnons de notre quotidien, mais les détourne de leur fonction . Devenus paysages, personnages, animaux, ces supports inattendus servent de réceptacle pour exprimer l'univers de l'artiste.
© L
a D
ocum
enta
tion
fran
çais
e | T
éléc
harg
é le
25/
07/2
022
sur
ww
w.c
airn
.info
(IP
: 65.
21.2
29.8
4)©
La Docum
entation française | Téléchargé le 25/07/2022 sur w
ww
.cairn.info (IP: 65.21.229.84)