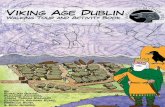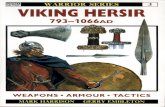Quand la Bretagne était viking
Transcript of Quand la Bretagne était viking
En 1906, est découverte sur l’île de Groix une tombe viking. C’est aujourd’hui encore le principal témoignage archéologique d’une époque, le xe siècle, où la Bretagne faillit devenir une deuxième Normandie. Pendant une vingtaine d’années, de 913 à 936, la Bretagne se retrouve sans ses élites politiques et religieuses, dominée par des Scandinaves en passe de la coloniser.
Tu d i Ke r n a l e g e n n
Quand les archéologues ama-teurs Louis Le Pontois et Paul
du Chatellier commencent, en juin 1906, à fouiller le tumulus du Cruguel sur l’île de Groix, ils s’at-tendent à explorer un “banal” site néolithique. Rapidement toutefois, ils comprennent qu’ils sont en train de découvrir un site bien plus récent, relevant d’un univers culturel inédit en Bretagne : une sépulture en barque viking. Après trois premières journées d’exploration, la fouille est remise à plus tard, le temps entre autres que ces deux pionniers de l’archéo-logie bretonne se renseignent sur une période qui ne leur est pas familière.Ancien officier de marine, Louis Le Pontois (1838-1928) s’est tourné vers l’archéologie à sa sortie du service actif. Chercheur de terrain méticu-leux, il a focalisé ses recherches sur les sites préhistoriques et protohis-toriques de Groix et du pays de Lorient. Collectionneur et érudit, Paul du Chatellier (1833-1911) est, quant à lui, président de la Société archéologique du Finistère. Très inté-gré dans les réseaux scientifiques de son époque, il conserve ses décou-vertes dans le musée de son château
de Kernuz, à Pont-l’Abbé, collec-tions transférées en 1926 au musée des Antiquités nationales, à Saint-Germain-en-Laye. Après quelques lectures et échanges épistolaires, les deux archéologues reviennent sur l’île le mois suivant pour mettre au jour ce qui se révèle être une tombe viking du xe siècle, principale incinération à bateau connue hors du monde scandinave à ce jour, selon la jeune archéologue Liliane Tarrou.
Une affirmation territorialeLe tumulus, érodé par la mer, se trouve à environ 4,50 mètres au-dessus du niveau de la mer et domine la baie sableuse de Port-Maria, seul véritable port naturel de Groix. D’un diamètre estimé à dix-sept mètres – la mer a enlevé une partie du site initial –, le monticule a été élevé de manière experte. Immédiatement au-dessus des restes de l’incinération s’étend un plan de dalles disposées jointivement avec soin. Surmonté d’un amas désordonné de dalles de schiste et de galets de tailles diverses, le tout a été recouvert d’une couche de terre argileuse mêlée de sable et de coquillages.
Page suivanTe Le dreki (dragon)
qui ornait la proue des langskip avait
de quoi effrayer les contemporains. Par
métonymie, il a donné le terme de “drakkar”,
néologisme du xixe siècle.
Quand la Bretagne
12
196_BZH-VIKING_12-19.indd 12 02/08/13 09:50
Qu a n d l a Br e tag n e é ta i t Vi k i n g
Quand la Bretagneétait viking
196_BZH-VIKING_12-19.indd 13 02/08/13 09:50
Ce croquis, par Louis Le Pontois, du site de
la tombe de l’île de groix, rappelle que la
mer a enlevé une partie de l’espace sur lequel
avaient été étendus les restes du bûcher.
Page suivanTeLe mobilier de la
tombe de l’île de groix évoque le quotidien du défunt. ici, un dé parallélépipédique, une bague en or, et une plaque-boucle remarquablement
conservés.
Sur l’espace globalement trapézoï-dal de la sépulture sont disséminés des bouts de charbon et d’ossements incinérés, de même qu’une quantité considérable de rivets de barque et les débris d’un mobilier funéraire remar-quable par sa quantité et sa diversité, mais malheureusement dans un état de dégradation très avancé (1). Les découvreurs supposent que l’on a procédé à l’incinération d’un seul bateau et estiment, en se basant sur le nombre de rivets et de clous trouvés, que celui-ci devait mesurer environ onze mètres de longueur et
2,40 mètres de largeur. L’étude des ossements révèle que deux personnes furent incinérées : un homme adulte et un adolescent ou une femme, pro-bablement un ou une esclave chargés d’accompagner le mort.Comme il est de coutume dans ce style de tombes, de nombreux objets accompagnent le défunt, pour par-ticiper à son voyage vers l’au-delà. Révélant la forte dimension guer-rière du Viking inhumé, l’armement est largement représenté avec deux épées, deux haches, trois ou quatre pointes de lances, de quatre à huit pointes de flèches et entre quinze et vingt et un umbos de boucliers. Le guerrier reposait également avec ses
parures, et notamment une bague en or, et un jeu viking, constitué de deux dés parallélépipédiques en ivoire de morse et d’environ dix-neuf pions plus ou moins hémisphériques en bois de cerf et en ivoire. À l’ins-tar de ce qui se faisait en Norvège, l’outillage occupe une large part du mobilier funéraire, lié à l’agriculture, à la charpenterie, mais aussi et surtout à la forge : enclume, pierre à aiguiser, pince de forge, chaudron, etc. Signe que le chef qu’il était devait, comme le plus humble de ses hommes, être capable de travailler le métal et le bois pour entretenir son bateau et réparer ses armes.Qui était ce chef viking ? Quand a-t-il vécu ? Comment s’est-il retrouvé sur Groix ? Peu de réponses défini-tives ont été apportées à ces ques-tions jusqu’à aujourd’hui. On sait que la sépulture de Groix s’inscrit dans un contexte culturel norvégien et la richesse de la découverte permet de comprendre que le guerrier inhumé était un chef important. Si Liliane Tarrou date la sépulture de la deu-xième moitié du xe siècle, s’appuyant sur le décor d’une épée qui relève-rait de cette période, d’autres cher-cheurs, tel le professeur britannique Neil Price, archéologue spécialiste du monde viking, estiment plus probable que la tombe date de la première moitié du xe siècle. L’inhumation se caractérise par un paganisme militant et archaïque et, surtout, le rituel de la crémation et de l’enterrement semble bien trop élaboré pour un pilleur de passage. Clairement, comme le souligne le regretté Jean-Christophe Cassard, historien spécialiste des Vikings en Bretagne, nous avons affaire à des Scandinaves qui se consi-déraient chez eux. Selon Neil Price, la tombe et le tumulus peuvent même être lus comme une affirmation ter-ritoriale, un acte politique. Il est en effet érigé sur un site stratégique, bien protégé, permettant de contrô-ler l’embouchure du Blavet, et plus largement toute la côte sud de la Bretagne, comme le suggère Kelig-Yann Cotto, conservateur du port-musée de Douarnenez. Cette tombe viking est un témoignage archéolo-gique inestimable sur une période particulièrement sombre et mécon-nue de l’histoire de la Bretagne, où les
(1) Lettre de la société des amis du musée de Groix n° 10, février-mars 2010.
14
196_BZH-VIKING_12-19.indd 14 02/08/13 09:50
Qu a n d l a Br e tag n e é ta i t Vi k i n g
Vikings contrôlaient un pays quitté par ses dirigeants légitimes.
Un siècle de confrontationsDès la fin du viiie siècle, il faut ima-giner des côtes bretonnes infestées de pirates normands en maraude. Ceux-ci sont en effet attestés à Noirmoutier en 799. Si une attaque en Bretagne est mentionnée dès 837, la date qui marque tous les esprits est celle du 24 juin 843, jour de la Saint-Jean-Baptiste, qui glaça d’effroi toute la chrétienté. Ce jour-là, une flotte de Vikings norvégiens remonte la Loire et s’empare par surprise de Nantes, toute à ses célébrations reli-gieuses. L’évêque Gunhard est immo-lé sur l’autel de sa cathédrale. La cité est pillée de fond en comble, ses habitants massacrés ou capturés pour être vendus comme esclaves. C’est le début d’un siècle entier de confrontations entre les Bretons et les Scandinaves, qui laisseront la pénin-sule exsangue (2).En 847, les Annales de Saint-Bertin évoquent trois batailles remportées par les “Danois” sur Nominoë, qui se voit contraint d’acheter au prix fort leur départ. En 853, les Vikings s’em-parent une seconde fois de Nantes et se retranchent cette fois-ci sur l’île de Bièce, juste en face de Nantes. Ils n’en repartiront quasiment plus pendant trois quarts de siècle, organisant sur l’îlot ligérien un camp fortifié dou-blé d’un marché permanent où ils écoulent le produit de leurs pillages. En 869, le roi Salomon achète le départ d’une armée scandinave ins-tallée sur les bords de la Vilaine et parvient à instaurer un fragile équi-libre entre Bretons, Vikings et Francs, jusqu’à son assassinat en 874. Dans la guerre civile qui oppose presque aus-sitôt ses meurtriers, Pascweten, comte de Vannes et gendre de Salomon, fait appel fort imprudemment à des mer-cenaires vikings, qui ne lui apportent pas la victoire (il meurt en 876), mais en profitent pour mettre le pays à feu et à sang, au point qu’en 889, les envahisseurs contrôlent la Bretagne jusqu’au Blavet. Face à la menace, les Bretons se réconcilient enfin et défont
les Scandinaves. L’avènement du roi Alain le Grand, frère de Pascweten, en 890, permet l’effacement provi-soire de la menace viking pendant une vingtaine d’années.
Effondrementd’un royaumeLa mort d’Alain le Grand, en 907, constitue toutefois le début d’une nouvelle période de turbulences, fatales cette fois, pour la Bretagne. Les raisons sont tout d’abord internes, marquées par une dislocation pro-gressive du royaume de Bretagne. Si le comte de Cornouaille Gourmaëlon semble succéder à Alain le Grand, étant décrit comme régnant sur la Bretagne, il n’est pas reconnu comme roi, pas plus que les fils survivants du dernier roi. Les raisons sont aussi externes. Avec le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui voit Charles iii concéder une partie de la Neustrie autour de Rouen au chef scandinave Rollon (Hrólfr) – c’est le noyau de la future Normandie –, un pouvoir viking stable et légitime s’installe à l’embouchure de la Seine. Comme le suggère Neil Price, les plus agres-sifs et ambitieux des Vikings de la Seine, des mercenaires et aventu-riers qui n’avaient aucune envie de s’établir et de cultiver la terre, font scission et se dirigent vers la Loire, concentrant désormais leurs attaques sur la Bretagne. Plus largement, la Bretagne apparaît comme une des-tination finale pour les raiders et pillards scandinaves, territoire naturel d’expansion, quand tout le reste de l’Europe du Nord-Ouest est déjà soit sous le joug viking, soit bien protégé par des princes puissants. Bien que les attaques continuent en Angleterre ou en Francie, il n’y a qu’en Bretagne qu’on voit une activité normande de pillage sur une aussi grande échelle au xe siècle, assure Neil Price.L’année 913 marque la rupture. La mort de Gourmaëlon initie une période de vingt-trois années sans pouvoir politique breton unifié en Bretagne. Avec l’attaque de l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec – probablement la plus importante fondation monastique de Bretagne occidentale –, c’est le pouvoir spiri-tuel breton qui est ébranlé au plus profond. Alors qu’il était protégé par
(2) Sur les premières décennies de cette confronta-tion, lire : Jean-Christophe CASSARD, “Premiers Vikings en Bretagne”, ArMen n° 128, mai-juin 2002.
196_BZH-VIKING_12-19.indd 15 02/08/13 09:51
des fossés, talus et palissades autour de l’enclos, et même un rempart massif du côté de la mer, les fouilles attestent une destruction quasi sys-tématique du monastère, comme le mettent en évidence les travaux des archéologues Annie Bardel et Ronan Pérennec.
Départ des élitesDe 914 à 917, les chefs vikings Ohter (vraisemblablement Óttarr) et Hroald (Hróaldr), auteurs pro-bables du pillage de Landévennec d’après l’universitaire Jean Renaud, reviennent piller la Bretagne en raids dévastateurs, sans rencontrer, semble-t-il, la moindre résistance. En 919, Ragenold (Rögnvaldr) porte le coup de grâce à l’ancien royaume en lançant une attaque massive sur la péninsule et en s’installant à Nantes, d’où il semble contrôler la Bretagne entière. Comme le souligne Jean-Christophe Cassard, dans tous les secteurs géographiques, la résistance bretonne s’effondre en ces années tragiques. Rien en réalité n’autorise même à parler de résistance : aucun nom de chef de guerre n’est avancé, aucune déroute des armées bretonnes n’est signalée nulle part. Le chro-niqueur Flodoard constate alors : “Les Normands ravagent, écrasent et ruinent toute la Bretagne située à
l’extrémité de la Gaule, celle qui est en bordure de mer, les Bretons étant enlevés, vendus et autrement chassés en masse.”L’invasion de Rögnvaldr marque le signe du départ des élites restées au pays. En effet, depuis 913, les ecclé-siastiques et les aristocrates avaient commencé à quitter massivement la Bretagne pour se rendre en Francie ou en Angleterre. C’est le cas de Mathuedoi, comte de Poher et gendre d’Alain le Grand, qui se rend à la cour d’Édouard l’Ancien. Il est accompa-gné de son fils, Alain, futur duc de Bretagne, et filleul d’Æthelstan, fils et successeur d’Édouard l’Ancien en 924.L’exode des religieux est relativement bien connu grâce aux travaux, notam-ment, de l’historien Hubert Guillotel. Ainsi, on sait que les moines de Landévennec, après un passage par Château-du-Loir, se replient sur Montreuil-sur-Mer. Les moines de Locminé et de Saint-Gildas se rendent à Issoudun via Déols. Le périple des moines de Redon est plus compliqué encore, passant par Angers, Candé-sur-Beauvron et Auxerre, avant de finir à Poitiers. Les moines emportent avec eux reliques et manuscrits, au point qu’il ne reste en Bretagne aujourd’hui aucun des textes composés dans les actifs scripto-
ria monastiques bretons avant l’arri-vée des Vikings.En certains endroits, tout parti-culièrement dans le pays nantais, l’émigration semble même mas-sive. L’historien Joël Cornette nous apprend qu’un diagramme pollinique établi sur le site du Carnet, à trente-cinq kilomètres à l’ouest de Nantes, montre de façon saisissante la dés-hérence de tout un terroir. Pendant près d’un siècle, l’effondrement des productions céréalières traduit l’aban-don du site : les plantes rudérales (oseille, plantain) qui progressent révèlent un retour de la lande et des espaces incultes. Il faudra attendre le xie siècle pour un retour “à la nor-male”. Des études similaires dans la basse vallée de l’Erdre, au nord de Nantes, démontrent qu’elle fut, elle aussi, complètement désertée pen-dant quelques décennies.Il ne faut pas pour autant imaginer une Bretagne vidée complètement de ses habitants. La Chronique de Nantes, rédigée au siècle suivant, souligne que “seuls les pauvres bretons cultivant la terre restèrent sous la domination des barbares, sans guide et sans soutien”. On sait également que le comte de Rennes, Bérenger, se maintient tout au long de la période grâce à une habile politique de bascule entre les Francs – il prête serment de fidélité au roi des Francs Robert Ier en 922 ou 923 – et les Normands – auxquels sa famille est apparentée par des liens matrimoniaux.
Un début de colonisationAprès avoir assiégé Nantes sans suc-cès pendant cinq mois, Robert, le marquis de Neustrie, qui devient roi des Francs l’année suivante, concède à Rögnvaldr “la Bretagne qu’ils avaient dévastée avec le pays de Nantes” selon Flodoard, qui ajoute que les Vikings “commencèrent à recevoir la foi du Christ”. Le parallélisme avec l’instal-lation de Hrólfr à Rouen dix années auparavant est frappant, comme le souligne Jean Renaud. Il ne fait pas de doute qu’à partir de 921 existe une principauté scandinave en Bretagne reconnue par les Francs.Les années 920 se caractérisent donc par un début de colonisation de la Bretagne. Toutefois, contrairement
Page suivanTeCette épée aux décors
typiques des ateliers scandinaves a été draguée
près de l’île de Bièce dans les années 1930,
témoignage de près d’un siècle de présence viking
à nantes.
De nombreux umbos ont été découverts
dans la sépulture viking de groix. L’umbo est
la protubérance, le plus souvent décorée,
de la partie centrale d’un bouclier, visant
à protéger la main du défenseur et à dévier les
coups.
16
196_BZH-VIKING_12-19.indd 16 02/08/13 09:51
Qu a n d l a Br e tag n e é ta i t Vi k i n g
aux Vikings de la Seine, qui se coulent dans le moule franc et se mettent à organiser administrativement et éco-nomiquement leur territoire, ceux de la Loire s’en tiennent à une présence essentiellement militaire. Ils utilisent le pays, sans essayer de l’organiser. Les villes semblent avoir été délais-sées, sans volonté de développer le commerce, contrairement à ce que firent les Scandinaves dans d’autres colonies.L’explication vient probablement de l’origine des Vikings en Bretagne, dont on sait qu’elle fut essentiellement norvégienne. Or, pour l’historien Lucien Musset, la colonisation nor-végienne était essentiellement indi-viduelle, ou du moins familiale. Elle ne donna naissance à aucune entité politique, à la différence des Danois qui se distinguaient par le caractère organisé, collectif et militaire de leurs entreprises. Les Norvégiens opéraient par petits groupes, se livrant soit au pillage pur et simple, soit à la recherche de terres de colonisation où ils pourraient mener leur vie semi-pastorale. Les établissements qui en résultaient étaient de petites princi-pautés militaires soudées par un com-pagnonnage juré autour d’un chef.Dès lors, outre Nantes, plusieurs autres petites principautés scandinaves sont attestées en Bretagne, comme en Cornouaille, ou probables, comme dans le Penthièvre. Jean-Christophe Cassard mentionne ainsi de nom-breux camps vikings probables sur la côte nord de la Bretagne : Saint-Malo (où les assises de la tour Solidor révèlent leur présence), Saint-Servan, Saint-Suliac, Trans (camp du Vieux M’na) et surtout le camp de Péran à Plédran. Sur ce dernier site, qui dominait stratégiquement la baie d’Yffiniac, les fouilles de l’archéo-logue Jean-Pierre Nicolardot ont mis en évidence de nombreux outils et objets domestiques se rattachant à des types scandinaves – dont une mar-mite similaire à celle trouvée dans la tombe viking de l’île de Groix –, mais aussi des armes et un denier viking frappé à York au début du xe siècle.Certains indices témoignent mal-gré tout d’un début de colonisation agricole. Des analyses des pollens fossiles ont révélé la présence sur les sites du Teilleul (Ille-et-Vilaine) et
de Péran (Côtes-d’Armor) d’Avena strigosa, une avoine des terres pauvres, inconnue par ailleurs en Bretagne, mais répandue en Scandinavie. Des éléments toponymiques vont dans le même sens, à l’instar du lieu-dit Bolast à Rosnoën, au bord de la rivière du Faou, face à l’abbaye de Landévennec, qui pourrait venir du norrois Bólstaðr, “la ferme”, selon l’hypothèse de Joëlle Quaghebeur. Cet élément fut omniprésent dans les colonies vikings norvégiennes, en Écosse et en Islande notamment.
Première rébellion bretonneLoin de se contenter du traité de 921 et d’organiser le territoire qui lui avait été concédé par le pou-voir franc, Rögnvaldr continue ses attaques contre ces mêmes Francs, Nantes lui servant de base arrière. Attaquant l’Aquitaine et l’Auvergne en 923, il remonte la Loire en 924 pour piller la Bourgogne. Il s’attire un nouveau siège de Nantes en 927 diri-gé par Hugues le Grand et Herbert de Vermandois, les deux hommes forts du royaume franc. Mais c’est un nouvel échec. La cession de Nantes aux Vikings est confirmée – sans mention du reste de la Bretagne cette fois-ci toutefois – en échange de la fin de leurs raids. Ce qui n’empêche par les Scandinaves, encore une fois, de rompre le traité et d’attaquer l’Aqui-taine et le Limousin en 930. Cette fois, cependant, ils se voient infliger une sévère défaite sur la Dordogne par le roi franc Raoul.Le 29 septembre 931, lors de la fête de Saint-Michel – il s’agissait proba-blement, suggère Joëlle Quaghebeur, de s’adjoindre symboliquement l’aide de l’archange pour triompher d’une puissance païenne et perçue comme diabolique –, une première rébellion bretonne, dirigée par le jeune Alain Barbetorte et le comte de Rennes Bérenger, confirme que le vent com-mence à tourner. En Cornouaille, les Bretons massacrent les occupants scandinaves, à commencer par leur chef, le duc Félécan. Seul Viking qualifié de dux dans les annales de l’époque, sa mort n’est pas anecdo-tique. Il paraissait jouir en Bretagne d’un pouvoir avéré, bénéficiant d’une reconnaissance extérieure, voire
196_BZH-VIKING_12-19.indd 17 02/08/13 09:51
considérée comme légitime, ce qui avait de quoi inquiéter les deux pré-tendants bretons connus au trône de Bretagne. Son titre, insiste Joëlle Quaghebeur, semble sanctionner une installation définitive et recon-nue de populations scandinaves en Bretagne. En outre, son nom, clai-rement d’origine celtique, témoigne d’unions matrimoniales et de fusions ethniques ou culturelles jugées suffi-samment inquiétantes par Bérenger et Alain pour qu’ils réagissent et ne laissent pas s’installer un pouvoir qualifié, et donc compris, par les Francs de façon identique au leur. L’effet de surprise passé, les Vikings de Nantes, commandés par Incon (vraisemblablement Håkon ou Inge),
le successeur de Rögnvaldr, lancent une grande opération de représailles sur la Bretagne, avec l’aide du duc des Normands de la Seine Guillaume Longue-Épée, contraignant Alain à un nouvel exil. Incon contrôle alors la majeure partie de la Bretagne, Guillaume Longue-Épée s’emparant du Cotentin et de l’Avranchin, terres bretonnes depuis 867. Ce dernier n’hésite d’ailleurs pas à se proclamer duc des Bretons, comme en atteste un denier trouvé au Mont-Saint-Michel.
Le retour d’Alain BarbetorteLa structure géopolitique de l’Europe occidentale est pourtant en train de changer très rapidement, créant
une situation permettant le retour d’Alain Barbetorte. Tout d’abord, les Vikings de Bretagne sont de plus en plus isolés et affaiblis. En 935, alors qu’ils ravagent le Berry, les Vikings sont “anéantis” par une alliance des Berrichons et des Tourangeaux, à en croire Flodoard. Cette nouvelle défaite sape un peu plus leur puis-sance militaire. La même année, Guillaume Longue-Épée fait alliance avec Hugues le Grand, où il s’engage notamment à ne plus intervenir pour aider les Vikings de Bretagne. Ces derniers se trouvent dès lors complè-tement isolés diplomatiquement.Les Bretons sont aussi actifs pour préparer leur retour. L’abbé Jean de Landévennec traverse la Manche sans
Carte extraite de l’Atlas de Bretagne de
Mikael Bodlore-Penlaez et Divi Kervella, paru
aux éditions Coop Breizh, en 2011.
18
196_BZH-VIKING_12-19.indd 18 02/08/13 09:51
Qu a n d l a Br e tag n e é ta i t Vi k i n g
relâche pour préparer diplomatique-ment le retour d’Alain Barbetorte, négociant aussi bien avec les Saxons d’Æthelstan, les Francs d’Hugues le Grand ou encore les Normands de Guillaume Longue-Épée et même les Vikings installés en Bretagne. D’intenses tractations se déroulent alors, nous explique Jean-Christophe Cassard, qui dépassent, et de loin, le cas breton. Elles visent avant tout au retour en Francie de Louis iv d’Ou-tremer, fils du roi Charles iii, exilé comme Alain à la cour d’Æthelstan.La mort du roi Raoul le 15 janvier 936 est l’opportunité nécessaire. Le 19 juin, Louis iv est sacré à Laon. Puis c’est au tour d’Alain de rentrer reconquérir son trône, avec l’aide de quelques troupes données par le roi anglais, et face à des Vikings affaiblis par une succession de défaites sur la Loire et abandonnés à leur sort par les autres Scandinaves. Son itinéraire nous est connu grâce à la Chronique de Nantes. Débarquant à Dol, où il massacre les Vikings, il gagne ensuite Saint-Brieuc par la mer, où il sur-prend et anéantit une seconde armée, peut-être retranchée dans le camp de Péran. L’année suivante, il traverse toute la Bretagne en direction du pays de Nantes. Alain attaque les Vikings retranchés dans un camp au pré Saint-Aignan. Prenant le camp d’assaut, il force les derniers Vikings nantais à regagner leurs navires et à fuir. Alain fait aussitôt de Nantes sa capitale et en organise la défense. Les combats continuent néanmoins jusqu’en 939. Réunissant leurs forces, les Bretons d’Alain et de Bérenger et les Francs d’Hugues le Grand défont les Vikings à Trans – il a été sug-géré qu’ils y étaient retranchés dans le camp du Vieux M’Na –, mettant un point final à l’invasion viking de la Bretagne, même si quelques attaques scandinaves eurent encore lieu jusqu’en 1014.Ainsi, loin de la vision roman-tique imaginée par Arthur de la Borderie au xixe siècle, le retour d’Alain Barbetorte est avant tout la conséquence de tractations diplo-matiques complexes. Alain ne put revenir qu’avec l’accord de ses pairs. Guillaume Longue-Épée et Hugues le Grand n’avaient toutefois aucune envie de voir le nouveau maître de la
Bretagne avec un titre supérieur au leur. Alain Barbetorte doit donc se contenter du titre de duc.
Une coupure irrémédiableAu final, que reste-t-il de ces près de vingt-cinq années sans dirigeant bre-ton en Bretagne ? Quelles furent les conséquences de cette invasion viking dans la péninsule ? Globalement, il n’y a rien dans l’organisation sociale et économique de la Bretagne posté-rieure à 939 qui soit dû aux Vikings. Cela ne veut nullement dire que les années 913-936 furent une paren-thèse sans conséquences.S’ils n’organisèrent pas politiquement la Bretagne, les Vikings eurent le temps de s’installer. Plusieurs noms de lieux d’origine scandinave per-durent en Bretagne, tout particuliè-rement sur le littoral. Mentionnons les Étocs, au large de Penmarc’h (de stakkr, “rocher en mer”) ou les Escarets en baie de Saint-Brieuc (de sker, “récif”). On peut toute-fois regretter que, contrairement à la Normandie, aucune étude de micro-toponymie systématique n’ait jusqu’à présent été menée en Bretagne pour mieux appréhender l’implantation territoriale viking. Les rares élé-ments que nous avons permettent à Jean-Christophe Cassard de suggé-rer que l’implantation normande a probablement été plus importante en Bretagne qu’en Normandie. Dès lors, il est inenvisageable que tous les Scandinaves aient été tués ou aient pris la fuite lors du retour d’Alain Barbetorte. Nombre d’entre eux ont dû s’intégrer et reconnaître le nou-veau prince.À tous points de vue, l’intermède viking fut une coupure irrémédiable dans l’histoire de la Bretagne. Si les principales communautés ecclésias-tiques reprennent aussi vite qu’elles le peuvent le chemin de la péninsule, elles reviennent les mains vides, et notamment sans leurs manuscrits. La mémoire de la Bretagne est anéantie. Globalement, l’histoire de ses pre-miers siècles d’existence ne peut plus s’écrire, pour ainsi dire, qu’à partir des écrits des chroniqueurs gallo-romains et francs, c’est-à-dire des adversaires des Bretons, de Grégoire de Tours à Ermold le Noir.
La rupture est aussi géographique, selon Jean-Christophe Cassard. À cause des Vikings, les Bretons perdent l’habitude de gagner couramment le pays de Galles et la Cornouailles (et inversement). La mer intérieure bre-tonne disparaît. Les contacts entre les peuples brittoniques des deux côtés de la Manche se distendent. Les lan-gues commencent progressivement à s’éloigner.La rupture est enfin économique, si l’on en croit le même auteur. Les paysans libres, qui constituaient la base sociale du royaume de Nominoë ou de Salomon, affrontent des diffi-cultés économiques insurmontables et doivent engager leurs terres. Ils se trouvent ainsi peu à peu relégués par leur endettement croissant au statut de serf dépendant d’un propriétaire foncier. Ruinée, dépourvue de ses richesses culturelles et de son patri-moine spirituel, la Bretagne libérée a perdu le dynamisme qui caractérisait le royaume de Nominoë et de ses successeurs. n
Bibliographie• “Les Vikings en France”, Dossiers d’archéologie n° 277, octobre 2002.• Jean-Christophe Cassard, Le siècle des Vikings en Bretagne, éditions Gisserot, 1996.• Neil Price, The Vikings in Brittany, Viking Society for Northern Research, 1989.
Expositions• La tombe viking de groix,Port-musée, Douarnenez, jusqu’au 23 septembre. Tél. : 02 98 92 65 20. www.port-musee.org.• La Bretagne, les vikings et la bande dessinée : mythes et réalités, ancienne abbaye de Landévennec, jusqu’au 15 septembre.Tél. : 02 98 27 35 90.www.musee-abbaye-landevennec.fr
Colloque• Landévennec, les vikings et la Bretagne, colloque organisé par l’ubo et le crbc en hommage à Jean-Christophe Cassard, le 27 septembre, auditorium de l’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec (nouvelle abbaye).
196_BZH-VIKING_12-19.indd 19 02/08/13 09:51