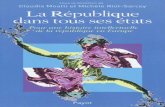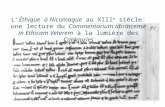La production de poterie à Paris au Moyen Age (XIIIe-XVIe s.) à travers les sources écrites
Transcript of La production de poterie à Paris au Moyen Age (XIIIe-XVIe s.) à travers les sources écrites
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, Publications du CRAHM, 2011, p. 107-121
Résumé : Dans les sources écrites, les témoignages de l’artisanat de la poterie de terre à Paris deviennent nombreux à partirdu XVIe siècle grâce aux sources notariales. Pour les périodes antérieures, il faut se contenter des règlements du métier rédigésdans la deuxième moitié du XIIIe siècle et régulièrement « actualisés » au cours des siècles suivants, ainsi que de rares mentionsdans les sources judiciaires. L’examen de ces sources écrites apporte un éclairage complémentaire à la découverte exception-nelle du four de potier de la petite rue du Grenier-sur-l’Eau, l’actuelle allée des Justes-de-France. Son installation en pleincœur de la ville, dans un tissu urbain dense, correspond parfaitement aux descriptions d’ateliers de potiers parisiens que nousont laissées certains inventaires après décès du XVIe siècle. Les riches données qui figurent dans ces sources permettent demieux comprendre son fonctionnement. Les prisées qui ont été faites dans les différentes pièces permettent de comprendreaussi son organisation spatiale. Enfin, la description des marchandises complète le catalogue des céramiques qui ont étéretrouvées dans le four et nous restitue l’image de ce que devait être sa production.
Mots-clés : atelier de potier, four, sources écrites, céramique parisienne, carreau de pavement, céramique du Beauvaisis, MoyenÂge, XVIe siècle.
Abstract: Production of earthenware in Paris during the 13th to 16th centuries through the written sources. In the written sources,the evidence for earthenware potters in Paris increases from the 16th century based on the notarial records. For the previous period,one has to settle for the working regulations in the second half of the 13th century and regularly reinforced in the following centuries,along with rare mentions in the judicial records. The examination of the written sources sheds light on the remarkable discoveryof a potter’s kiln in the little Grenier-sur-l’Eau street, now the alley Justes-de-France. Its construction right in the centre of the town,in a particularly built-up urban area corresponds exactly with the descriptions of the potters’ workshops given in some 16th centurywills and inventories. The expensive gifts that appear in these sources allow us to better understand their purpose. The valuationsmade on the different items also allow for their spatial organisation. Finally the description of the merchandise completes thecatalogue of ceramics recovered from the kiln and reveals to us what would have been produced there.
Keywords: pottery workshops, kiln, written sources, parisian pottery, tile floor, beauvais pottery, Middle Ages, 16th century.
* INRAPCentre Île-de-France, CRAHAM-UMR 6273 (UCBN/CNRS). Remerciements à Rebecca Peake, Patrick Pihuit et NicolasThomas.
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS AU MOYEN ÂGE (XIIIe-XVIe SIÈCLE)À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES
Fabienne RAVOIRE*
Introduction
Historiquement, le quartier de Grève – dans lequel étaitimplanté l’atelier de potier de la rue du Grenier-sur-l’Eau1 – et plus largement le secteur situé autour des halles,compris entre l’enceinte de Philippe Auguste au nord etla Seine au sud, est celui où étaient installés les potiers deterre au Moyen Âge. Au XVIe siècle, comme le prouvecette découverte archéologique, ils sont encore là, dissé-minés en leur «hostel », même si la plupart sont installésen périphérie sud de la ville, sur la rive gauche, dans lesfaubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, tout près desvillages d’Arcueil et de Gentilly (Val-de-Marne) où étaitextraite l’argile. La confrontation des données historiquesavec les données archéologiques2 constitue le propos de cetarticle ; elle permet de mieux rendre compte de la spéci-ficité de cette activité en milieu urbain à la fin du MoyenÂge.
1. Les potiers de terre à Paris3
Au Moyen Âge, dès le XIIIe siècle au moins, d’après le statutdu métier4, mais très certainement plus tôt, des potierssont installés dans Paris intra-muros (fig. 1) et dans lesfaubourgs de la ville5. Au XVIe siècle, quelques actes notariés
et d’autres sources indirectes comme les insinuations duChâtelet témoignent de leur présence dans les faubourgsSaint-Victor et surtout Saint-Marcel6, situés près desvillages de Gentilly et d’Arcueil, mais également plus àl’ouest, dans les faubourgs de Notre-Dame-des-Champs7et de Saint-Germain-des-Prés8. Ces secteurs correspondentégalement à des lieux de travail privilégiés, des enclosseigneuriaux qui permettent aux artisans de ne pasdépendre des jurés parisiens. L’étude menée par StefanGouzouguec sur les tuiliers parisiens à la fin du Moyen Âgemontre que ces derniers étaient également implantés endehors de l’enceinte de la ville, sur la rive gauche de laSeine, dans le bourg de Saint-Germain-des-Prés ainsi quedans la châtellenie voisine de Vaugirard, et sur la rivedroite, dans le faubourg Saint-Honoré9.
La situation du four du XVIe siècle de la rue du Grenier-sur-l’Eau dans le centre de Paris, dans l’ancien quartier deGrève, s’explique par l’étude des témoignages relatifs àcette activité dans le secteur10. En effet, un récent travailportant sur l’organisation spatiale de cet artisanat sur larive droite de la Seine11 met en évidence, au travers dessources écrites et archéologiques, la présence de nombreuxpotiers de terre à cet endroit dès le bas Moyen Âge. Cesderniers sont installés autour de lieux bien spécifiques, lemarché des Halles, qui était le lieu de vente réglementaire,la chapelle Saint-Bon12, autour du cimetière Saint-Jean et
FABIENNE RAVOIRE108
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
1. X. Peixoto et F. Ravoire, dans ce volume.2. Ibid.3. Les recherches sur l’artisanat de la poterie de terre parisienne au
Moyen Âge remontent aux travaux de J. Nicourt (NICOURT 1974,1986). Quelques années plus tard, E. Beaufils, dans le cadre des fouillesde la cour Napoléon du Louvre, a poursuivi ce travail en dépouillantnotamment plusieurs inventaires après décès de potiers (BEAUFILS
1985 ; 1998). À la même période, à l’occasion d’un mémoire sur lescéramiques modernes des collections du musée Carnavalet, Y. Cagneuxtravaille également sur le sujet (CAGNEUX 1985). En 1997, dans unethèse de doctorat de l’université de Paris I, nous avons poursuivi cetterecherche, en utilisant notamment les dépouillements d’actes notariésréalisés (voir RAVOIRE 1997, vol. 3 ; 2000, 2008, 2009). Citonségalement C. Brut, qui s’est aussi intéressée aux artisans de la terre cuiteà Paris (BRUT 1997, 2004), B. Dufaÿ (DUFAŸ 1998) et S. Gouzouguecaux tuiliers (GOUZOUGUEC 2009), R. Plinval de Guillebon aux faïen-ciers et porcelainiers (PLINVAL DE GUILLEBON 2002). Très récemmentN. Thomas a étudié une production spécifique, celle des creusetsutilisés pour le travail de fonderie des composés métalliques auXIVe siècle (THOMAS 2009).
4. Le métier de potier de terre à Paris était « juré », c’est-à-dire qu’ilétait hiérarchisé avec un maître et des apprentis. L’accès à la professionétait donc réglementé. L’organisation du métier n’est pas abordée danscet article. Voir BEAUFILS 1998 et RAVOIRE 1997.
5. LESPINASSE et BONNARDOT 1879. Récemment, des rejets deproduction potière du haut Moyen Âge ont été retrouvés au pied de la
tour Saint-Jacques sur la rive droite (étude en cours par C. Brut, villede Paris), et d’autres de la deuxième moitié du XIIIe siècle sur la rivegauche dans des remblais de nivellement du collège des Bernardins,situés à proximité de Saint-Marcel.
6. C’est ce qui ressort des quelques mentions publiées par ErnestCoyecque (COYECQUE 1905) : « les poteries, lieu-dit à Saint-Marcel »(1543), clos des Poteries à Saint-Marcel (1551), rue des poteries àSaint-Marcel ; « les poteries, au terroir de Sainte-Geneviève», « cheminde la porte-Saint-Jacques aux Poteries ». Les sources archéologiquesattestent également de leur présence en ces lieux. Anciennement sur larive gauche, deux tessonnières datées des XVIe et XVIIe siècles furentégalement identifiées, aux angles de la rue d’Ulm et de la rue Lhomond.
7. COYECQUE 1905, «les poteries, lieu-dit à Notre-Dame-des-Champs»(1548), «la poterie, lieu-dit à Notre-Dame-des-Champs» (1542).
8. Par exemple, en 1583, Jehan Perigon, marchand potier de terredemeure (et travaille à son atelier) à Saint-Germain-des-Prés, « en lagrant rue dudit lieu ». AN, Minutier central CXXII-1491, 5 fol.
9. GOUZOUGUEC 2006, p. 215-216 ; DUFAŸ 1998.10. Voir figures.11. Un travail sur la cartographie de l’activité de la poterie de terre
sur la rive droite de la Seine entre le XIIIe et le XVIIe siècle a été réalisépar F. Ravoire dans le cadre du PCR «Cartographie de l’espace parisien(2006-2008)» dirigé par C. Besson et D. Derrieux (voir RAVOIRE 2010).
12. Cette chapelle, aujourd’hui disparue, était celle de la confrérie.Aujourd’hui ne subsiste que la rue Saint-Bon (IVe arr.) dans laquelle ellese trouvait. Ibid.
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 109
Publications du CRAHM, 2011
Enceinte de Charles VEnceinte de Philippe-Auguste
la Seine
rue Saint-Denis
rue de la Poterie(XIIIe s.)
rue Saint-Martin
rue des Arcis
rue Beaubourgmarché des Halles
censive du Temple
potiers de terretessonière du haut Moyen ÂgeXIIIe
XIVe
XVe
Enceinte de Charles VEnceinte de Philippe-Auguste
la Seine
rue Saint-Denis
rue Saint-Martin
rue Trousse-Nonains(act. rue Beaubourg)
marché des Halles
chapelle Saint-Bon
potiers de terre1re moitié XVIe
2nde moitié XVIe
1re moitié XVIIe
chapelle Saint-Bon
rue de la Poterie(XVIe s.)
Enceinte de Charles VEnceinte de Philippe-Auguste
la Seinerue Saint-Denis
rue de la Poterie(XIIIe s.)
rue Saint-Martin
rue des Arcis
rue Beaubourgmarché des Halles
censive du Temple
potiers de terretessonière du haut Moyen ÂgeXIIIe
XIVe
XVe
Enceinte de Charles VEnceinte de Philippe-Auguste
la Seine
rue Saint-Denis
rue Saint-Martin
rue Trousse-Nonains(act. rue Beaubourg)
marché des Halles
chapelle Saint-Bon
potiers de terre1re moitié XVIe
2nde moitié XVIe
1re moitié XVIIe
chapelle Saint-Bon
rue de la Poterie(XVIe s.)
Fig. 1 : Localisation de l’artisanat de la poterie de terre sur la rive droite de la Seine au Moyen Âge (à partir des sources écrites et archéologiques). Carte F. Ravoire. DAO P. Pihuit (INRAP).
Fig. 2 : Localisation de l’artisanat de la poterie de terre sur la rive droite de la Seine aux XVIe et XVIIe siècles (à partir des sources écrites et archéologiques). Carte F. Ravoire. DAO P. Pihuit (INRAP).
le long ou avoisinant les principaux axes de circulationsouest-est (rue de la Tixeranderie, rue de la verrerie et rueSaint-Paul) et nord-sud (rue Saint-Martin, rue Saint-Denis, rue Beaubourg) (fig. 1). La microtoponymie gardela trace de leur activité sur la rive droite de la Seine avecune rue de la Poterie (ancienne rue de la Poterie des Arcismentionné en 1272 dans les archives de Saint-Martin-des-Champs), située derrière l’église Saint-Merri dans lequartier Saint-Paul au Moyen Âge, puis une seconde ruesituée au sud des halles (« rue de la poterie des Halles »)achevée en 155613. À cette période, l’implantation despotiers marque une extension vers l’ouest (quartiers Saint-Paul et Saint-Antoine) et vers le nord (quartiersSaint-Sauveur, Saint-Eustache) et tend à sortir des limitesde l’enceinte de la ville (fig. 2), ce qui sera le cas auXVIIe siècle.
La petite rue du Grenier-sur-l’Eau14, située à proximitéde la place de Grève et des bords de Seine, permettait aupotier un approvisionnement aisé en eau et en bois. C’estnon loin de là que se situait la rue de la Savonnerie où setrouvait la maison du potier Gosselin et également la ruede la Tixeranderie où fut retrouvé en 1854 un four depotier et enfin le cimetière Saint-Jean, autour duquelplusieurs potiers semblent résider aux XVe et XVIe siècles15.Un peu plus à l’est, dans le quartier Saint-Paul, unecinquantaine de tessons médiévaux «qui présentent tousles caractères de rebuts de cuisson» furent trouvés dans lesdéblais d’une canalisation16.
L’abandon du four est daté du milieu du XVIe siècle.On peut s’étonner de sa présence en cœur de ville àcette époque. En effet, dès la fin du Moyen Âge, enraison des dangers d’incendie et des problèmes depuanteur, la présence de cette activité en ville suscite desplaintes de la part des riverains. Une sentence duChâtelet, en date du 4 novembre 1486, relate le procèsfait par le procureur du roi et celui de la ville de Parisà l’encontre d’un potier de terre, Celin Gosselin,demeurant « en ung hotel rue de la Savonnerie » « oupendoit pour enseigne les Ratz » qui est accusé de gêneret d’empoisonner ses voisins par les fumées et les odeursqui émanent de son activité qui « … bonnement ne
povaient faire residence en leurs maisons… ». Desdocteurs en médecine et en chirurgie sont entenduspour savoir s’il y a un vrai risque d’empoisonnementdans le voisinage17. Malgré la défense du potier, lasentence tombe. Il ne peut plus cuire dans Paris mais ille peut dans d’autres lieux :
… deffenses seront factes audict Gosselon de necuire doresnavant potz [fol. 141r] de terre surpeyne de vingt livres parisis d’amende et neant-moins se iceluy Gosselin veult cuire desditz potzet autres choses en ceste ville de Paris en autreslieux destournez, faire le pourra jusques ad ceque par justices autrement en soit ordonné etsans despens de ceste presente poursuitte d’unepart et d’autre, ou pour causes par nostresentence, jugement et par droit18.
À l’occasion d’une plainte contre Guillaume Laurens,maître potier, demeurant près du cimetière Saint-Jean19 etdonc tout près de la rue du Grenier-sur-l’Eau, un arrêtdu Parlement en date du 7 septembre 1497 interdit
FABIENNE RAVOIRE110
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
13. RAVOIRE 2010. Au XVIIe siècle, des boutiques de potiers y sontétablies.
14. Des recherches en archives menées par Olivier Bauchet (INRAP)n’ont pas permis de retrouver le potier qui occupait l’atelier. En revanche,d’autres inventaires de potiers du quartier ont été retrouvés et nousremercions Olivier Bauchet de nous les avoir transmis.
15. RAVOIRE 2008, p. 83 et ss.16. NICOURT 1986, p. 61, notes 66 et 67.
17. BNF, ms. 21808 (collection Nicolas de La Mare sur la policede Paris) […], [fol. 134r], Livre neuf vert fol. IIIIxx XVIIr, Touchantles potiers de terre. « (...) pour faire pots de terre convenoit que la terrefeust argillée ou avant qu’elle feust mise en euvre, falloit qu’elle feüsttoute pourri et trempée par longue espace de temps en eauescorrompues, et a ceste cause quant ladicte terre (fol. 136r) estoit miseen estat et disposicion de mectre en euvre, et quelle estoit mise, feütsen façon de potz, de autres ouvraiges et y faloit cuire desdictz ouvraigesmis au fourneau pour cui, et le feu estoit dedans lesdits fourneauxsalloit et issoit grans fumées et vapeurs puantes et infectes a l’occasiondes matières qui estoient corrompües et aussi du plomb, souffre etlimaille, occre et austres mestaux gros et materiaux que l’on mectoitdedans lesdictz ouvreages et sans lesqueles matieres on ne pouroit fairelesdictz ouvrages, et pour obvier aux grans inconveniens qui pourroientadvenir, estoit besoing et necessite de deffendre que (fol. 136v) telzouvrages ne feüssent fais en ceste dicte ville de Paris quy estoit commedit est la ville cappital de ce royaume…». Transcription deS. Gouzouguec que je remercie vivement. Ce texte a aussi été transcritdans LA MARE 1705, p. 541.
18. Ibid.19. Ibid. Livre bleu fol. CVIIv, Arrest de la court contre un potier
de terre. Extraict des registres de parlement : «… contra GuielmumLaurens, magistrum fugullum in dicta nostra villa Parisiensis commor-rantem, actorem ac sibi dictim furnum as potos terros alai vasa ac caeterahujusce ministerii opra coquendum, in domo in qua moratur in antiquoBeati joannis Cimetrerio situata in vico de Chartron [l’édition transcit deChartion] retro correspondanti ac domini praedicta [e] [relectae]. Amiartcontigua, facere seu fieri facere, et in dicto furno facere, coquere, (...) ».Publié aussi par LESPINASSE 1886, p. 771. Ce potier semble être celuiqui a réalisé «21 toises de carreaulx verts et jaulnes » pour l’hôpitalSaint-Jacques-aux-Pèlerins en 1494-1495, cf. GOUZOUGUEC 2009,p. 17.
encore d’allumer des fours à poterie dans Paris. Ces deuxpotiers sont voisins. Comme le rappelle Lespinasse, à lafin du XIXe siècle,
… la salubrité de l’air, la pureté de l’eau, la bontédes aliments et des remèdes sont les aspectsimmédiats des soucis de la santé publique. De làviennent les ordonnances et les règlements pourle nettoyement des rues, l’écoulement desinondations par les cloaques, et les décharges…C’est sur ce motif que sont fondés les Règle-ments qui ordonnent que les tanneurs, les foursà cuire les poteries de terre, les teinturiers et lestueries des bestiaux seront éloignés du milieudes villes20.
En définitive, en dépit de ces règlements, il paraît certainque les potiers sont encore dans le centre de la ville auxXVIe et XVIIe siècles, plusieurs actes notariés (contratsd’apprentissage, marché, etc.) en témoignent (fig. 2).Toutefois, un déplacement de cette industrie à l’extérieurde l’enceinte urbaine est attesté dès la fin du XVIe siècle versle faubourg Saint-Antoine (qui à partir du XVIIe siècleprolonge la rue Saint-Paul au-delà du rempart), encouragéen cela par les lettres patentes qui autorisent la liberté detravail en marge des communautés de métiers parisiens,aux artisans qui viendraient s’installer sur les terres del’abbaye Saint-Antoine21. C’est également là que lesmanufactures de faïence et de porcelaine vont aux XVIIe etXVIIIe siècles s’implanter22. En 1749, les potiers de terre dufaubourg obtiennent par une délibération de jurandeauprès de potiers parisiens de vendre leurs productionsdans une boutique en ville, contrairement aux faïenciersqui doivent vendre par colportage23.
2. Les structures de productions : l’«hostel » despotiers parisiens
Les inventaires après décès de maîtres potiers parisiensconstituent une source de premier ordre pour étudier lesstructures de cet artisanat. Ils témoignent notamment del’implantation des ateliers dans le tissu urbainenvironnant, ce que confirme l’emplacement du four dela rue du Grenier-sur-l’Eau24. En effet, les potiersdemeurent et vendent en leurs «hostels ». Ils peuvent êtrepropriétaires ou bailleurs (bail entre potiers ou entre
potiers et propriétaires n’ayant rien à voir avec le métier25).Les données concernant l’organisation spatiale sontcependant peu nombreuses. On relève la présence systé-matique de plusieurs pièces. D’une part des pièces enfaçade, principalement la boutique ou « l’ouvroir » : « enl’ouvoirier de devant dudit hostel » et « en la boutiquedudit hostel ayant vue sur la rue » (1563)26, avec parfoisune « arrière-boutique ». D’autre part des pièces situées àl’arrière : « en la première chambre du corps d’hôtel dederrière » puis, la cave dans laquelle il est dit que se trouvele four et, enfin, la cour et parfois le grenier. Il estquelquefois fait mention d’une petite salle basse : « en lasalette basse de ladite maison ayant vue sur la boutique etsur la court » (1563)27. Cette pièce pourrait correspondreà la petite pièce «vestibule». Dans ce même inventaire, onévoque des caveaux dont l’un est dit joignant à la cave. Cespièces pouvaient être des « chambres chaudes », c’est-à-dire des séchoirs pour les poteries, comme cela a pu êtrerelevé à Fosses, dans des inventaires après décès de potiersdes XVIIe et XVIIIe siècles28.
L’arrière-boutique semble être la pièce à vivre. On yretrouve les chenêts, une fontaine avec son robinet, desustensiles de cuisine en cuivre (chaudrons, pelle et poêlongarnis de leur queue de fer, broche de fer servant à rôtir)ainsi que de la vaisselle métallique (plats, pots et écuellesd’étain). On a également fait mention de futailles, de« 1 selle de 4 pieds de long à asseoir à table, 2 hottes,2 rouetz, 1 dévidoir ». Par ailleurs, dans les chambres, ontrouve, avec la prisée des effets personnels, des objetsprécieux en or ou en argent (bijoux, gobelets, salières).
Le tour qui est indiqué par la mention de « roue » estattesté dans plusieurs endroits de l’atelier : dans la cave
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 111
Publications du CRAHM, 2011
20. LESPINASSE 1886, p. 202.21. THILLAY 2002, p. 22 ; p. 145-148.22. PLINVAL DE GUILLEBON 2002.23. THILLAY 2002, p. 148.24. Cf. § 2.2.
25. C’est le cas en 1647 de Pierre de La Tour, conseiller et secré-taire du roi et des ses finances, qui loue à maître Robert Chevel, maîtrepotier de terre demeurant à la porte Saint-Michel, une maison « sizeentre les portes Saint-Denis et Saint-Martin » pendant 4 ans,moyennant un pâté de jambon de Mayence chaque année au jour deSaint-Laurent et 100 s. de poterie « telle qu’elle plaira au bailleur parchacun an aussi. ». AN, Minutier central, étude XXXV-259. C’estaussi le cas en 1640, d’Adam Bureau, sergent à verge du Châtelet quibaille à Denis Bourdois, maître potier de terre demeurant au faubourgSaint-Marcel, une maison rue Mouffetard, pour cinq ans, comprenantun corps de logis arrière situé sur une cour (commune avec le proprié-taire) avec jardin. AN, Minutier central, XVIII-157.
26. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).27. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).28. GUADAGNIN 2000, p. 124. Voir également ALEXANDRE-BIDON
1986, p. 72-73 : « (…) lorsqu’en milieu urbain, tchèque tout au moins,les bâtiments adventices ont été retrouvés, ils comptent bien un séchoirchauffé ».
(« premièrement en la cave de l’hostel fut trouvé […] 1 roue garnie de ses ustancilles 30 s. t. » ; « en la cave estétrouvé, une roue de fer garny de ses 2 penans de siège1 £, une autre roue de boys les rayes de fer 20 s. », 158029),dans la boutique (« en l’ouvoirier de devant dudit hostel :une roue garnie 25 s. », 156330) et dans des pièces debâtiment situé en fond de parcelle (corps d’hôtel dederrière ; «En la première chambre du corps d’hotel dederrière, 1 roue garnie de ses ustancilles prisée 40 s. » ;« en la deuxième chambre, 1 roue de fer garnie de sesustancilles 50 s. », 156531)..
Les roues sont en fer, parfois munies de siège et le plussouvent associées au petit matériel de tournage (la girelle?et sans doute les outils, estèque et tournassin, commel’indique le terme «garnie de ces ustancilles » : «2 rouesservant audit estat de potier de terre dont l’une garnye etl’autre non prisées ensemble 3 l. t.» (1569)32 ; « une rouemontée preste à travailler à faire pots de terre 10 l.» (1607)33.
Les fours se trouvaient dans les caves des maisons. Ainsi,dans un acte concernant un hostel de la rue aux Ours(Oies), on relève : «En la cave dudit hostel où est le fourt»,« A été trouvé tant au four de ladite maison estant en laditecave (…) » (1563)34. Dans un autre acte, il est mentionné :«Dessus le four dudit hostel fut trouvé (…) » (1565)35.Sans devoir être considéré, on l’a vu plus haut, commeune cave, l’espace dans lequel se trouvait le four de la ruedu Grenier-sur-l’Eau était bien construit dans un espacesemi-excavé. En cas de bail, le potier était tenu de laisserles lieux en bon état (mur et aussi annexe tels que jardins,cours)36. Parfois aussi, le potier peut être obligé d’installerson four ailleurs que dans la cave, dans la cour par exemple,comme dans un acte de 1640, ou le potier de terre esttenu de mettre et placer son fourneau dans «une petitecour mi-pavée qui est à costé dudit logis pour y cuire sesouvrages et autres qui sont à présent dans la cave37 ».
3. Les matériaux (fig. 3)
Dans l’atelier, il y a des matériaux nécessaires au métier depotier, à savoir l’argile, le bois, le sable. La Seine quitraverse Paris, outre son rôle d’alimentation en eau deconsommation, sans être un facteur déterminant, a sansaucun doute favorisé l’implantation des potiers au cœurmême de la capitale, comme on le voit avec cet atelier dela rue du Grenier-sur-l’Eau. Les matériaux de base, l’argileet le sable proviennent des environs immédiats de Paris.
3.1. L’argileL’argile provient des villages situés aux portes de Paris, ausud, le long de la vallée de la Bièvre (Gentilly, Arcueil).Toutefois, au nord de la ville, à Pontoise, des gisementsont également été exploités au Moyen Âge par les potiersde Saint-Denis38 et de Paris39. Ce qui est intéressant, c’estque dans deux actes du XVe siècle, ils sont le fait demarchands de Gentilly, qui contrôlaient le commerce del’argile. L’origine de ces exploitations d’argile dans larégion est sans doute très ancienne. À Vanves, villageproche de Gentilly et d’Arcueil, furent retrouvés desateliers de potiers antiques et du haut Moyen Âge40.L’argile utilisée par les potiers parisiens pouvait venir deces gisements bien que l’exploitation d’argile sur place, àVanves, soit encore attestée au XIXe siècle (cf. supra).
Plusieurs documents provenant essentiellement dufonds du minutier central des notaires parisiens montrentque les potiers de la capitale utilisent la plupart desgisements du sud parisien durant l’Ancien Régime, autourde ces deux villages d’Arcueil et de Gentilly. L’extractionde la terre à poterie aux abords des villes ou dans lesquartiers d’habitation est chose apparemment courante àcette époque, et ce depuis plusieurs siècles. Au XVIe siècle,Bernard Palissy souligne que « auprès de Paris, il y a troissortes de terres argileuses, la plus fine se prend à Gentilly,qui est un village dudit lieu41 ». En 1605, il est précisédans les statuts des potiers de la ville que le village deGentilly est le principal endroit où les potiers parisienss’approvisionnent en terre42. Plusieurs actes, le plus souvent
FABIENNE RAVOIRE112
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
29. AN, Minutier central, étude XCI-128 (1580).30. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).31. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).32. AN, Minutier central, étude XCI-122 (1569).33. AN, Minutier central, étude XV-48 (1607).34. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).35. AN, Minutier central, étude XCI-117 (1563).36. Par exemple le potier s’engage devant le propriétaire d’une
maison «de faire en icelle dedans la cave un fourneau qu’il auroit faitpour sa commodité à condition que s’il endommageait les gros murset voute de ladite maison qu’il les restabliroit à ses frais [...] ». AN, Minutier central, étude XXXV-259.
37. AN, Minutier central, étude XVIII-257.
38. MEYER-RODRIGUES et SMIRNOFF 1992, p. 343-344.39. FAVIER 1975, p. 113 : «Même chose pour la terre à pots, que
l’on voit seulement à deux reprises apportée de Pontoise par unmarchand de Gentilly : les potiers parisiens vont eux-mêmes choisirleur terre ».
40. Ce site a été fouillé récemment par X. Peixoto (INRAP).41. FRANCE 1880.42. «Nul marchant forain, quel qu’il soit, ne pourra et lui est
defendu d’acheter ou enlever aucune terre à faire potz, carreaux et
des marchés de terre passés entre potiers et laboureurs,attestent l’utilisation de l’argile prélevée à Gentilly pour lespotiers de terre parisiens établis dans le faubourg Saint-Marcel (notamment rue de Lourcines). Un marché delivraison de terre daté de 1547 concerne cependant unpotier installé dans Paris43. D’autres lieux d’extraction sontégalement mentionnés, par exemple en 1659 « devantl’hôpital Saint-Anne au faubourg Saint-Marcel » :
… fut présent en sa personne Jean Moreaumarchand de terre à potier, demeurant aufaubourg Sainct-Marcel rue de Lourcine
parroisse Sainct-Médard. Lequel a recogneu etconfessé avoir faict marché, promis, et promectà Roch Montailly, maistre potier de terredemeurant au faubourg et paroisse Sainct-Jacques de ceste dicte ville et (a) ce present etacceptant, de lui fournir et livrer par ledictMoreau toute la terre à potier qui se doibtprendre et fouiller devant l’hôpital Saincte-Anne dudict faubourg Sainct-Marcel…44.
À Gentilly et à Arcueil, l’exploitation de l’argile se faisaità ciel ouvert sous la forme de fosses comme c’était l’usageau Moyen Âge : «… la terre hors la fosse, et preste àcharger au lieu et endroict ou ledict Perigou la faict tirerhors terre, qui est entre Gentilly et Arcueil lez Paris…45 ».Il pouvait s’agir de trous ponctuels, effectués sur les terresde simples particuliers46. Des concessions pouvaient êtres
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 113
Publications du CRAHM, 2011
ouvrages dudit mestier, soit au village de Gentilly ou ailleurs, prèsParis, où ladite terre se fouille, si premièrement tous les maistres duditmestier de ladite Ville et faulxbourg de Paris s’en soient fournis etpourvus…» (LESPINASSE 1886, p. 772). Le terme «ailleurs » s’appliqueaux villages voisins comme Arcueil ou Vanves, dans lesquels l’exploi-tation d’argile était également répandue.
43. COYECQUE 1905, p. 193.44. AN, Minutier central, étude AF, XLIII 94.45. AN, Minutier central, étude AF, XXIII-R 218, fol. 533.
I
II
III
IV
VVI
VII
VIII
IX X
XI
XII
XIIIXIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XXBois
deBoulogne
Bois de
Vincennes
Seine
MarneGentillyMontrouge
Chapelle St-BonChapelle St-Bon
Vanves
Bagnolet
Saint-Denis
Belleville
Vaugirard
Auteuil
Passy
1122
5
33
6
4
7
0 km 2 km
Sablière
Argilière
attesté par les sources écrites
attesté par l’archéologie
Lieux de production :
N
J.-C. F. (del.)Centre Michel de BoüardCRAHAM, UMR 6273, 2010
1 – Quartier de Grève, Saint-Jacques de la Boucherie et verrerie. Four de l’allée des Justes (ancienne rue du Grenier-sur-l’Eau) et tessonnières du haut Moyen Âge (tour Saint-Jacques) 2 – Quartier Saint-Paul (tessonnières du XIVe siècle) 3 – Quartier des Halles 4 – Collège des Bernardins (tessonnières du XIIIe siècle) et quartier de l’Université 5 – Faubourg Saint-Martin 6 – Faubourgs Saint-Germain-des-Prés (tessonnières du XVIe siècle) et de N-D des Champs 7 – Faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor (tessonnières du XVIe siècle)
F. Ravoire - INRAP
Fig. 3 : Carte des ateliers et des sites d’approvisionnement en argile et sable des potiers de terre parisiens.
accordées pour exploiter un filon comme l’atteste unmarché passé entre les chanoines de l’Église de Paris ettrois marchands potiers, pour la fouille de trois quartiersde terre durant 5 ans47. Outre les potiers, qui pouvaienteux-mêmes tirer de la terre48, il existait des personnes plusou moins spécialisées dans la vente (mention d’unmarchand fouilleur de terre à potier49) et l’extraction dela terre. Le plus souvent, les marchés concernent des fouil-leurs de terre50, des terrassiers, des laboureurs ou desfouleurs51 qui extraient et qui vont livrer l’argile à despotiers de Paris :
Claude Macé, laboureur à Notre-Dame desChamps, à Jean Fontaine, manouvrier, et ClaudeRameau, laboureur, demeurant à Gentilly, dusous-sol d’un quarteron de terre, sis à Gentilly,lieu-dit la Terre à pots, pour… prendre par eulxtoute et telle quantité de terre… que bon leursemblera et utile sera pour faire potz deterre…52.
La terre est acheminée chez le potier soit par ceux quiont extrait la terre, soit par des voituriers53.
En dehors des potiers, les tuiliers se fournissaientégalement en argile et aussi en sablon et en bois, souventen passant par des intermédiaires54. Un certain JeanPaulmier en 1473 loue la fosse à extraire de la terre à pots« tant qu’il en pourra tirer, dudit jour et si longtemps quela fousse qui a present y est overte pourra durer55 ».Comme pour les potiers, la terre est tirée de Gentilly maisaussi de Montrouge, de Vanves, de Vaugirard « soubz terrees carrieres de Vaugirard qui sont prez du pressouer deMalassiz ou ilz foulloient la terre a pos56 » et du sud-ouest,des villages d’Auteuil et de Passy, l’argile étant alors
acheminée par bateau jusqu’au port de Nesle57. AuXVIIIe siècle, les potiers et faïenciers du faubourg Saint-Antoine se fournissent en argile à Arcueil mais égalementplus près, à Belleville, Charonne ou Picpus58.
Au XIXe siècle, Alexandre Brongniart indique que cesgisements (Vaugirard, Vanves, Issy, Auteuil) sont encoreutilisés par les potiers parisiens ainsi qu’au nord de Paris,ceux de Belleville et au nord-ouest d’Argenteuil (Val-d’Oise) :
L’argile figuline très douce au toucher forme avecl’eau une pâte assez tenace. On l’emploie dans lafabrication de la faïence, des fourneaux, despoteries grossières, à pâte poreuse ou rougeâtre.Il en existe une grande quantité près de Paris,dans les environs de Vanves, de Vaugirard etd’Arcueil, dont on se sert non seulement pourfaire les poteries du plus bas prix mais encorepour glaiser les bassins et les modeler. L’argile laplus blanche et à veines rouges est la meilleure ;elle arrive en mottes dans les fabriques. Celletirée de Vaugirard est d’un bleu turquoise ; on laconnaît sous le nom de belle59.
Alexandre Brongniart précise que les potiers utilisentl’argile plastique d’Arcueil pour la fabrication de faïencebrune ou blanche60. Elle servait notamment à cetteépoque pour la fabrication de poêles en faïence61.
Les échantillons d’argiles prélevés par AlexandreBrongniard ont fait l’objet d’analyses physico-chimiques62.Ces analyses ont été comparées aux vingt-neuf échan-tillons analysés provenant des céramiques retrouvées dansle four (cf. infra). Ces productions forment un groupehomogène caractérisé par 70 % de silice pour 22 %d’alumine, peu d’alcalins (1 %) et 3,5 % de fer63. Cesrésultats sont tout à fait comparables aux analyses desterres d’Arcueil, village voisin de Gentilly avec 69,9 %de silice pour 24,16 % d’alumine, peu d’alcalins (1 %) et2,4 % de fer. Ils permettent ainsi de caractériser lesproductions parisiennes et confirment les donnéesfournies par les textes d’un approvisionnement périurbain.Des analyses de céramiques provenant de plusieurs sitesde consommation parisiens ont été réalisées64, confirmantla réalité de cet approvisionnement parisien qui se
FABIENNE RAVOIRE114
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
46. AN, Minutier central, étude XLIII-59 (marché du 6 décembre1649 pour les besoins de la manufacture royale de la tuile).
47. AN, Minutier central, étude CII-49, fol. 342 (marché du10 juin 1647).
48. AN, Minutier central, étude AF, XXIII-R 218, fol. 533 (marchédu 26 août 1600).
49. AN, Minutier central, étude AF, XVIII-53 (marché du16 novembre 1647).
50. AN, Minutier central, étude AF, XLIII-48 (marché du 5 mars1646).
51. COYECQUE 1905, p. 193. AN, Minutier central, étude XXXIII,32 bis-fol.
52. AN, Minutier central, p. 402. AN, Minutier central, étudeAF, XXIII-53.
53. AN, Minutier central, étude AF, étude XVII-53 (marché du6 novembre 1647).
54. GOUZOUGUEC 2006, p. 218 et 219.55. Ibid. ; AN, Z2 1146, fol. 46v.56. GOUZOUGUEC 2006, p. 229 ; AN, Z2 3268, fol. 28.
57. GOUZOUGUEC 2006, p. 216 (fig. 1), p. 218, 221.58. THILLAY 2002, p. 146.59. BRONGNIART 1977 (1877), vol. II.60. Ibid., p. 22.61. MUNIER 1949, p. 13.62. RAVOIRE et BOUQUILLON 2004, p. 54, tableau 1.63. Ibid., p. 57.64. Ibid., p. 55, tableau 2 et p. 57.
distingue d’autres centres de production franciliens dontcelui, désormais bien connu, de Fosses65.
Transportée depuis les carrières toutes proches, l’argileétait stockée dans les caves des « hostels » des maîtrespotiers. Une sentence du Châtelet de 1486 précise que
pour faire pots de terre convenoit que la terrefeust argillée et avant qu’elle feust mise enœuvre, fallait quelle feust toute pourrie etdétrempée par longue espace de temps en cavecorrompue66.
Plusieurs mentions dans des inventaires après décès fontréférence à l’argile conservée dans les caves :
En la cave de corps d’hôtel de derrière :1 charreté et demi de terre servant audit estat45 s. ; 1 auge de pierre de taille servant à tremperla terre 7 £ 10 s.67 ; Premièrement en la cave de l’hostel fut trouvé(…) 6 tombereaux de terre à faire carreau 60 s.,en terre marché 20 s. t. ; 1 aulge de pierre detaille à tremper la terre 100 s. t. ; 3 chartiers deterre à 9 s. par chartée68 ; En ladite seconde chambre estant elle du corpsd’hostel du millier fut trouvé 2 (…) de terrecrue estimés 18 l. t. ; En la cave esté trouvé 15 mottes de terre 12 s. t.,ung auge de pierre 20 s.69 ;En ladite cave tant en terre motte que en terremarchée la somme de 20 escuz et demi (soit22 £. et demi)70.
Avant toute manipulation, l’argile est déposée dans depetites fosses, en général rectangulaires, ou dans une augeen pierre remplie d’eau. Ces auges étaient « en pierre detaille servant à tremper la terre » :
deux auges de pierre de taille prisées et estimées2 escuz 10 s…71 ; (…) une demi voye de terre servant à faire pots,deux autres servant à détremper terre avec unegrande hotte d’osier 60 s. t. 72 ; de la terre de poterie plastre 15 £. ; deux voyesde boue flottée 13 £. ; une voye de terre 50 s.73.
L’argile est ensuite retournée régulièrement avec unepelle en fer dont l’existence est attestée dans certainsinventaires après décès. Le lavage de l’argile avait pourbut d’en séparer les sables et autres inclusions grossières.Puis l’argile est broyée et battue : « plusieurs moulet etbattes 10 s. » (1565)74.
L’argile avant d’être pétrie est «marchée », c’est-à-direqu’après avoir été disposée sur une aire plane et avoir étédétrempée,
un marcheur nu-pied, aidé d’un bâton, marche desheures durant, en spirale, du centre vers la périphériepuis inversement. Sous les pieds, le marcheur sentles nodules pierreux et doit les extraire75 .
Cette opération précédait la battée de l’argile afin de larendre parfaitement malléable et prête à l’emploi. Noustrouvons trois mentions de terre dans les inventaires :
6 tombereaux de terre à faire carreau 60 s. en terremarché 20 s. t. ; 3 chartiers de terre à 9 s. parchartée76.
3.2. Le sableLa présence de tas de sable témoigne de la haute valeurmarchande de ce matériau naturel dont les potiersdevaient faire une grande consommation. On relève ainsidans trois inventaires après décès de potiers :
En la cave du corps d’hôtel de devant1 tombereau et demi de sablon servant auditestat 15 s.77 ; Premièrement en la cave de l’hostel fut trouvé3 tombereaux de sablon ou environ 28 s.78 ; Ung tombereau de sablon 10 s. t.79 ; Un monceau de sable estant dans la cour pourla somme de 12 l.80.
Bernard Palissy précise, à propos des potiers de Paris,la cause pourquoy le sable peut faire que la pièceendurera plutost le grand feu, que quand la terresera pure, est qu’il fait division des subtilesparties de la terre : et d’autant que sa subtilité larendoit plus alise et reserrée, le sable luy causequelques pores par lesquels l’humide s’exale pluspromptement pour donner place au feu, sonadversaire. Pour ces causes, les potiers de Parismettent du sable à toutes leurs besongnes81.
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 115
Publications du CRAHM, 2011
65. GUADAGNIN 2000 et 2007.66. AN, Y 61, fol. 97.67. AN, Minutier central, étude XCI-117, 10 fol. (17 mars 1563).68. AN, Minutier central, étude XCI-117, 4 fol. (11 janvier 1565).69. AN, Minutier central, étude XCI-128 (28 novembre 1583).70. AN, Minutier central, étude XCI-128 (28 novembre 1583).71. AN, Minutier central, étude CXXII-1491, 5 fol. (1580).72. AN, Minutier central, étude XV-48, 4 fol. (1607).73. AN, Minutier central, étude XXIII-R 262, 4 fol. (1624).
74. AN, Minutier central, étude XCI-117, 4 fol. (11 janvier 1565).75. ALEXANDRE-BIDON 1986, p. 81 ; CHAPELOT 1975, p. 43-44.76. AN, Minutier central, étude XCI-117 4 fol. (11 janvier 1565).77. AN, Minutier central, étude XCI-117 4 fol. (11 janvier 1565).78. AN, Minutier central, étude XCI-117 4 fol. (11 janvier 1565).79. AN, Minutier central, étude XCI-128 (28 novembre 1583).80. AN, Minutier central, étude XXIII-R 262.81. FRANCE 1880, p. 366.
La ou les sources d’approvisionnement en sable ne sontpas connues précisément. Cependant, un texte de 1610mentionne un prélèvement de sable dans les environsimmédiats de la capitale, à Notre-Dame-des-Champs :
… Léon Le Devin, marchand, demeuranthors la porte Saint-Michel qui promet auditPaul Meslin de fouiller, pendant un an dusable jusqu’à tant qu’il en faudroit laditeannée seulement moyennant la somme de18 l., une pièce de terroir à Notre-Dame desChamps82.
Au XIXe siècle, le sable vient, au nord, de Belleville et, ausud, d’Arcueil (l’un et l’autre sont fins et peu mêlés decailloux)83. Le sable dit de «Fontainebleau » provient desniveaux stampiens (Oligocène), qui abondent surtoutdans le sud de Paris, en bordure de la vallée de la Bièvre,mais également à l’ouest vers Meudon et Saint-Cloud,au nord-est à Belleville84. C’est sans doute celui qui, grâceà ses qualités intrinsèques (granulométrie très fine à fine,forme anguleuse naturelle) a été tout particulièrementapprécié des potiers du XVIIIe et du XIXe siècle et sans doutede ceux des siècles précédents. Alexandre Brongniartprécise que :
le sable est tantôt du quartz pur, tantôt du quartzmélangé d’argile, de calcaire, d’oxyde de fer et demica; il est alors employé, après avoir été broyé ouréduit à un état de grande ténuité, soit commedégraissant dans les pâtes trop argileuses, soitcomme fondant en donnant à la pâte plus deliaison avec la glaçure : tel est le sable de Nevers,par rapport à la faïence ; mais dans ce cas le sablen’est pas du quartz pur (…). Au reste le sable n’estjamais parfaitement pur, celui de Fontainebleaurenferme environ 4 % de matières étrangères,consistant en alumine, magnésie et fer ; celui dela butte d’Aumont est plus pur, ne renfermantguère que 1 % de matières étrangères à la silice85.
3.3. Les composés métalliquesDans les descriptions archéologiques de la chaîne opéra-toire des potiers de terre, on a tendance à faire l’impassesur les composés métalliques ou les métaux indispensablesà la fabrication des glaçures. La production parisienne, enparticulier à la Renaissance, fait une très large place à
l’usage de la glaçure, en particulier verte, obtenue parl’emploi d’oxydes de plomb et de cuivre. Nous n’avonsretrouvé qu’une seule mention de plomb, dans un inven-taire après décès de 1607 : «un rable de fer garni de sonance avec un pot et une grande cuillère de fer servant àfondre plomb 15 s.86 ». L’on sait par une sentence duParlement de 1486 que les potiers de terre parisiens utili-saient de la limaille ainsi que du plomb et du soufre87.Savary des Bruslons nous apprend que pour «plommer »leur ouvrage, les potiers de terre se servent ordinairementde l’alquifoux ou plomb minéral ou du plomb enpoudre88.
Les approvisionnements en composés métalliques ouen métaux des potiers parisiens se faisaient par l’intermé-diaire de marchands spécialisés, les plombiers. La thèserécente de Nicolas Thomas sur un atelier d’artisan parisiendu métal dans la première moitié du XIVe siècle a montrél’importance et la structuration du marché du métal àParis89. Le recours au recyclage est par ailleurs trèsdéveloppé et il n’y a pas de difficulté pour les potiersparisiens à se procurer ces matières premières d’autantque les quantités nécessaires pour la céramique sont sansmesure avec celles manipulées par les métallurgistes. Ilfaut souligner que la qualité des métaux utilisés pour lesglaçures n’a que peu d’importance, en particulier pour lecuivre qui n’a pas besoin d’être affiné. Quant au plomb,sous-produit de l’extraction de l’argent, il est peu coûteuxet très abondant.
3.4. Le boisLa cuisson des poteries nécessite beaucoup de bois.L’anecdote de Bernard Palissy vers le milieu du XVIe siècleà Saintes, brûlant tout son mobilier pour continuer àtravailler malgré la pénurie de bois90, illustre l’absolue
FABIENNE RAVOIRE116
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
82. AN, Minutier central, étude XXIII-R 241, fol. 345 ; voir aussiGOUZOUGUEC 2009, p. 15, fig. 2.
83. BOYER 1846, p. 264.84. BRONGNIART 1977 (1877), vol. II, p. 4.85. Ibid., p. 72.
86. AN, Minutier central, étude XV-48, 4 fol.87. Voir note 13.88. «Plommer. Terme de potier de terre. C’est la même chose que
plomber ; c’est-à-dire, vernisser la poterie de terre, parce que le vernisse donne avec du plomb, ou du moins des minéraux qui entiennent lieu, et des drogues tirées de ce métal. Les potiers se serventordinairement à cet usage de l’alquifoux ou plomb minéral ; du plomben poudre, qui sui se fait en jetant du charbon pilé dans du plomb enfusion ; et des cendres de plomb, qui ne sont autre chose que sonécume et ses scories. » (SAVARY 1741, p. 859).
89. THOMAS 2009, p. 578-597.90. «… Il me survint un autre malheur, lequel me donna grande
fascherie, qui est que le bois m’ayant failli, je fus contraint brusler lesestapes qui soustenoyent les tailles de mon jardin, lesquelles estantbruslées, je fus contraint brusler les tables et plancher de la maison, afinde faire fondre la seconde composition», PALISSY 1989 [1580], p. 34.
nécessité de ce matériau pour cet artisanat. La haute valeurmarchande du bois justifiait des prix d’achat très élevés91.Elle est prouvée indirectement par le soin avec lequel ilest inventorié dans les inventaires après décès. Plusieursd’entre eux mentionnent la présence de grandesquantités de bois entreposées dans les « hostels » desmaîtres potiers de terre de Paris. La quantité de boisnécessaire au bon fonctionnement d’un ou de plusieursfours de potiers de terre est importante. La consom-mation totale était encore plus importante en hiver, parmauvais temps prolongé, si l’on était obligé de fairesécher les produits à l’intérieur des ateliers, à l’aide defeux entretenus durant toute la journée, ainsi qu’on lefaisait en Berry au début du siècle92. Ces bois n’étaientpas tous destinés à la cuisson des poteries. En effet, seulesdeux mentions font référence à du bois à brûler « unedemi voye de boys à brusler 30 s. t.93», les autres neprécisant pas la destination de tout ce bois qui secompose pour l’essentiel de « ais » (planches) et delatières. Ces grandes planches pouvaient servir à couvrirle four quand il ne fonctionnait pas ou à le protéger desintempéries94. Bernard Palissy précise clairement lesdommages causés par la pluie et le vent :
… mais il me survint une autre affliction conca-ténée avec les susdites, qui est que la chaleur, lagelée, les vents, pluyes et gouttières me gastoyentla plus grande part de mon œuvre, au paravantqu’elle fut cuitte ; tellement qu’il me fallutemprunter charpenterie, lattes, tuilles et clouspour m’accommoder95.
Ces bois se retrouvent un peu partout dans « l’hostel »96,essentiellement cependant dans des espaces protégés, enparticulier la cave :
En la cave dudit hostel où est le fourt 38 ais debois de chêne tant grands que petits de plusieurslongueurs 15 s. ;
En la cave a esté trouvé 22 ays de plusieurslongueurs et largeurs de bois de chêne priséensemble 1 l. 6 s., 9 petits ays aussi de boys dechesne de plusieurs longueurs prisés ensemble10 s. t., plusieurs pièces de membrures deplusieurs longueurs de bois de chêne 1 l., undemi cent de ays de plusieurs longueur et largeurde boys de chesne 40 s. t., 5 ays et 3 petites piècesde membrure le tout de boys de chesne 25 s.
ou des caveaux : En un petit caveau joignant ladite cave, 9 ais debois de chêne de plusieurs longueurs 40 s. ; En un autre petit caveau, plusieurs chantiers debois à brûler 50 s. .
On en trouve également dans la boutique : En la boutique dudit hostel ayant vue sur la rue,33 ais de bois de chêne tant grands que petits et6 membrures 40 s.,
dans les chambres :En la première chambre du corps d’hotel dederrière 40 ais et 8 latières aussi de boys 4 l. 4 s.,En la deuxième chambre, 18 ais et 4 latières letout de bois 40 s.
Les mentions relatives aux espaces extérieurscomme lieu de stockage sont peu nombreuses :
En l’allée, 6 ays 12 s. ; En la court, 4 voyes de boys prisées 12 s. t. ;En l’arrière boutique et en la cour dudit hostel :12 membrures et autre ais tant grands que petitsde plusieurs longueurs 40 s.
La carte des Chasses du Roi montre que si Paris étaitenvironnée de forêts, ce ne sont pas ces dernières quialimentent la capitale en combustible. Au Moyen Âge, larégion la plus proche de Paris procure, avec un peu defoin, quelques cargaisons de gros et menu bois dechauffage (bûches, bourrières, cotterets) venant deSèvres97. Du bois provient également des forêts franci-liennes de Sénart, de la Laye, des environs de Lagny et dela Bourgogne voisine98. Mais à la fin du Moyen Âge, lesvilles étant le plus souvent déboisées, le bois, en parti-culier de construction et d’œuvre, arrivaitquotidiennement par charroi et par flottage99. À Paris auXVe siècle, ce sont les hêtraies du Valois qui fournissent cesbois qui arrivent par voie fluviale de Villers-Cotterêts, deCompiègne, de Pont-Sainte-Maxence, de Versigny-lès-
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 117
Publications du CRAHM, 2011
91. Si l’on se réfère au cahier de compte de livraison de bois de JeanBabut, faïencier à Bergerac (1767-1775), «d’une manière générale, ilsemblerait qu’il y ait une lente augmentation du prix des bourrées aucours du cycle des saisons, de l’hiver à l’été suivant, parallèlement à ladiminution des stocks des fournisseurs et à la difficulté de préparer desbourrées de bois sec lorsque la végétation est en pleine croissance »(LACOMBE 1992, p. 94).
92. SCHWEITZ 1979, p. 74.93. AN, Minutier central, étude XV-48, 4 fol. (22 mai 1607).94. RÉGALDO-SAINT-BLANCARD 1986, p. 177. 95. PALISSY 1989 [1580], p. 44-45.96. AN, Minutier central, étude XCI-117, 10 fol. (17 mars 1563) ;
étude XCI-117, 4 fol. (11 janvier 1565) ; étude CXXII-1491, 5 fol.(15 décembre 1580).
97. FAVIER 1975.98. WOLF 1983, p. 24.99. CHEVALIER 1982, p. 183 ; BABELON 1986 : en particulier
p. 294, la gravure sur bois représentant les mesureurs de bûches où l’onvoit un charroi de bois. Livre des ordonnances de la prévôté des marchands(Bibl. hist. de la ville de Paris).
Senlis, de Beaumont-sur-Oise et de Verneuil-en-Halatte100. Des cargaisons de bûches et de foins arriventaussi de Pont-l’Évêque près de Noyon, de Pontoise et deRoyaumont101. Dans la vallée de l’Ysieux, les bois dechauffe utilisés par les potiers venaient des forêts environ-nantes102.
4. La production des potiers dans les inventaires
4.1. La cuisson des céramiquesDans les statuts des potiers de Paris de 1456, le neuvièmerèglement précise les modalités de cuisson :
[…] fors tant que lesdits potiers, après ce qu’ilsauront enfournez leurs pos et estouppé leur fourde gastellement, pourront, se bon leur semble,bouter le feu en leurs fourneaux pour cuire lespotz et deffourner à toute heure que bon leursemblera, sans offence103.
Les statuts de 1456 et 1605 précisent que[…] seront lesdits ouvrages restouppez et refaizpar les ouvriers dudit mestier, de terre bonne etsouffisante, plomez et recuiz comme il appar-tient, sur ladite peine de 20 sols parisis àappliquer comme dessus104.
Par ailleurs, les ouvrages « recacinés » peuventestre destoupez et refaits par les ouvriers duditmestier, de bonne terre et suffisante, plombéeet recuite comme il appartient, estant recuitededans le four105.
4.2. Les marchandisesLes inventaires du XVIe siècle dont nous disposons fonttous référence à des maîtres potiers qui sont égalementmarchands potiers106. Il y a toujours dans la prisée,mention de la boutique et de la cave où est le four. Ilsvendent leurs productions, à savoir des poteries et descarreaux, mais également des marchandises foraines, en
particulier des grès du Beauvaisis107. Cette marchandisese trouve dans plusieurs endroits : dans la boutiqued’abord, dans la cour, dans les chambres à l’arrière, augrenier108. S’y trouvent également les carreaux tant grandsque petits, qui étaient confectionnés par les potiers, maisjamais de tuiles, contrairement à ce qui a pu être observédans d’autres villes au Moyen Âge109. Pour leur fabri-cation, l’on a mention d’outils nécessaires à leurfaçonnage :
deux équerres de fer servant à tailler carreauxavec leurs battes 30 s. t. (1607)110 ; quatre ruilleaux avec leurs niveaulx, deux auges,une grande ruille avec deux grandz clouz le toutservant à paver petitz carreaux de terre (…)65 s. t. (1607)111.
On relève des « yeux de Bœufs » : des éléments architec-turaux112 destinés à laisser passer la lumière.
Les récipients sont désignés assez précisément et passeulement par « pot ». De ce fait, plusieurs formesnommées dans les inventaires peuvent être associées àcelles que nous retrouvons en fouilles113. Il en est ainsi despots tripodes (« pots à trois pieds »), des coquemars114(« coquemartz »), des réchauffoirs (« réchaulx »), des potsde chambre (« pots de chambre »), des marmites(«chauderons»), des bassins115, jattes et terrines («bassins,poelles, casseroles »), des tirelires, des tasses.
Certains récipients, dont la forme ne pose pas deproblème, ne semblent pas avoir été retrouvés (ou pasidentifiés comme tels) en contexte de consommation,
FABIENNE RAVOIRE118
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
100. FAVIER 1975.101. Ibid.102. GUADAGNIN 2000, p. 130-131.103. LESPINASSE 1886.104. Ibid., extrait de l’article VIII des statuts de 1456.105. Ibid., extrait de l’article IX des statuts de 1605.106. Il semble qu’il y a eu dès le Moyen Âge, d’après l’étude de
Lespinasse, des potiers fabricants et des marchands potiers (LESPINASSE 1879, p. 155-157). Cette organisation semble êtreidentique pour les potiers de Fosses, du moins sous l’Ancien Régime.Voir GUADAGNIN 2007, p. 312-318.
107. Par exemple, dans un inventaire de 1563, on relève dans legrenier de l’hôtel, « tant cruches que salloirs, pots de Beauvaisis 10 livres100 escuelles de Beauvais 25 sous, plusieurs pièces de Beauvais tantgrands que petits 60 sous ». Il est à noter que la faïence n’apparaît pasdans les inventaires du XVIe siècle consultés.
108. AN, Minutier central, étude XCI-117 ; AN, Minutier central,étude CXXII-1491.
109. GOUZOUGUEC 2006, p. 234.110. AN, Minutier central, étude XV-48, 4 fol.111. AN, Minutier central, étude XV-48, 4 fol.112. Selon le Dictionnaire Universel de Furetière, «Oeuil de bœuf,
se dit aussi en maçonnerie des fenestres rondes ou lucarnes qui sontaux derniers estages des maisons, et sur les toits. On en fait aussi deplomb et de poterie comme des tuiles ».
113. Voir le répertoire de formes proposé dans RAVOIRE 2006,p. 105-202 et sur le site ICERAMM (répertoire Île-de-France).
114. Selon le Dictionnaire universel de Furetière, c’est un «Ustensilede cuisine qui sert à faire bouillir de l’eau, et cuire plusieurs choses. Lesbarbiers portent avec eux leur bassin et leur coquemar. On fait descoquemars de terre, d’étain, de cuivre, d’argent ».
115. Ce nom de récipient est dans les textes médiévaux souventassocié aux usages de l’eau. Voir ALEXANDRE-BIDON 2005, p. 262.
comme les « tasses116 », les « coquetiers117 », les « pots àhuile118 ». L’identification de certaines formes n’est pasassurée. Ainsi les « pots à morgneaulx » pourraient êtredes nichoirs à pigeons, cette dénomination a été retrouvéedans un inventaire de potier du XVIIIe siècle de Bellefon-taine (Val-d’Oise)119. Les «pots à picquettes » sont-ils nospichets ? L’identification des « pots à ances » poseégalement problème puisque la plupart de nos pots sontà anse. Cependant ceux à plusieurs anses sont plus rares :il y a les marmites, les jattes. Enfin, d’autres formes nesont pas du tout identifiées, comme les «birettes120 », les«gellettes », les « cacquons» (une autre forme de poêlon?),les «pots à bequet à gerte » (mangeoire à oiseaux ?) et les«poislettes à couvercles» (petites poêles ?). Quant aux potsà étuves, s’agit-il d’une sorte de baquet pour le lavage,comparables aux vastes récipients retrouvés dans laproduction d’un atelier du XIIIe siècle de Dourdan121 ? Enrevanche, le «poêlon» ou «poslin», plusieurs fois nommé,n’est pas une forme, si l’on se réfère aux exemplairesmédiévaux répandus à cette époque, contrairement auxterrines à anse et à tenons qui apparaissent au XVIe siècle.S’agit-il néanmoins de la même forme ? Les « pots deplommeriers122 » et les « plombières » sont-ils nos potsentièrement glaçurés comme les coquemars verseurs ?
Les coquemars sont les récipients les plus fréquemmentcités. Ce constat corrobore les données archéologiques, àla fois celles issues des contextes de production comme cefour parisien et les fours et tessonnières du XVIe siècle deFosses mais également les sites de consommation123. Le«pot à trois pieds» ainsi dénommé dans les inventaires oupot tripode est absent des inventaires de 1563 et 1565
mais il est présent dans celui de 1583. Ce type de récipientcommence à se généraliser dans les contextes de consom-mation parisiens dans les dernières décennies du XVIe siècleet se généralise au cours du XVIIe siècle124. À Fosses, cespots tripodes sont absents des productions des premierstiers du XVIe siècle mais sont présents dans celles dudernier tiers.
Sans pouvoir préciser des notions de contenance, l’onrelève des notions de taille. On a ainsi des « coquemartzgrandz pots », des « petits poellons », « en gros poslin »,« larges pots à picquettes, gros et petits pots », « plusieursplombières de plusieurs grandeurs ». Certains vases seprésentent sous des formes variées (nos types parisiens ?)«plusieurs sortes de poislons ».
Conclusion
L’activité de potiers de terre à Paris, connue par les sourcesréglementaires, est davantage révélée par les sourcesnotariales qui regorgent d’informations concernant l’orga-nisation du métier mais surtout les ateliers et lesproductions des potiers, à partir du XVIe siècle. Cependant,les inventaires complets sont encore peu nombreux et ledépouillement de ces sources constitue un énorme travailqui reste à poursuivre. Pour autant, les inventaires aprèsdécès renseignent sur les ateliers parisiens encoreimplantés dans le tissu urbain au XVIe siècle, mais aussiprésents dans les faubourgs de la ville (dès le XIIIe siècle).Les informations qu’ils apportent permettent de replacerle four de l’Allée des Justes (rue du Grenier-sur-l’Eau)dans son contexte historique.
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 119
Publications du CRAHM, 2011
116. Cette forme est fréquente dans les contextes médiévaux franci-liens. Dans le répertoire de la Renaissance francilienne, elle n’a pas étéencore identifiée. Peut-être s’agit-il d’une forme plus grande que celledes tasses et que nous désignons comme «petite terrine à anse ». VoirRAVOIRE 2006, p. 167, planche 33.
117. Selon le Dictionnaire universel de Furetière, c’est «un petitvaisseau servant à la table, fait en forme d’une salière, pour porter unœuf à la coque ».
118. Il pourrait s’agir de la forme que nous désignons par cruchon,récipient à liquide pourvu d’un goulot verseur. RAVOIRE 2006, p. 124-125.
119. GUADAGNIN 2000, p. 335.120. Il peut toutefois s’agir de burette qui est selon le Dictionnaire
universel de Furetière, un «Petit vaisseau pour mettre du vin et del’eau, dont on se sert particulièrement pour porter le vin et l’eau néces-saires pour le sacrifice de la messe ».
121. CLAUDE 2005.122. Ces pots serviraient-ils plus spécifiquement à l’usage du potier
pour contenir la glaçure ? Voir note 88.123. RAVOIRE 1997, p. 594-597 ; GUADAGNIN 2007. 124. RAVOIRE 1997, p. 603.
ALEXANDRE-BIDON D.1986, « Le métier de potier en terre
(XIIIe-XIXe siècle) : histoire, icono-graphie et archéologie », RAMAGE,n° 4, 1986, p. 61-97.
2005, Une archéologie du goût.Céramique et consommation, Paris,Picard (collection Espacesmédiévaux), 301 p.
BABELON J.-P.1986, Nouvelle histoire de Paris. Paris au
XVIe siècle, Paris, Hachette, 626 p.
BEAUFILS E.1985, «Les potiers de terre parisiens du
XVIe au XVIIIe siècle d’après lesarchives du Minutier central desnotaires », dans « Plaquette multi-copiée éditée par le chantier de lacour Napoléon du Louvre àl’occasion du 1er Congrès interna-tional d’archéologie médiévale(Paris, 4-6 octobre 1985) », p. 4-12.
1998, « Les potiers parisiens auXVIe siècle d’après les archives duMinutier central des notaires », dansAspects méconnus de la Renaissance enÎle-de-France, Catalogue de l’expo-sition du musée archéologique deGuiry-en-Vexin, avril-janvier 1998,Paris, Éditions d’art Somogy, p. 232-234.
BOYER M.1846, Nouveau manuel complet du porce-
lainier, du faïencier, du potier de terre,du briquetier, du tuilier, contenant desnotions pratiques sur la fabrication desporcelaines, Paris, Roret, 312 p.
BRONGNIART A.1977 (1877), Traité des Arts céramiques
ou des poteries considérées dans leurhistoire, leur pratique et leur théorie,Paris, Dessain et Tolra, fac-similé del’édition de 1877, vol. I et II, 759 p.et 823 p.
BRUT C.2004, « L’artisanat de la terre cuite à
paris. Carreaux et pavementsparisiens », Revue archéologique dePicardie, n° 3-4, vol. 3, p. 27-38.
1997, «La céramique du Moyen Âge àParis, potiers et pots de terre, tuiliers,tuiles et carreaux de pavement deXIIIe et XIVe siècles », thèse dedoctorat, Paris, EPHE, IVe section.
CAGNEUX Y.1985, «Céramiques post-médiévales
découvertes à Paris de 1840 à 1920,collections du Musée Carnavalet,Paris », Bulletin du Groupe derecherche et d’étude de la céramiquedu Beauvaisis, n° 7, p. 7-83.
CHAPELOT J.1975, Potiers de Saintonge. Huit siècles
d’artisanat rural, Catalogue d’expo-sition, Paris, éd. Musées nationaux,127 p.
CHEVALIER B.1982, Les bonnes villes de France, du XIVe
au XVIe siècle, Paris, Aubier, 345 p.
CLAUDE C.2005, «Un lot de céramiques médiévales
inédites découvertes sur le site del’Auberge du Château à Dourdan»,dans Archéologie en Essonne, Actes de lajournée archéologique de Saint-Pierre-du-Perray, 13 octobre 2001, Évry,Conseil général de l’Essonne, p. 91-95.
COYECQUE E.1905, Recueil d’actes notariés relatifs à
l’histoire de Paris et de ses environs auXVIe siècle, Paris, Imprimerienationale, 2 vol.
DUFAŸ B.1998, « La croissance d’une ville : les
tuileries parisiennes du faubourgSaint-Honoré », dans VAN OSSEL P.(dir.), Les Jardins du Carrousel
(Paris). De la campagne à la ville : laformation d’un espace urbain, DAFn° 73, Paris, MSH, p. 261-310.
FAVIER J.1975, Le commerce fluvial dans la région
parisienne au XVe siècle. I - Le registredes compagnies françaises (1449-1467), Paris, Imprimerie nationale,367 p.
FURETIÈRE A.1701, Dictionnaire universel, contenant
généralement tous les mots françoistant vieux que modernes et les termesdes sciences et des arts, secondeédition revue, par Basnage deBauval, 3 vol., La Haye etRotterdam, A. et R. Leers. [Gallica :http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30470957z]
FRANCE A.1880, «Les œuvres de Bernard Palissy »,
dans Œuvres complètes de BernardPalissy, [Texte imprimé] publiéesd’après les textes originaux, Paris,Charavy frères, 499 p.
GAY V. et STEIN H.1883-1928, Glossaire archéologique du
Moyen Âge et de la Renaissance, Paris,Librairie de la Société bibliographique.
GOUZOUGUEC S.2009, «L’artisanat de la terre cuite
architecturale en Île-de-France (XIIIe-XVe siècle) : l’apport des sources écrites»,dans CHAPELOT J. et O. et RIETH B.(éd.), Terres cuites architecturales médié-vales et modernes en Île-de-France et dansles régions voisines, Caen, Publicationsdu CRAHM, p. 5-20.
GRODECKI C.1986, Documents du Minutier central des
notaires de Paris. Histoire de l’art auXVIe s. (1540-1600), Paris, impri-merie nationale.
FABIENNE RAVOIRE120
À propo[t]s de l’usage, de la production et de la circulation des terres cuites…, p. 107-121
Bibliographie
GUADAGNIN R.2000, Fosses – Vallée de l’Ysieux. Mille
ans de production céramique en Île-de-France, volume 1, Les donnéesarchéologiques et historiques, Caen,Publications du CRAHM, 368 p.
2007, Fosses – Vallée de l’Ysieux. Mille ans deproduction céramique en Île-de-France,volume 2, Catalogue typo-chronologiquedes productions, Caen, Publications duCRAHM, 735 p.
LACOMBE C.1992, «Le cahier de compte de livraison de
bois de Jean Babut, faïencier à Bergerac(1767-1775), Analyse et commen-taires», Documents d’archéologie etd’histoire périgourdines, t. 7, p. 85-104.
LA MARE N. DE
1705, Traité de la police, 1707-1738,4 vol., Livre IV, titre II, Paris, Jean etPierre Cot, p. 541-543.
LESPINASSE R. DE
1886, Les Métiers et corporations de laville de Paris, XIVe-XVIIIe siècle, Paris,Imprimerie nationale, 420 p.
LESPINASSE R. DE et BONNARDOT F.1879, Les métiers et corporations de la
ville de Paris, XIIIe siècle. Le livre desmétiers d’Étienne Boileau, Paris,Imprimerie nationale, 423 p.
MEYER-RODRIGUES N. et SMIRNOFF H.1992, «Fouilles de Saint-Denis », dans
Plaisirs et manières de table aux XIVe etXVe siècles, Catalogue d’exposition,Toulouse (Musée des Augustins),Imprimerie du Sud, p. 343-344.
MUNIER P.1949, «Contribution à l’étude des
céramiques de Bernard Palissy : la grottedes Tuileries», Bulletin de la Sociétéfrançaise de céramique, n° 3, 22 p.
NICOURT J.1974, « Productions médiévales des
potiers de terres parisiens », Archéo-logia, n° 7, p. 117-130.
1986, Céramiques médiévales parisiennes.Classification et typologie, Ermont,Jeunesse préhistorique et géologiquede France, 366 p.
PALISSY B.1989 (1580), De l’art de terre, de son
utilité, des esmaux et du feu, Caen,L’Échoppe, 55 p.
PLINVAL DE GUILLEBON R.2002, « Les céramistes du faubourg
Saint-Antoine avant 1750. Fabri-cation et commerce. Le point desrecherches en 2002», Bulletin de laSociété de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 129e année, p. 1-68.
RAVOIRE F.1997, «La vaisselle de terre cuite en Île-
de-France entre la fin du XVe siècle etla première moitié du XVIIe siècle.Définition d’un faciès régional »,thèse de doctorat nouveau régime,sous la direction du professeurL. Pressouyre, Paris, Université deParis 1 Panthéon-Sorbonne, 960 p.,4 vol. (dactyl.).
2000, « Aperçu sur l’artisanat de lapoterie de terre en Île-de-Franceentre le XIIIe et le XVIIe siècle », dansUtilis est lapis in structura, Mélangesofferts à Léon Pressouyre, Paris,Éditions du Comité des travauxhistoriques et scientifiques, p. 447-460.
2008, « Étude d’un ensemble decéramiques du XVIe siècle provenantd’un dépotoir domestique à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) », Revuearchéologique d’Île-de-France, n° 1,p. 379-396.
2010, « Esquisse d’une cartographie dela poterie de terre sur la rive droitede la Seine (XIIIe-XVIIe siècles) », dans« Si Paris m’était cartographié…»,journée d’étude du 14 février 2008aux Archives nationales,http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/carto-poterie-seine.pdf
RAVOIRE F. et BOUQUILLON A., avec laparticipation de DUFOURNIER D.
2004, «La poterie en terre cuite en Île-de-France (XVe-XVIe siècle) :production et diffusion», TECHNÈ,n° 20 (Terres cuites de la Renais-sance), p. 53-60.
RÉGALDO-SAINT-BLANCARD P.1986, «Les potiers et les intempéries : les
structures de production céramiquede l’Entre-Deux-Mer à la fin duMoyen Âge », Aquitania, 4, p. 173-181.
SAVARY DES BRUSLONS J.1741,Dictionnaire universel du commerce,
Paris, Veuve Estienne, t. III, p. 975-978.
SCHWEITZ D.1981, « L’artisanat céramique dans le
Centre à la fin du Moyen Âge »,Revue archéologique du centre de laFrance, n° 20, p. 63-88.
THILLAY A.2002, Le faubourg Saint-Antoine et ses
« faux-ouvriers ». La liberté du travailà Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris,Champ Vallon, 401 p.
THOMAS N.2009, «Les ateliers urbains de travail du
cuivre et de ses alliages au bas MoyenÂge : Archéologie et histoire d’unsite parisien du XIVe siècle dans laVilleneuve du Temple (1325-1350) », thèse de l’université Paris IPanthéon-Sorbonne, 4 vol., 974 p.et 285 p.
WOLF P.1985, «L’approvisionnement des villes
françaises au Moyen Âge », dansL’Approvisionnement des villes del’Europe occidentale au Moyen Âge etaux Temps modernes, cinquièmejournée internationale d’histoire, 16-18 septembre 1983, Auch, Centreculturel de l’abbaye de Flaran, n° 5,p. 11-31.
LA PRODUCTION DE POTERIE DE TERRE À PARIS (XIIIe-XVIe SIÈCLE) À TRAVERS LES SOURCES ÉCRITES 121
Publications du CRAHM, 2011