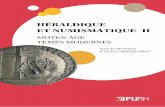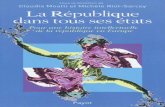"L’héraldique dans les sceaux du clergé séculier portugais (XIIIe-XVe siècles)"
UNE RESIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIECLE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of UNE RESIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIECLE
En 1852, lors des grands travauxqui remodelèrent le quartier duPalais des Thermes (actuel hôtelde Cluny), bientôt suivis par le
percement de la rue des Écoles (1852-1855), on dégagea à l’angle de la rue desMathurins et des rues des Maçons etCoupe-Gueule, ce qu’il restait des bâtimentsd’une grande demeure gothique, notam-ment les deux pignons est et ouest. Cesvestiges furent très rapidement détruits 1.Pourtant, les archéologues et les historiensqui suivaient les transformations de Paris,après les avoir avec beaucoup de justessedatés de la fin du XIIIe siècle, les avaientimmédiatement identifiés comme des par-ties de l’hôtel d’Harcourt 2, dont le souve-nir était resté attaché à ces lieux. Sauvalnotait dès le XVIIIe siècle que « Les comtesd’Harcourt ont eu près de deux cents ans àla rue des Mathurins, au coin de celle desMaçons, un grand et vieux logis, accom-pagné d’un jardin assez spacieux, qu’onappelait l’Hôtel d’Harcourt » 3.
Cette destruction fut d’autant plusregrettable que les parties retrouvées étaientd’une ampleur considérable et que leur étatde conservation était très remarquable.Pour autant, on ne se soucia pas alors ducaractère spécial de l’édifice, unique repré-sentant connu, datant de la fin du XIIIe
siècle, des résidences aristocratiques pari-siennes, un type de programme très impor-tant depuis que l’affermissement de lamonarchie capétienne avait assis le rôle deParis comme capitale. Sans être à propre-ment parlé négligé, le monument ne retintpas vraiment l’attention : il fut certes citépar Albert Lenoir dans un « Rapport… sur
les découvertes produites par les récentstravaux de construction et les percementsde rues nouvelles… », présenté devant leComité de la langue, de l’histoire et des artsde la France en 1852, mais parmi denombreux autres bâtiments 4 ; en revanche,il ne fut pas publié dans la Statistiquemonumentale de Paris, bien que Lenoir yeût songé 5. Une génération plus tard,Fédor Hoffbauer lui consacra quelqueslignes et un dessin, sans oublier de le repé-rer sur un de ses plans de restitution 6. Leshistoriens de la Topographie Historique duVieux Paris, quant à eux, ne manquèrentpas de signaler son emplacement en esquis-sant un court historique et en risquant unedéfinition de son emprise 7. Aucun auteur,donc, ne se détermina à présenter les bâti-ments découverts et à les situer dans lepanorama de la demeure aristocratiqueparisienne du Moyen Âge.
Une des causes de ce manque d’intérêtfut peut-être la mauvaise interprétationproposée pour le bâtiment principal parAlbert Lenoir. À la différence de ThéodoreVacquer qui se borna à évoquer « l’hôteld’Harcourt », mais ne publia rien, Lenoir,reprenant les informations de Jaillot, y vitune chapelle 8 ; or le grand nombre d’édi-fices religieux condamnés par les travauxen cours n’incitait pas à porter une atten-tion particulière à une chapelle supplé-mentaire. Il fut suivi par Hoffbauer,pourtant seul auteur à avoir publié une vueinterprétée d’une des façades de l’hôtel 9.
Au total, le sort réservé à la mémoire del’hôtel d’Harcourt ne différa guère de celuiqui fut fait aux autres demeures pari-siennes, nobles et princières aussi bien que
bourgeoises. En cela, il fut expressif de ladéshérence dans laquelle est restée depuisla fin du XIXe siècle l’étude de l’architecturedomestique de la capitale du royaume deFrance durant le Moyen Âge 10. L’expo -sition sur le temps de Philippe le Bel nelui a naguère prêté aucune attention et lesseules recherches la concernant ont été desétudes de topographie historique 11.
Une récente publication de l’InstitutNational d’Histoire de l’Art (INHA) acependant attiré l’attention sur AlbertLenoir et sur le fonds de dessins qui porteson nom 12, en révélant les planchesinédites réalisées sur l’hôtel d’Harcourt parThéodore Vacquer, faisant renaître unecuriosité pour l’édifice 13. À l’issue d’unequête dans les fonds parisiens, la docu-mentation rassemblée autorise en effet uneapproche précise du monument et permetde dresser le portrait unique d’une rési-dence aristocratique du dernier tiers duXIIIe siècle.
ÉTAT DE LA DOCUMENTATION
L’hôtel occupait toute la tête d’un îlotétroit, d’axe nord-sud, dont le sommet etpetit-côté donnait sur la rue des Mathurins(actuelle rue du Sommerard) ; il était bordéà l’ouest par la rue des Maçons (actuellerue Champollion) et à l’est par la rueCoupe-Gueule, qui a disparu. Plusieursplans représentent le quartier avant et aprèsles grands travaux du milieu du siècle, avecsurimposition des nouvelles rues, tels leplan d’E. Morieu (fig. 1), ou celui de Fédor
127
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS
UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE
LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
Pierre Garrigou Grandchamp
Bulletin Monumental Tome 167-2 • 2009
Hoffbauer 14. Il se dressait donc juste ausud du « Palais des Thermes », installé surles ruines des thermes romains, plus tardannexés par les abbés de Cluny et inclusdans leur hôtel, qui a survécu (place PaulPainlevé). À son emplacement se trouveun petit îlot complètement reconstruit auXIXe siècle, défini par la rue du Sommerardau nord, la rue des Écoles au sud, la placePaul Painlevé à l’est et le boulevardSaint-Michel à l’ouest.
Les informations recueillies sont detrois ordres. L’architecture de l’édifice està peu près exclusivement documentée parles dessins des fonds de la BibliothèqueHistorique de la Ville de Paris (BHVP) etde l’Institut national d’histoire de l’art(INHA). Les informations topographi-ques sont fournies par les représentationsanciennes de Paris et par la cartographie
historique élaborée par les chercheurs duXIXe siècle. Les sources historiques sont plusrestreintes et plus éparses 15 ; elles deman-dent la prise en compte des ouvrages ayanttraité des circonscriptions parisiennes, dudomaine de la ville de Paris et de la fiscalité.Il sera également fait appel aux ressourcesde l’héraldique pour tenter d’identifier lescommanditaires de la construction.
L’architecture de l’hôtel d’Harcourt
L’architecture nous est connue auxtravers des dessins de Théodore Vacquer etd’Albert Lenoir, ainsi que par deux repré-sentations de seconde main. La documen-tation figurée la plus abondante est l’œuvredu premier. L’architecte archéologue suivitla découverte des vestiges de l’hôtel
d’Harcourt et exécuta trois types de docu-ments : des dessins pris sur le terrain,presque toujours au crayon ; des restitu-tions partielles, manifestement tracées surla table à dessin, le plus souvent à l’encre,relevés de lavis ou mises en couleurs àl’aquarelle ; des planches de restitutionachevées, sur calque ou sur papier, à l’encreet mises en couleurs. Hormis les planchesen couleurs sur papier, tous ces documentssont conservés à la BHVP 16. Pour ce quiest du grand corps de logis nord, ils rensei-gnent exclusivement sur ses façades laté-rales occidentale et orientale, les façadessud et nord ayant été complètement trans-formées à partir des temps modernes. Ence qui concerne les ailes perpendiculaires àce grand bâtiment, seule une partie de lafaçade qui regardait la rue Coupe-Gueuleest documentée, sur près de 8 m de long ;l’aile symétrique, sur la rue des Maçons,était trop transformée et ne livra aucunvestige médiéval substantiel.
Au cours des visites qu’il fit sur leslieux, l’archéologue exécuta sur des petitscarnets un très grand nombre de dessinsplus ou moins aboutis, cotés ou non : descroquis approximatifs, mais évocateurs,souvent cotés (fig. 14), y côtoient des éléva-tions précises de certaines parties, tel unangle du logis (fig. 13) ou bien des profilsrelevés avec soin. Tous les dessins de cettemultitude ne sont pas précisément réfé-rencés et l’identification de certains détailsest parfois malaisée. Cependant, ThéodoreVacquer revint souvent sur les mêmesparties, ce qui facilite les rapprochements.Les restitutions partielles concernentd’abord les fenêtres à réseau des étages pourles murs pignons, objets de tous les soins(fig. 17), puis les pignons eux-mêmes,en particulier leur couronnement avecmerlons, échauguettes et roses (fig. 11). Ony décèle un souci d’exactitude et on peutsuivre les hésitations. Comme la critiqued’authenticité des restitutions finales lemontrera, ce sont moins ces parties que lesailes latérales qui posèrent les questions lesplus difficiles à résoudre, en raison de leurmauvais état de conservation.
Les restitutions finales en couleurs sontprésentées sur une grande planche de
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
128
Fig. 1 : Paris, plan de situation avec surimposition des rues actuelles sur la topographie du milieu duXIXe siècle : le cercle indique la position de l’hôtel d’Harcourt ; IX : collège d’Harcourt ; X : collègede Cluny ; XV : hôtel de Cluny ; 15 : rue des Mathurins (plan E. Morieu).
dessins sur papier calque (BHVP, ms. 251)et sur quatre planches de dessins aquarelléssur papier (INHA). La première livre, pourla façade orientale, l’état le plus accomplides restitutions dont l’auteur est certain(fig. 2), puis une proposition de complé-ment pour le couronnement du pignonet pour la toiture de l’aile qui fait suite :c’est cette dernière version qui sera reprisesur la planche en papier (fig. 3). Les quatreautres planches donnent des détails quireprennent, pour l’essentiel, les restitutionspartielles évoquées ci-dessus (fig. 20, 21,22, 28, 29, 31 et 32).
Albert Lenoir est le seul à nous rensei-gner sur une grande salle voûtée, située ausud des vestiges précédents. Manifestementpour tout ou partie enterrée, celle-ci devaitfonctionner comme une cave. Il en donnaun croquis de plan coté, pris sur le terrain,et une version mise au net, à l’encre ; aucund’eux n’est daté (fig. 33 et 34). Ce sont lesseuls dessins que cet auteur consacra àl’hôtel d’Harcourt et, curieusement, cettepartie est apparemment ignorée parThéodore Vacquer qui ni ne la dessina nine la mentionna. Elle fut en revanchesoigneusement indiquée dans l’emprise de
l’hôtel sur les cartes historiques deHoffbauer et Berty, qui seront évoquéesci-dessous (fig. 8).
Deux dessins de seconde main sontégalement connus. Le premier, représenteles façades sur la rue Coupe-Gueule, vuesde trois-quarts depuis la gauche / le sud(fig. 35) 17. Publié par Fédor Hoffbauer, ilest signé P. Benoît, « d’après Lenoir », réfé-rence difficile à interpréter en toute certi-tude : il est probable que l’auteur ait vu lesplanches de Théodore Vacquer, en posses-sion d’Albert Lenoir, plutôt que d’hypo-thétiques dessins de ce dernier, aujourd’huiinconnus ; la fidélité à la planche restitu-tive donnant l’élévation sur la rue Coupe-Gueule prouve la validité de la premièrehypothèse. Le second est une eau-fortesignée R.M. et intitulée « Restes de l’ancienhôtel d’Harcourt, rue Coupe Gueule » ;selon Alfred Bonnardot l’auteur serait undénommé Martial et le dessin datable« vers 1850 » 18.
Topographie de l’hôtel d’Harcourt
Les informations topographiques sontà rechercher à la fois dans les représenta-tions anciennes de Paris, qui livrent desvues de l’îlot, à vol d’oiseau ou en plan, etdans les cartes historiques élaborées parles historiens de Paris au XIXe siècle : cesdernières proposent une synthèse desdonnées archéologiques et des renseigne-ments fournis par les sources écrites.
Les plans à vol d’oiseau de Paris semultiplièrent à partir du milieu du XVIe
siècle 19. Or, il est remarquable que presquetous les premiers plans donnent unereprésentation très évocatrice de l’hôteld’Harcourt. Il est d’autant plus étonnantque les historiens de la TopographieHistorique du Vieux Paris (THVP), qui ontpris soin d’en reproduire un grand nombreen tête du volume consacré à La partiecentrale de l’Université, aient complètementignoré cette source documentaire, qu’ilspassent sous silence dans les pages surl’hôtel 20. Il serait fastidieux de décrire endétail tous les plans à vol d’oiseau. Nousnous attarderons néanmoins sur quatre
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
129
Fig. 2 - Restitution de l’élévation des façades sur la rue Coupe-Gueule, avec plan des trois niveaux,du rez-de-chaussée du logis nord et coupe du pignon (dessin préparatoire de Th. Vacquer, BHVP, ms.251, n° 131 r°).
Cl. Bodet.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
130
d’entre eux, qui présentent les vues les plusprécises : toutes sont prises depuis l’ouest etreprésentent donc l’édifice sous le mêmeangle. Elles informent sur les façades occi-dentales, rue des Maçons, mais aussi sur lesannexes de l’hôtel bâties au sud, c’est-à-diredisposées à droite sur les plans.
Bien qu’il soit très schématique, le plande Truschet et Hoyau (1552) [fig. 4] four-nit deux informations qui seront corrobo-rées par les représentations postérieures : lebâtiment qui occupe la tête nord de l’îleprésente à l’ouest un pignon sur la rue,cantonné d’une échauguette à l’angle nord-ouest, formé avec la rue des Mathurins ; enoutre, une cour et un pourpris, attribuablesà l’hôtel, s’étendent vers le sud sur uneprofondeur imprécise, mais considérable.
Le plan de Saint-Victor (1550 à1555) [fig. 5] tire ses informations d’unplan original, dit « plan premier », perdu,datable des années 1523-1530, et qu’il fautvraisemblablement attribuer à l’atelier deDu Cerceau 21. Il est à la fois plus précis etplus complet : la tête de l’île y est égale-ment occupée par un grand bâtiment d’axeest-ouest, dont le pignon occidental est
Fig. 4 - Détail du plan de Truschet et Hoyau, 1552 : « hôtel Harocourt ». Le nord est à gauche.
Fig. 3 - Restitution de l’élévation des façades sur la rue Coupe-Gueule, avec coupe du pignon(dessin final de Th. Vacquer, INHA, Fonds Lenoir, Boîte IV : Édifices civils et militaires,cote OA 716).
Cl. Yvrande.
Cl. Bodet.
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
131
Fig. 5 - Détail du plan de Saint-Victor, 1550-1555 : « L de Hercour ». Le nord est à gauche.
Fig. 6 - Détail du plan de Braun et Hogenberg, 1572. Le nord est à gauche.
Cl. Yvrande.
Cl. Yvrande.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
132
cantonné de deux échauguettes, reliées parun dispositif, galerie ou chemin de ronde.En outre, au-delà de la cour qui s’étend ausud de ce premier bâtiment, se dresse unautre ensemble qui paraît faire partie del’hôtel 22 : il est composé d’une tour, deplan carré et coiffée d’un toit à quatre pans,puis d’un corps de logis à étage(s), présen-tant un pignon sur rue et d’axe parallèle aupremier. Au-delà on distingue un jardin,clos au sud par un mur, lui aussi parallèleaux corps de logis.
La représentation sur le plan de laTapisserie (vers 1555) est des plus som-maires. En revanche, le plan de Braun etHogenberg (1572) [fig. 6] confirme cesinformations : en tête de l’île, au nord, onretrouve le bâtiment à pignon cantonné dedeux échauguettes, suivi d’une cour au sud,puis d’une haute tour adossée à un longcorps d’axe est-ouest et enfin d’un jardin.
Bien qu’il soit un peu moins précis, leplan de Belleforest (1575) [fig. 7] fournitles mêmes données : le bâtiment en tête del’île offre un pignon pourvu d’échau-guettes ; dans la profondeur s’étagent versle sud les mêmes composantes, mais la toura disparu.
Au total c’est donc le plan dont lesinformations sont les plus anciennes, celuide Saint-Victor, qui est le plus précis. Onnotera en revanche que l’hôtel n’apparaîtplus au XVIIe siècle, dès les plans de Quesnel(1609 ; la tête de l’île est occupée par ungrand bâtiment d’axe est-ouest, dépourvud’échauguettes), de Mérian (1615) et deGomboust (1658). Il est a fortiori absentdu dernier plan à vol d’oiseau, celui deTurgot (1735) : le bâtiment a disparu,engoncé dans plusieurs maisons. Quantaux plans stricto sensu, qui ne donnent quela planimétrie et / ou le parcellaire, onobserve sur le plan de Delagrive (1728)une tête d’îlot divisée en plusieurs parcelleset, sur le plan de Verniquet (1793-1799),une absence totale d’indications. À la veillede la découverte des vestiges de l’hôtel,l’Atlas général des 48 quartiers de la ville deParis de Vasserot et Bellanger (1827-1836)attestait que son emplacement était occupépar des maisons qui portaient les nos 9 à 17sur la feuille 148.
Les plans historiques publiés proposentdiverses interprétations de la topographiedu quartier du palais des Thermes. L’hôtel
d’Harcourt n’est pas porté sur le Plan deParis sous Philippe le Bel établi par AlbertLenoir en 1837, et pour cause, ses vestigesétant encore inconnus. Il est plus curieuxqu’il n’apparaisse pas sur le Plan de Paris en1380 par Henri Legrand (1868). Il sera enrevanche par deux fois précisément localisésur deux plans établis à la fin du XIXe siècle,le premier par Fédor Hoffbauer (1880) 23,le second à partir des recherches d’AdolpheBerty et de Théodore Vacquer, publiées en1906 seulement 24.
Le plan de Fédor Hoffbauer indique àla lettre E une propriété composée d’uncorps de logis rectangulaire en tête d’île aunord et un second corps au sud, parallèleau premier et affrontant la rue des Maçons,mais ne traversant pas jusqu’à la rueCoupe-Gueule ; il correspond à la grandecave voûtée dessinée par Albert Lenoir.Ce plan ignore les deux ailes qui, depuisle grand corps de logis nord, s’étiraientle long des rues Coupe-Gueule et desMaçons. Il a le mérite de superposer letracé des rues vers 1850 et le tracé actuelde la voirie.
La planche XIV du Plan archéologiquede Paris du XIIIe jusqu’au XVIIe siècle propose
Cl. Yvrande.
Fig. 7 - Détail du plan de Belleforest, 1575. Le nord est à gauche.
un plan beaucoup plus complet : la tota-lité du pourtour de l’édifice occupant latête de l’île est indiquée, mais aussi ledépart des deux ailes qui longeaient respec-tivement la rue des Maçons et la rueCoupe-Gueule, l’ensemble formant un U,ouvert vers une cour au sud, que ferme le« bâtiment de la cave » (fig. 8). La cave decinq travées est accessible à son extrémiténord-ouest par un escalier situé dans lacour, perpendiculaire au bâtiment, et ausud-ouest par un autre escalier : ce dernierest une preuve complémentaire de l’appar-tenance à l’hôtel de l’espace non bâti ausud. De fait, la délimitation proposée desdépendances et du pourpris de l’hôtel lesétend vers le sud jusqu’au parallèle de lalimite sud du collège de Narbonne, soitpresque à mi chemin entre la rue desMathurins et la rive nord de la place de laSorbonne actuelle. Cette emprise n’a pu sedéduire de vestiges bâtis, mais fut détermi-née à partir de l’examen des titres concer-nant les propriétés voisines.
Les informations fournies par les planshistoriques récents sont contrastées. Le Plande Paris à la fin du XIVe siècle publié en 2001ignore superbement l’hôtel d’Harcourt 25. Enrevanche, celui-ci est sommairement repérésur la carte des résidences aristocratiques quifigure dans l’Atlas de Paris au Moyen Âge 26.
L’emprise de l’hôtel se composait doncde plusieurs corps de logis, séparés par desespaces non bâtis, dont l’étendue exactene peut se déduire de ces plans. Elle a enrevanche été évaluée par les historiens, àpartir des sources écrites documentant l’en-semble des propriétés qui se partageaient lequartier.
Sources historiques sur l’hôtel d’Harcourt
Les sources historiques sont comptées,en particulier pour le XIIIe siècle et mêmepour la fin du Moyen Âge. C’est encore la
THVP qui en donna le résumé le pluscomplet, sinon le plus convainquant entous points, mais elle doit être complétéepar de nombreuses sources 27.
Pour les auteurs de la THVP, l’hôteld’Harcourt était un édifice seigneurialde vastes proportions et possédant unechapelle. On en constate l’existence dès lafin du XIIIe siècle, dans le Livre de la Taillede 1297 28. Ils prétendent aussi que lafamille d’Harcourt n’aurait pas faitconstruire ce manoir, mais on ne sait surquelle source ils se fondent pour l’affirmer.Sans doute ont-ils accordé crédit aux obser-vations héraldiques d’Albert Lenoir : « …aux peintures retrouvées à l’intérieur semêlaient des armoiries autres que celles dela famille d’Harcourt, qui n’aurait possédél’hôtel que de seconde main » 29. On verraque cette interprétation est contestable,alors que l’archéologue avait remarquéavec justesse que « l’écu de forme ancienneest du XIIIe siècle ». On en trouve en faitune attestation plus précoce, antérieure dequelques années à celle du Livre de la taillede 1297. L’hôtel s’élevait en effet sur lacensive de la Ville de Paris, comme leprouve une mention dans le Livre dessentences du parloir aux bourgeois, années1268-1325, plus précisément dans l’« Étatdes rentes et revenus du Parloir aux bour-geois de février 1292 », au paragraphe Laporte d’Enfer en descendant au Palais deTermes, et du Palais tout contreval jusqu’aubout de la rue du Serpent : « Le sire deHerecourt, VI deniers et oboles à la seintRemi » 30. À en croire Sauval, l’hôtel restapendant deux siècles dans la famille 31 ; unde ses membres y résidait encore en 1371,une source, non citée, évoquant « lamaison du comte d’Harcourt, devant lepalais des Thermes » 32.
L’hôtel paraît avoir été en mauvais étatà la fin du XVe siècle : un compte desrecettes de la commanderie du Temple deParis pour l’année 1499-1500 évoque eneffet, dans la rue des Maçons, l’hôteld’Harcourt « lequel est de present enmasure » 33. Peu après des travaux y furentconduits, afin de redonner de l’éclat à sonjardin : une minute de 1522 rapporte unmarché passé entre noble Jean Bauldry,d’une part, et Jean Larchier et Guillaume
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
133
Cl. Yvrande.
Fig. 8 - Détail du Plan archéologique de Paris…, par Berty, 1906, pl. XIV.
Le Forestier, charpentiers de la grandecognée à Paris, d’autre part, pour faire tousles appuis autour du jardin de l’hôteld’Harcourt que possède le premier, au coindes rues des Maçons et du palais duTherme, avec deux autres allées au traversdu jardin, comportant sablières et piliersaussi durs ( ?) que les piliers de pierre detaille qui sont audit jardin, avec décor de« pommes rondes ou boullons » et avecdouze guichets enchassillés, à faire avantla Trinité, et ce moyennant 66 l.t. pourmatériau et peine d’ouvrier 34. Ce dernierdocument témoigne d’une mutation depropriété, au moins partielle, ainsi que del’étendue du jardin, tout en documentantdes aménagements qu’il serait hasardeux defaire remonter au XIIIe siècle.
Des Harcourt, tout ou partie des droitssur la propriété passa par alliance auxLorraine 35, puisque le fief de Lorraine étaitattesté en 1547 : « Jehan Bonhom, l’un desquatre libraires jurés de l’Université […]propriétaire d’une maison rue du Palais duTerme, appelée maison de la Caige […]tenant d’une part à l’hôtel des Carmeaux[…] à l’hôtel d’Harcourt, fief de Lorraine,appartenant de présent à Me Gilles Magny,avocat du Roy […] et à l’hôtel d’EstrilleFauveau » 36. Dès les premières décenniesdu XVIe siècle, la densification du tissu bâticonduisit à des empiètements et les pro -priétaires durent réagir pour sauvegarderleurs droits : en 1547, les minutes d’unprocès citent les « esgousts, gargouilles,contre-piliers, taillus et vuidanges » del’hôtel, qui doivent être dégagés des bâti-ments qui se sont adossés à lui 37. Il étaitentre les mains des Le Mestre au plus tarden 1574 38.
Depuis le début du XVIIe siècle aumoins, la demeure était très morcelée, bienque la propriété éminente restât toujoursà la Ville de Paris : en 1677, sept maisonsoccupaient effectivement son emplace-ment. Cependant, A. des Cilleuls note que,rue des Mathurins, deux maisons tenantà la ruelle Coupe-Gueule occupaient unepartie de l’ancien Hôtel d’Harcourt(première inscription sur le Terrier de1603 ; dernière inscription sur le Terrierde 1767) et que, rue des Maçons, cinqmaisons contiguës tenant, par derrière, à la
ruelle Coupe-Gueule, étaient égalementbâties sur une partie de l’ancien Hôteld’Harcourt (première inscription sur leTerrier de 1603). Or, ces sept maisons n’enétaient pas moins solidairement tenuesd’un cens de 6 deniers 1 obole parisisenvers la ville, comme composant tout l’em-placement de l’ancien hôtel d’Harcourt 39.De même, le Plan des fiefs du Parloir auxBourgeois et Franc-Rosier, retraçant en 1767l’emprise de la seigneurie appartenant à laVille, prouve la pérennité de la propriétédu sol 40 : un Le Mestre possédait unepartie de l’ancien hôtel en 1724 et lafamille resta ici possessionnée pendant laplus grande partie du XVIIIe siècle, ce queconfirme le Plan des fiefs du Parloir auxBourgeois… en 1767. À la veille de ladécouverte du bâtiment nord, son empla-cement était occupé par les maisons nos 9 à17 de la rue des Mathurins 41.
Sans être abondante, la documentationest importante, mais n’apporte guère dedonnées précises sur les origines, la date dela construction et l’identité du commandi-taire.
On ne peut en dire autant des vestigesmatériels. En dépit de la qualité des réseauxdes baies, et plus encore des corbeauxsculptés de personnages ou d’animaux, quiarboraient encore leur polychromie, ilsemble qu’aucune pièce de sculpture n’aitété déposée et soit conservée, dans unecollection publique. Il est avéré que lesfonds lapidaires du Musée Carnavalet n’ensont pas dépositaires 42.
Au total, l’ensemble de ces donnéesétablit de façon indubitable l’existenced’un hôtel des seigneurs de Harcourt,depuis la dernière décennie du XIIIe siècleau moins, en tête de l’îlot où furent décou-verts en 1852 les vestiges de grandsédifices. La famille l’occupa encore aumoins un siècle et sa mémoire ne se perditpas lorsqu’elle céda la place. Quoi qu’en aitdit Albert Lenoir, la présence des sires deHarcourt dans les bâtiments composantcet hôtel est établie avec certitude parl’existence de blasons de la famille, quiseront étudiés ultérieurement, lorsqueseront formées des hypothèses sur l’iden-tité des constructeurs. Par ailleurs, les plansdéfinissent son emprise et les dessins
effectués en 1852 renseignent sur deux deses façades. Ces informations autorisentune étude approfondie de la résidence pari-sienne des sires de Harcourt. Elle supposenéanmoins au préalable une analysearchéologique incluant une critique dessources graphiques, qui fonderont uneappréciation du programme et son évalua-tion dans le cadre de l’architecture pari-sienne et de l’habitat urbain seigneurialdu nord de la France. Enfin un affinementdes données historiques, nourrira un essaid’identification du commanditaire et dedescription du milieu auquel il appartient.
ANALYSE CRITIQUE DES RELEVÉS
En l’absence totale d’informations surles façades nord (rue des Mathurins) et sud(cour) du bâtiment nord qui occupait latête de l’îlot, cette analyse ne portera quesur ses façades latérales et sur l’amorce del’aile qui le prolongeait, à l’est, le long de larue Coupe-Gueule. Elle se fondera presqueexclusivement sur les relevés de terrain etsur les dessins mis au propre, les auteursn’ayant pas livré de rapports écrits, ouceux-ci n’ayant pas été retrouvés.
Le corps de logis nord
Les relevés de détails et d’ensemble quefit Théodore Vacquer des murs pignons ducorps de logis nord attestent que la matièreconservée était très importante, en parti-culier à l’est, sur la rue Coupe-Gueule.La très grande conformité de ces deuxélévations à un même parti général permiten outre à l’archéologue de complétercertaines données manquantes sur une desfaçades par les informations recueillies surl’autre ; les mentions manuscrites portéessur la restitution partielle d’un pignon sonttrès éclairantes (fig. 9) : elles attribuentchacun des détails calé sur la structure dupignon à une des deux « rues ». Enrevanche, seules les amorces de la façadenord, rue des Mathurins, en retour d’an-gle, purent être repérées, ainsi qu’il appertdu plan au sol et de certains croquis dedétail (fig. 13). On peut en déduire que
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
134
l’alignement sur la rue des Mathurins étantprobablement resté inchangé, les nouveauxpercements opérés en grand nombredétruisirent les baies originelles. Enrevanche, les murs latéraux furent protégés,qu’ils soient demeurés visibles, en façadesur rue, cas vraisemblable si l’on en croitJaillot (ce pourrait être le cas à l’ouest,rue des Maçons), ou qu’un immeuble soitvenu s’accoler au pignon, réduisant, voirecondamnant la voie publique : ce cas defigure paraît avoir été celui de la rueCoupe-Gueule, à en juger par le plan deQuesnel (1609), confirmé par les plans deTurgot (1735) et de Delagrive (1757), alorsqu’une impasse apparaît toujours sur leplan de Jaillot (1774). Dans les deux circons-tances, on se contenta de murer la plupartdes baies, dont beaucoup se révélèrent
intactes lors de leur découverte. Les pignonseux-mêmes et leurs couronnements avaientété en revanche beaucoup plus affectéspar les nouveaux canons esthétiques de l’ar-chitecture classique : les tourelles échau-guettes furent supprimées dans le courantde la deuxième moitié du XVIe siècle, enmême temps probablement qu’étaientdémontés les garde-corps des galeries quiles reliaient l’une à l’autre et les rampantsdes pignons.
Les divers relevés de Théodore Vacquerinforment sur la matière conservée, mais ilsn’ont pas enregistré les percements opérésau cours du temps. L’auteur dessine ce qu’iljuge appartenir à la construction originelle,en prenant le parti d’attribuer toutes lesbaies et tous les membres architecturaux
médiévaux à celle-ci. Nous ne disposonsdonc pas d’informations sur la chronolo-gie relative des parties, ni sur les reprises demaçonneries : ces dernières sont dessinéesseulement quand elles sont jugées d’origineet à défaut sont omises. Ces dessins livrentdonc plus un état déjà interprété qu’uninstantané de l’état des murs au momentde la découverte. Pour autant, la sûreté desobservations permet d’accorder du créditau tri effectué par Théodore Vacquer. Seshésitations ne concernent guère que lesformes de certaines baies ; elles sont dévoi-lées par la pluralité des essais de restitution,dont il sera fait état dans l’analyse de détail.Pour bien suivre l’analyse, on se reportera àla fois aux restitutions partielles et à la resti-tution finale (fig. 2, 10 et 12).
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
135
Cl. Bodet. Cl. Bodet.
Fig. 9 - Restitution partielle d’un pignon, avec synthèse des donnéesfournies par les vestiges des deux pignons ; coin droit supérieur, esquissesau crayon du passage de la galerie dans le contrefort ; coin gauchesupérieur, esquisses des merlons (dessin à la plume, Th. Vacquer, 22 r°).
Fig. 10 - Restitution partielle du pignon est, rue Coupe-Gueule : élévationet coupe, avec parties réellement conservées du sommet et esquisse desfenêtres (dessin à la plume et au crayon, Th. Vacquer, 4 v°).
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
136
Le rez-de-chaussée de la façade est à murpignon, rue Coupe-Gueule, est peu docu-menté, mais il semble n’avoir posé aucunproblème (fig. 10) : les maçonneries enplace devaient être suffisamment complètespour autoriser d’emblée une esquisse dusocle, de la base des contreforts et desangles, qui ne variera pas, comme on leconstate sur une des premières restitutionspartielles (fig. 16) et aussi sur la restitutionfinale (fig. 2). Les baies à croisée de cemême niveau ne sont connues que par desrelevés partiels (16 r°) : ils sont insuffisantspour en tracer le contour et pour définir laforme de l’appui intérieur, tels qu’ils appa-raissent sur la restitution finale ; celle-ci adû se fonder sur des relevés qui ne se sontpas conservés. Eu égard aux informationsdisponibles, on pourrait se demander si laseconde fenêtre à croisée, à droite / nord,survivait, au moins en partie, ou si elle aété restituée par symétrie : au vu de sonrendu sur le dessin final, avec les compar-timents bas murés, la première hypothèseest la plus vraisemblable.
À l’étage, en revanche, la situation estbeaucoup plus assurée, car les relevésexhaustifs d’une fenêtre et des fragmentsde plans complètent les esquisses de l’élé-vation d’ensemble. Théodore Vacquer livrel’élévation extérieure de la fenêtre à réseau
gauche / sud (fig. 25) ; le dessin identifiela baie et informe sur le destin de savoisine : « Baie à gauche. Celle près del’angle était détruite ». Il faut cependantnuancer cette affirmation ; il semble queles réseaux de la fenêtre droite / nordavaient disparu, mais que l’embrasure étaitreconnaissable : sur un dessin à la plumedonnant un plan partiel de l’étage figurentles piédroits de cette fenêtre, à proximitédes restes de la tourelle campée à l’anglenord-est du bâtiment (16 v°). Toujours àce niveau, un autre plan partiel livre l’étatde la tourelle sud et le raccord du bâtimentnord avec l’aile qui le prolongeait vers lesud (39 v°). En revanche, l’état précis desvestiges des corps des tourelles n’est docu-menté que par des croquis (16 r°, profild’un culot) et illustré par le projet de resti-tution intermédiaire (fig. 10). Le bon étatde conservation de certaines parties del’élévation est également attesté par uncroquis qui illustre la superposition desfenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage,vues de l’intérieur, avec l’emplacement dessolives du plancher (fig. 38).
Le pignon lui-même, sinon son couron-nement, était incontestablement une partiebien conservée, qui est très documentée(fig. 10). De longs segments de la grandecorniche qui portait la galerie subsistaient
apparemment, ainsi que les parties sommi-tales des corps des tourelles échauguettesqui regardaient vers cette galerie, lesmorceaux en saillie ayant été dérasés 43.L’ensemble composé par le contrefort axialau sommet taluté (évidé d’un passage pourla galerie 44), par les deux grandes roses quil’encadraient et par les deux petites baiesbarlongues du sommet était, semble-t-il,presque intact. Des croquis cotés donnentl’élévation latérale et le plan du contrefortmédian entre la pointe du pignon et lepassage (40 r°), de nombreux détails decelui-ci (40 v°), la structure du « chaperonde la niche formant plafond sur le passage »(13 v°), ainsi que les profils des roses(13 r°, 38 r°) et la structure des petitesbaies barlongues (10 v°, 40 r°). Quant auxéchauguettes et aux portes entre lessommets de celles-ci, des vestiges significa-tifs en furent retrouvés et dessinés (13 r°,39 v°). Enfin, une restitution partielle
Fig. 11 - Rue Coupe-Gueule : restitutions partielles d’une tourelle échauguette et du garde-corps dela galerie, à la jonction avec l’aile sud (élévation et plan avec passage traversant de la galerie dans lavis) et d’une fenêtre de cette aile sud, en surimposition (dessin au crayon, Th. Vacquer, 12 v°).
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Fig. 12 - Restitution partielle du pignon ouest,rue des Maçons : élévation et coupe, avec partiesréellement conservées du sommet et indicationssur la charpente (dessin coté à la plume et aucrayon, Th. Vacquer, 5 v°).
137
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
figure l’élévation de la jonction du sommetde l’échauguette sud et des merlons, avecl’entrée de la galerie, représentée en plan(fig. 11) ; elle fut complétée par un détailde restitution du contrefort central et dugarde-corps merlonné (4 r°).
L’état de conservation de la façadeouest à mur pignon, sur la rue des Maçons(fig. 12), semble avoir été très comparable.Le rez-de-chaussée est mieux documenté, aumoins pour la partie basse : la configura-tion de l’angle des rues des Maçons et desMathurins, cantonné par deux contreforts,est assurée par un relevé en plan et en éléva-tion, qui indique également l’emplacementde la fenêtre à croisée nord (fig. 13). Il enest de même au-dessus grâce à un relevédu mur pignon et de l’angle, à hauteurdu plancher séparant le rez-de-chaussée del’étage (9 r°, coté). Les baies à croisée sontdessinées avec soin, bien que les renseigne-ments soient épars : des croquis donnent leplan d’un piédroit et la structure du raccor-dement avec une fenêtre à réseau et le plan-cher (9 r°) ; il indique par ailleurs quel’embrasure d’une baie à croisée était peinteen jaune. D’autres croquis documententles linteaux, de face et de profil (11 r°) ainsique les meneaux, renforcés d’une colombetriangulaire à l’arrière, et dont la face laté-rale porte des trous de grille espacés de14 cm (9 v°).
À l’étage, les jonctions entre les baies àréseau et les vestiges des tourelles sontdocumentées par deux plans (11 r°). Lesdeux fenêtres à réseau firent l’objet de
nombreux relevés cotés (11 v°, 21 r°, 39 r°),avec mise au net des élévations des facesextérieures, en couleurs (fig. 26 et 27) ou àla plume et au lavis pour la fenêtre dont larose possède des lobes en amande (fig. 17).Au-dessus, à en juger par de nombreuxcroquis, les vestiges de la galerie qui reliaitle sommet des deux échauguettes étaientnombreux sur cette façade. Plusieursrelevés donnent le profil de la cornichequi portait l’encorbellement de la galerie(22 v°), les raccords entre la galerie et leséchauguettes (40 v°), puis le plan et l’élé-vation du passage de cette galerie à traversle contrefort (fig. 14 et 15) : l’auteur prendsoin d’indiquer que l’écoulement des eauxavait été prévu vers la rue des Mathurins, cequi justifiera la restitution d’une gargouillesur le dessin final, détail qui est renduen trait fin sur la version achevée remiseà Albert Lenoir (fig. 2 : entre f et d). Undétail du sommet du contrefort axial et despetites baies barlongues est en outre précisépar un croquis (10 v°).
Au total, la restitution du parti généralde ces deux pignons n’était pas trop malai-sée et put se faire avec un bon degré deprécision, voire de certitude, comme ilapparaît pour les morceaux difficiles queconstituaient la galerie et les échauguettes :
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Fig. 13 - Angle nord-ouest des rues desMathurins et des Maçons : plan et détaild’élévation du rez-de-chaussée, avec positionde la croisée Cr (dessin coté au crayon,Th. Vacquer, 23 v°).
Fig. 14 - Rue des Maçons, détails du passagedans le contrefort central : I. élévation et coupesurimposées, sur le contour du contrefort (c) etdes roses (r); II. Plan du passage ; III. Coupes ducontrefort et de la corniche, à la base de lagalerie ; IV. Profil de la corniche (dessins aucrayon, Th. Vacquer, 22 v°).
c’est effectivement elles qui demandèrentle plus de recherches et les tâtonnementsde l’auteur se lisent dans les nombreuxdessins restitutifs partiels. À observer lepignon sud du grand bâtiment du collègede Cluny, qui sera évoqué ci-dessous auxfins de comparaison (fig. 36), on ne peutdouter qu’il ait fortement guidé les partis
de restitution de Théodore Vacquer, qui enfit d’ailleurs le relevé 45. Les restitutionsfinales des pignons de l’hôtel, sur papiercalque et sur papier (INHA), ne diffèrentque par quelques détails (fig. 2 et 3) : lapremière donne deux états des couronne-ments, avec ou sans restitution des toitures,des sommets des échauguettes et de la gale-
rie – chemin de ronde à la base du pignon,et du toit de l’aile latérale. Sur la version del’INHA, ces compléments sont portés enrouge, ce qui permet d’emblée d’apprécierles parties objets des restitutions les plusimportantes. En revanche, l’ordonnancegénérale et les dessins des baies sont stricte-ment identiques. Les plans du rez-de-chaussée, des divers niveaux du pignon et lacoupe sur celui-ci sont semblables.
Aile sud sur la rue Coupe-Gueule
Les ailes latérales perpendiculaires aucorps de logis nord, à murs goutterots enfaçades, étaient beaucoup plus perturbéesque les pignons. Seule celle qui regardaitla rue Coupe-Gueule conservait suffisam-ment d’éléments en place pour inciterThéodore Vacquer à en donner une éléva-tion, sur une longueur de 8 m (fig. 2 et 3).On en connaît peu de dessins préparatoireset certaine restitution partielle atteste deshésitations de l’auteur (fig. 16). L’étage yest percé de trois fenêtres géminées iden-tiques (au lieu de deux dans les versionsfinales) et deux partis s’affrontent pour leurcouvrement, réseau sous archivolte, iden-tique à celles des fenêtres du pignon, oubaies géminées barlongues redentées detrilobes, avec traverse ; Théodore Vacqueren risqua un essai précis, en surimposition,avant de renoncer à cette solution (fig. 11).La version finale tranchera en faveur d’untympan avec réseau en orbevoie, sans quel’auteur s’explique sur ce choix (fig. 3).
Une divergence plus grave se manifesteà propos de la deuxième fenêtre de l’étage,la plus au sud / à gauche : les élévationsd’ensemble représentent à tort une fenêtregéminée avec appui droit. Or, une éléva-tion de détail, avec plan et coupe (fig. 31),indique sans ambiguïté qu’elle étaitdépourvue d’allège et de coussièges, maisavait deux appuis talutés. Son arc intérieurbénéficiait en outre d’une exceptionnelledécoration sculptée et peinte : la modéna-ture refouillée composait un profil qui nese compare à aucun autre (21 v° et 36 r°).La précision de ces élévations, justifiée parla présence de décors peints, fait conclureque c’est l’élévation d’ensemble qui est
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
138
Fig. 15 - Rue des Maçons, détails du passage dans le contrefort central : coupe surimposée sur lecontrefort ; profils de la corniche et d’un larmier (dessin au crayon, Th. Vacquer, 53 v°).
Fig. 16 - Rue Coupe-Gueule, projet de restitution des niveaux 1 et 2 du pignon (à droite) et del’amorce de l’aile sud (à gauche) : essais de deux tracés, superposés, pour les fenêtres de l’aile sud(dessin à l’encre, Th. Vacquer, 8 r°).
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
fautive. Notons enfin qu’en dépit dumanque de données sur l’ordonnance decette aile, Théodore Vacquer tenta unerestitution systématisant les trames verti-cale et horizontale (40 v°) ; faute d’infor-mations suffisantes, il la rejeta.
ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE DES
PARTIES DOCUMENTÉES
L’analyse des données et la critiqued’authenticité des documents graphiquesétablissent des bases sûres. Leur interpré-tation vise à restituer l’apparence et leprogramme de l’hôtel. Cependant, contrai-rement aux principes d’une démarcheprogressive, mais fort des aperçus déjàofferts, qui jettent quelques lueurs sur l’as-pect d’ensemble de l’hôtel, on ne partirapas du général, le plan de masse, pour allerau particulier, l’étude des différents corpsde bâtiments : une question préalable doitd’abord être tranchée, celle de la nature ducorps de logis nord.
Chapelle ou grande salle ?
Alors que Sauval n’en faisait pas état,Jaillot identifia les vestiges qu’il voyaità l’emplacement de l’hôtel d’Harcourtavec ceux d’une chapelle ; Albert Lenoirrépéta cette assertion, sans en chercher depreuve 46. Depuis, cette identification futinégalement acceptée. Prudente, la THVPne parla que des « restes de l’hôtel », toutcomme l’Atlas de Paris au Moyen Âge 47. Enrevanche, la notice du catalogue édité parl’INHA prit apparemment ses informa-tions dans Lenoir et attribua les deuxpignons à la chapelle 48.
Plusieurs raisons nous poussent à refu-ser cette identification. En premier lieu,le bâtiment compte deux niveaux et ilest manifeste que les auteurs précités ontplacé la chapelle à l’étage. Cette hypothèseprésente deux caractères étonnants pour unhôtel : la localisation d’une chapelle àl’étage et les dimensions considérables quiauraient été les siennes (20 x 11,27 m).Certes, on connaît mal les partis adoptés
en la matière dans les hôtels nobles et prin-ciers parisiens : la chapelle de l’hôtel deBourbon, exceptionnellement vaste, étaitapparemment de plain-pied. La recensionfaite par Jean Mesqui dans les palais et leschâteaux montre soit des chapelles deplain-pied, soit des chapelles prestigieuses àdeux niveaux, soit des chapelles et desoratoires à l’étage, mais comme annexesde la grande salle. Il ne semble pas existerde chapelle d’étage de cette ampleur enl’absence de grande salle, ce qui aurait étéle cas ici si le bâtiment le plus vaste avaitété la chapelle 49.
La morphologie du bâtiment nousrend au surplus dubitatif. La symétrieabsolue de l’ordonnance des deux pignons,sans le moindre indice d’abside ni de carac-térisation du pignon oriental, surprend.Le couronnement de merlons et d’échau-guettes relève d’une rhétorique qui n’a riende religieux. Les façades des chapelles royalesdu milieu du XIIIe siècle sont cantonnées detourelles, mais montant de fond, et ont unecomposition unitaire, sans contrefort central(Sainte-Chapelle de Paris, chapelle de laVierge à Saint-Germain-des-Prés et chapellede Saint-Germain-en-Laye). Plus décisif
encore est le type des fenêtres à remplages,qui appartient nettement au vocabulaire del’architecture civile. Leurs embrasures sontpourvues d’allèges et de coussièges (fig. 17)alors que les traverses séparent nettementles compartiments bas, ouvrables, desdormants placés dans les réseaux. Cedernier dispositif est attesté par les obser-vations précises de Théodore Vacquer 50 et,en outre, les relevés en coupe et du reversdes fenêtres montrent les logements desvolets barlongs dans les feuillures despiédroits et de la traverse (fig. 22).
L’ensemble de ces arguments conduit àaffirmer que l’espace de l’étage était celuide la grande salle de l’hôtel. À l’originede l’opinion erronée doit se trouver unfait exact ou probable, l’existence d’unechapelle dans l’hôtel ; son emplacementdevait cependant être autre et nous propo-serons une solution alternative. Pourautant, il est vraisemblable que les préjugésconcernant l’architecture civile jouèrentun rôle dans l’incompréhension du pro -gramme : les grandes fenêtres à réseau etles roses durent être jugées caractéristiquesde l’architecture religieuse : or on verra ciaprès que les premières ne sont pas raresdans un rayon de 100 km autour de Pariset que les roses, pour être moins fréquentesdans les bâtiments civils, n’en étaient pasabsentes.
Le corps de logis nord, bâtiment principal de l’hôtel
Cette partie de l’hôtel en était indubi-tablement le bâtiment principal. Il necomprenait que deux niveaux, d’une belleélévation : sa hauteur était de 21 m ausommet du pignon, divisée entre un rez-de-chaussée (6,50 m du niveau du sol exté-rieur au larmier séparant les niveaux) et unétage très haut (près de 14 m). Il occupaitégalement une vaste surface au sol, ses cotesextérieures étant de 11,20 à 11,30 x 22 menviron, soit près de 250 m2 (fig. 18). À enjuger d’après le plan restitué par ThéodoreVacquer, la distribution semble avoir étédes plus simples : une pièce unique occu-pait chaque niveau. Elles communiquaiententre elles par un escalier en vis installé
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
139
Cl. Bodet.
Fig. 17 - Rue des Maçons, élévation extérieureet plan de la fenêtre à remplages gauche (dessinà l’encre et au lavis, Th. Vacquer, 3 r°).
dans l’angle sud-ouest, et avec les aileslatérales par au moins une porte pourchacune d’elles : un seul piédroit deces passages s’était conservé, au rez-de-chaussée, dans l’angle sud-est. L’unicité del’escalier de liaison entre les deux niveauxincite à penser qu’un autre escalier devaitdesservir l’étage et qu’il trouvait place àl’extérieur de la salle, sans doute dans lacour. On y reviendra en étudiant les accèsà l’hôtel. Par comparaison avec cet usagerestreint de la vis entre les deux pièces, onne peut qu’être frappé par la multiplicitédes vis qui partaient de l’étage pour desser-vir les galeries hautes périphériques.
La pièce du rez-de-chaussée était éclai-rée par de hautes fenêtres à croisées, peuaccessibles depuis l’intérieur (fig. 3 et19) :leurs appuis talutés étaient haut placés, iln’y avait pas de coussièges dans les embra-sures et tous les compartiments se garnis-saient de grilles. Ces fenêtres n’étaient doncpas aménagées pour le repos, ni pour leplaisir de regarder dans la rue. Un plafondcouvrait la pièce, porté par trois poutresmaîtresses d’axe nord-sud, parallèles auxpignons, sur lesquelles reposaient dessolives d’axe est-ouest : les arrière-voussuresdes croisées montant jusqu’au ras du plan-cher, les poutres se logeaient avec difficulté
entre les arcs et le sol de l’étage, commel’atteste un croquis (fig. 38). Cette piècen’était pas dépourvue d’apprêt : les mursétaient badigeonnés et Théodore Vacquernota que l’embrasure d’une fenêtre étaitpeinte en jaune et les feuillures des fenêtressoulignées en rouge ; dans les tympanscompris entre les arrière-voussures et leslinteaux étaient figurés des écus appenduspar une courroie ou guiche 51 (fig. 22). Endépit du type des fenêtres, cette salle avaitdonc bénéficié d’une mise en valeurcertaine, qui incite à lui attribuer les troiscorbeaux découverts par Théodore Vacquer(fig. 20) 52. Leur forte saillie, de 25 à 40 cm,pour une hauteur de 16,5 cm (45 r° :atlante de profil), indique en effet qu’ilsétaient destinés à soulager des poutresmaîtresses. Leurs sous-faces portaient, l’uneun mufle de lion, les deux autres un busted’atlante. Ces sculptures, traitées quasi-ment en ronde-bosse, étaient rehaussées decouleurs vives où dominaient le rouge, lebleu et le vert ; la facture en était vigou-reuse, avec des accents naturalistes. Ledécor et l’aménagement précis des sallesbasses du commun des grandes demeuresdes XIIIe et XIVe siècles sont mal connus, carelles sont le plus souvent ruinées ou défi-gurées. On citera néanmoins un exemplecomparable, postérieur, de poutres portéespar de belles consoles à personnages dansla salle basse du château de Pierrefonds 53.
L’étage se démarquait très nettementdu niveau inférieur, par une mise en scènebien plus recherchée des volumes et par lecaractère somptueux de ses baies. Cettepièce de plus de 190 m2 s’élevait d’un jetjusqu’à plus de 13 m de haut : tout indiqueen effet qu’elle était couverte par unecharpente apparente, vraisemblablementlambrissée, conformément aux usages dutemps. On déduit cette structure del’existence de baies hautes dans le pignon,qui est percé de trois registres de fenêtres :au niveau inférieur, des fenêtres à rem-plages, puis des grandes roses et enfin desminces baies barlongues, près du sommet.Cette superposition, qui témoigne d’unerecherche d’un éclairement maximal, auraitété inopérante si l’espace avait été compar-timenté et on imagine mal de pareillesroses éclairant les combles d’un logis.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
140
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Fig. 18 - Plan du rez-de-chaussée du corps de logis nord, avec amorces des ailes sud ; en P : le seulpiédroit de porte subsistant ; en noir : parties conservées ; en rose : parties restituées (dessin cotépréparatoire, encre et lavis, Th. Vacquer, ms. 251, n° 131 r°).
fig. 19 : Façade rue Coupe-Gueule : plans des trois niveaux (de bas en haut) du pignon. Oratoire :F : fenêtre avec appui taluté ; Cr : crédence ; noir : parties conservées ; rose : parties restituées (dessin,Th. Vacquer, ms. 251, n° 131 r°.
Les fenêtres à remplages des pignonsétaient toutes différentes (fig. 21 et 22) :sous la traverse, deux hautes baiesbarlongues (0,64 x 1,56 m), surmontées deréseaux. La modénature assemblait desprofils aigus, à faces droites ou légèrementconcaves, et avait répudié les mouluresrondes et les tores. Alors que dans laplupart des autres maisons, sur des fenê-tres moins élaborées, il était de mise quela face interne fût plane, ici les deuxfaces des remplages étaient profilées. Lesformes arrondies n’étaient cependant pascomplètement absentes, sur les angles despiédroits, abattus d’une large gorgeconcave, ou dans les archivoltes quicouronnaient les croisées du rez-de-chaussée. Ce côté aigu était particulière-ment sensible de face, les meneaux et lestraverses ne présentant que la proue deleurs sections triangulaires. Vus sous cetangle, les meneaux semblaient nus, maisleurs côtés étaient façonnés en chapiteauxplats à décors, dont plusieurs motifs ont étérelevés (fig. 23).
Outre la mouluration, non pas toriquemais chanfreinée, certaines caractéristiquesde ces baies à réseau, aux écoinçons évidés,s’observent essentiellement à la fin duXIIIe et au début du XIVe siècle. Ainsi leurscompositions comprennent-elles 1°) deuxlancettes brisées et trilobées, épointées ausommet, surmontées d’un trèfle posé surdeux pétales (fig. 25) ; 2°) deux lancettesen arcs brisés, redentées d’un trilobe ouvertet pointu, sous un quadrilobe posé sur unpétale et inscrit dans un cercle (fig. 26) ;3°) deux lancettes en arc brisé, à la tête
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
141
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Fig. 21 - Fenêtres à remplages des pignons : à gauche, rue des Maçons (fenêtre gauche / nord),à droite, rue Coupe-Gueule, élévations internes (en haut) et externes (Th. Vacquer, pl. INHA).
Fig. 20 - Salle basse du commun : trois consoles, de face et de profil (Th. Vacquer, pl. INHA).
également redentée d’un trilobe ouvert etpointu, surmontées d’un trèfle épointé,posé sur deux pétales et inscrit dans untriangle curviligne (fig. 27). À cela on peutajouter les chapiteaux pourvus de longuesfeuilles au limbe froissé et cloqué, ainsiqu’une base à deux tores, celui du dessousdébordant nettement par rapport au soclequi présente un renflement au-dessus de laplinthe (fig. 24).
Ces fenêtres (comme d’ailleurs cellesdu rez-de-chaussée) étaient conçuespour recevoir des volets dont les targettesse fermaient dans les trous percés dansdes colombes, renforts triangulaires desmeneaux (fig. 22). Dans les sections despierres dessinant les vides des réseaux,des feuillures étaient entaillées pour l’ins-tallation de panneaux dormants. Il est plusque vraisemblable qu’ils étaient vitrés etThéodore Vacquer apporte un témoignagesur la présence de verres de couleur : à lapage 9 r°, il a en effet noté « Fragment demeneau avec verre bleu – vient d’une fenê-tre à sous-arcatures non prolongées sur laface ». La fin est un peu obscure : il semblequ’il faille comprendre qu’il s’agit d’arcssubtrilobés. Ces fenêtres n’étaient pasinstallées dans des embrasures couvertesd’arrière-voussures ; les arcs apparents enparement étaient traversants, comme lemontre la coupe (fig. 22) : elles étaientdonc du type que Viollet-le-Duc nomme« fenêtre châssis », les réseaux étant indé-pendants de la maçonnerie de la baie 54.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
142
Fig. 22 - Fenêtre à remplages droite / sud, du pignon rue des Maçons : élévations externe (à gauche)et interne, coupe et plan ; noter les coussièges et le blason des Harcourt sur le tympan de la croiséedu niveau 1 (Th. Vacquer, pl. INHA).
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Fig. 23 - Meneaux colonnettes des fenêtres à remplages : sculptures latérales de quatre des faces des chapiteaux, de front et de profil, sans indicationd’emplacement (Th. Vacquer, pl. INHA).
En revanche elles étaient équipées de pairesde coussièges et entièrement peintes : parchance, les badigeons avaient été conservés,signe que les fenêtres avaient été muréestrès tôt. Ces couleurs répondaient sur lesdeux faces à la même harmonie, jouantde trois tons, bleu, rouge et jaune, mis enœuvre chaque fois différemment (fig. 25,26 et 27). L’effet produit à l’extérieur parces réseaux entièrement peints de couleursvives devait être remarqué.
De telles fenêtres n’étaient pas raresdans l’architecture civile de style rayon-nant. On en trouvera ainsi un grandnombre dans l’Oise, dont celles du logis dela maladrerie Saint-Lazare, près de Beauvais,qui adoptent un dessin très proche 55. Oncitera aussi la maison, dite « hôtel deVauluisant », à Provins ; le remplage estcomposé par deux baies barlongues, unetraverse, deux arcs trilobés et une rose auxlobes en amande : ce dessin mêle les partisdes rues des Maçons et Coupe-Gueule,mais les piédroits et les meneaux sontmoulurés de tores sommés de petits chapi-teaux, qui attestent la date sans doute unpeu plus précoce de la maison provinoise.À Reims, rue Dieu-Lumière, les remplagesde la claire-voie d’une maison détruiteprésentaient une modénature comparable,à pans coupés, profils aigus – avec quelquesmembres arrondis – et meneaux sanschapiteaux 56. À l’ouest, la Normandieconfirme l’existence de telles fenêtres dansl’architecture civile, par exemple dans laSeine-Maritime : la salle haute du manoirde Boos s’éclaire par de grandes fenêtres àbaies barlongues, traverse et réseau composéd’arcs brisés et d’une rose, ou de trois rosesposées deux et un : les formes y sont sècheset aiguës, comme à Paris. Le tracé àlancettes trilobées et rose à trois lobes de la« maison des Templiers », à Caudebec-en-Caux, est un peu différent 57 : les traversesen sont absentes, mais la modénature estréduite à des chanfreins. Enfin, les fenêtresdu logis du manoir du Tortoir, à Saint-Jean-aux-Bois (Aisne) sont presque iden-tiques ; il est éclairant de comparer leurréseau à celui de la chapelle contiguë : lesspécificités des fenêtres civiles y sont mani-festes 58. La datation de ces demeures n’estmalheureusement pas précisément établie.À titre de comparaison, on avancera letriforium de la cathédrale de Tours, dontles diverses versions sont bien calées par lesdatations dendrochronologiques proposéespour les charpentes : certes les traversessont absentes de ces réseaux et les meneauxont des chapiteaux, mais le tracé de ceuxdu triforium du transept sud est trèsproche ; ils auraient été construits peuaprès 1270 59.
Au registre médian ouvraient des rosesde grande taille : moulures externes
incluses, leur diamètre était de près de 2 m,pour une ouverture d’environ 1,50 m ;l’intrados en était festoné de sept lobesarrondis). Le profil des moulures, parti-culièrement raffiné, comportait des dou -cines et un tore à filet (fig. 28) : la partie laplus richement décorée, tournée vers l’in-térieur, s’enrichissait d’une polychromiefondée sur l’alternance du rouge, du jauneet du vert. En outre, une frise doublait l’ex-trados des roses : un feston s’y développait,aux pointes couronnées de fleurons jaunessur fond rouge ; les transitions étaient
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
143
Fig. 24 - Détails des bases et des renforts (colombes)des meneaux colonnettes (Th. Vacquer, 9r°).
Fig. 25 - Fenêtre à remplages rue Coupe-Gueule :élévation externe (Th. Vacquer, 12 r°).
Fig. 26 - Fenêtre à remplages rue des Maçons (àgauche / nord) : élévation externe (Th. Vacquer,2 r°).
Fig. 27 - Fenêtre à remplages rue des Maçons (àdroite / sud) : élévation externe (Th. Vacquer, 2 v°).
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
soulignées de filets noirs. Ainsi que l’attestela présence de feuillures, ces roses étaientégalement fermées de panneaux vitrésdormants. Les roses ne sont pas fréquentesdans les demeures, sans pour autant en êtreabsentes. En dehors de la Bourgogne(Flavigny-sur-Ozerain, Côte-d’Or, « maisondu Bailli »), elles ont surtout été repéréesdans les architectures du Midi. On citerades maisons, de la deuxième moitié duXIIIe siècle ou du début du siècle suivant, àFigeac (Lot : 17, rue de Clermont), àBruniquel (Tarn-et-Garonne : maison Payrol),à Gimont (Gers) et à Aurillac (Cantal) 60 :les roses y sont de belle venue, mais pluspetites qu’à Paris, ce qui n’est pas le cas decelles d’une maison tour de Cahors (2, ruedu Four-Sainte-Marguerite) 61. Toujoursdans le Midi aquitain, des roses éclairaientles salles de plusieurs châteaux, telsMazères, à Barran (Gers), Roquetaillade(Gironde : château vieux), Mirefleurs etSaint-Floret (Puy-de-Dôme) 62. À Parismême on ne saurait ignorer les grandesroses des pignons de la grande salle duPalais de la Cité, sans doute construitesaprès 1299 et donc postérieures d’unegénération à celles de l’hôtel d’Harcourt 63.Le bilan est mince et confirme que les roses
étaient des formes prestigieuses. Ellesétaient d’ailleurs également présentes dansles riches constructions des ordres religieuxà Paris, comme dans le proche collège deCluny (fig. 36) : purent-elles servir demodèle ? Du moins leurs choix architectu-raux traduisaient-ils les goûts et les aspira-tions du milieu parisien, dans les années1260-1270, période probable, comme onle verra, de la construction de l’hôteld’Harcourt 64.
Les baies barlongues du sommet dupignon (0,17 x 0,59) avaient un encadre-ment formé de larges chanfreins (14 cm)et leur embrasure intérieure était talutée(fig. 10). Éclairaient-elles la salle ou lecomble ? Le parti précis de la charpente estincertain, les seules informations figurantsur l’élévation au fol. 4 v° (fig. 12) : despoutres, arbalétriers ou plus probablementchevrons, étaient accolées aux rampants dupignon et s’assemblaient en tête. À en jugerpar les exemples qui couvraient beaucoupde grandes salles non voûtées, la proba-bilité est en faveur d’une charpente àchevrons formant fermes, triangulés par desfaux entraits, avec fermes majeures àintervalles réguliers, comportant entrait et
poinçon. Vu la présence des roses, la piècene devait pas être plafonnée et un lambriscaréné devait être cloué, ou assemblé dansdes rainures, sur les chevrons, les aisseliers etles faux entraits. Ce parti de la carène lam -brissée avec ventilation du comble par lesdeux petites baies sommitales se retrouvaitau pignon du grand bâtiment du collège deCluny, détruit en juin 1860 (fig. 36).
La salle devait être particulièrementlumineuse, si l’on songe que la façadenord s’ajourait également de fenêtres àremplages, probablement au nombre dequatre. Ses vitrages colorés répondaient auxpeintures des murs, dont ne sont plusconnus que de minces vestiges 65, et sansdoute au sol de pavements de carreauxvernissés. On ne saurait en effet exclure quecertains des carreaux de pavement retrou-vés par Théodore Vacquer aient appartenuau sol de cette pièce (fig. 29) : les morceauxassemblés par quatre, avec fleurs de lysplacées tête-bêche dans une rosace poly-lobée, seraient de bons candidats pourcompléter la parure de la salle de l’hôteld’un grand seigneur, proche du roi commeon le verra ci-dessous.
Les deux façades connues, à murspignons, présentaient toutes deux la mêmeordonnance, scandée par trois verticales, lecontrefort médian et les contreforts d’an-gles, développés en tourelles partiellementdans œuvre, sommés aux angles par deséchauguettes et au centre par le pignon.Quatre registres de baies, régulièrementordonnées sinon parfaitement symétriques,reprenaient la composition pyramidale.Deux membres horizontaux achevaient latrame orthogonale, en mineur pour lelarmier qui séparait les étages, et en modemajeur au bas du pignon, où se dévelop-pait une composition puissante : unecorniche en fort encorbellement portait unegalerie dont le garde-corps merlonné seraccordait au contrefort axial et aux échau-guettes d’angle. Le passage était étroit, maisbien réel, traversant celles-ci comme celui-là, et se poursuivait donc sur la façade nord,comme sans doute le long des ailes adja-centes. La traversée du contrefort était untour de force technique, résolu en évidant àla fois le mur du pignon et la masse ducontrefort (fig. 15 et 19). La composition
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
144
Cl. Bodet.
Fig. 28 - rose d’un pignon : élévation interne avec profil et fragment de peinture murale (Th. Vacquer,pl. INHA).
frappe par sa régularité, son harmonie, lajustesse des proportions et la puissance dechacun des membres.
Elle trouvait un contrepoint dans lacomposition du pignon sud de la grandesalle du collège de Cluny, déjà évo -quée (fig. 36) : même structuration autourd’un contrefort central et de contrefortsd’angle sommés d’échauguettes, et non detourelles ; étage ajouré de baies à remplages,puis de roses, enfin de minces fenêtresbarlongues ; couronnement par une galeriepériphérique, traversant les échauguettes etpassant derrière le contrefort central, avecgarde-corps en encorbellement sur uneforte corniche vigoureusement profilée 66.La similarité de l’ordonnance en dit longsur les schémas communs à la culture desmaîtres d’œuvre parisiens.
La tourelle développée sur deuxniveaux et achevée en échauguetteétait moins fréquente que l’échauguettesimple 67, attribut fort prisé à Paris, depuisle XIIIe siècle, par les bâtiments recherchantune certaine distinction 68. Sur la rivegauche, on en voyait par exemple sur desbâtiments du collège de Cluny et de l’hôtelde Reims. Un siècle plus tard, elles flan-quaient le haut pignon d’un des principauxcorps de logis de l’hôtel de Bourbon, quiregardait la Seine. En revanche, aucunautre bâtiment civil parisien connu ne
présentait la même ordonnance. Il est nota-ble, pour une demeure, que les baies del’étage ne reposaient pas sur un cordond’appui régnant et qu’ait été préféré unlarmier placé plus bas, dans la conti-nuité des moulures des culots des tourelles,choix dicté par une recherche de monu-mentalité.
En conclusion de l’étude de ce corps delogis, quelques réflexions s’imposent sur laqualité de sa construction. Les parementsétaient entièrement réalisés en pierres detaille et la perfection de la stéréotomie nesouffrait aucune réserve ; on s’en convaincaisément en constatant la maîtrise aveclaquelle furent surmontées les difficultés àrésoudre au niveau des étages des façadesest et ouest, que rendent bien les plans(fig. 19) : les tourelles, en partie réaliséesdans œuvre, logeant chacune un escalier envis, les échauguettes accueillant les arrivéesde ces vis et aussi deux portes chacune, lepassage à travers le contrefort médianenfin, dénotent une science de la construc-tion affirmée. Quant aux partis des baies età la modénature, ils attestent une scienceconsommée du tracé et un soin extrêmedans la mise en œuvre. Autre preuve decette maîtrise, la relative minceur des murs,et leur décroissance, visible sur les coupes(fig. 19), de 0,92-0,96 m au rez-de-chaussée (9 r°), à 0,50 m au niveau desroses (22 v°).
L’aile est, sur la rue Coupe-Gueule
La restitution qu’en proposa ThéodoreVacquer était très partielle et il hésita beau-coup à interpréter les vestiges (fig. 2, 3 et16). Il dessina le même larmier que surle corps de logis nord ; on ne sait si c’esten fonction de vestiges en place ou fautede données permettant de restituer uncordon ? Les croisées au rez-de-chausséeont des canons bien plus trapus que leursvoisines ; on ne saurait affirmer qu’elles ensoient contemporaines et ne sont pas despercements ultérieurs. On est en effetfrappé par la muralité aveugle de ce niveau.Quant aux fenêtres géminées de l’étage, ona expliqué lors de l’étude de la documen-tation combien le parti de leur couronne-ment était incertain. Encore faut-il noterque l’auteur dessina en traits fins un réseauen orbevoie reprenant le parti des trilobessurmontés par une rose trilobée.
L’examen des relevés du bas de la fenê-tre la plus au sud / à gauche, en élévation(fig. 30) ainsi qu’en plan et en coupe(fig. 31), est plus riche d’informations.Il indique que les piédroits bénéficiaientd’un encadrement interne exceptionnel deriches moulures ; on observe au surplusque la fenêtre était dépourvue d’allège et decoussiège, mais que ses appuis, tant exté-rieurs qu’intérieurs, étaient talutés (alorsque l’élévation d’ensemble est fautive, endonnant un appui droit !) ; on note enfinque les compartiments bas de la fenêtreétaient eux-aussi pourvus de feuillures, etdonc de vitraux, trait qui achève de lesdifférencier des fenêtres à réseau voisines.Cette morphologie n’est pas celle d’unefenêtre de pièce à vivre, surtout à l’étage.Le choix d’un tel parti doit avoir une raisonprécise. Ne serait-ce pas la baie d’une pièceà fonction religieuse ? La fenêtre regardaiteffectivement vers l’est. Qui plus est, àproximité immédiate était aménagéedans le mur une niche à logettes latérales,couverte d’un arc trilobé, nomméecrédence par Théodore Vacquer, qui la faitfigurer sur le plan de la façade pris auniveau de l’étage et en donne l’élévation etle plan (fig. 32), ainsi que l’emplacementexact (39 v°) 69. Voilà qui incite à placer icila chapelle de l’hôtel, qui en l’occurrence
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
145
Cl. Bodet.
Fig. 29 - Carreaux de pavement (Th. Vacquer, pl. INHA).
n’aurait été qu’un oratoire, sans doutedisposé transversalement et parallèlementà la grande salle, afin de respecter l’orien-tation canonique.
Les décors peints, à même la pierre, surces deux éléments étaient doublementremarquables, par leur grand raffinement,alliant finesse d’exécution et chaleur d’unegamme colorée particulièrement étendue,et aussi par la succession des décors : lesvestiges étaient suffisamment importantspour que Théodore Vacquer puisse recon-naître et relever deux décors superposés.Dans son premier état, l’embrasure et l’en-cadrement de la baie de la chapelle, voirepeut-être même tout le mur est, étaientuniformément peints en vert bronze assezvif : un semis d’alignements de fleurs de lysalternées avec des rosaces à six lobes s’enle-vait en doré sur le fond sombre (fig. 30). Lesmoulures de l’intrados de la baie se déta-chaient en rouge vif sur des gorges sombres(noir ?) ; les bases des gros tores étaient trai-tées en blanc gris, du jaune soulignant lesdeux petits tores horizontaux en soucoupe.Le deuxième décor, attribué par l’auteur auXIVe siècle 70, était aussi riche, mais inversaitles valeurs : sur l’encadrement de la fenêtre,de fins rinceaux dorés animaient un fondrouge vif ; au registre inférieur s’enroulaientdes circonvolutions bleu et blanc, ressem-blant à la représentation conventionnelledes nuages sur nombre de miniatures. Lesmoulures étaient traitées au naturel, couleurpierre pour les tores, les gorges étant à l’op-posé alternativement peintes en rouge et enbleu, avec des filets noirs. La crédence reçutsuccessivement les deux mêmes décors :encadrement à fond vert semé de fleursde lys et de rosaces, puis à fond rouge àrinceaux dorés, surmontant un registre de« nuages » blanc et bleu (fig. 31) 71.
La qualité d’exécution et l’apparat deces décors témoignent en faveur de l’inves-tissement consenti par les seigneurs deHarcourt pour parer leur hôtel. Ils peuventen tous points se comparer avec les aména-gements de l’hôtel d’Artois dans lespremières années du XIVe siècle 72. Si cettepièce était bien l’oratoire, il est vraisembla-ble que les espaces faisant suite vers le sud,dans cette aile, devaient accueillir les cham-bres du maître des lieux.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
146
Fig. 30 - Fenêtre de l’oratoire de l’aile sud, rue Coupe-Gueule : élévation partielle intérieure restituée,état I (Th. Vacquer, 8v°).
Fig. 31 - Fenêtre de l’oratoire de l’aile sud, rue Coupe-Gueule : élévation partielle, coupe et profil,avec les deux états des peintures (I, en bas et II en haut) [Th. Vacquer, pl. INHA].
Cl. Bodet.
Cl. Bodet.
Le corps de bâtiment sud et la cave
L’extrémité sud de la cour était ferméepar un grand bâtiment, dont on ne connaîtbien que la cave, grâce aux plans d’AlbertLenoir 73. Hors œuvre, cette aile couvraitenviron 140 m2 (20 x 7 m ; fig. 33), lasurface de la cave étant de 126 m2 (19 x5,40 m). Des voûtes sur croisées d’ogivescouvraient les cinq travées de sa nefunique. Entre elles, les arcs retombaient dechaque côté sur des ensembles de cinqculots en demi-tronc de pyramide renver-sée : le culot médian, pour le doubleau,était encadré par deux paires de culots pourles branches d’ogives et les formerets(fig. 34). Les plans d’Albert Lenoir nereprésentent aucun soupirail, mais figurentsur la face sud, vers le jardin, quatre perce-ments, larges de 3,30 m, qui évidaientquasiment le mur entre les retombées ; leurcontemporanéité avec la structure de lacave est incertaine.
Deux accès étaient aménagés dans latravée occidentale. L’entrée principale, aunord, était une rampe d’escalier de 19marches hors œuvre, plus 4 dans l’emprisede la cave, qui longeait la rue des Maçons ;son débouché dans la cour n’est pas précisé,mais sa longueur incite à restituer au-dessus un corps de bâtiment considérable,
d’au moins 5,70 m de front vers l’ouest(0,30 m x 19 marches). Le second accès,installé au sud contre la première retombéedes voûtes, était un court escalier de 4 à 5marches hors œuvre, entre les deux mursd’un petit avant-corps. Il débouchait dans
les jardins, séparés de la rue, à l’ouest, parun mur qui est figuré sur les plans. Si tantest que l’escalier sud ait été dessiné dansson intégralité, la différence du nombrede marches entre les deux escaliers laisseperplexe : elle suggère qu’il existait un déni-velé important entre la cour au nord et lejardin au sud, celui-ci étant plus bas d’en-viron 14 marches, soit près de 3,50 m sil’on donne une hauteur moyenne de 20 cmà une marche. Cette configuration duterrain expliquerait l’existence des grandesbaies ménagées dans le mur sud de la cave :celle-ci aurait été complètement enterréeau nord et presque hors du sol au sud. Untel dénivelé, descendant du nord vers lesud, est plutôt à contre-pente de la décli-vité de la montagne Sainte-Geneviève :il faut supposer que le terrain avait étéremblayé inégalement, ou que certainsbâtiments étaient surélevés par la présencede substructions antérieures, peut-êtreantiques.
Les profils des culots recevant lesvoûtes, seuls éléments de datation, ne s’op-posent pas à une contemporanéité entre lacave et le corps de logis nord. En revanche,
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
147
Cl. Bodet.
Fig. 33 - Cave du bâtiment au sud de la cour : plan (dessin, encre et lavis, A. Lenoir, INHA).
Fig. 32 - Crédence de l’oratoire de l’aile sud, rue Coupe-Gueule : élévation et coupe restituées ; détaildes peintures, état II (Th. Vacquer, pl. INHA).
Cl. Bodet.
on ne saurait étendre sans prudence cettechronologie aux niveaux qui la surmon-taient, dont seule la silhouette est connue.En effet, la construction qui s’élevait au-dessus de la cave ne donna lieu à aucunrelevé en 1852. Sans doute avait-elle étécomplètement transformée au cours dutemps, du fait de la division de la propriétéet de l’aménagement de divers hôtels surson emprise, situation que figurent lesplans détaillés du quartier Sainte-Genevièvepar Delagrive en 1757 74.
Les plans dressés en vue à vol d’oiseaudans le courant du XVIe siècle sont plusexplicites. On se souvient que le plan deSaint-Victor (vers 1550) représente enlimite sud de la cour de l’hôtel d’Harcourtun long bâtiment à étage, flanqué dansl’angle nord-ouest, sur la rue des Maçons,d’une tourelle carrée (fig. 5) : cette confi-guration concorde parfaitement avec lalocalisation et le développement de lacave et de l’avant-corps supposé, au-dessusde l’escalier. Le renseignement est trèsexactement confirmé par le plan de Braunet Hogenberg (1572) [fig. 6], celui deBelleforest (1575) figurant le bâtiment,mais sans la tourelle (fig. 7).
Il est donc licite de restituer en fond decour un bâtiment contemporain du corpsde logis nord, à lui parallèle mais pluscourt, et laissant à l’est un passage libre versles jardins. Il comptait au moins un étage,
un rez-de-chaussée et une cave, partielle-ment hors sol vers le sud ; une tourellecampée dans l’angle de la cour et de la ruedes Maçons abritait la rampe de l’escaliernord vers la cave et devait contenir une visqui desservait l’étage.
L’HÔTEL PARISIEN D’UN GRAND SEIGNEUR
À LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
Un programme de résidence aristocratique très complet
Le plan de masse proposé par les docu-ments analysés dans la première partie estamplement confirmé et précisé par l’étudearchéologique. La résidence parisiennedes sires de Harcourt occupait une vasteparcelle et comportait de nombreux corpsde bâtiments. La surface de la parcelle étaitcirconscrite par trois rues, à l’est, au nord età l’ouest ; au sud, on admettra la limitetracée sur le Plan archéologique de Paris 75
(fig. 8). La seule dimension connue avecune grande exactitude est celle du frontnord : Théodore Vacquer porte 22 m surles plans qu’il a dessinés. En conséquence,la profondeur du terrain occupé par l’hôtelpeut être estimée à 110 m. La parcellen’était pas parfaitement rectangulaire, sonflanc sud-est étant aminci d’une bande deterrain : l’étendue du pourpris de l’hôtelaurait donc dépassé 2 200 m2, surface trèsconsidérable au cœur d’une ville en pleindéveloppement.
Cette emprise était subdivisée en troisparties. En tête d’îlot, le noyau résidentielde l’hôtel articulait quatre ailes autourd’une cour, l’ensemble couvrant plus de850 m2. Le grand corps de logis nords’étendait sur près de 250 m2. À l’est et àl’ouest, deux ailes d’axe nord-sud et d’unesurface inconnue le jouxtaient : elles s’éti-raient le long des rues latérales sur unelongueur incertaine, car on ne sait si ellesétaient contiguës au bâtiment qui fermaitla cour au sud ; leur largeur était moitiémoindre de celle du corps nord. Au sud,le bâtiment de la cave, d’une surface de140 m2, flanqué d’une tour à son extrémiténord-ouest, laissait libre un étroit passage
vers le jardin sur son flanc oriental. Lasurface exacte du préau central rectangu-laire, également d’axe nord-sud, ne peutêtre évaluée exactement, faute de connaî-tre l’extension des ailes ; elle devait couvrirenviron 220 m2 76. Faisait suite, au sud, lejardin, dont l’existence est attestée par lessources écrites et les représentations desplans du XVIe siècle (fig. 5 et 6). Sauvalévoque «… un jardin assez spacieux » 77.On se souvient également que la cave avaitune entrée vers le jardin : elle atteste quel’espace qui s’étendait au sud appartenaitbien à l’hôtel. De fait, sur le Plan archéolo-gique…, il est à peine moins profond quel’ensemble des bâtiments de l’hôtel, soitenviron 700 m2 (22 x 31 m), contre prèsde 850 m2 pour celui-là.
Le fond de la parcelle, enfin, soit envi-ron 850 m2, était occupé par des dépen-dances, dont on ne sait rien. L’ampleur desbesoins à couvrir paraît avoir nécessité des’étendre hors de cette aire, pourtant déjàconsidérable, sur la rive ouest de la rue desMaçons : la THVP localise en effet desbâtiments, dits Petit Harcourt, dans l’em-prise du collège de Bayeux 78, dénomina-tion typique des usages en vigueur vers1300, comme il appert des noms donnésaux annexes accueillant les logements de lafamilia des cardinaux en Avignon 79. Onpeut imaginer ici, ou au fond du pourpris,les écuries, nécessaires pour le train demaison d’un grand seigneur, et que l’usageplaçait à distance des logements, telles les« Écuries du Pape », dans l’hôtel des Rogerà Villeneuve-lès-Avignon, quelques décen-nies plus tard 80.
Le programme du corps de logis nordse déduit de la description de ses deuxsalles superposées, qui parle d’elle-même(fig. 35). La pièce sous charpente appa-rente, par ses vastes proportions et labeauté de son architecture, s’annonçaitcomme la grande salle de l’hôtel, sise àl’étage comme il était de coutume « enFrance », à la différence des provinces del’Ouest où elle était souvent de plain-piedavec l’extérieur. La pièce du rez-de-chaussée, dont la configuration dénotait unrang moindre, mais qui se paraît cependantde blasons, dont ceux des maîtres des lieux,n’était-elle pas la salle basse du commun ?
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
148
Fig. 34 - Cave du bâtiment au sud de la cour :détail des retombées des voûtes (dessin à laplume, A. Lenoir, INHA).
Cl. Bodet.
Les dimensions de la salle haute, supé-rieures à 190 m2, la classaient au rang desplus importantes grandes salles des hôtelsurbains méridionaux, cependant tous plusjeunes de deux à trois décennies : elle étaitainsi à égalité avec le « château » Balène àFigeac, mais était moins vaste que celle du« palais » Duèze à Cahors (275 m2) 81.Autour de Paris, on peut citer, à titre decomparaison, plusieurs salles de grandshôtels patriciens, plutôt un peu moinsgrandes, à Beauvais (hôtel de Maubeuge :146 m2), à Chartres (« le Perron », 13, ruedes Changes, vers 1272 : 220 m2) et àProvins (« hôtel de Vauluisant » : un peumoins de 100 m2 ; hôtel de Renier Accorre,22, rue Saint-Thibaud : plus de 140 m2).Les grandes salles des évêchés à peu prèscontemporaines étaient elles-mêmes dedimensions fort variables : celle de Laon(bâtie entre 1250 et 1255) mesurait plus de330 m2 et celle d’Auxerre environ 146 m2
(construction en 1248-1249) 82. À Parismême, on ne dispose pas de point decomparaison contemporain parmi desédifices de même statut, mais des bâti-ments monastiques peuvent servir de pointsde repère quant aux ambitions des maîtresd’ouvrage de la période : ainsi la surface dubâtiment du réfectoire du collège de Clunyétait-elle d’environ 360 m2 83. Un siècle plustard, la salle de l’hôtel d’Artois à Paris paraîtavoir été d’une surface proche ou un peusupérieure 84. En revanche, il ne pouvaitêtre évidemment question de rivaliser avecl’immense salle haute du Palais de la Cité(70 x 27 m, soit environ 1900 m2), niavec celle de l’hôtel de Bourbon (70 x 16m, soit plus de 1000 m2) 85. Replacée dansla série des grandes salles constituée parJean Mesqui, celle de l’hôtel d’Harcourt sesituait au-dessus des dimensions caractéri-sant une première série (15-20 x 5-10 m),et à peine au-dessous de celles de la
deuxième série, de loin la plus nombreuse(30-35 x 10-15 m) 86.
La taille des cheminées et leur décorsignalaient également la grande salle, maisen l’hôtel d’Harcourt l’emplacement de cesdernières est inconnu. Les pignons n’ayantpas été retenus pour leur implantation,elles pouvaient être adossées soit à la façadenord, soit à celle donnant sur la cour, horsde l’emprise des portes.
La grande salle était en principe magni-fiée par son accès sur la cour, desservie parun grand degré et il n’était pas rare que laporte qui y menait fût richement sculptée.Or, le mode d’accès à l’hôtel d’Harcourt estlui aussi inconnu. Les pignons ne gardaientla trace d’aucune porte. Deux solutions seprésentent alors : le portail pouvait êtredisposé dans la façade nord, sur la rue desMathurins, ou être rejeté sur une des rueslatérales. Dans le premier cas, on aurait
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
149
Fig. 35 - Façade sur la rue Coupe-Gueule : restitution, vue de trois-quartsdepuis la gauche / le sud-est (dessin de P. Benoît, « d’après Lenoir », dansHoffbauer [1980]).
Fig. 36 - Paris, collège de Cluny, bâtiment du réfectoire, pendant lesdémolitions de 1860 : élévation du pignon sud (gravure, B.n.F., Est. Va260j Fol).
accédé directement à l’intérieur du cœur del’hôtel, ce qui était incompatible avec lasécurité et peu conforme aux usages. Laseconde hypothèse paraît plus vraisem-blable, car elle permettait de contrôler lesentrées en organisant une pénétrationen deux temps au cœur de l’hôtel : sur larue aurait d’abord ouvert un portail percédans une des ailes latérales, orientale ouplus probablement occidentale, la rue desMaçons étant plus importante que la rueCoupe-Gueule. Ce filtre donnait accès à lacour intérieure : dans cette hypothèse, dèsque l’on y pénétrait la façade sud du corpsde logis nord devait se révéler à l’arrivant,à main gauche. La porte principale del’hôtel ouvrait sans doute à l’étage, commec’était la règle, probablement desservie parun grand degré ; l’usage le plus fréquentétant de la placer à l’opposé des chambresdu maître de céans, il est probable qu’elleétait rejetée à l’extrémité sud-ouest de lafaçade sur cour.
À l’intérieur, l’unicité de la vis reliantle rez-de-chaussée et l’étage confirme lecaractère différent des deux niveaux enimposant une restriction aux circulationsverticales entre la salle basse et la grandesalle haute. La multiplicité des vis partantde l’étage vers ce couronnement à tourellesd’angle et galeries hautes périphériquesdisait son importance, malgré l’étroitessedes passages : il offrait un belvédère etsignalait de loin l’hôtel à la vue desParisiens. Le dispositif satisfaisait auxdemandes d’agrément et de prestigeconjuguées, en adoptant une figure déjàdéployée pour la grande salle de l’archevê-ché de Sens, mais sans les lucarnes ; elle futdéveloppée, moins d’un siècle plus tard,par le couronnement de la grande salle deCoucy, où une galerie de circulation passaitau-devant des grandes lucarnes, ainsi qu’auchâteau de Saumur, où fut installée uneloggia devant une grande lucarne de la sallela plus haute 87. Dans cette recherched’effet, les tourelles échauguettes n’appar-tenaient pas seulement à une rhétoriqueseigneuriale, mais participaient aussi d’unerecherche de monumentalité 88. Celles del’hôtel des sires de Harcourt paraissentavoir atteint cet objectif : elles durentmarquer le paysage et frapper les contem-porains pour que les cartographes du
XVIe siècle prennent autant soin à les dessi-ner : ainsi, sur le plan de Saint-Victor, seull’hôtel des archevêques de Reims est traitéà l’identique, quoique à une échelle moinsmonumentale.
La structure avec galerie à garde-corpset tourelles échauguettes encadrant uncontrefort central ne se retrouve pas dansle dessin des pignons de la Grande salle dupalais de la Cité ; en revanche les points derapprochements ne manquent pas, dansl’articulation de chaque pignon par descontreforts plats, ou dans le contrasteformé par le premier niveau, très peu percé,avec l’ajourement de l’étage. Ceci dit, lepignon cantonné de contreforts, aveccontrefort axial, est un topos médiéval,particulièrement employé pour le traite-ment des pignons dans la région parisienneau cours du XIIIe siècle 89. À Paris même, lepignon sud du grand bâtiment du réfec-toire du collège de Cluny en donnait uneversion proche, sans doute à peu prèscontemporaine : si le dessin des roses paraîtarchaïque, on retrouve en revanche lastructuration par des contreforts médianet d’angles, les tourelles échauguettes, lagalerie à garde-corps et jusqu’au passagederrière le contrefort axial, tour de forceapparemment bien maîtrisé par les maçonsparisiens (fig. 36).
Le programme des autres corps de bâti-ment est plus sujet à conjectures. Les ailesoccidentales et orientales accueillaient sansdoute à l’étage des chambres et probable-ment un oratoire pour l’aile sur la rueCoupe-Gueule. Au rez-de-chaussée, onimagine le logement du concierge et d’au-tres locaux domestiques. Plutôt que d’êtreplacées dans cette cour, les écuries étaientsans doute disposées dans les dépendancesindiquées plus au sud, à l’écart du logis,comme on avait coutume de le faire auMoyen Âge 90.
Il est vraisemblable que la cave dubâtiment sud abritait les provisions de vinindispensables au train d’un grand hôtel ;son principal escalier débouchait nonloin de la rue, ce qui devait faciliter lemaniement des lourds tonneaux 91. Le rez-de-chaussée offrait des surfaces importantespour les services domestiques, peut-être lacuisine et ses dépendances, tandis que
l’étage pouvait accueillir les logis descommensaux. On hésite en effet, sur laseule foi des dires de Jaillot évoquant unechapelle, à envisager que ce corps de bâti-ment ait accueilli un lieu de culte aussivaste, mais si étroit.
Le cœur de l’hôtel des sires d’Harcourtétait donc un quadrilatère bordé de ruessur trois côtés, et dont toutes les faces de lacour centrale étaient bâties. Cette disposi-tion en front de rue est à souligner, bienéloignée des ensembles à bâtiments dispo-sés dans des cours, comme le sera l’hôtelSaint-Paul, un siècle plus tard. Les bâti-ments y étaient individualisés, les toitsétant distincts, et, pour ceux qui étaientcontigus, articulés et hiérarchisés selonleurs fonctions, annoncées notamment parl’ordonnance des façades et par leurs baies.La structuration en trois parties, noyaurésidentiel compact, jardin et dépendances,ici en enfilade du nord au sud, était claire-ment affirmée. On ne saurait en déduirequ’une telle organisation de l’espace étaitde règle dans les résidences urbaines del’époque, en général contraintes par ladensité du tissu urbain. Pour autant, si ladisposition des différentes composantes,dont la régularité géométrique fut ici faci-litée par le caractère faiblement urbanisé duquartier, devait s’adapter ailleurs à la confi-guration des parcelles, la séparation entrel’hôtel à cour centrale et la basse-cour avecdépendances nous paraît une hypothèsesoutenable, tout comme celle de larecherche d’un jardin ; ces deux caractèresde l’hôtel urbain reproduisaient alors lastructuration de nombreuses résidencesrurales.
Ce type de résidence urbaine est malconnu pour les XIIIe et XIVe siècles dans lenord de la France, alors qu’il s’en est beau-coup conservé dans le Midi aquitain, datantdes dernières années du XIIIe siècle et despremières décennies du siècle suivant.Beaucoup adoptaient le même parti, àcour centrale, et n’hésitaient pas à placerle logis principal en front de rue(« palais » Duèze à Cahors, « Raymondie »à Martel, « château Balène » à Figeac), leurgrande salle occupant généralement l’étaged’une des ailes. En revanche, tous cesorgueilleux logis comportaient une tour,
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
150
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
151
attribut qui manque à l’hôtel des seigneursde Harcourt : le doute quant à la nature età la datation de celle qui jouxte l’aile sudne permet en effet aucunement de la quali-fier en toute certitude de tour seigneuriale,contemporaine de l’érection de l’hôtel.De toutes ces grandes demeures c’est le« château Balène » qui, grâce à sa relativecomplétude, son plan de masse et soninsertion dans le tissu urbain, offre la meil-leure évocation de ce que pouvait êtrel’hôtel d’Harcourt (fig. 37) : inclus dans unbâti dense, cet hôtel n’est bordé que par desvoies modestes, sur deux de ses faces prin-cipales. Sa grande salle occupe l’étage d’undes corps de logis formant un petit côté duquadrilatère ; elle développe sur la faceorientale, où est placée la grande entrée, unpignon percé de deux immenses fenêtresà remplages aux réseaux raffinés ; aucunecheminée n’y est adossée. Deux ailes laté-rales plus étroites enserrent une courcentrale, fermée par un dernier corps égale-ment peu large. On accède à la cour par unportail placé à l’extrémité de l’aile est : faceà cette entrée s’amorce le grand degré àdeux volées, accolé à – puis inclus dans –l’aile opposée. L’hôtel possède une tour,mais les pignons n’arborent ni tourelles nigaleries à garde-corps merlonné.
Le roi devait veiller à l’érection destours dans sa capitale, édifices dont lacharge symbolique était si forte aux yeuxdes contemporains. De fait, on connaîtpeu d’hôtels comportant alors, non unetourelle d’escalier, mais une vraie tour, tellecelle du Pet-au-Diable sur la rive droite 92.Certes, des sources documentent diversestours, d’Étienne de Garlande, « deDagobert » et Billouart 93, mais plus d’uneétait antérieure au règne de Saint Louis,voire de Philippe Auguste. Pour autant,on n’a pas mention d’une interdictioncomplète des tours, ni de la destruction decelles qui existaient : le constat est doncambigu et la question reste ouverte ; à toutle moins, il n’est pas impossible que lestourelles et les échauguettes aient jouécomme substitut de la tour.
En l’état des connaissances, l’élargisse-ment du champ de l’observation hors deFrance ne fournit guère plus d’exemplesillustrant le programme de l’hôtel aristo-
cratique de la fin du XIIIe siècle. Situerl’hôtel d’Harcourt parmi ses pairs dansl’Europe du Nord-Ouest, paraît en effetpresque aussi malaisé que ne l’est la tenta-tive de le comparer aux hôtels parisiens,du fait des destructions et de la carenceen recherches spécifiques. Ainsi Londres,principale ville occupant des fonctionset un rang comparable à celui de Parisà la fin du XIIIe siècle, a-t-elle connu lesmêmes destructions ; bien que les sources
documentent une centaine de demeuresdes Grands, tant ecclésiastiques quelaïques 94, seule l’architecture des pre-mières est quelque peu connue : lesdessins d’Ely Place, hôtel des évêques d’Ely,et les vestiges de la grande salle deWinchester’s House (79 pieds de long),dont le pignon conservé s’orne d’unegrande rose, en donnent une idée, mais elleest éloignée de la morphologie de l’hôteld’Harcourt 95.
Fig. 37 - Figeac, « château » Balène : restitution en vue à vol d’oiseau depuis le sud-ouest(dessin A.-L. Napoléone).
Le paysage autour de l’hôtel et duPalais des Thermes
Le corps de logis principal affrontait lesrues majeures et dominait le paysage urbain.La position du principal corps de logis peutsurprendre, car il était bordé sur trois côtéspar des rues découpant le tissu bâti en îlotsétroits et très allongés. Doit-on en déduireun état de densification importante duquartier, ou y voir simplement le résultatdu lotissement des jardins du Palais desThermes en vastes propriétés ? La situationparaît relever de ces deux processus. En effet,la rue du Palais / des Mathurins, fut ouverteau midi du Palais, dans ses jardins, peut-êtrepar la Ville de Paris qui était un des princi-paux propriétaires de l’ancien Palais 96.Quant à la rue des Maçons, c’était une rueancienne 97. Les actes de fondation ducollège de Sorbonne prouvent que l’urbani-sation du quartier était bien engagée aumilieu du XIIIe siècle : les propriétés dontRobert de Sorbon obtint la dévolution à sonœuvre étaient amplement bâties. L’angleouest des rues des Maçons et des Mathurinsétait occupé par la maison de Robert deDouay dès 1235 ; elle fut acquise après1254. De l’autre côté de l’hôtel d’Harcourt,la reine Blanche de Castille donna à Robertde Sorbon une maison face au Palais desThermes, rue Coupe-Gueule ; il en ajoutabientôt beaucoup d’autres situées au mêmeendroit ou aux environs et, en 1256, leroi lui donna « toutes les maisons rueCoupe-Gueule, devant l’Hostel des Bains,depuis la maison de Guillaume Pointain etJ. Henneinville jusqu’au bout » 98. L’insti -tution fondée par Robert de Sorbon se trou-vait donc propriétaire de la plupart desmaisons disposées sur la rive orientale de larue Coupe-Gueule, face à ce qui deviendrale pourpris de l’hôtel d’Harcourt. Il estremarquable que les maisons aient alors étédites « devant l’Hostel des bains ». Peut-onen déduire que cette emprise n’était pasencore connue comme appartenant auxseigneurs de Harcourt, mais était occupéepar une « baignerie » ? C’est un indice enfaveur d’une construction de l’hôtel et de sesdépendances après 1256.
Pourtant l’îlot n’appartenait pas à unquartier plein. Par certains côtés il gardait
un caractère rural, avec des granges et unpressoir en 1263 et en 1302, tenant à desmaisons 99. Ce faciès explique la possibilité,encore au milieu du XIIIe siècle, d’acquérirune grande parcelle. Il fallait du tempspour rassembler de telles surfaces, bien queles délais fussent moins longs s’il s’agissaitd’une portion de jardin, que du remem-brement de parcelles bâties, qui exigeaitquelques années 100. Au regard des délaisnécessaires à Robert de Sorbon pourconstituer le patrimoine du collège onformera plutôt, pour l’hôtel d’Harcourt,l’hypothèse de l’achat de grands morceauxde propriétés, dont peut-être cet « hosteldes Bains ».
Il est en revanche encore délicat desituer l’hôtel dans une géographie pré-cise des demeures des Grands sur la rivegauche 101. À proximité immédiate, lesCourtenay possédaient en février 1292 unlogis dans l’emprise du Palais des Thermes,parmi des maisons d’établissements ecclé-siastiques ou appartenant à de nombreuxartisans 102. Quant aux autres voisins laïcsd’un rang un tant soit peu élevé, c’est seule-ment vers 1300 qu’on identifie les hôtelsde proches du roi, celui de Guy Chevrier(sur la montagne Sainte-Geneviève) etcelui de Guillaume Courteheuse (près desBernardins), tous deux conseillers dePhilippe le Bel et de ses fils. Au total,en l’état des connaissances, les Harcourtparaissaient alors plutôt isolés dans leurhôtel de la rue des Mathurins. Il est possi-ble que cette impression soit imputable aumanque des données qui permettraient dedécrire leur voisinage immédiat dans lesannées 1260, période à laquelle il faut attri-buer la construction de la résidence desHarcourt.
Datation de l’édifice et recherche du commanditaire
On a déjà noté que, dès 1292, l’hôtelétait bien identifié comme celui du sire deHarcourt dans l’État des rentes et revenus duParloir aux bourgeois. Il est donc établi quela famille était ici possessionnée et que lepropriétaire était un seigneur laïc et non unecclésiastique. L’intérêt secondaire de cette
source est d’illustrer un point du droitfoncier : tout grand seigneur qu’était le sirede Harcourt, il devait payer à la Ville uncens récognitif de sa propriété éminente dusol, au titre de la seigneurie bourgeoisecollective dite fief du Parloir aux bourgeois.Cette situation désagréable de dépendantjuridique, dont les droits de propriétérestaient subordonnés à ceux des seigneursdu sol parisien, n’était pas exceptionnelle ;il la partageait avec les autres seigneurs quivoulaient posséder une résidence à Paris 103.
Il est un fait que, sur deux des tympansqui surmontaient des fenêtres à croiséede la salle basse du logis nord, figuraientdes écus aux armes des Harcourt, relevéspar Théodore Vacquer (fig. 38 à 40).Cependant leur interprétation a été contro-versée. Albert Lenoir émit en 1852 l’idée,opinion accréditée ultérieurement par laTHVP, que la construction ne serait pasattribuable à la famille Harcourt, appa-remment en se fondant sur l’existence deblasons estimés étrangers à ses armes :« … aux peintures retrouvées à l’intérieurse mêlaient des armoiries autres que cellesde la famille d’Harcourt, qui n’auraitpossédé l’hôtel que de seconde main. L’écude forme ancienne est du XIIIe siècle etporte de gueules, avec hermine en chef » 104.Cependant un doute s’insinua dansl’esprit de L.-M. Tisserand, continuateurd’Adolphe Berty, qui porta en note dans laTHVP : « En fait les branches deBeaumesnil et de Charantonne portaientde gueules à deux fasces d’hermine ». Or il estinfondé de dénier ces armes aux Harcourt,si l’on suit une proposition de Christian deMérindol qui a le mérite d’expliquer d’ap-parentes contradictions 105. L’écu de gueulesau franc-canton, ou franc-quartier, d’her-mine plain peut être lu comme de gueules àdeux fasces d’or (disparues) au franc-canton,ou franc-quartier d’hermine plain, soit l’écude la famille d’Harcourt avec cette brisure(i.e. d’hermine), les métaux ayant disparude la peinture murale. La présence de l’her-mine, qui a dérouté certains auteurs, n’em-pêcherait donc pas de reconnaître les armesde membres de la famille Harcourt.
Peut-on identifier le propriétaire desarmes peintes dans la salle basse ? Jean II,du vivant de son père Jean Ier († 1288),
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
152
brisait les armes familiales avec un lambeld’azur et ne porta les armes pleines qu’aprèsla mort de son père. On ne peut doncreconnaître dans les armes brisées au franc-canton d’hermine plain celles du chef defamille, Jean Ier jusqu’en 1288, puis Jean II,et pas plus celles de Jean du vivant de sonpère (il brisait alors au lambel).
Il y eut pourtant un moment où Jean IIput porter des armes brisées au franc-canton d’hermine plain. Les brisures étaienten effet différentes selon le rang : le futurJean II était un cadet en troisième position,par rapport au second fils Richard, du faitde la mort précoce de l’aîné, Philippe, quin’a jamais brisé. Or la brisure alors en usagepour ces cadets était bien le franc-quartierd’hermine plain et non le lambel. Dès lorson peut estimer que le franc-canton d’her-mine plain, adopté par Jean du vivant deson frère Richard fut, selon toute vraisem-blance, abandonné à la mort de ce dernieren 1269 : ce décès le plaçait en effet endeuxième position derrière son pèreJean Ier et, à partir de ce moment là, il dutbriser au lambel. En conséquence, cet écuserait celui du futur Jean II, avant la mortde Richard (1269).
Quant au second écu relevé, il pourraits’agir d’une mauvaise lecture de Vacquer, àmoins que ce dessin ne témoigne de laprésence de l’écu d’un Harcourt d’uneautre branche, Beaumesnil ou Avrilly ?
Au total, si l’écu reconstitué de gueulesà deux fasces d’or (disparues) au franc-canton d’hermine plain était celui du futur
Jean II, porté avant 1269, les peintures nepurent être exécutées qu’avant cette date.Il est donc légitime d’estimer que le corpsprincipal de l’hôtel, le logis nord, étaitachevé en 1269 et qu’il fut très probable-ment construit à la demande de Jean Ier, lefutur Jean II étant alors trop peu avancédans sa carrière. L’écu du chef de famille,Jean Ier, se trouvait sans doute ailleurs dansl’hôtel. Le style de la construction étant trèsmoderne, si le commanditaire n’avait pasété Jean Ier il eût fallut que celui-ci achetâtl’hôtel peu après sa construction. Or on avu ci-dessus qu’il est très probable que toutou partie de son emplacement ait étéoccupé par l’hostel des Bains jusqu’en1256. Sans être impossible, la successiond’une construction par un anonyme dansla décennie suivant 1256, puis d’un achatpar Jean Ier d’Harcourt avant 1269, estmoins probable qu’une construction parcelui-ci entre 1256 et 1269, soit, commeon le verra, pendant ses années de compa-gnonnage avec Saint Louis et avant la VIIIe
croisade.
La main de Pierre de Montreuil ?
Une telle chronologie est-elle compati-ble avec les éléments de datation tirés desformes et si tel est le cas, comment expli-quer la modernité de celles-ci ?
Deux des types des réseaux apparurentdans le milieu parisien un peu avant lemilieu du XIIIe siècle (fig. 25 et 26) et vers
1260 pour le plus récent (fig. 27). Lescomparaisons les plus pertinentes sontà faire avec le bras sud du transept deNotre-Dame de Paris, élevé par Pierre deMontreuil à partir de 1258 106. En effet, lescombinaisons des figures 25 et 26 se retrou-vent dans le transept nord de Notre-Dame(dans la rose pour la première et dans lesremplages aveugles au revers de la façadepour la seconde). En revanche, avant sagrande fortune, vers 1300, le motif de lafigure 27, constitué de lancettes aux têtesredentées sous un trilobe épointé inscritdans un triangle curviligne, ne trouved’équivalents que dans les remplages aveu-gles ouest et est, au niveau de la rose du brassud du transept de la cathédrale de Paris : lemotif principal fut simplement inversépuisque, à Notre-Dame, le triangle seprésente la pointe dirigée vers le bas alorsque le trèfle est posé sur un seul pétale. Endehors de la cathédrale, les comparaisons lesplus proches sont à établir avec les chapellesrayonnantes de la collégiale de Mantes, vers1270-1280, très inspirées par l’œuvre deJean de Chelles et par celle de Pierre deMontreuil à la cathédrale de Paris 107. Parailleurs, les feuillages cloqués et la base avecun renflement à la hauteur de la plinthe serencontrent dans les œuvres de Pierre deMontreuil, non seulement dans le bras sudde Notre-Dame, mais aussi sur les vestigesde la chapelle de la Vierge et du réfectoirede l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
Ainsi, si l’on suit l’argument héraldiquequi place la construction de l’hôteld’Harcourt après 1256 et avant 1269, leséléments les plus modernes des réseaux des
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
153
Cl. Bodet. Cl. Bodet. Cl. Bodet.
Fig. 38 - Détail du pignon ouest de l’aile nord :superposition des baies du rez-de-chaussée etde l’étage, avec emplacement des solives duplancher et blason (dessin, Th. Vacquer, 16 v°).
Fig. 39 - Blason des Harcourt : peint au reversdu tympan d’une des croisées du rez-de-chaussée du pignon rue des Maçons (dessin aucrayon, Th. Vacquer, 9 r°).
Fig. 40 - Blason des Harcourt : peint au reversdu tympan d’une des croisées du rez-de-chaussée du pignon rue des Maçons (Th. Vacquer,pl. INHA) [voir fig. 22].
baies, de la modénature et du décor nepeuvent, pour le moins, s’expliquer que parune très grande proximité avec l’œuvre dePierre de Montreuil, voire par l’œuvre dumaître lui-même. Il fallait pour cela que lecommanditaire fût proche des milieux dela création les plus en avancés, la courroyale et l’Église parisienne.
Une famille de grands seigneursnormands, proches du roi et
grands de l’Église
La famille comptait parmi les fidèles etles proches du roi de France depuisRichard de Harcourt († 1242), chevalierbanneret de Philippe-Auguste, qui futinvité au couronnement de Saint Louis àReims (1226) et à prendre part à uneassemblée des principaux seigneurs duroyaume en 1233 108. Son fils aîné, Jean Ier
(† 1288), surnommé le Prud’homme parSaint Louis qui le tenait en haute estime,accompagna le roi à la VIIe (1248-1254),puis à la VIIIe croisade (1268-1270). Sa vieest moins bien connue que celle de sesnombreux enfants, mais il est manifesteque ce seigneur connut une ascensionrapide et importante sous le règne du saintroi ; il s’imposa au premier plan, et préparal’éclatante réussite de sa nombreuse lignée,dès lors aux avant postes du service de lamonarchie.
Tous ses enfants firent en effet unecarrière remarquable, pour beaucoup trèsparisienne. L’aîné Jean II, dit le Preux,maréchal et amiral de France († 1302),servit successivement Saint Louis, Philippele Hardi et Philippe le Bel 109. Son frèreGuillaume († 1327) fut conseiller du roisous Philippe le Bel, maître de l’hôtel etgrand queux de France. Les frères ecclé-siastiques furent aussi brillants. Robert(† 1315) et Raoul († vers 1307), lespremiers universitaires de leur familleenseignèrent le Droit romain à Orléans.Robert fut ensuite conseiller de Philippe IIIle Hardi et de Philippe IV le Bel, évêquede Coutances (1291), et assuma des missionsdiplomatiques pour Philippe le Bel etdivers arbitrages à la demande du pape
Clément V. Raoul, après avoir rempli dehautes fonctions dans les diocèses deBayeux, d’Évreux, de Coutances et deRouen, fut chanoine de Notre-Dame deParis, aumônier de Charles de Valois etconseiller de Philippe le Bel. Guy († 1336),fut évêque de Lisieux (1303). Enfin Agnès(† 1291), abbesse du monastère desClarisses de Longchamp, écrivit une vie desainte Isabelle de France, sœur de SaintLouis, dont elle avait été demoiselle d’hon-neur. Dès le règne de Saint Louis la familleétait donc aux premiers rangs.
Le milieu auquel appartenaient cesgrands seigneurs est admirablement carac-térisé par certains détails consignés parLa Roque 110 : cet auteur relate que Jean IIfut nommé exécuteur testamentaire deJeanne de Châtillon, comtesse d’Alençon,veuve de Pierre d’Alençon, fils de SaintLouis, en compagnie de Pierre, évêqued’Orléans, Raoul de Clermont, sire deNesle et connétable de France, Mathieu,sire de Montmorency et chambellan deFrance, Pierre, sire de Chambly, et denombreux clercs. Il fut aussi exécuteurtestamentaire de Jeanne, comtesse de Blois,aux côtés de Pierre, évêque d’Orléans, deMathieu seigneur de Montmorency et deRaoul de Clermont, tous deux cités ci-dessus, ainsi que de Hugues de Blois, deGuy comte de Saint-Paul et de Jacques,frères de la dite comtesse. Il est donc établique le milieu dans lequel évoluaient àpartir du milieu du XIIIe siècle les membresde cette branche des Harcourt était celuide l’hôtel royal, du Conseil du roi et aussides plus hautes fonctions militaires.
Il n’y a donc rien de surprenant à cequ’un seigneur du rang de Jean Ier aitconstruit un hôtel d’une belle ampleur etde cette ambition architecturale, alorsmême que sa bonne fortune le plaçait aupremier plan des proches du roi. Une telledemeure, à la fois résidence de fonction etrésidence privée, était indispensable pourun commensal du souverain et affichait laréussite du constructeur et du lignage. Onne sait pourquoi la famille jeta son dévolusur ce quartier. Il est vrai, comme il a étéobservé ci-dessus, qu’en ce troisième quartdu XIIIe siècle la place ne devait pas y être
trop comptée et que l’on n’y était peu éloi-gné du palais de la Cité. Ce quartier centralde l’Université fut, en tout état de cause,prisé des fils de Jean Ier, dont on ne connaîtcependant pas les lieux de résidence : peuaprès la construction de l’hôtel familial lechanoine Raoul fonda un collège à proxi-mité de celui-ci (le collège d’Harcourt 111) ;un autre des frères de Jean II, Guy, fondaquant à lui le collège de Lisieux un peuplus haut et à l’est, au sommet de la collineSainte-Geneviève 112.
*
* *
Cette étude monographique, en dépitde quelques zones d’ombre, restitue laphysionomie d’un grand hôtel aristocra-tique du 3e quart du XIIIe siècle, apportantainsi une contribution précise à la connais-sance du milieu des grands seigneurs del’entourage du roi. Cet exemple est uniqueà ce jour. Elle suggère en outre leur proxi-mité avec les milieux qui produisaient alorsla nouveauté architecturale et propose uneréférence à ajouter à l’œuvre de, ou autourde, Pierre de Montreuil.
Elle atteste en outre qu’une approchede l’architecture domestique médiévale deParis est possible, même avant le XVe siècle.Il y faut certes des sources écrites point tropmuettes, des données architecturales suffi-samment complètes et des informationstopographiques un tant soit peu précises.Il serait sans doute possible de proposer lesmonographies d’autres résidences aristo-cratiques, tels l’hôtel de Bourbon ou l’hôteldu Chevalier du guet. L’étude de cesprogrammes est d’autant plus nécessaireque Paris est la moins bien connue des troisaires qui, en France, présentaient ouconservent encore des concentrationsremarquables de résidences importantesdes XIIe, XIIIe et XIVe siècles : le Sud-Ouestest quant à lui déjà bien étudié et, dans leSud-Est, si les palais avignonnais attendenttoujours un successeur du docteur Pansier,Villeneuve-lès-Avignon vient de bénéficierd’une étude fondamentale 113.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
154
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
155
Albert Lenoir, historien 2005Albert Lenoir, historien de l’architecture et archéo-logue, Catalogue, INHA, Paris, 2005.
Atlas de Paris au Moyen Âge 2006C. Lorentz et D. Sandron (dir.), Atlas de Parisau Moyen Âge, Paris, 2006.
Babelon 1972-1973J.-P. Babelon, « Histoire de l’architectureau XVIIe siècle », Annuaire de l’École Pratiquedes Hautes Études, IVe section, Extraits desrapports sur les conférences, 1972-1973, p. 501-508.
Babelon 1989J.-P. Babelon, « Naissance des beaux quartiers àParis », D’une ville à l’autre..., École française deRome, 1989, t. 122, p. 58-61.
Berty et al. 1897A. Berty, L.-M. Tisserand et C. Platon, Histoiregénérale de Paris. THVP, t. VI, Région centralede l’Université, Paris, 1897.
Berty et al. [1906]A. Berty, Th. Vacquer et G.-T. Petrovitch, Planarchéologique de Paris du XIIIe jusqu’au XVIIe siècle,dans Plan archéologique depuis l’époque romainejusqu’au XVIIe siècle, Topographie historique duVieux Paris, Paris, s. d. [1906], 19 pl.
Bove 2004B. Bove, Dominer la ville. Prévôts des marchandset échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, 2004.
Bruel 1887A. Bruel, « Notice sur la tour et l’hôtel du Pet-au-Diable, 1322-1843 », Mémoires de la Sociétéde l’histoire de Paris, 1887, t. 14, p. 239-256.
Cazelles 1972R. Cazelles, Paris de la fin du règne de PhilippeAuguste à la mort de Charles V (1223-1380),Nouvelle Histoire de Paris, Paris, 1972.
Chapelot et Rieth 2006O. Chapelot et B. Rieth, « Dénomination etrépartition des espaces. Les résidences descomtes d’Artois en Ile-de-France (fin XIIIe - 1ère
moitié XIVe siècle », dans Cadres de vie etmanières d’habiter (XIIe-XVIe siècle), Caen, 2006,p. 103-108.
Cilleuls 1885A. des Cilleuls, Le domaine de la ville de Parisdans le présent et dans le passé, Paris, 1885.
Garrigou Grandchamp 2002P. Garrigou Grandchamp, « Les résidencespatriciennes dans le Sud-Ouest de la France, duXIIe au XIVe siècle », dans G. Meirion-Jones,E. Impey et M. Jones (éd.), The SeigneurialResidence in Europe, Oxford, 2002, p. 63-87.
Guérout 1949-1951J. Guérout, « Le palais de la Cité à Paris desorigines à 1417. Essai topographique et archéo-logique », Mémoires de la Fédération des Sociétéshistoriques et archéologiques de Paris et de l’Ile-de-France, 1949, t. I, p. 57-212 ; 1950, t. II, p. 21-204 ; 1951, t. III, p. 7-101.
Hoffbauer 1875-1882 et [1980]F. Hoffbauer, Paris à travers les âges, Paris, 1875-1882, 2 vol. in fol° ; reprint, Paris, s.d. [vers1980].
Jaillot 1772-1775J.-B. Michel Renou de Chaviné, dit Jaillot,Recherches critiques historiques et topographiquessur la ville de Paris depuis ses commencementsjusqu’à présent, Paris, 1772-1775, 5 vol. et atlas.
La famille d’Harcourt 1979La famille d’Harcourt, histoire, iconographie, Artde Basse-Normandie, n° 78, 1979.
La Roque 1662G.-A. de La Roque de La Lontière, Histoiregénéalogique de la maison de Harcourt…, Paris,4 vol., 1662 (Publication numérique, Versailles,2004). Table des familles étudiées par P. de Farcyet Preuves généalogiques et historiques de lamaison de Harcourt, Paris, 1907.
Lefeuve 1873L’historiographe Lefeuve, Les anciennes maisonsde Paris sous Napoléon III, Paris, 1873, t. V.
Legrand 1868H. Legrand, Paris en 1380. Plan de restitution.Histoire générale de Paris, Paris, 1868.
Lenoir 1852-1853« Rapport de M. Albert Lenoir, membre ducomité, sur les découvertes produites par lesrécents travaux de construction et les perce-ments de rues nouvelles exécutés à Paris »,Bulletin du Comité de la langue, de l’histoire etdes arts de la France, Paris, 1852-1853, t. 1,p. 413-421.
Le Roux de Lincy 1846aM. Le Roux de Lincy, Histoire de l’hôtel de ville
de Paris, suivie d’un Essai sur l’ancien gouverne-ment municipal de cette ville, Paris, 1846.
Le Roux de Lincy 1846bM. Le Roux de Lincy, « Recherches sur lespropriétaires et les habitants du Palais desThermes et de l’hôtel de Cluny… dans l’inter-valle des années 1218 à 1600 », Mémoires de laSociété des Antiquaires de France, 1846, t. XVIII,p. 23-62.
Mesqui 1988J. Mesqui, Île-de-France gothique, 2. Lesdemeures seigneuriales, Paris, 1988.
Mesqui 1993J. Mesqui, Châteaux et enceintes de la Francemédiévale, De la défense à la résidence, Paris,1993, t. 2.
Meunier 2004Fl. Meunier, « Le renouveau de l’archi-tecture civile sous Charles VI, de Bicêtre àl’hôtel de Bourbon », dans La création artistiqueen France autour de 1400, Paris, 2006, p. 219-246.
Michaelsson 1962K. Michaelsson, Le livre de la taille de Paris l’an1297, Göteborg, 1962.
Paris et Charles V 2001F. Pleybert (dir.), Paris et Charles V. Arts et archi-tecture, Paris, 2001.
Pinon et al. 2004P. Pinon, B. Le Boudec et D. Carré (dir.), Lesplans de Paris. Histoire d’une capitale, Paris,2004.
Roblin 1964M. Roblin, « Au quartier Latin. Les résidencesde la grande noblesse provinciale », LaMontagne Sainte-Geneviève et ses abords, février1964, t. XXXII, p. 1-5.
Roux 1991S. Roux, « Résidences princières parisiennes :l’exemple de l’hôtel de Bourbon, fin XIVe-milieuXVe siècle », dans Fürstliche Residenzen imspätmittelalterlichen Europa, éd. H. Patze etW. Paravicini, Sigmaringen, 1991, p. 75-101.
Sauval 1724, 1974H. Sauval, Histoire et recherches des Antiquités dela ville de Paris, Paris, 1724, 3 vol. ; rééd. Paris-Genève, 1974.
BIBLIOGRAPHIE
Semmler 1966J. Semmler, « Die Residenzen der Fürstenund Präläten im Mittelalterlichen Paris (12.-14.Jahrhundert) », dans Mélanges offerts à R. Crozet,1966, t. III, p. 1217-1234.
Sournia et Vayssettes 2006B. Sournia, J.-L. Vayssettes, Villeneuve-lès-Avignon.
Histoire artistique et monumentale d’une villé-giature pontificale (coll. « Cahiers du Patri -moine », n° 72), Paris, 2006.
Verdier et Cattois 1858A. Verdier et F. Cattois, Architecture civile etmilitaire au Moyen Âge et à la Renaissance, Paris,1858, 2 t.
Viollet-le-Duc 1854-1868E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecturefrançaise du XIIIe au XVIe siècle, Paris, 1854-1868, 10 vol.
Willesme 1979J.-P. Willesme, Sculptures médiévales (XIIe siècle -début du XVIe siècle), Catalogues d’art et d’his-toire du Musée Carnavalet, Paris, 1979.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
156
NOTES
1. Le témoin immédiat le plus sûr est ThéodoreVacquer, qui assista au dégagement et à la destructiondes vestiges de l’hôtel ; tous les dessins et relevés effec-tués sur le terrain sont attribués à l’année 1852 :Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP),Papiers Vacquer, ms. 237, « Hôtel d’Harcourt,1852 ». Alexandre Lenoir rendit compte des évène-ments la même année : Lenoir 1852-1853, p. 418-419, rubrique « Hôtel d’Harcourt ». Berty et al. 1897,p. 309 : reprise de la même chronologie.
2. Lenoir 1852-1853, p. 418-419.
3. Sauval 1974, t. 2, p. 239. Jaillot 1772, p. 98.
4. Lenoir 1852-1853, p. 418-441.
5. C’est à cet effet que Th. Vacquer dut composer dès1852 les quatre planches conservées à l’InstitutNational d’Histoire de l’Art (INHA) dans leFonds Lenoir, Boîte IV : Édifices civils et militaires,cote OA 716, intitulées : « Hôtel d’Harcourt. Rue desMathurins – Saint-Jacques ».
6. Hoffbauer [1980], Le Petit Châtelet et l’Université,chap. 1, p. 31, fig. 37 et pl. VI, Topographie du quar-tier de l’Université.
7. Topographie Historique du Vieux Paris (citée commeTHVP par la suite) : Berty et al. 1897, p. 307-309 ;Berty et al. [1906], pl. XIV.
8. Jaillot 1772, p. 98 : « On voit au coin de cette rue[des Maçons], du côté des Mathurins, les restes d’unechapelle qui faisait partie d’un grand hôtel que lescomtes de Harcourt avaient en cet endroit ». Lenoir1852-1853, p. 418-419 : la démolition des maisonsbâties vis-à-vis l’hôtel de Cluny « … a fait voir qu’ellesoccupaient toute l’étendue de la chapelle parti-culière de l’hôtel d’Harcourt, construite vers la fin duXIIIe siècle ».
9. Hoffbauer [1980], p. 31.
10. Les exceptions concernent l’hôtel d’Artois –Bourgogne (dont la tour de Jean sans Peur) et l’hôtelde Bourbon, plus jeunes d’un siècle ; encore mérite-raient-ils une monographie exhaustive.
11. L’art au temps des rois maudits. Philippe le Bel etses fils, 1285-1328, Catalogue d’exposition, 1998.Topographie historique : Roblin 1964. Semmler1966.
12. Albert Lenoir, historien…, 2005, p. 21 (reproduc-tion de trois planches de Th. Vacquer).
13. L’hôtel d’Harcourt paraît n’avoir fait l’objet d’au-cune publication au cours du XXe siècle. Le ducd’Harcourt s’y était intéressé dans les années 1970,
mais ne livra pas le résultat de ses recherches(La famille d’Harcourt 1979, p. 3). Une planche deThéodore Vacquer est reproduite dans l’Atlas de Parisau Moyen Âge 2006, p. 210.
14. E. Morieu : B.n.F., Est., Va 260d fol. Hoffbauer[1980], Le Petit Châtelet et l’Université, chap. 1, pl. VI,Topographie du quartier de l’Université.
15. Il n’a pas été possible de reprendre une rechercheexhaustive, qui risquait d’être sans fin, dans tous lesfonds susceptibles de livrer des informations surl’hôtel lui-même, son environnement immédiat oules membres de la famille d’Harcourt. Nous noussommes borné à la consultation des ouvrages cités enbibliographie. Il nous est en outre agréable de remer-cier madame Y.-H. Le Maresquier-Kesteloot, qui abien voulu faire des vérifications à notre profit et n’apas repéré d’acte qui n’ait été publié ou utilisé par lesauteurs cités en bibliographie.
16. BHVP, Papiers Vacquer, ms. 237, 242 et 251.Hormis deux planches, tous les autres dessins appar-tiennent au ms. 237 ; en conséquence, dans le reste dutexte, les références abrégées ne comportant que lenuméro d’une page, et l’indication « r° » ou « v° », serapportent par convention au ms. 237.
17. Hoffbauer [1980], Le Petit Châtelet et l’Université,chap. 1, p. 31, fig. 37.
18. A. Bonnardot, Iconographie du Vieux Paris, BHVP,ms., t. 2, p. 450.
19. Les dates des plans ici indiquées sont cellesretenues dans Pinon et al. 2004.
20. Même curieuse omission sur le plan restitutif Parisen 1380 dans Legrand 1868.
21. Pinon 2004, p. 30. A. Bonnardot, Études archéo-logiques sur les anciens plans de Paris, réédition, Paris,1994, p. 56-66.
22. Il est bien dans l’emprise indiquée par le planprécédent et la partie lisible du nom de l’hôtel leconcerne.
23. Hoffbauer [1980], Le Petit Châtelet etl’Université, chap. 1, pl. VI, Topographie du quartierde l’Université.
24. Berty et al. [1906], plan de synthèse et plan XIV(BHVP, A 102). Les mêmes dispositions étaient déjàindiquées par un plan antérieur : A. Berty, Plan duquartier de la Sorbonne en 1470, 1876, BHVP, B 448et B.n.F., Est., 259a Fol.
25. Paris et Charles V 2001, p. 7.
26. Atlas de Paris au Moyen Âge 2006, p. 106.
27. Berty et al. 1897, p. 307-309.
28. Michaelsson 1962, p. 409, dans la premièrequeste saint-Benoît (i.e. aux environs de la rue Saint-Jacques) : « Du coing Saint-Mathelin jusqu’à lamaison au Seigneur de Harcourt ».
29. Lenoir 1852-1853, p. 418.
30. Le Roux de Lincy 1846a, p. 110.
31. Sauval 1724, t. 2, p. 239 : « Les comtes d’Harcourtont eu près de deux cents ans à la rue des Mathurins,au coin de celle des Maçons, un grand et vieux logis,accompagné d’un jardin assez spacieux, qu’on appelaitl’Hôtel d’Harcourt, et que le peuple mal-à-proposnomme le Palais de Julien l’Apostat ».
32. Sauval 1724, t. III, p. 261.
33. Arch. nat., MM 154, fol. 44. Nous devons cetteréférence, comme la suivante, à Étienne Hamon.Qu’il reçoive ici le témoignage de notre gratitude.
34. Arch. nat., MC, Et. VIII, 50, 20 avril 1512.Analyse succincte dans É. Hamon, Documents duminutier des notaires de Paris, Art et architecture avant1515, Paris, Archives nationales, 2009, analysen° 177. Ce Jean Bauldry est-il le même ou un parentd’un homonyme, conseiller au Parlement en 1475(Ph. de Commines, Mémoires, À Paris, chez Rollin,1747, p. 453) ?
35. Jaillot 1782, t. II, p. 98 : « Il appartint sans douteensuite à la maison de Lorraine ; car dans le 18e
compte de François de Vigni, receveur du domainede la Ville, pour l’année finie à la Saint-Jean 1574, ilénonce « l’hôtel de Harcourt, dit de Lorraine, appar-tenant de présent à M. Gilles Le Mestre, Président enla Cour de Parlement ». Cet hôtel a passé depuis àM. Le Mestre de Ferrières ».
36. BHVP, Papiers Berty, Plan archéologique – Rues deParis, cote provisoire 3267, t. 21, doc. 174. Cesrenseignements sont portés sur le Plan archéologiquede Paris…, Berty et al. [1906], plan XIV (BHVP,A 102).
37. THVP, citant Arch. nat., S 6211.
38. Le Roux de Lincy 1846b, p. 46, Comptes de l’Hôtelde ville pour 1574 et 1575 : « Du comte d’Harcourtpour sa maison faisant le coin de la dite rue des Maçonsassise devant le Palais des Thermes. C’est la maison duprésident Lemaistre ». Lefeuve 1873, p. 485 : « Le 5 etle 7 vous représentent l’ancien hôtel de Ferrières,antérieurement d’Harcourt... M. Souchon desPréaux, avant la grande révolution, était propriétaire
L’HÔTEL DES SEIGNEURS DE HARCOURT À PARIS, UNE RÉSIDENCE ARISTOCRATIQUE DE LA FIN DU XIIIe SIÈCLE
157
de six maisons, dont l’une occupait le coin de la ruedes Mathurins ; les cinq autres suivaient la rue desMaçons, et tout le reste sur cette ligne à la suite deSorbonne. Or la châtellenie de Ferrières fut élevée enmarquisat par lettres du mois de juillet 1655 en faveurde Jean Le Maistre, Conseiller au Parlement de Paris,mais Jean et Gilles Le Maistre, père et grand-père de cemagistrat… et l’ayant aussi précédé dans la rue desMaçons – Sorbonne, étaient déjà seigneurs deFerrières… Avant les Le Maistre, Henri de Lorraine,comte d’Harcourt, avait eu la même résidence… »(note rédigée en 1862).
39. Cilleuls 1885, p. 140.
40. Original : Arch. nat. 1884. Copie à la BHVP, G216a : les parcelles 6 et 7 sont à monsieur La Coupelleet la parcelle 8 au marquis de Ferrières, alias Le Mestre.
41. Ph. Vasserot et Bellanger, Atlas général des 48quartiers de la Ville de Paris, 1810-1836, Arch. nat.,F31* 73 à 96, f° 148.
42. Willesme 1979.
43. Elles n’ont pas été représentées sur la restitutionpartielle 4 v°, mais apparaissent sur la restitution finale.
44. Voir les coupes en fig. 10 (4 v°) et fig. 2 (ms. 251,131 r°).
45. BHVP, ms. 237, 140v°.
46. Voir les citations de J.-B. Jaillot et A. Lenoir en note 8.
47. Berty et al. 1897, p. 309 : « on dégagea ce qu’ilrestait des bâtiments de l’hôtel en 1852, notammentles deux pignons est et ouest, et ces vestiges furentdétruits ». Atlas de Paris au Moyen Âge 2006, p. 210.
48. Albert Lenoir, historien… 2005, p. 21.
49. Mesqui 1993, p. 112-117.
50. Note Vacquer, 16 r° : « Dans les fenêtres, clôturedormante dans le réseau + clôture sur le ch. ou ouvrantedans le bas sur arrière du meneau perpendiculaire »(les volets battaient donc contre le meneau, sous latraverse).
51. Écus différents : 9 r° et 16 v° ; détail sur plancheINHA. Lecture et interprétation ci-dessous.
52. L’archéologue n’indique pas le lieu des découverteset ne se hasarde pas à une hypothèse quant à leuremplacement originel et à leur fonction. Une mentionmanuscrite au 9 r° fait seulement connaître que l’und’eux vient d’être découvert : ils étaient donc soitmasqués par des maçonneries postérieures, soit enremploi. Leur bon état et la conservation des poly-chromies militent en faveur de leur maintien en place,emmurés.
53. J. Mesqui, « Le château de Pierrefonds. Unenouvelle vision du monument », Bull. mon., 2008,t. 166, p. 231-232 et fig. 40.
54. Viollet-le-Duc 1854-1868, t. V, 1861, p. 383 etsuiv.
55. P. Garrigou Grandchamp, « L’architecture domes-tique dans les pays de l’Oise aux XIIIe et XIVe siècles »,dans L’art gothique dans l’Oise et ses environs Beauvais,GEMOB, 2001, p. 126-158.
56. Provins : Verdier et Cattois 1858, t. 1, p. 120-121et pl. 10. Reims : A. Laprade, Carnets, 1942, t. II,pl. 11.
57. D. Pitte, « Caudebec-en-Caux, maison dite “desTempliers” et édifices civils médiévaux en pierre », dansCongr. arch. de France. Rouen et Pays de Caux, 2003,p. 48-56. Boos : Fr. Épaud, De la charpente romane àla charpente gothique en Normandie, Caen, 1997,p. 547-551.
58. Verdier et Cattois 1858, t. 2, p. 108. Th. Crépin-Leblond, « Le domaine du Tortoir (abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois) », Congr. arch. de France. Aisneméridionale, 1990, t. 2, p. 673-687 (fenêtres p. 678 et684).
59. Tours : datation de la charpente après 1277 : A. deSaint-Jouan, « Exemples de datations de charpentes enTouraine… », Bulletin de la Société Archéologique deTouraine, 1998, t. 45, p. 463-500, ici p. 485-487.Dessins dans P. Garrigou Grandchamp, « Consi -dérations sur l’architecture domestique des 12e-14e
siècles à Châteauneuf », dans H. Galinié (dir.), Toursantique et médiéval, Tours, 2007, p. 261-274.
60. Les maisons de Flavigny, Bruniquel et Gimont sontinédites. Figeac : A.-L. Napoléone, Figeac au MoyenÂge : les maisons du XIIe au XIVe siècle, Thèse de doctorat,Université de Toulouse - Le Mirail, 1993 (éd. Figeac,1998), vol. II, fig. 348 ; Paris, Médiathèque del’Architecture et du Patrimoine, plan n° 31336.Aurillac : M. Lavenu, « L’habitation civile romane àAurillac », L’habitation à l’époque romane, Issoire, 2004,p. 47-66 (ici p. 62).
61. M. Scellès, Cahors, ville et architecture civile auMoyen Âge, Paris, 1999, p. 136-137.
62. Mazères : O. Meslay, « Un inventaire du château deMazères en 1318 », Bulletin de la Société archéologique,historique, littéraire et scientifique du Gers, XCIVe année,1993, p. 145 et suiv. Roquetaillade : B. Larrieu et J.-F.Duclot (dir.), Léo Drouyn et le Bazadais méridional,collection Léo Drouyn. Les albums de dessins, t. 6, 2000,p. 148-153. Mirefleurs : B. Phalip, Auvergne etBourbonnais gothiques. Le cadre civil, Paris, 2003, p. 63.Saint-Floret : G. Fournier, Châteaux et villes d’Auvergneau XVe siècle d’après l’armorial de Guillaume Revel,Paris, 1973, fig. 69. Nous n’en avons trouvé aucunautre exemple dans les ouvrages de J. Mesqui.
63. Viollet-le-Duc 1854-1868 : 1864, t. VII, p. 8 et1866, t. VIII, p. 83. Pour la chronologie de la construc-tion de la grande salle voir Jean Guérout (Guérout1950, p. 29 et suiv. : entre 1301 et 1315).
64. Collège de Cluny : dessin BHVP, ms. 237, n° 140 r°.La construction des bâtiments fut l’œuvre des abbésYves de Vergy et Yves de Chassant, entre 1260 et 1289 :Ph. Racinet, Crises et renouveaux. Les monastères cluni-siens à la fin du Moyen Âge, Arras, 1997, p. 100. Lachronologie demande à être précisée.
65. Th. Vacquer donne un fragment de peinturemontrant un rameau de vigne et une feuille de fougère,sans indiquer sa provenance (planche en couleurs del’INHA, fig. 28).
66. Collège de Cluny : BHVP, ms. 237, n° 120 r° et140 r°.
67. Tourelles développées en échauguettes : à Paris(Palais : pignon ouest de la grande salle : Viollet-le-Duc1854-1868, t. 7, 1864, p. 8) ; dans l’Aisne : évêché deLaon (Viollet-le-Duc 1854-1868, t. VII, 1864, p. 20),manoir du Tortoir, à Saint-Jean-aux-Bois (Verdier etCattois 1858, t. 2, p. 108) et maison forte de Marizy-Saint-Mard (Mesqui 1988, p. 391).
68. Babelon 1973.
69. Comparer avec les crédences de l’église desBernardins, construite à partir de 1338 : Willesme1979, p. 161.
70. 66 r° : profil avec indication des couleurs et note« profil… avec les repeints du XIVe siècle ».
71. 25 r° : profil avec indication des couleurs ; 37 r° :restitution en couleurs.
72. L’hôtel d’Artois vient de bénéficier d’une étude quia repris l’analyse des sources : Chapelot et Rieth 2006.
73. INHA, Fonds Lenoir, cote OA 716, boîte IV, Édi -fices civils et militaires, plan de la cave, à la plume, etdessin préparatoire du plan au crayon, coté, avec indica-tion du plan et des élévations des retombées des voûtes.
74. Pinon et al. 2004, p. 58.
75. Berty et al. [1906], Plan archéologique…, pl. XIV.
76. Les évaluations sont approximatives, car lesdonnées du Plan archéologique… et celles du pland’Albert Lenoir ne concordent pas (il indique lalongueur entre le nu du mur nord de la cave et « le trot-toir moderne de la rive nord de la rue des Mathurins » ;de plus, le relevé diffère du plan achevé). Dans lesgrandes demeures patriciennes du Midi la surface descours variait de 100 m2 à près de 300 m2 : GarrigouGrandchamp 2002.
77. Sauval 1724, t. 2, p. 239.
78. Berty et al. 1897, p. 311-312.
79. Sournia et Vayssettes 2006, p. 101 : on parle de la« petite Bologne » ou de la « petite Poitiers ».
80. Hôtel des Roger, puis de Canilhac : Sournia etVayssettes 2006, p. 166 (carte) et 171-172.
81. La surface des grandes salles des hôtels urbains duMidi variait de 100 à 200 m2 : Garrigou Grandchamp2002. Celle des palais cardinalices de Villeneuve-lès-Avignon était un peu supérieure, entre 180 et 260 m2 :Sournia et Vayssettes 2006, p. 91.
82. Datations établies par dendrochronologie pourAuxerre, Chartres et Laon : voir P. Hoffsummer etJ. Mayer (dir.), Charpentes du XIe au XIXe siècle. Typologieet évolution en France du Nord et en Belgique, Paris,2002, p. 158. Beauvais : P. Garrigou Grandchamp,« L’architecture domestique dans les pays de l’Oise auxXIIIe et XIVe siècles », L’art gothique dans l’Oise et ses envi-rons, Beauvais, 2001, p. 131 et 142. Laon : Th. Crépin-Leblond, « Le palais épiscopal de Laon », dans Congr.arch. de France. Aisne méridionale, 1990, t. 2, p. 369-394. Autres salles : aucun plan publié.
83. Réfectoire du collège de Cluny : plans de Th.Vacquer à la BHVP, ms. 237, n° 127r° et 144r°.
84. Hôtel d’Artois : les dimensions de la salle dansMesqui 1993, p. 167, donnent une surface de 167 m2
(22,60 x 7,40 m), alors qu’Odile Chapelot et BénédicteRieth l’estiment à 283 m2 (Rieth et Chapelot 2006,p. 107).
85. Sauval indique une longueur de 35 toises pour unelargeur de 18 pas communs ; cf. Meunier 2006, p. 237.
86. Mesqui 1993, p. 78-79.
87. Sens : Viollet-le-Duc 1854-1868, t. VIII, 1866, p. 76.Coucy : Mesqui 1993, p. 100 et 151. Saumur : resti-tution par G. Mester de Parajd, ACHM, en 2003.
88. À cet égard Albert Lenoir surestime la fonctiondéfensive : « Les deux pignons de cette chapelle ont faitvoir que des moyens de défense étaient aménagés surtoutes les parties des habitations particulières » (Lenoir1852-1853, p. 419). On peut contester l’emploidu vocable « militaire » à propos de l’intégration d’élé-ments « militaires » dans des hôtels (Meunier 2006,p. 239).
89. Exemple du début du siècle à l’hôpital deCompiègne et de la fin du siècle au manoir du Tortoir :Verdier et Cattois 1858, t. 2, p. 148 et 108. Aux portesde la capitale, le pignon du réfectoire de l’abbayeSainte-Marie de Breteuil (Viollet-le-Duc 1854-1868,t. IV, 1859, fig. 224-228) offrait, avant le milieu duXIIIe siècle, une composition à tourelles d’angle, contre-fort central, bandeaux larmiers, mais sans rose ni gale-rie, ce qui confirme le statut de ces organes et leurappartenance au vocabulaire d’une architecture relevée.
90. P. Liévaux, Les écuries des châteaux français, Paris,2005, p. 35-42 : écuries dans les basses-cours.
91. Bove 2004, p. 163-165 : celliers des grands hôtelsbourgeois.
92. Bruel 1887, p. 6 : en 1379 Raoul de Coucy, cheva-lier, seigneur d’Encre et de Montmirail-en-Brie,conseiller du roi, acquit l’hôtel plus tard appelé deSaint-Mesme ou du Pet-au-Diable, soit « une maison,tour, court et jardin, séant à Paris, au Martelet Saint-Jehan en Grève, pour 3000 francs or ». Raoul de Coucyétait le troisième fils de Guillaume, sire de Coucy ; ilépousa Jeanne d’Harcourt, fille de Jean, comted’Harcourt.
93. La question des tours privées à Paris a été esquisséepar Jean-Pierre Babelon en 1973. Un grand bourgeoisproche du roi, Jean Billouart, en possédait deux dans lesannées 1310-1320, celle du Pet-au-Diable et la tourdite Billouart (Bruel 1887, p. 20). Il faudrait aussireprendre l’étude de trois hôtels sis dans la Cité : l’hôteldes Ursins, la tour dite « de Dagobert », 18, rueChanoinesse (attestée en 1120 comme domus adturrim : Babelon 1973) et l’hôtel d’Étienne deGarlande, appelé « palais » vers 1127 (L. Grant, F.Hébert-Suffrin et D. Johnson, « La chapelle Saint-Aignan à Paris », Bull. mon., t. 157, 1999, p. 283-299).
94. J. Schofield, « Medieval and Tudor DomesticBuildings in the City of London », Medieval Art,Architecture and Archaeology in London, 1990, p. 16-28(ici p. 19-21). Voir aussi M. B. Honeybourne, « Thereconstructed Map of London under Richard II »,London Topographical Record, t. 22, 1965, p. 29-76.
95. J. Schofield, The building of London from theConquest to the Great Fire, Londres, 1984, p. 65 (ElyPlace), 81 et 94 (Winchester’s House).
96. Le Roux de Lincy 1846b, p. 27 et 30. L’auteur sefonde essentiellement sur le Livre des sentences du parloiraux bourgeois, années 1268-1325, « État des rentes etrevenus du Parloir aux bourgeois de février 1292 ».
97. Rue des Maçons : vicus cimentarium en 1254.Lefeuve 1873, p. 482. Berty et al. 1897, p. 305
98. Rue des Maçons : Berty et al. 1897, p. 307. RueCoupe-Gueule, ibid., p. 119-120 et 424.
99. Legrand 1868, p. 48, note 3 et Berty et al. 1897,p. 136 : rue du Foin, au nord du Palais des Thermes.
100. Roux 1991, p. 77 : acquisitions du duc Louis 1er
pour le premier hôtel de Bourbon, entre 1303 et 1312.
101. La géographie des demeures des princes et desgrands seigneurs aux XIIIe et XIVe siècles a été esquisséepar Semmler 1966, p. 1217-1234, Cazelles 1972,p. 19-23, Babelon 1989, p. 58-61 et Roux 1991, p. 93et suiv. Plus axée sur la rive gauche, Roblin 1964.Aucune de ces études ne rassemble toutes les informa-tions disponibles sur les règnes de Saint Louis et de sonfils, ni sur ceux de Philippe le Bel et de ses fils et il estdonc hasardeux de tenter des comparaisons. Un récentaperçu dans l’Atlas de Paris au Moyen Âge (2007,p. 108-109) ignore l’hôtel d’Harcourt.
102. Le Roux de Lincy 1846a, p. 114, § La rue duPalais : « La meson misire Robert de Cortenay, duPalais de Termes, X deniers obole ».
103. Roux 1991, p. 95 : « La dépendance était légère finan-cièrement, mais, socialement, elle était désagréable... ».
104. Lenoir 1852-1853, p. 419.
105. Il nous est agréable de remercier Christian deMérindol pour son aide efficace dans la lecture desarmes portées sur les écus figurant sur plusieurs relevés.Nous reproduisons ici sa lettre du 3.06.2007 : « L’écude gueules au franc-canton, ou franc-quartier, d’hermineplain peut être lu comme de gueules à deux fasces d’or(disparues) au franc-canton, ou franc-quartier d’hermineplain, soit l’écu de la famille d’Harcourt avec cettebrisure. Les couleurs résistent mieux que les métaux surune peinture murale.
Jean II, du vivant de son père Jean Ier († 1288), brise lesarmes familiales avec un lambel d’azur, d’après l’armo-rial Wijnbergen (1270-1285) et un sceau de la collec-tion Clairambault (1284). Après la mort de son père,il porte les armes pleines d’après l’armorial ChiffletPrinet (1285-1298).
La brisure des armes familiales dans l’écu en questiontrouve une explication. Dans un premier temps, pourl’écu de Jean (qui est cadet en 3e position, par rapportau chef de famille, qui est le 2e fils, l’aîné Philippe, mortjeune, ne brisant pas), est retenue la brisure alors enusage pour ces cadets, le franc-quartier d’hermine plain.Ce type de brisure est fréquemment adopté au XIIIe
siècle et au début du siècle suivant par les cadets desmaisons nobles en France du Nord, aux Pays-Bas, enAngleterre et en Écosse. Cette brisure, selon toute vrai-semblance, est abandonnée [par Jean] à la mort de sonfrère, en 3e position, Richard, en 1269 » : ce décès leplaçait en deuxième position et il dut à partir de cemoment là briser au lambel. En conséquence, cet écuserait celui du futur Jean II, avant la mort de Richard(1269).
L’emploi de l’hermine comme brisure est aussi retenupar son oncle Robert, seigneur de Beaumesnil, égale-ment cadet en 3e position, qui, d’après le père Anselme,est vivant en 1270. Ses armes, et celles de son filsRobert II († 1313), sont de gueules à deux fasces d’her-mines, au lieu de deux fasces d’or, d’après l’armorialWijnbergen (1270-1285) et un sceau de Normandiepublié par Demay (1301).
Quant à Richard, d’après l’armorial Glover’s Roll, duXIIIe siècle, il devait briser en inversant les émaux duchamp et du meuble, soit d’or à deux fasces de gueules.
La présentation de l’écu en question, suspendu par unecourroie, ainsi que sa forme correspondent volontiers àl’époque de Jean II. Le second écu relevé, semblable parsa présentation et sa forme, est un écartelé d’hermine etde gueules. Il s’agit sans doute d’une mauvaise lecture ».
106. Nous savons gré à Philippe Plagnieux des nom -breuses observations qui permettent ces conclusions.
107. Cl. Lautier, « Les remplages aveugles de Jean deChelles et de Pierre de Montreuil à Notre-Dame deParis », dans Architecture et sculpture monumentale du12e au 14e siècle, Mélanges offerts à Peter Kurmann,2006, p. 129-141. Y. Gallet, « Les chapelles du chevetde la collégiale de Mantes. Un petit chef-d’œuvre dugothique rayonnant », Bull. mon., 2005, t. 163, p. 101-114.
108. Les notes biographiques sont extraites de LaRoque 1662 et de Marie d’Harcourt, « Les Harcourtdu Xe siècle au XXe siècle », dans La famille d’Harcourt1979, p. 9-10.
109. Ayant accompagné Charles d’Anjou en Sicile, ilréchappa du massacre des vêpres siciliennes (1282).Maréchal de France (1283), il suivit le roi dans la croi-sade d’Aragon (1285). Pour la guerre d’Angleterre(1295), le roi le nomma lieutenant-général de l’arméenavale avec Mathieu IV de Montmorency. En 1302, ànouveau avec Charles de Valois en Sicile, il mourut demaladie au retour de l’expédition, le 21 décembre1302, laissant pour exécuteur testamentaire son frèreRaoul, chanoine de Notre-Dame : La Roque 1662,p. 348.
110. La Roque 1662, p. 348.
111. Contrairement à ce qui a été fréquemmentavancé, il semble que le chanoine était toujours vivanten 1303 : Le Roux de Lincy 1846a, Livre des sentencesdu parloir aux bourgeois, années 1268-1325 , p. 157,5 août 1303 : « Permission accordée a Raoul deHarecourt de faire venir par eau 12000 ardoises pourcouvrir sa maison (Plege monseigneur Pierre Hardi sonchapelain) ».
112. Proche de l’hôtel et destiné aux étudiants pauvresdes quatre diocèses où Raoul avait rempli des fonctionsecclésiastiques, le collège d’Harcourt fut organisé àpartir des années 1280 ; après sa mort, son frèrel’évêque Robert mena à bien la fondation. Guy fondaen 1336 le collège de Lisieux sur le modèle du collèged’Harcourt.
113. Sud-Ouest : bibliographie dans P. GarrigouGrandchamp 2002. Sud-Est : P. Pansier, Les palaiscardinalices d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, Avignon,1926-1932 et Sournia et Vayssettes 2006.
Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP
158