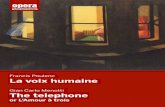La dignité de la personne humaine
-
Upload
univ-paris12 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La dignité de la personne humaine
La dignité de la personne humaine
Pierre de MontalivetProfesseur à l’Université de Bretagne-Sud,
directeur de l’Institut de recherche sur les entreprises et les administrations (IREA-EA 4251)
Quelle est l’influence du droit européen sur le concept de dignité de la personne humaine en droit public français ? La réponse à cette question conduit à s’interroger sur les ambiguïtés de la juridicisation d’un concept philosophique et moral1 ainsi que sur la complexité des rapports existants entre les ordres juridiques.
La dignité de la personne humaine peut être définie comme la valeur intrin-sèque de la personne humaine2, qui commande le respect d’autrui. Il s’agit d’un principe avant tout philosophique3 ainsi que d’une valeur chrétienne4. Comme d’autres concepts, elle a été juridicisée, en étant consacrée par des textes juridiques ou par la jurisprudence. Il s’agit d’un principe universel, ou considéré comme tel, ce que montre d’ailleurs la généralité de sa consécration, en droit international, en droit européen et dans les divers droits nationaux, notamment constitutionnels.
Le droit public français ne fait pas exception, mais la reconnaissance de la dignité de la personne humaine au plus haut niveau s’est faite plus tardivement
1. Dans le cadre restreint de cette étude, on ne discutera pas ici de la qualification de la dignité de la personne humaine comme concept du droit public français ni de sa qualification comme « valeur de l’État ».
2. On ne parlera pas ici du second sens de la dignité, en tant que prérogative (charge, fonction ou titre). C’est dans ce sens que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme emploie le mot « dignités » : « Tous les citoyens [...] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics » (souligné par nous).
3. V. notamment L.-E. Pettiti, « La dignité de la personne humaine en droit européen », in M.-L. Pavia, T. Revet (dir.), La dignité de la personne humaine, Économica, coll. « Études juridiques », 1999, p. 53 et s. Saint Thomas d’Aquin et Pic de la Mirandole ont évoqué la dignité de la personne humaine, mais c’est Kant qui semble avoir le plus développé le concept de dignité. Pour le philosophe allemand, l’homme ne peut jamais être utilisé simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme fin.
4. V. notamment sur ce point H. Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », RD publ. 1999. 161-162.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5013eMP_IaXII_001_992.indd 501 29/07/10 17:21:4929/07/10 17:21:49
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 502
que dans d’autres États. Si la dignité avait pu être reconnue par divers textes5 ou jurisprudences6, il a fallu attendre 1994 pour la voir solennellement consacrée.
La reconnaissance du principe constitutionnel de « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » a été opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision Bioéthique du 27 juillet 1994 à partir d’une lecture constructive de l’alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 19467. C’est à sa suite, un an après, que le Conseil d’État, dans le célèbre arrêt d’Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge, du 27 octobre 1995, a consacré « le respect de la dignité de la personne humaine » comme une composante de l’ordre public8.
La généralité de la consécration du concept de dignité conduit à s’interroger sur la réalité d’une influence en la matière du droit européen sur le droit public français. Les caractères de la consécration du concept semblent rapprocher davan-tage le droit français du droit international et des droits constitutionnels étrangers que du droit européen. Avant sa reconnaissance par le droit français, le concept de dignité de la personne humaine avait été proclamé de manière expresse et générale par les conventions internationales de protection des droits de l’homme, notam-ment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 19489 et les deux pactes des Nations Unies de 1966 que sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques10 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
5. L’article 1er de la loi du 30 sept. 1986 modifiée, énonce que l’exercice de la communication au public par voie électronique peut être limité dans la mesure requise « par le respect de la dignité de la personne humaine ». La législation civile a également consacré la dignité, à travers, depuis la loi du 29 juill. 1994 relative au respect du corps humain, l’article 16 du Code civil. Selon cet article, « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». La législation pénale, enfin, punit les atteintes à la dignité de la personne (art. 225-1 et s. C. pén.).
6. Le Conseil d’État, à l’occasion des contrôles exercés sur les salariés, avait déjà par exemple souligné la nécessaire préservation de la « dignité [...] de la personne ». CE 11 juill. 1990, Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi c. Syndicat CGT de la Société Griffine-Maréchal, Lebon 215.
7. Cons. const. 27 juill. 1994, no 94-343/344 DC, Bioéthique, Rec. Cons. const. 100. Selon le Conseil, « le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et prin-cipes constitutionnels en soulignant d’emblée que : “Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés” ; qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitution-nelle » (cons. 2).
8. CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, Lebon 372, concl. Frydman. V. égale-ment du même jour, CE, ass., Ville d’Aix-en-Provence, Lebon 372.
9. Son Préambule énonce : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la jus-tice et de la paix dans le monde ». Surtout, son article 1er proclame : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». V. également les articles 22 et 23. On peut citer également le Préambule de la Charte des Nations Unies.
10. Son Préambule énonce que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » ou encore que « ces droits découlent de la dignité inhérente à la
3eMP_IaXII_001_992.indd 5023eMP_IaXII_001_992.indd 502 29/07/10 17:21:4929/07/10 17:21:49
La dignité de la personne humaine 503
culturels11. Cette consécration, renouvelée depuis12, est particulièrement claire, explicite et générale, ce qui n’a pu que favoriser la reconnaissance de la dignité par les juridictions françaises13. Le droit international a incontestablement exercé en la matière une influence sur le droit public français.
Le concept de dignité de la personne humaine avait également été proclamé de manière expresse et générale par les droits constitutionnels étrangers et notamment par les constitutions des États européens. On peut citer par exemple les droits alle-mand, belge, espagnol, italien ou encore portugais14. Ces textes ont très probable-ment influencé le Conseil constitutionnel lorsqu’il a consacré le principe constitu-tionnel de dignité.
En comparaison, la consécration par le droit européen de la dignité est plutôt modeste et récente. Le concept n’est en effet pas explicitement proclamé à l’origine par la Convention européenne des droits de l’homme. Ce n’est qu’en 2002, par le protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, que la Convention évoque la dignité. Et encore, elle ne le fait pas en la proclamant comme un principe général auquel serait consacré un article, mais de manière rela-tivement incidente dans le Préambule de ce protocole15.
De même, en ce qui concerne le droit de l’Union européenne, il a fallu attendre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000, pour voir un texte consacrer la dignité de manière générale16. La consécra-tion jurisprudentielle du principe est également récente. Dans un arrêt du 30 avril 1996, P. c. S. et Cornwall County Council, la Cour de justice des Communautés européennes fait référence au « respect de la dignité », qui doit être protégé par la Cour17. Ce n’est que dans un arrêt du 9 octobre 2001, Pays-Bas c. Parlement et
personne humaine ». Selon l’article 10, « Toute personne privée de sa liberté est traitée avec huma-nité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
11. Son Préambule cite également « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » et « la dignité inhérente à la personne humaine ». V. également l’article 13.
12. V. la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de l’Unesco (1997) ou encore la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de l’Unesco (2005).
13. Certains auteurs semblent estimer que l’intégration du principe dans les droits internes européens est due à l’influence du droit international, tout en notant que « le droit constitutionnel français n’a pas enregistré de la même manière l’influence du droit international », en raison de sa lenteur à consacrer le principe. M.-L. Pavia, « La dignité de la personne humaine », in R. Cabrillac, M.-A. Frison-Roche, T. Revet (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 14e éd., Dalloz, 2008, p. 156, § 269.
14. V. l’article 1er § 1 de la Loi fondamentale allemande, l’article 23 de la Constitution belge, l’article 10 § 1 de la Constitution espagnole, l’article 3 de la Constitution italienne et l’article 1 de la Constitution portugaise.
15. Ce Préambule commence comme suit : « Les États membres du Conseil de l’Europe, signa-taires du présent Protocole, Convaincus que [...] l’abolition de la peine de mort est essentielle [...] à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains... ».
16. La Charte accorde une large place à la dignité. Celle-ci donne son nom au chapitre I et l’ar-ticle 1er énonce : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».
17. CJCE 30 avr. 1996, P. c. S. et Cornwall County Council, C-13/94, Rec. CJCE I-2143 : « Tolé-
3eMP_IaXII_001_992.indd 5033eMP_IaXII_001_992.indd 503 29/07/10 17:21:4929/07/10 17:21:49
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 504
Conseil18, que, de manière plus explicite, elle consacre le « droit fondamental à la dignité humaine » comme un principe général du droit communautaire19. Cette position a été confirmée dans un arrêt Omega de 2004, dans lequel la Cour évoque le principe général du « respect de la dignité humaine »20.
Ces constats donneraient à croire qu’en apparence, la reconnaissance de la dignité de la personne humaine en droit public français soit le fruit de l’influence du droit international et des droits constitutionnels étrangers, à l’exclusion du droit européen.
Cette première impression résiste-t-elle à l’analyse ? La réponse semble être négative. L’idée de dignité est en effet loin d’être absente de la Convention euro-péenne. Elle inspire un certain nombre des droits qui y sont consacrés, notamment l’interdiction des traitements inhumains et dégradants, posée à l’article 321. Le concept de dignité n’est pas consacré expressément par la Convention mais semble constituer une source d’inspiration et un but de celle-ci. Ce n’est pas la dignité qui découle des articles de la Convention mais ce sont ces articles qui découlent de l’idée de dignité. Par ailleurs, d’autres textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe ont réaffirmé la dignité humaine. C’est le cas par exemple de la Conven-tion sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 199722 ou encore de la Charte sociale européenne révisée de 199623.
La Cour européenne des droits de l’homme affirme également la dignité de la personne humaine. Dans un arrêt de 1978, elle évoque « ce dont la protection figure précisément parmi les buts principaux de l’article 3 [...] : la dignité et l’inté-grité physique de la personne »24. Il n’y a néanmoins pas là l’énoncé d’un principe
rer une telle discrimination reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une telle personne, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger » (pt 22).
18. CJCE 9 oct. 2001, Pays-Bas c. Parlement et Conseil, 377/98, Rec. CJCE I-7079.19. En ce sens, v. L. Dubouis, C. Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, 4e éd., Mont-
chrestien, coll. « Domat », 2006, p. 159, § 214. La Cour énonce qu’« Il appartient à la Cour, dans son contrôle de la conformité des actes des institutions aux principes généraux du droit communautaire, de veiller au respect du droit fondamental à la dignité humaine et à l’intégrité de la personne » (pt 70).
20. CJCE 14 oct. 2004, Omega, C-36/02. La Cour déclare que « l’ordre juridique communau-taire tend indéniablement à assurer le respect de la dignité humaine en tant que principe général du droit » (pt 34).
21. J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 3e éd., LGDJ, coll. « Manuels », 2002, p. 1, § 1 et p. 453, § 254 ; F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 7e éd., PUF, coll. « Droit fondamental », 2005, p. 202, § 145.
22. Elle proclame la dignité de l’être humain. Le titre complet du traité est « Convention pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine ». Selon son article 1er, « Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son iden-tité ».
23. L’article 26 garantit le « droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail ». Cette protection permet de lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral du travailleur. La référence à la dignité ne figurait pas dans le texte de 1961 ni dans les protocoles de 1988, 1991 et 1995.
24. CEDH 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, A 26, § 33.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5043eMP_IaXII_001_992.indd 504 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
La dignité de la personne humaine 505
général de dignité. La Cour conçoit la dignité comme un des buts de la Conven-tion, ce qui est confirmé par un autre arrêt de 1995, dans lequel elle se réfère aux « objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité ? et de la liberté ? humaines »25.
Certains textes communautaires, dont certains sont antérieurs à 1994, ont fait ou font de même référence à la dignité, comme le règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Com-munauté26, la résolution du Conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l’homme au travail ou encore le Livre vert de la Commis-sion sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audio-visuels et d’information du 16 octobre 1996.
Le droit européen a pu ainsi exercer une certaine influence sur le Conseil consti-tutionnel et le Conseil d’État dans la consécration explicite et générale du concept. Il a pu inciter ces juridictions à affirmer la dignité de la personne humaine et ainsi à juridiciser ce concept. À cela s’ajoute le fait que la consécration actuelle et de manière expresse et générale par le droit européen de la dignité de la personne humaine n’est pas sans influence aujourd’hui sur l’utilisation et l’application du concept.
L’analyse montre ainsi que l’influence du droit européen n’est pas à elle seule déterminante, qu’elle n’est pas exclusive, mais qu’elle existe. Le droit européen contribue à faire évoluer le droit français. Son influence est limitée, car partagée avec d’autres droits. L’influence réelle est difficile à déterminer, mais il apparaît que le droit européen va plutôt dans le sens d’une reconnaissance et d’un renforcement du concept. En effet, il a influencé les juridictions nationales concernant la consécration du concept. Il les amène également à l’évoquer plus souvent et différemment. En outre, il les conduit à enrichir son contenu et à lui offrir une protection accrue.
L’ensemble de ces éléments conduit ainsi à constater que le droit européen est un facteur à la fois d’affirmation (I) et de renforcement (II) de la dignité de la per-sonne humaine en droit public français.
I. LE DROIT EUROPÉEN, FACTEUR D’AFFIRMATION DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Le droit européen, et tout particulièrement le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, est fortement marqué par l’idée de dignité de la personne humaine. Cette présence a influencé les juridictions françaises, en ce sens qu’elle
25. CEDH 22 nov. 1995, C.R. c. Royaume-Uni, A 335-C, § 42. V. également, du même jour, S.W. c. Royaume-Uni, A 335-B, § 44.
26. Selon le Préambule du règlement no 1612/68, « le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement ».
3eMP_IaXII_001_992.indd 5053eMP_IaXII_001_992.indd 505 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 506
les a amenées à consacrer expressément le concept. Elle exerce toujours une certaine influence sur ces juridictions, en ce qu’elle les incite à évoquer plus fréquemment et plus fortement ce concept. C’est ce que l’on verra en constatant que le droit euro-péen est un facteur à la fois de consécration (A) et d’évocation (B) du concept.
A. LA CONSÉCRATION DU CONCEPT
On a constaté qu’avant les décisions de 1994 et 1995 du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, ni le droit communautaire, ni le droit du Conseil de l’Europe ne consacraient d’une manière générale et explicite un principe juridique de dignité de la personne humaine. Il n’en demeure pas moins que le droit européen a pu influencer le législateur et les juges constitutionnel et administratif français dans la consécration de la dignité.
Les textes communautaires que sont le règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté et la résolution du Conseil du 29 mai 1990 concernant la protection de la dignité de la femme et de l’homme au travail ont probablement eu une influence, même limitée, en la matière. Le droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme a plus fortement incité le législateur et les juges français à consacrer le concept de dignité de la personne humaine. La présence implicite de la dignité dans l’article 3 de la Convention et la référence à celle-ci dans l’arrêt Tyrer de la Cour n’ont sûre-ment pas été sans influence sur les juridictions françaises. Si cette influence a peut-être été limitée, elle n’en existe pas moins.
L’influence sur le Conseil constitutionnel est favorisée par la prise en compte d’une manière générale de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Conseil admet en effet recevoir l’influence du droit européen. C’est ce dont témoignent les propos d’un ancien membre du Conseil, Jacques Robert, qui affirmait : « nous ne pouvons pas nous mettre à contre-courant de ce que juge la Cour européenne des droits de l’homme »27. Va dans le même sens un rapport dans lequel le Conseil soulignait qu’« au niveau du Conseil constitutionnel, il est tenu compte de la jurisprudence dégagée par la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme [...]. Par ce biais, le contenu des principes de valeur constitution-nelle peut s’en trouver enrichi »28. Le Conseil soulignait également l’existence d’un « même attachement à des valeurs communes »29.
L’influence sur le Conseil d’État est attestée par les propos mêmes du commis-saire du gouvernement sur l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge. M. Frydman a fait
27. J. Robert, « Les activités du Conseil constitutionnel », entretien, L’Astrée sept. 1998, no 5, p. 4.
28. Cons. const., « Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fonda-mentaux », Rapport présenté par la délégation française à la VIIIe conférence des Cours constitution-nelles européennes (Ankara, 7-10 mai 1990, RFDA 1990. 335).
29. Ibid., p. 329.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5063eMP_IaXII_001_992.indd 506 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
La dignité de la personne humaine 507
explicitement référence aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme avant de proposer la reconnaissance de la dignité de la per-sonne humaine30.
L’influence du droit européen s’explique notamment par la promotion générale des droits fondamentaux. Les juridictions françaises ne veulent pas rester à l’écart de ce mouvement et refuser le rôle qui leur est offert de participer à la protection des droits fondamentaux. Une certaine émulation s’est instaurée entre les juridic-tions européennes et nationales dans cette protection, émulation qui explique en partie que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État aient souhaité faire réfé-rence à la dignité de la personne humaine. La convergence sur ce point entre les jurisprudences européennes et françaises contribue ainsi à l’élaboration progressive d’un « droit constitutionnel commun » en Europe31. Cette convergence dans la consécration du principe de dignité témoigne également de la part du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État de l’emploi d’une méthode systémique d’inter-prétation, méthode qui vise à favoriser la cohérence de l’ordre juridique. Elle contribue enfin à légitimer les jurisprudences des juridictions françaises quant à l’affirmation de la dignité de la personne humaine.
Si le droit européen a constitué l’une des sources matérielles du principe de dignité en droit français32, il reste que son influence n’a pas été exclusive. Elle s’est conjuguée avec celle du droit international des droits de l’homme et celle des droits étrangers, notamment allemand33.
Le droit européen est non seulement un facteur de consécration du concept de dignité, il en est également un facteur d’évocation.
B. L’ÉVOCATION DU CONCEPT
Le droit européen n’est pas sans conséquences quant à l’évocation du concept, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Il invite en effet les juridictions fran-çaises à l’évoquer plus fréquemment et différemment.
30. P. Frydman, « L’atteinte à la dignité de la personne humaine et les pouvoirs de police municipale. À propos des “lancers de nains” », conclusions sur CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge et, du même jour, Ville d’Aix-en-Provence, RFDA 1995. 1206 et 1210.
31. Sur ce sujet, v. notamment G. Drago, Contentieux constitutionnel français, 2e éd., PUF, coll. « Thémis », 2006, p. 115 et s. et p. 498.
32. Dans le même sens, V. Saint-James, « Réflexions sur la dignité de l’être humain en tant que concept juridique du droit français », D. 1997. Chron. 61.
33. Les cas d’influence « flagrante » exercée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sont en nombre limité. En effet, la doctrine n’a relevé que trois cas d’influences de la jurisprudence sur celle du Conseil constitutionnel. L. Favoreu, « La prise en compte du droit inter-national et communautaire dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », in L’internationalité dans les institutions et le droit : convergences et défis. Études offertes à A. Plantey, Paris, Pedone, 1995, p. 36 ; P. Gaïa, « Les interactions entre les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel », RFDC 1996. 742.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5073eMP_IaXII_001_992.indd 507 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 508
Le droit européen n’est pas sans influence tout d’abord quant à l’utilisation du concept, en incitant le législateur et les juges français à y faire fréquemment référence. Les références au concept de dignité de la personne humaine sont nombreuses en droit européen. On a constaté qu’elles avaient lieu non seulement dans la jurispru-dence, mais également dans les textes. On peut ainsi estimer que la « banalisation » du concept en droit européen favorisera son évocation tant par les juridictions fran-çaises que par la loi et les règlements. La multiplicité des références en droit européen conforte, on l’a vu, la légitimité de la proclamation du concept. Il n’est pas impossible non plus que la dignité fasse son entrée dans le texte de la Constitution. C’est ce qu’avait proposé le Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé par le doyen Vedel34. C’est également ce qu’a envisagé le président de la République dans sa lettre de mission du 9 avril 2008 relative au Comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution présidé par Madame Simone Veil35.
Le droit européen n’est également pas sans influence ensuite quant à la formu-lation du concept. À l’origine, le Conseil constitutionnel parlait de la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation », reprenant certains termes de l’article 1er du Préambule de la Consti-tution de 1946. L’emploi des termes « asservissement » et « dégradation » visait à montrer le caractère écrit de la norme dégagée et ce afin d’éviter les accusations de « gouvernement des juges ». Par la suite, le Conseil a utilisé une formule plus courte. Il parle à l’heure actuelle du « respect de la dignité de la personne humaine »36. Le Conseil d’État adopte d’ailleurs exactement la même formulation.
Cette dénomination est plus proche des formules retenues en droit européen. Le Préambule du protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances évoque en effet la « dignité inhérente à tous les êtres humains », la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme la « dignité humaine », la Cour de justice des Communautés européennes fait référence au « respect de la dignité »37, à la « dignité humaine »38 et récemment au « respect de la dignité humaine »39. De même, la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du 4 avril 1997 proclame par son titre même la « dignité de l’être humain »40. De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme parle de « la
34. Propositions pour une révision de la Constitution, 15 févr. 1993. Rapport au président de la République, La Documentation française, coll. « Rapports officiels », 1993, p. 75.
35. Le président de la République précise d’ailleurs que « Le contexte international, et notam-ment l’entrée en vigueur prochaine de la Charte européenne des droits fondamentaux, doit [...] être pris en considération ».
36. Cons. const. 20 juill. 2006, no 2006-539 DC, Loi relative à l’immigration et à l’intégration, JO 25 juill. 2006, p. 11066, cons. 5 ; Cons. const. 15 nov. 2007, no 2007-557 DC, Loi relative à la maî-trise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, JO 21 nov. 2007, p. 19001, cons. 18.
37. CJCE 30 avr. 1996, P. c. S. et Cornwall County Council, préc., pt 22.38. CJCE 9 oct. 2001, Pays-Bas c. Parlement et Conseil, préc., pt 70.39. CJCE 14 oct. 2004, Omega, préc., pt 34.40. On a rappelé que le titre complet du traité est « Convention pour la protection des Droits de
l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’homme et la biomédecine ».
3eMP_IaXII_001_992.indd 5083eMP_IaXII_001_992.indd 508 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
La dignité de la personne humaine 509
dignité [...] de la personne »41 et du « respect de la dignité ? et de la liberté ? humaines »42.
Le Conseil semble vouloir se dégager de la formulation datée du Préambule de 1946 afin de « normaliser » la formulation du principe, en adoptant une dénomina-tion plus en harmonie avec celle retenue en droit européen. On peut ainsi déceler ici l’influence de ce droit. Là encore, cette influence se conjugue avec celles du droit international des droits de l’homme et des droits étrangers, puisque la dénomi-nation retenue par les juges français est également proche des formules retenues dans ces droits.
Le droit européen n’est pas sans influence enfin quant à la qualification du concept. La qualification de la dignité de la personne humaine en droit européen n’est pas uni-forme. Dans un certain nombre de cas, le concept est évoqué mais ne reçoit pas de qualification particulière. C’est le cas dans le règlement du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs ou dans le Préambule du protocole no 13 relatif à l’abolition de la peine de mort. Dans d’autres cas, la protection de la dignité est vue comme un objectif. C’est l’attitude de la Cour européenne des droits de l’homme43. Enfin et surtout, la dignité est qualifiée de droit. C’est le cas dans la jurisprudence communautaire44, dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne45 et dans la Charte sociale européenne révisée de 199646.
À l’heure actuelle, le Conseil constitutionnel qualifie le respect de la dignité de la personne humaine de principe47. Le Conseil d’État, de son côté, ne retient aucune qualification et ne parle que d’une composante de l’ordre public. Il n’est pas impossible que la qualification de droit retenue par le droit européen amène, du moins dans certains cas, les juridictions françaises à qualifier comme tel la dignité. Va dans ce sens le fait que cette qualification de droit est utilisée également par une partie de la doctrine48. Si une telle qualification était retenue, les juges français
41. CEDH 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, préc., § 33.42. CEDH 22 nov. 1995, C.R. c. Royaume-Uni, préc., § 42 et du même jour, S.W. c. Royaume-Uni,
préc., § 44. La Cour parle aussi du « respect de la dignité humaine » (24 févr. 1998, Botta c. Italie, Rec. CEDH 1998-I, p. 422, § 27).
43. CEDH 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, préc., § 33.44. CJCE 30 avr. 1996, P. c. S. et Cornwall County Council, préc., pt 22. V. également CJCE
9 oct. 2001, Pays-Bas c. Parlement et Conseil, préc., pt 70. La Cour range ce droit parmi les principes généraux du droit.
45. Si l’article 1er n’utilise pas le mot « droit », les articles 25, 31 et 34 mentionnent la dignité comme un droit.
46. À travers l’article 26 qui garantit le « droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail », la Charte reconnaît un droit à la protection de la dignité.
47. V. Cons. const. 27 juill. 1994, no 94-343/344 DC, préc., cons. 2 ; Cons. const. 20 juill. 2006, no 2006-539 DC, préc., cons. 5 ; Cons. const. 15 nov. 2007, no 2007-557 DC, préc., cons. 18.
48. V. notamment L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2007, § 1276 ; B. Mathieu, « Force et faiblesse des droits fondamentaux comme instruments du droit de la bioéthique : le principe de dignité et les interventions sur le génome humain », RD publ. 1999. 103-104 ; J. Tremeau, note sous Cons. const. 29 juill. 1998, no 98-403 DC, RFDC 1998. 767. Contra, v. D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 7e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit public », 2006, p. 134.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5093eMP_IaXII_001_992.indd 509 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 510
parleraient probablement non d’un « droit à la dignité », mais d’un « droit au res-pect de la dignité ».
Ainsi, le droit européen exerce une certaine influence sur le droit français, même si cette influence est limitée en raison d’une part de l’absence pendant long-temps de la consécration générale et explicite d’un principe de dignité de la per-sonne humaine, d’autre part de l’influence conjointe d’autres ordres juridiques. Le droit européen constitue un facteur non seulement d’affirmation de la dignité de la personne humaine, mais également de renforcement de celle-ci.
II. LE DROIT EUROPÉEN, FACTEUR DE RENFORCEMENT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
L’influence qu’exerce le droit européen sur le droit public français va dans le sens d’un renforcement de la dignité de la personne humaine. Certes, l’influence du droit européen sur le concept apparaît ici aussi limitée. Il n’en demeure pas moins que le droit européen peut amener les juridictions françaises à enrichir le contenu du concept et à lui donner une portée normative accrue. Il constitue ainsi à la fois un facteur d’enrichissement (A) et de protection accrue (B) de ce concept.
A. L’ENRICHISSEMENT DU CONCEPT
L’absence même d’une définition générale du principe de dignité est commune aux droits français et européen. Suivant notamment l’exemple du droit européen, le législateur et les juges français ont choisi de ne pas définir le principe. Le choix est compréhensible, tant il semble délicat de définir un concept aussi vaste et flou49. Il permet en outre de ne pas enfermer le concept dans des limites textuelles et, partant, de lui donner un contenu extrêmement extensible.
Le droit européen semble d’ailleurs inciter le législateur et les juges français à étendre le contenu du principe, en en élargissant le champ d’application. La dignité semble en effet s’appliquer à toute matière, en vertu de la reconnaissance générale qu’en fait l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux. Par ailleurs, le concept a vu ses domaines d’application se multiplier. En droit communautaire, sont concernés tant les relations de travail que les services audiovisuels et d’information, la libre circulation des travailleurs et celle des marchandises, la libre prestation de services ou encore la biotechnologie50. Dans le droit du Conseil de l’Europe, la
49. V. notamment O. Cayla, « Dignité humaine : le plus flou des concepts », Le Monde 31 janv. 2003, p. 14.
50. La dignité est souvent présentée dans un domaine particulier, comme le travail, telle profes-sion ou encore les services audiovisuels et d’information (v. par exemple le Livre vert de la Commis-sion sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d’informa-
3eMP_IaXII_001_992.indd 5103eMP_IaXII_001_992.indd 510 29/07/10 17:21:5029/07/10 17:21:50
La dignité de la personne humaine 511
dignité est appliquée aux traitements inhumains et dégradants51 et notamment à la peine de mort, aux applications de la biologie et de la médecine ou encore aux relations de travail.
Le Conseil constitutionnel applique le principe de dignité en matière de bio-éthique, de droit des étrangers, d’interruption volontaire de grossesse, de logement, de mariage et de PACS. Le juge administratif l’applique en matière de spectacles, de liberté d’expression en matière audiovisuelle et de santé.
Certaines similitudes entre droit européen et droit français traduisent proba-blement une certaine influence du premier sur le second. Le principe de dignité intervient dans des domaines parfois similaires, comme la bioéthique. Sur ce der-nier point, le Conseil constitutionnel estime que certains principes législatifs « ten-dent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » : la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain, ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine. Il ne s’agit pas pour autant de principes de valeur constitutionnelle, mais de prin-cipes législatifs garants de principes constitutionnels52. Le législateur peut modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives, à la seule condition de ne pas priver le principe de dignité de ces garanties légales.
À côté de ces quelques similitudes, on constate entre droit européen et droit français des divergences d’appréciation. Ces divergences ne révèlent pas d’influence passée, mais peuvent amener les juges constitutionnel et administratif à faire évo-luer leur jurisprudence. Par exemple, le principe de dignité en droit communautaire trouve à s’appliquer dans le domaine audiovisuel et dans le domaine social, alors que ce n’est pas le cas en droit constitutionnel français, du moins jusqu’à présent. Le droit européen est ici un facteur d’enrichissement du contenu du concept. Il incite le Conseil constitutionnel à faire application du principe de dignité en matière audiovisuelle ou en matière sociale.
Dans certains cas de figure, le droit européen vient conforter la position du juge français. C’est le cas par exemple du lien entre la dignité et l’ordre public, qui se retrouve dans les jurisprudences administrative et communautaire. Le Conseil
tion du 16 oct. 1996). Elle concerne tout particulièrement le domaine de la bioéthique. On a vu que dans l’arrêt du 9 oct. 2001, Pays-Bas c. Parlement et Conseil (préc.), la Cour de justice des Communau-tés européennes a consacré le droit fondamental à la dignité humaine comme un principe général du droit communautaire. Cet arrêt concernait la brevetabilité des inventions biotechnologiques. La doc-trine énonce par ailleurs que le respect de la dignité de la personne humaine « s’il ne se limite pas à elle, constitue le principe fondateur de tout le droit de la bioéthique ainsi que le confirment les droits rangés sous la qualification de droit à l’intégrité de la personne » (L. Dubouis, C. Blumann, Droit maté-riel de l’Union européenne, préc., p. 159, § 214).
51. Selon la Cour, « À l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force phy-sique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (CEDH 4 déc. 1995, Ribitsch c. Autriche, A 336, § 38).
52. B. Mathieu, M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, coll. « Manuels », 2002, p. 432.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5113eMP_IaXII_001_992.indd 511 29/07/10 17:21:5129/07/10 17:21:51
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 512
d’État estime dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge de 1995 que le « respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public »53. De même, dans l’arrêt Omega de 2004, la Cour de justice des Communautés euro-péennes semble inclure la dignité dans l’ordre public54.
La même remarque pourrait être faite concernant le lien entre la dignité et la protection des personnes contre elles-mêmes. On sait en effet que le Conseil d’État, sur le fondement du respect de la dignité de la personne humaine, a justifié l’inter-diction d’un spectacle de lancers de nains, alors même que la personne concernée était consentante et y trouvait un intérêt financier. On peut voir dans cette juris-prudence, peut-être critiquable par ailleurs, une extension du contenu du principe, et ainsi un enrichissement de celui-ci. Dans un arrêt de 1997, Laskey c. Royaume Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a également « pris en compte la notion de dignité et de respect de la personne »55 pour protéger un adulte consen-tant contre l’atteinte à sa propre dignité56.
Par ailleurs, le droit français semble dans certains cas dépasser le droit euro-péen. Par exemple, selon le Conseil constitutionnel, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, combiné avec les principes issus des alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946, implique l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent 57. Cette interprétation du principe de dignité ne semble pas
53. Sur ce point, v. CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, préc. V. notamment B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », in M.-L. Pavia, T. Revet (dir.), La dignité de la personne humaine, préc., p. 31-32.
54. CJCE 14 oct. 2004, Omega, préc. La Cour déclare que « le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’une activité économique consistant en l’exploitation commerciale de jeux de simulation d’actes homicides fasse l’objet d’une mesure nationale d’interdiction adoptée pour des motifs de pro-tection de l’ordre public en raison du fait que cette activité porte atteinte à la dignité humaine » (pt 41).
55. L.-E. Pettiti, « La dignité de la personne humaine en droit européen », préc., p. 59.56. Elle a justifié des condamnations pénales à l’encontre de personnes participant à des prati-
ques sadomasochistes.57. Cons. const. 19 janv. 1995, no 94-359 DC, Diversité de l’habitat, Rec. Cons. const. 176. Dans
cette décision, le Conseil affirme : « Considérant qu’aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, “La nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement” ; qu’aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la nation “garantit à tous, notam-ment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence” ; Considérant qu’il ressort également du Préambule de la Constitu-tion de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humainecontre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; Considérant qu’il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décentest un objectif de valeur constitutionnelle » (cons. 5-7). Le Conseil constitutionnel a rappelé le triple fondement de l’objectif par la suite (v., par exemple, Cons. const. 29 juill. 1998, no 98-403 DC, Taxe d’inhabitation, Rec. Cons. const. 276, cons. 2-4). Cependant, dans la décision no 2004-503 DC du 12 août 2004 (Loi relative aux libertés et responsabilités locales, Rec. Cons. const. 144, cons. 21), le principe de dignité n’est plus cité parmi ces fondements. Sur la contestation du rattachement de l’objectif au principe de dignité, v. B. Mathieu, « Le droit au logement révélateur de la place des droits sociaux dans l’ordre juridique », in D. Gros,
3eMP_IaXII_001_992.indd 5123eMP_IaXII_001_992.indd 512 29/07/10 17:21:5129/07/10 17:21:51
La dignité de la personne humaine 513
particulièrement inspirée par la jurisprudence des cours européennes58. Grâce à cet objectif, le Conseil constitutionnel actualise le principe constitutionnel de dignité et élargit son champ d’application59. Le principe trouve en effet à s’appliquer au logement alors qu’il s’appliquait jusqu’alors au domaine de la bioéthique 60. À l’instar de certains droits issus de la Convention européenne des droits de l’homme61, la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent constitue un pro-longement social du droit à la dignité.
Le droit européen contribue non seulement à enrichir le concept de dignité de la personne humaine en droit français, mais également à lui conférer une protection accrue.
B. LA PROTECTION ACCRUE DU CONCEPT
Il pourrait être tentant de dénier toute normativité au concept de dignité au prétexte de sa particulière imprécision . Et pourtant le Conseil constitutionnel reconnaît à la dignité une véritable portée juridique propre à en faire une norme juridique. Le droit européen semble inciter le juge et le législateur français à ren-forcer la portée normative du principe.
Le droit européen contribue tout d’abord à reconnaître la normativité du concept. Le droit français comme le droit européen reconnaissent à la dignité certaines fonctions normatives. La dignité bénéficie d’une fonction d’obligation, en s’imposant de manière impérative62. La Cour européenne des droits de l’homme lui reconnaît également une fonction d’interdiction, en énonçant qu’un châtiment corporel peut se révéler incompatible avec la dignité et l’intégrité physique de la
S. Dion-Loye (dir.), La pauvreté saisie par le droit, colloque de Dijon, 2-3 déc. 1999, Seuil, coll. « Le genre humain », 2002, p. 218 et s.
58. En outre, selon le Conseil constitutionnel, les conditions de mise en œuvre de l’objectif relatif au logement décent sont renforcées par des mesures prévoyant des conditions spécifiques d’ac-cueil des gens du voyage et tendant à assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri dans des locaux présentant des conditions d’hygiène et de confort respectant la dignité humaine. Cons. const. 19 janv. 1995, no 94-359 DC, préc., cons. 9.
59. V., É. Sales, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : instruments de saisie des nouveaux champs du droit ? », Association française des constitutionnalistes et Université d’Aix-Marseille III, IVe Congrès français de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, 10, 11 et 12 juin 1999, Atelier 4.
60. Selon F. Zitouni (« Le Conseil constitutionnel et le logement des plus démunis », note sous Cons. const. 19 janv. 1995, no 94-359 DC, LPA 12 janv. 1996), « Alors que la notion de traitement dégradant n’était évoquée, dans la décision de juill. 1994, que dans le contexte de relations interindi-viduelles (manipulations génétiques ou expérimentations médicales), elle est étendue dans le cas pré-sent à des situations dont la collectivité est responsable envers certains de ses membres (privation de logement, maintien en habitat insalubre...) ».
61. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, si la Convention « énonce pour l’essentiel des droits civils et politiques, nombre d’entre eux ont des prolongements d’ordre économique ou social ». CEDH 9 oct. 1979, Airey, A-32, § 26.
62. La Cour européenne des droits de l’homme parle de « l’obligation de garantir aux personnes handicapées le plein respect de la dignité humaine » (24 févr. 1998, Botta c. Italie, préc., § 27).
3eMP_IaXII_001_992.indd 5133eMP_IaXII_001_992.indd 513 29/07/10 17:21:5129/07/10 17:21:51
L’influence du droit européen sur les « valeurs de l’État » 514
personne, protégées par l’article 3 de la Convention63. Sa violation est donc sanc-tionnée par le juge.
La dignité bénéficie de même d’une fonction de permission, en ce qu’elle permet de justifier certaines mesures restreignant l’exercice des libertés, comme la libre prestation de services64. Pour le Conseil d’État, la dignité permet une restric-tion de l’exercice de certaines libertés65. De même, la législation française reconnaît au principe de dignité une fonction de permission. L’article 1er de la loi du 30 sep-tembre 1986 modifiée énonce que l’exercice de la communication audiovisuelle peut être limité dans la mesure requise par le respect de la dignité de la personne humaine66 . Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la dignité amène également, de manière indirecte, à travers l’objectif relatif au logement décent, à limiter l’exercice d’autres droits et libertés. C’est le cas du droit de propriété, la pos-sibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent permettant d’en limiter l’exercice. La garantie de l’effectivité du principe de dignité rend nécessaire la limitation de l’exercice d’autres droits et libertés.
Le droit européen contribue ensuite à reconnaître le caractère absolu du concept. Le droit européen reconnaît aux droits qui expriment l’idée de dignité une portée absolue67. Le droit consacré à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est intangible. Le principe de dignité en droit français pouvait alors de prime abord paraître absolu et ainsi non dérogeable68. Et pourtant, le Conseil constitutionnel admet une conciliation entre la dignité de la personne humaine et d’autres normes constitutionnelles69, telles que la liberté de la femme70 ou la protection de la santé71. Certes, il semble que le Conseil accorde à la dignité
63. CEDH 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, préc., § 33.64. CJCE 14 oct. 2004, Omega, préc., pts 34-36.65. CE, ass., 27 oct. 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, préc. Selon le Conseil, « le respect
du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public ».
66. Pour une application de cet article, v. CE 20 mai 1996, Société Vortex, Lebon 189. Le Conseil d’État considère « que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait contraire au principe de la liberté d’expression [...], dès lors que l’article 1er de la loi du 30 sept. 1986 précité précise que la liberté de la communication audiovisuelle, dont elle affirme le principe, peut être limitée dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la per-sonne humaine et la sauvegarde de l’ordre public ».
67. V. l’article 15 de la Convention.68. B. Mathieu, M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, op. cit., p. 473.69. Dans la décision no 94-343/344 DC du 27 juill. 1994 (préc.), le Conseil affirme que l’en-
semble des dispositions des lois soumises à son examen « mettent en œuvre, en les conciliant et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables », au nombre desquelles figure le principe de dignité, la liberté individuelle et la protection de la santé (cons. 19) (souligné par nous).
70. Cons. const. 27 juin 2001, no 2001-446 DC, Interruption volontaire de grossesse II, Rec. Cons. const. 74, cons. 5.
71. La question se pose pour la liberté de communication. V. commentaire de la décision no 2004-496 DC, 10 juin 2004, Cah. Cons. const. 2004. 10. Selon l’auteur, « il appartient au législateur
3eMP_IaXII_001_992.indd 5143eMP_IaXII_001_992.indd 514 29/07/10 17:21:5129/07/10 17:21:51
La dignité de la personne humaine 515
une protection particulière72. Mais il admet la relativité de la dignité. Le droit euro-péen amènera peut-être le juge français à accorder au principe de dignité une pro-tection accrue, en limitant les cas dans lesquels son exercice serait limité au profit d’autres droits et libertés.
** *
En définitive, l’ensemble de ces éléments ont montré l’existence de l’influence du droit européen sur la dignité de la personne humaine en droit public français. Cette influence, délicate à déterminer avec précision, est toutefois limitée. En outre, elle s’est conjuguée avec celles d’autres ordres juridiques. Cette influence est ainsi non seulement limitée, mais également partagée. L’influence de ces autres ordres juridiques est soit directe, soit indirecte, par le biais de la Convention européenne des droits de l’homme elle-même ou de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui subissent ou ont subi l’influence du droit interna-tional et des droits des États européens. L’influence du droit européen cache parfois celle des droits des États membres.
Ce cas n’est finalement que l’illustration de la complexité du système dans lequel s’insère notre ordre juridique. Système fait de relations d’interdépendances, d’une multiplicité de lieux de définition du droit. L’influence du droit européen sur le droit français s’insère dans ce système complexe, ce qui amène à ne pas bor-ner l’horizon à la seule action d’un droit sur l’autre. L’action est souvent une interaction.
[...] de concilier [...] l’exercice de la liberté de communication [...] avec des exigences de valeur consti-tutionnelle, telles que la dignité de la personne humaine ».
72. D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 133 ; D. Breillat, « La hiérarchie des droits de l’homme », in Mélanges P. Ardant. Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 371-372.
3eMP_IaXII_001_992.indd 5153eMP_IaXII_001_992.indd 515 29/07/10 17:21:5129/07/10 17:21:51