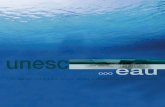« A quoi sert la “théorie des climats” ? Éléments d’une histoire du déterminisme environnemental »
Impact environnemental des retenues d'hydraulique pastorale. Etude de cas de cinq retenues d'eau au...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Impact environnemental des retenues d'hydraulique pastorale. Etude de cas de cinq retenues d'eau au...
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (U.A.C) FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES (F.L.A.S.H) DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (D.G.A.T)
MEMOIRE DE MAITRISE
Option : Aménagement du territoire
Présenté par : Sous la direction de :
Abdel Kader BABA CHEICK (1) Dr. Ir. Brice SINSIN,
Ingénieur agronome forestier,
Maître de Conférence en Ecologie
Appliquée (FSA/UAC)
(2) Dr. Eustache BOKONON- GANTA
Docteur en Hydrologie,
Maître-assistant au Département
de Géographie et Aménagement
du Territoire (DGAT- FLASH/UAC)
Soutenu le 16 décembre 2004
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES RETENUES D’HYDRAULIQUE PASTORALE DANS LA COMMUNE DE NIKKI (DEPARTEMENT DU BORGOU)
ii
CERTIFICATION
Je certifie que ce travail a été entièrement conduit par BABA CHEICK Abdel Kader du
Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT), Option Aménagement du
Territoire de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université
d’Abomey-Calavi.
Le Directeur de mémoire Le CoDirecteur de mémoire Prof. Dr. Ir. Brice SINSIN Prof. Dr. Eustache BOKONON-GANTA Ingénieur agronome forestier, Docteur en Hydrologie, Maître de conférences en Ecologie Maître-assistant au département de Appliquée (FSA/UAC) Géographie et Aménagement du
Territoire (FLASH/UAC)
iii
DEDICACE A Allah, le tout puissant et le tout miséricordieux et à son prophète Mahomet (SAW) pour
m´avoir donné la vie et gratifié d’une bonne santé physique et mentale.
A ma feue mère Adama MAMADOU. Toi, dont l´amour pour ton benjamin était si grand et si
naturel qu´il ne s´en apercevait même pas. Je regrette aujourd´hui que tu ne sois pas là pour
partager ma joie et profiter des fruits de l´arbre que tu as planté.
A mon feu père Ahmed BABA CHEICK. Au-delà de ta rigueur, de ton extrême courage qui te
conduisait envers et contre tous à te battre pour tes convictions, tu as été pour nous un père
responsable et loyal.
A mon feu frère Sidi BABA. Au-delà des querelles et des incompréhensions dont nos relations
ont été victimes, je t´aimais et tu as également contribué à ce que je suis devenu aujourd´hui.
Partage avec moi la joie que je ressens aujourd´hui.
A ma sœur Mariam KOURA née BABA. Si je n´avais pas connu ma mère, je t’aurais sans
peine confondue avec elle. Tu m´as toujours comblé d’attentions et d’amour, partagé mes joies et
mes peines. En réalité, c’est toi qui a assuré mon éducation et ma réussite est la tienne.
A mon frère Chouaibou BABA. Malgré tes multiples difficultés et les moyens assez réduits dont
tu disposes, tu as toujours accepté te priver pour satisfaire mes besoins. Ce document est le fruit
de tes sacrifices et de ta persévérance. Tu croyais en moi et en mes capacités. Profonde gratitude
cher frère.
A ma sœur Aminath BABA et à mon frère Mohamed BABA. Vous avez toujours été là quand
j’avais besoin de vous. Mes douleurs et mes joies ont toujours été les vôtres. Recevez ce
document comme le fruit de vos douleurs et peines.
A mes nièces Nabilath BABA CHEICK, Fadilath KOURA et à mes neveux Abdel Nasser KOURA, Abdel Aziz KOURA et Abdel Rahmane KOURA. Que ce travail vous inspire et
vous donne le courage de travailler et de réussir votre vie rien que par le travail.
A Salomon MATCHOUDO et à son épouse ALIA née BISSALOUE. L’homme ne vaut que
par sa personnalité et son caractère. Avec vous, j’ai compris que l’intégrité et la loyauté ne sont
pas que des mots mais surtout un comportement. Dans mon cœur et dans ma tête, vous êtes mon
grand frère et bien plus, mon ami.
iv
A Adebola MEGUIDA. La fraternité ne se définit pas par le sang mais par le cœur et le
comportement. Aucun mot n’est assez précis pour traduire ma gratitude pour tout ce que tu as
fait pour moi. Reçois à travers ce mémoire cher frère, mes vifs remerciements pour ta présence et
ton assistance quotidiennes à chaque fois que j’avais besoin de toi.
v
REMERCIEMENTS Le présent mémoire que vous avez dans les mains est mon œuvre dira-t-on. Ne vous y méprenez
pas, car c’est un iceberg dont on ne voit que la face visible. L’autre face est faite de nombreuses
personnes dont la contribution sous diverses formes a abouti à ce document. Sans ségrégation
aucune et sans vouloir minimiser l’appui de qui que ce soit, qu’il me soit permis de citer certains
noms :
Monsieur le Professeur Brice SINSIN, maître de conférences en Ecologie Appliquée : Lors
de la visite que vous m’avez rendue sur le terrain, vous m’avez dit ``Du courage. C’est
seulement par le travail qu’on gagne sa vie. Il faut être persévèrent´´. Vous ne pourrez jamais
vous imaginer l’impact de ces mots sur le présent travail. Merci pour votre disponibilité et
pour avoir accepté diriger et suivre ce travail de bout en bout.
Monsieur le Professeur Eustache BOKONON-GANTA, Maître-Assistant au Département
de Géographie et Aménagement du Territoire. En vous sollicitant comme codirecteur de
mémoire, j’avoue que j’avais une grosse appréhension par rapport à votre disponibilité. Mais,
de manière objective, aucun étudiant en Géographie ne peut aborder un sujet qui traite de
l’eau sans faire référence à vous. Merci pour avoir démenti les préjuges et suivi ce travail de
bout en bout.
Docteur Armand NATTA : Merci pour avoir accepté lire et corriger ce mémoire. Vos
remarques, critiques et suggestions m’ont permis d’enrichir ce document et de l’améliorer
aussi bien dans la forme que dans le fond.
Monsieur Safiri IBOURAIMA : Merci pour votre disponibilité et surtout les discussions et
critiques constructives portées sur le document. Elles ont contribué à l'améliorer.
Yacoubou BONI : Grâce à vous, j’ai découvert la splendeur sauvage des forêts et j’ai appris
à apprécier le calme et la sérénité qui y règnent. J’ai aussi beaucoup appris en
phytosociologie. Merci pour l'appui intellectuel et financier que vous m'avez apporté sur le
terrain. Des liens d'amitié et de fraternité nous rattachent aujourd´hui.
Adam BOULANKI : Vos remarques, analyses et suggestions sur les données socio-
sanitaires collectées m’ont permis d’avoir des données plus fiables et assez synthétiques sur
les différentes maladies qui sévissent parmi les populations riveraines. Merci pour votre
disponibilité et pour votre contribution à la rédaction de ce document.
vi
Salifou DRAMANE et son épouse Rékyath née SIDI : Vous avez été des tuteurs
exemplaires et disponibles pour moi dans une ville ou l'individualisme est la règle du jeu.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Djima ADAMOU : Merci pour ton amitié constante et fidèle et pour l'aide logistique que tu
m’as apportée.
Télesphore E. L. KABORE : Je n’ai jamais lu les comportements de patron en vous mais
plutôt ceux d’un grand frère pour qui, professionnellement l’équité, la sincérité, la simplicité,
le respect de l’autre et la conscience professionnelle priment sur tout. Vous vous êtes
toujours dépensé pour nous enseigner le meilleur de vous-même et de vos convictions
profondes. La stabilité professionnelle et surtout l’esprit d’équipe que vous avez su instaurer
entre vous et vos collègues nous ont permis de finir ce mémoire. Merci aussi pour l’aide
logistique que vous m’avez apportée.
Julien DJEGO : Merci pour votre disponibilité de chaque instant et pour les critiques,
remarques et suggestions pertinentes que vous m’avez faites pour améliorer la qualité de ce
document.
A tous les collègues et doyens du Laboratoire d’Ecologie Appliquée pour l’ambiance de
travail et la disponibilité dont ils ont fait montre.
A tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à la mise à jour de ce mémoire et
particulièrement mes amis les plus proches. Ils se reconnaîtront à travers ce document.
A tous les facilitateurs communautaires (FaC) de PROSAF en particulier ceux de
Bembèrèkè-Sinendé.
Aux auteurs des ouvrages que j’ai eu à consulter du début à la fin de ce document.
A tous ceux que j’ai injustement oubliés de citer nommément et qui se sentent frustrés de
n’avoir pas été cité.
vii
Résumé L’élevage en Afrique Tropicale et particulièrement au Bénin est sous la dépendance de la
disponibilité en eau. Le climat de type soudanien est marqué par l’alternance d’une saison
pluvieuse et d’une saison sèche qui peut durer cinq ou six mois. Ce climat chaud et sec fait
augmenter les besoins du bétail, alors qu’il raréfie les points d’abreuvement, indispensables au
développement du secteur de l’élevage.
Pour améliorer le rendement de ce secteur sous-exploité et qui pourtant regorge d’énormes
potentialités, le Bénin a initié la construction de plusieurs retenues d’hydraulique pastorale.
Toute intervention humaine sur l’environnement créant toujours des perturbations dans
l’équilibre de l’écosystème, l’intérêt de ce travail est d’évaluer les impacts physico-
environnementaux et socio-économiques de la construction de ces points d’eau permanents.
Les impacts physico-environnementaux ont été mesurés par l’observation directe d’une part et
par la photo-interprétation, l’étude diachronique des cartes d’occupation du sol et l’exécution de
21 relevés phytosociologiques de 1000 m² chacun d’autre part.
Les impacts socio-économiques ont été évalués à travers des questionnaires et différentes
techniques de collecte de données comme l’entretien individuel approfondi et le focus group.
Pôles de vie extrêmement importants pendant la saison sèche, les retenues d’hydraulique
pastorale sont le lieu de rassemblement privilégié des hommes pour venir y chercher l’eau
nécessaire à leurs besoins et des animaux pour s’y abreuver.
Ces grands rassemblements de troupeaux en un même lieu pendant plusieurs jours, sont d’une
part à l’origine des dégradations observées (du sol, de la végétation et même de la qualité de
l’eau) du fait des intenses piétinements et du surpâturage qu’ils occasionnent et d’autre part sont
des occasions de contamination des germes de maladies entre animaux. La pollution des eaux de
ces retenues par les particules de terre ameublies, les fécès des animaux et les déchets d’origine
anthropique sont à l’origine de la prolifération de certaines maladies chez les populations
riveraines. Les effets corollaires de cette pollution des eaux et de cette augmentation de la charge
alluvionnaire des cours d’eau vont de la perte de la diversité faunistique à la rupture des barrages
en passant aux inondations probables (à terme).
Les dégâts physiques occasionnés sont d’autant plus grands que la retenue est grande et que l’on
se rapproche de celle-ci.
viii
Mais la construction des retenues d’eau ne crée pas que des dommages. Plusieurs avantages aussi
bien environnementaux que socio-économiques sont liés à la mise en place des points
d’abreuvement.
Les observations de terrain et l’analyse des indices de diversité calculés pour chacun des quatre
groupements identifiés permettent d’une part de constater une progression des formations
végétales avoisinant les retenues d’eau et d’autre part de déduire que ces milieux sont assez
stables et supportent les perturbations anthropique et zoologique qui s’y exercent. Un autre
avantage non négligeable de la construction des retenues d’eau, est la prolifération d’une faune
assez diversifiée allant des animaux aquatiques aux animaux terrestres vivant dans les formations
avoisinant les retenues d’eau en passant par des animaux semi-aquatiques.
La construction des retenues d’eau a non seulement permis de réduire considérablement les
graves problèmes de déficit d’eau que rencontraient les populations et le cheptel pendant la
saison sèche mais aussi d’améliorer de manière substantielle les revenus économiques des
populations (maraîchage, vente de poissons et de produits laitiers, taxes d’abreuvement etc.).
Au total, la construction des retenues d’hydraulique pastorale apparaît comme un préalable au
développement de l’élevage dans tous les pays tropicaux.
Mots clés : Equilibre de l’écosystème – Etude diachronique – cartes d’occupation du sol – charge
alluvionnaire – milieu stable – perturbations anthropique et zoologique.
ix
Abstract Cattle and sheep-farming in Tropical Africa, particularly in Benin, are dependent upon the
availability of water. The sudanian type of climate is characterized by alternating wet and dry
seasons, the latter of which can last up to five or six months. This hot and dry climate increases
the water needs of herds while, at the same time, making scarce drinking water spots required for
the development of cattle-and sheep-farming.
In order to improve the yield of this under-exploited sector which, however, carries a great
potential, the government of Benin has initiated the construction of several water-holding
structures for cattle-and-sheep-farming purposes. Because every human intervention on the
environment always creates disturbances in the equilibrium of the ecosystem, the usefulness of
this work is the evaluation of the environmental, social and economical impacts of those
permanent water-holding structures.
Environmental impacts have been measured through direct observation on the one hand, and, on
the other hand, through photo interpretation, diachronic studies of land-use maps, and the
establishment of 21 plant community reports based on a 1000 m2 area each.
The social economical impacts have been evaluated through questions and different data-
collection techniques, such as interviews and focus group.
Extremely important survival centers during the dry season, these water-holding structures are
the gathering place of choice of humans for the water they need, and of animals for drinking.
Those large gatherings of herds in a single area for several days are at the root of the observed
degradations (of soil, vegetation and water quality) through excess trampling and overgrazing,
and also responsible for germ transmission between animals. The pollution of those waters due
to mud animal fecal matter, and anthropical wastes is responsible for the proliferation of some
diseases among local populations. The consequences of both this water pollution and the
increased loads of sediments to water bodies go from the loss of faunal diversity to potential
inundations to dam collapse. It should be noted that the bigger the water-holding structure is, the
more it is visited and the more intense are the environmental degradations observed.
But, the building of water-holding structures doesn’t generate just problems. Several
environmental as well as social economical advantages are associated with the permanent
existence of surface water, used by both animals and humans.
x
Fields observations and the analysis of diversity indices, computed for each of the four groups
identified, reveal a gradual change in plant communities around water sources and also imply
that those areas are stable enough and can withstand the anthropical and zoological disturbances
that take place there. Another noticeable advantage in building those structures is the spread of a
fauna diversified enough, going from aquatic animals to amphibious to terrestrial ones.
The construction of water-holding structures has not only allowed a considerable reduction of the
serious problems of water shortages formerly encountered by the population and the herds during
the dry season, but has also improved in a substantial way the income of the people (through
farming, sale of fish and milk products, taxes on herd drinking water, etc.)
All in all, the construction of water-holding structures for cattle- and/or sheep-farming purposes
appears to be a prerequisite to the development of farming in all tropical countries.
xi
TABLE DES MATIERES Chapitres Pages Chapitre I : INTRODUCTION…………………………………………………………..1-4 I- INTRODUCTION………………………………………………………………………….2 1- Problématique………………………………………………………………………………2
2- Justification du thème………………………………………………………………………3
3- Objectifs de l'étude…………………………………………………………………………4
3-1- Objectifs généraux…………………………………………………………………….….4
3-2- Objectifs spécifiques……………………………………………………………………..4
Chapitre II : MILIEU D’ETUDE………………………………………………………..5-29 1- Bref aperçu sur le département du Borgou………………………………………………… 7
1-1- Ressources physiques du département……………………………………………………7
1-2- Ressources humaines et socio-économiques du département…………………………...10
2- Caractéristiques physiques et socio-économiques de la commune de Nikki…………..12-29
2-1- Traits physiques…………………………………………………………………………12
2-1-1- Localisation géographique…………………………………………………………….12
2-1-2- Conditions mésologiques……………………………………………………………...12
2-1-2 1- Géomorphologie……………………………………………………………………..12
2-1-2-2- Réseau hydrographique………..…………………………………………………….14
2-1-2-3- Facteurs climatiques………………………………………………………………...19
2-1-2-4- Sols………………………………………………………………………………….24
2-1-2-5 - Formations végétales……………………………………………………………….26
2-2- Caractéristiques humaines et socio-économiques……………………………………….28
2-2-1- Subdivisions administratives et ressources humaines…………………………………28
2-2-2- Potentialités socio-économiques………………………………………………………29
2-2-2-1- L’agriculture………………………………………………………………………...29
2-2-2-2- L’élevage……………………………………………………………………………29
xii
Chapitre III : MATERIELS ET METHODE…………………………………………....30-41 III- Matériels et méthode de collecte et de traitement des données…………………………….31
III-1- Matériels de collecte des données………………………………………………………..31
III-1-1- Données physiques…………………………………………………………………….31
III-1-2- Données socio-économiques……………………………………………………….…..32
III-2- Méthode de collecte de données………………………………………………………….32
III-2-1- Données physiques…………………………………………………………………….32
III-2-2- Données socio-économiques…………………………………………………………...36
III-3- Traitement des données collectées……………………………………………………….38
III-3-1- Données physiques…………………………………………………………………….38
III-3-2- Données socio-économiques……………………………………………………….….40
Chapitre IV : RESULTATS……………………………………………………………..42-108 IV- Résultats de l’étude………………………………………………………………………….43 IV-1-Dynamique de l’occupation du sol de la région de Nikki-Est……………………………..43
IV-2- Caractérisation phytosociologique des retenues d’hydraulique pastorale………………...48
IV-2-1- Analyse du dendrogramme……………………………………………………………...48
IV-2-2- Caractérisation des groupements………………………………………………………..50
IV-2-2-1- Groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal…………………………..50
IV-2-2-1-1- Sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana…………………...54
IV-2-2-1-2 Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis…………………...58
IV-2-2-2- Formations sur sols ferrugineux tropicaux de type à concrétions……………………63
IV-2-2-2-1- Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha…………………69
IV-2-2-2-2- Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata………74
IV-2-3- Synthèse générale………………………………………………………………………79
IV-3- Les impacts négatifs des retenues d’hydraulique pastorale sur l’environnement…….…..81
IV-3-1- Sur l’environnement physique………………………………………………………….81
IV-3-1-1- Sur le sol………………………………………………………………………….…..83
IV-3-1-2- Sur l’hydrographie……………………………………………………………………84
IV-3-1-3- Sur la flore……………………………………………………………………………84
IV-3-2- Sur l’environnement socio-économique………………………………………………..86
xiii
IV-3-2-1- Sur les populations des localités………………………………………………………86
IV-3-2-2- Sur les animaux domestiques…………………………………………………………89
IV-3-2-3- Sur la faune……………………………………………………………………………90
IV-4- Les impacts positifs……………………………………………………………………….92
IV-4-1- Sur l’environnement physique………………………………………………………….92
IV-4-1-1- Impacts sur la végétation……………………………………………………………...92
IV-4-1-2- Sur la faune……………………………………………………………………………94
IV-4-1-2-1- Sur la faune sauvage………………………………………………………………..94
IV-4-1-2-2- Sur les animaux domestiques………………………………………………………95
IV-4-2- Sur l’environnement humain……………………………………………………………95
IV-4-2-1- Sur les agriculteurs……………………………………………………………….…...97
IV-4-2-2- Sur les éleveurs……………………………………………………………………….98
IV-4-2-3- Sur les femmes ménagères…………………………………………………………..101
IV-4-2-4- Sur la communauté villageoise………………………………………………………103
Chapitre V : DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS……………………………109-115 V- DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS………………………………………………110
1- Faut-il continuer à promouvoir la construction des retenues d’hydraulique pastorale
malgré les nombreux impacts négatifs qu’elles occasionnent
sur l’environnement ?……………………………………………………………………...110
2- La construction des retenues d’hydraulique pastorale a t-elle réellement contribué à la
sédentarisation des éleveurs de notre région d’étude ?…………………………………114
CONCLUSION………………………………………………………………………………..117 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES……………………………………………………118 ANNEXES………………………………………………………………………………..123-150
xiv
LISTE DES PHOTOS Photos Pages Photo 1: Retenue d’eau de Ouénou vue du nord vers le sud du lac de la retenue……………..14
Photo 2 : Retenue d’eau de Ouroumon vue du sud-ouest……………………………………..15
Photo 3 : Retenue d’eau de Sakabansi vue de la digue (sud-est)……………………………...16
Photo 4 : Retenue d’eau de Fombaoui en saison sèche………………………………………..16
Photo 5: Retenue d’eau de Sansi vue du sud-ouest…………………………………………....17
Photo 6: Piétinements intenses autour de la retenue de Sansi………………………………....83
Photo 7 : Erosion du sol en amont de la retenue de Ouénou………………………………….83
Photo 8: femmes peulh faisant la vaisselle et la lessive au bord de la retenue de Sakabansi....87
Photo 9: Bovins venus s’abreuver dans la retenue d’eau de Ouénou……………………….…89
Photo 10: Femmes faisant la lessive au bord de la retenue d’eau de Sakabansi……………..102
xv
LISTE DES TABLEAUX Tableaux Pages Tableau 1 : Effectifs du cheptel du département du Borgou par espèces et par commune……..10
Tableau 2 : Caractéristiques des principales races de cheptel observées dans le Borgou………11
Tableau 3 : Tableau récapitulatif synoptique des caractéristiques de chaque retenue
d’hydraulique pastorale…………………………………………………………………………19
Tableau 4 : Effectifs du cheptel du Borgou et de Nikki en 2001……………………………….29
Tableau 5: Répartition des relevés par site et par phytocénose………………………………...34
Tableau 6: Tableau de synthèse du nombre d’enquêtés par groupe socio-professionnel………37
Tableau 7: Dynamique de l’occupation du sol de la région de Nikki-Est entre 1986 et 1998…43
Tableau 8: Tableau synthétique des caractéristiques des groupements individualisés dans les
phytocénoses environnant les retenues d’hydraulique pastorale de la région de Nikki-Est……49
Tableau 9 : Tableau phytosociologique du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type
modal…………………………………………………………………………………….……...50
Tableau 10 : Caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus
dans les phytocénoses environnant les retenues d’hydraulique pastorale de Ouénou et de
Ouroumon………………………………………………………………………………………54
Tableau 11 : Tableau phytosociologique du groupement à Allophyllus africanus et Acacia
sieberiana……………………………………………………………………………………….55
Tableau 12 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha
golungensis……………………………………………………………………………………..59
Tableau 13 : Tableau phytosociologique des groupements sur sol ferrugineux tropical de type à
concrétions……………………………………………………………………………………...64
Tableau 14 : Caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus
dans les phytocénoses environnant les retenues d’hydraulique pastorale de Sakabansi, Fombaoui
et Sansi………………………………………………………………………………………….69
Tableau 15 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia
ataxacantha……………………………………………………………………………………...70
Tableau 16 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca
longepedunculata………………………………………………………………………………..74
Tableau 17 : Abondance-dominance des types biologiques obtenus par sous-groupement……79
xvi
Tableau 18 : Abondance-dominance des types phytogéographiques obtenus par
sous-groupement…………………………………………………………………………….…..80
Tableau 19 : Tableau synthétique des paramètres dendrométriques et de diversité spécifique
obtenus par sous-groupement……………………………………………………………………80
Tableau 20 : Tableau synthétique des impacts négatifs des retenues d’hydraulique pastorale sur
l’environnement physique……………………………………………………………….………82
Tableau 21: Principales maladies bovines recensées dans la région d’étude……………………89
Tableau 22 : Tableau synthétique des impacts positifs des retenues d’hydraulique pastorale sur
l’environnement physique de la région d’étude…………………………………………………93
Tableau 23 : Tableau synthétique des différentes espèces animales observées dans et autour des
retenues d’hydraulique pastorale………………………………………………………………..94
Tableau 24 : Tableau synthétique des impacts positifs des retenues d’hydraulique pastorale sur
les populations de la région étudiée……………………………………………………………..96
Tableau 25 : Importance des retenues d’hydraulique pastorale pour l’acquisition des animaux de
trait………………………………………………………………………………………………97
Tableau 26 : Tableau de synthèse des différentes utilisations faites de l’eau des retenues
d’hydraulique pastorale de la région d’étude…………………………………………………..100
Tableau 27 : Principales sources d’approvisionnement en eau des populations suivant
les saisons……………………………………………………………………………………...101
Tableau 28 : Evolution de la prise de poissons et des recettes de pêche par saison et
par localité……………………………………………………………………………………...104
Tableau 29 : Répartition des taxes d’abreuvement par retenue d’hydraulique pastorale….…..106
Tableau 30 : Principales maladies courantes observées chez les populations de la zone
d’étude…………………………………………………………………………………………127
Tableau 31 : Synthèse des maladies humaines qui seraient liées aux retenues d’hydraulique
pastorale……………………………………………………………………………………. …128
Tableau 32 : Maladies animales rencontrées dans les différentes localités……………………128
Tableau 33 : Maladies animales liées à la retenue d’eau d' après les populations enquêtées…129
Tableau 34: Importance des retenues d' eau pour la culture Attelée…………………………...129
Tableau 35: Différentes sources d'approvisionnement en eau par localité et par saison……….129
Tableau 36 : Différentes utilisations faites des retenues d' eau par localité et par saison……...130
xvii
Tableau 37: Sources d' approvisionnement en eau des Peulh et Gando par localité et par
saison……………………………………………………………………………………………130
Tableau 38 : Différentes utilisations faites de l' eau des retenues par les Peulh et Gando par
localité et par saison…………………………………………………………………………….131
Tableau 39 : Superficie de l'occupation du sol de Nikki-Est…………………………………...131
Tableau 40 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type modal par centre de
classe de diamètre………………………………………………………………………………132
Tableau 41 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type modal par centre de
classe de surface terrière………………………………………………………………………..134
Tableau 42 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana par centre
de classe de diamètre…………………………………………………………………………...136
Tableau 43 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana par centre
de classe de surface terrière…………………………………………………………………….137
Tableau 44 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre
de classe de diamètre…………………………………………………………………………...138
Tableau 45 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre
de classe de surface terrière…………………………………………………………………….140
Tableau 46: Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type concrétionné par
centre de classe de diamètre…………………………………………………………………….142
Tableau 47 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type concrétionné par
classe de surface terrière………………………………………………………………………..143
Tableau 48 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia sieberiana par centre
de classe de diamètre…………………………………………………………………………...144
Tableau 49 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia sieberiana par classe
de surface terrière……………………………………………………………………………….145
Tableau 50 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata
par centre de classe de diamètre………………………………………………………………...146
Tableau 51 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata
par classe de surface terrière……………………………………………………………………147
Tableau 52 : Répartition des espèces récoltées dans les 21 placeaux par famille et
correspondances en langue fulbe……………………………………………….……………...148
xviii
Liste des figures Figures Pages Figure 1 : Carte de localisation de la commune de Nikki………………………………………...6
Figure 2: Evolution des précipitations annuelles enregistrées à Parakou de 1970 à 2000………..8
Figure 3: Evolution des précipitations mensuelles enregistrées à Parakou de 1970 à 2000……...8
Figure 4 : Carte de localisation des villages enquêtés dans la commune de Nikki……..……….13
Figure 5 : Carte hydrographique de la région de Nikki-Est……………………………………..18
Figure 6 : Variation des moyennes annuelles de température enregistrées à Parakou de 1970 à
2000………………………………………………………………………………………….….20
Figure 7 : Variation des moyennes mensuelles de température enregistrées à Parakou de 1970 à
2000……………………………………………………………………………………………..20
Figure 8 : Variation des moyennes mensuelles de l’humidité relative de l’air enregistrées à
Parakou de 1970 à 2000…………………………………………………………………………21
Figure 9 : Variation des moyennes annuelles de l’humidité relative de l’air enregistrée à Parakou
de 1970 à 2000…………………………………………………………………………………..21
Figure 10 : Evolution de l’insolation moyenne mensuelle enregistrée à Parakou de 1970 à
2000………………………………………………………………………………………….….22
Figure 11 : Evolution de l’insolation moyenne annuelle enregistrée à Parakou de 1970 à
1998………………………………………………………………………………………….….22
Figure 12 : Variation des moyennes mensuelles de hauteurs de pluie enregistrées à Nikki de 1970
à 2000………………………………………………………………………………….………...23
Figure 13 : Variation des hauteurs annuelles de pluie enregistrées à Nikki de 1970 à 1997……24
Figure 14 : Carte pédologique de Nikki-Est…………………………………………………….25
Figure 15 : Carte de l’occupation du sol de Nikki-Est en 1986…………………………………44
Figure 16 : Carte de l’occupation du sol de Nikki-Est en 1998…………………………………45
Figure 17 : Carte de synthèse de l’occupation du sol de Nikki-Est (1986-1998)……………….47
Figure 18 : Dendrogramme de la classification hiérarchique des relevés……………………….48
Figure 19 : Spectre biologique du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type
modal…………………………………………………………………………………………….52
xix
Figure 20 : Spectre phytogéographique du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type
modal…………………………………………………………………………………………….53
Figure 21 : Répartition du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière…………………………….……..53
Figure 22 : Spectre des types biologiques du sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia
sieberiana……………………………………………………………………………………….57
Figure 23 : Spectre des types phytogéographiques du sous-groupement à Allophyllus africanus et
Acacia sieberiana……………………………………………………………………………….57
Figure 24 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière…………………………….……..58
Figure 25 : Spectre des types biologiques du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha
golungensis……………………………………………………………………………………...61
Figure 26 : Spectre des types phytogéographiques du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa
et Zanha golungensis……………………………………………………………………………62
Figure 27 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre
de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière………………………………..62
Figure 28 : Spectre des types biologiques des formations sur sols ferrugineux tropicaux de type à
concrétions……………………………………………………………………………………...66
Figure 29 : Spectre des types phytogéographiques des formations sur sols ferrugineux tropicaux
de type à concrétions……………………………………………………………………………67
Figure 30 : Répartition du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type concrétionné par
centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière…………………………68
Figure 31 : Spectre des types biologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia
ataxacantha………………………………………………………………………………….…..72
Figure 32 : Spectre des types phytogéographiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et
Acacia ataxacantha………………………………………………………………………….…..72
Figure 33 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha par centre
de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière………………………………...73
Figure 34 : Spectre des types biologiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca
longepedunculata………………………………………………………………………………..76
xx
Figure 35 : Spectre des types phytogéographiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et
Securidaca longepedunculata……………………………………………………………….…..77
Figure 36 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata
par centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière……………………..78
Figure 37 : Principales sources d’approvisionnement en eau par saison………………………..86
Figure 38 : Différentes utilisations faites de l’eau des retenues d’hydraulique pastorale pendant la
saison sèche……………………………………………………………………………………...86
Figure 39 : Principaux groupes de maladies rencontrés chez les populations riveraines et qui
seraient liés à l’utilisation de l’eau des retenues…………………………………………….…..88
Figure 40 : Principales maladies bovines contractées aux retenues d’eau………………………90
Figure 41 : Evolution du nombre de paires d’animaux de trait fonctionnelles dans la commune de
Nikki…………………………………………………………………………………………….98
Figure 42 : Différentes sources d’approvisionnement en eau des communautés fulbé et gando de
la région d’étude………………………………………………………………………….……..99
2
1- Problématique Avec une contribution d’environ 40% du Produit Intérieur Brut (PIB), le secteur rural occupe une
place prépondérante dans l’économie béninoise, en dépit des nombreux aléas naturels et la crise des
marchés extérieurs auxquels il est soumis (RGPH2, 1992).
Malgré de bonnes potentialités, l’élevage représente un secteur sous-exploité. Occupant la deuxième
place du secteur primaire après l’agriculture, il contribue pour 16% du PIB agricole soit près de 6%
du PIB total (aux prix courants 1991). Il est pratiqué majoritairement par les Fulbé représentant
6,14% de la population totale du Bénin (RGPH2, 1992). Le patrimoine cheptel national toutes
espèces confondues, représente un capital dont la valeur totale en 1992 est estimée à 64,5 milliards
de francs CFA, dont 77% pour les seuls bovins (RGPH2, 1992). D’une manière générale, les
cheptels ruminants, bovins en tête constituent un patrimoine économique très important dont
l’intérêt n’est aujourd’hui ignoré de personne. En effet, beaucoup d’autres opérateurs appartenant à
divers groupes socioprofessionnels (agriculteurs, commerçants, artisans, fonctionnaires en service
ou retraités, etc.) investissent de plus en plus leurs revenus d’exploitation ou de service dans
l’acquisition d’animaux pour les confier aux bouviers. Bien qu’il s’agisse là d’une forme de
thésaurisation, toute affectation de ces troupeaux, en termes de productivité et de santé, fragilise les
revenus d’une fraction importante de la population déjà confrontée à un environnement économique
difficile.
Des multiples contraintes qui affectent les troupeaux et l’élevage en général, nous ne retenons que
quatre principales :
- L’insuffisance des points d’eau permanents qui entraîne une sous-utilisation du potentiel pastoral
et représente la principale cause des mouvements de transhumance ;
- la faible valeur alimentaire des fourrages disponibles en saison sèche qui représente le principal
facteur limitant du développement de l’élevage ;
- les parasitoses internes et la Trypanosomiase ;
- les conditions peu stimulantes de la commercialisation (faiblesse du prix de vente du cheptel).
Dans le but d’apporter quelques solutions aux problèmes ci-dessus mentionnés et de répondre aux
besoins exprimés par les populations, diverses installations d’hydraulique pastorale (retenues d’eau)
ont été réalisées par divers projets et organismes de développement. Considérés comme des pôles de
progrès, ces points d’eau artificiels devraient permettre la constitution des groupements d’éleveurs
dont la vocation initiale serait la gestion des ouvrages réalisés mais dont la finalité résiderait dans
l’amélioration de la conduite du cheptel.
3
Comment sont aujourd’hui gérés ces ouvrages ? Ont-ils réellement contribué à l’amélioration des
conditions de l’élevage ? Quels sont les impacts de ces retenues sur le milieu physique et sur la vie
socio-économique des populations ?
Pour répondre plus ou moins objectivement à toutes ces interrogations, nous avons circonscrit notre
cadre d’étude à la Commune de Nikki et plus précisément aux retenues d’eau de Sakabansi,
Ouénou, Fombaoui, Ouroumonsi et Sansi.
2- Justification du thème Tout aménagement ou toute intervention humaine sur la nature entraîne toujours des perturbations
au niveau de l’équilibre de l’écosystème. Ainsi, la construction des retenues d’hydraulique pastorale
constitue une intrusion dans l’écosystème de cette région. Cette intrusion se manifeste par une série
de perturbations qui peuvent être directes et/ou indirectes, socio-environnementales et/ou physico-
environnementales, positives et/ou négatives… Mais les aménagements ne créent pas que des
perturbations. Beaucoup d’avantages socio-environnementaux peuvent également être enregistrés.
Plusieurs raisons argumentent en faveur de cette étude. Entre autres, nous retiendrons :
- La nécessité de faire le point des impacts des retenues d’eau sur les populations et sur
l’environnement physique,
- l’existence des références techniques intéressantes (PDPIB, PDEBB, PDEBE…) dans la
zone d’étude
- et surtout les priorités actuelles de la politique de développement (augmentation de la
contribution de l’élevage au Produit Intérieur Brut, meilleure utilisation des ressources
existantes, diversification de la production nationale, transfert de certaines compétences aux
populations locales, etc.)
4
3- Objectifs de l'étude 3-1- Objectifs généraux L’impact des retenues pouvant être mesuré à partir de plusieurs paramètres, nous avons focalisé
notre étude sur deux objectifs globaux :
- Evaluer les conséquences écologique et socio-économique des retenues d’hydraulique
pastorale dans la Commune Nikki.
- Identifier les barrières socio-culturelles à une gestion saine et durable de ces retenues
3-2- Objectifs spécifiques Pour atteindre les objectifs généraux que nous nous sommes fixés, nous avons identifié six objectifs
spécifiques aussi bien au niveau écologique qu’au niveau socio-économique. Il s’agit :
Au niveau écologique - Déterminer les composantes de l’environnement naturel local affectées négativement par la
création des retenues.
- Déterminer les composantes de l’environnement naturel local affectées positivement par la
construction des retenues.
- Identifier les moyens simples de minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et
d’augmenter les impacts positifs.
Au niveau socio-économique - Déterminer les avantages socio-économiques générés par la construction des retenues dans
le milieu d’étude.
- Déterminer les groupes sociaux et les activités économiques pénalisés par la construction
des retenues.
- Identifier les moyens simples de minimiser les inconvénients sociaux et économiques des
retenues.
7
II- MILIEU D’ETUDE D’une superficie évaluée à environ 112.622Km², le territoire national de la République du Bénin
peut être représenté par un quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes: 0°45’
et 3°55’ de longitude Est et 6°10’ et 12°25’ de latitude Nord (KREIS, 1988). On y compte
6.752.569 habitants dont 3.467.665 femmes soit environ 59,96 habitants par kilomètre carré. Entre
1992 et 2002, on a enregistré un taux d’accroissement naturel de 3,23 et une masculinité de 94,7
(RGPH3, 2002).
Le territoire national est subdivisé en douze départements dont celui du Borgou englobant notre
zone d'étude. La figure No 1 montre la localisation de la commune de Nikki par rapport au
département du Borgou et par rapport au Bénin.
1- Bref aperçu sur le département du Borgou
1-1- Ressources physiques du département Anciennement appelé Sud-Borgou, l'actuel département du Borgou est limité au nord par le
département de l'Alibori, au Sud et à l'Ouest par les départements des Collines et de la Donga et à
l'Est par la frontière du Nigeria.
- Le relief de ce département est dominé par une grande unité morphologique, la pénéplaine
cristalline. D'une altitude moyenne de 200-300 m dans la partie Sud, elle s’élève progressivement
pour atteindre 400 m d’altitude à la latitude de Bembéréké, puis elle descend insensiblement jusqu’à
250 m au contact du plateau de Kandi (KREIS, 1988).
- Il s’ensuit une gamme variée de sols généralement aptes à l’agriculture et dont les plus répandus
sont les sols sur socle granito-gneissiques (OLOULOTAN, 1988).
- Ce département est arrosé par un certain nombre de cours d’eau qui prennent leur source à partir
de deux bassins qui sont :
Le bassin du Niger avec ses affluents : Mékrou, Alibori et Sota
Le bassin de l’Ouémé où le fleuve Ouémé donne naissance à l’Okpara (OLOULOTAN, 1988).
- Le climat de ce département est typiquement tropical ( soudanien ) et humide. Ce type de climat
est caractérisé d’une part par des températures élevées pendant toute l’année et d’autre part par
l’alternance de deux saisons bien marquées :
une saison des pluies d’avril à octobre
une saison sèche de novembre à mars (KREIS, 1988).
8
- L’intensité maximale de pluie enregistrée de façon générale à Parakou durant le mois d’août est de
211,5 mm (moyenne 1970 à 2000) avec une moyenne annuelle de 1151,12 mm pour la même
période (Source : ASECNA, 2002). Selon la même source, le maximum de pluie enregistrée au
cours des trente dernières années se situe en 1988 où les précipitations annuelles ont atteint 1614,6
mm. De cette date, on assiste grossièrement à une chute de la hauteur des pluies. Ces variations sont
illustrées par les figures 2 et 3 ci-dessous.
0
500
1000
1500
2000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31
Années (de 1970 à 2000)
Hau
teur
s an
nelle
s de
pl
uie
(mm
)
Figure 2: Evolution des précipitations annuelles enregistrées à Parakou de 1970 à 2000
(Source : ASECNA, 2002)
050
100150200250
Janv
ierMars Mai
Juille
tSep
tNov
Mois
haut
eurs
de
plui
e (m
m)
Figure 3: Evolution des précipitations mensuelles enregistrées à Parakou de 1970 à 2000
(Source: ASECNA, 2002)
Cette chute des moyennes annuelles de pluie depuis quelques années pourrait s’expliquer par
l’irrégularité des pluies consécutive à la destruction croissante des couverts forestiers.
9
- Les maxima mensuels moyens de température enregistrés à Parakou varient entre 29,25 et 36,5°C
tandis que les minima vont de 18,44 à 23,39°. Les maxima annuels atteignent 33,57°C alors que les
minima sont de l’ordre de 19,93°C au niveau de la même station (Source : ASECNA, 2002).
Deux types de vents dominants se succèdent au cours de l’année dans la zone :
L’alizé maritime qui souffle d’avril à novembre en direction sud-ouest ;
l’harmattan, vent sec et froid, très desséchant qui souffle du nord vers l’est sur toute la partie
septentrionale du pays de novembre à mars.
- L’humidité relative de l’air enregistrée au niveau de la station de Parakou varie de 18,45% en
février (minimum) à 96% en septembre (maximum) avec une moyenne de 81,11% enregistrée en
septembre. Les moyennes annuelles varient de 38,33% (minimum) à 88,33% (maximum) selon les
statistiques de la période allant de 1970 à 2000 (ASECNA, 2002).
- L’évapotranspiration est de l’ordre de 1500 mm dans le département alors qu’elle atteint 1850 mm
dans l’Alibori (KREIS, 1988).
- Les formations végétales rencontrées dans le Borgou appartiennent presque toutes à l’un ou l’autre
type de savane. Les seules exceptions sont les forêts-galeries le long des cours d’eau, les quelques
ilôts de forêt claire et les ‘’bowé’’ ou cuirasse affleurante, présentant une végétation très réduite
(KREIS, 1988).
Les savanes arbustives et arborées sont les plus fréquentes. Les savanes boisées se trouvent dans les
dépressions et talwegs à sol bien drainé, tandis que la savane herbeuse est absente.
Il existe cependant aussi des formations végétales semi-naturelles, qui représentent les divers stades
de recolonisation post-culturale.
Les premières années après l’abandon des champs s’installe une végétation herbacée avec comme
seuls ligneux quelques individus de karité (Vitellaria paradoxa ) et de néré (Parkia biglobosa ). Ces
deux arbres sont épargnés lors des défrichements avant mise en culture parce que leurs fruits sont
des produits alimentaires : les noix de karité sont transformées en beurre et les gousses de néré en
condiment (KREIS, 1988).
Plus la couverture ligneuse augmente et plus la végétation se transforme en un type de savane
arborée, appelé savane-parc (ROCHAIN, cité par KREIS, 1988). Cette formation végétale
ressemble aux savanes naturelles, sauf que la fréquence des karité et néré y est plus grande.
Dans toutes les régions intertropicales, les savanes sont utilisées comme pâturages extensifs, parce
que cet écosystème représente l’habitat optimal pour les populations d’herbivore.
10
Au total, on observe dans le département, une végétation du type soudano-guinéen qui évolue au
type soudano-sahélien en progressant vers l’extrême Nord du pays (extrême Nord de l’Alibori)
(OLOULOTAN, 1988). Elle est caractérisée par deux principales formations :
- l’une naturelle regroupe des forêts claires à flore arborescente et herbacée, des îlots forestiers
denses généralement peu étendus, des savanes arborées et des prairies sur sols hydromorphes ;
- l’autre anthropique est faite de cultures et de jachères naturelles’’ (OLOULOTAN, 1988).
1-2- Ressources humaines et socio-économiques du département Avec une superficie de 25.856 km² et une densité de 27,86 habitants/Km², le département du
Borgou est une région essentiellement agricole, comme le démontre les 80% de la population active
qui travaille dans le secteur rural. Il compte 720.287 habitants dont 358.526 femmes soit un taux
d’accroissement de 4,32 entre 1992 et 2002 (RGPH3, 2002).
La population est constituée de plusieurs groupes socio-culturels dont les plus importants sont les
Baribas, ethnie sédentaire vivant essentiellement de l’agriculture et les Peulhs ou Fulbés, ethnie de
pasteurs transhumants. Selon BAWA (1997), ce dernier groupe représente les 27,65% de la
population de l’ex. département du Borgou, soit les 75,87% des Fulbés à l’échelle nationale.
Les cultures vivrières de base du département sont le sorgho (Sorghum spp.), le maïs (Zea mays), le
petit mil (Pennisetum typhoides) et le fonio (Digitaria exilis) pour les céréales et l’igname
(Dioscorea sp.) et le manioc (Manihot esculenta) pour les tubercules. Le coton (Gossypium
barbadense, G. hirsutum) et l’arachide (Arachis hypogea) représentent les cultures industrielles.
C’est l’une des régions les plus importantes en ce qui concerne l’élevage. En effet, 50,89% du
cheptel bovin, 20,47% du cheptel ovin, 11,48% du cheptel caprin et 3,33% du cheptel porcin y est
concentrés.
Les tableaux 1 et 2 résument l’un, les effectifs du cheptel du Borgou et l’autre, quelques
caractéristiques des races bovine et ovine rencontrées dans le département.
Tableau 1: Effectifs du cheptel du département du Borgou par espèces et par commune
Secteurs /Espèces Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Asins Volailles
Borgou 811.428 137.066 140.471 9.198 347 61 529.917
Bénin 1.594.352 669.629 1.223.609 276.513 - - -
Pourcentage 50,89 20,47 11,48 3,33
(Source : Rapport annuel 2001 de la Direction de l’Elevage).
11
Tableau 2: Caractéristiques des principales races de cheptel observées dans le Borgou
Nature
cheptel
Races Taille adulte Poids adulte Autres caractéristiques
Bovins Zébu 1,4 à 1,5 m 400 à 500 kg Race la plus grande et la plus
lourde ; très résistante aux
conditions du milieu, supporte
les longues marches et accepte
les fourrages même grossiers.
Race trypanosensible, elle est
celle de la zone sahélienne.
Borgou 1,1 à 1,3 m - Considérée comme issue du
croisement entre le Taurin de
lagunes (race autochtone) et le
Zébu. Race trypanotolérante,
elle a un caractère doux.
Hybride
Borgou x Zébu
Difficulté de définir une véritable race d’hybrides Borgou x Zébu à
cause de l’énorme variabilité de leurs caractères, variabilité due à
l’hétérogénéité de la race Borgou.
Ovins Diallonké 50 à 55 cm 30 à 32 kg Queue fine, poil blanc, pas de
corne.
Peulh 65 à 80 cm : femelle
75 à 90 cm : mâle
40 kg -
Caprins Guinéenne - 20 kg -
(Source : KREIS, 1988)
Mais de nos jours, on assiste à une intégration entre ces deux activités révélée par l’apparition des
agro-éleveurs de plus en plus nombreux. Cela se traduit par la pratique de l’agriculture par les Peulh
(cultures vivrières et de plus en plus de coton) et l’acquisition des animaux de trait par les
agriculteurs.
12
2- CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COMMUNE DE NIKKI
2-1- Traits physiques 2-1-1- Localisation géographique Située entre 9°40’ et 10°15’ de latitude Nord et entre 2°47’ et 3°37’ de longitude Est, la commune
de Nikki est située à l’Est du département du Borgou et couvre une superficie estimée à environ
3.171 km². Elle est limitée au Nord par la commune de Kalalé, à l’Ouest par la commune de
Bembéréké, au Sud-Ouest par la commune de N’dali, au Sud par la commune de Pèrèrè et à l’Est
par le Nigéria. La figure 4 montre la carte de la commune de Nikki et la localisation des
arrondissements/villages enquêtés dans la commune. On remarque sur cette carte que les
arrondissements/villages enquêtés sont situés à l’Est de cette commune.
Du point de vue phytogéographique, cette région appartient au domaine phytogéographique
soudanien du Nord-Bénin (Adjanohoun et Guillaumet, 1971; Sinsin, 1993).
2-1-2- Conditions mésologiques 2-1-2 1- Géomorphologie Le substratum géologique de la région d’étude est composé du socle précambrien et du bassin
sédimentaire de Kandi. Le socle précambrien est formé notamment des gneiss du Dahomeyen
(ensemble des formations métamorphiques et plissées) et des granites d’extension assez importante.
Quant au bassin sédimentaire de Kandi, il comprend surtout le grès du Crétacé. L’altération du
granite et du grès est à l’origine des sols sans ou à concrétions (TOKO MOUHAMADOU, 2000).
Le paysage géomorphologique de cette région est dénommé plateau cristallin. Il est le domaine des
roches grenues consolidées. On y reconnaît les formations métamorphisées et plissées comme
granites post-tectoniques, grès, gneiss, migmatites, quartzites, et micaschistes et une pénéplaine
faite d’une succession de croupes surbaissées, caractéristiques des plaines soudanaises
(OLOULOTAN, 1988) s’étendant à perte de vue.
14
2-1-2-2- Réseau hydrographique - Cours d’eau naturels
La région d’étude appartient au bassin versant du Niger et est drainée par la Sota qui prend sa
source vers 400 m d’altitude et s’écoule vers le nord.
Le réseau hydrographique de la Sota et ses affluents entaillent une pénéplaine à peine ondulée où les
zones hautes sont importantes par rapport aux zones basses et aux versants. Les cours d’eau comme
Tassiné, Sota et Oli possèdent de très nombreux affluents tous à sec pendant la saison sèche (cours
d’eau temporaires). (OLOULOTAN, 1988).
Ce caractère temporaire des cours d’eau de la région justifie la construction de nombreuses retenues
d’hydraulique pastorale sur les différents affluents du fleuve Sota dont celles ciblées par cette étude.
- Retenues d’hydrauliques pastorales étudiées
1- Retenue d’hydraulique pastorale de Ouénou La retenue d’une capacité totale de 19.000 m3 a été construite dans la partie supérieure du marigot
Sondara à environ 1 km au sud du village de Ouénou (7 km de Nikki). Le thalweg en amont est
ouvert avec une largeur de 300 m et une pente longitudinale de 6 pour mille. En aval, le thalweg se
rétrécit avec une pente prononcée de 10 pour mille. Le sous-sol du terrain a un caractère nettement
argileux. (GADO et al., 1990).
Avec un bassin versant estimé à 11,50 km², cette retenue a une capacité utile de 10.400 m3 et une
charge d’abreuvement prévue de 2.900 têtes de bétail. Sa profondeur d’eau est de 3,75 m. (GADO
et al., 1990).
Photo 1: Retenue d’eau de Ouénou vue du nord vers le sud du lac de la retenue. Observez la forêt
galerie située au fond de la photo (Source : photo prise sur le terrain, 2001)
15
2- Retenue d’hydraulique pastorale de Ouroumon La retenue d’eau de Ouroumon d’une capacité totale de 10.800 m3, est la première construite par le
projet PDPIB. L’ouvrage se trouve au confluent de la rivière Issi et de son affluent Sokossanan à 1
km au nord-est de Ouroumon (15 km à l’est de Nikki). Le sous-sol présente une roche-mère
imperméable de couleur blanche entre 2,25 et 3 m de profondeur.
Avec un bassin versant estimé à 20,8 km², cette retenue a une capacité utile de 5.400 m3 et une
charge d’abreuvement prévue de 1.500 têtes de bétail. Sa profondeur d’eau est de 3,50 m.
Photo 2 : Retenue d’eau de Ouroumon vue du sud-ouest. Observez la forêt-galerie tout autour du lac
de la retenue. (Source : photo prise sur le terrain, 2001)
3- Retenue d’hydraulique pastorale de Sakabansi D’une capacité totale de 250.000 m3, cette retenue d’eau est située au sud de l’agglomération de
Sakabansi et a une capacité utile de 125.000 m3. Elle est contruite sur le cours d’eau appelé
Sakabana, affluent secondaire de la rivière Oli.
16
Photo 3 : Retenue d’eau de Sakabansi vue de la digue (sud-est). Observez une partie de la forêt
galerie environnant le lac du nord-ouest jusqu’à l’amont. (Source : photo prise sur le terrain, 2001)
4- Retenue d’hydraulique pastorale de Fombaoui La retenue d’eau de Fombaoui, d’une capacité totale de 17.000 m3 se trouve au côté inférieur du
marécage Kuena à 1 km à l’ouest du village de Fombaoui, lui-même situé à 23 km à l’est de Nikki
et à 8 km au nord de Ouroumon. Le sous-sol du terrain est nettement argileux.
Avec un bassin versant estimé à 2,4 km², cette retenue a une capacité utile de 8.500 m3 et une
charge d’abreuvement prévue de 2.400 têtes de bétail. Sa profondeur d’eau est de 3,50 m (GADO et
al., 1990).
Photo 4 : Retenue d’eau de Fombaoui en saison sèche. Observez l’espace laissé par le recul de l’eau
et les animaux venus s’abreuver. (Source : photo prise sur le terrain, 2001)
5- Retenue d’hydraulique pastorale de Sansi
17
La retenue d’eau de Sansi d’une capacité totale de 66.500 m3 a été construite sur le cours d’eau Fini
à environ 1 km à l’est du village de Sansi. Les coordonnées du site sont 03°25’29’’ Est et
10°56’50’’ Nord. Le lit du cours d’eau est assez encaissé et celui-ci tarit vers la fin du mois de
décembre. Les pentes longitudinales et transversales du site sont respectivement de 15 et 35 pour
mille, ce qui donne un cours d’eau relativement calme sans effets d’érosion importants. (GADO et
al., 1990).
Avec un bassin versant estimé à 4,25 km², cette retenue d’eau a une capacité utile de 17.500 m3
pour une profondeur maximale d’eau de 4,8 m et une charge d’abreuvement maximale journalière
prévue de 3.000 têtes de bétail. (GADO et al., 1990).
Photo 5: Retenue d’eau de Sansi vue du sud-ouest. Observez la galerie située en amont du cours
d’eau barré en arrière plan et les herbacées aquatiques colonisant le lac de la retenue. (Source :
photo prise sur le terrain, 2001)
La carte de la figure 5 montre le réseau hydrographique de la région Est de la commune de Nikki et
la répartition géographique des retenues d’hydraulique pastorale étudiées.
19
Les principales caractéristiques des retenues d’hydraulique pastorales étudiées sont résumées dans
le tableau 3.
Tableau 3 :Tableau récapitulatif synoptique des caractéristiques de chaque retenue d’hydraulique
pastorale
Retenues d’eau Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou
Superficie bassin versant
(km²)
- 2,4 4,3 20,8 11,5
Capacité
(m3)
Total 250.000 17.000 66.500 10.800 19.000
Utile 125.000 8.500 17.500 5.400 10.400
Hauteur maximum d’eau
(m)
- 3,00 4,80 3,00 3,30
Hauteur digue (m) - 4,00 5,80 4,00 4,30
Têtes de bétail
abreuvées
- 3.000 3.000 3.000 3.000
Populations utilisatrices 6.313 2.837 - 706 1.035
Coût (millions de FCFA
historique)
- 5,9 23,1 4,7 5,7
Date de réalisation 1984 04-02-89 28-02-94 15-06-88 25-07-89
Sources: PDEBE, Génie rural et RGPH2
2-1-2-3- Facteurs climatiques Le climat de la zone est typiquement soudanien (OLOULOTAN, 1988).
- Température Les moyennes annuelles varient entre 25,68° et 27,91° C. Les maxima sont enregistrés entre mars-
avril et sont de l’ordre de 35 à 36,5° C. Les minima allant de 18,44 à 19,04° C se situent entre
décembre-janvier, période au cours de laquelle l’Harmattan bat son plein dans la région. Les
variations annuelle et mensuelle de température enregistrées au niveau de la station de Parakou sont
illustrées par les figures 6 et 7 suivantes.
20
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
Années (1970-2000)
Tem
péra
ture
s (d
egré
ce
lciu
s) moy max
moy min
moy
Figure 6: Variation des moyennes annuelles de température enregistrées à Parakou de 1970 à 2000.
Ces valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
0.005.00
10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00
Janvie
rMars Mai
Juillet
Sept
Nov Mois
Tem
péra
ture
(de
gré
celc
ius)
moy maxmoy minmoy
Figure 7 : Variation des moyennes mensuelles de température enregistrées à Parakou de 1970 à
2000. Ces valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
- Humidité relative. L’humidité moyenne mensuelle de l’air enregistrée au niveau de la station de Parakou varie entre
54,06% en janvier et 95,87% et 96% respectivement pour les mois d’août et septembre pour les
maxima tandis que les minima varient entre 18,5% en janvier et février et 21,7% en décembre. On
constate que les maxima de l’humidité sont enregistrés pendant les mois les plus pluvieux de
l’année (juillet-août-septembre) tandis que les minima sont enregistrés pendant la période de
l’harmattan (décembre-janvier-février). L’humidité moyenne mensuelle de l’air varie de 36,34% en
janvier à 81,11% en août. L’humidité moyenne annuelle varie de 58,92 à 67,79% avec des maxima
pouvant atteindre 88,33 et des minima pouvant descendre jusqu’à 38,33%. Ces différentes
variations mensuelle et annuelle sont illustrées par les figures 8 et 9 suivantes :
21
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00120.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mois
Hum
idité
rela
tive
moy maxmoy minmoy
Figure 8 : Variation des moyennes mensuelles de l’humidité relative de l’air enregistrées à Parakou
de 1970 à 2000. Ces valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00
1 5 9 13 17 21 25 29
Années (1970-2000)
Hum
idité
rela
tive
moy maxmoy minmoy
Figure 9 : Variation des moyennes annuelles de l’humidité relative de l’air enregistrée à Parakou de
1970 à 2000. Ces valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
- Evapotranspiration potentielle (ETP). La moyenne interannuelle de ce paramètre est de 1560,7 mm à Nikki (9°55’N) et varie de 3,9 mm/j
en période humide à 4,1 mm/j en saison sèche avec un fort déficit des précipitations sur l’ETP de
novembre à février (SINSIN, 1993).
22
- Insolation. La durée moyenne annuelle de l’insolation au cours des trente dernières années (1970-2000) est
d’environ 2476 heures à Parakou. La moyenne mensuelle varie de 190,09 heures en juin à 254,56
heures en janvier pour la même période. La durée journalière moyenne est d’environ 8 heures de
novembre à février et de 4 ou 5 heures de juillet à septembre (ASECNA, 2002). Les figures 10 et 11
montrent les variations mensuelle et annuelle de l’insolation enregistrées au niveau de la station de
Parakou.
0
100
200
300
Janv
ier
Fevrie
rMars Avri
lMai
Juin
Juille
tAou
tSep
tOct Nov Dec
Mois Inso
latio
n (h
eure
s)
Figure 10 : Evolution de l’insolation moyenne mensuelle enregistrée à Parakou de 1970 à 2000. Ces
valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
0
1000
2000
3000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
Années (1970-1998)
Inso
latio
n (h
eure
s)
Figure 11 : Evolution de l’insolation moyenne annuelle enregistrée à Parakou de 1970 à 1998. Ces
valeurs sont climatiquement représentatives de la région de Nikki.
23
- Saisons. Ce sont les précipitations qui déterminent les saisons. Dans cette zone, l’année est caractérisée par
l’alternance de deux saisons bien tranchées :
Une saison sèche d’octobre-novembre à mars-avril. Cette saison, très fraîche en décembre-janvier,
est très chaude à partir de mars-avril avec un minimun en avril où sous abri il fait en moyenne 38°C.
Une saison pluvieuse ou ‘’hivernage’’de mars-avril à octobre-novembre. Les mois les plus pluvieux
sont les mois de juillet, août et septembre avec un pic de 228 mm au dernier mois (septembre).
- Précipitations La pluviométrie moyenne annuelle enregistrée à Nikki (entre 1970 et 1997) est de 976,22 mm tandis
que la moyenne mensuelle varie de 0,36 mm en janvier (mois le plus sec) à 227,8 mm en septembre
correspondant au mois le plus arrosé dans le milieu d’étude au cours de ces dernières années
(ASECNA, 2002).
Les figures 12 et 13 montrent respectivement l’évolution mensuelle et annuelle des précipitations
au cours de ces trente dernières années (de 1970 à 2000).
0
50
100
150
200
250
Janvie
r
Fevrier
Mars Avril Mai Juin
Juillet Aou
tSep
tOct Nov Dec Mois
Hau
teur
s de
plu
ie (m
m)
Figure 12 : Variation des moyennes mensuelles de hauteurs de pluie enregistrées à Nikki de 1970 à
2000
24
0
500
1000
1500
1 4 7 10 13 16 19 22 25
Années (1970-1997)
Hau
teur
des
plu
ies
(mm
)
Figure 13 : Variation des hauteurs annuelles de pluie enregistrées à Nikki de 1970 à 1997
- Vents Dans la région de Nikki, deux types de vents dominants se succèdent au cours de l’année :
L’alizé maritime qui souffle d’avril à novembre en direction Sud-Ouest. Sa vitesse moyenne passe
de 3 m/s en Avril à 2 m/s pendant la période mai-octobre. Sa vitesse maximale oscille autour de 23
m/s et 30 m/s suivant les mois (SINSIN, 1993).
L’harmattan, vent sec et froid, très desséchant souffle du Nord-Est sur toute la partie septentrionale
du pays de novembre à mars. Sa vitesse moyenne n’excède pas 2 m/s avec un maximum de 12 à 14
m/s. (SINSIN, 1993).
2-1-2-4- Sols Différents types de sols sont observés dans la zone d’étude :
- des sols minéraux bruts de profil (A)C ou C qui sont des sols non climatiques d’érosion sur roches
dures.
- des sols peu évolués d’origine non climatique d’érosion lithique ou d’apports hydromorphes bien
pourvus à haut potentiel de fertilités, qui ne sont que difficilement utilisables à cause de leur
situation dans des secteurs insalubres et d’accès difficile aux agriculteurs.
- des sols ferrugineux tropicaux qui sont les plus rencontrés. Ce sont des sols à profil ABC ou
A(B)C, riches en sesquioxydes individualisés et marqués par une coloration jaune, brune ou rouge
des horizons B ou (B) à l’opposition de la coloration claire des horizons A peu humifères et les
teintes ternes ou tachetées des horizons C. On y rencontre des sols peu lessivés de type modal, des
sols lessivés de type à concrétions et des sols pauvres de types modal et à concrétions.
26
Les sols lessivés de type à concrétions et les sols appauvris de type modal occupent les 90% du
territoire de notre zone d’étude (Nikki-est).
- des sols ferrallitiques très peu représentés, mais très profonds au profil A(B)C, colorés, aux limites
d’horizons peu tranchées. On y note la présence de minéraux kaoliniques, sesquioxydes métalliques,
alumines, et avec un complexe échangeable réduit.
- des sols hydromorphes de faible extension, mais très fertiles. Ce sont des sols peu humifères, à
gley de profondeur, caractérisés par un engorgement prolongé, dû à un mauvais drainage externe
(OLOULOTAN, 1988 ; CENAP et ORSTOM, 1975-1976).
2-1-2-5 - Formations végétales. La région d’étude est couverte par un ensemble de formations végétales qui varient des forêts
claires aux savanes arbustives. On y rencontre par endroits des forêts galeries et des plages
complètement nues. La plupart de ces formations, présentent une identité spécifique et seule la
hauteur et le couvert des arbres permettent de les catégoriser (OLOULOTAN, 1988).
On distingue :
- Forêt claire et savane boisée. Ce sont des formations qui sont peuplées par : Anogeissus leiocarpus, Vitellaria paradoxa,
Daniellia oliveri, Isoberlinia doka.
On y dénombre également mais en faible densité des espèces comme Khaya senegalensis et Afzelia
africana.
La forêt claire couvre généralement de faible superficie et s’observe surtout au nord de Kalalé (forêt
classée des Trois Rivières) et de façon éparse dans les régions de Nikki.
Quant à la savane boisée, sa composition floristique est principalement influencée par des facteurs
édaphiques et anthropiques.
- Savane arborée et savane arbustive Ce sont des formations très ouvertes qui dérivent de la précédente et qui occupent la grande partie
de la zone d’étude. On y distingue une strate arbustive très dense et un tapis graminéen continu.
Elles sont dominées par Vitellaria paradoxa, Lannea acida, Isoberlinia doka, Terminalia spp,
Combretum spp et Hymenocardia acida.
On remarque également la forte présence d’arbustes épineux tels que: Dichrostachys glomerata,
Acacia senegal, A. seyal, A. flava, A. gourmaensis ainsi que Strychnos spinosa. Un peu partout, on
27
note la présence de grands arbres comme Khaya senegalensis, Daniellia oliveri et Afzelia africana.
A partir de 10°20 N dans la partie Nord de Kalalé, Monotes kerstingii apparaît.
- Savane arborée et savane arbustive à forte emprise agricole Ces formations dérivent des précédentes et concernent les cultures vivrières permanentes et les
cultures industrielles (ex: coton) qui sont établies dans les savanes. Ces parcelles peuvent être plus
ou moins étendues ou disséminées mais séparées les unes des autres par des formations arborées
non défrichées ou par des jachères. Ces cultures et jachères sont parsemées d’arbres comme Parkia
biglobosa et Vitellaria paradoxa laissés sur place par les agriculteurs.
On observe ces formations surtout autour des agglomérations importantes comme Nikki et Kalalé.
- Savane arborée et savane arbustive saxicoles On les distingue surtout sur les plateaux à cuirasse marqués par la présence de gravillons roux, les
affleurements rocheux, les inselbergs et les petites chaînes granitiques.
Les essences qui caractérisent cette formation sont: Burkea africana et Detarium microcarpum dans
un cortège floristique où abondent Combretum spp, Monotes kerstingii, Parinari spp, Terminalia
spp, Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus. Nous les distinguons aussi bien sur les replats de
collines que sur les plateaux à Lophira lanceolata.
Dans ces formations saxicoles, les arbres sont peu développés, les arbustes sont assez nombreux et
la couverture graminéenne est discontinue bien que sujette aux feux de brousse.
- Galeries forestières Ce sont des peuplements forestiers qui s’étendent sur des largeurs variables le long des cours d’eau.
Les essences qui dominent ces formations sont: Berlinia grandiflora, Pterocarpus santalinoides,
Diospyros mespiliformis, Ficus spp, Khaya senegalensis, Afzelia africana, Vitex doniana On y
observe par ailleurs des espèces comme Elaeis guineensis et Oxytenanthera abyssinica et
Anogeissus leiocarpus, Bombax costatum en bordure.de la galerie.
- Zones périodiquement inondées Ce sont des formations végétales qui, par leur situation topographique (bas-fonds, dépressions le
long des cours d’eau) sont inondées une partie de l’année. Elles s’observent le long de nombreuses
rivières mais s’étendent sur des superficies relativement faibles. On y distingue le plus souvent
Pseudocedrala kostchyi, Terminalia macroptera et Mitragyna inermis.
28
- Plages dénudées Ce sont souvent des sols fortement induirés observés à partir du parallèle 10°30. Ils portent pour
végétation, quelques pieds de Gardenia erubescens ou de Securidaca longepedunculata. Les
superficies occupées par ces surfaces sans végétation sont relativement réduites.
2-2- Caractéristiques humaines et socio-économiques 2-2-1- Subdivisions administratives et ressources humaines Couvrant une superficie de 4100 km², la commune de Nikki compte une commune urbaine et six
arrondissements (Biro, Gnonkourakali, Ouénou, Sérékalé, Suya et Tasso) subdivisés en cinquante
villages et quartiers de ville (PADEL, 1998).
Elle compte 99.067 habitants dont 49.240 femmes. En 10 ans, cette commune a connu un
accroissement de 4,12 et une masculinité de 101,2 (RGPH 3, 2002). Sa densité moyenne est de
31,24 hbts / km². C’est une région relativement dense.
Les groupes socio-culturels dominants sont les Baribas (et apparentés), et les Fulbés (et apparentés)
en proportions inégales.
Groupe socio-culturel majoritaire, les Baribas sont un peuple sédentaire pratiquant essentiellement
l’agriculture.
Les Fulbés, principaux utilisateurs des retenues d’hydraulique pastorale sont des éleveurs-pasteurs
pratiquant un élevage extensif transhumant. Mais compte tenu de la multiplication des points
d’abreuvement permanents (construction de nombreuses retenues d’eau) et des sanglants conflits
avec les agriculteurs qu’entraîne parfois la transhumance, on assiste de plus en plus à la
sédentarisation de ce groupe socio-culturel. Vivant dans des campements composés de plusieurs
ménages ayant à leur tête le ‘’Jon Wuro’’ ou chef de famille, les Fulbés vivent dans une société
hiérarchisée et considèrent leurs troupeaux comme une marque de prestige social (OHOUKO,
1986). Cela justifie d’ailleurs le faible taux d’exploitation des troupeaux bovins qu’on observe.
Mais aujourd’hui, force est de constater que ces valeurs socio-culturelles sont en plein changement
surtout parmi les jeunes qui manifestent des besoins nouveaux. Cela se traduit par la
commercialisation plus fréquente du bétail et l’expansion de la pratique de l’agriculture surtout la
culture du coton afin d’accroître les revenus monétaires nécessaires à l’acquisition des biens de
consommation.
29
Comme dans la plupart des régions du pays, la population de cette commune est rurale à 57%
(PADEL, 1998). Les actifs agricoles impliqués dans les diverses activités de production étaient
estimés en 1992, à 56.067 personnes dont 28.262 hommes et 27.805 femmes (RGPH 2, 1992).
2-2-2- Potentialités socio-économiques Les ressources économiques de cette région proviennent essentiellement de l’agriculture et de
l’élevage mais c’est l’agriculture qui concentre la plus grande partie des potentialités des ressources
parce qu’elle constitue non seulement le principal domaine d’activités mais également le secteur qui
active la croissance de l’économie (PADEL, 1998).
2-2-2-1- L’agriculture D’après les statistiques de 1992/1993 à 1996/1997, les principales productions végétales de la
commune de Nikki concernent par ordre d’importance, l’igname (87.534 tonnes), le coton (14376
tonnes), le maïs <<local>> (8.085 tonnes), le sorgho (6.948 tonnes) et le manioc (6.198 tonnes).
Remarquons que la production cotonnière entre 1992/1993 et 1996/1997 a connu un accroissement
de plus de 158%, alors que l’accroissement de la production d’igname n’est que de 36% et celui du
maïs de 66%. A titre indicatif, en 1997, la valeur brute de la production végétale seule à Nikki était
estimée à plus de 12 milliards de FCFA/an pour un disponible commercialisable (revenu net
agricole) évalué à plus de 6 milliards de FCFA (PADEL, 1998).
2-2-2-2- L’élevage Bien que la commune dispose de cours d’eau et de retenues aménagées et empoissonnées, sa
production halieutique est quasiment nulle.
Selon des estimations faites en 1997/1998 par le PADEL, la volaille constitue la principale
production animale de Nikki (94.725 têtes en 1997/1998). Le tableau 4 montre les effectifs du
cheptel de la commune de Nikki en 2001.
Tableau 4 : Effectifs du cheptel du Borgou et de Nikki en 2001
Espèces /
Secteurs Bovins Ovins Caprins Porcins Equins Assins Vollailles
Nikki 102480 12463 26702 823 65 43 97887
Total Borgou 811.428 137.066 140.471 9.198 347 61 529.917
Pourcentage 12,63 9,09 19,01 8,95 18,73 70,49 18,47
Source : Rapport annuel 2001 de la Direction de l’Elevage. (2002)
31
III- MATERIELS ET METHODE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES
III-1- MATERIELS DE COLLECTE DES DONNEES III-1-1- Données physiques
Repérage dans le milieu et cartographie Le document de base utilisé pour se repérer dans le milieu et pour la réalisation des cartes
d’occupation du sol a été une photo-interprétation autour des retenues d’eau de notre région d’étude
(Sakabansi, Fombaoui, Sansi, Ouroumon, Ouénou). Cette photo-interprétation a été réalisée à partir
des photographies aériennes de la Mission 1986 BEN. 41/250 à l’aide du papier film, des stabilos à
encre permanente et un stéréoscope à miroir. Une boussole de précision a servi à s’orienter et à
positionner les différents placeaux mis en place sur le terrain.
Installation des placeaux Il a été utilisé :
- un clinomètre SUUNTO pour prendre les mesures des pentes,
- un mètre ruban de 50 m pour mesurer le périmètre des placeaux,
- une boussole SUUNTO pour vérifier l’orthogonalité des angles aux sommets
des placeaux,
- deux rouleaux de fil nylon bleu long chacun d’au moins 100 m pour délimiter
les placeaux à mettre en place.
Mesures dendrométriques Les circonférences des troncs des ligneux dans chaque placeau ont été mesurées avec un ruban de
50 m.
Constitution de l’herbier Le matériel utilisé pour la constitution de l’herbier se présente comme suit :
- des papiers journaux,
- des cartons rectangles,
- deux planchettes en bois munies de ceinturon pour servir de pressoir,
- une paire de ciseaux,
- un coupe-coupe,
- des sachets en plastique pour le transport des échantillons prélevés.
32
Observation directe Certaines informations d’ordre physique ont été également collectées grâce à un appareil
photographique (impacts sur le sol, utilisations faites des retenues d’eau, etc.).
III-1-2- Données socio-économiques
Outils de collecte des données Les données socio-économiques ont été collectées à l’aide de questionnaires élaborés à l’intention
des différents groupes socioculturels et socioprofessionnels qu’on rencontre dans les localités cibles.
Pour minimiser les pertes d’information, un enregistreur a été utilisé lors des discussions. Un
appareil photographique a enfin été utilisé pour prendre les images des différentes utilisations faites
des retenues d’eau par les populations.
III-2- METHODE DE COLLECTE DE DONNEES III-2-1- Données physiques
Choix des sites d’étude Les phytocénoses avoisinant les retenues d’eau étant les plus exposés aux impacts et aux pressions
des animaux venant s’abreuver, elles ont par avance été ciblées pour servir de sites de placeaux.
Ainsi, les placeaux ont été prioritairement installés dans les galeries forestières définies comme des
formations forestières fermées qu’on rencontre sur les rives d’un cours d’eau dans la savane
(PNUD/FAO, 1979). En dehors des galeries forestières, les formations végétales situées dans un
périmètre de 500 m environ autour des retenues d’eau ont également servi de sites de placeaux.
Trois critères principaux ont été pris en compte pour la mise en place des placeaux :
- uniformité physionomique des formations végétales ou phytocénoses (jachères, savanes
arbustive, arborée ou boisée, forêts galeries) ;
- homogénéité floristique au niveau de chaque site de placeaux ;
- homogénéité topographique et pédologique au niveau de chaque site de placeaux.
Relevés phytosociologiques L’étude de la végétation d’une région implique l’adoption d’une méthode d’investigations dont il
est indispensable de préciser les principes et la technique. Toutes les méthodes sont valables à
condition que le but recherché soit clairement indiqué et que l’élément de subjectivité ne soit pas
prépondérant. (TROUPIN, 1966 ).
33
Les relevés phytosociologiques ont été effectués suivant la méthode stigmatiste de Braun-Blanquet
(1932). En effet, cette méthode Zuricho-montpellierraine a déjà été appliquée avec succès par de
nombreux auteurs (Braun-Blanquet et Pavillard, 1935; Adjanohoun, 1962; Troupin, 1966; Sinsin,
1993; Sokpon, 1995; Ganglo, 1999) dans l’étude de la végétation intertropicale, notamment ouest-
africaine.
Lors de chaque relevé, différents paramètres floristiques et stationnels ont été notés. Ce sont d’une
part le type de formation végétale, la stratification de la végétation, le recouvrement du sol,
l’espèce, les coefficients d’abondance-dominance, la circonférence des troncs des ligneux ayant au
moins 25 cm de circonférence (mesure effectuée à 1,30 m du sol), et la situation topographique, le
type de sol, la pente et la position du placeau par rapport à la digue du barrage d’autre part. Dans
chaque groupement végétal, l’inventaire des espèces a été fait dans un faciès floristique jugé
suffisamment homogène.
Les coefficients d’abondance-dominance affectés aux espèces lors des relevés phytosociologiques
sont :
5 : espèces couvrant plus de 75 % de la surface du relevé (RM=87,5 %),
4 : espèces couvrant 50 à 75 % de la surface du relevé (RM=62,5 %),
3 : espèces couvrant 25 à 50 % de la surface du relevé (RM=37,5 %),
2 : espèces couvrant 5 à 25 % de la surface du relevé (RM=15 %),
1 : espèces couvrant 1 à 5 % de la surface du relevé (RM=3 %),
+ : espèces présentes et couvrant moins de 1 % de la surface du relevé (RM=0,5 %),
- : espèces absentes dans le relevé.
Les recouvrements moyens (RM) correspondent à chaque classe d’abondance-dominance.
Détermination des plantes Lors de nos relevés, les plantes rencontrées ont été déterminées grâce à l’appui de notre guide de
terrain d’origine Gando et qui a une très bonne connaissance des noms des espèces végétales.
Les noms locaux (peulh) des espèces identifiées au niveau de chaque placeau ont été notés et des
herbiers constitués après récolte des échantillons.
Aire et nombre des relevés Les relevés ont été effectués dans des placeaux de 50 m x 20 m soit sur une surface de 1000 m². Le
tableau 5 montre le nombre de relevés effectués par site et par phytocénose identifiée.
34
Tableau 5: Répartition des relevés par site et par phytocénose
Sites Forêt galerie Forêt galerie en
reconstitution
Savane
boisée
Jachère Total
relevés/sites
Ouénou 3 0 0 0 3
Ouroumon 4 0 0 1 5
Sansi 2 3 0 0 5
Fombaoui 1 1 1 0 3
Sakabansi 4 1 0 0 5
Total relevés/
phytocénose
14 5 1
1 21
Période d’exécution des relevés La plupart des relevés ont été effectués dans le mois de septembre correspondant au mois le plus
pluvieux de l’année dans la zone d’étude.
Les types biologiques ( TB) Pour Boullard (1988) cité par Oumorou (1998), les types biologiques désignent les diverses
silhouettes végétales reconnues jadis par Raunkiaer (1938) mettant en parallèle, l’aspect de chaque
plante à la belle saison et durant la mauvaise saison.
Les types biologiques utilisés dans les tableaux phytosociologiques sont ceux définis par Raunkiaer
(1938) in Boudet (1984) et cité par Oumorou (1998). Il s’agit :
- Des thérophytes (Th) : Ce sont des plantes qui accomplissent leur cycle de développement
pendant la belle saison et passent la mauvaise saison uniquement sous forme de graine
(Ozenda, 1982)
- Des hémicryptophytes (Hé) : Ce sont des plantes qui ne persistent que par des parties situées
au ras du sol (Ozenda, 1982) ; leur appareil végétatif se dessèche complètement pendant la
mauvaise saison et les bourgeons persistants se développent au niveau du collet
(Habiyaremye, 1997).
- Des géophytes (Gé) : Ce sont des plantes qui en mauvaise saison de végétation ne subsistent
que par des parties souterraines (bulbe, rhizome ou tubercule). (Ozenda, 1982)
- Des chaméphytes (Ch) : Ce sont des plantes dont les parties aériennes sont persistantes en
mauvaise saison de végétation, à une hauteur généralement inférieure à 40 cm (Ganglo,
1999)
35
- Des phanérophytes (Ph) : Ce sont des plantes dont l’appareil caulinaire porte à plus de 40 cm
du sol des bourgeons persistants (Ganglo, 1999).
Les hémicryptophytes et les géophytes sont respectivement subdivisés en hémicryptophytes
rhizomateux (Hér) et hémicryptophytes bulbeux (Héb) et en géophytes bulbeux (Géb), géophytes
suffrutescents (Gés), géophytes rhizomateux (Gér) et géophytes tuberculeux (Gét). En fonction de la
forme ou de la hauteur de leur port, on distingue parmi les chaméphytes, des chaméphytes dressés
(Chd) et des chaméphytes prostrés (Chp). Parmi les phanérophytes, on distingue les
mégaphanérophytes (MPh) (hauteur > 30 m), les mésophanérophytes (mPh) (10 – 30 m), les
microphanérophytes (mph) (2 – 10 m), les nanophanérophytes (nph) (0,4 – 2 m) et enfin les
phanérophytes ligneux grimpants (Phgr) (Schnell, 1971).
Les types phytogéographiques (TP) Les types phytogéographiques désignent les diverses aires de distribution géographique des espèces
végétales. Les types phytogéographiques ont été établis en accord avec les subdivisions
chorologiques généralement admises pour l’Afrique (White, 1986) et appliquées avec succès par
Sinsin (1993) puis Oumorou (1998) dans notre zone d’étude. Les principaux types de distribution
(TP) retenus dans cette étude sont :
• Espèces à large distribution :
- Cos = espèces cosmopolites : elles sont répandues dans les pays tropicaux et non tropicaux ;
- Pan = espèces pantropicales : ce sont des espèces réparties dans toutes les régions
tropicales ;
- Pal = espèces paléotropicales : elles sont présentes en Afrique tropicale, en Asie tropicale, à
Madagascar et en Australie ;
- Aam = espèces afro-américaines : elles sont réparties en Afrique et en Amérique tropicale ;
• Espèces pluri-régionales africaines ou espèces à distribution continentale :
- SZ = Soudano-Zambéziennes : ce sont des plantes présentes à la fois dans les régions
Soudanienne et Zambézienne ;
- AT = espèces afro-tropicales : ce sont des espèces distribuées dans toute l’Afrique tropicale ;
- AM = espèces afro-malgaches : il s’agit des espèces distribuées en Afrique et à
Madagascar ;
- P-A = espèces pluri-régionales africaines : ce sont des espèces dont l’aire de distribution
s’étend à plusieurs régions florales africaines ;
36
- G = espèces Guinéo-Congolaises : ce sont des espèces Omni ou sub-omni guinéo-
congolaises ; elles sont largement distribuées dans la région Guinéenne (Mullenders, 1954)
et la région du bassin du Congo.
• Elément base Soudanien :
- S = espèces Soudaniennes : ce sont des espèces présentes dans la région soudanienne.
III-2-2- Données socio-économiques
- Echantillonnage de la population Afin de pouvoir faire le point de la situation socio-économique (approvisionnement en eau potable
et abreuvement des animaux) qui prévalait dans le milieu d’étude avant la construction des retenues,
nous avons ciblé les populations vivant dans les localités bien avant l’implantation des retenues
d’hydraulique pastorale. Plusieurs hypothèses et considérations ont guidé le choix des échantillons
de population.
Le ciblage s’est fait grâce aux renseignements et à l’aide des chefs de village, des agents
polyvalents de vulgarisation (APV), des agents de santé ou autres personnes ressources vivant dans
la localité avant la construction des retenues. C’est grâce à ce travail préalable que les échantillons
ont été choisis. Ayant connu les difficultés d’approvisionnement en eau qui prévalaient dans les
localités avant la construction des retenues, ces personnes ciblées sont pour la plupart encore en
activité et par conséquent mieux placées pour parler des avantages et inconvénients générés par la
construction des retenues d’eau dans leurs localités respectives.
La constitution des échantillons a aussi reposé sur d’autres critères comme l’appartenance
socioculturelle et la catégorie socioprofessionnelle. Ainsi, des échantillons ont également été
constitués parmi les femmes ménagères (autochtones et peulhes / gando), les agriculteurs / agro-
éleveurs (Bariba et Boo), et les éleveurs (Peulh et Gando) ont été enquêtés.
Techniques d’enquête Les informations et données socio-économiques ont été recueillies par la méthode des entretiens
semi-structurés reposant sur différents questionnaires suivant les groupes cibles concernés. Pour
éviter les pertes d’information, nous avons enregistré les discussions.
Nombre d’enquêtés Les caractéristiques des personnes enquêtées sont résumées dans le tableau 6 suivant :
37
Tableau 6: Tableau de synthèse du nombre d’enquêtés par groupe socio-professionnel
Technique
d’enquête
Groupes cibles Nombre enquêté
par localité
Total enquêté dans
milieu d’étude
Entretien
individuel
approfondi
Agriculteurs / agro-
éleveurs
05 25
Eleveurs 05 25
Femmes ménagères
autochtones
05 25
Femmes ménagères
Peulh / Gando
05 25
Agents vétérinaires 1 à Sakabansi et 1 à
Nikki
2
Agents de santé 1 à Sakabansi et 1 à
Fombaoui
2
T.S. pêche Nikki 1 1
Agent PADEB Nikki 1 1
Source : Enquête réalisée par nous-même.
L’interview ou l’entretien individuel approfondi a été appliqué à un échantillon représentatif de 5
personnes par groupe socioculturel (agriculteurs ou agro-éleveurs, éleveurs, femmes ménagères). En
raison de leur réticence à s’exprimer ouvertement, l’entretien avec les femmes ménagères de ce
dernier groupe socioculturel a parfois pris l’allure d’un focus group de trois à quatre personnes.
Au total, 106 personnes ont été enquêtées dans toute la région d’étude à raison de vingt (20)
personnes en moyenne par localité.
Administration des questionnaires L’administration des questionnaires a été faite par nous même en bariba pour les populations
autochtones, en peulh pour les populations peulhes et gando et en français pour les agents de santé,
les vétérinaires et autres spécialistes enquêtés.
Temps et lieu des entretiens Sauf les éleveurs et les femmes peulhes que nous avons rencontrés dans leurs campements
respectifs, les autres catégories socio- professionnelles ont été enquêtées dans les centres des
villages ou agglomérations principales. Les éleveurs sont rencontrés généralement les matins (après
38
10 h) après qu’ils aient fini de traire les vaches et les agriculteurs dans l’après – midi (à partir de 14
h ou 15 h). Quant aux femmes ménagères, elles ont été rencontrées dans leurs domiciles respectifs
entre les deux principaux repas que sont le déjeuner et le dîner (généralement entre 13 h et 17 h). La
durée moyenne des entretiens était d’environ vingt (20) minutes pour les interviews et trente à trente
cinq (35) minutes pour les focus.
III-3- TRAITEMENT DES DONNEES COLLECTEES III-3-1- Données physiques
Elaboration des cartes d’occupation du sol Compte tenu du fait que toutes les retenues étudiées sont situées dans la région Est de la commune
de Nikki, la photo-interprétation et les cartes d’occupation du sol réalisées ont été limitées à cette
région pour une meilleure lecture des informations. L’élaboration des cartes d’occupation du sol a été faite en quatre grandes étapes :
- Géoréférencement de la carte topographique de notre zone d’étude (tracé du fond
topographique et ajustement des échelles).
- Interprétation des photographies aériennes de la zone d’étude.
- Numérisation.
- Edition de la carte.
Identification des espèces. L’identification des espèces s’est faite en trois grandes étapes.
Dans un premier temps, tous les ligneux de la strate arborescente (arborée et arbustive) ayant au
moins 25 cm de circonférence ont été identifiés en langue Fulfuldè au niveau de chaque placeau par
un guide fulbé rencontré dans la localité de Fombaoui et herborisés.
Dans un deuxième temps, les herbiers ont été présentés au responsable volet pastoralisme et
phytosociologie du PADEB (lui-même Fulbé) pour confirmation des noms locaux et scientifiques.
Enfin, quelques espèces n’ayant pas pu être identifiées ont été acheminées au Laboratoire
d’Ecologie Appliquée de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi.
Individualisation des groupements L’ensemble des 21 relevés phytosociologiques a été soumis à l’analyse factorielle des
correspondances (AFC présence-absence) et à la classification hiérarchique ascendante à l’aide du
logiciel STATISTICA. Les regroupements des relevés obtenus à partir du dendrogramme ont
permis d’individualiser les groupements végétaux.
39
Identification des groupements L’identification des groupements s’est faite à partir des valeurs de fréquence et recouvrement
moyen calculées pour chaque espèce rencontrée dans un groupement donné. Le nom du groupement
est donné en combinant le nom de l’espèce commune la plus dominante et la plus abondante du
groupement à celui de l’espèce caractéristique du milieu la plus dominante et la plus abondante.
Spectres biologiques et phytogéographiques Grâce aux types biologiques et phytogéographiques notées lors de nos différents relevés et aux
nombreux ouvrages consultés (SINSIN et al., 1987; OUMOROU, 1988; SINSIN et al., 1989;
SINSIN, 1993; SIDDIKOU, 1998; AKINDELE, 2000) pour confirmer ces notes, nous avons pu
réaliser les spectres biologiques et phytogéographiques (brut et pondéré) de chaque groupement
identifié. Le spectre biologique permet d’observer la répartition des espèces dans les différentes
formes de vie, le résultat étant proposé sous forme d’histogramme en pourcentage d’espèces. Le
spectre phytogéographique met en évidence la répartition des espèces selon leur aire de distribution.
Le spectre brut reflète la présence relative et le spectre pondéré prend en compte les coefficients de
recouvrement moyen des espèces.
Données dendrométriques Les mesures dendrométriques effectuées lors de chaque relevé ont permis de calculer les paramètres
suivants:
- La surface terrière du peuplement G
G =ΣΠd²/4
d = diamètre à 1,30 m (dbh) des individus
G = surface terrière en m²/ha
- Densité de peuplement D
C’est le nombre de tiges à l’hectare.
- La richesse spécifique Ni
Elle représente le nombre d’espèces sur une surface déterminée de la phytocénose considérée.
Diversité spécifique Pour avoir une idée de la diversité floristique des différentes formations rencontrées dans notre zone
d’étude, deux paramètres ont été calculés. Il s’agit de:
- L’indice de diversité de Shannon-Wiever (H’)
H’ = -Σpi log(pi) avec pi = ni / n
Pi = fréquence relative des individus du groupement
40
H’ = indice de diversité spécifique de Shannon en bit et varie de 0 à 5
L’indice de diversité de Shannon est utilisé en se basant sur l’hypothèse que la diversité est fonction
de l’abondance relative d’une espèce i dans un ensemble d’individus.
Un indice de diversité de Shannon élevé correspond à des conditions de milieu favorables à
l’installation de nombreuses espèces ; c’est le signe d’une grande stabilité du milieu (DAJOZ,
1985).
- Le coefficient d’équitabilité de Pielou (E) (1966) Cet indice traduit le degré de diversité spécifique atteint par rapport au maximum possible.
E = H’/Log2 (S)
H’ = indice de Shannon
S = le nombre d’espèces. C’est la valeur théorique de la diversité maximale pouvant être atteinte
dans chaque groupement; elle correspond à un état de répartition égale de tous les individus entre
toutes les espèces du groupement.
Ce coefficient varie de 0 à 1.
E = 0, équivaut à la dominance/abondance d’une seule espèce dans la phytocénose. E = 1, révèle que les espèces sont toutes équitablement réparties.
E élevé (proche de 1), est le signe d’un peuplement équilibré (DAJOZ, 1985).
- Indice de similitude de Jacquard (Ij) Cet indice exprimé en pourcentage traduit le degré d’homogénéité entre deux relevés. Il varie de 0 à
100%.
Ij = C/(A+B)-C
C= Espèces communes aux deux relevés.
A= Espèces exclusives du premier relevé
B= Espèces exclusives du second relevé
Un indice de Jacquard supérieur ou égal à 50% exprime une bonne homogénéité des relevés
constituant un groupement.
III-3-2- Données socio-économiques Deux principales variables ont été prises en compte dans le traitement des données socio-
économiques. Il s’agit d’une part, des groupes socioprofessionnel (agriculteurs, éleveurs,
ménagères…) et socioculturel (Bariba/Boo et Peulh/Gando) et d’autre part, de la fréquence de
répétition d’un événement (différentes maladies rencontrées dans la zone) dans chaque groupe. On
considère que plus un événement est cité et plus il est important en termes d’étendue et de gravité
41
dans la zone d’étude. Statistiquement, l’individu ici est l’évènement cité et l’effectif est la somme
des évènements.
En dehors de ces traitements statistiques faits sur les données brutes issues du dépouillement des
questionnaires, nous avons aussi procédé à la confirmation ou à l’infirmation de certaines
informations en les soumettant à l’appréciation des spécialistes (infirmiers diplômés d’Etat,
Docteurs vétérinaires, responsable Génie Rural) et en les comparant à la littérature existante.
43
IV- RESULTATS DE L’ETUDE IV-1-DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL DE LA REGION DE NIKKI-EST La plupart des retenues étudiées étant situées dans la région Est de la commune de Nikki, nous
avons donc choisi de limiter l’étude de la dynamique de l’occupation du sol à cette région.
Six types de formations végétales sont observés dans cette région. Il s’agit de galeries forestières, de
forêts denses sèches ou forêts semi-décidues, de forêts claires ou savanes boisées, de savanes
arborées ou arbustives, de savanes à emprise agricole et de savanes saxicoles. Le tableau 7 résume
les superficies occupées par chaque type d’occupation du sol dans la région de Nikki-Est en 1986 et
en 1998.
Tableau 7: Dynamique de l’occupation du sol de la région de Nikki-Est entre 1986 et 1998
Types d’occupation du sol
1986 1998 Bilan
Ha % Ha %
Galerie forestière 5.665 4,9 5.515 4,7 régression
Forêt semi-décidue 1.656 1,4 1368 1,2 régression
Forêt claire ou savane boisée 30.584 26,3 24.727 21,2 régression
Savane arborée ou arbustive 46.291 39,8 31.385 27,0 régression
Savane saxicole 41 0,04 41 0,04 stabilité
Savane à emprise agricole 31.879 27,4 52,478 45,1 progression
Agglomérations 288 0,25 890 0,8 progression
Total 116.404 100,0 116.404 100,0 L’analyse de ce tableau révèle la dominance de trois types de formation dans le paysage de Nikki-
Est en 1986. Il s’agit par ordre d’importance de la superficie, de la savane arborée ou arbustive, de
la savane à emprise agricole et de la forêt claire ou savane boisée qui couvrent respectivement
39,77%, 27,39% et 26,27% de la superficie de Nikki-Est. La figure 15 montre l’occupation du sol
de la région de Nikki-Est en 1986.
En 1998, une formation domine prioritairement le paysage. Il s’agit de la savane à emprise agricole
qui occupe 45,08% de la superficie de la région. Viennent ensuite la savane arborée ou arbustive et
la forêt claire ou savane boisée qui occupent respectivement 26,96% et 21,24% de la superficie de la
région. La figure 16 montre l’occupation du sol de la même région en 1998.
46
On remarque au total une régression de la plupart des formations sauf pour la savane saxicole qui
montre une relative stabilité et la savane à emprise agricole qui a progressé de près de 20.599 ha aux
dépens principalement de la savane arborée ou arbustive.
On remarque aussi que la superficie occupée par les agglomérations a triplé et est passée de 288 ha
à 890 ha. Ces variations sont illustrées par la figure 17 qui montre la carte de synthèse de
l’occupation du sol de Nikki-Est (1986-1998).
La progression de la savane à emprise agricole s’expliquerait par la multiplication des espaces
cultivés consécutive à l’augmentation de la population d’une part et à la production cotonnière
d’autre part. Les savanes saxicoles étant par définition des formations qu’on rencontre surtout sur
des plateaux à cuirasse marqués par la présence de gravillons roux, des affleurements rocheux, les
inselbergs et les petites chaines granitiques, on explique leur relative stabilité par les énormes
difficultés que rencontrent les paysans pour labourer sur ces types de sol.
48
IV-2- CARACTERISATION PHYTOSOCIOLOGIQUE DES RETENUES D’HYDRAULIQUE PASTORALE
Les données floristiques recueillies dans les différentes formations végétales rencontrées aux abords
des retenues d’eau correspondent à une matrice brute de 21 relevés x 121 espèces. Les relevés
phytosociologiques effectués sont soumis à l'analyse factorielle des correspondances. La
classification hiérarchique ascendante résultant de la matrice brute analysée grâce au logiciel
Statistica présente sur le dendrogramme (figure 18), le découpage de grands ensembles de
formations individualisées :
Arbre de 21 VariablesMéth. de Ward
Dist. Euclidiennes
Sim
ilitud
e (%
)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
S
5P2
S
5P1
S
4P4
S
5P3
S
4P3
S
3P3
S
4P1
S
4P2
S
4P5
S
3P2
S
1P4
S
1P3
S
1P2
S
3P5
S
3P4
S
2P3
S
3P1
S
2P1
S
1P5
S
2P2
S
1P1
G1 G2
G1-1 G1-2G2-1 G2-2
Figure 18: Dendrogramme de la classification hiérarchique des relevés
IV-2-1- Analyse du dendrogramme L’analyse du dendrogramme montre la ségrégation de deux grands groupements G1 et G2 au seuil
de similitude de 100%. Aux seuils de similitude respectifs de 75% et 65%, le groupement G1 se
scinde en deux sous-groupements G1-1 et G1-2 et le groupement G2 en G2-1 et G2-2.
Le groupement G1 regroupe la totalité des relevés effectués à Ouénou et Ouroumon et deux relevés
de forêt galerie effectués à Sansi. Le groupement G2 regroupe la totalité des relevés effectués à
Sakabansi et Fombaoui et trois relevés de galerie en reconstitution effectués à Sansi.
Le tableau 8 montre les caractéristiques de chaque groupement et sous-groupement individualisés
par le dendrogramme.
49
Tableau 8: Caractéristiques des groupements individualisés dans les phytocénoses environnant les
retenues étudiées.
Groupe
ments
Nombre
de relevés
Codes des relevés Types de formations Types de sol ou
nature de sol
G1
10
S3P2-S3P3-S4P1-
S4P2-S4P3-S4P4-
S4P5-S5P1-S5P2-S5P3
Forêt galerie sauf le relevé
S4P4 fait dans une
ancienne jachère
Sol ferrugineux
tropical de type
modal
G1-1 02 S5P1-S5P2 Forêt galerie ± intacte Sol peu lessivé
G1-2 08 S3P2-S3P3-S4P1-
S4P2-S4P3-S4P4-
S4P5-S5P3
Forêt galerie sauf le relevé
S4P4
Sol peu lessivé
à lessivé
G2 11 S1P1-S1P2-S1P3-
S1P4-S1P5-S2P1-
S2P2-S2P3-S3P1-
S3P4-S3P5
6 relevés de forêt galerie, 4
de galerie en reconstitution
et 1 de savane boisée
Sol ferrugineux
tropical de type
concrétionné
G2-1 03 S1P2-S1P3-S1P4 Forêt galerie ± intacte Sol lessivé
G2-2 08 S1P1-S1P5-S2P1-
S2P2-S2P3-S3P1-
S3P4-S3P5
3 relevés de forêt galerie, 4
de galerie en reconstitution
et 1 de savane boisée
Sol lessivé
L’analyse du tableau 8 révèle que le groupement G1 (groupement sur sols ferrugineux tropicaux de
type modal ) regroupe les relevés de forêt galerie sur sol modal tandis que le groupement G2
(groupement sur sol ferrugineux tropical de type concrétionné) regroupe les relevés de forêt galerie
et de galerie en reconstitution sur sol concrétionné.
Le sous-groupement G1-1 (sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana) regroupe
les relevés de forêt galerie ± intacte sur sol peu lessivé de type modal et le sous-groupement G1-2
(sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis) regroupe les relevés de forêt
galerie sur sol peu lessivé à lessivé de type modal
Le sous-groupement G2-1 (sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha)
regroupe les relevés de forêt galerie plus ou moins intacte sur sol lessivé de type concrétionné et le
sous-groupement G2-2 (sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata)
50
regroupe les relevés de forêt galerie et de galerie en reconstitution sur sol lessivé de type
concrétionné.
IV-2-2- Caractérisation des groupements IV-2-2-1- Groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal
- Composition floristique Ce cortège floristique sur sol ferrugineux tropical de type modal compte 76 espèces végétales dont
la présence est révélée par 10 relevés phytosociologiques effectués à 90% dans des galeries
forestières. Le recouvrement moyen de la strate arborée est de 49% et celui de la strate arbustive est
de 27%. Chaque relevé compte en moyenne 24 espèces végétales dont les plus communes et les
plus dominantes sont Anogeissus leiocarpa, Securinega virosa, Terminalia avicennioides, Daniellia
oliveri et Allophyllus africanus. Les fréquence et recouvrement moyen de chaque espèce sont
représentés dans le tableau phytosociologique de ce groupement (tableau 9).
Tableau 9 : Tableau phytosociologique du groupement sur sol ferrugineux tropical de type modal Numéro de relevé 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 Type de formation Fg Fg Fg Fg Fg Ja Fg Fg Fg Fg Type de sol S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A H S-A H Pente (%) 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 Nombre d'espèces par relevé 31 23 31 32 21 20 18 33 25 20 Recouvrement de la strate arborée (%) 55 45 55 60 65 10 65 45 30 60 Nombre d'espèces dans la strate arborée 19 9 20 21 13 4 14 25 19 12 Recouvrement de la strate arbustive (%) 20 15 25 30 25 70 10 20 45 10 Nombre d'espèces dans la strate arbustive 17 14 18 15 12 17 6 13 10 9 TB TP ESPECES 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 FR RM mph Pal Securinega virosa 2 2 + 2 2 1 3 1 2 1 1 12,2 mPh S Terminalia avicennioides + 1 + + 1 3 + 3 2 2 1 11,3 Mph SZ Daniellia oliveri 2 1 2 2 2 + 2 2 1 1 1 9,95 Mph S Vitellaria paradoxa 2 + 2 + 1 1 + 1 2 2 1 7,05 Mph SZ Anogeissus leiocarpus 3 2 4 4 4 + 4 - + + 0,9 30,4 Mph Pal Diospyros mespiliformis 1 + 2 2 2 - 2 - + 1 0,8 6,7 mPh AT Allophyllus africanus - 2 2 + + - - 1 4 3 0,7 13,4 mph S Combretum ghosalense 1 + 1 2 - - + 1 + - 0,7 2,55 Mph SZ Pterocarpus erinaceus 1 1 1 1 - - 1 1 1 - 0,7 2,1 mPh S Detarium microcarpum 1 - + - + 1 + + + - 0,7 0,85 Mph S Khaya senegalensis - + + + + - + - + + 0,7 0,35 mph S Feretia apodanthera + 1 2 + + - - - + - 0,6 2 Mph S Prosopis africana - - 1 - + + + 1 + - 0,6 0,8 Mph S Pericopsis laxiflora + - + + - 1 + + - - 0,6 0,55 nph P-A Ziziphus mucronata - 3 + + + - - - - + 0,5 3,95 Mph AT Burkea africana - - - 2 1 1 + + - - 0,5 2,2 mph AT Piliostigma thonningii + - - 1 - 2 - + - + 0,5 1,95 Phgr AT Smilax kraussiana 1 - + - + - 2 + - - 0,5 1,95
51
Mph S Lannea acida + - 1 + - - + 1 - - 0,5 0,75 mph AT Hymenocardia acida + - - + - 2 - 2 - - 0,4 3,1 mPh AT Acacia sieberiana - + - + - - - 1 2 - 0,4 1,9 nph S Annona senegalensis 1 - - 2 - + - + - - 0,4 1,9 mPh AT Crossopteryx febrifuga + - + - - - + 2 - - 0,4 1,65 nph SZ Nauclea latifolia 2 - - + - - - + - + 0,4 1,65 mPh S Cussonia arborea + - - 1 - - - 1 1 - 0,4 0,95 mPh SZ Lannea kerstingii + - + - - - - 1 1 - 0,4 0,7 Ch AT Byrsocarpus coccineus - - 1 + + - - - + - 0,4 0,45 mph SZ Entada africana - 1 - + - + - + - - 0,4 0,45 mPh SZ Lannea microcarpa + - - + 1 - + - - - 0,4 0,45 mph AT Combretum collinum + - + + - - - - + - 0,4 0,2 mph S Combretum nigricans - + - - + + - - - + 0,4 0,2 nph Pan Dichrostachys cinerea + - + - + - - - - + 0,4 0,2 Mph AT Sterculia setigera - - 1 1 1 - - - - - 0,3 0,9 mph P-A Antidesma venosum - - + + - - - 1 - - 0,3 0,4 Mph Pal Parkia biglobosa - - + - + - - 1 - - 0,3 0,4 mph Pan Ficus capensis + - - - - + - - + - 0,3 0,15 nph SZ Gardenia aqualla + - + - - - - + - - 0,3 0,15 Mph AT Margaritaria discoidea - - - + - - - + - + 0,3 0,15 mph AT Combretum aculeatum - + - - - - - - - 3 0,2 3,8 mPh Pal Acacia senegal - 2 - - - - - - + - 0,2 1,55 Mph S Bombax costatum - - 1 - - - - - 1 - 0,2 0,6 mPh G Pteleopsis suberosa - 1 - - - 1 - - - - 0,2 0,6 mPh Zanha golungensis - - 1 1 - - - - - - 0,2 0,6 Mph AT Vitex doniana - - - - - - - - + 1 0,2 0,35 Gét S Dioscorea cf togoensis + + - - - - - - - - 0,2 0,1 mPh S Lophira lanceolata - - - + - + - - - - 0,2 0,1 Thgr Pan Mucuna pruriens - - - - - - - - + + 0,2 0,1 Ch AA Paullinia pinnata - + - - + - - - - - 0,2 0,1 mPh Pan Trichilia emetica - - - - - + - + - - 0,2 0,1 Mph SZ Holarrhena floribunda + - - - - - - - - + 0,2 0,1 Mph Pan Pterocarpus santalinoides - - - - - - - - - 4 0,1 6,25 mPh Crataeva religiosa 1 - - - - - - - - - 0,1 0,3 Mph Pan Tamarindus indica - 1 - - - - - - - - 0,1 0,3 Mph S Uapaca togoensis - - - - - - - 1 - - 0,1 0,3 Mph S Afzelia africana + - - - - - - - - - 0,1 0,05 Ch Pal Asparagus africanus - - - - - - - + - - 0,1 0,05 Mph SZ Borassus aethiopum - + - - - - - - - - 0,1 0,05 Ch S Bridelia scleroneura - - - - - - - + - - 0,1 0,05 mPh SZ Cassia sieberiana - + - - - - - - - - 0,1 0,05 Lph S Cissus populnea - - + - - - - - - - 0,1 0,05 mph AT Combretum molle + - - - - - - - - - 0,1 0,05 Gét S Dioscorea tomentosa + - - - - - - - - - 0,1 0,05 mPh S Erythrina senegalensis - - + - - - - - - - 0,1 0,05 nph SZ Grewia bicolor - - - - - - - - - + 0,1 0,05 mph - Leucaena leucocephala - - - - - - + - - - 0,1 0,05 Mph SZ Lonchocarpus laxiflorus - - - - - - - - + - 0,1 0,05 Phgr SZ Opilia amentacea - - - + - - - - - - 0,1 0,05 mPh SZ Parinari curatellifolia - - - - - - - + - - 0,1 0,05
52
Mph SZ Stereospermum kunthianum - - - - - + - - - - 0,1 0,05 mph SZ Strychnos innocua - - - - - - - + - - 0,1 0,05 mPh AT Swartzia madagascariensis - - - + - - - - - - 0,1 0,05 Légende :
Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Ja = Jachère arbustive
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
- Spectre des types biologiques Quatre grands types biologiques sont rencontrés dans ce groupement. Les plus dominants et les plus
abondants sont les phanérophytes (90,28% et 99,37%). Puis viennent dans l’ordre les chaméphytes
(5,56% et 0,45%), les géophytes (2,78 et 0,10%) et les thérophytes (1,39 et 0,07%). La figure 19
suivant montre le spectre biologique de ce groupement.
0,00
20,00
40,00
60,00
Ch Get Lph Mph mPh mph nph Phgr ThgrTypes biologiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 19: Spectre biologique du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal
- Spectre des types phytogéographiques Huit types phytogéographiques sont rencontrés dans ce paysage. Les plus dominants sont
respectivement les types soudanien (30,43%), soudano-zambézien (24,64%) et afro-tropical
(21,74%). Les mêmes types sont les plus abondants avec des spectres bruts respectifs de 21,53% ;
32,58% et 22,59%. La figure 20 illustre les spectres brut et pondéré de chaque type
phytogéographique rencontré dans le groupement.
53
0,005,00
10,0015,0020,0025,0030,0035,00
Aam AT G P-A Pal Pan S SZTypes phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 20: Spectre phytogéographique du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal
- Caractéristiques dendrométriques Dans ce groupement, la densité du peuplement ligneux est de 451tiges/ha avec une surface terrière
de 46,41m2/ha. La répartition par centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface
terrière est illustrée par les histogrammes de la figure 21.
Figure 21-a Figure 21-b
Figure 21 : Répartition du groupement sur sols ferrugineux tropicaux de type modal par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
L’analyse de la répartition de ce groupement par centre de classe de diamètre révèle une abondance
des individus dont le diamètre de tronc mesure entre 10 et 50 cm avec une légère dominance de
ceux dont le centre de classe de diamètre est 25 (94 tiges/ha). Le meilleur ajustement de la structure
est une fonction exponentielle décroissante des classes de diamètre inférieur vers les classes de
diamètre élevé et qui est traduite par une courbe de tendance dont l’équation est y = 1,24x² - 25,76x
+ 131,99. Le coefficient de corrélation (R²) de cette courbe de tendance donne 0,94.
L’analyse de la répartition du groupement par centre de classe de surface révèle une dominance des
individus dont le diamètre de tronc est compris entre 30 et 50 cm (7,73 m²/ha pour les individus de
la classe [30-40] et 7,70 m²/ha pour la classe [40-50]).
y = 1.2394x2 - 25.762x + 131.99R2 = 0.9409
-20
0
20
40
60
80
100
120
Centre de classe de diamètre (cm)
0
2
4
6
8
10
Centre de classe de diamètre (cm)
54
- Caractéristiques biologiques Le calcul des indices de diversité donne respectivement 1,64 bits pour l’indice de Shannon et 0,94
pour le coefficient d’équitabilité de Piélou.
Cet ensemble floristique est constitué de deux sous-groupements différenciés essentiellement selon
la nature de leur support (sol) et leur densité floristique. Il s’agit du sous-groupement à Allophyllus
africanus et Acacia sieberiana et du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis.
Les caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus sont résumées
dans le tableau 10 ci-dessous.
Tableau 10: Caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus dans les
phytocénoses environnant les retenues d’hydraulique pastorale de Ouénou et de Ouroumon.
Sites Sous-groupements D G Ni H’ E
Retenue d’hydraulique
pastorale de Ouénou
Sous-groupement à Allophyllus
africanus et Acacia sieberiana
450
32,76
46
1,64
0,99
Retenue d’hydraulique
pastorale de Ouroumon
Sous-groupement à Anogeissus
leiocarpa et Zanha golungensis
360
41,25
65
1,72
0,95
IV-2-2-1-1- Sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana
- Composition floristique Ce sous-groupement sur sol modal peu lessivé compte 46 espèces végétales réparties entre deux
relevés phytosociologiques (S5P1 et S5P2) réalisés dans des forêts galeries rencontrées en amont et
en aval de la retenue d’eau de Ouénou. La strate arborée est dominée par Allophyllus africanus, une
micro-phanérophyte qui caractérise le faciès du groupement (32,75% de recouvrement moyen et
100% de fréquence) tandis que la strate arbustive révèle une omniprésence et une dominance de
Terminalia avicennioides (26,25% de recouvrement moyen et 100% de fréquence). Cette formation
compte en moyenne 29 espèces végétales par placeau dont 22 dans la strate arborée et 12 dans la
strate arbustive avec des recouvrements moyens respectifs de 35,7% et 32,5%. Les espèces
communes les plus dominantes dans ce sous-groupement sont par ordre d’importance de
recouvrement Allophyllus africanus et Terminalia avicennioides. Ces espèces sont suivies de loin
par Acacia sieberiana, Daniellia oliveri, Securinega virosa et Vitellaria paradoxa. Les fréquence et
recouvrement moyen de chaque espèce sont présentés dans le tableau phytosociologique du sous-
groupement (Tableau 11).
55
Tableau 11 : Tableau phytosociologique du groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana
Numéro de relevé : 19 20 Type de formation : Fg Fg Type de sol : H S-A Pente (%) : 4 5 Nombre d'espèces par relevé : 33 25 Recouvrement de la strate arborée : 45 30 Nombre d'espèces dans la strate arborée : 25 19 Recouvrement de la strate arbustive : 20 45 Nombre d'espèces dans la strate arbustive : 13 10 TB TP ESPECES 19 20 Fr (%) RM (%) mPh AT Allophyllus africanus 1 4 100 32,75 mPh S Terminalia avicennioides 3 2 100 26,25 mPh AT Acacia sieberiana 1 2 100 9 Mph SZ Daniellia oliveri 2 1 100 9 mph Pal Securinega virosa 1 2 100 9 Mph S Vitellaria paradoxa 1 2 100 9 mPh S Cussonia arborea 1 1 100 3 mPh G Lannea kerstingii 1 1 100 3 Mph SZ Pterocarpus erinaceus 1 1 100 3 mph S Combretum ghosalense 1 + 100 1,75 Mph S Prosopis africana 1 + 100 1,75 mPh S Detarium microcarpum + + 100 0,5 mPh AT Crossopteryx febrifuga 2 - 50 7,5 mph AT Hymenocardia acida 2 - 50 7,5 mph P-A Antidesma venosum 1 - 50 1,5 Mph S Bombax costatum - 1 50 1,5 mPh S Lannea acida 1 - 50 1,5 Mph Pal Parkia biglobosa 1 - 50 1,5 Mph S Uapaca togoensis 1 - 50 1,5 mPh Pal Acacia senegal - + 50 0,25 nPh S Annona senegalensis + - 50 0,25 Mph SZ Anogeissus leiocarpus - + 50 0,25 Ch Pal Asparagus africanus + - 50 0,25 Ch S Bridelia scleroneura + - 50 0,25 Mph AT Burkea africana + - 50 0,25 Ch AT Byrsocarpus coccineus - + 50 0,25 mPh AT Combretum collinum - + 50 0,25 Mph Pal Diospyros mespiliformis - + 50 0,25 mph SZ Entada africana + - 50 0,25 mph S Feretia apodanthera - + 50 0,25 mph Pan Ficus capensis - + 50 0,25 nph SZ Gardenia aqualla + - 50 0,25 Mph S Khaya senegalensis - + 50 0,25 Mph SZ Lonchocarpus laxiflorus - + 50 0,25 Mph AT Margaritaria discoidea + - 50 0,25 Thgr Pan Mucuna pruriens - + 50 0,25
56
nph SZ Nauclea latifolia + - 50 0,25 mph SZ Parinari curatellifolia + - 50 0,25 Mph S Pericopsis laxiflora + - 50 0,25 mph AT Piliostigma thonningii + - 50 0,25 Phgr AT Smilax kraussiana + - 50 0,25 mph SZ Strychnos innocua + - 50 0,25 mPh Pan Trichilia emetica + - 50 0,25 Mph AT Vitex doniana - + 50 0,25
Légende :
Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Ja = Jachère arbustive
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
- Spectre des types biologiques Les 46 espèces végétales que compte cette formation sont réparties en trois grands types biologiques
dont les plus dominants et les abondants sont respectivement les phanérophytes (90,91% et 99,27%)
suivis de très loin par les chaméphytes (6,82% et 0,55%). Il faut noter que les phanérophytes
observées ici sont subdivisées en mégaphanérophytes, en mésophanérophytes, en
microphanérophytes, en nanophanérophytes et en phanérophytes grimpants. Les subdivisions les
plus abondantes sont respectivement les mésophanérophytes (61,61%), les mégaphanérophytes
(21,39%) et les microphanérophytes (15,54%) tandis que les plus dominantes sont dans l’ordre les
mégaphanérophytes (34,09%), les mésophanérophytes (25%) et les microphanérophytes (22,73%).
Les subdivisions les moins dominantes et les moins abondantes sont les nanophanérophytes (6,82%
et 0,55%) et les phanérophytes grimpants (2,27% et 0,18%).
Remarquons que les thérophytes identifiés dans cette formation sont les thérophytes grimpants
(2,27% de dominance et 0,18% d’abondance). La figure 22 illustre les proportions de chaque type
biologique dans le groupement.
57
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.00
Ch Mph mPh mph nph Phgr Thgr
Types biologiques
Effe
ctifs
/ RM
(%)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 22: Spectre des types biologiques du sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia
sieberiana
- Spectre des types phytogéographiques Des six types phytogéographiques rencontrés dans cette formation, trois sont dominants. Il s’agit
respectivement du type soudanien (31,82%), du type afro-tropical (25%) et du type soudano-
zambézien (22,73%). En considérant l’abondance des espèces, nous remarquons premièrement les
afro-tropicales(42,78%) suivies des espèces soudaniennes (35,10%) et enfin des espèces soudano-
zambéziennes (12,25%). Les espèces les moins abondantes sont les espèces pantropicales (0,55%)
et les moins dominantes sont les autres pluri-régionales africaines (2,27%). La figure 23 illustre les
proportions de chaque type phytogéographique dans ce groupement.
0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AT P-A Pal Pan S SZTypes phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 23 : Spectre des types phytogéographiques du sous-groupement à Allophyllus africanus et
Acacia sieberiana
58
- Caractéristiques dendrométriques Les mesures dendrométriques faites au sein de cette formation révèlent une densité des ligneux de
450 tiges/ha pour 32,76 m2/ha de surface terrière. Les répartitions par centre de classe de diamètre
et par centre de classe de surface terrière sont présentées dans les figures 24-a et 24-b.
Figure 24-a Figure 24-b
Figure 24 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acacia sieberiana par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
L’analyse des figures 17-a et 17-b révèle que ce groupement est essentiellement dominé par des
individus dont le tronc mesure entre 10 et 30 centimètres de diamètre. Le meilleur ajustement de la
structure est une fonction exponentielle décroissante des classes de diamètre inférieur vers les
classes de diamètre élevé et qui est traduite par une courbe de tendance dont l’équation est
y = 6,19x² - 81,07x + 263,21. Le coefficient de corrélation (R²) de cette courbe de tendance donne
0,88. Nous remarquons cependant que les individus les plus recouvrants sont ceux dont les troncs
mesurent respectivement 40 et 45 cm (9,85 m²/ha) puis 20 et 30 cm de diamètre (7,65 m²/ha).
- Caractéristiques biologiques Les indices de diversité calculés pour ce groupement donne respectivement 1,64 bits pour l’indice
de Shannon et 0,99 pour le coefficient d’équitabilité de Pielou (0,99).
IV-2-2-1-2- Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis
- Composition floristique Cette formation a une richesse spécifique de 65 espèces réparties entre huit relevés
phytosociologiques faits en grande majorité dans des forêts galeries (7 relevés) et dans une jachère
abandonnée (1 relevé). La strate arborée a un recouvrement moyen de 51,9% avec en moyenne 14
espèces par placeau et dont les plus dominantes et les plus abondantes sont Anogeissus leiocarpa
y = 6,1905x2 - 81,071x + 263,21R2 = 0,8792
-50
0
50
100
150
200
15 25 35 45 55 65 75 85
Centre de classe (cm)
Effe
ctifs
(Tig
es/h
a)
02468
1012
15 25 35 45 55 65 75 85
Centre de classe de diamètre (cm)Su
rface
terri
ère
(m²/h
a)
59
(37,94% de recouvrement moyen et 100% de fréquence) et Daniellia oliveri (11,19% de RM et
100% de fréquence). La strate arbustive a un recouvrement moyen de 25,6% pour une moyenne de
13 à 14 espèces par placeau et dont les plus dominantes et la plus abondantes sont Terminalia
avicennioides (7,56% pour le recouvrement moyen et 100% de fréquence) et Ziziphus mucronata
(4,94 et 62,5%). Les espèces les plus fréquentes sont par ordre Anogeissus leiocarpa et Vitellaria
paradoxa suivies de Khaya senegalensis mais la plus dominante est Anogeissus leiocarpa. Les
coefficients d’abondance-dominance des espèces de ce sous-groupement sont présentés dans le
tableau phytosociologique suivant (Tableau 12).
Tableau 12 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis Numéro de relevé : 10 11 14 15 16 17 18 21 Type de formation : Fg Fg Fg Fg Fg Ja Fg Fg Type de sol : S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A H Pente (%) : 5 4 4 3 4 5 4 4 Nombre d'espèces par relevé : 31 23 31 32 21 20 18 20 Recouvrement de la strate arborée : 55 45 55 60 65 10 65 60 Nombre d'espèces dans la strate arborée : 19 9 20 21 13 4 14 12 Recouvrement de la strate arbustive : 20 15 25 30 25 70 10 10 Nombre d'espèces dans la strate arbustive : 17 14 18 15 12 17 6 9 TB TP ESPECES 10 11 14 15 16 17 18 21 FR RM Mph S Vitellaria paradoxa + 2 1 1 2 + 2 + 100 6,56 mPh SZ Anogeissus leiocarpa 3 2 4 4 4 + 4 + 100 37,94 Mph S Khaya senegalensis + - + - + + + + 75 0,38 Mph S Pericopsis laxiflora - + - 1 + + - + 62,5 0,63 mPh S Detarium microcarpum - 1 + 1 + - - + 62,5 0,94 Mph SZ Pterocarpus erinaceus 1 1 - - 1 1 - 1 62,5 1,88 mph S Feretia apodanthera 1 + + - 2 + - - 62,5 2,44 mph S Combretum ghosalense + 1 - - 1 2 - + 62,5 2,75 nph P-A Ziziphus mucronata 3 - + - + + + - 62,5 4,94 mPh AT Allophyllus africanus - 2 2 + + - - 3 62,5 8,56 nph Pan Dichrostachys cinerea - + + - + - + - 50 0,25 mph S Combretum nigricans - + - - + + - + 50 0,25 Mph S Prosopis africana - - + + 1 - - + 50 0,56 Mph S Lannea acida - + - - 1 + - + 50 0,56 mPh SZ Lannea microcarpa - + 1 - - + - + 50 2,06 Phgr AT Smilax kraussiana - 1 + - + - - 2 50 2,38 mph AT Piliostigma thonningii - + - 2 - 1 + - 50 2,38 Mph AT Burkea africana - - 1 1 - 2 - + 50 2,69 mPh AT Crossopteryx febrifuga - + - - + - - + 37,5 0,19 mph AT Combretum collinum - + - - + + - - 37,5 0,19 mph SZ Entada africana 1 - - + - + - - 37,5 0,50 Ch AT Byrsocarpus coccineus - - + - 1 + - - 37,5 0,50 Mph AT Sterculia setigera - - 1 - 1 1 - - 37,5 1,13 nph SZ Nauclea latifolia - 2 - - - + + - 37,5 2
60
mph AT Hymenocardia acida - + - 2 - + - - 37,5 2 nph S Annona senegalensis - 1 - + - 2 - - 37,5 2,31 Ch AA Paullinia pinnata - + - - + - - - 25 0,13 Mph Pal Parkia biglobosa - - + - + - - - 25 0,13 Mph AT Margaritaria discoidea - - - - - + + - 25 0,13 mPh S Lophira lanceolata - - - + - + - - 25 0,13 mPh SZ Lannea kerstingii - + - - + - - - 25 0,13 Mph SZ Holarrhena floribunda - + - - - - + - 25 0,13 nph SZ Gardenia aqualla - + - - + - - - 25 0,13 mPh Pan Ficus capensis - + - + - - - - 25 0,13 Gét S Dioscorea cf togoensis + + - - - - - - 25 0,13 mph P-A Antidesma venosum - - - - + + - - 25 0,13 mPh AT Acacia sieberiana + - - - - + - - 25 0,13 mPh S Cussonia arborea - + - - - 1 - - 25 0,44 Mph Zanha golungensis - - - - 1 1 - - 25 0,75 mPh G Pteleopsis suberosa - 1 - - - 1 - - 25 0,75 Mph S Combretum aculeatum - + - - - - - 3 25 4,75 mPh Pan Trichilia emetica - - - - - + - - 12,5 0,06 mPh AT Swartzia madagascariensis - - - - - + - - 12,5 0,06 Mph SZ Stereospermum kunthianum - - - - - + - - 12,5 0,06 Phgr SZ Opilia amentacea - - - - - + - - 12,5 0,06 Thgr Pan Mucuna pruriens - - - - - - - + 12,5 0,06 mph Aam Leucaena leucocephala - - - - - - - + 12,5 0,06 nph SZ Grewia bicolor - - - - - - - + 12,5 0,06 mph S Erythrina senegalensis - - - - + - - - 12,5 0,06 Gét S Dioscorea tomentosa - + - - - - - - 12,5 0,06 mph AT Combretum molle - + - - - - - - 12,5 0,06 Lph S Cissus populnea - - - - + - - - 12,5 0,06 mPh SZ Cassia sieberiana - + - - - - - - 12,5 0,06 Mph SZ Borassus aethiopum - + - - - - - - 12,5 0,06 Mph S Afzelia africana - + - - - - - - 12,5 0,06 Mph AT Vitex doniana - - - - - - - 1 12,5 0,38 Mph Pan Tamarindus indica - 1 - - - - - - 12,5 0,38 mPh Crataeva religiosa - 1 - - - - - - 12,5 0,38 Mph S Bombax costatum - - - - 1 - - - 12,5 0,38 mph Pal Acacia senegal - 2 - - - - - - 12,5 1,88 Légende : Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Ja = Jachère arbustive
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
61
- Spectre des types biologiques Les types biologiques les plus dominants et les abondants dans ce groupement sont les
phanérophytes (92,31% et 99,40%), suivis de très loin par les chaméphytes (3,08% et 0,43%), les
types biologiques les moins dominants et les moins abondants étant constitués de géophytes (3,08%
et 0,13%) et de thérophytes (1,54% et 0,04%). Parmi les phanérophytes, on rencontre quatre
subdivisions qui vont des mégaphanérophytes aux phanérophytes grimpantes en passant par les
microphanérophytes et les nanophanérophytes. Mais il faut remarquer que ce sont les
mégaphanérophytes (58,75% et 35,38%) qui sont les plus dominantes et les plus abondantes. Elles
sont suivies des mésophanérophytes (23,08% et 14,76%) et des microphanérophytes (20% et
17,59%), les premières plus dominantes et les secondes plus abondantes. Les types biologiques les
moins représentés en termes d’abondance et de dominance sont les nanophanérophytes (6,59% et
9,23%) et les phanérophytes grimpantes (1,67% et 3,08%).
Il faut également remarquer que les géophytes et les thérophytes rencontrés dans cette formation
sont les uns tuberculeux et les autres grimpants. La figure 25 montre le spectre des types
biologiques de ce sous-groupement.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00
Ch Get Lph Mph mPh mph nph Phgr ThgrTypes biologiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 25: Spectre des types biologiques du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha
golungensis
- Spectre des types phytogéographiques Huit types phytogéographiques sont rencontrés dans ces groupements. Les types les plus dominants
sont respectivement le type soudanien (31,75%), le type soudano-zambézien et le type afro-tropical
(22,22%) tandis que les plus abondants sont dans l’ordre le type soudano-zambézien (38,10%), le
type soudanien (21,38%), le type paléotropical (16,08%) et le type afro-tropical (14,31%). Les types
les moins dominants et les moins abondants sont respectivement le type pantropical (9,52% et
5,99%), le type pluri-régional africain (3,17% et 3,49%), le type Guinéo-congolais (1,59% et
62
0,52%) et le type afro-américain (3,17% et 0,13%). La figure 26 illustre la proportion de chaque
type phytogéographique observé dans ce sous-groupement.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Aam AT G P-A Pal Pan S SZTypes phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 26: Spectre des types phytogéographiques du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et
Zanha golungensis
- Caractéristiques dendrométriques L’indice de Jacquard pour cette phytocénose est de 89,92%, ce qui traduit une bonne affinité entre
les relevés constituant ce sous-groupement. Les mesures dendrométriques effectuées lors de chaque
relevé donnent une densité des ligneux de 360 tiges/ha et une surface terrière de 41,25 m2/ha dans
ce groupement. Les figures 27-a et 27-b montrent la répartition de ce groupement par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
Figure 27-a Figure 27-b
Figure 27 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière
y = 2.5524x2 - 52.493x + 266.64R2 = 0.9405
-500
50100150200250
15 35 55 75 95>1
05
Centre de classe (cm)
Effe
ctifs
(Tig
es/h
a)
0.005.00
10.0015.0020.00
15 35 55 75 95>1
05
Centre de classe (cm)
Effe
ctifs
(m²/h
a)
63
L’analyse du diagramme de répartition de ce groupement par centre de classe de diamètre montre
une forte proportion des individus dont le diamètre de tronc varie de 10 à 50 cm. Le meilleur
ajustement de la structure de ce groupement est une fonction exponentielle décroissante des classes
de diamètre inférieur vers les classes de diamètre élevé et qui est traduite par la courbe de tendance
d’équation y = 2,55x² - 52,49x + 266,64. Le coefficient de corrélation (R²) de la courbe de tendance
donnent 0,94. Plusieurs individus ont une surface terrière supérieure à 10 m²/ha. L’analyse de la
répartition du groupement par centre de classe de surface terrière révèle que les individus ayant un
diamètre de tronc compris entre 40 et 50 cm sont les plus dominants suivis des individus de la classe
[30-40].
- Caractéristiques biologiques L’indice de diversité de Shannon et le coefficient d’équitabilité de Pielou calculés dans ce
groupement donne respectivement 1,72 bits et 0,95.
IV-2-2-2- Formations sur sols ferrugineux tropicaux de type à concrétions. - Composition floristique
Les formations sur sols ferrugineux tropicaux à concrétions réunissent au total 85 espèces végétales
réparties sur 11 relevés phytosociologiques dont la plupart ont été effectués dans des galeries
forestières dégradées ou en reconstitution. Chaque relevé compte en moyenne 25 espèces dont 10
dans la strate arborée avec un recouvrement moyen de 47,73% et 18 dans la strate arbustive pour un
recouvrement moyen de 30,91%.
Dans la strate arborée, Anogeissus leiocarpa, de par son abondance-dominance, affiche son
omniprésence et sa dominance (100% de fréquence et 47,05% de recouvrement moyen). Il est
respectivement suivi de Vitellaria paradoxa (81,82 et 10,59%), de Combretum ghosalense (72,73 et
1,91%), et de Daniellia oliveri (54,55 et 2,27%). Les espèces les plus rencontrées dans la strate
arbustive par ordre d’abondance-dominance sont Anogeissus leiocarpa (81,82 et 11,91%),
Securinega virosa (81,82 et 3,27%), Combretum ghosalense (72,73 et 4,55%) et Vitellaria
paradoxa (72,73 et 3,23%). Les espèces communes les plus dominantes sont respectivement
Anogeissus leiocarpa, Vitellaria paradoxa, Combretum ghosalense, Securinega virosa et Detarium
microcarpum. Les fréquences et recouvrement moyen de chaque espèce sont présentés dans le
tableau phytosociologique du groupement (Tableau 13).
64
Tableau 13 : Tableau phytosociologique des groupements sur sol ferrugineux tropical à concrétions Numéro de relevé : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 Type de formation : Fg Fg Fg Fg Fg Gr Fg Sb Gr Gr Gr Type de sol : S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A Pente (%): 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 Recouvrement de la strate arborée : 60 75 55 45 75 45 65 35 20 30 20 Nombre d'espèces par placeau : 22 31 15 50 26 23 26 19 21 17 21 Nombre d'espèces dans la strate arborée : 16 16 8 11 9 11 14 9 5 8 4 Recouvrement de la strate arbustive (%) : 25 15 35 70 40 20 20 20 15 45 35 Nombre d'espèces dans la strate arbustive : 10 20 13 46 21 15 15 13 18 12 19 TB TP ESPECES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 FR RM Mph SZ Anogeissus leiocarpa 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 100 51,36 Mph S Vitellaria paradoxa 3 + + 1 1 2 2 3 2 2 + 100 17,50 mph S Combretum ghosalense + 1 3 + + + 1 + - + 2 91 5,59 mph Pal Securinega virosa - + + 2 + + + + 1 - 2 82 3,27 mph AT Combretum collinum + + + 1 + 2 - - - 2 2 73 4,54 mPh S Detarium microcarpum + - - + + - + + 1 + + 73 0,59 mph AT Piliostigma thonningii + + - + - + + 1 + + - 73 0,59 mPh AT Crossopteryx febrifuga - - - + + + + 1 - 2 1 64 2,09 mph S Feretia apodanthera 1 + - + + + 2 1 - - - 64 2,09 mPh AT Acacia ataxacantha + + 2 2 + + - - - - - 55 2,90 Ch S Bridelia scleroneura + - - + + + + + - - - 55 0,27 Ch AT Byrsocarpus coccineus + + + + + - - - - - + 55 0,27 Mph SZ Daniellia oliveri - 2 - 1 + + + - - 1 - 55 2,05 Mph S Pericopsis laxiflora + + - 1 + - - - + + - 55 0,50 Mph SZ Pterocarpus erinaceus + + - - + + + + - - - 55 0,27 mPh S Terminalia avicennioides - 2 - - - + + 1 + - 3 55 7,45 Mph SZ Holarrhena floribunda - 1 4 1 1 - - 1 - - - 45 6,77 Gét S Dioscorea tomentosa - - - 1 2 - + + + - - 45 1,77 Mph S Lannea acida + - - - - - + 1 + - + 45 0,45 Mph AT Margaritaria discoidea 2 4 1 2 + - - - - - - 45 8,73 nph SZ Nauclea latifolia - 1 - 2 - + - + 1 - - 45 2,00 Mph Pal Parkia biglobosa + + - + + - - - 1 - - 45 0,45 mph S Combretum nigricans + - - - + + - - - 3 - 36 3,54 Ch Pan Desmodium velutinum - - - + + - - - + - + 36 0,18 nph Pan Dichrostachys cinerea - - - + - + - - - + + 36 0,18 Mph Pal Diospyros mespiliformis - + - 1 - + + - - - - 36 0,41 nph SZ Gardenia aqualla - + - + - - - - + + - 36 0,18 Mph S Prosopis africana - + - + - - + - - - + 36 0,18 nph S Acacia gourmaensis - - - + + - + - - - - 27 0,14 mPh AT Allophylus africanus 2 + + - - - - - - - - 27 1,45 nph S Annona senegalensis - - - + - + - - + - - 27 0,14 mph S Combretum glutinosum - - - + + - - + - - - 27 0,14 mPh S Cussonia arborea - - - - + - - + - + - 27 0,14
65
Gét S Dioscorea cf togoensis - - - + - + 1 - - - - 27 0,36 Mph Pan Ficus capensis - + - + - - - - - 2 - 27 1,45 mph AT Hymenocardia acida - - - + - - - - + - 1 27 0,36 mPh SZ Lannea microcarpa + - + - - - - - - - + 27 0,14 Phgr SZ Opilia amentacea - + + + - - - - - - - 27 0,14 mPh SZ Parinari curatellifolia - - - + - - - - + - + 27 0,14 Mph S Pseudocedrala kotschyi + - - + - - - - - - + 27 0,14 nph Pan Ximenia americana - - - + - - + - - + - 27 0,14 nph P-A Ziziphus mucronata - + - + - + - - - - - 27 0,14 mph P-A Antidesma venosum - + - - - - - - - - + 18 0,09 Mph S Bombax costatum + - - - - - + - - - - 18 0,09 Mph AT Burkea africana - - - - - - - + - 2 - 18 1,41 nph SZ Grewia bicolor - - - - + + - - - - - 18 0,09 Mph S Khaya senegalensis - + - - - - + - - - - 18 0,09 mPh SZ Lannea kerstingii - - + 1 - - - - - - - 18 0,32 Ch AA Paullinia pinnata - 1 - + - - - - - - - 18 0,32 mPh Rhus natalensis - - - + 2 - - - - - - 18 1,41 mPh AT Securidaca longepedonculata - - - - - + - - - - + 18 0,09 mph AM Strychnos spinosa 1 - - - - - - - - + - 18 0,32 mPh S Terminalia glaucescens - - - + + - - - - - - 18 0,09 mPh Pan Trichilia emetica - - - + - - - - + - - 18 0,09 Phgr Pan Abrus precatorius - - - + - - - - - - - 9 0,05 mPh Pal Acacia senegal - - 3 - - - - - - - - 9 3,41 mPh AT Acacia sieberiana - - - + - - - - - - - 9 0,04 Mph S Adansonia digitata - - - - - - 1 - - - - 9 0,27 Gét G Anchomanes difformis - - - - - - - + - - - 9 0,04 mph SZ Bridelia ferruginea - - - + - - - - - - - 9 0,04 Lph AT Cissus cf gracilis - - - - - - - - + - - 9 0,04 Lph S Cissus populnea - - - - - - + - - - - 9 0,04 Lph SZ Cissus sokodensis - - - - - - - - - - + 9 0,05 Mph S Combretum aculeatum - - 2 - - - - - - - - 9 1,36 Phgr AT Combretum paniculatus - - - + - - - - - - - 9 0,04 Gét Pan Dioscorea bulbifera - - - 1 - - - - - - - 9 0,27 mph SZ Entada africana - - - - - + - - - - - 9 0,05 Mph Ficus trycopoda - + - - - - - - - - - 9 0,05 nph Pal Gardenia termifolia - - - + - - - - - - - 9 0,05 mph AT Grewia venusta - - - - + - - - - - - 9 0,05 Mph SZ Lonchocarpus laxiflorus - - - - - - + - - - - 9 0,05 Mph S Lophira lanceolata - - - - - - - - + - - 9 0,05 Mph SZ Mitragyna inermis - + - - - - - - - - - 9 0,05 mph AT Phyllanthus muellerianus - - - + - - - - - - - 9 0,05 mPh G Pteleopsis suberosa - - - - - - - - - - + 9 0,05 Phgr AT Smilax kraussiana - - - - - - - - + - - 9 0,05 Mph AT Sterculia setigera - - - - - - + - - - - 9 0,05 Mph SZ Stereospermum kunthianum + - - - - - - - - - - 9 0,05 Lph SZ Strophanthus sarmentosus - - - - - - + - - - - 9 0,05
66
Mph AT Sysygium guineensis - - - + - - - - - - - 9 0,05 Th SZ Vernonia ambigua - - - 1 - - - - - - - 9 0,27 nph SZ Vernonia colorata - - - - - - - - + - - 9 0,05 Mph AT Vitex doniana - - - + - - - - - - - 9 0,05
Légende : Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Ja = Jachère arbustive
Sb = Savane boisée
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
- Spectre des types biologiques Quatre types biologiques caractérisent ce groupement.
Les types biologiques les plus remarquables par leur abondance-dominance sont les phanérophytes
(97,36% et 89,16%), suivis des géophytes (1,72% et 4,82%), des chaméphytes (0,73% et 4,82%) et
enfin des thérophytes (0,19% et 1,20%). Parmi les phanérophytes, on constate que ce sont les
microphanérophytes et les mégaphanérophytes qui s’imposent dans le paysage, les premiers par
leur abondance (51,10%) et les seconds par leur dominance (31,33%). Puis viennent les
mésophanérophytes (14,40% pour le spectre brut et 19,28% pour le spectre pondéré). Les
subdivisions les moins visibles de par leur abondance-dominance sont respectivement les
nanophanérophytes (2,18 et 12,05%), les phanérophytes grimpants (0,19 et 4,82%) et les
phanérophytes lianescents (0,12% et 4,82%). Il faut remarquer que les géophytes rencontrés dans
cette formation sont tuberculeux. La répartition des types biologiques dans cet ensemble
phytosociologique est illustrée par la figure 28.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00
Ch Get Lph mph mPh Mph nph Phgr ThTypes biologiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 28: Spectre des types biologiques des formations sur sols ferrugineux tropicaux de type à
concrétions
67
- Spectre des types phytogéographiques Trois grands types phytogéographiques dominent ces groupements. Il s’agit dans l’ordre
décroissant, du type soudanien (29,63%), du type soudano-zambézien (24,69%) et enfin du type
afro-tropical (23,46%). Mais lorsqu' on considère leur abondance, on remarque que ce sont les
espèces soudano-zambéziennes (43,12%) qui prennent le dessus, suivies des espèces soudaniennes
(31,87%) et des espèces afro-tropicales (16,92%). Les types les moins représentés en général en
tenant compte de leur abondance-dominance sont les types afro-américains et afro-malgaches
(0,24% et 1,23%) , les autres pluri-régionales africaines (0,17% et 2,47) et enfin le type guinéo-
congolais (0,07% et 2,47%). Entre ces deux extrêmes, on remarque respectivement les types
pantropical (8,64%) et paléotropical (6,17%) par leur dominance et inversement paléotropical
(5,63%) et pantropical (1,75%) par leur abondance.
La figure 29 montre les différents types phytogéographiques rencontrés dans ce paysage et leur
proportion.
0,0010,0020,0030,0040,0050,00
Aam AM AT G P-A Pal Pan S SZ
Types phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 29: Spectre des types phytogéographiques des formations sur sols ferrugineux tropicaux à
concrétions
- Caractéristiques dendrométriques La densité du peuplement ligneux dans cette formation est de 349 tiges/ha et la surface terrière est
d’environ 46,41 m2/ha. La répartition par centre de classe de diamètre et par centre de classe de
surface terrière est illustrée par les histogrammes de la figure 30.
68
Figure 30-a Figure 30-b
Figure 30 : Répartition du groupement sur sols ferrugineux tropicaux concrétionnés par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
L’analyse de la répartition de ce groupement par centre de classe de diamètre révèle une forte
proportion des individus dont le diamètre de tronc mesure entre 10 et 20 cm (167,78 tiges/ha) suivis
des individus de la classe [20-30] estimés à 107,78 tiges/ha. Le meilleur ajustement de la structure
est une fonction exponentielle décroissante d’ordre 3 des classes de diamètre inférieur vers les
classes de diamètre élevé et qui est traduite par une courbe de tendance dont l’équation est y = -
0,68x³+ 15,47x² - 113,39x + 269,7. Le coefficient de corrélation (R²) de cette courbe de tendance
donne 0,99.
L’analyse de la répartition du groupement par centre de classe de surface révèle une dominance des
individus dont le diamètre de tronc est compris entre 30 et 50 cm (7,73 m²/ha pour les individus de
la classe [30-40] et 7,70 m²/ha pour la classe [40-50]).
- Caractéristiques biologiques L’indice de diversité de Shannon et le coefficient d’équitabilité de Pielou ont pour valeurs
respectives 1,80 bits et 0,94. La faible valeur de l’indice de Shannon témoigne d’une grande
instabilité du milieu défavorable à l’installation de nombreuses espèces. Mais compte tenu de la
valeur du coefficient de Pielou qui se rapproche de 1, nous pouvons dire que nous sommes en
présence d’un peuplement équilibré.
Cet ensemble floristique est individualisé au seuil de similitude de 65% d’après le dendrogramme
en deux sous-groupements : le sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha et le
sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata.
Les caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus sont résumées
dans le tableau 14.
y = -0.684x3 + 15.473x2 - 113.39x + 269.7
R2 = 0.9931
-50.00
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
15 35 55 75 95
Centre de classe de diamètre (cm)
Den
sité
(tig
es/h
a)
0.001.002.003.004.005.006.00
15 35 55 75 95
Centre de classe de diamètre (cm)
Surfa
ce te
rrièr
e (m²/h
a)
69
Tableau 14: Caractéristiques dendrométriques et de diversité des sous-groupements obtenus dans les
phytocénoses environnant les retenues d’hydraulique pastorale de Sakabansi, Fombaoui et Sansi.
Sites Sous-groupements D G Ni H’ E
Retenue d’hydraulique
pastorale de Sakabansi
Sous-groupement à Anogeissus
leiocarpa et Acacia ataxacantha
363
19,70
62
1,72
0,97
Retenues d’hydraulique
pastorale de Fombaoui
et de Sansi
Sous-groupement à Anogeissus
leiocarpa et Securidaca
longepedunculata
228
20,98
65
1,72
0,95
IV-2-2-2-1- Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha.
- Composition floristique Ce sous-groupement sur sol lessivé à concrétions est caractérisé par Anogeissus leiocarpa (100% de
fréquence et 38,33% de recouvrement moyen), Margaritaria discoidea (100 et 26,83%) et
Holarrhena floribunda (100 et 17,12%) dans la strate arborée et par Combretum ghosalense (100%
de fréquence et 13,67% de recouvrement moyen) et Securinega virosa (100 et 5,33%) dans la strate
arbustive. Avec une richesse spécifique de 62 espèces, ce groupement est constitué de trois relevés
phytosociologiques faits dans des forêts galeries (dont un dans une galerie en reconstitution) et
compte en moyenne 58 espèces végétales par relevé. Dans la strate arborée, on compte environ 12
espèces par relevé pour un recouvrement moyen de 32% tandis que dans la strate arbustive, on
décompte 26 espèces par relevé pour un recouvrement moyen de 40%. Les espèces communes les
plus dominantes sont Anogeissus leiocarpa, Margaritaria discoidea, Holharrhena floribunda,
Combretum ghosalense et Acacia ataxacantha. Le tableau phytosociologique (Tableau 15) présente
la fréquence et le recouvrement moyen de chaque espèce du sous-groupement.
70
Tableau 15 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha
Numéro de relevé : 2 3 4 Type de formation : Fg Fg Fg Type de sol : S-A S-A S-A Pente (%) : 4 3 3 Nombre d'espèces par relevé : 75 55 45 Recouvrement de la strate arborée : 31 15 50 Nombre d'espèces dans la strate arborée : 16 8 11 Recouvrement de la strate arbustive : 15 35 70 Nombre d'espèces dans la strate arbustive : 20 13 46 TB TP ESPECES 2 3 4 Fr (%) RM (%) Mph SZ Anogeissus leiocarpa 3 2 4 100 38,33 Mph AT Margaritaria discoidea 4 1 2 100 26,83 Mph SZ Holarrhena floribunda 1 4 1 100 17,13 mph S Combretum ghosalense 1 3 + 100 13,67 mPh AT Acacia ataxacantha + 2 2 100 10,17 mph Pal Securinega virosa + + 2 100 5,33 mph AT Combretum collinum + + 1 100 1,33 mPh S Vitellaria paradoxa + + 1 100 1,33 Ch AT Byrsocarpus coccineus + + + 100 0,50 Phgr SZ Opilia amentacea + + + 100 0,50 Mph SZ Daniellia oliveri 2 - 1 66,66 6,00 nph SZ Nauclea latifolia 1 - 2 66,66 6,00 Mph Pal Diospyros mespiliformis + - 1 66,66 1,17 mPh SZ Lannea kerstingii - + 1 66,66 1,17 Ch AA Paullinia pinnata 1 - + 66,66 1,17 Mph S Pericopsis laxiflora + - 1 66,66 1,17 mPh AT Allophylus africanus + + - 66,66 0,33 mph S Feretia apodanthera + - + 66,66 0,33 Mph Pan Ficus capensis + - + 66,66 0,33 nph SZ Gardenia aqualla + - + 66,66 0,33 Mph Pal Parkia biglobosa + - + 66,66 0,33 mph AT Piliostigma thonningii + - + 66,66 0,33 Mph S Prosopis africana + - + 66,66 0,33 nph P-A Ziziphus mucronata + - + 66,66 0,33 mPh Pal Acacia senegal - 3 - 33,33 12,50 Mph S Combretum aculeatum - 2 - 33,33 5,00 mPh S Terminalia avicennioides 2 - - 33,33 5,00 Gét Pan Dioscorea bulbifera - - 1 33,33 1,00 Gét S Dioscorea tomentosa - - 1 33,33 1,00 Th SZ Vernonia ambigua - - 1 33,33 1,00 nph S Acacia gourmaensis - - + 33,33 0,17
71
mPh AT Acacia sieberiana - - + 33,33 0,17 nph S Annona senegalensis - - + 33,33 0,17 mph P-A Antidesma venosum + - - 33,33 0,17 Phgr Pan Abrus precatorius - - + 33,33 0,17 Ch S Bridelia scleroneura - - + 33,33 0,17 mph SZ Bridelia ferruginea - - + 33,33 0,17 mph S Combretum glutinosum - - + 33,33 0,17 Phgr AT Combretum paniculatus - - + 33,33 0,17 mPh Crataeva capparoides + - - 33,33 0,17 Mph AT Crossopterix febrifuga - - + 33,33 0,17 Ch Pan Desmodium velutinum - - + 33,33 0,17 mPh S Detarium microcarpum - - + 33,33 0,17 nph Pan Dichrostachys cinerea - - + 33,33 0,17 Gét S Dioscorea cf togoensis - - + 33,33 0,17 nph Pal Gardenia termifolia - - + 33,33 0,17 mph AT Hymenocardia acida - - + 33,33 0,17 Mph S Khaya senegalensis + - - 33,33 0,17 mPh SZ Lannea microcarpa - + - 33,33 0,17 Mph SZ Mitragyna inermis + - - 33,33 0,17 mPh SZ Parinari curatellifolia - - + 33,33 0,17 mph AT Phyllanthus muellerianus - - + 33,33 0,17 Mph S Pseudocedrala kotschyi - - + 33,33 0,17 Mph SZ Pterocarpus erinaceus + - - 33,33 0,17 mPh Rhus natalensis - - + 33,33 0,17 Mph AT Sysygium guineensis - - + 33,33 0,17 mPh S Terminalia glaucescens - - + 33,33 0,17 mph Pan Trichilia emetica - - + 33,33 0,17 Mph AT Vitex doniana - - + 33,33 0,17 Mph Pan Ficus trycopoda + - - 33,33 0,17 nph Pan Ximenia americana - - + 33,33 0,17
Légende : Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Ja = Jachère arbustive
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
- Spectre des types biologiques Quatre types biologiques caractérisent cette dernière. Suivant leur abondance-dominance, on
distingue dans l’ordre les phanérophytes (96,87% et 86,89%), les chaméphytes plus dominants
(6,56%) mais moins abondants (1,21%), les géophytes moins dominants que les chaméphytes
(4,92%) mais un peu plus abondants (1,31%) et enfin les thérophytes (1,64% pour la dominance et
0,61% pour l’abondance). Les investigations au sein des phanérophytes permettent de constater que
72
ce sont les mégaphanérophytes (59,32 et 29,51%), les mésophanérophytes (19,18 et 21,32%) et les
microphanérophytes (13,32 et 18,03%) qui sont les espèces les plus abondantes et les plus
dominantes dans ce type biologique. Le spectre des types biologiques de cette formation est illustré
par la figure 31 ci-dessous.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00
Ch Get mph mPh Mph nph Phgr Th
Types biologiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 31: Spectre des types biologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia
ataxacantha
- Spectre des types phytogéographiques Suivant leur abondance-dominance, quatre types phytogéographiques s’imposent dans cette
phytocénose. Dans l'ordre décroissant de dominance, on note le type soudanien (29,31%), les types
soudano-zambézien et afro-tropical (22,41%) et le type pantropical (12,07%) alors que les types les
plus répandus (abondance) sont respectivement le type soudano-zambézien (37,22%), le type afro-
tropical (27,36%), le type soudanien (19,73%) et le type paléotropical (13,12%). Les types les
moins visibles sont les autres pluri-régionales africains et les afro-américains qui ont respectivement
pour dominance 3,45% et 1,72% et 0,34% et 0,79% pour l’abondance. La figure 32 suivante montre
les différents types phytogéographiques rencontrés dans ce groupement.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Aam AT P-A Pal Pan S SZTypes phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 32: Spectre des types phytogéographiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia
ataxacantha
73
- Caractéristiques dendrométriques Les mesures dendrométriques effectuées dans ce groupement donne une densité des ligneux de 363
tiges/ha avec une surface terrière de 19,70 m2/ha. Les histogrammes de la figure 33 montre la
répartition du groupement par centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
Figure 33-a Figure 33-b
Figure 33 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha par centre de
classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière
L’analyse de répartition par centre de classe de diamètre de ce groupement révèle une nette
dominance des individus de 10 à 20 cm de diamètre (213 tiges/ha). Le meilleur ajustement de la
structure de ce groupement est une fonction exponentielle décroissante d’ordre 3 des classes de
diamètre inférieur vers les classes de diamètre élevé et qui est traduite par la courbe de tendance
d’équation y = -1,18x³ + 24,48x² - 160,6x + 335,78. Le coefficient de corrélation (R²) de la courbe
de tendance est de 0,97. Bien que les individus observés dans les autres classes de diamètre ne
soient pas assez nombreux, on constate qu’ils sont plus ou moins recouvrants, même si la surface
terrière de chaque classe de diamètre est relativement faible (entre 3 et 4 m²/ha). Remarquons
également le bon recouvrement des individus ayant entre 80 et 90 cm de diamètre de tronc bien
qu’ils soient quasi inexistants dans le groupement.
- Caractéristiques biologiques Les indices de diversité calculés pour cette formation végétale donne 1,72 bits pour l’indice de
Shannon et 0,97 pour le coefficient de Pielou.
y = -1.1849x3 + 24.476x2 - 160.6x + 335.78R2 = 0.9678
-50
0
50
100
150
200
250
15 25 35 45 55 65 75 85 95 >105
Centre de classe diamètre (cm)
Dens
ité (T
iges
/ha)
0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50
15 25 35 45 55 65 75 85Centre de classe de diamètre (cm)
Surfa
ce te
rrièr
e (m²/h
a)
74
IV-2-2-2-2- Sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata
- Composition floristique Huit relevés phytosociologiques réalisés dans des galeries forestières dégradées ou en reconstitution
ont permis de caractériser ce groupement dominé au niveau de la strate arborée par Anogeissus
leiocarpa (56,25% de recouvrement moyen et 100% de fréquence) et Vitellaria paradoxa (17,31%
de RM et 100% de fréquence) et au niveau de la strate arbustive, par Combretum ghosalense
(2,56% de recouvrement moyen et 87,5% de fréquence) et Crossopteryx febrifuga (2,81% de RM et
75% de fréquence). Tous ces relevés sont érigés sur des sols lessivés à concrétions.
Cette formation compte en moyenne 44 espèces par relevé dont 10 espèces dans la strate arborée et
15 dans la strate arbustive. Le recouvrement moyen pour la strate arborée est de 21,87% tandis que
celui de la strate arbustive est de 27,5%. En dépit de l'importance des caractères physionomiques
particuliers de chaque placeau, l’indice de similitude de Jaccard (62,06%) révèle une certaine
affinité entre les espèces des différents relevés et une bonne homogénéité au sein de cette formation.
Les fréquence et recouvrement moyen de chaque espèce recensée sont inscrits dans le tableau
phytosociologique du groupement (Tableau 16).
Tableau 16 : Tableau phytosociologique du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata Numéro de relevé : 1 5 6 7 8 9 12 13 Type de formation : Fg Fg Gr Fg Sb Gr Gr Gr Type de sol : S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A S-A Pente (%) : 3 4 3 3 4 3 5 3 Nombre d'espèces par relevé : 60 75 45 65 35 20 30 20 Recouvrement de la strate arborée : 22 26 23 26 19 21 17 21 Nombre d'espèces dans la strate arborée : 16 9 11 14 9 5 8 4 Recouvrement de la strate arbustive : 25 40 20 20 20 15 45 35 Nombre d'espèces dans la strate arbustive : 10 21 15 15 13 18 12 19 TB TP ESPECES 1 5 6 7 8 9 12 13 Fr (%) RM (%) Mph SZ Anogeissus leiocarpa 4 4 3 4 4 4 3 4 100 56,25 mPh S Vitellaria paradoxa 3 1 2 2 3 2 2 + 100 17,31 mph S Combretum ghosalense + + + 1 + - + 2 87,5 2,56 mPh S Detarium microcarpum + + - + + 1 + + 87,5 0,75 Mph AT Crossopteryx febrifuga - + + + 1 - 2 1 75 2,81 mph Pal Securinega virosa - + + + + 1 - 2 75 2,50 mph AT Piliostigma thonningii + - + + 1 + + - 75 0,69 Mph S Lannea acida + + - + 1 + - + 75 0,69
75
mph AT Combretum collinum + + 2 - - - 2 2 62,5 5,75 mPh S Terminalia avicennioides - - + + 1 + - 3 62,5 5,25 mph S Feretia apodanthera 1 + + 2 1 - - - 62,5 2,75 Ch S Bridelia scleroneura + + + + + - - - 62,5 0,31 Mph SZ Pterocarpus erinaceus + + + + + - - - 62,5 0,31 mph S Combretum nigricans + + + - - - 3 - 50 4,88 Gét S Dioscorea tomentosa - 2 - + + + - - 50 2,06 Mph SZ Daniellia oliveri - + + + - - 1 - 50 0,56 Mph S Pericopsis laxiflora + + - - - + + - 50 0,25 nph SZ Nauclea latifolia - - + - + 1 - - 37,5 0,50 Mph Pal Parkia biglobosa + + - - - 1 - - 37,5 0,50 mPh AT Acacia ataxacantha + + + - - - - - 37,5 0,19 Ch AT Byrsocarpus coccineus + + - - - - - + 37,5 0,19 mPh S Cussonia arborea - + - - + - + - 37,5 0,19 Ch Pan Desmodium velutinum - + - - - + - + 37,5 0,19 nph Pan Dichrostachys cinerea - - + - - - + + 37,5 0,19 Mph AT Burkea africana - - - - + - 2 - 25 1,94 Mph AT Margaritaria discoidea 2 + - - - - - - 25 1,94 Mph SZ Holarrhena floribunda - 1 - - 1 - - - 25 0,75 Gét S Dioscorea cf togoensis - - + 1 - - - - 25 0,44 mph AT Hymenocardia acida - - - - - + - 1 25 0,44 mph AM Strychnos spinosa 1 - - - - - + - 25 0,44 nph S Acacia gourmaensis - + - + - - - - 25 0,13 nph S Annona senegalensis - - + - - + - - 25 0,13 Mph S Bombax costatum + - - + - - - - 25 0,13 mph S Combretum glutinosum - + - - + - - - 25 0,13 Mph Pal Diospyros mespiliformis - - + + - - - - 25 0,13 nph SZ Gardenia aqualla - - - - - + + - 25 0,13 nph SZ Grewia bicolor - + + - - - - - 25 0,13 mPh SZ Lannea microcarpa + - - - - - - + 25 0,13 mPh SZ Parinari curatellifolia - - - - - + - + 25 0,13 Mph S Prosopis africana - - - + - - - + 25 0,13 Mph S Pseudocedrala kotschyi + - - - - - - + 25 0,13 mPh AT Securidaca longepedonculata - - + - - - - + 25 0,13 nph Pan Ximenia americana - - - + - - + - 25 0,13 nph SZ Vernonia colorata - - - - - + - - 12,5 0,06 mPh AT Allophylus africanus 2 - - - - - - - 12,5 1,88 Mph Pan Ficus capensis - - - - - - 2 - 12,5 1,88 mph - Rhus natalensis - 2 - - - - - - 12,5 1,88 Mph S Adansonia digitata - - - 1 - - - - 12,5 0,38 Gét G Anchomanes difformis - - - - + - - - 12,5 0,06 mph P-A Antidesma venosum - - - - - - - + 12,5 0,06 Lph AT Cissus cf gracilis - - - - - + - - 12,5 0,06 Lph S Cissus populnea - - - + - - - - 12,5 0,06 Lph SZ Cissus sokodensis - - - - - - - + 12,5 0,06 mph SZ Entada africana - - + - - - - - 12,5 0,06
76
mph AT Grewia venusta - + - - - - - - 12,5 0,06 Mph S Khaya senegalensis - - - + - - - - 12,5 0,06 Mph SZ Lonchocarpus laxiflorus - - - + - - - - 12,5 0,06 Mph S Lophira lanceolata - - - - - + - - 12,5 0,06 mPh G Pteleopsis suberosa - - - - - - - + 12,5 0,06 Phgr AT Smilax kraussiana - - - - - + - - 12,5 0,06 Mph AT Sterculia setigera - - - + - - - - 12,5 0,06 Mph SZ Stereospermum kunthianum + - - - - - - - 12,5 0,06 Lph SZ Strophanthus sarmentosus - - - + - - - - 12,5 0,06 mPh S Terminalia glaucescens - + - - - - - - 12,5 0,06 mPh Pan Trichilia emetica - - - - - + - - 12,5 0,06 nph P-A Ziziphus mucronata - - + - - - - - 12,5 0,06 Légende : Fg = Forêt galerie
Gr = Galerie en reconstitution
Sb = Savane boisée
Ja = Jachère arbustive
S-A = Sablo-argileux
H = Hydromorphe
- Spectre des types biologiques Malgré une richesse spécifique élevée (65 espèces), on ne rencontre dans cette formation que trois
types biologiques dont le plus important de par sa dominance et son abondance est le type
phanérophyte (90,77% et 97,30%). Les autres types rencontrés sont respectivement les géophytes
(4,62% et 2,12%) et les chaméphytes (4,62% et 0,57%). La figure 34 suivante montre le spectre des
types biologiques de cette formation.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00
Ch Get Lph mph mPh Mph nph PhgrTypes biologiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 34: Spectre des types biologiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca
longepedunculata
77
- Spectre des types phytogéographiques D’après leur abondance-dominance, trois types phytogéographiques sont très visibles dans cette
formation. Suivant leur dominance, on note les types soudanien (35,38%), soudano-zambézien
(23,08%) et afro-tropical (21,54%) et suivant leur abondance respectivement les types soudano-
zambézien (49,16%), soudanien (32,18%) et afro-tropical (13,45%). Les autres types rencontrés
dans ce groupement sont par ordre de dominance, le type pantropical (7,69%), le type paléotropical
(4,62%), le type guinéo-congolais et autres espèces pluri-régionales africaines (3,08%) et le type
afro-malgache (1,54%) et par ordre d’abondance, le type paléotropical (2,60%), le type pantropical
(2,03%), le type afro-malgache (0,37%) et enfin les types guinéo-congolais et autres pluri-
régionales africaines (0,11%). Les différents types phytogéographiques observés dans ce
groupement sont montrés par la figure 35.
0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00
AM AT G P-A Pal Pan S SZTypes phytogéographiques
Effe
ctifs
/ R
M (%
)
Spectre brutSpectre pondere
Figure 35: Spectre des types phytogéographiques du groupement à Anogeissus leiocarpa et
Securidaca longepedunculata
- Caractéristiques dendrométriques Les mesures dendrométriques effectuées par placeau ont permis de calculer la densité des ligneux et
la surface terrière au sein de cette formation. Ainsi, on y trouve 288 tiges/ha sur une surface terrière
de 20,98 m2/ha environ. Les histogrammes de la figure 36 montrent la répartition de ce groupement
par centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière
78
Figure 36-a Figure 36-b
Figure 36 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata par
centre de classe de diamètre et par centre de classe de surface terrière.
L’analyse du diagramme de répartition de ce groupement par centre de classe de diamètre montre
une prédominance des individus dont les diamètres de tronc mesurent respectivement entre 10 et 20
cm (116,25 tiges/ha) et entre 20 et 30 cm (98,75 tiges/ha). Le meilleur ajustement de la structure de
ce groupement est une fonction exponentielle décroissante d’ordre 3 des classes de diamètre
inférieur vers les classes de diamètre élevé et qui est traduite par la courbe de tendance d’équation y
= -0,29x³ + 7,67x² - 66,37x + 184,91. Le coefficient de corrélation (R²) de la courbe de tendance est
de 0,96.
L’analyse de la répartition du groupement par centre de classe de surface terrière révèle la
dominance des individus dont les troncs mesurent entre 30 et 40 cm de diamètre suivis des individus
de la classe [20-30]. Nous remarquons également un bon recouvrement des individus ayant plus de
115 cm de diamètre de tronc bien qu’ils soient très peu abondants dans le groupement.
- Caractéristiques biologiques Les indices de diversité calculés pour ce groupement permettent de constater que les conditions de
milieu de celui-ci sont très semblables à celles du groupement précédent (H’=1,72 bits et E=0,95).
L’indice de Jacquard calculé pour cette phytocénose est de 62,06%. Cette dernière témoigne de la
bonne affinité qui existe entre les relevés constituant ce sous-groupement et par suite, de
l’homogénéité floristique de celui-ci.
0123456
15 35 55 75 95>1
15
Centre de classe de diamètre (cm)
Surfa
ce te
rrièr
e (m²/h
a)y = -0.2868x3 + 7.6748x2 - 66.376x + 184.91R2 = 0.9631
-200
20406080
100120140
15 25 35 45 55 65 75 85 95 105
>115
Centre de classe de diamètre (cm)
Den
sité
(Tig
es/h
a)
79
IV-2-3- Synthèse générale Le dendrogramme issu de l’analyse factorielle des 121 espèces x 21 relevés des diverses formations
végétales avoisinant les retenues d’eau de notre zone d’étude montre au seuil de similitude de
100%, la ségrégation des relevés en deux grands groupements. Il s’agit des formations sur sols
ferrugineux tropicaux de type modal typique de la région sud-ouest de Nikki-Est (englobant les
localités de Ouénou et Ouroumon) et des formations sur sols ferrugineux tropicaux à concrétions
typiques de la région nord-est de Nikki-Est (englobant les régions de Sakabansi, Fombaoui et
Sansi). Au seuil de 75%, on constate l’individualisation du premier et du second groupement en
deux sous-groupements respectifs. Il s’agit d’un côté du sous-groupement à Allophyllus africanus et
Acacia sieberiana qui regroupe les relevés effectués dans les phytocénoses environnant la retenue
d’hydraulique pastorale de Ouénou et du sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha
golungensis, regroupant les relevés effectués dans les phytocénoses environnant la retenue
d’hydraulique pastorale de Ouroumon ; de l’autre, on a le sous-groupement à Anogeissus leiocarpa
et Acacia ataxacantha, caractéristique des phytocénoses observées autour de la retenue
d’hydraulique pastorale de Sakabansi et le sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca
longepedunculata, regroupant les relevés effectués dans les phytocénoses environnant les retenues
d’hydraulique pastorale de Fombaoui et Sansi.
Que ce soit dans le premier ou le second groupement, on remarque que ce sont les phanérophytes
qui sont les plus dominants et les plus abondants au niveau des types biologiques et au niveau des
types phytogéographiques, les espèces à distribution continentale sont en général les plus
abondantes et les plus dominantes, suivies des espèces de l’élément base soudanien. Les tableaux
suivants résument les proportions des types biologique (tableau 17), phytogéographique (tableau
18), les résultats des mesures dendrométriques et les indices de diversité (tableau 19) obtenus au
niveau de chaque sous-groupement.
Tableau 17: Abondance-dominance des types biologiques obtenus par sous-groupement.
Groupements
Ph Ch Ge Th
Dom
(%)
Abon
(%)
Dom
(%)
Abon
(%)
Dom
(%)
Abon
(%)
Dom
(%)
Abon
(%)
G1-1 90,91 99,27 6,82 0,55 - - 2,27 0,18
G1-2 92,31 99,40 3,08 0,43 3,08 0,13 1,54 0,04
G2-1 86,20 96,52 6,90 1,35 5,17 1,46 1,72 0,27
G2-2 90,77 97,31 4,62 0,57 4,62 2,13 - -
80
Tableau 18 : Abondance-dominance des types phytogéographiques obtenus par sous-groupement.
Groupements
Elément base
soudanien
Espèces à
distribution
continentale
Espèces à large
distribution
Dom.
(%)
Abon.
(%)
Dom.
(%)
Abon.
(%)
Dom.
(%)
Abon.
(%)
G1-1 31,82 35,1 50 56,13 18,18 8,78
G1-2 31,75 21,38 49,20 56,42 19,04 22,20
G2-1 29,31 19,73 48,27 64,92 22,41 15,37
G2-2 35,38 32,18 52,32 63,20 12,31 4,63
Tableau 19: Tableau synthétique des paramètres dendrométriques et de diversité spécifique obtenus
par sous-groupement.
Sites Sous-groupements Ij D G Ni H’ E
Retenue d’hydraulique
pastorale de Ouénou
Sous-groupement à
Allophyllus africanus et
Acacia sieberiana
54,55
450
32,76
46
1,64
0,99
Retenue d’hydraulique
pastorale de Ouroumon
Sous-groupement à
Anogeissus leiocarpa et
Zanha golungensis
89,92
360
41,25
65
1,72
0,95
Retenue d’hydraulique
pastorale de Sakabansi
Sous-groupement à
Anogeissus leiocarpa et
Acacia ataxacantha
68,25
363
19,70
62
1,72
0,97
Retenues d’hydraulique
pastorale de Fombaoui
et de Sansi
Sous-groupement à
Anogeissus leiocarpa et
Securidaca
longepedunculata
62,06
228
20,98
65
1,72
0,95
De façon générale, on retiendra que les conditions de milieu des deux grands groupements identifiés
sont contraignantes. De ce fait, les espèces identifiées sont peu nombreuses mais très représentées.
81
IV-3- LES IMPACTS NEGATIFS DES RETENUES D’HYDRAULIQUE PASTORALE SUR L’ENVIRONNEMENT En permettant toute l’année (surtout en saison sèche) l’abreuvement des troupeaux, les retenues
d’hydraulique pastorale constituent des pôles de vie extrêmement importants puisqu’elles sont le
lieu de rassemblement privilégié des hommes pour venir y chercher l’eau nécessaire à leurs besoins
et des animaux pour s’y abreuver.
Cette forte fréquentation des retenues d’hydraulique pastorale surtout en saison sèche est à l’origine
de la plupart des impacts négatifs constatés sur l’environnement.
IV-3-1- Sur l’environnement physique Les impacts négatifs des retenues d’hydraulique pastorale sur l’environnement physique recensés
dans notre zone d’étude proviennent principalement des grands rassemblements de troupeaux
surtout en saison sèche qu’occasionnent la disponibilité permanente de l’eau rendue possible par la
construction des retenues d’hydraulique pastorale. Le tableau 20 résume ces impacts.
82
Tabl
eau
20 :
Tabl
eau
synt
hétiq
ue d
es im
pact
s nég
atifs
des
rete
nues
d’h
ydra
uliq
ue p
asto
rale
sur l
’env
ironn
emen
t phy
sique
.
Caus
es /
Effe
ts
Proc
essu
s Im
pact
Po
int d
’impa
ct
Effe
t 1
Effe
t 2
Effe
t 3
Gra
nds
rass
embl
emen
ts d
e
troup
eaux
au
tour
des
rete
nues
surto
ut
en
saiso
n
sèch
e
Inte
nses
piét
inem
ents
auto
ur
des
rete
nues
Am
eubl
issem
ent
couc
he
supe
rfici
elle
du
sol
Tran
spor
t de
s pa
rticu
les
de s
ol
arra
chée
s pa
r l’e
au
de
ruis
selle
men
t.
Eros
ion
Sol
Acc
ès d
irect
e de
s an
imau
x
au la
c de
rete
nue
Aug
men
tatio
n ch
arge
allu
vion
naire
de
l’e
au
des
rete
nues
Com
blem
ent
Rete
nues
d’hy
drau
lique
pasto
rale
Urin
es
et
dépô
t de
fé
cès
aux
abor
ds e
t dan
s le
lac
des r
eten
ues
Pollu
tion
de l
’eau
des r
eten
ues
Inte
nses
piét
inem
ents
des
pâtu
rage
s
Dég
rada
tion
des
pâtu
rage
s
auto
ur d
es r
eten
ues
surto
ut
les a
rbus
tes e
t her
bacé
es
Surp
âtur
age
par
man
que
de
pâtu
rage
s
Dég
rada
tion
des
phyt
océn
oses
envi
ronn
ant
les
rete
nues
d’e
au
Flor
e
Mul
tiplic
atio
n de
la
char
ge
anim
ale
des
pâtu
rage
s
envi
ronn
ant
Pres
sion
sur
four
rage
s
ligne
ux s
e m
anife
stan
t pa
r
l’étê
tage
de
ce
rtain
es
espè
ces
Disp
ariti
on
prog
ress
ive
des
espè
ces
forte
men
t étê
tées
com
me
Afze
lia
afri
cana
, K
haya
sene
gale
nsis
et
Pt
eroc
arpu
s
erin
aceu
s
Rédu
ctio
n de
la
biod
iver
sité
des
phyt
océn
oses
envi
ronn
ant
les
rete
nues
d’e
au
83
IV-3-1-1- Sur le sol Chaque jour, ce sont des centaines ou des milliers de bovins qui se rassemblent autour des retenues
d’eau surtout lorsque la saison sèche survient. Ces rassemblements occasionnent d’intenses
piétinements autour des points d’eau, avec pour conséquences directes l’ameublissement des couches
superficielles du sol comme le témoigne la photo 6 prise au niveau de la retenue d’hydraulique
pastorale de Sansi.
Photo 6: Piétinements intenses autour de la retenue de Sansi. (Photo prise en Septembre 2001)
Ces sols dont la structure superficielle a été ainsi rompue, offrent une moindre résistance aux
différents agents de l’érosion en particulier l’eau de ruissellement. Ainsi, dès les premières pluies,
l’eau de ruissellement transporte les particules détachées vers le lac de la retenue, laissant sur place
des sols érodés et de nombreux ravinements. C’est le cas au niveau de toutes les retenues de notre
zone d’étude. La photo 7, prise en amont de la retenue de Ouénou, renforce cette observation.
Photo 7 : Erosion du sol en amont de la retenue de Ouénou (Photo prise en Septembre 2001)
84
En conclusion, l’impact des retenues d’hydraulique pastorale sur le sol dans notre région d’étude se
traduit de manière indirecte par l’érosion occasionnée en amont par les intenses piétinements des
troupeaux venant s’abreuver dans ces retenues.
IV-3-1-2- Sur l’hydrographie Tout comme au niveau du sol, l’impact de la création des retenues d’hydraulique pastorale sur
l’hydrographie a pour cause l’ameublissement du sol (en amont et autour du lac des retenues
d’hydraulique pastorale) que provoquent les intenses piétinements engendrés par la prolifération des
troupeaux autour des retenues d’hydraulique pastorale surtout en saison sèche.
En effet, lorsque les sols sont ameublis, les particules qui les constituent perdent leur cohésion et, dès
les premières pluies sont arrachées puis transportées vers les lacs de retenues. Ces alluvions déposées
dans les lacs de retenues contribuent progressivement au comblement de ces derniers. C’est
notamment le cas à Sansi où le niveau d’eau de la retenue a sérieusement baissé pendant la saison
sèche de 2001 occasionnant la mort de nombreux poissons et la fuite de nombreuses autres espèces
(crocodiles, tortues…) vers d’autres écosystèmes plus favorables à leurs conditions de vie. Si la
situation n’est pas aussi criarde au niveau de toutes les autres retenues de notre région d’étude, le
risque de comblement de celles-ci est inévitable si des mesures pour réduire la masse d’alluvions qui
est drainée à chaque début de saison pluvieuse vers le lac des retenues ne sont pas prises.
L’accès direct des animaux aux lacs de retenue observé au niveau de toutes les retenues
d’hydraulique pastorale de la zone d’étude, constitue une source de pollution des eaux de ces
retenues. Cette pollution est en général provoquée par les urines et défécations laissées aux abords
des retenues et parfois même dans les lacs de retenue par les animaux venus s’abreuver.
Nous retiendrons au total que les inconvénients de la prolifération des animaux autour des retenues
d’hydraulique pastorale de la zone d’étude sont principalement la pollution des eaux de ces retenues
et leur envasement à terme.
IV-3-1-3- Sur la flore Les impacts des retenues d’hydraulique pastorale sur la flore proviennent exclusivement du
rassemblement des troupeaux (locaux et transhumants) autour des retenues d’hydraulique pastorale
de la zone d’étude.
En effet, après s’être abreuvés, les animaux vont naturellement paître dans les pâturages avoisinants
les retenues d’eau. Chaque jour, ce sont des centaines d’animaux (locaux et transhumants) qui
fréquentent ces pâturages avec pour corollaires d’intenses piétinements dont la conséquence
immédiate est la dégradation de ces pâturages. Cette dégradation des pâturages, plus visible au
niveau de la strate herbacée réduit la masse de fourrages disponibles déjà insuffisants pendant cette
85
période de l’année. Il s’ensuit alors un surpâturage au niveau des phytocénoses environnant les
retenues d’hydraulique pastorale et par suite leur dégradation. Pour subvenir aux besoins alimentaires
de leurs troupeaux, les éleveurs émondent ou étêtent les ligneux fourragers par des méthodes très
sommaires aboutissant très souvent à la destruction des arbres et des arbustes. Les ligneux fourragers
les plus étêtés dans la région sont Khaya senegalensis, Pterocarpus erinaceus et Afzelia africana à tel
point que ce dernier semble disparaître dans la région. En effet, lors de nos relevés, nous n’avons
rencontré cette espèce qu’une seule fois et fortement ébranchée (cf tableaux phytosociologiques No 9
et 13).
Au total, nous retiendrons que les impacts de la fréquentation des retenues d’hydraulique pastorale
par les bovins sur la flore de la zone d’étude se manifestent par la dégradation des pâturages
environnants et même la disparition de certaines espèces provoquant la réduction de la biodiversité.
En conclusion, nous retiendrons que les principaux impacts négatifs de la construction des retenues
d’hydraulique pastorale sur l’environnement physique proviennent essentiellement de la
multiplication des troupeaux aux différents points d’eau pendant la saison sèche.
Ces grands rassemblements de troupeaux sont à l’origine des érosions de sols observées surtout en
amont et aux abords des retenues d’eau d’une part et à la dégradation des pâturages environnants ces
points d’abreuvement d’autre part.
Les érosions de sols consécutives à l’ameublissement des couches superficielles des sols sont
occasionnées par les intenses pietinements des troupeaux. Il faut aussi noter que les particules de sols
érodés participent au comblement des lacs de retenues.
Les dégradations de pâturages observées sont la conséquence des intenses pietinements sur les
herbacées d’une part et de la pression exercée par les éleveurs sur les pâturages aériens d’autre part.
Cette pression se manifeste par les émondages des arbres et arbustes fourragers par les bouviers.
Il faut retenir que ces dégradations sont la conséquence directe de l’écart entre la charge animale
(surplus) et la capacité de charge des pâturages environnants les retenues d’eau pendant cette période.
86
IV-3-2- Sur l’environnement socio-économique IV-3-2-1- Sur les populations des localités Les effets néfastes des retenues sur les populations viennent exclusivement des différentes
utilisations qu’elles font de l’eau de ces retenues.
En effet, dans la zone d’étude, on constate que la principale source d’approvisionnement en eau des
populations pendant la saison sèche provient des retenues d’hydraulique pastorale (39,56%) suivie de
loin par les forages hydrauliques (26,37%), les puisards et mares (16,48%), les puits (13,19%) et
enfin les marigots (4,40%) ( Cf. tableau 35 en annexe)
Figure 37: Principales sources d’approvisionnement en eau par saison
Si la grande majorité des interviewés reconnaît que l’eau des retenues d’hydraulique pastorale est
susceptible de porter des germes de maladies d’origine hydrique, on remarque néanmoins que
21,78% de la population de notre zone d’étude l’utilisent comme boisson et pour la préparation des
aliments et 44,55% pour faire les lessive/vaisselle et toilette comme le montre la figure 38.
0.0010.0020.0030.0040.0050.00
1Saison sèche
Fréq
uenc
e (%
)
Boisson/Mets
Lessive/Vaisselle/ToiletteConstruction
Alcool
Jardinage
Figure 38: Différentes utilisations faites de l’eau des retenues d’hydraulique pastorale pendant la
saison sèche
01020304050
Puits
Marigo
t
Puisard
/mare
Eau de
pluie
Barrag
e
Forage
Sources d'approvisionnement en eau
Fréq
uenc
e d'
utilis
atio
n de
la
sour
ce (%
)
Saison pluvieuse
Saison sèche
87
Cela s’explique par le fait que pendant la saison sèche, la plupart des sources traditionnelles
d’approvisionnement en eau (puits, marigots, puisards…) s’assèchent. Les retenues d’hydraulique
pastorale sont les seules sources disponibles et surtout faciles d’accès pendant cette période, les
autres sources (forage, puits à grand diamètre) contraignant les populations à de longues et épuisantes
files d’attente et parfois même à de violentes disputes.
Mais il faut signaler que c’est surtout parmi les populations gando et peulh que l’eau des retenues est
plus consommée aussi bien comme boisson et pour la préparation des aliments que pour toutes les
autres activités domestiques. En effet, 19,51% des membres de ce groupe socio-culturel utilisent
l’eau des retenues comme boisson et pour la préparation des mets, 51,22% pour faire les autres
activités domestiques (vaisselle, lessive, toilette, etc.). Tous les animaux des localités sont abreuvés
aux retenues même si à partir de novembre, une partie du cheptel de la région va en transhumance
pour des besoins de pâturages d’une part et pour des raisons de tradition culturelle d’autre part.
Vivant généralement en dehors des agglomérations, les populations peulh et gando ont difficilement
accès aux puits et mieux aux forages en saison sèche. C’est ce qui explique la forte utilisation de
l’eau des retenues par ces populations (24,39% contre 18,65% pour les populations autochtones
composées essentiellement de bariba, boo) pour leurs principaux besoins domestiques allant de la
boisson et préparation des aliments à la vaisselle, lessive et toilette (70,73% contre 66,34% pour les
populations autochtones).
Les principales sources d’approvisionnement en eau pendant la saison des pluies dans la région sont
en général, les marigots (14,51%), les puits (13,99%) et l’eau de pluie (11,92%). On remarque
cependant chez les Peulh/ Gando que la principale source d’approvisionnement en eau pendant la
saison des pluies est le marigot (19,51%), suivie de l’eau de pluie (12,20%). La photo 8 montre des
femmes Peulhes venues faire la lessive et la vaisselle à la retenue de Sakabansi.
Photo 8: femmes peulh faisant la vaisselle et la lessive au bord de la retenue de Sakabansi
88
Plusieurs maladies ont été recensées dans la région d’étude. Elles vont des maladies respiratoires
(toux, bronchite, rhumes, asthme, coqueluche) aux maladies urinaires (bilharziose, pertes urétrales),
en passant par des gastro-entérites (dysenterie, maux de ventre, choléra, diarrhée, vomissement), des
maladies dermiques (gale, urticaire), des maladies infectieuses (rougeole), des maladies parasitaires
intestinales (oxyures, vers), des maladies du sang (paludisme, ictère) et autres maladies
(hémorrhoïde, conjonctivite, maux d’yeux, hernie…). (Cf. tableau 30 en annexe).
Parmi ces maladies, neuf auraient un lien plus ou moins direct avec les retenues d’hydraulique
pastorale. Il s’agit suivant la fréquence de répétition des maladies prédominant dans la zone d’étude,
des gastro-entérites qui sont les plus répandues (53,33%), des maladies dermiques (33,33%), des
maladies parasitaires intestinales (6,66%), des maladies urinaires et de la conjonctivite (3,33%). (cf.
tableau 31 en annexe pour détails). La figure 39 montre les proportions des principaux groupes de
maladies rencontrés chez les populations riveraines et qui seraient liées à l’utilisation de l’eau des
retenues.
54%33%
7%3%
3%
gastro-entérites
maladies dermiques
MPI
maladies urinaires
conjonctivite
Figure 39: Principaux groupes de maladies rencontrés chez les populations riveraines et qui seraient
liés à l’utilisation de l’eau des retenues. (Les données brutes sont résumées en annexe dans le tableau
31)
Remarque : MPI= Maladies Parasitaires Intestinales
Si de l’avis des agents de santé interrogés, toutes ces maladies ne peuvent être citées comme ayant
une origine hydrique, ils sont cependant unanimes pour reconnaître que ces maladies peuvent être
provoquées par l’eau souillée et polluée des retenues (eau polluée par les fécès des animaux, les
urines, transport par l’eau de ruissellement des déchets en amont et actions anthropiques…). La forte
fréquence des gastro-entérites et des maladies dermiques dans cette région confirme la forte
utilisation de l’eau des retenues d’hydraulique pastorale comme boisson et pour la préparation des
mets d’une part et pour les autres besoins domestiques (vaisselle, lessive, toilette etc.) d’autre part
surtout pendant la saison sèche.
89
IV-3-2-2- Sur les animaux domestiques Les conséquences négatives des retenues d’eau sur les animaux résultent prioritairement des
maladies qu’ils contractent aux points d’eau.
En effet, les grands rassemblements des animaux au même point d’eau sont des occasions de
contamination des maladies entre troupeaux. Cette contamination se fait de plusieurs manières soit
directement par contact physique entre animaux ou par l’eau d’abreuvement, soit indirectement par
l’intermédiaire d’un vecteur. La photo 9 montre les bovins venus s’abreuver à la retenue de Sansi.
Photo 9: Bovins venus s’abreuver dans la retenue d’eau de Ouénou. (Photo prise en Septembre 2001)
Dans notre région d’étude, plusieurs maladies sont rencontrées. Le tableau 21 présente les principales
maladies bovines recensées dans cette région.
Tableau 21 : Principales maladies bovines recensées dans la région d’étude
Légende
N = Nombre d’éleveurs interviewés
N = Nombre d’éleveurs ayant cité cette maladie
nt = Nombre de fois que la maladie a été citée dans la zone d’étude
Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon OuénouN = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5
n n n n n nt %Trypanosomiase
bovine 3 4 4 5 5 21 30.00PPCB 2 3 1 - 1 7 10.00
Pasteurellose bovine 3 4 3 4 3 17 24.29
Fièvre aphteuse 1 5 4 2 2 14 20.00Streptotrycose cutano-bovine 1 - - - - 1 1.43
Néphrite 1 1 2 - - 4 5.71Gâle 1 - - - - 1 1.43
Brucellose - 2 2 1 - 5 7.1470 100.00Total
Zone d'étude25Maladies bovines
90
De l’avis des Médecins vétérinaires du PADEB interrogés, aucune des maladies mentionnées dans le
tableau 21 n’est a priori d’origine hydrique. Mais elles sont généralement contractées lors des grands
rassemblements pendant la saison sèche à une même source d’abreuvement. La figure 40 ci-dessous
montre les principales maladies contractées aux retenues d’eau d’après les enquêtes effectuées auprès
des éleveurs de la région d’étude.
Figure 40: Principales maladies bovines contractées aux retenues d’eau (résultats d’enquêtes socio-
économiques, 2001)
En dehors de la Trypanosomiase bovine dont le vecteur est la glossine (mouche tsé-tsé) qui vit dans
les milieux humides, les autres maladies énumérées sont des maladies contagieuses.
La plupart des maladies animales rencontrées dans la zone d’étude ont des vaccins sauf la Fièvre
aphteuse. Il faut remarquer que le coût des soins, l’insuffisance de personnel vétérinaire, les
escroqueries de certaines personnes qui se font passer pour des vétérinaires, etc. sont autant de
facteurs qui limitent les campagnes de vaccination et la confiance des éleveurs, entraînant ainsi la
persistance de certaines maladies qui auraient pu être contrôlées grâce aux soins.
IV-3-2-3- Sur la faune Les impacts de retenues d’hydraulique pastorale sur la faune n’ont pas été observés dans la zone
d’étude. Cependant, nous remarquerons que les piétinements intenses occasionnés par les animaux
dans les pâturages environnant ces retenues d’hydraulique pastorales sont autant de facteurs de
perturbation et de destruction des biotopes des organismes vivant dans ces phytocénoses.
En conclusion, il faut retenir retenir que les impacts négatifs de la construction des retenues
d’hydrauliques pastorale sont essentiellement des impacts liés à la santé des populations riveraines et
à la santé animale.
En effet, cinq principaux groupes de maladies ont été recensés parmi la population riveraine et qui
auraient un lien plus ou moins directe avec les retenues d’eau. Il s’agit suivant la prédominance, des
31%
4%
32%
29%
4%TrypanosomiasebovinePPCB
PasteurellosebovineFièvre aphteuse
Néphrite
91
gastro-entérites (53,33%), des maladies dermiques (33,33%) et des maladies parasitaires intestinales
(6,66%), des maladies urinaires et la conjonctivite (3,33%).
Trois principales maladies ont été recensées parmi les bovins de la région d’étude. Il s’agit par ordre
de fréquence, de la Trypanosomiase bovine (30%), de la pasteurellose bovine (24,29%) et de la
fièvre aphteuse (20%). Bien que ces maladies ne soient pas d’origine hydrique, elles sont en général
contractées à une même source d’abreuvement soit par des agents vecteurs ou soit par la
contamination.
92
IV-4- Les impacts positifs IV-4-1- Sur l’environnement physique Les impacts des retenues d’hydraulique pastorale sur l’environnement physique de notre région
d’étude ont été observés de manière directe sur la végétation et la faune. Le tableau 22 résume ces
impacts.
IV-4-1-1- Impacts sur la végétation Afin de préserver et de pérenniser les retenues d’eau créées, il a été délimité un large périmètre de
protection autour de la retenue et dans le bassin versant. Pour ce faire, tous les champs situés à
l’intérieur du secteur protégé ont été déplacés. Les populations ont été également sensibilisées sur la
nécessité d’éviter toute action anthropique (culture, coupe d’arbres, feux de vegetation, etc.) pouvant
affecter négativement les formations végétales dans le périmètre délimité. L’action combinée de ces
deux mesures de protection depuis la construction des retenues d’hydraulique pastorale a permis
l’évolution des anciens sites de champs et jachères en savanes arbustives et arborées ou en galeries
en reconstitution suivant la vieillesse de la jachère ou son emplacement par rapport au cours d’eau
d’une part, et la conservation des pâturages de saison sèche d’autre part.
Au total, ces mesures de protection ont globalement contribué à la conservation des ressources
biologiques et de la biodiversité de la région d’étude.
93
Tabl
eau
22 :
Tabl
eau
synt
hétiq
ue d
es im
pact
s pos
itifs
des
rete
nues
d’h
ydra
uliq
ue p
asto
rale
sur l
’env
ironn
emen
t phy
sique
de
la ré
gion
d’é
tude
Caus
es /
Effe
ts
Proc
essu
s Im
pact
Po
int
d’im
pact
Ef
fet1
Ef
fet2
Dél
imita
tion
périm
ètre
de
prot
ectio
n en
am
ont
et a
utou
r des
rete
nues
d’ea
u
Dép
lace
men
t ch
amps
et
jach
ères
situ
ées
dans
le p
érim
ètre
de
prot
ectio
n
Evol
utio
n de
s an
cien
s si
tes
de c
ham
ps e
t
de
jach
ères
en
sa
vane
s ar
busti
ves
et
arbo
rées
ou
en g
aler
ie e
n re
cons
titut
ion.
Cons
erva
tion
des
ress
ourc
es
biol
ogiq
ues
et d
e bi
odiv
ersit
é de
s
phyt
océn
oses
Flor
e
Inte
rdic
tion
des
feux
ou
to
ute
actio
n
anth
ropi
que
susc
eptib
le
d’af
fect
er
néga
tivem
ent l
es fo
rmat
ions
situ
ées d
ans l
e
périm
ètre
Cons
erva
tion
des
ress
ourc
es b
iolo
giqu
es
des
phyt
océn
oses
env
ironn
ant l
es r
eten
ues
d’hy
drau
lique
pas
tora
le
Cons
erva
tion
des
pâtu
rage
s de
sa
ison
sèch
e
Am
élio
ratio
n
disp
onib
le f
ourra
ger
de
la ré
gion
.
Chep
tel
Disp
onib
ilité
perm
anen
te d
e l’e
au
Empo
isson
nem
ent
des
rete
nues
d’hy
drau
lique
pas
tora
le
Atti
ranc
e ve
rs
la
régi
on
d’un
e fa
une
aqua
tique
et s
emi-a
quat
ique
Am
élio
ratio
n di
vers
ité
biol
ogiq
ue d
e la
fau
ne
de la
régi
on
Faun
e
sauv
age
Rédu
ctio
n so
uffra
nces
ph
ysiq
ues
des
anim
aux
pour
l’a
breu
vem
ent
en
saiso
n
sèch
e
Chan
ces
de s
urvi
e de
s ve
aux
accr
ues
et
sant
é du
bét
ail a
mél
ioré
e
Acc
roiss
emen
t
num
ériq
ue d
u bé
tail
Béta
il
Rédu
ctio
n se
nsib
le
des
prob
lèm
es
d’ab
reuv
emen
t dan
s la
régi
on
A
mél
iora
tion
des
cond
ition
s sa
nita
ires
du
béta
il
Béta
il
94
IV-4-1-2- Sur la faune Les avantages de la construction des retenues d’hydraulique pastorale pour la faune
proviennent principalement de la disponibilité permanente en eau rendue possible par la
construction des retenues et de la protection des phytocénoses environnant ces retenues.
IV-4-1-2-1- Sur la faune sauvage La disponibilité permanente en surface de l’eau des retenues d’hydraulique pastorale a
favorisé localement la mise en place naturelle d’une zoocénose allant des espèces aquatiques
aux espèces terrestres en plus de l’empoissonnement fait par les techniciens du PDEBE et du
CARDER. Le tableau 23 résume les différentes espèces de poissons introduites dans les
retenues et les autres espèces animales observées.
Tableau 23 : Tableau synthétique des différentes espèces animales observées dans et autour
des retenues d’hydraulique pastorale
Retenues/es
pèces
Empoissonnement Espèces aquatiques
et semi-aquatiques
Espèces terrestres
1ère espèce 2ème espèce 3ème espèce
Ouénou Carpe Silure Sardine Crocodiles, tortues,
crabes, grenouilles,
crapauds etc.
Canards d’eau,
pintades sauvages,
scorpions d’eau,
pique-bœufs, varans,
lézards, etc.
Ouroumon Sardine Silure Carpe
Sakabansi Silure Carpe Sardine
Fombaoui Carpe Silure -
Sansi Sardine Carpe silure
Remarquons que l’empoissonnement n’a pas été fait de manière aléatoire. Il a en effet été tenu
compte de la qualité physique de l’eau d’une part et des autres espèces aquatiques vivant dans
ces eaux d’autre part. La non prise en compte de la chaîne alimentaire entre toutes les espèces
vivant dans un milieu peut en effet compromettre la survie d’une espèce voire même sa
disparition. Cela pourrait expliquer par exemple le choix d’empoissonner la retenue de
Fombaoui prioritairement de carpes. En effet, les crocodiles nombreux dans cette retenue
auraient une préférence alimentaire pour les silures que les carpes truffées d’ossements.
Au total, grâce aux retenues d’hydraulique pastorale, la diversité biologique de la faune
sauvage de la région a été améliorée.
95
IV-4-1-2-2- Sur les animaux domestiques Contraints autrefois à parcourir de très longues distances à la recherche d’un point d’eau pour
s’abreuver, le cheptel de la zone d’étude n’est plus confronté aux problèmes d’abreuvement
depuis la construction des retenues d’hydraulique pastorale.
Cette réduction des souffrances physiques du bétail conjuguée avec la disponibilité de l’eau
d’abreuvement a selon les éleveurs, permis d’accroître les chances de survie des veaux et
d’améliorer les conditions sanitaires du cheptel adulte.
Un autre avantage non négligeable des retenues d’hydraulique pastorale pour le bétail
provient de la protection des phytocénoses environnant ces retenues contre les feux de
végétation et toute action anthropique (exploitation forestière) susceptible de les affecter
négativement. Cette mesure favorise la conservation des pâturages de saison sèche (graminées
sèches, arbustes et arbres fourragers, etc.) dans ces régions.
S’il n’a pas été possible d’évaluer les impacts des retenues sur la production animale, on
retiendra néanmoins que la disponibilité permanente de l’eau d’abreuvement permet aux
vaches allaitantes de disposer en permanence de lait, indispensable pour la croissance et la
survie des veaux.
En résumé, nous retiendrons que la construction des retenues d’hydraulique pastorale a des
impacts positifs sur l’environnement physique perceptibles sur la flore environnante, la faune
sauvage et sur les animaux domestiques.
En effet, la délimitation d’un périmètre de protection en amont et autour des retenues d’eau a
contribué à la conservation des ressources biologiques et de la biodiversité des phytocénoses
environnantes d’une part et à l’amélioration de la disponibilité de fourrage pour le cheptel
surtout en saison sèche. La disponibilité permanente en eau dans la région rendue possible par
les retenues d’eau, contribue à l’amélioration de la diversité biologique de la faune sauvage
(aquatique et semi-aquatique en particulier) de la région, à un accroissement numérique du
cheptel (bovin surtout) et de façon générale à l’amélioration des conditions sanitaires des
animaux.
IV-4-2- Sur l’environnement humain Les impacts positifs des retenues d’hydraulique pastorale sur les populations humaines
proviennent essentiellement de la disponibilité permanente de l’eau, des possibilités qu’elle
permet et des utilisations que les populations en font. Le tableau 24 résume ces impacts.
96
Tableau 24 : Tableau synthétique des impacts positifs des retenues d’hydraulique pastorale
sur les populations de la région étudiée.
Causes /
Effets
Processus Impact Point
d’impact Effet1 Effet2
Disponib
ilité
permane
nte de
l’eau
Amélioration des
conditions
d’abreuvement des
bovins
Réduction des
flux de
transhumance
Sédentarisation des
éleveurs et amélioration
des conditions
d’élevage.
Eleveurs
Difficultés
d’approvisionnement
en eau pendant la
saison sèche jugulées
Satisfaction de
la plupart des
besoins vitaux
des populations
Amélioration
conditions de vie des
populations
Eleveurs et
agro-éleveurs
Amélioration des
conditions
d’abreuvement des
bovins
Amélioration
de la culture
attelée
Amélioration des
conditions de
production
Agriculteurs
et agro-
éleveurs
Empoissonnement des
retenues
Vente de
poissons en
saison sèche.
Accroissement revenus
monétaires des
populations riveraines
Femmes
ménagères
Mise en place des
plantations et des
maraîchages en aval
des retenues
Vente des
produits de
maraîchage et
des plantations
Empoissonnement des
retenues et institution
des taxes
d’abreuvement
Vente de
poissons et
prélèvement
des taxes
d’abreuvement
Accroissement des
recettes du Comité
Barrage et amélioration
des capacités
d’investissement de la
communauté
Communauté
97
IV-4-2-1- Sur les agriculteurs Les avantages de la construction des retenues d’hydraulique pastorale pour les agriculteurs
vont l’amélioration des moyens de productions (élevage des animaux de trait) à la mise en
place des plantations de fruitiers en aval des retenues d’eau en passant par l’amélioration des
conditions de vie des agriculteurs (construction de nouvelles maisons). Le tableau 25 révèle
l’importance de la construction des retenues d’hydraulique pastorale pour la culture attelée.
Tableau 25 : Importance des retenues d’hydraulique pastorale pour l’acquisition des animaux
de trait
Pensez-vous pouvoir
garder des animaux
de trait si vous
n'aviez pas de
barrages?
Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Zone d'étude
N = 5 N =5 N =5 N 5 N 5 15
n n n n n nt %
OUI 0 1 0 Pas d’animaux de trait
à cause des vols de
bêtes
1 6,25
NON 2 2 2 6 37,50
OUI MAIS… 3 3 3 9 56,25
Total 16 100,00
Légende
N = Nombre d’agriculteurs interviewés
n = Nombre d’agriculteurs ayant cité une réponse donnée
nt = Nombre de fois que la réponse a été citée dans la zone d’étude
L’analyse du tableau 25 permet de ressortir deux types de réponse. Les uns (37,50%)
affirment qu’ils ne se seraient jamais hasardés à l’acquisition des animaux de trait sans
s’assurer de la disponibilité d’une source d’abreuvement. Les autres (56,25%) estiment que la
nécessité d’avoir des animaux de trait pour une meilleure production se serait imposée à eux
mais reconnaissent qu’il leur aurait été très difficile de les garder et d’en tirer un bon
rendement. La figure 40 montre l’évolution du nombre de paires d’animaux de trait
fonctionnelles de 1991 à 2001 dans la commune de Nikki.
98
010002000300040005000
1 2 3 4 5 6Années (de 1991 à 2001)
Nom
bre
de p
aire
s d'
anim
aux
de tr
ait
fonc
tionn
elle
s
Figure 41: Evolution du nombre de paires d’animaux de trait fonctionnelles dans la commune
de Nikki (source : CARDER BORGOU, 2002)
On constate une augmentation du nombre de paires d’animaux fonctionnelles dans la zone de
Nikki. La plupart des retenues d’hydraulique pastorale ayant été créées dans cette commune
entre 1988 et 1989, cette augmentation croissante du nombre d’animaux de trait dans la
commune pourrait avoir été influencée par la construction des retenues d’hydraulique
pastorale dans la région.
En proie à un manque crucial d’eau avant la construction des retenues, les agriculteurs
n’arrivaient pas à subvenir à tous leurs besoins en eau. La construction de nouvelles maisons
exigeant beaucoup d’eau, les agriculteurs se trouvaient alors dans l’incapacité d’en construire
d’autres.
Un autre avantage non négligeable de la construction de ces retenues est lié aux plantations de
fruitiers qui assurent aux propriétaires un revenu monétaire de l’ordre de 10.000 à 20.000
FCFA (à Sakabansi) à chaque saison en plus des produits autoconsommés.
IV-4-2-2- Sur les éleveurs En dehors des nombreux avantages tirés par leur bétail de la construction des retenues
d’hydraulique pastorale, les conditions de vie des communautés fulbé et gando ont été
nettement améliorées par la disponibilité permanente en eau de ces retenues.
Vivant généralement en dehors des agglomérations, les populations de ces communautés ont
difficilement accès aux sources d’approvisionnement en eau disponibles en saison sèche
(puits à grand diamètre, forages) dans cette région. Pour subvenir à leurs besoins, ces
populations creusaient des puisards dans les bas-fonds ou en aval de certains cours d’eau pour
recueillir de l’eau.
99
Depuis la construction des retenues d’hydraulique pastorale, les difficultés
d’approvisionnement en eau de ces communautés sont presque entièrement jugulées. La
figure 41 résume les différentes sources d’approvisionnement en eau de ces communautés.
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
Puits
Marigo
t
Puisard
/mare
Eau de
pluie
Barrag
e
Forage
Sources d'approvisionnement en eau
Fréq
uenc
e (%
) Saisonpluvieuse
Saison sèche
Figure 42: Différentes sources d’approvisionnement en eau des communautés fulbé et gando
de la région d’étude.
Si en saison pluvieuse, les principales sources d’approvisionnement en eau de cette
communauté sont respectivement les marigots (40%), l’eau de pluie recueillie (25%) et les
puits classiques creusés avec des moyens rudimentaires (20%), en saison sèche, on constate
que les retenues d’hydraulique pastorale sont la principale source d’approvisionnement en eau
des populations (47,62%) suivies des puisards/mares (26,19%).
Les différentes utilisations faites de l’eau de ces retenues d’hydraulique pastorale sont
résumées dans le tableau 26.
100
Tableau 26 : Tableau de synthèse des différentes utilisations faites de l’eau des retenues
d’hydraulique pastorale de la région d’étude.
Saisons Utilisations
Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou
Région
d'étude
Nm = 3 Nm = 6 Nm = 6 Nm = 4 Nm = 3 Nmt=22
n n n n n nt %
Saison
sèche
Boisson/Mets 2 2 2 - 2 8 25,81
Lessive/Vaisselle
/Toilette 2 6 6 4 3
21 67,74
Autres - - 2 - - 2 6,45
Saison
pluvieuse Les retenues sont peu fréquentées pendant cette période de l’année.
- -
Total 31 100
Légende
Nm = Nombre de ménages interviewés
Nmt = Nombre total de ménages interviewés dans la région d’étude
n = Nombre de ménages ayant cité une utilisation donnée
nt = Nombre de fois que l’utilisation a été citée dans la zone d’étude
L’analyse du tableau 26 révèle que 25,81% des populations fulbé et gando utilisent l’eau des
retenues d’hydraulique pastorale pour la consommation et la cuisson des aliments et 67,74%
l’utilisent pour toutes les autres activités domestiques.
La disponibilité permanente en eau, en améliorant les conditions d’élevage a également
contribué à sédentariser certains éleveurs.
Plusieurs facteurs expliquent ce changement de mode de vie. Si les nombreuses pertes
d’animaux (mort d’animaux, saisie par les agriculteurs, vols, etc.) enregistrées lors de la
transhumance, l’occupation constante des parcours et des couloirs de transhumance par les
cultures et les sanglants conflits avec les agriculteurs qui s’ensuivent sont autant de facteurs
qui limitent la pratique de la transhumance, la construction des retenues d’hydraulique
pastorale a contribué à accélérer la sédentarisation de certains éleveurs.
En conclusion, on peut retenir que les retenues d’hydraulique pastorale ont contribué à
améliorer les conditions de vie des éleveurs (disponibilité en eau pour les populations et le
bétail) et accéléré le processus de sédentarisation de ces derniers.
101
IV-4-2-3- Sur les femmes ménagères Les avantages tirés de la construction des retenues par les femmes proviennent de trois
sources : la disponibilité permanente en eau qui leur permet de s’approvisionner en eau à tout
moment de l’année, l’empoissonnement des retenues d’hydraulique pastorale et la mise en
place des maraîchages qui contribuent à l’autoconsommation et à l’augmentation des recettes
de saison sèche.
Au centre de toutes les activités domestiques, les femmes sont également responsables de
l’approvisionnement en eau des ménages. Le tableau 27 montre les principales sources
d’approvisionnement en eau des populations et surtout des communautés fulbé et gando au
cours de l’année.
Tableau 27 : Principales sources d’approvisionnement en eau des populations suivant les
saisons
Saisons Sources Populations (%) Fulbé et Gando (%)
Saison pluvieuse Marigot 27,45 40
Puits 26,47 20
Eau de pluie 22,55 25
Saison sèche Barrage 39,56 47,62
Forage 26,37 9,52
Puisard/mare 16,48 26,19
L’analyse du tableau 27 révèle trois principales sources d’approvisionnement en eau pendant
la saison des pluies dans la région dont la plus usitée sont les marigots (27,45% dans les
agglomérations et 40% dans les campements). Les autres sources d’approvisionnement en eau
sont les puits (26,47%) suivis de l’eau de pluie (22,55%) dans toutes les agglomérations et
l’inverse dans les campements (pluie : 25% et puits : 20%).
Trois principales sources d’approvisionnement en eau sont également utilisées en saison sèche
dont la plus importante et la plus utilisée sont les retenues d’hydraulique pastorale désignées
par barrages dans les localités (39,56% et 47,62% respectivement dans les agglomérations et
les campements). Viennent ensuite les forages (26,37%)et les puisards/mares (16,48%) (dans
les agglomérations) et l’inverse dans les campements (puisards/mares : 26,19% et forages :
9,52%).
Plusieurs utilisations sont faites de l’eau des retenues d’hydraulique pastorale. Elles vont de la
consommation et préparation des aliments (21,78) à la lessive/vaisselle/toilette (44,55%).
Contraintes de passer de longues journées aux puits ou aux forages avant la construction des
retenues, et parfois au prix de violentes disputes pour avoir une bassine ou un seau d’eau, les
102
conditions de vie des femmes se sont donc nettement améliorées depuis la construction des
retenues d’hydraulique pastorale. La photo 10 montre des femmes et des jeunes filles venues
faire la vaisselle et la lessive au bord de la retenue d’hydraulique pastorale de Sakabansi.
Photo 10: Femmes faisant la lessive au bord de la retenue d’eau de Sakabansi.
En plus de la satisfaction de problèmes d’approvisionnement en eau, les retenues d’eau
contribuent à l’amélioration des revenus monétaires des femmes.
Dans la plupart des localités, les femmes s’adonnent au maraîchage (Fombaoui, Ouroumon,
Ouénou), ce qui leur permet de disposer même en saison sèche de condiments et autres
produits maraîchers. En plus de la satisfaction des besoins alimentaires, la vente des récoltes
permet aux femmes d’augmenter leurs revenus monétaires. Même si ce revenu monétaire est
difficilement quantifiable, on peut estimer que le maraîchage permet aux femmes d’améliorer
leur niveau de vie.
Certaines femmes utilisent encore l’eau des retenues dans le processus de fabrication de
l’alcool local (sodabi et tchoukoutou). En effet, cette eau intervient à tous les niveaux du
processus, de la fermentation de la matière première au refroidissement du matériel
d’extraction.
Ainsi, de manière indirecte, l’eau des retenues permet aux femmes de fabriquer de l’alcool,
qui après vente leur assure un revenu monétaire.
Bien que la vente des poissons en saison sèche soit sous la responsabilité des comités de
barrages, cette activité permet aux femmes d’avoir également des revenus monétaires en
achetant puis en revendant les poissons par la suite.
En conclusion, on peut également dire que la création des retenues d’eau a non seulement
permis d’améliorer les conditions d’existence des femmes en réduisant de manière
considérable les difficultés et les contraintes qu’elles rencontraient dans la recherche d’eau
mais contribué aussi à augmenter leur niveau et leur condition de vie.
103
Il faut préciser ici que les recettes issues de la vente des produits maraîchers auraient pu être
meilleures si les femmes étaient mieux organisées et plus motivées.
En effet, certaines femmes estiment que la distance qui sépare les retenues d’eau de leurs
agglomérations (parfois 2 km) ne leur est pas favorable et ne leur permet pas de bien
entretenir et surtout de bien surveiller leurs maraîchages. D’autres estiment que ce sont les cas
de vol de produits de maraîchages qui constituent le principal obstacle à la mise en place des
maraîchages. Ces vols proviennent du fait que certaines femmes n’hésitent pas à aller cueillir
les légumes (fruits et feuilles) des voisines en leur absence, ce qui à terme finit par décourager
les victimes.
Bien que la création des retenues d’eau ait contribué à l’amélioration des conditions de vie des
femmes ménagères de la région, ces dernières ne jouissent pas assez des opportunités que leur
offrent ces retenues d’eau. Cela est principalement dû à une mauvaise organisation des
bénéficiaires et aux cas de vol des produits par certaines d’entre-elles.
Il est alors urgent de sensibiliser et de mieux organiser les femmes afin qu’elles puissent tirer
un meilleur profit des maraîchages qu’elles font.
IV-4-2-4- Sur la communauté villageoise Les avantages que la communauté villageoise tire des retenues d’eau peuvent être résumés en
deux points :
- Grande disponibilité de poissons en saison sèche qui permet aux populations de
s’approvisionner localement en poissons à bas prix,
- Recettes issues de la vente des poissons et des taxes ou ‘’droit d’abreuvement’’ perçus
auprès des éleveurs transhumants et/ou locaux qui permettent de financer certaines
activités d’utilité publique comme achat de matériels scolaires, construction de salles
de classe, réfection de voie, payement du pêcheur, entretien des retenues…
En effet, dans toutes les localités où les retenues d’hydraulique pastorale ont été créées, il a
été mis en place un comité de suivi appelé ‘’ comité barrage’’. Ce comité est composé
d’agriculteurs majoritairement, d’éleveurs et de quelques femmes et comptent onze (11)
membres dont un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire,
un secrétaire adjoint, deux organisateurs, deux commissaires au compte et un gardien de
retenue. Les attributions des ‘’comités barrages’’ sont nombreuses. Elles vont de l’entretien
des retenues à la vente des produits de pêche en passant par la surveillance des retenues et de
la bonne observance des règles d’hygiène pour éviter la souillure et la pollution de l’eau des
retenues, la perception des taxes ou ‘’droits d’abreuvement’’, l’aménagement des pistes
d’accès aux retenues d’eau pour le bétail, surveillance du périmètre de protection délimité
pour protéger et pérenniser les retenues …
104
La retenue d’eau est la propriété de toute la localité. A ce titre, nul n’a le droit d’aller y pêcher
à titre individuel. Chaque saison sèche, dès que l’eau de la retenue cesse de s’écouler par le
déversoir, un Soroko (pêcheur spécialisé d’origine nigérienne) vient dans la localité pour la
pêche. Pour 3 kg de poissons pêchés, le Soroko garde 1kg comme sa paye. En fin de journée,
on totalise le nombre de kilos de poissons pêchés et la part de poissons qui revient au Soroko.
Dans les faits, le Soroko ne garde pas sa part de poissons mais l’équivalent en FCFA. Le
poisson étant vendu à 500 FCFA/Kg en moyenne dans toutes ces localités, à la fin de la
campagne de pêche et après vente, on donne au Soroko son salaire proportionnellement à sa
part de poissons.
La quantité de poissons pêchés varie d’une retenue à l’autre et dépend d’un certain nombre de
paramètres. Le tableau 28 montre l’évolution de la prise de poissons et des recettes issues de
la vente de ces produits par localité et par saison.
Tableau 28 : Evolution de la prise de poissons et des recettes de pêche par saison et par
localité
Localités Recettes issues de la vente des poissons Bénéfices
nets * 1997 1998 1999 2000 2001
Sakabansi - - 149.000 35.000 55.000 45.000
Fombaoui 27.500 29.000 20.825 6.734 22.000 17.500
Sansi Pas de données 25.000
Ouroumon 18.000 14.500 Versements non faits 25.000
Ouénou Pas de données 25.000
* Les bénéfices ne sont fondés sur aucun calcul mais estimés par les membres du comité
barrage et concernent la saison 2001.
Source : Enquête socio-économique de cette présente étude et carnets d’épargne des comités
barrages
L’analyse du tableau 28 montre des recettes saisonnières relativement faible au niveau de
toutes les localités. C’est à Sakabansi que les recettes sont les plus élevées (55000 fcfa en
2001 pour un bénéfice net estimé à 45000 fcfa). Ces recettes saisonnières sont fonction de la
prise de poissons effectuée au cours de la saison. La différence de prise au niveau des retenues
s’explique par plusieurs facteurs dont les principaux sont :
- La taille de la retenue,
- Le niveau de comblement de la retenue
- les relations trophiques existant entre les animaux vivant dans le lac de la retenue
105
- Et enfin la compétence du ‘’Soroko’’.
Ainsi, les premières années après l’empoissonnement de la retenue de Sakabansi, les prises de
poissons seraient de l’ordre de 40 à 60 kg/jour. La faible prise observée ces dernières années
serait due aux dires des pêcheurs, à l’envasement de cette retenue. A Fombaoui, c’est
beaucoup plus la forte proportion des crocodiles présents dans cette retenue qui expliquerait la
faiblesse de la prise. Considérés comme les fétiches de la localité, les crocodiles mangeraient
autant ou plus de poissons que la quantité pêchée de l’avis des membres du comité barrage.
Partout ailleurs, le comblement progressif des retenues expliquerait cette décroissance de la
prise de poissons constatée.
On remarque de la même manière au niveau de toutes les localités, une tendance à la baisse
des recettes issues de la vente des poissons et par ricochet des bénéfices nets (recettes -
charges liées à la pêche et à la vente des poissons).
S’il est vrai que le comblement progressif de ces retenues d’eau ne permet plus les mêmes
prises de poissons au fil des années, il est à noter que les malversations, les escroqueries de
certains responsables de suivi de ces retenues et la mauvaise gestion des fonds sont à l’origine
de cette chute progressive des recettes. Il importe alors de mettre en place un système de suivi
des activités de pêche incluant tous les acteurs des Comités Barrages, de donner une
formation en gestion et contrôle de gestion à tous les acteurs des Comités Barrages et de
s’assurer que toutes les catégories socio-culturelles des localités sont représentées dans le
comité pour une meilleure gestion de ces points d’eau.
Grâce aux bénéfices tirés de la vente des poissons, plusieurs activités d’utilité publique sont
financées dans les localités.
A Sakabansi par exemple, ces bénéfices ont permis l’achat d’un microphone pour la mosquée,
le revêtement de la voie menant vers Fombaoui lors des campagnes cotonnières de 1999,
l’achat de matériels scolaires et didactiques (tables et bancs, boîtes de craie…), la construction
de salles de classe, le payement d’un instituteur vacataire, la fabrication d’une pirogue, etc.
Dans toutes les localités, on prélève dans la caisse pour faire face aux dépenses liées aux
travaux d’entretien des retenues d’eau, pour payer le Soroko, pour accueillir les responsables
des structures intervenant dans le domaine des retenues d’eau, …A Ouroumon, le Comité
Barrage a acheté des fils de fer barbelés et payé des manœuvres pour la fabrication d’une
clôture autour de la retenue d’eau. La clôture a pour objectif de forcer les animaux à n’avoir
qu’une seule voie d’accès à la retenue.
Mais il faut remarquer que les avantages financiers issus de cette activité de pêche auraient pu
être meilleures si les prises de poissons et les recettes issues de la vente de ces derniers étaient
mieux gérées (distribution de poissons aux agents superviseurs, aux ‘’responsables des
106
retenues d’hydraulique pastorale’’, recettes de pêche non versées dans les caisses d’épargne,
retraits de fonds et dépenses non justifiées par le président ou le trésorier du Comité Barrage,
etc.).
En dehors des activités de pêche, ce sont les taxes ou ‘’droits d’abreuvement’’ prélevées
auprès des agro-éleveurs, éleveurs transhumants et/ou locaux qui permettent aux Comités
Barrages d’augmenter leurs revenus monétaires. Le tableau 29 fait la synthèse des taux de
taxe prélevée au niveau de chaque retenue.
Tableau 29: Répartition des taxes d’abreuvement par retenue d’hydraulique pastorale
Retenues Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou
Eleveurs ou agro-
éleveurs locaux
0 FCFA 0 FCFA 0
FCFA
200 à 500
FCFA
200 à 500
FCFA
Eleveurs
transhumants
500
FCFA
500 à 2000
FCFA
0
FCFA
500 à 1000
FCFA
500
FCFA
Les taxes varient d’une localité à une autre et sont fixées par le Comité Barrage.
Ainsi, à Sakabansi, les transhumants payent 500FCFA/troupeau quel que soit le nombre de
têtes de bétails de celui-ci s’ils passent sans s’arrêter. Si les transhumants passent la journée
ou la nuit à la retenue, la taxe est doublée. Les éleveurs locaux ne sont soumis pour le moment
à aucune taxe.
A Fombaoui, la taxe est fixée suivant le nombre de têtes de bœufs que compte le troupeau
transhumant. Ainsi, selon que le troupeau est grand ou petit, les taxes varient de 500FCFA à
2000FCFA, le caractère grand ou petit étant apprécié par le gardien du barrage chargé du
recouvrement des taxes. Les éleveurs locaux ne payent pas de taxe.
A Sansi, aucune taxe n’est recouvrée selon les membres du Comité Barrage justifiant que le
Comité Barrage n’a été mis en place que l’année passée.
A Ouroumon, les taxes varient en fonction de l’origine des éleveurs et du nombre de bêtes
qu’ils possèdent.
Ainsi, les transhumants payent 500FCFA pour les troupeaux d’au plus cent têtes de bovins, et
1000FCFA pour les troupeaux de plus de cent têtes de bovins. Les éleveurs locaux payent
200FCFA pour les troupeaux d’au plus soixante têtes de bovins, 300FCFA pour les troupeaux
dont le nombre de têtes de bovins est compris entre trente et cent et 500FCFA pour les
troupeaux dont le nombre de têtes de bovins est supérieur ou égal à cent.
A Ouénou, les agro-éleveurs payent 200FCFA pour abreuver leurs animaux de trait. Les
éleveurs, qu’ils soient locaux ou transhumants payent 500FCFA indépendamment du nombre
de têtes de bovins de leurs troupeaux.
107
Au total, on constate que les revenus monétaires du Comité Barrage représentant la
communauté villageoise proviennent essentiellement de deux sources que sont la vente de
poissons et la collecte de taxes d’abreuvement auprès des éleveurs (transhumants surtout) et
parfois des agro-éleveurs.
Un autre avantage non moins important pour les communautés est l’exploitation des
ressources végétales avoisinant les retenues d’eau aussi bien pour les besoins alimentaires que
de médication.
En effet, plusieurs maladies humaines et animales sont traitées traditionnellement grâce à
certaines espèces végétales rencontrées dans le périmètre de protection des bassins versants.
Les espèces les plus exploitées sont fonction des maladies qui sévissent les plus dans les
localités. Ce sont notamment les feuilles de banane utilisées contre le paludisme, les écorces
de Khaya senegalensis (Kahi) utilisées contre la dysenterie et l’hémorrhoïde
interne/aspergillus, les écorces de Vitellaria paradoxa (Kaarehi), de Parkia biglobosa
(Nareeri) et de Detarium microcarpum (Konkehi) utilisées contre l’hémorrhoïde
interne/aspergillus, les racines de Terminalia avicennioides (Tiggerehi) utilisées également
dans la lutte contre l’hémorrhoïde…pour la pharmacopée ; combinaison de feuilles de tabac,
de tiges de Gardenia aqualla (Digaali gorel) et de racines de Borassus aethiopum (Doubbi)
dans la lutte contre la Trypanosomiase bovine, combinaison de feuilles tendres de Piliostigma
thonningii (Barkehi), de tiges de mil et de sabot d’âne contre la Fièvre aphteuse, combinaison
de feuilles de Anogeissus leiocarpa (Agbangahi) et Cussonia arborea (Alan-beelouhi) et de
cadavres de lièvres et/ou singe dans la lutte contre la Brucellose, écorces de Daniellia oliveri
(Kallahi), de Parkia biglobosa (Nareeri), de Vitellaria paradoxa (Kaarehi) et de Ficus
capensis (Ibbi ou Rimata-betchehi) dans la lutte contre la Pasteurellose bovine. Sauf la fièvre
aphteuse dont le traitement ici est préventif, les autres combinaisons sont à titre curatif.
Plusieurs autres herbacées sont utilisées aussi bien pour soigner les hommes que les animaux.
Les autres utilisations faites des ressources forestières de cette zone sont la cueillette et le
ramassage des gousses/noix ou fruits pour l’autoconsommation (surtout karité qui constitue
souvent une bonne source de revenus monétaires pour les femmes), la petite chasse (petits
mammifères, oiseaux, etc.) et l’utilisation des branches de Anogeissus leiocarpa dans toutes
les localités pour clôturer les champs afin de les protéger des bêtes en divagation etc.
En conclusion, nous retiendrons que la construction des retenues d’hydraulique pastorale a eu
des impacts positifs sur les conditions de vie de toutes les couches socio-professionnelles des
localités où ces points d’eau permanents sont installés (éleveurs, agro-éleveurs, agriculteurs,
femmes ménagères, communauté, etc.).
108
En effet, la disponibilité permanente en eau rendue possible par la construction des retenues
d’eau contribue à renforcer le processus de sédentarisation des éleveurs et agro-éleveurs de la
région d’étude et à améliorer les conditions de production (culture attelée) des agro-éleveurs
et agriculteurs. De façon générale, des revenus monétaires sont tirés des retenues d’eau par les
populations riveraines. Ils proviennent pour la plupart des taxes d’abreuvement prélevés par
les comités barrages auprès des éleveurs (transhumants et locaux), du maraîchage, de la vente
des poissons et même des plantations.
110
V- DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS
1- Faut-il continuer à promouvoir la construction des retenues d’hydraulique pastorale malgré les nombreux impacts négatifs qu’elles occasionnent sur l’environnement ?
Pour essayer de répondre à cette interrogation, nous partirons des résultats d’étude de
quelques auteurs qui ont travaillé autour de certains points d’abreuvement permanents et de
l’hypothèse que moins il y a de points d’eau permanents dans un espace agropastoral et plus
grande est la pression qu’il subit de même que chaque point d’eau.
Dans toutes les régions ne disposant que d’un nombre très limité ou d’un seul point d’eau
permanent, on assiste à une convergence de tous les troupeaux de la région et des régions
environnantes vers le point d’eau avec tous les dégâts que ces déplacements occasionnent sur
tout le parcours et surtout aux environs immédiats de celui-ci. Les dégâts occasionnés sont
multiples mais les plus visibles vont des intenses piétinements observés aux abords des points
d’eau à la dégradation des pâturages environnants. Selon Peyre de Fabrègues cité par Serres
(1980), lorsque les animaux se rassemblent nombreux au pied des arbustes pour brouter les
feuilles et tout simplement pour se mettre à l’ombre, ils affouillent le sol par leur piétinement
et ébranlent l’arbuste en se grattant contre le tronc de sorte que l’arbuste ne tarde pas à tomber
surtout s’il s’agit d’animaux lourds. Sinsin (1993), après une étude dans le Borgou-Est
remarque que l’impact du passage des troupeaux transhumants en provenance du Niger et du
Nigéria (bovins zébus) est très remarquable au niveau de la strate herbacée. Une fois le
pâturage surexploité et piétiné, il ne reste plus rien et ces transhumants décampent pour
d’autres pâturages. Pour Boudet cité par Serres (1980), lorsque plusieurs milliers d’animaux
séjournent à proximité d’un point d’eau, les espèces appétées sont tondues à un rythme
accéléré qui épuisent leur possibilité de grenaison et donc de régénération. Cette situation est
aggravée selon Geny et al. (1992) par le manque de diversité des herbivores qui encourage la
prolifération sélective d’espèces végétales non désirables, parce que non consommées et la
disparition progressive des espèces les plus recherchées par le bétail. Cette dégradation est
encore plus accentuée dans les milieux sahéliens ne disposant que d’un point d’eau unique où
tous les animaux de la région se concentrent en saison sèche. Après une étude dans le Sahel,
le Houérou (1986) affirme que le surpâturage à joué un rôle majeur dans la raréfaction de
Acacia seyal et A. senegal dans certaines zones du Sahel et Kuchar (1986) constate que ce
déclin est particulièrement marqué dans un rayon de 20 km autour des points d’eau.
Travaillant dans une région moins sèche, Meurer (1991) constate que la concentration de
111
charge animale est mise en évidence si on trace autour des points d´eau des cercles avec un
rayon de 10 km, ce qui correspond à la distance de déplacements journaliers du bétail.
Dans le cas particulier de notre zone d’étude, plusieurs impacts ont été relevés aussi bien au
plan physiquo-environnemental qu’au plan socio-économique.
Au plan physique, les impacts ont été principalement observés sur le sol et la flore.
Globalement, on assiste à une dégradation des sols par ameublissement de la couche
superficielle puis par érosion dès les premières pluies et des phytocénoses environnant du fait
des intenses piétinements d´une part et de la pression sur les pâturages engendrée par les
grands rassemblements de troupeaux autour des points d´eau surtout en saison sèche d’autre
part. Cette dégradation est accentuée par les troupeaux transhumants transfrontaliers qui
traversent cette région pendant la saison sèche.
Bien qu’il nous soit difficile de prouver scientifiquement la responsabilité de la forte
utilisation de l’eau des retenues d´hydraulique pastorale sur la santé des populations
riveraines, il apparaît très clairement que certaines maladies pourraient être causées par l’eau
polluée des retenues. Selon le rapport de la FAO (1993), la qualité de l´eau est directement
liée à la fréquence des maladies humaines, notamment les troubles gastro-intestinaux qui
affectent directement la capacité des sujets d’assimiler les aliments et donc leur état
nutritionnel. Dans la zone d’étude, plusieurs maladies susceptibles d´être causées par l´eau
des retenues ont été répertoriées. Elles vont des gastro-entérites aux maladies urinaires et
dermiques en passant par des maladies parasitaires intestinales. Plusieurs éléments participent
à l´altération de la qualité de l’eau parmi lesquels les particules de sol arrachées par les
intenses piétinements et transportées sous forme d’alluvions dans les lacs de retenue, les fèces
et les urines laissées par les animaux aux abords et dans les lacs de retenue lors de
l´abreuvement, les déchets d´origine anthropique, etc.
Au regard de tous ces impacts négatifs, ne vaudrait-il pas mieux arrêter la construction des
retenues d´hydraulique pastorale?
Dans tous les pays, les aménagements sont faits par l’homme et pour l’homme. L’opportunité
de créer des retenues d’hydraulique pastorale dans un milieu est fonction des difficultés qu´on
y rencontre et des opportunités qu’elles offrent. Une retenue d´hydraulique pastorale sur une
île serait inopportune mais d´une haute importance dans le Sahel ou dans un milieu doté de
cours d´eau temporaires.
En dépit des effets négatifs ci-dessus énumérés, les nombreux avantages que procurent les
retenues d´hydraulique pastorale aux populations riveraines et aux phytocénoses
environnantes sont à prendre en considération.
112
Au plan physiquo-environnemental, contrairement à la dynamique de l’occupation du sol dans
la région de Nikki-Est qui montre une régression de la plupart des formations végétales au
profit des cultures et jachères, on remarque en lieu et place des anciens sites exploités dans le
bassin versant et autour des retenues d’hydraulique pastorale, une reconstitution des
formations préexistantes (savanes, forêts galeries, etc.).
Les relevés phytosociologiques effectués dans les forêts galeries et les phytocénoses
environnant les retenues d´hydraulique pastorale ont permis d´identifier quatre sous-
groupements : le sous-groupement à Allophyllus africanus et Acacia ataxacantha,
caractéristique de la retenue de Ouénou, le sous-groupement à Anogeissus leiocarpus et
Zanha golungensis, caractéristique de la retenue de Ouroumon, le sous-groupement à
Anogeissus leiocarpa et Acacia ataxacantha, caractéristique de la retenue de Sakabansi et le
sous-groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata, caractéristique des
retenues de Fombaoui et Sansi. Tous ces groupements sont caracterisés par indices de
diversité de Shannon faibles et des coefficients d’équitabilité de Pielou élevés. Ces valeurs
traduisent d’une part des conditions de milieu instables, défavorables à la diversification des
espèces végétales qui y vivent et d’autre part la mise en place d’un peuplement équilibré
(DAJOZ, 1985).
Mais nous focaliserons notre attention sur le fait qu´une multiplication de retenues
d’hydraulique pastorale dans un espace agropastoral contribuera à la dilution de ses effets
néfastes dans l´environnement.
Il est évident que si les sites des retenues sont bien choisis, les impacts négatifs seront réduits
de manière sensible. Une bonne répartition des retenues d´hydraulique pastorale est un moyen
efficace de gestion de l´espace agropastoral.
En effet, dans un espace agropastoral doté d´un unique point d´abreuvement, la construction
de n retenues d´hydraulique pastorale, en réduisant l’aire d’influence du point d´eau,
contribue à réduire la pression exercée sur celui-ci de n fois si les retenues sont équitablement
réparties dans l´espace. Cette dispersion des effets négatifs dans l´espace permet de mieux
gérer les ressources disponibles en exploitant ces ressources sur un long temps et en
contrôlant mieux les effets négatifs résultant d´une telle exploitation. De ce point de vue, on
peut estimer que la construction des retenues d´hydraulique pastorale est très utile.
Au total, la construction des retenues d´hydraulique pastorale comme tout aménagement
présente des aspects négatifs sur l´environnement. Mais l´aménagement est fait par l´homme
et pour satisfaire les besoins de l´homme à court, moyen et/ou long terme. Il importe alors
dans la mise en œuvre et le suivi de tout aménagement, de prendre en compte toutes les
mesures de protection pour réduire au maximum les effets néfastes qui pourraient être
113
engendrés par l’ouvrage depuis son exécution jusqu´à son fonctionnement. Plusieurs
recommandations sont donc à faire pour une mise en œuvre et une gestion efficace des
retenues d´hydraulique pastorale.
- Avant la construction de l’ouvrage :
1- Bien cibler le site en s´assurant que l´ouvrage se situera en amont des campements
afin de réduire les risques de dégradation de sol et d´envasement de la retenue d´une
part et la pollution de l’eau de ces retenues par le transport des alluvions et autres
déchets zoologique et anthropique vers le cours d´eau ou le lac de la retenue.
2- Pour les animaux qui viendraient à la retenue en traversant le bassin versant du cours
d´eau barré, il importe de prévoir des couloirs de passage pour minimiser les
piétinements sur le bassin versant et les conséquences qu´ils engendrent.
3- Principaux utilisateurs des retenues d´hydraulique pastorale, les éleveurs et agro-
éleveurs seront sensibilisés sur la nécessite de respecter les mesures de protection du
bassin versant et de l´ouvrage. On devra insister sur les conséquences du non-respect
de ces précautions.
- Après la création de l´ouvrage :
1. Sensibiliser et former les populations sur le traitement des eaux des retenues
avant usage.
2. Mobiliser des équipes vétérinaires durant toute la période de transhumance
prioritairement aux points d’abreuvement pour un meilleur suivi sanitaire du
cheptel.
3. Nettoyer les abords des lacs de retenue en coupant les arbres ou arbustes
susceptibles de nuire à la perrénité de la digue pour éviter la rupture du plan
d’eau à chaque fin de saison sèche.
4. Organiser une formation en gestion et contrôle de gestion à l’intention des
Comités Barrages.
5. S’assurer que toutes les couches socioculturelles sont représentées au sein du
Comité Barrage pour une meilleure participation dans la gestion des ouvrages.
6. Encourager les autorités communales à faire le suivi-évaluation des activités
d’entretien des retenues et de la gestion des fonds issus du fonctionnement des
retenues d’eau à la fin de chaque saison.
7. Pour motiver les membres des Comités Barrages, leur allouer des ristournes
calculées au prorata des recettes saisonnières et stimuler la concurrence entre
114
membres de Comités Barrages en organisant des séances de restitution des
activités de fonctionnement de chaque Comité Barrage à l’occasion de
réjouissances populaires à la fin de chaque saison sèche.
8. Renforcer les politiques de vaccination transfrontalières en début de saison
sèche pour minimiser les risques d´épidémies au niveau du cheptel de la
région.
Ces activités orientées vers un meilleur fonctionnement des Comités Barrages, une meilleure
participation des communautés à la gestion des ouvrages d´utilité publique ou vers une
gestion efficace et efficiente des retenues d´hydraulique pastorale pourraient être considérées
comme des objectifs à atteindre dans le cadre d´un projet de gestion des ressources pastorales.
2- La construction des retenues d’hydraulique pastorale a t-elle réellement contribué à la sédentarisation des éleveurs de la zone d’étude ? On a souvent justifié la transhumance des éleveurs par le manque de point d’abreuvement et
de pâturage. Mais dans la zone d’étude, nous continuons à observer quelques flux de
transhumants malgré la disponibilité de l’eau d’abreuvement. Plusieurs raisons sont avancées
mais elles varient d’une classe d’âge à l’autre.
En effet, lors de nos enquêtes, à la question de savoir pourquoi malgré l’existence des
retenues d’eau les éleveurs continuent à aller en transhumance, deux sortes de réponses ont
été données. Pour les jeunes, le manque de pâturage et les feux de végétation qui détruisent
les graminées sont les causes de leur départ en transhumance. Pour les vieux, le manque de
pâturage est un prétexte car les retenues assurant une disponibilité permanente de l’eau, les
animaux n’auraient pas trop de difficulté à atteindre la bonne saison avec les pâturages des
environs. Pour eux, la transhumance ne rend service qu’aux jeunes qui vont en transhumance
car ils en profitent pour vendre quelques bœufs afin de se livrer à des parties de plaisirs
(alcool, tabac, femmes…). Ils déplorent le fait qu’il revient au bercail toujours moins de têtes
de bétail qu’au départ.
Au total, il faut retenir qu’au-delà de la recherche de pâturage ou d’eau, la transhumance est
un fait culturel que les jeunes qui vont en transhumance ne sont pas prêts d’abandonner. En
effet, ces transhumances représentent pour eux des occasions uniques de s’initier à la gestion
du troupeau, de soi et de sa famille. Ce sont aussi des occasions pour ces jeunes de s’évader,
de se défouler, de faire des rencontres, de s’affirmer et surtout d’échapper à l’autorité des
parents. Remarquons cependant que le processus de sédentarisation des éleveurs se renforce au fil des
années du fait de la construction des retenues d’hydraulique pastorale, des pertes d’animaux
115
constatées au retour de la transhumance et surtout des violents et sanglants conflits qui les
opposent aux agriculteurs. Ce processus de sédentarisation croissant s’exprime de nos jours
par le nombre réduit des éleveurs allant en transhumance et surtout par l’importance de
l’agriculture commerciale dans ce milieu. Commencée comme production alimentaire
d’autosuffisance, l’agriculture commerciale (coton surtout) gagne d’ampleur de nos jours dans
les campements et est surtout pratiquée par les jeunes, soucieux d’augmenter leurs revenus
monétaires afin de s’assurer une autonomie financière vis-à-vis des parents et de se sentir plus
indépendants. Il s’ensuit une disparition progressive de l’autorité parentale et surtout des
valeurs et mœurs authentiquement fulbées.
117
CONCLUSION Caractérisée par des cours d´eau temporaires qui s´assèchent en saison sèche, la zone d’étude
était confrontée à un grave problème de déficit d'eau. Pour faire face à ce problème et surtout
au problème d'abreuvement, plusieurs retenues d'hydraulique pastorale ont été mises en
œuvre. Comme tout aménagement, la construction de ces retenues d’hydraulique pastorale a
eu des impacts sur l’environnement.
Au plan physique, si la construction des retenues d’hydraulique pastorale a contribué à la
conservation et à la diversification des ressources biologiques (faune et flore environnants) de
la région d’étude, de nombreuses dégradations occasionnées par les intenses piétinements des
troupeaux ont été observées sur le sol et les phytocénoses environnantes surtout.
Au plan socio-économique, les avantages observés vont de l’amélioration des conditions de
vie des populations (disponibilité permanente en eau) à l’augmentation de leur niveau de vie à
travers l’amélioration de leurs revenus monétaires ( augmentation des superficies cultivées
grâce à la culture attelée, vente de poissons, de produits de plantations, de maraîchage,
prélèvement des taxes d’abreuvement). La disponibilité en eau d’abreuvement et les
phytocénoses environnantes ont également contribué au renforcement du processus de
sédentarisation des éleveurs déjà en cours dans le département. Cependant, la forte utilisation
de l’eau des retenues pourrait être à l’origine des gastro-entérites, des maladies parasitaires
intestinales, dermiques et urinaires observées parmi les populations riveraines. Certaines
maladies contagieuses bovines ont également pu être contractées au niveau des retenues
d’hydraulique pastorale.
En dépit de ces impacts sur l’environnement, il apparaît urgent de continuer la politique de
construction des retenues d’hydraulique pastorale pour deux principales raisons. D’une part,
elles contribuent au développement de l’élevage qui demeure encore un secteur sous-exploité
malgré les énormes potentialités qu’il offre, et d’autre part, elles apparaissent comme un
puissant moyen de gestion de l’espace agropastoral si les sites sont bien choisis et les mesures
de protection du bassin versant et de l’ouvrage bien respectées. Pour ce faire, il importe
d’impliquer la population dans la gestion des ouvrages car, si les questions d’organisation, de
formation et de représentativité des usagers dans une structure compétente, responsable et
motivée, ne sont pas préalablement étudiées et résolues, on peut être assuré que la
construction ou la réhabilitation des ouvrages d’intérêt public se fera, non seulement à fonds
perdus, mais aussi que leur durée de vie sera assez courte. Car en définitive, les communautés
ne s’approprient que ce qu’elles ont aidé à concevoir et à mettre en œuvre.
118
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AGONYISSA, D. 1997 : Etude d’impact environnemental des actions du PDPA III.
Laboratoire d’Ecologie Appliquée, FSA/UAC. Cotonou, Bénin, 29 p.
AKINDELE, S. 2000 : Possibilités d’aménagement durable de la Forêt Classée de
l’Alibori Supérieur : Structure et dynamique des principaux groupements végétaux et
périodicité d’exploitation. Thèse d’Ingénieur Agronome des eaux, forêts et chasse.
FSA/UNB, Bénin. Nbre de page
AZONTONDE, H..A. 1988 : Conservation des sols et des eaux en République
Populaire du Bénin. Bilan des actions passées, perspectives. CENAP / INRAB,
Cotonou, Bénin, 50p
BABIO, O.Z. 2000 : Conséquences non désirables des aménagements hydro-
pastoraux : Enquête sur la Schistosomiase bovine et humaine dans les développements
du Borgou et de l’Alibori. Communication sur la gestion efficiente des ressources en
eau dans le bassin versant de l’Ouémé. PADEB, Parabou, Bénin, 5p.
BAWA, R 1997 : Enjeux, acteurs et mécanismes du pastoralisme dans le Nord-Bénin :
étude de cas du village de Sikki, sous-préfecture de Sinendé dans le département du
Borgou. Thèse d’Ingénieur Agronome. FSA/UNB, Bénin. 134p.
BIAOU, G. 1996 : Pouvoir local et gestion des ressources naturelles au Bénin.
Cotonou, Bénin, 8p.
BOGAARD, V.D. 1984 : Les processus de transformations chez les Peulh et les
agriculteurs dans le Nord -Borgou. Fac. Sc. Agron. , Univ. Nat. Cotonou, BENIN.
Direction de l´elevage, 1994 : Definition d´une strategie et d´un plan d´actions pour le
sous-secteur de l´elevage. Rapport principal, volume 1, Cotonou. 95p.
Direction de l’élevage, 1994 : Définition d’une stratégie et d’un plan d’actions pour le
sous-secteur de l’élevage. Rapport principal, volume 1, Cotonou. 95p.
DONIS, C. 1948 : Essai d’économie forestière au Mayumbe. Publications de l’Institut
National pour l’Etude Agronomique du Congo Belge (INEAC). Série Scientifique n°
37.
FAO/FENU, 1989 : Projet de Développement de l’Elevage dans le Borgou-Est.
Rapport de formulation. Représentation F.A.O, Cotonou, Bénin, 46p.
GADO, M. ; VERSTEGEN, A. et CHABI, M., 1990 : Contribution à l’étude des
Bassins Versants des retenues d’eau dans les sous-préfectures de Nikki et Kalalé.
119
Travail exécuté pour le compte du projet Développement Pastoral Intégré dans le
Borgou. PNUD/FAO/BEN 84/011, Parakou. 41 p.
GANGLO, J.C. 1999 : Phytosociologie de la végétation naturelle de sous-bois,
écologie et productivité des plantations de teck (Tectona grandis L.f.) du Sud et du
Centre Bénin. Thèse présentée pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences
Agronomiques. Université Libre de Bruxelles. 366p.
GAOUE, O.G. 2000 : Facteurs déterminants pour le zonage de la Zone Cynégétique
de la Pendjari comme base de gestion intégrée. Thèse d’Ingénieur Agronome.
FSA/UNB, Bénin. 106p.
GENY, P. ; WAECHTER, P. et YATCHINOVSKY 1992 : Environnement et
développement rural. Editions Frison-Roche. Paris, 355 p.
ISSA MAMA, S. 2001 : Etude d’Impact sur l’Environnement. Cours de Maîtrise
spécialisée. Cotonou, 41 p.
KADADJI, K.; OGODJAN, J. O.; SWINDEREN, H. V. et GADO, M. 1992 :
Evaluation de la disponibilite et de l´exploitation fourragere des residus de recolte
dans l´Est du Borgou. Travail execute pour le compte du Projet de Developpement de
l´Elevage dans le Borgou-Est, Parakou. 43p.
KREIS, M. 1988 : Contribution à l’étude agropastorale de la province du Borgou :
District de Kalalé et Nikki (République Populaire du Bénin ). Travail de fin d’études
présenté en vue de l’obtention du grade d’Ingénieur Agronome, Université Libre de
Belgique. 165p.
de SOUZA, S. 1988 : Flore du Benin. Noms des plantes dans les langues nationales
Beninoises. Tome 3, Cotonou. 424p.
Universite d´Amsterdam/Universite Nationale du Benin/Commission des
Communautes Europeennes : Rapports entre agriculteurs et eleveurs au Nord Benin :
Ecologie et interdependance transformee. Tome I, Rapport principal. 207p.
OCDE/CILSS/Club du Sahel, 1986 : Analyse des conditions de l´elevage et
propositions de politiques et de programmes. Burkina Faso, 202p.
PDPA, 1993: Document preparatoire pour l´evaluation a mi-parcours du PDPA.
Direction de l´elevage, Ministere du Developpement Rural, Cotonou. 49p.
HOUINATO, M. 1996 : Amenagement Agropastoral de la Zone riveraine de la
Reserve de la Biosphere de la Pendjari. Rapport principal, MAB-UNESCO, Cotonou.
54p.
120
ONIBON, P. et ADANDEDJAN, Cl. 1990 : Transhumance du betail dans le Zou.
Travail execute pour le compte du projet ``Promotion de l´Elevage et preparation
d´actions integrees dans le Zou. 35p.
MEHU 1992 : Plan d’Action Environnemental au Bénin. MEHU, Cotonou, Bénin,
116p.
MEURER, M. 1991 : Rapport final de l’étude sur les potentialités pastorales. Phase II
(1989-1990). Travail exécuté pour le compte du projet Bénino-Allemand ‘’ Promotion
de l’Elevage dans l’Atacora’’. Institut für Geographie und Geoökologie/Universitat
Karlsruhe (RFA). GTZ/BMZ. 311P.
Ministère du Développement Rural 2000 : Mise en place du système de suivi
évaluation du Projet de Développement de l’Elevage. Projet de Développement de
l’élevage - phase III. MDR, Cotonou, Bénin, 20 p.
OLOULOTAN, S. 1988 : Etude des pâturages naturels du nord-Bénin : Périmètre
Nikki-Kalalé. Mémoire d’Ingénieur Agronome. Univ. Nat. Bénin. Fac. Sc. Agron.
Cotonou, Bénin.
PADEB, 2000 : Rapport annuel 1999 de la direction de l’élevage. PADEB Nikki.
PNUD / FAO (BEN / 77 / 011 ), 1979 : La végétation du Parc National de la Pendjari
et des régions avoisinantes. Rapport préparé pour le gouvernement de la république
populaire du Bénin. Cotonou, Bénin, 87p.
Projet de Développement de l’Elevage dans le Borgou-Est (P.D.E.B.E), 1991 :
Rapport de synthèse. Assistance Technique Consulint. Direction de l’Elevage /
Ministère de Développement Rural. Bénin, 52p.
Projet de Développement de l’Elevage dans le Borgou-Est (P.D.E.B.E), 1993 : Dossier
technique de construction de retenue d’eau. Sansi. Service du Génie Rural du PDEBE.
Direction de l’Elevage / Ministère de Développement Rural. Bénin, 8p.
Projet de Développement Elevage Bovin dans le Borgou (PDEBB), 1991 : Rapport de
synthèse Assistance Technique Consulint, Parakou. 24p.
Projet de Développement Elevage Bovin dans le Borgou (PDEBB), 1991 : Réunion
d’Examen Tripartite finale du projet, Cotonou. 12p.
Projet Développement Pastoral Intégré dans le Borgou (P.D.P.I.B), 1990 :
Contribution à l’étude des Bassins Versants des retenues d’eau dans les sous-
préfectures de Nikki et Kalalé. Direction de l’Elevage et des Industries Animales /
Ministère de Développement Rural. Bénin, 41p.
SEAPA/DPAA-FSA, 1989 : Etudes agrostologique et bromatologique. Périmètre
Nikki-Kalalé- Ségbana. Rapport final. Bénin, 181 p.
121
SIDI, L. 1996 : Etude des facteurs pastoraux dans les zones d’actions prioritaires.
Rapport principal. Projet de Restauration des Ressources Forestières dans la région de
Bassila. DE /MDR / Cotonou, Bénin, 46p.
SINSIN, B ; AHANCHEDE, A ; KREIS, M. et HEYMANS, J.C. 1987 : Etude des
pâturages naturels du Borgou. Périmètre Nikki – Kalalé – Ségbana. Bibliothèque
SEAPA/FSA/UNB Cotonou – Bénin, 189P.
SINSIN, B. ; OLOULOTAN, S. et OUMOROU, M. 1989 : Les pâturages de saison
sèche de la zone soudanienne du Nord-Est du Bénin. Revue Elev. Méd. Vét. Pays trop.
SINSIN, B. 1996 : Ecosystème et diversité biologique. Série, notes du Laboratoire
d’Ecologie Appliqué.
SINSIN, B. 1997 : Etude d’impact environnemental des actions du PDE III. Document
de synthèse. PDE / DE / MDR. Cotonou, Bénin, 59 p.
SINSIN, B. et ZANNOU, A. 1995 : Possibilités et contraintes au développement des
élevages pastoraux : considérations socio-économiques, institutionnelles et
environnementales au cas du Bénin. Cotonou, Bénin.
SINSIN, B. ; AHANCHEDE, A. et KREIS, M. 1988 : Etude des pâturages naturels du
Borgou : périmètre Nikki-Kalalé-Ségbana. Travail exécuté pour le compte du projet
‘’Développement Pastoral Intégré du Borgou’’, Parakou. 89p.
SOGBOHOSSOU, E. 2000 : L’élevage des bovins autour des aires protégées et son
impact sur la faune sauvage et son habitat : cas de la Zone Cynégétique de la Pendjari
au Bénin. Thèse d’Ingénieur Agronome. FSA/UNB, Bénin. 99p.
TCHABI, I. V.1986 : Etude préliminaire sur l’écologie et les ressources pastorales de
la zone d’exploitation contrôlée de gibier (Z.E.C.G) de la Pendjari au Bénin. Mémoire.
Montpellier III, 79P.
UICN/PNUE/WWF, 1980 : Stratégie mondiale de la conservation. UICN, Suisse, 37p.
Van den BOGAARD, H 1984 : Les processus de transformation chez les Peulhs et les
agriculteurs du Nord Borgou de la République Populaire du Bénin. Wageningen, Pays
Bas. 79p.
VLAAR, J.C.J.(Ed) 1992 : Les techniques de conservation des eaux et des sols dans
les pays du Sahel. Université Agronomique Wageningen (UAW), Pays-Bas, 99p.
WOTTO, J. 1982 : Contribution à l’étude de la Brucellose bovine dans la province du
Zou. Mémoire de fin d’étude en Production Animale. CPU/UNB, Bénin. 56p.
Projet d´Appui au Developpement Local (PADEL), 1998 : Etude socio-economique et
Financiere. Ville de Nikki.SERHAU-SEM, Cotonou. 56p.
122
PNUD/FAO, 1979 : Développement des parcs nationaux. La végétation du parc
national de la Pendjari et des régions avoisinantes. Document de travail No 8, version
non officiel. Cotonou, 87p.
HOUNGUE, S. G. 2001: Phytosociologie et bilan fourrager des parcours naturels
soudano-guinéens: Cas de la ferme d’élevage de l’Okpara en République du Bénin.
Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur des Travaux (DIT).
CPU/UNB, Bénin, 155p.
124
ANNEXE 1 : Quelques informations sur les maladies animales rencontrées dans notre zone d’étude.
1- Trypanosomiase bovine C’est une maladie parasitaire liée à l’environnement. Elle est contractée par l’intermédiaire
d’un vecteur appelé glossine ou mouche tsé-tsé qui a son habitat naturel dans les zones de
forêt-galerie. Elle se manifeste par un amaigrissement croissant de l’animal qui pourtant paraît
être en bonne santé puisqu’il se déplace et va même au pâturage, par le poil piqué et par une
hypertrophie ganglionnaire (prise de volume au niveau des ganglions) lorsque la maladie
s’accentue.
Il n’existe pas de vaccin spécifique contre cette maladie. Les moyens de lutte disponibles sont
essentiellement à base d’antibiotiques (Trypanocides) comme le Veriben, le Berenyl et le
Trypamidium.
2- Pasteurellose bovine Maladie dont les germes se trouvent au sol, la Pasteurellose bovine est causée par
consommation des œufs de Pasteurellas lors du broutage (pâturage). La maladie se caractérise
par une respiration accélérée, un manque d’appétit, une diarrhée, des larmoiements et jetage
(écoulement d’une substance visqueuse des narines et/ou de la bouche de l’animal malade).
C’est une maladie très dangereuse qui occasionne une forte mortalité des troupeaux atteints.
Les moyens de lutte disponibles contre cette maladie sont en traitement préventif, un vaccin
appelé Pasteurellox et en traitement curatif, des antibiotiques comme l’Oxycline PE,
l’Oxytétracycline (5%, 10%, 15% et 20%) et Sulfa 33.
3- Péri-Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) C’est une maladie très contagieuse qui décime beaucoup de troupeaux.
4- Fièvre aphteuse C’est une maladie virale qui frappe tous les animaux domestiques mais surtout les bovins.
Très contagieuse, elle se manifeste par des lésions buccales, par des ulcérations douloureuses
sur la langue qui empêchent l’animal de manger, par des aphtes (plaies) entre les sabots qui
empêchent l’animal de se déplacer. Elle est très redoutée parce que très contagieuse et surtout
parce qu’il n’existe aucun vaccin contre cette maladie.
Pour cette maladie, il n’existe pas de vaccin spécifique, seul un traitement par antibiotiques
(Péniprocaïne) et des désinfectants comme l’Alun et le bleu de méthylène permettent de
soigner les animaux malades.
125
5- Brucellose La Brucellose bovine est responsable d’une grande morbidité, d’avortement épizootique et
d’une incapacité de travail chez l’homme. L’agent causal est du genre Brucella qui comporte
six espèces dont Brucella melitansis qui transmet la maladie aux bovins, ovins, caprins et
l’homme et Brucella abortus qui provoque l’avortement épizotique des bovins et infecte
l’homme. Sa prévalence serait de l’ordre de 23 à 25% dans le Borgou. (source : PADEB)
Le contact des animaux infectés avec les animaux sains entraîne la contagion.
Le taureau s’infecte après la saillie d’une vache malade et transmet la Brucellose aux autres
femelles. Les enveloppes et eaux fœtales, l’avorton et les écoulements vulvaires, très riches en
microbes assurent la propagation soit directement par contact ou soit indirectement par
souillure des aliments et les boissons, soit par la piqûre de certains arthropodes tels que les
Tabanidés, les Muscidés ayant piqué auparavant un animal infecté. La maladie peut
également apparaître dans un troupeau par introduction d’une femelle pleine venant d’une
étable infectée ou par l’utilisation du même pâturage.
Dans les deux sexes (mâle et femelle), la suite des symptômes de la Brucellose est la stérilité
et par conséquent la non productivité des animaux. (WOTTO, 1982)
6- Néphrite C’est une maladie qui infecte les reins et les déforme.
7- Streptotrycose cutano-bovine Elle se manifeste par une dépigmentation de l’animal, par la disparition progressive des poils,
par des plaies profondes et des croûtes qui finissent par contraindre l’animal à ne plus
s’alimenter. La contagion d’un animal à un autre n’est possible que par l’intermédiaire des
tiques.
En plus des antibiotiques cités plus hauts, on utilise le Pénistrepto pour lutter contre cette
maladie. Pour cette dernière aussi, il faut signaler qu’il n’existe pas de vaccin spécifique
disponible.
8- Gale C’est une maladie parasitaire contagieuse qui provoque de nombreuses plaies sur toute la
peau de l’animal.
126
9- Peste bovine Bien que les éleveurs interviewés aient évoqué cette maladie, les spécialistes de la santé
animale affirment qu’elle est totalement contrôlée et mieux éradiquée depuis 1999 (source :
Vétérinaires du PADEB).
10- Parasitoses gastro-intestinales (PGI) Ce sont des maladies de l’intestin occasionnées par des parasites et dont sont victimes de
nombreux veaux.
127
ANNEXE 2 : Autres données socio-économiques collectées sous forme de tableaux
Tableau 30 : Principales maladies courantes observées chez les populations de la zone d'étude
Maladies
Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 Nt=50 n n n n n nt % Paludisme 3 2 1 2 2 10 5.18 Fièvre 1 8 9 4 7 29 15.03 Maux de tête 0 2 3 4 6 15 7.77 Maux de ventre 1 1 2 0 2 6 3.11 Vers 1 0 1 1 0 3 1.55 Diarrhée 6 6 8 7 7 34 17.62 Conjonctivite 2 0 0 0 0 2 1.04 Gâle/Dermatose 6 3 4 5 4 22 11.40 Urticaire/Prurit 1 0 0 0 0 1 0.52 Oxyures 1 1 0 0 0 2 1.04 Pertes urétrales 2 0 0 0 0 2 1.04 Choléra 3 1 3 3 2 12 6.22 Toux 1 0 1 0 4 6 3.11 Dysenterie 1 0 0 2 1 4 2.07 Rhumes 1 1 1 5 5 13 6.74 Bronchite 1 0 0 0 0 1 0.52 Bilharziose 1 0 0 0 0 1 0.52 Rougeole 2 1 0 0 0 3 1.55 Convulsions 1 1 0 0 0 2 1.04 Vomissement 1 3 2 2 2 10 5.18 Hémorroide/Aspergilus 0 3 3 1 1 8 4.15 Anémie / Ictère 0 1 1 0 0 2 1.04 Hernie 0 0 1 0 0 1 0.52 Asthme 0 0 0 1 1 2 1.04 Coqueluche 0 0 0 0 2 2 1.04 Total 193 100.00
128
Tableau 31 : Synthèse des maladies humaines qui seraient liées aux retenues d'hydraulique pastorale
Groupes de maladies
Maladies Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 N = 10 Nt=50 n n n n n nt %
Gastro-entérites
Choléra 2 0 0 0 0 2 6.67 Dysenterie 1 0 0 0 0 1 3.33 Vomissement 0 1 2 0 0 3 10.00 Diarrhée 3 2 5 0 0 10 33.33
Maladies dermiques
Gâle 4 2 3 0 0 9 30.00 Urticaire / Prurit 1 0 0 0 0 1 3.33
MPI Oxyures 1 0 0 0 0 1 3.33 Vers 0 0 1 0 0 1 3.33
Maladies urinaires
Bilharziose 1 0 0 0 0 1 3.33
Maladies des yeux
Conjonctivite 1 0 0 0 0 1 3.33
Total 30 100.00 Tableau 32 : Maladies animales rencontrées dans les différentes localités
Maladies bovines Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Zone d'étude N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 25 n n n n n nt %
Trypanosomiase bovine 3 4 4 5 5 21 30.00 PPCB 2 3 1 - 1 7 10.00 Pasteurellose bovine 3 4 3 4 3 17 24.29 Fièvre aphteuse 1 5 4 2 2 14 20.00 Streptotrycose cutano-bovine 1 - - - - 1 1.43 Néphrite 1 1 2 - - 4 5.71 Gâle 1 - - - - 1 1.43 Brucellose - 2 2 1 - 5 7.14 Total 70 100.00
129
Tableau 33 : Maladies animales liées à la retenue d' eau d' après les populations enquêtées
Maladies bovines Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 25 n n n n n nt %
Trypanosomiase bovine 2 - 3 2 2 9 32.14 PPCB 1 - - - - 1 3.57 Pasteurellose bovine 1 3 2 2 1 9 32.14 Fièvre aphteuse - 3 3 1 1 8 28.57 Néphrite 1 - - - - 1 3.57 Total 28 100.00 Tableau 34: Importance des retenues d' eau pour la culture Attelée
Pensez-vous pouvoir garder des animaux de trait si vous n'aviez pas de barrages?
Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 15
n n n n n nt %
OUI 0 1 0 Pas de culture attelée à cause des vols de bêtes,
1 6.25 NON 2 2 2 6 37.50 OUI MAIS,,, 3 3 3 9 56.25 Total 16 100.00 Tableau 35: Différentes sources d'approvisionnement en eau par localité et par saison
Saisons Sources Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N=10 N=10 N=10 N=10 N=10 Nt=50 n n n n n nt %
Saison pluvieuse
Puits 7 5 4 5 6 27 26.471 Marigot 6 7 9 2 4 28 27.451 Puisard/mare 1 1 0 0 2 4 3.9216 Eau de pluie 4 7 2 4 6 23 22.549 Barrage 3 0 0 0 2 5 4.902 Forage 3 3 3 3 3 15 14.706
Total 102 100
Saison sèche
Puits 2 2 0 5 3 12 13.19 Marigot 0 1 3 0 0 4 4.40 Puisard/mare 2 2 5 2 4 15 16.48 Pluie 0 0 0 0 0 0 0 Barrage 8 10 9 3 6 36 39.56 Pompe 2 4 3 8 7 24 26.37
Total 91 100.00
130
Tableau 36 : Différentes utilisations faites des retenues d' eau par localité et par saison
Saisons Utilisations Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude N=10 N=10 N=10 N=10 N=10 Nt=50 n n n n n nt %
Saison sèche
Boisson/Mets 6 3 7 2 4 22 21.78 Lessive/Vaisselle/Toilette 6 10 10 9 10 45 44.55 Construction 1 1 2 1 2 7 6.93 Alcool 0 2 1 1 1 5 4.95 Jardinage 0 1 4 4 5 14 13.86 Abreuvement 1 3 0 0 4 8 7.92
Saison pluvieuseLES RETENUES D' EAU SONT TRES PEU FREQUENTEES. - - Total 101 100.00
Tableau 37: Sources d' approvisionnement en eau des Peulh et Gando par localité et par saison
Saisons Sources Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude Nm = 3 Nm = 6 Nm = 6 Nm = 4 Nm = 3 Nmt=22 n n n n n nt %
Saison pluvieuse
Puits 2 2 0 2 2 8 20.00 Marigot 0 5 6 2 3 16 40.00 Puisard/mare 2 1 0 0 0 3 7.50 Pluie 2 5 1 2 0 10 25.00 Barrage 2 0 0 0 1 3 7.50 Pompe 0 0 0 0 0 0 0.00
Total 40 100.00
Saison sèche
Puits 0 2 0 1 0 3 7.14 Marigot 0 1 3 0 0 4 9.52 Puisard/mare 0 1 6 2 2 11 26.19 PLuie 0 0 0 0 0 0 0.00 Barrage 3 6 6 2 3 20 47.62 Pompe 0 1 0 3 0 4 9.52
Total 42 100.00
Nm représente le nombre de ménages Peulh et/ou Gando enquêtés
131
Tableau 38 : Différentes utilisations faites de l' eau des retenues par les Peulh et Gando par localité et par saison
Saisons Utilisations Sakabansi Fombaoui Sansi Ouroumon Ouénou Région d'étude Nm = 3 Nm = 6 Nm = 6 Nm = 4 Nm = 3 Nmt=22 n n n n n nt %
Saison sèche
Boisson/Mets 2 2 2 - 2 8 25.81 Lessive/Vaisselle/Toilette 2 6 6 4 3 21 67.74 Autres - - 2 - - 2 6.45
Saison pluvieuseLES RETENUES D' EAU SONT TRES PEU FREQUENTEES. - - Total 31 100.00 Tableau 39 : Superficie de l'occupation du sol de Nikki-Est Formations 1986 1998 Ecart
Ha % Ha % Ha % Galerie forestière 5665 4.87 5515 4.74 -150 -0.13 Forêt semi-décidue 1656 1.42 1368 1.18 -288 -0.25 Forêt claire et savane boisée 30584 26.27 24727 21.24 -5857 -5.03 Savanes arborée et arbustive 46291 39.77 31385 26.96 -14906 -12.81 Savane saxicole 41 0.04 41 0.04 0 0.00 Savane à emprise agricole 17416 14.96 24329 20.90 6913 5.94 Cultures et jachères 14463 12.42 28149 24.18 13686 11.76 Agglomérations 288 0.25 890 0.76 602 0.52 Total 116404 100.00 116404 100.00 0 0.00 Remarque : Un écart négatif exprime une regression de la formation entre 1986 et 1998 Un écart positif traduit une progression de la formation entre les deux dates Un écart nul illustre une stabilité de la formation entre les deux dates
132
Tableau 40 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type modal par centre de classe de diamètre ESPECES 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 Total Allophylus africanus 1 1 2 Acacia senegal 5 4 9 Acacia sieberiana 0 Afzelia africana 1 1 Annona senegalensis 0 Anogeissus leiocarpa 10 14 22 13 4 3 66 Antidesma venosum 1 1 Bombax costatum 1 1 Borassus aethiopium 0 Burkea africana 2 4 1 7 Byrsocarpus coccineus 0 Cassia sieberiana 0 Cissus populnea 0 Combretum aculeatum 1 1 Combretum collinum 1 1 Combretum micranthum 8 2 10 Combretum molle 1 1 Combretum nigricans 1 1 2 Crataeva religiosa 3 1 4 Crossopterix febrifuga 1 2 3 Cussonia arborea 1 1 1 3 Daniellia oliveri 1 5 7 1 1 4 2 2 23 Detarium microcarpum 5 1 6 Dichrostachys cinerea 1 1 Dioscorea cf togoensis 0 Dioscorea tomentosa 0 Diospyros mespiliformis 1 2 3 3 1 1 11 Entada africana 2 2 Erythrina senegalensis 0 Feretia apodanthera 3 3 Ficus capensis 1 1 2 Gardenia aqualla 0 Grewia bicolor 1 1 Holarrhena floribunda 0 Hymenocardia acida 2 2 Khaya senegalensis 1 2 2 3 1 1 1 11 Lannea acida 3 3 6 Lannea kerstingii 1 1 Lannea microcarpa 1 1 1 3 Leucaena leucocephala 0 Lophira lanceolata 1 1 2 Margaritaria discoidea 1 1 2
133
Mucuna pruriens 0 Nauclea latifolia 7 2 1 10 Opilia amentacea 0 Parkia biglobosa 1 1 Paullinia pinnata 0 Pericopsis laxiflora 3 1 4 Piliostigma thonningii 5 5 Prosopis africana 3 3 6 Pteleopsis suberosa 1 1 Pterocarpus erinaceus 1 4 5 10 3 23 Pterocarpus santalinoides 2 3 3 7 1 Saba thompsonii 0 Smilax kraussiana 0 Sterculia setigera 2 1 3 Stereospermum kunthianum 0 Swartzia madagascariensis 1 1 Tamarindus indica 1 1 2 Terminalia avicennioides 4 13 1 1 19 Trichilia emetica 1 1 Vitellaria paradoxa 4 8 2 4 18 Vitex doniana 2 1 3 Zanha golungensis 2 1 3 Ziziphus mucronata 0 Total (tiges) 73 75 68 45 18 13 7 2 0 2 0 1 288 Densité des ligneux (tiges/ha) 91 94 85 56 23 16 8.8 2.5 0 2.5 0 1.3 360
134
Tableau 41 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type modal par centre de classe de surface terrière Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 Total Allophylus africanus 0.01 0.08 0.089 Acacia senegal 0.2 0.41 0.611 Acacia sieberiana 0 Afzelia africana 0.19 0.186 Annona senegalensis 0 Anogeissus leiocarpa 0.17 0.73 2.03 2.06 0.99 0.88 6.853 Antidesma venosum 0.02 0.017 Bombax costatum 0.23 0.227 Borassus aethiopium 0 Burkea africana 0.09 0.42 0.19 0.693 Byrsocarpus coccineus 0 Cassia sieberiana 0 Cissus populnea 0 Combretum aculeatum 0.01 0.008 Combretum collinum 0.07 0.073 Combretum micranthum 0.13 0.12 0.251 Combretum molle 0.03 0.03 Combretum nigricans 0.01 0.09 0.095 Crataeva religiosa 0.05 0.07 0.119 Crossopterix febrifuga 0.02 0.08 0.099 Cussonia arborea 0.04 0.12 0.13 0.284 Daniellia oliveri 0.02 0.28 0.61 0.23 0.32 1.9 1.1 1.6 6.066 Detarium microcarpum 0.09 0.07 0.166 Dichrostachys cinerea 0.08 0.075 Dioscorea cf togoensis 0 Dioscorea tomentosa 0 Diospyros mespiliformis 0.03 0.1 0.32 0.69 0.47 1.18 2.783 Entada africana 0.02 0.023 Erythrina senegalensis 0 Feretia apodanthera 0.03 0.031 Ficus capensis 0.01 0.05 0.063 Gardenia aqualla 0 Grewia bicolor 0.08 0.075 Holarrhena floribunda 0 Hymenocardia acida 0.02 0.024 Khaya senegalensis 0.02 0.1 0.18 0.42 0.23 0.36 0.4 1.702 Lannea acida 0.2 0.46 0.66 Lannea kerstingii 0.03 0.032 Lannea microcarpa 0.08 0.27 0.3 0.648 Leucaena leucocephala 0 Lophira lanceolata 0.01 0.07 0.081 Margaritaria discoidea 0.06 0.11 0.171
135
Mucuna pruriens 0 Nauclea latifolia 0.16 0.07 0.15 0.38 Opilia amentacea 0 Parkia biglobosa 0.12 0.118 Paullinia pinnata 0 Pericopsis laxiflora 0.04 0.05 0.091 Piliostigma thonningii 0.07 0.065 Prosopis africana 0.06 0.14 0.198 Pteleopsis suberosa 0.02 0.015 Pterocarpus erinaceus 0.02 0.22 0.41 0.53 0.72 1.898 Pterocarpus santalinoides 0.17 0.47 0.65 2.37 0.41 4.079 Saba thompsonii 0 Smilax kraussiana 0 Sterculia setigera 0.34 0.22 0.564 Stereospermum kunthianum 0 Swartzia madagascariensis 0.08 0.075 Tamarindus indica 0.11 0.19 0.299 Terminalia avicennioides 0.08 0.74 0.08 0.19 1.078 Trichilia emetica 0.01 0.011 Vitellaria paradoxa 0.08 0.4 0.17 0.7 1.349 Vitex doniana 0.14 0.1 0.235 Zanha golungensis 0.16 0.15 0.309 Ziziphus mucronata 0
Total (m²) 1.24 3.89 6.19 6.16 4.21 4.24 3.18 1.1 0 1.6 0 1.18 32.999
Surface terrière (m²/ha) 1.55 4.87 7.73 7.71 5.26 5.3 3.98 1.38 0 2.01 0 1.47 41.24875
136
Tableau 42 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acaciasieberiana par centre de classe de diamètre Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 Total Terminalia avicennioides 8 9 1 1 19 Pterocarpus erinaceus 3 1 3 7 Vitellaria paradoxa 5 1 1 7 Combretum micranthum 5 1 6 Acacia sieberiana 4 1 5 Hymenocardia acida 3 2 5 Crossopteryx febrifuga 2 2 4 Daniellia oliveri 2 1 1 4 Antidesma venosum 2 1 3 Cussonia arborea 1 1 1 3 Detarium microcarpum 1 1 2 Lannea kerstingii 1 1 2 Piliostigma thonningii 2 2 Prosopis africana 1 1 2 Uapaca togoensis 1 1 2 Anogeissus leiocarpa 1 1 Antiaris africana 1 1 Bombax costatum 1 1 Bridelia scleroneura 1 1 Burkea africana 1 1 Diospyros mespiliformis 1 1 Entada africana 1 1 Feretia apodanthera 1 1 Khaya senegalensis 1 1 Lannea acida 1 1 Lonchocarpus laxiflorus 1 1 Margaritaria discoidea 1 1 Nauclea latifolia 1 1 Parinari curatellifolia 1 1 Parkia biglobosa 1 1 Pericopsis laxiflora 1 1 Strychnos densiflora 1 1 Total / placeau 37 31 5 13 0 3 0 1 90 Total / ha 185 155 25 65 0 15 0 5 450
137
Tableau 43 : Répartition du groupement à Allophyllus africanus et Acaciasieberiana par centre de classe de surface terrière Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 Total Terminalia avicennioides 0.16 0.46 0.08 0.17 0.866 Lannea kerstingii 0.16 0.57 0.732 Pterocarpus erinaceus 0.16 0.11 0.45 0.727 Daniellia oliveri 0.07 0.13 0.48 0.682 Parkia biglobosa 0.48 0.482 Acacia sieberiana 0.22 0.19 0.406 Crossopteryx febrifuga 0.07 0.27 0.343 Bombax costatum 0.32 0.322 Cussonia arborea 0.05 0.11 0.13 0.279 Uapaca togoensis 0.06 0.19 0.243 Vitellaria paradoxa 0.04 0.13 0.164 Lannea acida 0.16 0.158 Hymenocardia acida 0.07 0.08 0.147 Combretum micranthum 0.07 0.07 0.143 Vitellaria paradoxa 0.14 0.135 Prosopis africana 0.02 0.09 0.108 Antidesma venosum 0.04 0.05 0.094 Burkea africana 0.08 0.078 Detarium microcarpum 0.01 0.05 0.065 Diospyros mespiliformis 0.05 0.054 Margaritaria discoidea 0.05 0.054 Piliostigma thonningii 0.05 0.05 Parinari curatellifolia 0.05 0.047 Pericopsis laxiflora 0.03 0.029 Bridelia scleroneura 0.03 0.028 Nauclea latifolia 0.03 0.026 Lonchocarpus laxiflorus 0.02 0.02 Strychnos densiflora 0.01 0.014 Entada africana 0.01 0.013 Khaya senegalensis 0.01 0.013 Anogeissus leiocarpa 0.01 0.011 Antiaris africana 0.01 0.011 Feretia apodanthera 0.01 0.008 Total 0.72 1.53 0.47 1.97 0 0.32 0.96 0.57 6.552 Total/ha 3.62 7.65 2.35 9.86 0 1.61 4.82 2.86 32.76
138
Tableau 44 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre de classe de diamètre Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 >105 Total Acacia senegal 5 4 9 Afzelia africana 1 1 Allophylus africanus 1 1 2 Anogeissus leiocarpa 10 14 22 13 4 3 66 Antidesma venosum 1 1 Bombax costatum 1 1 Burkea africana 2 4 1 7 Combretum aculeatum 1 1 2 Combretum molle 1 Combretum micranthum 8 2 10 Combretum nigricans 1 1 2 Crataeva religiosa 3 1 4 Crossopteryx febrifuga 1 2 3 Cussonia arborea 1 1 1 3 Daniellia oliveri 1 5 7 2 1 4 2 1 23 Detarium microcarpum 5 1 6 Dichrostachys cinerea 1 1 Diospyros mespiliformis 1 2 3 3 1 1 11 Entada africana 2 2 Feretia apodanthera 3 3 Ficus capensis 1 1 2 Ficus sp 1 1 Grewia bicolor 1 1 Hymenocardia acida 2 2 Khaya senegalensis 1 2 2 3 1 1 10 Lannea acida 3 4 7 Lannea kerstingii 1 1 Lannea microcarpa 1 1 1 3 Lophira lanceolata 1 1 2 Margaritaria discoidea 1 1 2 Nauclea latifolia 7 2 1 10 Parkia biglobosa 1 1 Pericopsis laxiflora 3 1 4 Piliostigma thonningii 5 5 Prosopis africana 3 3 6 Pteleopsis suberosa 1 1 Pterocarpus erinaceus 1 4 5 9 3 22 Pterocarpus santalinoides 2 3 3 7 1 16 Sterculia setigera 2 1 3 Swartzia madagascariensis 1 1
139
Tamarindus indica 1 1 2 Terminalia avicennioides 4 13 1 1 19 Trichilia emetica 1 1 Vitellaria paradoxa 4 8 2 4 18 Vitex doniana 2 1 3 Zanha golungensis 2 1 3 Total / placeau 74 75 68 45 18 13 7 2 0 1 1 303 Total / ha 185 188 170 113 45 32.5 17.5 5 0 2.5 2.5 758
140
Tableau 45 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Zanha golungensis par centre de classe de surface terrière Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 >105 Total Acacia senegal 0.2 0.409 0.61 Afzelia africana 0.19 0.19 Allophylus africanus 0.01 0.076 0.09 Anogeissus leiocarpa 0.17 0.73 2.029 2.06 0.99 0.88 6.85 Antidesma venosum 0.02 0.02 Bombax costatum 0.23 0.23 Burkea africana 0.09 0.416 0.19 0.69 Combretum aculeatum 0.01 0.01 Combretum fragrans 0.073 0.07 Combretum molle 0.03 0.03 Combretum micranthum 0.13 0.12 0.25 Combretum nigricans 0.01 0.086 0.1 Crataeva religiosa 0.05 0.07 0.12 Crossopteryx febrifuga 0.02 0.08 0.1 Cussonia arborea 0.04 0.115 0.13 0.28 Daniellia oliveri 0.02 0.28 0.612 0.23 0.32 1.9 1.1 1.6 6.07 Detarium microcarpum 0.09 0.073 0.17 Dichrostachys cinerea 0.075 0.08 Diospyros mespiliformis 0.03 0.1 0.322 0.69 0.47 1.18 1.6 Entada africana 0.02 0.02 Feretia apodanthera 0.03 0.03 Ficus capensis 0.01 0.05 0.06 Ficus sp 0.01 0.01 Grewia bicolor 0.075 0.08 Hymenocardia acida 0.02 0.02 Khaya senegalensis 0.02 0.1 0.175 0.42 0.23 0.36 0.4 1.7 Lannea acida 0.2 0.46 0.66 Lannea kerstingii 0.03 0.03 Lannea microcarpa 0.076 0.27 0.3 0.65 Lophira lanceolata 0.01 0.072 0.08 Margaritaria discoidea 0.06 0.109 0.17 Nauclea latifolia 0.16 0.07 0.15 0.38 Parkia biglobosa 0.118 0.12 Pericopsis laxiflora 0.04 0.05 0.09 Piliostigma thonningii 0.07 0.07 Prosopis africana 0.06 0.14 0.2 Pteleopsis suberosa 0.02 0.02 Pterocarpus erinaceus 0.02 0.22 0.411 1.53 0.72 2.9 Pterocarpus santalinoides 0.173 0.47 0.65 2.37 0.41 4.08 Sterculia setigera 0.34 0.22 0.56
141
Swartzia madagascariensis 0.075 0.08 Tamarindus indica 0.105 0.19 0.3 Terminalia avicennioides 0.08 0.74 0.075 0.19 1.08 Trichilia emetica 0.01 0.01 Vitellaria paradoxa 0.08 0.4 0.173 0.7 1.35 Vitex doniana 0.14 0.1 0.24 Zanha golungensis 0.164 0.15 0.31 Total 1.25 3.89 6.187 7.16 4.21 4.24 3.18 1.1 0 1.6 1.18 32.8 Total/ha 3.13 9.74 15.47 17.9 10.5 10.6 7.96 2.75 0 4.01 2.95 82.1
142
Tableau 46: Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type concrétionné par centre de classe de diamètre Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95>105Total Anogeissus leiocarpa 35 37 19 2 3 2 1 99 Vitellaria paradoxa 14 11 6 1 32 Margaritaria discoidea 17 6 23 Hatarê gorou 13 4 17 Pterocarpus erinaceus 5 6 4 1 16 Crossopteryx febrifuga 6 9 15 Acacia senegal 4 4 2 10 Combretum micranthum 4 6 10 Terminalia avicennioides 7 2 9 Combretum collinum 7 1 8 Burkea africana 1 5 1 7 Daniellia oliveri 1 3 1 2 7 Piliostigma thonningii 7 7 Nauclea latifolia 6 6 Detarium microcarpum 4 4 Grewia bicolor 3 1 4 Lannea acida 1 2 1 4 Parkia biglobosa 1 1 1 1 4 Bombax costatum 1 1 1 3 Feretia apodanthera 3 3 Pericopsis laxiflora 2 1 3 Bridelia scleroneura 2 2 Lannea microcarpa 1 1 2 Prosopis africana 1 1 2 Acacia ataxacantha 1 1 Adansonia digitata 1 1 Allophyllus africanus 1 1 Combretum nigricans 1 1 Cussonia arborea 1 1 Diospyros mespiliformis 1 1 Entada africana 1 1 Ficus capensis 1 1 Khaya senegalensis 1 1 Lonchocarpus laxiflorus 1 1 Mitragyna inermis 1 1 Pseudocedrala kotschyi 1 1 Securidaca longepedonculata1 1 Stereospermum kunthianum 1 1 Strychnos spinosa 1 1 Wobayi 1 1 Ximenia americana 1 1 Total 151 97 44 10 5 3 1 2 0 1 314 Total / ha 167.78107.7848.8911.115.563.331.112.220 1.11 348.89
143
Tableau 47 : Répartition du groupement sur sol ferrugineux tropical de type concrétionné par classe de surface terrière Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 >105 Total Acacia ataxacantha 0.032 0.032 Acacia senegal 0.173 0.405 0.333 0.911 Adansonia digitata 3.158 3.158 Allophyllus africanus 0.009 0.009 Anogeissus leiocarpa 0.728 1.759 1.857 0.356 0.718 0.669 0.399 6.486 Bombax costatum 0.019 0.096 0.134 0.249 Bridelia scleroneura 0.038 0.038 Burkea africana 0.023 0.253 0.08 0.356 Combretum collinum 0.111 0.036 0.147 Combretum micranthum 0.08 0.252 0.332 Combretum nigricans 0.008 0.008 Crossopteryx febrifuga 0.132 0.432 0.564 Cussonia arborea 0.046 0.046 Daniellia oliveri 0.019 0.27 0.227 1.11 1.626 Detarium microcarpum 0.057 0.057 Diospyros mespiliformis 0.102 0.102 Entada africana 0.018 0.018 Feretia apodanthera 0.038 0.038 Ficus capensis 0.015 0.015 Grewia bicolor 0.035 0.035 0.07 Hatarê gorou 0.251 0.183 0.434 Khaya senegalensis 0.105 0.105 Lannea acida 0.015 0.172 0.134 0.321 Lannea microcarpa 0.009 0.139 0.148 Lonchocarpus laxiflorus 0.015 0.015 Margaritaria discoidea 0.245 0.222 0.467 Mitragyna inermis 0.186 0.186 Nauclea latifolia 0.128 0.128 Parkia biglobosa 0.009 0.062 0.152 0.214 0.437 Pericopsis laxiflora 0.032 0.046 0.078 Piliostigma thonningii 0.092 0.092 Prosopis africana 0.029 0.084 0.113 Pseudocedrala kotschyi 0.029 0.029 Pterocarpus erinaceus 0.104 0.314 0.386 0.16 0.964 Securidaca longepedonculata 0.009 0.009 Stereospermum kunthianum 0.034 0.034 Strychnos spinosa 0.009 0.009 Terminalia avicennioides 0.12 0.075 0.195 Vitellaria paradoxa 0.255 0.541 0.61 0.303 1.709 Wobayi 0.089 0.089 Ximenia americana 0.008 0.008 Total 2.689 4.495 4.256 1.594 1.159 0.972 0.399 1.11 0 3.158 19.83 Total / ha 2.99 4.99 4.73 1.77 1.29 1.08 0.44 1.23 0 3.51 22.04
144
Tableau 48 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia sieberiana par centre de classe de diamètre Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 >105 Total Anogeissus leiocarpa 16 2 4 1 23 Margaritaria discoidea 15 6 21 Holarrhena floribunda 13 4 17 Acacia senegal 4 4 2 10 Daniellia oliveri 1 2 1 2 6 Terminalia avicennioides 4 1 5 Nauclea latifolia 4 4 Combretum micranthum 2 2 Lannea kerstingii 2 2 Parkia biglobosa 2 2 Piliostigma thonningii 2 2 Pterocarpus erinaceus 1 1 2 Vitellaria paradoxa 1 1 2 Acacia ataxacantha 1 1 Allophyllus africanus 1 1 Combretum collinum 1 1 Combretum nigricans 1 1 Diospyros mespiliformis 1 1 Ficus capensis 1 1 Lannea microcarpa 1 1 Mitragyna inermis 1 1 Pericopsis laxiflora 1 1 Prosopis africana 1 1 Ficus trichopoda 1 1 Total 64 23 12 6 1 1 0 2 0 0 109 Total / ha 213 76.67 40 20 3.33 3.33 0 6.67 0 0 363.33
145
Tableau 49 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Acacia sieberiana par classe de surface terrière Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 Total Daniellia oliveri 0.041 0.195 0.244 1.11 1.59 Anogeissus leiocarpa 0.319 0.091 0.384 0.167 0.961 Acacia senegal 0.173 0.405 0.333 0.911 Margaritaria discoidea 0.223 0.222 0.445 Holarrhena floribunda 0.251 0.183 0.434 Vitellaria paradoxa 0.011 0.303 0.314 Parkia biglobosa 0.305 0.305 Mitragyna inermis 0.186 0.186 Pterocarpus erinaceus 0.018 0.102 0.12 Terminalia avicennioides 0.082 0.034 0.116 Combretum micranthum 0.107 0.107 Ficus trichopoda 0.089 0.089 Nauclea latifolia 0.077 0.077 Lannea kerstingii 0.076 0.076 Acacia ataxacantha 0.032 0.032 Prosopis africana 0.029 0.029 Piliostigma thonningii 0.026 0.026 Diospyros mespiliformis 0.018 0.018 Ficus capensis 0.015 0.015 Combretum collinum 0.014 0.014 Combretum nigricans 0.014 0.014 Pericopsis laxiflora 0.014 0.014 Allophyllus africanus 0.009 0.009 Lannea microcarpa 0.009 0.009 Total 1.13 0.96 1.18 0.99 0.24 0.30 0.00 1.11 5.91 Total / ha 3.76 3.20 3.92 3.30 0.81 1.01 0.00 3.70 19.70
146
Tableau 50 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidacalongepedunculata par centre de classe de diamètre Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 >115 Total Anogeissus leiocarpa 19 36 20 2 4 2 1 84 Vitellaria paradoxa 13 11 6 30 Crossopteryx febrifuga 6 9 15 Pterocarpus erinaceus 4 6 4 1 15 Burkea africana 1 5 2 8 Combretum collinum 7 1 8 Combretum micranthum 4 4 8 Piliostigma thonningii 6 6 Lannea acida 1 2 2 5 Daniellia oliveri 1 1 1 1 4 Detarium microcarpum 4 4 Grewia bicolor 3 1 4 Terminalia avicennioides 3 1 4 Bombax costatum 1 1 1 3 Feretia apodanthera 3 3 Margaritaria discoidea 3 3 Nauclea latifolia 3 3 Parkia biglobosa 1 1 1 3 Bridelia scleroneura 2 2 Pericopsis laxiflora 1 1 2 Adansonia digitata 1 1 Combretum nigricans 1 1 Cussonia arborea 1 1 Diospyros mespiliformis 1 1 Entada africana 1 1 Khaya senegalensis 1 1 Lannea microcarpa 1 1 Lonchocarpus laxiflorus 1 1 Parinari curatellifolia 1 1 Prosopis africana 1 1 Pseudocedrala kotschyi 1 1 Securidaca longepedonculata 1 1 Sterculia setigesa 1 1 Stereospermum kunthianum 1 1 Strychnos spinosa 1 1 Ximenia americana 1 1 Total 93 79 40 7 6 2 1 0 0 1 1 230 Total / ha 116.25 98.75 50 8.75 7.5 2.5 1.25 0 0 1.25 1.25 287.5
147
Tableau 51 : Répartition du groupement à Anogeissus leiocarpa et Securidaca longepedunculata par classe de surface terrière
Espèces 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 >115 Total Anogeissus leiocarpa 0.41 1.72 1.93 0.32 0.94 0.67 0.40 6.37 Adansonia digitata 0.41 3.16 3.57 Vitellaria paradoxa 0.41 0.54 0.61 1.56 Daniellia oliveri 0.41 0.08 0.23 0.87 1.58 Pterocarpus erinaceus 0.41 0.31 0.40 0.16 1.28 Crossopteryx febrifuga 0.41 0.43 0.84 Burkea africana 0.41 0.25 0.19 0.86 Lannea acida 0.41 0.17 0.27 0.85 Parkia biglobosa 0.41 0.06 0.21 0.68 Bombax costatum 0.41 0.10 0.13 0.64 Combretum micranthum 0.41 0.15 0.55 Combretum collinum 0.41 0.04 0.44 Lannea microcarpa 0.41 0.14 0.55 Khaya senegalensis 0.41 0.11 0.51 Diospyros mespiliformis 0.41 0.10 0.51 Sterculia setigesa 0.41 0.09 0.50 Piliostigma thonningii 0.41 0.41 Prosopis africana 0.41 0.08 0.49 Terminalia avicennioides 0.41 0.04 0.45 Grewia bicolor 0.41 0.04 0.44 Parinari curatellifolia 0.41 0.07 0.48 Nauclea latifolia 0.41 0.41 Pericopsis laxiflora 0.41 0.05 0.45 Detarium microcarpum 0.41 0.41 Cussonia arborea 0.41 0.05 0.45 Margaritaria discoidea 0.41 0.41 Bridelia scleroneura 0.41 0.41 Feretia apodanthera 0.41 0.41 Stereospermum kunthianum 0.41 0.03 0.44 Pseudocedrala kotschyi 0.41 0.41 Entada africana 0.41 0.41 Lonchocarpus laxiflorus 0.41 0.41 Securidaca longepedonculata 0.41 0.41 Strychnos spinosa 0.41 0.41 Combretum nigricans 0.41 0.41 Ximenia americana 0.41 0.41 Total 0.41 3.77 3.86 1.03 1.38 0.67 0.4 0 0 0.87 3.16 15.53 Total / ha 0.51 4.71 4.83 1.28 1.72 0.84 0.5 0 0 1.08 3.95 19.42
148
Tableau 52 : Répartition des espèces récoltées dans les 21 placeaux par famille et correspondances en langue fulbe No FAMILLE NOMS SCIENTIFIQUES NOMS LOCAUX (Fulbé)
1 Anacardiaceae
Lannea acida Toui Lannea kerstingii Goddogorehi gorel Lannea microcarpa Goddogorehi
2 Annonaceae Annona senegalensis Doukouhi
3 Apocynaceae
Holarrhena floribunda Tôoke ladde/Haataarê goorou Saba thompsonii Djibbinon-yi Strophanthus sarmentosus Tookehi
4 Araceae Anchomanes difformis Kenda 5 Araliaceae Cussonia arborea Alan-beelouhi
6 Arecaceae
Borassus aethiopium Doubbi Raphia sudanica Keesoudji Vernonia colorata Tchegorga
8 Bignoniaceae Stereospermum kunthianum Djilô djilôowel
9 Bombacaceae Adansonia digitata Bokki Bombax costatum Kourouhi
10 Capparidaceae Crataeva capparoides Naoudêa goorou Crataeva religiosa Naoudea gorel
11 Cesalpiniaceae
Afzelia africana Wangnanhi Burkea africana Kohi Cassia italica Bale balehi Daniellia oliveri Kallahi Detarium microcarpum Konkehi Piliostigma thonningii Barkehi Pterocarpus erinaceus Banouhi Tamarindus indica Djabbi
12 Combretaceae
Anogeissus leiocarpa Agbangahi Combretum aculeatum Laougni Combretum glutinosum Dôoga Combretum micranthum Bouiki Combretum molle Gnagna koonoehi Combretum nigricans Bouiki bodehi (bouiki gorel) Pteleopsis suberosa Baadji boelii Terminalia avicennioides Tiggerehi Terminalia glaucescens Latti bodehi
13 Connaraceae Byrsocarpus coccineus Djatamêrê
14 Dioscoreaceae
Dioscorea bulbifera Goufougafaala Dioscorea cf togoensis Dikaarê Dioscorea tomentosa Doundererouwa
15 Ebenaceae Diospyros mespiliformis Gnelbi
16 Euphorbiaceae
Antidesma venosum Bembenkouhi Bridelia scleroneura Neesin-nai Hymenocardia acida Ala fittahi
149
Margaritaria discoidea Bembenkouhi gorou Securinega virosa Tchami Uapaca togoensis Sarouhi
18 Liliaceae Asparagus africanus Labbel boûrou 19 Loganiaceae Strychnos densiflora Kiilikoloi
20 Meliaceae
Khaya senegalensis Kahi Pseudocedrala kotschyi Kahi loummê Trichilia emetica Piisa laddê
21 Mimosaceae
Acacia ataxacantha Djandjandji Acacia gourmaensis Guiô balehô Acacia senegal Pattouki Acacia sieberiana Guiê daneeje Dichrostachys cinerea Bourdi Entada africana Fada waanouhi Leucaena leucocephala Lekkon nai Parkia biglobosa Nareeri Prosopis africana Kohi dimi
22 Moraceae Antiaris africana Riini gorou Ficus capensis Rimata betchehi (Ibbi)
24 Ochnaceae Lophira lanceolata Karerehi Strychnos spinosa Mabbatarahi
25 Olacaceae Ximenia americana Tchaboullahi 26 Opiliaceae Opilia amentacea Saka sokahi
27 Papilionaceae
Desmodium velutinum Takko takkonin Erythrina senegalensis Bôodoua Lonchocarpus laxiflorus Baabousahi Mucuna pruriens Kaka yerekoua Pericopsis laxiflora Sôrôkouhi Pterocarpus santalinoides Daimai goorou Swartzia madagascariensis Kokoobi
28 Polygalaceae Securidaca longepedonculata Aalaali 29 Rhamnaceae Ziziphus mucronata Gonrahi 30 Rosaceae Parinari curatellifolia Naoudehi
31 Rubiaceae
Crossopteryx febrifuga Rimadjôogahi Feretia apodanthera Bourougel Gardenia aqualla Diigaali gorel Mitragyna inermis Kooli Nauclea latifolia Bakoûrehi
32 Sapindaceae
Allophylus africanus Tchami goorou Paullinia pinnata Tôoganhi Zanha golungensis Bokki
33 Sapotaceae Vitellaria paradoxa Kaarehi 34 Smilacaceae Smilax kraussiana Garagarowwa 35 Sterculiaceae Sterculia setigera Boboli 36 Tiliaceae Grewia bicolor Gnonrolongouhi