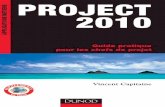Etude d'impact environnemental et social du second projet de ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Etude d'impact environnemental et social du second projet de ...
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
1
Etude d’impact environnemental et social du
second projet de ligne d’interconnexion entre
l’Ethiopie et Djibouti /Semera-Nagad
Partie Djiboutienne – Galafi-Nagad
Version finale
Décembre 2020
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
2
Etude d’impact environnemental et social du
second projet de ligne d’interconnexion entre
l’Ethiopie et Djibouti /Semera-Nagad
Partie Djiboutienne – Galafi-Nagad
Version 2.0
Décembre 2020
Mathilde Laval – experte en sauvegardes sociales
Louise Pierre – experte sociale
Frédéric Airaud – expert en sauvegardes environnementales
Jayati Chourey – expert environnementale
Léa Monin – experte développement durable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
3
Table des matières
Abréviations ............................................................................................................. 12
1 Résumé exécutif .................................................................................................. 13
1.1 Description du projet ................................................................................................................................. 13
1.2 Objectifs de l’EIES ...................................................................................................................................... 13
1.3 Description de l’aire du projet ................................................................................................................... 14
1.4 Méthodologie de l’étude ............................................................................................................................ 14
1.5 Organisation institutionnelle ..................................................................................................................... 15
1.6 Synthèse des principaux impacts et leurs mesures d’atténuation ....................................................... 16
1.6.1 Impacts sociaux............................................................................................................................................................ 16
1.6.2 Impacts environnementaux .......................................................................................................................................... 20
2 Executive summary ............................................................................................. 24
2.1 Project’s description .................................................................................................................................. 27
2.2 Study’s objectives ...................................................................................................................................... 27
2.3 Project area description ............................................................................................................................. 28
2.4 Study’s methodology ................................................................................................................................. 28
2.5 Institutionnal organisation ........................................................................................................................ 29
2.6 Summary of major impacts and mitigation measures ............................................................................ 30
2.6.1 Social impacts......................................................................................................................................................... 30
Environmental impacts ................................................................................................................................................... 32
3 Description du projet ........................................................................................... 37
3.1 Contexte ...................................................................................................................................................... 37
3.2 Description du projet ................................................................................................................................. 38
3.2.1 Caractéristiques du projet ................................................................................................................................... 38
3.2.2 Etapes du projet ..................................................................................................................................................... 45
3.2.3 Chronogramme indicatif du projet .................................................................................................................... 47
3.3 Zone d’étude du projet ............................................................................................................................... 49
3.3.1 Délimitation de la zone d’étude du projet ........................................................................................................ 49
3.3.2 Zone d’emprise du projet ..................................................................................................................................... 49
3.3.3 Zone d’influence sociale du projet .................................................................................................................... 50
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
4
3.3.4 Zone d’influence environnementale du projet ................................................................................................ 53
3.3.5 Installations connexes ou associées ................................................................................................................ 53
3.3.6 Champ d’application de l’EIES ........................................................................................................................... 53
4 Revue légale et institutionnelle ............................................................................ 56
4.1 Cadre institutionnel .................................................................................................................................... 56
4.2 Conventions internationales ratifiées ...................................................................................................... 58
4.3 Cadre légal national ................................................................................................................................... 61
4.4 Normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale .......................................................... 66
4.5 Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement . 68
5 Méthodologie de l’EIES ........................................................................................ 70
5.1 Participation du public ............................................................................................................................... 70
5.2 Etude de base sociale ................................................................................................................................ 70
5.3 Etude de base environnementale ............................................................................................................. 74
5.4 Identification et évaluation des impacts potentiels ................................................................................ 75
5.5 Proposition de mesures d’atténuation et évaluation des impacts résiduels ....................................... 79
5.6 Définition du système de suivi-évaluation du PGES .............................................................................. 80
6 Etude de base environnementale et sociale .......................................................... 81
6.1 Etude de base sociale ................................................................................................................................ 81
6.1.1 Démographie et ethnie .......................................................................................................................................... 81
6.1.2 Education ................................................................................................................................................................. 85
6.1.3 Santé et handicap .................................................................................................................................................. 86
6.1.4 Activités économiques et sources de revenus .............................................................................................. 89
6.1.5 Conditions de logement ....................................................................................................................................... 94
6.1.6 Conditions d’accès à l’électricité ....................................................................................................................... 99
6.1.7 Collectifs vulnérables ..........................................................................................................................................103
6.1.8 Inégalités femmes- hommes ..............................................................................................................................106
6.1.9 Gestion du foncier ................................................................................................................................................108
6.1.10 Occupation des sols .....................................................................................................................................................112
6.1.11 Patrimoine culturel ...............................................................................................................................................115
6.2 Etude de base de l’environnement physique ........................................................................................ 120
6.2.1 Géographie et topographie .................................................................................................................................120
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
5
6.2.2 Climat .......................................................................................................................................................................120
6.2.3 Qualité de l’air ........................................................................................................................................................123
6.2.4 Bruit ambient ..........................................................................................................................................................123
6.2.5 Géologie et sols .....................................................................................................................................................124
6.2.6 Hydrogéologie ........................................................................................................................................................127
6.3 Etude de base de l’environnement biologique ...................................................................................... 130
6.3.1 Habitats naturels ...................................................................................................................................................130
6.3.2 Flore ..........................................................................................................................................................................132
6.3.3 Faune ........................................................................................................................................................................135
6.4 Evaluation des impacts potentiels ......................................................................................................... 167
6.5 Evaluation des impacts sociaux et justification de leur importance .................................................. 167
6.5.1 Impact 1- Amélioration de l’approvisionnement en électricité..................................................................167
6.5.2 Impact 2- Création d'emplois directs et indirects liés au projet ...............................................................167
6.5.3 Impact 3- Restriction des usages dans le corridor du projet ....................................................................170
6.5.4 Impact 4- Perte temporaire de terres destinées aux campements de travailleurs, aux aires de
stockage et aux routes d’accès .........................................................................................................................172
6.5.5 Impact 5- Perte permanente de terres dans la zone d’emprise des pylônes, du poste et des routes
d’accès pour l’entretien .......................................................................................................................................174
6.5.6 Impact 6- Tensions sociales dues à des comportements inappropriés de travailleurs extérieurs .175
6.5.7 Impact 7- Augmentation des violences basées sur le genre du fait de l’afflux de travailleurs
extérieurs ................................................................................................................................................................177
6.5.8 Impact 8- Augmentation de l'incidence des maladies transmissibles, en particulier les maladies
sexuellement transmissibles .............................................................................................................................178
6.5.9 Impact 9- Augmentation de l’incidence de la COVID-19 .............................................................................179
6.5.10 Impact 10- Augmentation des risques d’accidents pour la population locale ......................................180
6.5.11 Impact 11- Impacts des champs électromagnétiques sur la santé de la population ..........................181
6.5.12 Impact 12- Pression accrue sur les services de base du fait de l’afflux de travailleurs ....................182
6.5.13 Impact 13- Risques de discrimination et de non-égalité des chances des travailleurs .....................183
6.5.14 Impact 14- Risques de conditions de travail non adéquates .....................................................................185
6.5.15 Impact 15- Expositions des travailleurs à des risques physiques et chimiques .................................187
6.5.16 Impact 16- Risque de détérioration de sites de patrimoine culturel et d’héritage culturel ................188
6.6 Tableau synthèse de l’évaluation des impacts sociaux ....................................................................... 189
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
6
6.7 Identification des impacts environnementaux et justification de leur importance ........................... 192
6.7.1 Impact 1 - Dégradation de la qualité de l'air ...................................................................................................193
6.7.2 Impact 2 – Emission de bruit et de nuisance sonore...................................................................................194
6.7.3 Impact 3 - Impact sur la géologie et la géomorphologie .............................................................................196
6.7.4 Incidence 4 - Changements dans les processus de sédimentation ........................................................197
6.7.5 Impact 5 - Augmentation de l'érosion et du compactage des sols ..........................................................198
6.7.6 Impact 6 – Contamination des sols ..................................................................................................................199
6.7.7 Impact 7 – Changement du paysage et impacts visuels.............................................................................199
6.7.8 Impact 8 - Modifications potentielles du schéma de ruissellement naturel des eaux ........................201
6.7.9 Impact 9 – Emission de gaz à effet de serre (GES) ......................................................................................202
6.7.10 Impacts sur la biodiversité .................................................................................................................................204
6.7.11 Impact 17 - Menace de l'intégrité d'une zone protégée terrestre traversée par la ligne électrique .213
6.8 Tableau synthèse de l’évaluation des impacts environnementaux .................................................... 215
7 Plan de gestion environnemental et social ......................................................... 217
7.1 Structuration des mesures d’atténuation .............................................................................................. 217
7.2 Responsabilités et rôles des parties prenantes .................................................................................... 223
7.3 Mesures d’atténuation et impacts résiduels.......................................................................................... 226
7.4 Mesures opérationnelles envisagées ..................................................................................................... 244
7.4.1 Dispositif de mise en œuvre et renforcement des capacités ....................................................................244
7.4.2 Dispositif de suivi et évaluation du PGES......................................................................................................................246
7.4.3 Indicateurs de suivi-évaluation des mesures d’atténuation sociale ..............................................................................248
7.4.4 Indicateurs de suivi-évaluation des mesures d’atténuation environnementales ...........................................................253
7.4.5 Mécanisme de gestion des plaintes .............................................................................................................................260
7.4.6 Consultations ..............................................................................................................................................................261
7.5 Budget et chronogramme ........................................................................................................................ 262
7.5.1 Calendrier de mise en œuvre .............................................................................................................................262
7.5.2 Budget estimatif ....................................................................................................................................................263
8 Annexes ............................................................................................................ 266
8.1 Cartes de l’occupation actuelle des sols ............................................................................................... 267
8.2 Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les marchés de travaux du projet295
8.3 Plan d’engagement environnemental et social ..................................................................................... 327
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
7
Titre de propriété de Nagad : concession provisoire ................................................................................... 334
8.4 Questionnaire de l’enquête-ménage ...................................................................................................... 339
8.5 Guide d’entretien des focus-groups ....................................................................................................... 353
8.6 Comptes-rendus et listes de présence .................................................................................................. 358
8.7 Bibliographie de la partie sociale ........................................................................................................... 380
8.8 Bibliographie pour la partie environnementale ..................................................................................... 381
8.9 Photo de la faune et de la flore ............................................................................................................... 383
Table des figures
Figure 1- Modèle de pylône.................................................................................................................... 42
Figure 2- Population urbaine et rurale dans les régions du projet (Annuaire 2017- DISED) ........................ 82
Figure 3- Taille du ménage (Enquête Insuco) ......................................................................................... 83
Figure 4- Age du chef de ménage en fonction du genre (Enquête Insuco) ................................................ 84
Figure 5- État civil du chef de ménage (Enquête Insuco) ......................................................................... 85
Figure 6- Groupe ethnique du chef de ménage (Enquête Insuco) ............................................................. 85
Figure 7- Alphabétisation des membres des ménages ayant plus de 14 ans en fonction du lieu (Enquête
Insuco) ................................................................................................................................................. 86
Figure 8- Alphabétisation des membres des ménages ayant plus de 14 ans en fonction du genre (Enquête
Insuco) ................................................................................................................................................. 86
Figure 9- Niveau d’éducation des membres du ménages ayant plus de 14 ans en fonction du genre (Enquête
Insuco) ................................................................................................................................................. 86
Figure 10- Principales raisons d’abandon de l’école en fonction du genre (Enquête Insuco) ....................... 86
Figure 11- Services de santé utilisés par les ménages (Enquête Insuco) ................................................... 87
Figure 12- Ménages avec des malades durant les 3 derniers mois (Enquête Insuco) .................................. 88
Figure 13- Ménages avec des personnes à charge (Enquête Insuco) ........................................................ 88
Figure 14- Ménages avec des personnes handicapées (Enquête Insuco) ................................................... 88
Figure 15- Activités économiques de la population active (Enquête Insuco) .............................................. 89
Figure 16- Ménages possédant des animaux d’élevage (Enquête Insuco) .................................................. 89
Figure 17- Activités économiques de la population active, hors agriculture et élevage (Enquête Insuco) ..... 91
Figure 18- Revenus moyens en FDJ/an en fonction du type d’activités, hors agriculture et élevage (Enquête
Insuco) ................................................................................................................................................. 91
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
8
Figure 19- Distribution des activités au sein des professions libérales et participation des femmes (Enquête
Insuco) ................................................................................................................................................. 92
Figure 20- Distribution des activités au sein des salariés et participation des femmes (Enquête Insuco) ...... 92
Figure 21- Estimation des revenus journaliers par unité de consommation du ménage (Enquête Insuco) .... 93
Figure 22- Ménages montrant des signes d’insécurité alimentaire (Enquête Insuco) .................................. 94
Figure 23- Ménages ayant reçu des aides financières de la famille (Enquête Insuco) ................................. 94
Figure 24- Matériau des toitures (EDAM 2017) ........................................................................................ 96
Figure 25- Matériau des toitures (Enquête Insuco) .................................................................................. 96
Figure 26- Matériau des murs (EDAM 2017) ............................................................................................ 96
Figure 27- Matériau des murs (Enquête Insuco) ...................................................................................... 96
Figure 28- Matériau des sols (EDAM 2017) ............................................................................................. 96
Figure 29- Matériau des sols (Enquête Insuco) ........................................................................................ 96
Figure 30- Sources d’eau des ménages (EDAM 2017) .............................................................................. 97
Figure 31- Sources d’eau des ménages (Enquête Insuco) ........................................................................ 98
Figure 32- Difficultés d’accès à l’eau (Enquête Insuco) ............................................................................ 98
Figure 33- Types de toilettes (EDAM 2017) ............................................................................................. 98
Figure 34- Types de toilettes (Enquête Insuco) ....................................................................................... 98
Figure 35- Sources d’énergie des ménages (EDAM-Energie 2004) .......................................................... 100
Figure 36- Consommation annuelle en MJ par ménage (EDAM-Energie 2004) ......................................... 100
Figure 37- Consommation annuelle du pays hors Djibouti-ville en millions de MJ (EDAM-Energie 2004) .... 100
Figure 38- Prix moyen des sources d’énergie en FDJ/MJ (EDAM-Energie 2004) ....................................... 100
Figure 39- Répartition des ménages selon la réduction du prix du kWh d'électricité jugée abordable (EDAM-
Energie 2004) ..................................................................................................................................... 101
Figure 40- Sources d’éclairage des ménages (EDAM 2017) .................................................................... 102
Figure 41- Sources d’électricité des ménages (Enquête Insuco) ............................................................. 102
Figure 42- Niveau d'équipement des ménages (Enquête Insuco) ............................................................ 103
Figure 43- Raisons justifiées par les femmes pour qu’un mari batte sa femme ........................................ 108
Figure 44 : Profil du niveau d'élévation du tracé de la ligne électrique d'Est en Ouest (km0 correspond au
poste de Nagad et km190 à la frontière entre Djibouti et l’Ethiopie) ....................................................... 120
Figure 45 : Les types de climat à Djibouti selon Köppen ........................................................................ 121
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
9
Figure 46: Températures et précipitations moyennes à Djibouti (1905-2015) .......................................... 122
Figure 47:Moyenne annuelle des précipitations à Djibouti ...................................................................... 122
Figure 48 : Distribution de la vitesse du vent à Djibouti à une hauteur de 60m ....................................... 123
Figure 49 : Géologie de Djibouti ........................................................................................................... 125
Figure 50 : Type de sols à Djibouti ....................................................................................................... 126
Figure 51 : Hydrogéologie de Djibouti .................................................................................................. 127
Figure 52 : Répartition des ressources en eaux souterraines et eau de surface à Djibouti ......................... 129
Figure 53- Typical Construction Noise Levels (Source OSHA 2003) ......................................................... 195
Table des tableaux
Tableau 3- Distances de dégagement à respecter ................................................................................... 41
Tableau 4- Calendrier de la construction de la ligne haute tension 230kV Nagad-Galafi ............................. 48
Tableau 5- Calendrier de l’extension du poste de Nagad .......................................................................... 48
Tableau 6- Grille d’évaluation de l’importance des impacts ....................................................................... 78
Tableau 7- Grille d’évaluation de la sévérite des impacts .......................................................................... 78
Tableau 8- Sévérité de l'impact et exigences en matière d'atténuation...................................................... 79
Tableau 9- Population de la zone d’influence du projet ............................................................................ 81
Tableau 10- Liste indicative des sites de patrimoine culturel .................................................................. 119
Tableau 11 : Indice de la qualité de l’air dans la zone de projet ............................................................. 123
Tableau 12 : Evaluation des impacts sociaux du projet .......................................................................... 190
Tableau 13 : Niveaux sonores typiques à plusieurs distances des équipements de travaux publics en Db(A),
Source : Geosolve & Certiprojecto (2009) ............................................................................................. 194
Tableau 14- Mesures d’atténuation et impacts sociaux résiduels du projet .............................................. 227
Tableau 15 : Mesures d’atténuation et impacts environnementaux résiduels du projet ............................. 233
Tableau 16- Système de suivi-évaluation des mesures d’atténuation sociales .......................................... 249
Tableau 17 : Système de suivi-évaluation des mesures d’atténuation environnementale .......................... 253
Tableau 18- Calendrier de mise en œuvre ............................................................................................ 262
Tableau 19- Budget estimatif de mise en œuvre du PGES ...................................................................... 263
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
10
Table des photographies
Photo 1 : terrain du futur poste de Nagad .............................................................................................. 44
Photo 2 : Vue de la localité de Tewo ...................................................................................................... 82
Photo 3 : Vue de la ville d’Ali Sabieh ....................................................................................................... 82
Photo 4 : Exemple de buul ..................................................................................................................... 95
Photo 5 : Exemple de maison en pierre .................................................................................................. 99
Photo 6 : Exemple de maison en ciment ................................................................................................. 99
Photo 7 : Exemple de maison en tôle ..................................................................................................... 99
Photo 8 : Exemple de maison en bâche .................................................................................................. 99
Photo 9 : Awello dans la région de Tadjourah (Source : Benoit Poisblaud) .............................................. 117
Photo 10 : Grand Bara en période de fortes précipitations ..................................................................... 129
Photo 11 : Acacia mellifera .................................................................................................................. 132
Photo 12 : Acacia tortilis ...................................................................................................................... 133
Photo 13 : Rhigozum somalense .......................................................................................................... 134
Photo 14 : Prosopis Chilensis ............................................................................................................... 135
Photo 15 : Exemple de tombes en pierre .............................................................................................. 171
Photo 16 : Exemple de tombe en pierre, site de patrimoine culturel ....................................................... 189
Photo 17 : Senna alexandrina .............................................................................................................. 383
Photo 18 : Calotropis Procera ............................................................................................................... 383
Photo 19 : Solanum Somalense ............................................................................................................ 384
Photo 20 : Commiphora Myrrha ........................................................................................................... 384
Photo 21 : Citrullus ecirrhosus ............................................................................................................. 385
Photo 22 : Aizoon Canariense .............................................................................................................. 385
Photo 23 : Aerva javanica .................................................................................................................... 386
Photo 24 : Aristolochia bracteolala ....................................................................................................... 386
Photo 25 : Anticharis Glandulosa .......................................................................................................... 387
Photo 26 : Hyphaene thebaica ............................................................................................................. 387
Photo 27: Papio hamadryas ................................................................................................................. 388
Photo 28 : Gazella dorcas .................................................................................................................... 388
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
11
Photo 29: Dromadaire (Camelus dromedarius) ...................................................................................... 389
Photo 30: Anes domestiqués ................................................................................................................ 389
Photo 31 : Moutons domestiqués ......................................................................................................... 390
Photo 32: Chèvres domestiqués ........................................................................................................... 390
Photo 33: Streptopelia roseogrise ......................................................................................................... 391
Photo 34: Pterocles exustus ................................................................................................................. 391
Photo 35: Oena capensis ..................................................................................................................... 392
Photo 36: Ploceus galbula .................................................................................................................... 392
Photo 37: Dépôt de sel à Yoboki .......................................................................................................... 393
Photo 38 : Une mare temporaire à Dikhil .............................................................................................. 393
Photo 39 : Une mare temporaire à Ali Sabieh ........................................................................................ 394
Photo 40 : Jardin à Ali Sabieh .............................................................................................................. 394
Photo 41: Erosion du remblais ............................................................................................................. 395
Photo 42 : mesure de prévention de l’érosion des sols ........................................................................... 396
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
12
Abréviations
CPR Cadre de Politique de Réinstallation
DISED Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques
EDAM Enquêtes djiboutiennes auprès des ménages
EDD Electricité De Djibouti
EDESIC Enquête Djiboutienne sur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation
EIES Etude d’Impact Environnemental et SocialFDJ Franc Djiboutien
MGF Mutilation Génitale Féminine
MGM Manuel de gestion de la main-d’œuvre
PAM Programme Alimentaire Mondiale
PAR Plan d’Action de Réinstallation (RAP en anglais)
PA-VBG Plan d’action contre les violences basées sur le genre
PGES Plan de Gestion Environnemental et social (ESMP an anglais)
PMPP Plan de Mobilisation des Parties Prenantes
UC Unité de consommation
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
VBG Violences Basées sur le Genre
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
13
1 Résumé exécutif
1.1 Description du projet
Le fort potentiel hydroélectrique de l'Éthiopie et les énormes investissements réalisés dans le
développement de la mise en service des centrales permettent d'exporter l'hydroélectricité vers les pays
voisins. Une première ligne de double-circuit 230kV entre l'Ethiopie et Djibouti est terminée et, depuis mai
2011, Djibouti est reliée au réseau éthiopien.
Pour accroître la fiabilité de l'approvisionnement en électricité de Djibouti, des discussions ont été
organisées entre l’Ethiopie et Djibouti afin de développer un itinéraire supplémentaire. Le Deuxième Projet
d’Interconnexion du Système d’Alimentation Electrique entre l’Ethiopie et Djibouti a ainsi pris forme avec
comme objectif la mise en place d’une ligne Haute Tension double circuit de 230kV entre Semera en
Ethiopie et Nagad à Djibouti. Les unités d’exécution du projet sont l’Ethiopian Electric Power (EEP) du côté
de l’Ethiopie et l’Electricité de Djibouti (EDD) du côté de Djibouti. Il est estimé que le budget total du projet
pour la partie djiboutienne est de l’ordre de 75 millions USD pour 190 km sur le territoire djiboutien. Les 102
km de ligne mis en place sur la partie éthiopienne sont considérés comme des infrastructures associées du
projet djiboutien. Dans la partie Djiboutienne, le corridor sera financé par la Banque Mondiale et les
infrastructures associées, comme les extensions du futur poste de Nagad, par la Banque Africaine de
Développement.
1.2 Objectifs de l’EIES
Une EIES a été formulée en 2017 pour ce projet qui a été validée au niveau du Gouvernement Djiboutien.
Cependant l’EIES n’est pas considérée comme conforme aux standards de la Banque Mondiale et de la
Banque Africaine de Développement. C’est pourquoi l’EDD a demandé à Insuco d’actualiser l’EIES en ne
prenant en compte que la partie djiboutienne du projet et en excluant donc la partie éthiopienne. L’EIES de
la partie Ethiopienne ayant déjà été approuvé par la Banque Africaine de Développement.
L’actualisation de l’EIES évaluera la composante suivante du projet :
La construction de la ligne double circuit de 230 kV entre Nagad et Galafi, à la frontière éthiopienne
(190 km)
L’alternative retenue est la moins perturbatrice pour les communautés locales et l’environnement. C’est le
constructeur de la ligne de transmission qui aura la responsabilité de finaliser la conception de la ligne et du
corridor, de sorte que le tracé actuel pourrait faire l’objet de légères modifications. Cependant ces
modifications devraient être minimes et on peut considérer que l’avant-projet actuel apporte suffisamment
d’information sur l’emplacement et les caractéristiques du corridor pour que l’on puisse mener l'évaluation
des impacts environnementaux et sociaux potentiels dans le cadre de cette EIES et proposer des mesures
d’atténuation adéquates.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
14
1.3 Description de l’aire du projet
La zone d'étude comprend les activités et les structures qui seront évaluées dans l'étude d'impact, en
considérant toutes les composantes du projet soumises par le promoteur ainsi que leurs effets. En ce sens,
la zone d'étude doit comprendre la zone d’emprise et les zones d'influence des impacts sociaux et
environnementaux liés au projet.
La zone d’emprise correspond à la zone qui va être directement touchée par le projet et comprend l'étendue
physique des travaux proposés, définie par les limites des terrains à acquérir ou à utiliser (temporairement
ou en permanence) par le projet. La zone d’emprise du projet mesure 760 hectares mais la zone d’étude
détaillée de l’emprise est de 1900 hectares, elle correspond à la zone sur laquelle a été réalisée l’étude
d’occupation des sols et à l’intérieur de laquelle la zone d’emprise se situera.
La zone d’influence correspond aux zones susceptibles d’être affectées par des activités non planifiées mais
techniquement prévisibles du projet. Elle peut être scindée en deux zones :
- La zone d’influence sociale qui correspond à la zone d’étude sociale de l’EIES dans laquelle il est
possible que des impacts directs, indirects ou cumulatifs liés au projet que ce soit pendant la phase
de construction ou la phase d’opération de la nouvelle ligne électrique existent.
- La zone d’influence environnementale qui comprend des éléments essentiels sur le site du projet (tel
que le poste de Nagad) et une zone tampon le long de l'emprise de la ligne de transmission et
jusqu'à 2 km autour du site du projet.
1.4 Méthodologie de l’étude
Cette EIES évalue les impacts environnementaux et sociaux potentiels de la construction et de l'exploitation
de la ligne de transmission Nagad-Galafi.
La méthodologie intègre les approches suivantes :
- Une recherche documentaire et bibliographique en collaboration avec l’EDD.
- Une analyse via photo-interprétation de l’occupation des sols de la zone d’étude de l’emprise du
projet en s’appuyant sur l’observation des images satellites disponibles sur Google Earth.
- Des visites sur le terrain visant à identifier les parties prenantes susceptibles d'être affectées par le
projet ainsi que les principaux problèmes et impacts environnementaux associés au projet proposé à
travers des observations in situ du tracé et de sa zone d’étude.
- Des consultations qualitatives : des réunions ont été organisées avec les différents acteurs du projet.
- Des enquêtes quantitatives : l'analyse quantitative de la population est essentielle pour construire
une base statistique solide sur laquelle les impacts peuvent être mesurés et suivis.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
15
1.5 Organisation institutionnelle
Acteurs Responsabilités
EDD
Désignation de.s expert.e.s social et environnemental au sein de l’EDD chargé.e.s de
la supervision de la construction de la ligne
Production des documents associés à l’EIES : PAR, PGES etc. et diffusion de ces
documents
Recrutement et supervision du bureau d’étude d’ingénieurs conseils (maitrise
d’œuvre sociale et maitrise d’œuvre environnementale) en charge de superviser et
mener à bien les différentes phases du PGES
Validation et diffusion du design final du projet
Recrutement et supervision de la maitrise d’œuvre technique
Information vis-à-vis de la BM
Instances locales
et autorités
coutumières
Enregistrement des plaintes et réclamations et traitement selon le mécanisme de
gestion des plaintes
Entreprise
contractante
Mise en œuvre des travaux
Responsable des entreprises sous-contractantes et fournisseurs
Ingénieurs
Conseils
(supervision des
travaux)
Validation du design
Dimensionnement et implantation précises des ouvrages
Participation au suivi de l’atténuation des impacts
Maitrise d’œuvre
sociale
Participation à la finalisation du design du projet
Sensibilisation et formation des communautés locales et des travailleurs
Réalisation des études socioéconomiques nécessaires à la réduction des impacts
Mise en œuvre, suivi et partage du PGES
Renforcement de capacités des parties prenantes
Evaluation à mi-parcours du processus
Evaluation et audit finales du processus
Maitrise d’œuvre
environnementale
Participation à la finalisation du design du projet
Réalisation des études et inventaires nécessaires à la réduction des impacts
Mise en œuvre, suivi et partage du PGES
Renforcement de capacités des parties prenantes
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
16
Suivi ornithologique
Evaluation à mi-parcours du processus
Evaluation et audit finales du processus
1.6 Synthèse des principaux impacts et leurs mesures d’atténuation
1.6.1 Impacts sociaux
Description de l’impact Mesure d’atténuation ou d’optimisation
IMPACTS POSITIFS SUR LES CONDITIONS ECONOMIQUES
Impact 1- Amélioration de
l’approvisionnement en électricité
Mesures d’optimisation :
- Diminution du cout du kwh pour les populations locales
Impact 2- Création d'emplois directs et
indirects liés au projet
Mesures d’optimisation :
- Favoriser les populations locales et les femmes lors des
processus de recrutement
- Promouvoir des conditions de travail sûres et saines
IMPACTS SUR L’UTILISATION DES TERRES ET LES POSSIBLES DEPLACEMENTS
Impact 3- Restriction des usages et pertes
potentielles dans le corridor du projet
- Maintenir le corridor de sécurité de la ligne de 40 m de
large dans la zone d’emprise1
- Exiger à la maitrise d’œuvre technique de
n’endommager aucun bien durant le câblage
- En cas de destruction, compenser les pertes
économiques et culturelles selon le CPR
- Concerter des actions de développement avec les
localités riveraines comme reconnaissance d’un droit
de servitude
- Informer et consulter la population
Impact 4- Perte temporaire de terres
(campements, stockage, accès)
- Minimiser et marquer les zones d’acquisition et exiger
aux travailleurs de les respecter
- Eviter d’inclure des biens économiques ou culturels
dans les zones et compenser les biens détruits
- Exiger au constructeur un plan de fermeture des
1 Si le couloir de sécurité ne se maintenait pas dans la zone d’emprise du projet il faudrait actualiser l’étude d’occupation des sols et en
particulier s’assurer qu’aucun logement ne se trouve dans la nouvelle zone.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
17
campements spécifiant les opérations de réhabilitation
des terrains
- Informer et consulter la population
Impact 5- Perte permanente de terres
(pylônes, poste de Nagad et routes)
- Minimiser et marquer les zones d’acquisition et exiger
aux travailleurs de les respecter
- Eviter d’inclure des biens économiques ou culturels
dans les zones et compenser les biens détruits
- Informer et consulter la population
IMPACTS SUR LA SANTE ET SECURITE DES COMMUNAUTES
Impact 6- Tensions sociales dues à des
comportements inappropriés de travailleurs
extérieurs
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite
- Former les employés sur les comportements
inappropriés et les sanctions encourues
- Consulter les okals2 pour identifier de possibles
incidents et s’accorder sur des mesures correctives
Impact 7- Augmentation des VBG du fait de
l’afflux de travailleurs extérieurs
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite
- Former les employés sur les comportements
inappropriés et les sanctions encourues
- Mettre en œuvre des actions de prévention et
protection contre les VBG
- Consulter les okals pour identifier des préoccupations
Impact 8- Augmentation de l'incidence des
maladies transmissibles, en particulier des
MST
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite
- Sensibiliser les travailleurs et la population riveraine
aux pratiques sexuelles sûres
- Consulter les okals pour identifier des préoccupations
Impact 9- Augmentation de l'incidence de la
COVID-19
- Sensibiliser les travailleurs et la population riveraine
aux protocoles sanitaires ainsi qu’aux signes de la
maladie
- Isoler les personnes présentant des symptômes
2 Les okals sont les leaders communautaires.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
18
Impact 10- Augmentation des risques
d’accident pour la population locale
- Exiger à l’entreprise contractante un plan de gestion du
trafic
- Marquer et sécuriser les zones de construction et
limiter les points d’accès
- Equiper les pylônes de dispositifs anti-escalade et de
panneaux d’avertissement avec des symboles
graphiques
Impact 11- Impacts des champs
électromagnétiques
Pas de mesure proposée car l’impact est déjà considéré
comme mineur
Impact 12- Pression accrue sur les services
de base du fait de l’afflux de travailleurs
- Exiger à l’entreprise contractante de proposer des
installations sanitaires et des systèmes d’eau potable et
de gestion des déchets indépendants des services
locaux existants
- Consulter les okals pour identifier de possibles
incidents et s’accorder sur des mesures correctives
IMPACTS SUR LA SANTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS
Impact 13- Risques de discrimination des
travailleurs
- Définir une politique de recrutement, des critères de
sélection et des possibilités de formation clairs et
transparents
- A compétences égales, promouvoir le recrutement des
populations locales, des jeunes et des femmes3
- Proposer des mesures de prévention contre le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Impact 14- Risques de conditions de travail
non adéquates
- Définir les principes de gestion des employés de
l'entreprise contractante et sous-traitants
- Proscrire l'exploitation des travailleurs informels et des
enfants
- Assurer un mécanisme de gestion des griefs anonyme
et connu des employés
- Loger les travailleurs selon les normes internationales4
(eau potable gratuite, toilettes, cantine, zone de repos,
etc.)
- Exiger à l’entreprise contractante de faire respecter les
points précédents par les sous-traitants
3 Cependant, il est important de savoir que certains postes peuvent ne pas être occupés par des femmes pour des raisons sociales.
4 Voir Workers' Accommodation: Processes and Standards de la Banque Mondiale
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
19
- Définir les principes de gestion des employés
- Assurer un mécanisme de gestion des griefs anonyme
et connu des employés
Impact 15- Expositions des travailleurs à des
risques physiques et chimiques
- Suivre les exigences de santé et sécurité au travail de
la législation djiboutienne, de la BM et de la BAD
- Exiger aux sous-traitants de se conformer aux mêmes
exigences que l’entreprise contractante
- Fournir un équipement adéquat et gratuit aux
travailleurs (gants, lunettes, casque, harnais, etc.)
- Former tous les travailleurs sur les exigences de santé
et de sécurité au travail
- Equiper les pylônes d'un système d'identification
permanente
- Proposer des inspections de ligne via des drones pour
diminuer les risques de chute
IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
Impact 16- Détérioration de sites d’héritage
culturel-
- Réaliser une étude détaillée des tombes recensées
dans le PAR pour identifier de potentiels awellos.
- Eviter d’inclure des biens culturels dans les zones
d’acquisition temporaire et permanente
- Compenser et déplacer les biens ne pouvant être évités
- Informer et consulter les okals et la population durant
tout le processus
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
20
1.6.2 Impacts environnementaux
Description de l'impact
Mesures d’atténuation ou d’optimisation
IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
Impact 1 – Dégradation de la
qualité de l'air
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise pour la phase de
construction, mais La mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
environnementale de la Banque Mondiale est recommandée5.
- Les émissions fugitives de poussières provenant de diverses activités telles que
l'excavation, le transport de matériaux (chargement et déchargement) et le
déplacement de véhicules (sur des routes non pavées) peuvent être réduites au
minimum grâce aux bonnes pratiques standard des chantiers de construction
(limitation de vitesse, contrôle des niveaux, etc)
- Les émissions des véhicules seront contrôlées par la maitrise d’œuvre technique
grâce à une inspection et un entretien approprié des véhicules pour minimiser les
niveaux de pollution
Impact 2 – Emission de bruit
et de nuisance sonore
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise et la mise en œuvre de
bonnes pratiques de gestion environnementale de la BM est recommandée5.
- Protection auditive (bouchons d'oreille) pour les travailleurs de la construction
IMPACT SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS
Impact 3 – Impact sur la
géologie et la géomorphologie
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise en œuvre de
bonnes pratiques de gestion environnementale est recommandée5 :
- Réaliser une évaluation ou une étude géotechnique pour la conception détaillée
des pylônes et du poste de Nagad
- Restreindre les activités de terrassement aux zones de construction strictement
nécessaires
Impact 4 - Changements dans
les processus de
sédimentation
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise en œuvre de
bonnes pratiques de gestion environnementale standard est recommandée5 :
- Limiter le défrichement de la végétation et le décapage de la couche arable aux
zones strictement nécessaires
- S'en tenir aux routes existantes, lorsque cela est possible, pour minimiser les
impacts sur les sols non perturbés
- Minimiser l'exposition du sol pendant les périodes de fortes pluies lors des
excavations et des activités de terrassement
- Veiller à ce que toutes les zones de construction de lignes électriques et du poste
de Nagad fassent l'objet d'un examen adéquat par des ingénieurs géotechniques et
des géologues afin de détecter les sols expansibles/affaissés et les zones
potentielles d'instabilité des pentes avant la construction
5 . La mise en œuvre de ces pratiques seront encouragées et contrôlées par l’EDD et la maitrise d’œuvre sociale.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
21
Impact 5 - Augmentation de
l'érosion et du compactage
des sols
- Privilégier l'utilisation des voies d'accès existantes pour accéder aux sites de
travail
- Limiter le défrichement de la végétation et l'enlèvement de la couche arable aux
zones strictement nécessaires à la construction
- Décaper et stocker la terre végétale avant les activités de terrassement pour la
réutiliser ultérieurement dans les travaux de réhabilitation
- Protéger les sols stockés provisoirement dans le cadre du Plan de gestion
environnementale
- Éviter la construction de pylônes dans les basses terres et les zones de pente
importantes afin de réduire les risques d'érosion du sol par la pluie et le vent
Impact 6 – Contamination des
sols
- Si un déversement se produit, un kit et une procédure d'urgence doivent être
utilisés pour réduire immédiatement la propagation potentielle du déversement
- Interdire le déversement de tout type d'eau résiduelle non traitée dans le sol et/ou
les ressources en eau (rivières, ruisseaux, sources, lagunes, aquifères, etc.)
- Élaborer un plan de gestion des déchets, en suivant les lignes directrices fournies
dans le PGES
IMPACT SUR LE PAYSAGE ET IMPACT VISUEL
Impact 7 - Changement du
paysage et impacts visuels
Tous les effets paysagers et visuels ne peuvent pas être atténués de manière
pratique pendant la phase de construction et d'opération een raison de la hauteur
de la plupart des éléments du projet, du paysage ouvert et de l'absence de
végétation naturelle.Il ne sera pas possible de réaliser un écran visuel avec de la
végétation et il est peu probable que l'on puisse atténuer les éventuels effets
paysagers et visuels pendant l'opération
Cependant, plusieurs mesures peuvent cependant être appliquées pour réduire,
dans la mesure du possible, les effets négatifs pendant la phase de construction :
- Limiter le défrichement et l'occupation des sols au minimum nécessaire pour les
travaux
- Limiter l'éclairage du chantier en dehors des heures normales de travail, autant
que possible, au minimum nécessaire pour la sécurité et la sûreté ; et
- Maintien de la propreté et du confinement du site
IMPACT SUR L’EAU
Impact 8 - Modifications du
schéma de ruissellement
naturel des eaux
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise
IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Impact 9 - Emission de gaz à
effet de serre
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
22
Impact 10 - Perte directe de
végétation ou d’habitats
- Limiter strictement le défrichement de la végétation aux zones requises, en
particulier dans les zones d'habitats naturels
- Dans la mesure du possible, mettre les arbres coupés à la disposition des
communautés locales pour qu'elles les ramassent et les utilisent comme matériaux
de construction ou à d'autres fins
- Éviter d'installer des camps de construction et des terriers dans les habitats
naturels
- Éviter d'installer des pylônes et des routes d'accès dans les oueds
- Réhabiliter et revégétaliser la zone aussi tôt que possible
- Le tracé de la ligne de transmission chevauche la zone du projet de la Grande
Muraille Verte. La perte de couverture végétale peut être compensée par la
plantation d'arbres indigènes dans le cadre d'initiatives d'agroforesterie et de
reboisement en partenariat avec le projet de la Grande Muraille Verte
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
Impact 11 - Exclusion
d'espèces de faune en raison
de l'augmentation des
perturbations
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise en œuvre de
bonnes pratiques environnementales de la BM suffira, telles que :
- Limiter le défrichement de la végétation aux zones requises, en particulier dans
les zones d'habitats naturels et les oueds
- Dans la mesure du possible, de nouveaux accès seront créés sur la base des
accès existants
- Les activités de défrichement de la végétation seront accompagnées par un
spécialiste en écologie/biologie pour détecter tout site de perchage et/ou de
reproduction important à proximité des zones de défrichement et mettre en œuvre
des mesures de précaution
- Éviter autant que possible les travaux de construction pendant la nuit
- Minimiser l'éclairage dans les camps de construction
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets
Impact 12 – Augmentation de
la mortalité des espèces de
faune due aux mouvements
de véhicules et aux activités
de construction
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise en œuvre de
bonnes pratiques environnementales de la BM est recommandée :
- Des restrictions de vitesse sur le site seront mises en place, que tous les
conducteurs de véhicules devront respecter
- Entreprendre une formation de sensibilisation des conducteurs sur les espèces
présentes dans la zone qui peuvent être affectées par les collisions de véhicules
- Mettre en place un système d'exploitation forestière exigeant des travailleurs de la
construction et des conducteurs qu'ils signalent toute observation ou collision
d'espèces de faune et permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures
d'atténuation supplémentaires si nécessaire (par exemple, utilisation de brise-
vitesse près des zones identifiées comme à haut risque, clôtures, réflecteurs de
lumière)
- Vérifier les relevés des zones de construction chaque matin afin de détecter les
reptiles, en particulier les serpents, qui auraient pu pénétrer dans les zones de
construction, les tranchées, etc. pendant la nuit
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
23
Impact 13: Fuites /
déversements accidentels
entraînant la dégradation de
l'habitat
Aucune mesure d'atténuation ou de gestion environnementale ou sociale n'est
requise. Les lignes directrices générales en matière d'ESS doivent être suivies
Impact 14 - Augmentation de
la mortalité des oiseaux
migrateurs planneurs par
électrocution et collision
Les mesures d'atténuation suivantes devraient être mises en œuvre pour réduire
les risques de collision et d'électrocution principalement dans les sections des
projets situées à proximité des zones sensibles aux oiseaux (Assamo, Djalelo,
Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul Kabah Kabah)
Réduire les risques de collision :
- Utilisation de déflecteurs d'oiseaux dans les zones à fort impact, en particulier le
long des voies de migration. Ceux-ci devraient augmenter la visibilité de la ligne en
épaississant l'apparence de la ligne d'au moins 20 cm sur une longueur de 10-20
cm
- Les marqueurs doivent être mobiles, de couleurs contrastées (par exemple noir et
blanc), contraster avec le fond, dépasser au-dessus et en dessous de la ligne et
être placés à 5-10 m l'un de l'autre
- Enlever le mince fil neutre ou de terre (blindage) au-dessus des lignes de
transmission à haute tension lorsque cela est possible, et lorsque cela n'est pas
possible, marquer la ligne pour la rendre plus visible
- Regrouper les fils à haute tension et utiliser des entretoises pour accroître la
visibilité
Réduire le risque d'électrocution :
- Concevoir des lignes électriques et des pylônes associés pour réduire le risque
d'électrocution
- Suspendre les isolateurs sous les bras et les poteaux, à condition que la distance
entre un perchoir probable (principalement le bras) et les parties sous tension
(conducteurs) soit d'au moins 70 cm
- Recouvrement des isolateurs verticaux avec un matériau non conducteur et
l'utilisation d'un matériau non conducteur pour fixer les isolateurs aux poteaux
- Isoler les câbles à proximité des poteaux, sur au moins 70 cm des deux côtés et
autour des zones de perchage, et jusqu'à au moins 140 cm dans les zones où se
trouvent de grands oiseaux en vol
- Lorsque le poteau est en acier, isoler toutes les lignes conductrices
- Sur les structures de traction où des cavaliers sont utilisés, au moins deux fils de
liaison doivent être suspendus sous la traverse et le troisième doit être isolé, ou
tous les cavaliers doivent être isolés
- Prévoir des plates-formes de nidification et de perchage sûres au-dessus du
poteau, à une hauteur minimale de 70 cm au-dessus des éléments sous tension, ou
plus haut selon les espèces présentes
- L'espacement entre les conducteurs ne doit pas être inférieur à 140 cm, et 70 cm
entre les sites de perchage et les composants sous tension
- Dans les zones où se trouvent de grands oiseaux planeurs, l'espacement entre les
composants sous tension ou l'isolation devrait être supérieur à 2,7 m
horizontalement et à 1,8 m verticalement
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
24
- prévoir des zones de perchage sûres et utiliser des techniques de gestion des
perchoirs
Mener des enquêtes post-construction (recherches de carcasses et enquêtes de
mortalité et évaluation des perturbations et des déplacements) sur les points
chauds prévus et connus (tels que les zones sensibles aux oiseaux d'Assamo,
Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul Kabah Kabah) à intervalles
rapprochés pendant au moins trois ans.
Impact 15 - Défrichement de la
végétation entraînant la perte
d'habitats et d'espèces
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en œuvre pendant la phase
de construction du projet :
- Des études de contrôle des oiseaux nicheurs devraient être entreprises avant le
déblaiement de toute végétation. Si des nids actifs sont enregistrés, le nettoyage de
la végétation doit être retardé jusqu'à ce que la nidification soit terminée et que la
zone de nidification soit protégée des perturbations dans un rayon défini par un
ornithologue dûment qualifié
- Les pylônes et les voies d'accès ont été situés en dehors des canaux des oueds
dans la mesure du possible
- La perte d'habitat sera limitée au minimum nécessaire pour une mise en œuvre
sûre des travaux
Impact 16 - Activité et bruit
entraînant une perturbation
des espèces
- Éviter, dans la mesure du possible, le dynamitage et le martèlement des roches
pendant la saison de reproduction
- Le PGE détaillera les mesures de meilleures pratiques, y compris celles ci-dessus
et d'autres à mettre en œuvre pour réduire le risque d'impacts secondaires sur les
oiseaux, notamment pour contrôler la poussière, le bruit et l'activité générale
Impact 17 – Menace de
l'intégrité d'une zone protégée
terrestre traversée par la ligne
électrique
- Modifier légèrement la localisation de la ligne électrique pour éviter de traverser la
zone protégée de Djalelo en déplaçant un pylône dans la direction sud-est afin de
s'assurer que la ligne électrique ne traversera pas la zone protégée et respectera
une zone tampon de 1 km.
1.7 Suivi et mise en œuvre du PGES
Un système de suivi et d'évaluation doit permettre de contrôler le niveau de mise en œuvre des différentes
actions du PGES et d'évaluer leur mise en œuvre, leur pertinence et leur efficacité au fur et à mesure de leur
réalisation. Le système géré en interne doit permettre d'adapter les propositions lorsque cela est nécessaire.
Un rapport annuel de suivi sera élaboré par l’unité de gestion de projet de l’EDD pendant la phase de
construction puis pendant la phase d'exploitation afin d'analyser les indicateurs collectés et de proposer des
mesures d'atténuation supplémentaires si nécessaire. Un audit environnemental et social sera réalisé par
une organisation indépendante avant la clôture du projet. Il permettra de vérifier les principaux indicateurs
d'impact.
Les activités de suivi comprennent :
Des visites régulières sur le site permettent d'observer la gestion des dispositions du PGES ;
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
25
Analyse des différents paramètres environnementaux et de sécurité ;
Échantillonnage des sites pour analyser la conformité aux exigences en matière d'ESS ;
Réunions régulières sur le site avec l'EDD et le contractant pour discuter des préoccupations en
matière de normes Environnementales et sociales.
Ces activités garantiront une mise en œuvre et une gestion efficace des mesures d'atténuation proposées.
En outre, les nouveaux et imprévus impacts identifiés, non examinés dans le PGES, seront facilement
enregistrés et traités tout au long du projet. L’entreprise contractante et l’entreprise en charge de la
supervision des travaux (ingénieurs conseils) devront employer responsable HSE local et des superviseurs
NES locaux spécifiques au site pour assurer la conformité avec PGES. L’ingénieur Conseil nommé par
l’entreprise contractante veillera également à ce que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre tout
au long des phases du projet.
Le dispositif de suivi / évaluation de la gestion environnementale, sanitaire et sociale proposera des activités
de contrôle qui seront menées durant toutes les phases du projet. L'entreprise contractante et l’ingénieur
conseil seront mandaté pour proposer des mesures qui garantiront l'exécution du dispositif pendant la phase
de construction. Les experts en environnement et social de l’EDD qui guiderons et superviseront le
contractant dans la mise en œuvre du PGES. Les experts feront régulièrement rapport à l'EDD sur le respect
du PGES par le contractant. Le niveau de contrôle périodique à l'achèvement des activités de construction
sera déterminé lors de la phase opérationnelle.
La Direction de l'Environnement et du Développement Durable (DEDD) du Ministère de l'Urbanisme, de
l'Environnement et du Tourisme devra également jouer un rôle majeur de suivi externe du PGES,
conformément au cadre légal djiboutien. Elle devra ainsi assurer un rôle de contrôle régalien (inspection) en
« veillant au respect des règles de bonne gestion et des normes tant nationales qu’internationales » et « en
assurant le suivi de la conduite de la procédure d’étude d’impact environnemental ».
1.8 Budget estimatif de mise en œuvre du PGES
Plans d’action Objet Description Quantité PU (€) Total (€)
Plan de Mobilisation
des Parties
Prenantes
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE + 4 agents
communautaires
Opération : 0,25 superviseur
HSE
1 forfait 75.000
Consultations publiques Construction : 8/an
Opération : 4/an
176 200 35.200
Impression support
d'information
Montant forfaitaire 1 forfait 15.000
Mise en œuvre du
mécanisme de gestion
des plaintes
Montant forfaitaire 1 forfait 20.000
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
26
Plan d'Action de
Réinstallation
Elaboration du PAR Montant forfaitaire 1 forfait 70.000
Mise en œuvre Montant forfaitaire + 0,25
superviseur HSE
Non connu
Procédure de
gestion de la main
d'œuvre
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE
Opération : 0,125 superviseurs
HSE
1 forfait 33.000
Formations Construction : 26/an (dont 2
santé) Opération : 1/an
52
40
400
400
38.400
16.000
Mécanisme de gestion
des plaintes
Suivi des plaintes 1 forfait 5.000
Procédure de
gestion de la main
d’œuvre (entreprise
contractante, forfait
à inclure dans le
DAO)
Personnel / formation /
suivi-évaluation / gestion
sous-contractants
Montant forfaitaire 1 forfait 30.000
Plan d'action contre
les VBG (EDD)
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE
Opération : 0,125 superviseurs
HSE
1 forfait 33.000
Personnel Expert genre (temps partiel) 1 forfait 16.500
Formations Construction : 24/an
Opération : 1/an
88 400 35.200
Sensibilisation des
travailleurs
Montant forfaitaire : 2/an 2 400 800
Impression support
d'information
Montant forfaitaire 1 forfait 15.000
Facultatif - Personnel Construction : 1 agent de
vérification indépendant pour
des missions courte (30 jours
par an)
1 forfait 15.000
Plan d'action contre
les VBG (entreprise
contractante, forfait
à inclure dans le
DAO)
Personnel/formation/suivi-
évaluation
Montant forfaitaire 1 forfait 30.000
Service d’appui aux
victimes (transport, soin,
etc)
Montant forfaitaire 1 forfait 10.000
Disposition contre la
propagation de la
COVID-19
Equipement
Equipement de protection
individuel (masque, gel
hydroalcoolique), mise aux
1 forfait 20.000
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
27
Formations
normes sanitaires
Tests de dépistage
Information et communication
sur le virus et les dispositions
anti-COVID 19
Activités de suivi interne du PGES 7% du total 31.017
Activités de suivi externe du PGES 5% du total 22.155
Total EDD (sans forfait inclus dans DAO)
496.272
Total PGES (sans mise en œuvre du PAR) 566.272
2 Executive summary
2.1 Project’s description
Ethiopia's strong hydropower potential and the huge investments made in the development of power plant
commissioning allow hydropower to be exported to neighboring countries. A first 230kV double circuit line
between Ethiopia and Djibouti has been completed and, since May 2011, Djibouti has been connected to the
Ethiopian grid.
To increase the reliability of Djibouti's electricity supply, discussions were held between Ethiopia and Djibouti
to develop an additional route. The Second Electricity Supply System Interconnection Project between
Ethiopia and Djibouti has thus taken shape with the objective of setting up a 230kV double-circuit high
voltage line between Semera in Ethiopia and Nagad in Djibouti. The project implementation stakeholders are
Ethiopian Electric Power (EEP) on the Ethiopia side and Djibouti’s Electricity (EDD) on the Djibouti side. It is
estimated that the total budget of the project for the Djiboutian part is of the order of 75 million USD for 190
km on the Djiboutian territory. The 102 km of line set up on the Ethiopian part are planned as associated
infrastructures of the Djibouti project. In the Djiboutian part, the corridor will be financed by the World Bank,
and associated infrastructure, such as the extensions of the future sub-sation of Nagad, by the African
Development Bank.
2.2 Study’s objectives
An ESIA (Environmental and Social Study Assessment) was formulated in 2017 for this project which was
validated by the Djiboutian Government. However, the ESIA is not considered to comply with the standards
of the World Bank and the African Development Bank. This is why the EDD asked Insuco to update the ESIA
taking into account only the Djiboutian part of the project and therefore excluding the Ethiopian part. The
ESIA of the Ethiopian side having already been approved by the African Development Bank.
The update of the ESIA will assess the following component of the project:
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
28
• Construction of the 230 kV double circuit line between Nagad and Galafi, on the Ethiopian border (190
km)
• Futur Nagad 230/63/20Kv post and its extentsion
The chosen alternative is the least disruptive to local communities and the environment. The transmission
line builder will be responsible for finalizing the line and corridor design, so the current route may be subject
to slight modifications. However, these modifications should be minimal and one may consider that the
current preliminary design provides sufficient information on the location and characteristics of the corridor so
that the assessment of potential environmental and social impacts can be carried out within the framework of
this ESIA and proposing adequate mitigation measures.
2.3 Project area description
The study area includes the activities and structures that will be assessed in the impact study, considering all
the project components submitted by the promotor as well as their effects. In this sense, the study area must
include the area of influence and the areas of influence of the social and environmental impacts associated
with the project.
The right-of-way area corresponds to the area likely to be directly affected by the project and includes the
physical extent of the proposed work, defined by the boundaries of the land to be acquired or temporarily
used by the project. The project area therefore measures 760 hectares, but the company's detailed study
area is 1900 hectares and corresponds to the area in which the land use study was carried out.
The area of influence corresponds to the areas likely to be affected by unplanned but technically foreseeable
activities of the project. It can be split into two areas:
- The area of social influence which corresponds to the social study area of the ESIA in which it is possible
that direct, indirect or cumulative impacts related to the project, whether during the construction phase or the
operation phase of the new power line occur.
- The zone of environmental influence which includes essential elements on the project site (such as the
Nagad substation) and a buffer zone along the right-of-way of the transmission line and up to 2 km around
the site of the project.
2.4 Study’s methodology
This ESIA assesses the potential environmental and social impacts of the construction and operation of the
Nagad-Galafi transmission line.
The methodology integrates the following approaches:
- Documentary and bibliographic research in collaboration with EDD
- An analysis via photo-interpretation of the land use of the project footprint study area based on the
observation of satellite images available on Google Earth.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
29
- Field visits aimed to identify the stakeholders likely to be affected by the project as well as the main
environmental problems and impacts associated with the proposed project through in situ observations of the
route and its study area.
- Qualitative consultations: meetings were organized with the various actors of the project,
- Quantitative surveys: quantitative analysis of the population is essential to build a solid statistical base on
which impacts can be measured and tracked.
2.5 Institutionnal organisation
Acteurs Responsabilités
EDD
Designation of social and environmental expert.s within EDD responsible for
supervising the construction of the line
Production and diffusion of documents associated to the ESIA
Recruitment and supervision of the consulting engineers study office.s (social and
environmental project management) in charge of supervising and implement of the
different phases of the environmental and social mitigation plan
Validation and diffusion of the final project design
Recruitment and supervision of the technical project management
Information regarding WB
Local and
traditional
authorities
Registration of complaints and claims and monitoring of the complaints’ mechanism
Contractor
Implementation of works
Responsible for subcontracting companies and suppliers
Consulting
engineer (works’
supervision)
Design validation
Precise sizing and location of the structures
Participation in the monitoring of impacts mitigation
Social project
management
Participation in the finalization of the project design
Sensitization and training of local communities and workers
Carrying out the socio-economic studies necessary to reduce the impacts
Implementation, monitoring and disclosure of the ESMP
Capacity building of stakeholders
Mid-term evaluation of the process
Final evaluation and audit of the process
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
30
Environmental
project
management
Participation in the finalization of the project design
Carrying out the studies and inventories necessary to reduce the impacts
Implementation, monitoring and disclosure of the ESMP
Capacity building of stakeholders
Ornithological monitoring
Mid-term evaluation of the process
Final evaluation and audit of the process
2.6 Summary of major impacts and mitigation measures
2.6.1 Social impacts
Impacts description Mitigation or optimisation measures
POSITIVE IMPACTS ON ECONOMICAL CONDITIONS
Impact 1- Improvement of
electricty supply
Optimization measures:
- Reduction in the cost of kwh for local populations
Impact 2- Creation of direct
and indirect jobs
Optimization measures:
- Encourage local populations and specially women during the recruitment
process
- Promote safe and healthy working conditions
IMPACTS ON LAND USE AND POSSIBLE RELOCATION
Impact 3- Uses restriction
and possible losses in the
project corridor
- Maintain safety corridor of 40 meters wide line in the right-of-way area
- Require the technical project manager not to damage any property during
wiring
- In case of destruction, compensate for economic and cultural losses according
to the RFP
- Coordinate development actions with neighboring localities as recognition of a
right of easement
- Inform and consult the population
Impact 4- Temporary loss of
lands (camps, storage,
access)
- Minimize and mark acquisition areas and require workers to respect them
- Avoid including economic or cultural goods in areas and compensate for
destroyed goods
- Require from the builder a plan for closing the camps specifying the land
rehabilitation operations
- Inform and consult the population
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
31
Impact 5- Permanent loss of
lands (pylons, Bagad
substation and roads
- Minimize and mark acquisition areas and require workers to respect them.
- Avoid including economic or cultural goods in areas and compensate for
destroyed goods
- Inform and consult the population
IMPACTS ON COMMUNITY HEALTH AND SECURITY
Impact 6- Social tensions
due to inappropriate
behavior of external workers
- Prohibit workers from going to neighboring localities and require them to
respect a code of good conduct
- Train employees on inappropriate behavior and penalties incurred
- Consult the okals to identify possible incidents and agree on corrective
measures
Impact 7- Increase of Gender
Based Violences due to the
influx of workers
- Prohibit workers from going to neighboring localities and require them to
respect a code of good conduct
- Train employees on inappropriate behavior and the penalties incurred
- Implement prevention and protection actions against GBV
- Consult okals to identify concerns
Impact 8- Increased
incidence of communicable
diseases in particular STDs
- Prohibit workers from going to neighboring localities and require them to
respect a code of good conduct
- Raise awareness among workers and the local population about safe sex
practices
- Consult okals to identify concerns
Impact 9- Increased
incidence of COVID-19
- Raise awareness among workers and the local population of health protocols
as well as signs of the disease
- Isolate people with symptoms
Impact 10- Increase accident
risks for the local population
- Require the contractor to have a traffic management plan
- Mark and secure construction areas and limit access points
- Equip pylons with anti-climbing devices and warning signs with graphic
symbols
Impact 11- Impacts of
electromagnetic fields No measure proposed because the impact is already considered as minor
Impact 12- Increased
pressure on basic services
due to the influx of workers
- Require the contractor to provide sanitation, drinking water and waste
management systems independent of existing local services.
- Consult the okals to identify possible incidents and agree on corrective
measures
IMPACTS ON HEALTH AND WORKING CONDITIONS OF THE WORKERS
Impact 13- Risks of
discrimination
- Define a clear and transparent recruitment policy, selection criteria and training
possibilities
- With equal skills, promote the recruitment of local populations, young people
and women
- Propose preventive measures against sexual harassment in the workplace
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
32
Impact 14- Risks of
unsuitable working
conditions
- Define the management principles of the employees of the contractor and
subcontractors.
- Outlaw the exploitation of informal workers and children
- Ensure an anonymous grievance mechanism known to employees
- Housing workers according to international standards (free drinking water,
toilets, canteen, rest area, etc.)
- Require the contractor to ensure that the above points are respected by the
subcontractors
- Define the principles of employee management
Impact 15- Exposure of
workers to physical and
chemical risks
- Follow the occupational health and safety requirements of Djiboutian
legislation, the WB and the ADB
- Require subcontractors to comply with the same requirements as the contractor
- Provide workers with adequate and free equipment (gloves, goggles, helmet,
harness, etc.)
- Train all workers on occupational health and safety requirements
- Equip the pylons with a permanent identification system
- Propose line inspections via drones to reduce the risk of falls
IMPACT ON CULTURAL HERITAGE
Impact 16- Deterioration of
cultural heritage sites
- Carry out a detailed study of the tombs listed in the RAP to identify potential
awellos.
- Avoid cultural property in the temporary and permanent acquisition areas
- Compensate and move goods that cannot be avoided
- Inform and consult the okals and the population throughout the process
Environmental impacts
Impact description
Mitigation or optimization measures
IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
Impact 1 – Air Quality
degradation
No specific mitigation measures are required for the construction phase, but the
implementation of World Bank’s good environmental practices is recommended6
- Fugitive dust emissions from various activities such as excavation, material
transport (loading and unloading) and vehicle movement (on unpaved roads) can be
minimized through good standard construction site practices. construction (speed
limits, level monitoring, etc.)
- Vehicle emissions will be controlled by technical supervision through inspection and
proper maintenance of vehicles to minimize pollution levels
6 EDD unit project and environmental project management shall encourage and monitor those measures
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
33
Impact 2 – Noise emissions
No specific mitigation measures are required and the implementation of WB good
environmental practices is recommended6
- Hearing protection (earplugs) for construction workers
IMPACT ON GEOLOGY AND SOILS
Impact 3 – Impact on geology
and geomorphology
No specific mitigation measures are required and the implementation of WB good
environmental practices is recommended6:
- Carry out an assessment or a geotechnical study for the detailed design of the
towers and the Nagad substation
- Restrict earthmoving activities to strictly necessary construction areas
Impact 4 – Changes in
sedimentation processes
No specific mitigation measures are required and the implementation of WB good
environmental practices is recommended6:
- Limit clearing of vegetation and stripping of topsoil to strictly necessary areas
- Stick to existing roads, when possible, to minimize impacts on undisturbed soils
- Minimize soil exposure during periods of heavy rains during excavations and
earthworks
- Ensure that all power line construction areas and Nagad substation are adequately
reviewed by geotechnical engineers and geologists to detect expanding / subsiding
soils and potential areas of instability of slopes before construction
Impact 5 – Increase of erosion
and soils compaction
- Prefer the use of existing access routes to access work sites
- Limit the clearing of vegetation and the removal of topsoil to areas strictly necessary
for construction
- Strip and store the topsoil before earthwork activities to reuse it later in rehabilitation
work
- Protect the soils temporarily stored as part of the Environmental Management Plan;
- Avoid the construction of pylons in lowlands and areas of significant slope in order to
reduce the risk of soil erosion by rain and wind
Impact 6 – Soils
contamination
- If a spill occurs, an emergency kit and procedure should be used to immediately
reduce the potential spread of the spill
- Prohibit the discharge of any type of untreated residual water into the soil and / or
water resources (rivers, streams, springs, lagoons, aquifers, etc.)
- Develop a waste management plan, following the guidelines provided in the ESMP
IMPACT ON LANDSCAPE AND VISUAL IMPACTS
Impact 7 – Changes in
landscape and visual impacts
Not all landscape and visual effects can be practically mitigated during the
construction and operation phase, due to the height of most of the elements of the
project, the open landscape and the lack of natural vegetation, it will not be possible
to create a visual screen with vegetation.
However, several measures can be applied to reduce, as far as possible, the negative
effects during the construction phase:
- Limit clearing and land use to the minimum necessary for the work
- Limit site lighting outside of normal working hours, as much as possible, to the
minimum necessary for safety and security
- Maintaining the cleanliness and containment of the site
IMPACT ON WATER
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
34
Impact 8- changes in the
natural flow pattern of water
No specific mitigation measure needed.
IMPACT ON CLIMATE CHANGE
Impact 9 – Greenhouse gaz
emissions
Linked with better access to electricity. No specific optimization measure needed.
Impact 10 – Direct loss of
habitats and vegetation
- Strictly limit the clearing of vegetation to the required areas, in particular in areas of
natural habitats
- To the extent possible, make cut trees available to local communities for collection
and use as building materials or for other purposes
- Avoid installing construction camps and burrows in natural habitats
- Avoid installing pylons and access roads in wadis
- Rehabilitate and revegetate the area as soon as possible
- The route of the transmission line overlaps the Great Green Wall project area. The
loss of vegetation cover can be compensated by planting native trees as part of
agroforestry and reforestation initiatives in partnership with the Great Green Wall
project.
IMPACT ON BIODIVERSITY
Impact 11 - Exclusion of
wildlife species due to
increased disturbance
No specific mitigation measures are required. The implementation of WB good
environmental practices is recommended:
- Limit the clearing of vegetation to the required areas, in particular in areas of natural
habitats and wadis
- When possible, new accesses will be created on the basis of existing accesses
- Vegetation clearing activities will be accompanied by an ecology / biology specialist
to detect any significant perching and / or reproduction site near the clearing areas
and implement precautionary measures
- Avoid construction work at night as much as much possible
- Minimize lighting in construction camps
- Develop and implement a waste management plan
Impact 12 – Increased
mortality of wildlife species
due to vehicle movements
and construction activities
No specific mitigation measures are required. The implementation of WB good
environmental practices is recommended:
- Speed restrictions on the site will be put in place, which all vehicle drivers must
respect
- Undertake awareness training for drivers on the species present in the area which
may be affected by vehicle collisions
- Establish a logging system requiring construction workers and drivers to report any
sightings or collisions of wildlife species and allow the identification and
implementation of additional mitigation measures if necessary (use of speed breaks
near areas identified as high risk, fences, light reflectors)
- Check the readings of construction areas every morning for reptiles, especially
snakes, which may have entered construction areas, trenches, etc. overnight
Impact 13 – leaks / accidental
spills resulting in habitat
degradation
No specific mitigation measures are required. The implementation of WB good
environmental practices is recommended
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
35
Impact 14 - Increased
mortality of migratory birds by
electrocution and collision
The following mitigation measures should be implemented to reduce the risk of
collision and electrocution mainly in sections of projects located near areas sensitive
to birds (Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre and Ougul Kabah Kabah).
Reduce the risk of collision:
- Use of bird deflectors in high impact areas, particularly along flyways. These should
increase the visibility of the line by thickening the appearance of the line by at least 20
cm over a length of 10-20 cm;
- Markers must be mobile, of contrasting colors (eg black and white), contrast with the
background, protrude above and below the line and be placed 5-10 m apart;
- Remove the thin neutral or earth wire (shield) above the high voltage transmission
lines when possible, and when it is not, mark the line to make it more visible;
- Bundle the high tension wires and use spacers to increase visibility;
Reduce the risk of electrocution:
- Design power lines and associated pylons to reduce the risk of electrocution
- Suspend insulators under arms and posts, provided that the distance between a
probable perch (mainly the arm) and the live parts (conductors) is at least 70 cm
- Covering the vertical insulators with a non-conductive material and the use of a non-
conductive material to fix the insulators to the posts
- Insulate cables near poles, for at least 70 cm on both sides and around perching
areas, and up to at least 140 cm in areas where large birds in flight are found
- When the pole is made of steel, insulate all the conductive lines
- On traction structures where jumpers are used, at least two jumper wires must be
suspended under the cross member and the third must be isolated, or all jumpers
must be isolated
- Provide safe nesting and perching platforms above the post, at a minimum height of
70 cm above the elements under tension, or higher depending on the species present
- The spacing between the conductors must not be less than 140 cm, and 70 cm
between the perching sites and the live components
- In areas with large soaring birds, the spacing between live components or insulation
should be greater than 2.7 m horizontally and 1.8 m vertically
- provide safe perching areas and use perch management techniques
Conduct post-construction surveys (carcass searches and mortality surveys and
assessment of disturbance and movement) at predicted and known hot spots (such
as bird-sensitive areas of Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre and Ougul
Kabah Kabah) at frequent intervals for at least three years
Impact 15 – Clearance of
vegetation leading to the loss
of habitats and species
- Breeding bird control studies should be undertaken prior to clearing any vegetation.
If active nests are spotted, vegetation cleaning should be delayed until nesting is
complete and the nesting area is protected from disturbance within a radius defined
by a qualified ornithologist
- Pylons and access roads have been located outside the wadis channels as far as
possible
- The loss of habitat will be limited to the minimum necessary for safe implementation
of the works
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
36
Impact 16 – Activity and noise
causing disturbance of
species
- Avoid, as much as possible, blasting and hammering of rocks during the breeding
season
- The EMP will detail best practice measures, including those above and others to be
implemented to reduce the risk of secondary impacts on birds, including monitoring
dust, noise and general activity
Impact 17 – Threat to the
integrity of a land protected
area crossed by the power
line
Slightly modify the location of the power line to avoid crossing the protected area of
Djalelo by moving a pylon in a south-eastern direction to ensure that the power line
will not cross the protected area and will respect a buffer zone of 1 km
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
37
3 Description du projet
3.1 Contexte
Une première ligne de double-circuit 230kV entre l'Ethiopie et Djibouti est terminée et, depuis mai 2011,
Djibouti est reliée au réseau éthiopien. La fréquence et le temps de coupure d’électricité restent cependant
élevé à Djibouti face à une demande qui ne cesse d’augmenter.
Pour accroître la qualité, la continuité et le volume d'approvisionnement en électricité de Djibouti, des
discussions ont été organisées entre l’Ethiopie et Djibouti afin de développer une deuxième ligne. Le
Deuxième Projet d’Interconnexion du Système d’Alimentation Electrique entre l’Ethiopie et Djibouti a ainsi
pris forme avec comme objectif la mise en place d’une ligne Haute Tension double circuit de 230kV entre
Semera en Ethiopie et Nagad à Djibouti. Les unités d’exécution du projet sont l’Ethiopian Electric Power
(EEP) du côté de l’Ethiopie et l’Electricité de Djibouti (EDD) du côté de Djibouti. Il est estimé que le budget
total du projet pour la partie djiboutienne est de l’ordre de 75 millions USD.
Une EIES a été formulée en 2017 pour ce projet qui a été validée au niveau du Gouvernement Djiboutien.
Cependant l’EIES n’est pas considérée comme conforme aux standards de la Banque Mondiale et de la
Banque Africaine de Développement. C’est pourquoi l’EDD a demandé à Insuco d’actualiser l’EIES en ne
prenant en compte que la partie djiboutienne du projet et en excluant donc la partie éthiopienne.
L’actualisation de l’EIES évaluera les composants suivants du projet :
la construction de la ligne double circuit de 230 kV entre Nagad et Galafi, à la frontière éthiopienne
(190 km)
Le futur poste 230/63/20Kv et ses extensions à Nagad
Cette EIES est destinée à répondre aux exigences établies par la Banque Mondiale et la Banque Africaine
de Développement. Les exigences applicables sont décrites dans le cadre légal et institutionnel. Avant de
prendre une décision de financement et de poursuivre le projet, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement et l’EDD devront s'assurer que :
Le projet répond aux exigences nationales de Djibouti et aux exigences de la Banque Mondiale et la
Banque Africaine de Développement.
Le projet inclut des mesures pour éviter ou minimiser les impacts négatifs en termes de conditions
environnementales, sanitaires et de sécurité, et socio-économiques.
Une consultation publique et une divulgation appropriée sont menées conformément à la législation
nationale djiboutienne et au cadre environnemental et social de la Banque Mondiale (Banque
Mondiale 2018), garantissant ainsi que tous les avis raisonnables du public et autres avis sont pris
en compte de manière adéquate avant de s'engager à poursuivre le projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
38
3.2 Description du projet
3.2.1 Caractéristiques du projet
Le projet est l'interconnexion entre Djibouti et l'Éthiopie, avec 190 km sur le territoire djiboutien. Les 102 km
de ligne mis en place sur la partie éthiopienne ne font pas partie de cette EIES, mais sont tout de même
considérés comme des infrastructures associées du projet djiboutien.
3.2.1.1 Alternatives au projet
Critères de sélection pour le tracé
Lors de la proposition de tracé pour la future ligne d’interconnexion, les critères suivants ont été respectés
pour limiter au maximum les impacts négatifs et favoriser au maximum les impacts positifs :
- Se situer à proximité des routes et pistes existantes afin de faciliter le transport de matériels et de
personnels lors de la phase de construction et lors des activités de maintenance.
- Limiter le croisement de la future ligne avec des lignes déjà existantes et des routes.
- Limiter la longueur totale de la ligne.
- Eviter le positionnement de pylônes dans des oueds, sur des collines, dans des terrains inondables
ou autres terrains dangereux, difficilement accessibles ou modifiables.
- Contourner les aires protégées.
- Eviter de survoler des aires boisées et les oasis.
- Eviter les jardins, les plantations et les zones d’élevages d’animaux.
- Eviter autant que possible les zones migratoires de la faune, notamment des oiseaux.
- Eviter les zones habitées : villes, villages, campements.
- Eviter de survoler les enclos, les tombes ou autres héritages culturels.
Historique des alternatives
Le bureau d’étude PACE a réalisé une première EIES en 2017 qui se basait sur un tracé qui ne répondait
pas aux critères ci-dessus. PACE a proposé une alternative au tracé initial7 qui évitait dans la mesure du
possible des habitations, des réservoirs d’eau, Holl-holl, se rapprochait autant que possible des routes et
pistes existantes et favorisait la mise en place des pylônes sur des terrains plats.
Lorsqu’Insuco a été mandaté en 2020 pour mettre à jour cette EIES, des évolutions dans la zone de projet
avaient été constatées et de nouveaux critères ont été établis pour l’élaboration du tracé :
7 Environmental and social impact assessment report, Second Ethiopia-Djibouti Power System Interconnection Project (SEDPSIP),
PACE Architecture Engineering Planning, 2017.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
39
- Eviter de survoler la ville de Holl-holl : depuis 2017, la ville s’est en effet étalée et le tracé de PACE
serait passé au-dessus de nouvelles habitations.
- Eviter de survoler la zone de projet de la future centrale solaire de 30 MW au Grand Bara,
actuellement en projet.
- Eviter l’aire protégée de Djalelo.
- Déplacer le tracé lorsque l’environnement est trop abrupt pour la mise en place de pylônes.
- Eviter les zones d’habitations, y compris les campements de nomades.
Le tracé proposé par Insuco dans ce document représente donc la troisième alternative de tracé.
L’alternative sans projet
L’option de ne pas réaliser reste l’option la moins favorable à l’échelle nationale. Le projet favorisera le
développement économique et social de l’ensemble du territoire djiboutien et participera à la lutte globale
contre la pauvreté. Au niveau local, des impacts négatifs environnementaux et sociaux seront observés si
aucune mesure d’atténuation n’est mise en place. Cependant, avec la mise en place de plans de gestion
adaptés, il est attendu que le projet ait des retombées positives supérieures aux impacts négatifs.
3.2.1.2 La ligne de transmission
L'étude de faisabilité a examiné de nombreuses alternatives pour la conception et l’implantation de la ligne
de transmission et du poste (types de pylônes, hauteurs, isolateurs, etc.). Elle a ainsi évalué les différentes
options par rapport à des facteurs techniques, financiers, environnementaux/sociaux et autres, et a identifié
les options les plus réalisables. Les facteurs pris en compte dans le choix du tracé sont d'ordre technique
(géologie, topographie, hydrologie, etc.), environnemental (éviter les zones protégées, minimiser les impacts
sur les oueds, etc.) et social (éviter les zones peuplées, etc.). L’alternative retenue est la moins perturbatrice
pour les communautés locales. C’est le constructeur de la ligne de transmission qui aura la responsabilité de
finaliser la conception de la ligne et du corridor, de sorte que le tracé actuel pourrait faire l’objet de légères
modifications. Cependant ces modifications devraient être minimes et on peut considérer que l’avant-projet
actuel apporte suffisamment d’information sur l’emplacement et les caractéristiques du corridor pour que l’on
puisse mener l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux potentiels dans le cadre de cette EIES.
Le corridor retenu pour la ligne de transmission part du poste de Nagad, prend la direction sud-ouest puis
longe la ligne existante de 230 kV OHL Nagad - Holhol, près de la ville de Holhol. Le tracé proposé
contourne ensuite Holhol par le nord et continue près de l'ancienne voie ferrée jusqu'à Da’Asboyo, d'où la
ligne part en direction de l'ouest pour trouver son chemin vers le désert du Grand Bara. En entrant dans le
désert, le tracé de la ligne prend une direction sud-ouest, traverse les lignes électriques existantes, la route
nationale 5 et la route nationale 1 et continue parallèlement à la route nationale 1 jusqu'à Dikhil. La ville de
Dikhil est contournée au nord et la ligne change de direction pour se diriger vers le nord-ouest, et continue
parallèlement à la route nationale 1 jusqu'à Yoboki. À Yoboki, après le croisement de la route nationale 1, la
ligne change de direction vers l'ouest en suivant parallèlement la route nationale 1 jusqu'à Galafi à la
frontière éthiopienne.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
40
Carte 1 : Tracé de la ligne de transmission entre Nagad et Galafi à Djibouti
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
41
41
Le corridor de la ligne de transmission mesurera 40 mètres de largeur conformément aux distances de
dégagements nécessaires pour une ligne de transmission de 230 kV. La ligne devrait comprendre 547
pylônes le long du tracé avec une portée moyenne de 350 mètres entre pylônes. Cependant le nombre de
pylônes à construire pourrait changer en fonction du résultat de l'inspection détaillée du site qui sera
effectuée par l'entreprise contractante retenu. Il pourra s’agir de pylônes de suspension ou de pylônes
d'angle (AP) qui sont des pylônes légèrement plus grands qui soutiennent la ligne là où elle tourne en angle
et soumet donc le pylône à des contraintes différentes que si la ligne est droite. Il est également prévu que la
conception des pylônes soit faite de manière à faciliter les travaux d'inspection, de peinture, d'entretien, de
réparation et d'exploitation, en gardant à l'esprit que la disponibilité de la ligne prévaut. Les pylônes seront
conçus en forme de treillis et auront une hauteur d'environ 54 à 60 mètres.
Tableau 1- Distances de dégagement à respecter
Description Conditions
Terrain accessible aux piétons uniquement 8 m
Terrain dans les zones urbaines, passages à niveau 9 m
Maisons dont le toit ne résiste pas au feu 4 m
Chemins de fer, électrifiés 12 m, min 4m pour la caténaire
Lignes de télécommunication 8,0 m
Distances horizontales par rapport aux pylônes de
télécommunication 40 m
Lignes aériennes < 50 kV min. Dpp de la tension la plus élevée
Distances horizontales par rapport aux routes min. 25 m à discuter
L'environnement dans lequel la ligne sera installée est désertique. Les pylônes proposés devront donc
pouvoir résister à l'environnement désertique chaud dans lequel la ligne sera installée et résister aux
conditions de charge en suivant une série de caractéristiques détaillées dans le design préliminaire du
projet. L’entreprise contractante devra également prendre toutes les mesures possibles pour éviter les
problèmes liés à la corrosion, à l'effet corona, aux isolateurs poussiéreux, etc. De même, afin d'éviter tout
dommage sur les conducteurs et/ou le câble de terre, dû aux vibrations éoliennes, l’entreprise contractante
proposera et mettra en œuvre des mesures préventives appropriées (installation d'amortisseurs de
vibrations, d'amortisseurs de bretelles, etc.). La maitrise d’œuvre technique sera en charge de s’assurer que
les équipements sont appropriés et rendra compte régulièrement à l’EDD, notamment en ce qui concerne
les mesures de l’accélération des vibrations.
Les pylônes auront quatre pieds qui seront chacun ancrés dans le béton. L'étude de faisabilité a
recommandé le type de pylône indiqué dans la figure suivante ; il peut y avoir six variantes (T, A, WA40,
WA70, Esp et E), mais la conception de base sera la même pour chacune d'entre elles.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
42
42
Figure 1- Modèle de pylône
Les fondations des pieds des pylônes seront en béton et seront placées ou coulées dans des trous qui
auront été creusés dans la terre ou ancrés à la roche solide. Si les conditions l'exigent, il peut être
nécessaire de procéder à un dynamitage pour préparer l'excavation. Les fondations des pieds du pylône
formeront les coins d'un carré qui pourra mesurer entre 9,12 m et 11,44 m de côté en fonction des types de
pylônes. Par conséquent, la superficie du terrain sous chaque pylône sera au maximum de 131 mètres
carrés (11,44 x 11,44 m). A cette superficie, il faudra ajouter les excavations qui pourront s'étendre sur 20
mètres de rayon autour du centre de pylône. C’est pourquoi, la surface totale de construction de chaque
pylône pourrait atteindre 1.256 mètres carrés (π x 202 m). Cela représentera l’acquisition permanente de
68,74 hectares le long du tracé (1.256 m2 x 547 pylônes). Au-delà de cette surface, l’entreprise contractante
en charge de la construction aura également besoin d'espace pour le stockage, le stationnement,
l'assemblage des pylônes et d'autres activités. Pour les besoins de l'EIES, on suppose que 350 mètres
carrés supplémentaires seraient concernés de manière temporaire pour chaque pylône, bien que cela soit
probablement une surestimation dans la plupart des cas. Cela représentera l’acquisition temporaire de 19,15
hectares le long du tracé (350 m2 x 547 pylônes), plus 2 hectares nécessaires à l’installation de camps
temporaires.
3.2.1.3 Les routes d’accès
Des routes seront nécessaires pour permettre l'accès aux pylônes et à la ligne de transmission :
Lors de la phase de construction, afin de transporter les travailleurs et les matériaux, de creuser et
d'installer les fondations, d'assembler et d'ériger les pylônes, et de placer les conducteurs.
Lors de la phase d’opération, afin de transporter les travailleurs et les matériaux pour assurer la
maintenance et les réparations de la ligne.
Au fur et à mesure que l’entreprise contractante élaborera le projet final, les routes et les pistes seront
identifiées et marquées pour éviter la conduite hors route et les perturbations inutiles du terrain. Dans la
mesure du possible, les routes et les pistes existantes seront utilisées, et les conducteurs des véhicules
seront avertis de rester sur les routes et les pistes approuvées. Le cas échéant, des routes seront
construites. Sachant que la zone du projet est désertique, cette "construction" devrait principalement
consister à créer des pistes à travers des terres ouvertes. Les routes ne seront améliorées avec du gravier
ou d'autres matériaux que si cela s'avère nécessaire pour la stabilité de la route ou pour améliorer la
traction. Les routes devront avoir une largeur d'environ quatre mètres, mais pourront atteindre six mètres à
certains endroits.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
43
43
Dans la mesure du possible, les routes seront situées dans le corridor de la ligne de transmission afin
d'éviter de perturber inutilement des terres qui ne seraient pas touchées autrement. Au vu de la faible
densité de population, il sera possible de définir des tracés de route évitant toute construction (maisons,
tombe, enclos) ou terre occupée.
3.2.1.4 Les bureaux et campements de travailleurs
L’entreprise contractante en charge de la construction aura besoin d'espace pour les bureaux, le stockage,
les petits travaux d'entretien et l'hébergement de la main-d'œuvre. L'effectif total de travailleurs devrait
osciller entre 250 et 500 personnes. Durant la phase de construction, l’entreprise contractante construira des
camps temporaires à différents endroits qui seront démolis à la fin des travaux.
3.2.1.5 Le poste de Nagad
Outre la ligne de transmission, il est prévu que la construction du poste de Nagad se réalise avec des fonds
koweitien/saoudien en 2021 et l’extension du poste de Nagad avec un financement de la Banque Africaine
de Développement. Le poste de Nagad sera situé à environ 5 km de l'aéroport international de Djibouti, à
proximité d'une route goudronnée menant vers la frontière éthiopienne en direction du sud-ouest. La
superficie du terrain disponible pour la construction est de 8 hectares (240 x 340 m), ce qui est considéré
comme suffisant pour le poste de 230 kV prévu et les futures extensions. Ce poste est considéré comme
une infrastructure annexe car il ne sera pas financé sur le budget concerné par le projet de cette présente
EIES.
La parcelle de terrain appartient à la République de Djibouti comme terre vacante et sans maître et est
grevée au profit de l’EDD d’un droit de concession provisoire en vertu de la notification enregistrée le 15
novembre 2015 (ACP/VOL 139-F°132-N°1374). Une procédure de décret accordant la parcelle de terrains
domaniaux à l’EDD est en cours.
Lors des visites de terrains effectuées dans le cadre de cette EIES, aucune construction sur ce terrain
n’avait été constatée. Le terrain n’est pas occupé et est actuellement désert. A proximité du terrain se trouve
la station de train de Nagad.
Le poste de Nagad et ses extensions feront l’objet de due diligences spécifiques.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
44
44
Carte 2- Ensemble du poste de Nagad
Photo 1 : terrain du futur poste de Nagad
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
45
45
3.2.2 Etapes du projet
3.2.2.1 Construction
La phase de construction devrait durer 24 mois. L’entreprise contractante prendra les dispositions finales
pour les travaux, mais il est probable que les travaux se déroulent comme suit. Le projet devrait employer 70
à 100 travailleurs au niveau du poste de Nagad et 250 à 400 travailleurs au niveau de la construction de la
ligne. Au niveau de la ligne, les pylônes ne seront probablement pas érigés d'un bout à l'autre de la ligne,
mais deux groupes de travailleurs commenceront chacun à une extrémité de la ligne et travailleront en se
rapprochant l’un de l’autre pour se rejoindre au milieu de la ligne. Chaque groupe comprendra plusieurs
équipes de travail qui effectueront les travaux en plusieurs étapes : transport des matériaux et des
équipements sur le site, préparation du terrain, excavation, achèvement des fondations (travaux de béton et,
dans certains cas, enfoncement de pieux ou forage), érection des pylônes et restauration du site. Les
équipes travailleront de manière séquentielle ce qui permettra que plusieurs pylônes soient en construction
en même temps. Une fois que tous les pylônes seront en place, l’entreprise contractante apportera les
conducteurs de ligne et câbles et les installera sur les pylônes qui le soutiendront. Une fois cette opération
terminée, la ligne pourra être mise sous tension.
Divers équipements et outils lourds seront utilisés pour la construction de la ligne de transmission et
l’extension du poste. L'entreprise contractante déterminera les besoins exacts en équipement. Les machines
et équipements suivants sont parmi ceux qui seront probablement utilisés :
Pelles pour creuser les fondations
Camions à benne pour l'enlèvement de la terre et d'autres matériaux
Bulldozer pour déplacer de la terre ou des rochers si nécessaire
Grues pour déplacer les pylônes
Camion lourd pour le transport de matériel
Camion de brigade 4X4 avec treuil
Véhicule 4x4 de la brigade avec treuil
Équipement pour l'installation de lignes et de câbles
Véhicules de passagers
3.2.2.2 Opération et entretien
La phase d’opération devrait suivre la phase de construction et durer 40 ans.
Le couloir de la ligne de transmission, les pylônes et la ligne elle-même devront être entretenus une fois que
la ligne sera mise en service et transportera l'électricité. En général, les lignes de transmission ne
nécessitent qu'un entretien minimal. Après une période de plusieurs années, l'ensemble du système
nécessite une étude et une révision détaillées.
L’EDD dispose de procédures spécifiques pour l'exploitation et l'entretien de ses lignes, qui sont définies
dans un manuel de 2010 intitulé « Manuel d’entretien à Haute tension ».
Le chef de l’entretien de l’EDD est la personne qui s’assure que le programme d’entretien des lignes à haute
tension est respecté afin de circonvenir aux pannes intempestives qui causent pertes financières et de
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
46
46
crédibilité auprès de la clientèle. Cette personne dirige une équipe de monteurs de lignes expérimentés qui
possèdent l’expérience nécessaire à l’identification des problèmes pouvant causer une coupure de courant
et l’expertise qui leur permettra de solutionner ces problèmes.
Les principales activités qui seront menées au cours des opérations sont les suivantes :
Visites de lignes : Les visites se feront à pied et seront réalisées par des monteurs de lignes
expérimentés qui sont capables de reconnaître ce qui est en bon état et ce qui pourrait être cause
de panne. Il est prévu de réaliser chaque année une visite de toute la ligne. Pendant ces visites les
intervenants marcheront d’un pylône à l’autre tout en inspectant visuellement, à partir du sol,
l’emprise, les fondations, les pylônes, les conducteurs. Ils s’aideront de jumelles pour déceler des
défauts.
Inspections de lignes : Les inspections de lignes diffèrent des visites par le fait que chaque pylône
est monté et inspecté en détail. Les routes d’accès, emprises, fondations, manchons, conducteurs
sont, dans un premier temps, inspectés à partir du sol à l’aide de jumelles. Puis les inspecteurs
montent à chaque pylône pendant que les deux circuits sont opérationnels. Ceci peut se faire sans
danger si les monteurs se limitent à grimper le fût du pylône en ne s’aventurant pas sur les consoles.
De cette façon un monteur est toujours au-delà de la distance de dégagement nécessaire à sa
sécurité. Les monteurs doivent réaliser des vérifications des pylônes, des conducteurs et des câbles
de garde. Les inspections doivent s’effectuer sur toute la longueur d’une ligne et non seulement sur
quelques pylônes particuliers ou au hasard. Chaque pylône doit être monté et inspecté. Les
inspections de lignes sont moins fréquentes que les visites : il est ainsi prévu de réaliser une visite
de toute la ligne tous les 2 ans.
Réparation de la ligne : Quand des dommages sont identifiés lors de visites ou d’inspection de
lignes, il peut être nécessaire d’intervenir. Les principales procédures d’intervention (réparation) sont
de remplacer une chaîne d’isolateurs composites en suspension, remplacer une chaîne d’isolateurs
composites en tension, remplacer un manchon de jonction et remplacer une cornière.
Pour effectuer les réparations et l'entretien, les véhicules et l'équipement peuvent devoir se rendre sur les
sites des pylônes. Comme pour la construction initiale, les routes et les pistes existantes seront utilisées
dans la mesure du possible ; dans certains cas, cependant, il faudra peut-être utiliser des routes temporaires
qui seront entretenues ou remises en état régulièrement lors de la phase d’exploitation pour assurer la
maintenance. Tout dommage au terrain survenu pendant les opérations de réparation et d'entretien sera
rétabli lorsque les activités seront terminées.
Lors de la phase d’opération, le nombre de travailleurs devrait être de l’ordre de 14 personnes. 6 personnes
se chargeront des visites, inspections et réparations de la ligne et 8 se chargeront de l’opération et
surveillance du poste de Nagad.
3.2.2.3 Clôture
La ligne de transmission et le poste sont censés rester en place pendant de nombreuses années, de sorte
que les travaux de démantèlement n'auraient pas lieu avant plusieurs décennies. Le démantèlement
comprendra le démantèlement, la décontamination (si nécessaire), l'expédition et le recyclage final, la
réutilisation ou l'élimination des matériaux, et la réhabilitation du site.
Lorsque la ligne sera mise hors service, EDD démantèlera et retirera les pylônes et les conducteurs, en
recyclant ou en réutilisant autant que possible les matériaux. Il en serait fait de même lorsque le poste devra
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
47
47
être mis hors service. Les matériaux seront vendus, réutilisés, stockés pour un usage futur ou envoyés à la
décharge. Une fois les pylônes retirés, les terres dans la zone d’emprise seront remises dans les conditions
d'avant-projet ou dans des conditions acceptables pour le Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et
du Tourisme de Djibouti et les propriétaires fonciers, si existant. De même, les terres du poste seront
restaurées à la satisfaction du Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme.
Lors du processus de sélection de la maitrise d’œuvre technique du projet, l’EDD exigera dans le cahier des
charges aux soumissionnaires d’élaborer un plan de fermeture avant le déclassement. Ce plan sera soumis
au Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme de Djibouti pour examen et approbation. Le
plan comprendra des mesures visant à éviter ou à réduire au minimum les impacts sur les ressources
environnementales, les personnes et les biens.
3.2.3 Chronogramme indicatif du projet
Il est prévu que la phase de construction s’étale sur 24 mois et que la phase d’opération dure 40 ans.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
48
48
Tableau 2- Calendrier de la construction de la ligne haute tension 230kV Nagad-Galafi
Tableau 3- Calendrier de l’extension du poste de Nagad
Description
Travaux typiques du poste
Mois
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Date de début
2 Conception
3 Fabrication de matériel et
d'équipement
4 Test d'usine
5 Livraison au site
6 Travaux de génie civil
7 Construction, installation, pré-
commission et tests
8 Mise en service et test final
Description des activités
Mois
Design Construction Fin
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2
Desig
n/
co
nstr
ucti
on
de l
a lig
ne a
éri
en
ne d
e 2
30kV
Etudes et design complet : profil
longitudinal, pylônes, conducteurs,
fondations des isolateurs, etc.
Travaux préparatoires : piquetage du
nouveau tracé, réalisation des pistes
d'accès, défrichement de végétation,
etc.
Acquisition de matériel
Mise en place des fondations
Installation des pylônes
Montage des chaines d’isolateurs
Installation des conducteurs
Installation de la fibre optique
Accordage de la ligne au sol
Test de mise en service
Tra
vau
x a
prè
s
la m
ise e
n
serv
ice
Finalisation et petites réparations
(fondations, peinture, etc.)
Restauration initiale des sols autour
des pylônes
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
49
49
3.3 Zone d’étude du projet
3.3.1 Délimitation de la zone d’étude du projet
La zone d'étude comprend les activités et les structures qui seront évaluées dans l'étude d'impact, en
considérant toutes les composantes du projet soumises par le promoteur ainsi que leurs effets.
Pour délimiter la zone d'étude, il convient de se référer aux exigences de la Sauvegarde Opérationnelle 1 de
la Banque Africaine de Développement8 qui stipule que l’EIES doit être réalisée dans la zone d’influence du
projet, en définissant la zone d’influence comme suit :
- La zone susceptible d’être directement touchée par le projet ;
- Les installations connexes ou associées découlant de la mise en œuvre des projets,
mais qui ne sont pas financées par le projet et qui n’auraient pas été mises en œuvre si
le projet n’existait pas, et ;
- Les zones – y compris les collectivités qu’elles abritent, qui peuvent être affectées par
des activités non planifiées mais techniquement prévisibles – susceptibles d’être
touchées par le projet
(BAD, 2013)
En ce sens, la zone d'étude doit comprendre la zone d’emprise et les zones d'influence des impacts sociaux
et environnementaux liés au projet.
3.3.2 Zone d’emprise du projet
La zone d’emprise correspond à la zone susceptible d’être directement touchée par le projet. Elle comprend
l'étendue physique des travaux proposés, définie par les limites des terrains à acquérir ou à utiliser
(temporairement ou en permanence) par le projet.
Celle-ci comprend :
Le futur poste de Nagad d’une superficie de 8 hectares et se trouvant à environ 5 km de l'aéroport
international de Djibouti
Le corridor de la ligne de transmission partant du poste de Nagad, contournant Holhol, Da’Asboyo,
Dikhil et Yoboki et arrivant jusqu'à Galafi à la frontière éthiopienne, en traversant trois
régions djiboutiennes (Arta, Ali Sabieh et Dikhil). Le corridor mesurera 190 km de long et 40 mètres
de large pour un total de 760 hectares. Cependant, dans le cadre de l’EIES, l’EDD a choisi de définir
un corridor de 100 mètres de largeur comme zone d’étude de l’emprise du projet afin de laisser une
marge de manœuvre à l’entreprise contractante en charge de la construction pour ajuster
8 Les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale ne définissent pas explicitement la zone d’étude de l’EIES mais la
NES 1 considère que l’EIES doit évaluer tous les impacts d’un projet (impacts directs, impacts indirects et impacts cumulatifs), ce qui
est cohérent avec la définition proposée par la Banque Africaine de Développement.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
50
50
l'emplacement final des pylônes sans que cela ne remette en cause les études environnementales
et sociales. Ces ajustements finaux concernant l'emplacement des pylônes seront justifiés par
l’analyse des conditions géologiques (par exemple, la capacité du sol et de la roche à supporter les
pylônes) et de l'angle de la pente (pour éviter les pentes extrêmes). Ils devront être approuvés par
l’EDD et maintiendront le corridor de la ligne à l’intérieur de la zone d’étude de l’emprise de 100
mètres de large. La zone d’emprise du projet mesure donc 760 hectares mais la zone d’étude
détaillée de l’emprise est de 1900 hectares et correspond à la zone sur laquelle a été réalisée
l’étude d’occupation des sols. A l’intérieur de cette zone, 68,74 hectares seront des acquisitions
permanentes de terres correspondant à l’emplacement des pylônes, 21,15 hectares seront des
acquisitions temporaires de terres pour les travaux et sur le reste de la zone (672,11 ha), un certain
nombre de restrictions seront appliquées afin de respecter les distances de dégagement entre la
partie sous-tension de la ligne et le sol ou d’autres éléments comme des arbres ou des
infrastructures. Les usages dans la zone d’emprise seront les suivants :
o Aucun logement ne devra se trouver dans la zone d’emprise. C’est pourquoi il a été proposé de
bouger la ligne par rapport au dernier tracé proposé en 2017, afin de s’éloigner de la ville de
Holhol et de Dikhil9.
o Ne pourront être maintenus que les arbres mesurant moins de 4 mètres de hauteur10.
o Il sera possible de pratiquer l'agriculture et l’élevage.
o Il sera possible de continuer à se rendre sur les sites d’héritage culturel.
o Les caravaniers et les transhumants pourront passer librement sous la ligne de transmission.
3.3.3 Zone d’influence sociale du projet
La zone d’influence sociale correspond aux zones susceptibles d’être affectées par des activités non
planifiées mais techniquement prévisibles du projet.
Si l’on considère les impacts positifs du projet sur les apports en électricité et la capacité de desservir plus
d’usagers, la zone d’influence socio-économique peut atteindre la majorité des centres urbains du pays.
Cependant en dehors de ces impacts positifs, les impacts du projet devraient se faire ressentir dans les
zones proches de la zone d’emprise du projet et dans les localités environnantes. Dans ce sens, il a été
défini une zone d’influence sociale englobant un corridor de 10 km de large autour du tracé de la ligne et
incluant les centres de population se trouvant à moins de 10 km du tracé.
La zone d’influence correspond à la zone d’étude sociale de l’EIES dans laquelle il est possible que des
impacts directs, indirects ou cumulatifs liés au projet que ce soit pendant la phase de construction ou la
phase d’opération de la nouvelle ligne électrique existent.
Les centres habités incluent dans la zone d’influence sont les suivants :
Chabellei à 1 km au nord du tracé (entre AP2 et AP3)
9 Une étude parcellaire est présentée dans les sections suivantes l’EIES pour étudier les usages actuels dans la zone d’étude de
l’emprise du projet.
10 En pratique la zone d’étude a une végétation arbustive clairsemée avec très peu d’arbres pouvant mesurer plus 4 mètres de hauteur.
L’étude d’occupation des sols précise les portions du tracé pouvant compter avec des arbres de plus de 4 mètres de hauteur.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
51
51
Goubetto, à 3 km au nord-ouest du tracé (entre AP3 et AP4)
Holhol, à moins d’1 km au sud du tracé (entre AP7 et AP8)
Da’Asboyo, à moins d’1 km au sud du tracé (entre AP11 et AP12)
Ali Sabieh, à 8 km au sud-est du tracé (entre AP15 et AP16)
Doudoub Bololé à moins d’1 km au sud du tracé (entre AP16 et AP17)
Mouloud, à 2 km au nord du tracé (entre AP19 et AP20)
Dikhil, à moins d’1 km au sud du tracé (entre AP20 et AP21)
Ab Aïtou, à 1 km à l’ouest du tracé (entre AP22 et AP23)
Gour’Obbous, à 2 km à l’est du tracé (entre AP23 et AP24)
Tewo, à 5 km à l’ouest du tracé (entre AP24 et AP25)
Yoboki, à 3 km à l’est du tracé (entre AP24 et AP25)
Galafi, à moins d’1 km à l’est du tracé (au niveau de AP29)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Carte 3: Zone d’influence sociale du projet
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
53
53
3.3.4 Zone d’influence environnementale du projet
La nouvelle ligne aérienne de 230 kV part du poste de Nagad, prend la direction sud-ouest et se poursuit
parallèlement à la ligne existante de 230 kV OHL entre Nagad et Holhol jusqu'à proximité de Holhol. Le tracé
proposé de la ligne contourne Holhol au nord et poursuit son trajet à proximité de l'ancienne ligne ferroviaire
jusqu'à Daas Bio, où la ligne tourne vers l'ouest pour trouver son chemin vers le désert du Grand Bara. En
entrant dans le désert, la ligne prend une direction Sud-Ouest, traverse les lignes existantes de 230 kV et 63
kV, la route nationale 5 et 1 et continue parallèlement à la route nationale 1 jusqu'à Dikhil. La ligne contourne
Dikhil au nord et change de direction vers le nord-ouest, et continue parallèlement à la route nationale 1
jusqu'à Yoboki. À Yoboki, après avoir traversé la route nationale 1, la ligne change de direction vers l'ouest
en suivant le parallèle avec la route nationale 1 jusqu'à Galafi.
La zone d’influence environnementale comprend des éléments essentiels sur le site du projet (le poste de
Nagad) et une zone tampon le long de l'emprise de la ligne de transmission et jusqu'à 2 km autour du site du
projet. La zone tampon de 2 km a été adoptée spécifiquement pour limiter les impacts négatifs du projet sur
les récepteurs aviaires mobiles tels que les oiseaux et les chauves-souris qui volent à travers le site et plus
loin.
3.3.5 Installations connexes ou associées
D’après les normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de
Développement, les installations connexes ou associées découlant de la mise en œuvre des projets doivent
également faire partie de l’EIES.
Le terme « d’installations associées » désigne les installations ou les activités qui ne sont pas financées
dans le cadre du projet mais qui sont : a) associées directement et étroitement au projet ; b) réalisées ou
doivent être réalisées en même temps que le projet ; et c) nécessaires pour la viabilité du projet et n’auraient
pas été construites, agrandies ou réalisées si le projet n’avait pas existé.
Dans le cas du présent projet, la ligne de transmission construite en Ethiopie entre Galafi et Semera et le
poste de Semera doivent être considérée comme des installations connexes qui ne sont pas financées par
le présent projet mais qui n’auraient pas été mises en œuvre si le projet n’existait pas. La Banque Africaine
de Développement a approuvé l’EIES réalisée pour analyser et atténuer les impacts de la construction et
opération de ces installations connexes en respectant les grands principes de gestion des risques de la BM.
Les conclusions de cette EIES seront reprises dans la présente EIES pour l’analyse des impacts des
installations connexes.
Concernant le poste de Nagad, des due diligences spécifiques seront réalisées avant le début de la
construction.
3.3.6 Champ d’application de l’EIES
Ainsi si le champ d’application de la présente EIES comprendra :
La zone d’étude de l’emprise avec une superficie de 1.900 ha (19 km2)
La zone d’influence du projet avec une superficie de 200.000 ha (2.000 km2)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
54
54
Les installations connexes du projet correspondant à 90 km de ligne de transmission et un poste
pour une zone d’emprise estimée à 370 hectares (3,7 km2).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Carte 4 : Champ d’application de l’EIES
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
56
56
4 Revue légale et institutionnelle
4.1 Cadre institutionnel
Institution Description
Energie
Ministère de
l’Energie
et des
Ressources
Naturelles
(MERN)
Le ministère est responsable de la mise en œuvre des politiques sectorielles
relatives à l'énergie et aux ressources naturelles, ainsi que de la promotion et du
développement des ressources pétrolières et minières, aussi bien sur le sol qu'en
mer. Le ministère est également chargé de la mise en œuvre des politiques
relatives à l'accès et à la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire.
Le développement des énergies renouvelables est supervisé par la Direction de
l'énergie qui fait partie du Ministère de l'énergie et des ressources naturelles.
Electricité de
Djibouti (EDD)
L’EDD est un établissement public chargé de la production et de la distribution de
l'électricité en République de Djibouti. L’EDD est habilité à construire des usines
thermiques, des postes de transformation, des lignes de transport ou de
distribution et d'une manière générale toutes les installations nécessaires à la
réalisation de son objet. Il est géré par un conseil d'administration. Le Directeur est
nommé par le Conseil des Ministres.
L'EDD est une institution du ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN).
Environnement
Ministère de
l'Urbanisme, de
l'Environnement
et du Tourisme
(anciennement
MHUE)
Le ministère est en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques
liées à l'urbanisme, à l'environnement et au tourisme afin de promouvoir un
développement équilibré et harmonieux des territoires. En outre, le ministère est
chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de développement
régional. Il est responsable de la planification urbaine et régionale entre les districts
et entre les régions, en vue de lutter contre l'insécurité et les inégalités sociales. Le
ministère élabore également des instruments législatifs et réglementaires, contrôle
les normes environnementales dans les domaines des infrastructures, du
logement, de l'équipement, des transports et de l'énergie en partenariat avec les
autres ministères concernés.
Il veille à l'application et au contrôle des études d'impact sur l'environnement.
Direction de
l'Environnement
et du
Développement
durable
La Direction est chargée de l'élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle des
politiques ministérielles en matière d'environnement et de développement durable
sur le territoire.
Les fonctions de la direction sont de :
- renforcer le cadre institutionnel et judiciaire en matière d'environnement et de
développement durable ;
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
57
57
- contribuer à la protection des ressources naturelles ;
- mettre en œuvre les instruments pertinents pour surveiller et contrôler l'état de
- l'environnement ;
- mettre en œuvre des études d'impact et fournir des avis sur les projets de
développement qui peuvent avoir un impact sur l'environnement ;
- prévenir et atténuer toutes formes de pollution et de nuisances qui peuvent avoir
un impact sur la santé humaine et l'environnement ;
- mettre en œuvre les contrôles pertinents et aider les personnes morales en
matière de protection de l’environnement ;
- intégrer, avec d'autres ministères concernés, la dimension environnementale
dans le cadre de programmes de développement tels que l'éducation, la formation,
la recherche et l'information ;
- mettre en œuvre des projets environnementaux ; et promouvoir la coopération
avec les organisations non gouvernementales internationales, les associations
nationales et les communautés locales dans le domaine de l'environnement.
La direction est composée de trois sous-directions, à savoir :
- La sous-direction du développement durable ;
- La sous-direction des pollutions et de l'évaluation environnementale ; et
- La sous-direction de la Grande Muraille verte.
Travail
Ministère du
travail et de la
réforme
administrative
Le ministère est responsable de la mise en œuvre de la politique gouvernementale
dans les domaines du travail, de l'emploi, de l'employabilité, des relations sociales,
de la gestion des agents de l'État et de la protection sociale. Le ministère élabore
et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, aux conventions
collectives et aux droits des employés. Il élabore et met également en œuvre la
réforme administrative. Le ministère a autorité sur l'inspection du travail. Un certain
nombre d'institutions publiques sont placées sous la tutelle du ministère,
notamment : l'Agence Nationale pour l'Emploi, la Formation et l'Insertion
professionnelle (ANEFIP), l'Institut National de l'Administration Publique (INAP), la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).
Genre
Ministère de la
Femme et de la
Famille (MFF)
Le ministère élabore et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière
d'intégration de la Femme dans le processus du développement du pays. Il
participe à la cohésion du tissu social, et particulièrement de la cellule familiale. Il
travaille en partenariat avec l'ensemble des ministères et est plus particulièrement
chargé de :
- conduire avec le Ministère de la Santé, la politique du Gouvernement en matière
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
58
58
de planification familiale, de prévention des risques liés à la santé maternelle et
infantile, la sensibilisation aux bonnes pratiques liées à la petite enfance ;
- participer, conjointement avec le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports,
aux programmes de prévention et d'information sur les comportements à risque ;
- définir conjointement avec le Ministère du Travail, le cadre légal et la mise en
application des dispositions liées à la protection du droit des femmes ;
- élaborer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement relative à l'insertion
professionnelle des femmes vulnérables (notamment celles opérant dans
l'informel) ainsi que la politique sociale de la protection de l'enfant et ce
conjointement avec les autres ministères compétents ;
- développer et mettre en œuvre en collaboration avec le Ministère de l'Education
Nationale et de la Formation Professionnelle des programmes dans le domaine de
l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la formation professionnelle et de la
petite enfance.
Transport
Ministère de
l'Equipement et
des Transports
Le ministère est responsable de la mise en œuvre et de la coordination des
politiques de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ainsi que des services
météorologiques nationaux. Il est également responsable de la gestion, de
l'exploitation, de l'entretien et de la rénovation des installations publiques. En outre,
le ministère est responsable de la conception et de la mise en œuvre de la
politique gouvernementale en matière d'infrastructures routières, portuaires et
aéroportuaires.
Le transport de toutes les composantes de l'infrastructure électrique se fera par la
route. Tout impact sur la route ou toute modification éventuelle sera examiné avec
ce ministère.
4.2 Conventions internationales ratifiées
Nom de la convention Description Impacts et plan d’action
associé
DROIT DE L’HOMME
Convention sur
l'élimination de toutes
les formes de
discrimination à l'égard
des femmes
Proscrire toute discrimination et violence
envers les femmes. Cela inclut les
violences sexuelles et l’exploitation
Impact social 7- Augmentation des
violences basées sur le genre du
fait de l’afflux de travailleurs
extérieur
Plan d’action contre les abus et
l’exploitation sexuelle
Convention relative aux
droits de l’enfant
Proscrire l’exploitation des enfants
incluant leur travail
Manuel de Gestion de la Main
d’œuvre
ENVIRONNEMENT
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
59
59
Convention sur le
changement climatique
et Protocole de Kyoto
Limitation des émissions de GES
Impact environnemental 1 –
Dégradation de la qualité de l’air
Impact environnemental 9 –
Emission de gaz à effet de serre
(GES)
Plan de Gestion Environnemental
et Social
Plan d’Engagements
Environnemental et Social
Convention sur la
diversité biologique
Les pays signataires de la convention
s’engagent soit à élaborer des
stratégies, des plans ou des
programmes nationaux pour la
conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité
Impact environnemental 10 - Perte
directe d'unités de végétation et
d'habitats
Impact environnemental 11 -
Exclusion d'espèces de faune en
raison de l'augmentation des
perturbations
Impact environnemental 12 -
Augmentation de la mortalité des
espèces de faune due aux
mouvements de véhicules et aux
activités de construction
PGES
PEES
Convention sur la
sécheresse et la
désertification
Appliquer des stratégies « intégrées à
long terme » axées sur l’amélioration de
la productivité des terres, la restauration,
la conservation et la gestion durable des
ressources en terre et en eau
Impact environnemental 3 - Impact
sur la géologie et la
géomorphologie
Impact environnemental 4 -
Changements dans les processus
de sédimentation
Impact environnemental 5 -
Augmentation de l'érosion et du
compactage des sol
Impact environnemental 8 -
Modifications potentielles du
schéma de ruissellement naturel
des eaux
PGES
PEES
Convention sur les
espèces migratrices
sauvages migrateurs
Lorsque cela s'avère approprié et
possible, les projets devraient
notamment prévoir :
- des examens périodiques de l'état de
conservation de l'espèce migratrice
concernée ainsi que l'identification des
Impact environnemental 14 -
Augmentation de la mortalité des
oiseaux migrateurs planneurs par
électrocution et collisions
Impact environnemental 15 -
Défrichement de la végétation
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
60
60
facteurs susceptibles de nuire à cet état
de conservation ;
- des plans de conservation et de
gestion coordonnés ;
- la conservation et, lorsque cela est
nécessaire et possible, la restauration
des habitats qui sont importants pour le
maintien d'un état de conservation
favorable et la protection desdits
habitats contre les divers facteurs qui
pourraient leur porter atteinte ;
- le maintien d'un réseau d'habitats
appropriés à l'espèce migratrice
concernée et répartis d'une manière
adéquate le long des itinéraires de
migration ;
- dans toute la mesure du possible,
l'élimination des activités et des
obstacles gênants ou empêchant la
migration ou la prise de mesures
compensant l'effet de ces activités et de
ces obstacles ;
entraînant la perte d'habitats et
d'espèces
Impact environnemental 16 -
Activité et bruit entraînant une
perturbation des espèces
PGES
PEES
Convention de Ramsar
sur les zones humides
Identifier et conservation au maximum
les zones humides du territoire
Impact environnemental 8 -
Modifications potentielles du
schéma de ruissellement naturel
des eaux
Impact environnemental 17 -
Menace de l'intégrité d'une zone
protégée terrestre traversée par la
ligne électrique
Droit du travail
Convention sur la
liberté syndicale et la
protection du droit
syndical
Proscrire toute discrimination à l’emploi
Proscrire l’exploitation des travailleurs
notamment illégaux
Proposer des conditions de travail
correcte
Proposer un cadre de vie correcte aux
travailleurs
Age minimum spécifié : 16 ans
Impact 12- Risques de
discrimination et de non-égalité des
chances des travailleurs
Impact 13- Risques de conditions
de travail non adéquates
Impact 14- Expositions des
travailleurs à des risques
physiques et chimiques
MGM
Convention sur l'égalité
de rémunération
Convention sur
l'abolition du travail
forcé
Convention concernant
la discrimination
(emploi et profession)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
61
61
Convention sur l'âge
minimum
Convention sur
l'inspection du travail
Convention sur la durée
du travail (industrie)
4.3 Cadre légal national
Nom du texte législatif Description Impacts et plans
d’action associés
Général
Loi n°171/AN/91
établissant et organisant
le domaine public
Établit le régime de base du domaine public
naturel et artificiel de l'État et les servitudes
relatives auxquelles sont soumis les terrains
et bâtiments de propriété privée. Le ministre
en charge du domaine accorde par décret les
autorisations d'occuper le domaine public et
d'y établir des constructions.
Procédure d’obtention par
l’EDD de la concession
légale des terrains publics
nécessaires au projet
Loi n° 177 / AN / 91 / 2eL
portant sur
l’organisation de la
propriété foncière
Crée un service de conservation des terres,
chargé de garantir aux propriétaires les rôles
qu'ils jouent dans la construction en
enregistrant tous les bâtiments dans les livres
fonciers et en les publiant. L'enregistrement
est obligatoire et définitif.
CPR
PAR
Loi n° 178/AN/91/2nd L
portant sur le droit de la
propriété
Réglemente le droit de la propriété dans tout
le pays.
CPR
PAR
Arrêté n°2006-
0515/PR/MHUEAT
Portant obligation pour
les départements
ministériels, les
établissements publics
et les unités de projet de
recourir à l'assistance
des services techniques
de l'Etat lors de la
réalisation des travaux
d'aménagement urbain
et de construction et lors
Impose aux départements ministériels, aux
institutions publiques et aux unités de projet
de demander l'assistance des services
techniques de l'État pendant la mise en
œuvre du développement, de la construction
et l’obtention d’un permis de construire.
Consultations des parties
prenantes :
- Service des domaines,
des ministères
- Conseil Régional
- District
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
62
62
des demandes de permis
de construire
Energie
Décret n°2009-
0218/PR/MERN portant
création de la
Commission nationale
de l'énergie
Crée la Commission nationale de l'énergie,
dont la mission est d'assurer la coordination
des projets énergétiques, et plus
généralement d'entreprendre des études sur
toutes les mesures contribuant à une
meilleure coordination du développement
énergétique du pays. Cette Commission est
chargée d'intervenir dans les domaines
stratégiques du développement énergétique
de la République de Djibouti, notamment les
études, la prospection, la recherche,
l'exploration, l'exploitation et le commerce.
Continuité avec
développement de la
première ligne entre
l’Ethiopie et Djibouti
Loi n°90/AN/15/7ème L
du 01 juillet 2015
instituant un cadre
législatif relatif à
l'efficacité énergétique
Définit un cadre juridique d'encadrement
dans le domaine de l'efficacité énergétique
en
République de Djibouti. La maîtrise de
l'énergie repose sur la promotion de
l'efficacité énergétique (ou utilisation
rationnelle de l'énergie) et le développement
des énergies renouvelables.
Amélioration de la
fourniture en électricité
Décret N° 2014-
252/PR/MB portant
affectation au profit du
MERN, une parcelle de
terrain constituée d'un
ensemble de corridors
pour l'alimentation en
électricité du secteur de
Nagad.
Affecte au Ministère de l'Energie et des
Ressources Naturelles, une parcelle de
terrain constituée d'un ensemble de corridors
reliant la centrale de JABANASS de PK 12
au secteur de la Gare-Station Nagad. La dite
parcelle sera mise à la disposition de
l'Electricité de Djibouti et est destinée à une
zone de sécurité dont l'emprise servira de
passage de toutes les lignes électriques de
63 et 230 KV. Son itinéraire est constituée
d'une longueur totale d'environ 13,52 km
avec des largueurs d'emprise variant entre 6,
15, 24, 100 et 283 selon les différents
secteurs dont les descriptions sont indiquées
suivants les plans ci-annexés.
Des servitudes de voiries pourront traverser
lesdits corridors aux besoins de l'Etat.
Procédure d’obtention par
l’EDD de la concession
légale des terrains publics
nécessaires au projet
Arrêté n°384/39/PR/ Définit les conditions auxquelles doivent
répondre les lignes électriques et les lignes
Cahier des charges
incluant clauses
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
63
63
de transport. Les enseignes destinées à
l'usage public seront gérées en fonction de
leur utilisation finale. Toutes les
infrastructures devront être construites avec
du matériel de première qualité.
environnementales et
sociales à insérer dans les
DAO et les marchés de
travaux du projet
Environnement
Décret n°2011-
029/PR/MHUEAT portant
sur la révision de la
procédure d'évaluation
d’impacts sur
l'environnement
Définit le champ d'application et les
méthodes d'exécution des évaluations
d’impact sur l'environnement. Toute activité
susceptible d'induire des impacts négatifs sur
l'environnement doit faire l'objet d'une
évaluation d'impact préliminaire.
EIES
Loi n°51/AN/09/6ème L
Portant sur le code de
l'environnement
Le code de l'environnement établit les règles
de base et les principes fondamentaux de la
politique nationale dans le domaine de la
protection et de la gestion de
l'environnement.
Le code stipule également que les normes de
qualité de l'eau et de l'air seront régies par
des textes juridiques. Cependant, jusqu'à
présent, aucun décret ou arrêté n'a été
produit pour compléter le code.
PGES
Loi n° 121 / AN / 01 /
4ème L approuvant le
Plan d'Action National
pour l'Environnement
(PANE) 2001-2010
Approbation du plan d'action national pour
l'environnement 2001-2010.
Plan toujours en vigueur
PGES
Décret n°2004-
0065/PR/MHUEAT
Portant sur la protection
de la biodiversité
Applique la Convention sur la diversité
biologique pour réglementer ou gérer les
ressources biologiques importantes pour la
conservation de la diversité biologique à
l'intérieur et à l'extérieur des zones protégées
à Djibouti.
Aire protégée de Djalélo à
éviter
PGES
Décret n°2001-
0108/PR/MAEM portant
approbation du plan
d'action national de lutte
contre la désertification
Le Plan d'action national de lutte contre la
désertification (PAN) est adopté comme
instrument de mise en œuvre du Plan
d'Action National pour l'Environnement
(PANE).
Le PAN et le PANE ont été développés et
mis en œuvre dans différents programmes
Impact environnemental 5 -
Augmentation de l'érosion et
du compactage des sol
Impact environnemental 8 -
Modifications potentielles du
schéma de ruissellement
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
64
64
stratégiques comme la stratégie et le
programme national pour la biodiversité.
naturel des eaux
PGES
Loi n°10/AN/03/5ème L et
Loi n°9/AN/03/5ème L
Ratification de l'accord
sur la conservation des
oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique-
Eurasie
Prévoit la protection des oiseaux migrateurs
(Afrique-Eurasie) et la ratification de la
Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage
(Convention de Bonn).
Impact environnemental 14
- Augmentation de la
mortalité des oiseaux
migrateurs planneurs par
électrocution et collisions
Impact environnemental 15
- Défrichement de la
végétation entraînant la
perte d'habitats et
d'espèces
Impact environnemental 16
- Activité et bruit entraînant
une perturbation des
espèces
PGES
PEES
Loi n°133/AN/11/6ème L
Ratification de la
Convention de la Grande
Muraille Verte
Prévoit la création de l'Agence panafricaine
pour la Grande Muraille verte (ratification de
la Convention). La Grande Muraille Verte est
une initiative africaine visant à faire pousser
un "mur" de 8000 km de végétation sur toute
la largeur de l'Afrique pour lutter contre la
désertification et les effets du changement
climatique.
Le tracé de la Grande Muraille Verte couvre
le Grand et le Petit Bara.
Impact environnemental
17 – Menace de l’intégrité
d’une zone protégée
terrestre traversée par la
ligne électrique
PGES
Travail
Loi n°133/AN/05/5th L
sur le code du travail
Réglemente les relations de travail entre les
travailleurs et les employeurs. En tant que loi
de la République, ce code du travail est
applicable sur tout le territoire national, à
l'exception des "zones franches", qui sont
régies par une législation spécifique.
Impact social 14 – risque
de conditions de travail
non adéquates
MGM
Loi n°28/AN/13/7 ème L
portant sur les
travailleurs migrants
Fixe le niveau des frais applicables aux
permis de travail délivrés aux travailleurs
Impact social 13 – risque
de discrimination et de
non-égalité des chances
des travailleurs
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
65
65
étrangers.
Tous les aspects administratifs relatifs aux
droits et permis de travail peuvent être gérés
par un bureau appelé "Guichet Unique", qui a
pour but d'améliorer le processus de
développement d'une entreprise à Djibouti.
Deux sites internet sont à consulter pour ces
aspects :
Guichet Unique : http://www.guichet-
unique.dj/
Agence nationale des droits de propriété :
https://www.djiboutinvest.com/
Impact social 14 – risque
de conditions de travail
non adéquates
MGM
Genre
Loi n°173/AN/02/4ème L
définissant la politique
nationale en matière
d'intégration de la
femme dans le
développement.
Approuve la Stratégie Nationale d'Intégration
de la Femme dans le Développement et le
Plan d'Action National qui définissent la
politique nationale en matière d'intégration de
la femme dans le développement.
Le Ministère de la Femme et de la Famille est
en charge de :
- l'évaluation de toutes les politiques,
stratégies et lois du point de vue de leur
impact sur l'intégration du genre dans le
développement ;
- l'évaluation et le suivi de l'impact de tous les
projets de développement sur le Genre ;
- la recherche de financement et le
lancement des projets pilotes et programmes
nationaux ;
- le renforcement des capacités
institutionnelles et de gestion des
intervenants gouvernementaux et non
gouvernementaux
impliqués dans la mise en œuvre de la
stratégie nationale ;
- la mise en place et l'exécution de
programmes de sensibilisation et
d'information sur la question du genre dans
Impact social 2 – création
d’emplois directs et
indirects liés au projet
Impact social 7 –
augmentation des
violences basées sur le
genre
Plan d’action contre les
abus et l’exploitation
sexuelle
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
66
66
le développement national.
Loi n°96/AN/00/4èmeL
portant Orientation du
Système Educatif
Djiboutien.
Instaure l’obligation scolaire pour les enfants
(filles et garçons) dans l’enseignement
fondamental (primaire et moyen).
MGM
4.4 Normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale
Seules les normes pertinentes au projet sont considérées.
Norme Environnementale
et Sociale Principes complémentaires
NES 1: Évaluation et
gestion des risques et
effets environnementaux et
sociaux
- énonce les responsabilités de l’Emprunteur en matière d’évaluation,
de gestion et de suivi des risques et effets environnementaux et
sociaux associés à chaque étape d’un projet appuyé par la Banque
au moyen du mécanisme de Financement de projets
d’investissement (FPI), en vue d’atteindre des résultats
environnementaux et sociaux compatibles avec les Normes
environnementales et sociales (NES).
NES2 : Emploi et
conditions de travail
- reconnaît l’importance de la création d’emplois et d’activités
génératrices de revenus à des fins de réduction de la pauvreté et de
promotion d’une croissance économique solidaire. Les Emprunteurs
peuvent promouvoir de bonnes relations entre travailleurs et
employeurs et améliorer les retombées d’un projet sur le
développement en traitant les travailleurs du projet de façon
équitable et en leur offrant des conditions de travail saines et sûres.
NES3 : Utilisation
rationnelle des ressources
et prévention et gestion de
la pollution
- reconnaît que l’activité économique et l’urbanisation sont souvent à
l’origine de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, et appauvrissent
les ressources déjà limitées. Ces effets peuvent menacer les
personnes, les services écosystémiques et l’environnement à
l’échelle locale, régionale et mondiale. Les concentrations
atmosphériques actuelles et prévisionnelles de gaz à effet de serre
(GES) menacent le bien-être des générations actuelles et futures.
Dans le même temps, l’utilisation plus efficace et rationnelle des
ressources, la prévention de la pollution et des émissions de GES,
et les techniques et pratiques d’atténuation sont devenues de plus
en plus accessibles et réalisables.
NES4 : Santé et sécurité
des populations
- reconnaît que les activités, le matériel et les infrastructures du projet
peuvent augmenter leur exposition aux risques et effets néfastes
associés au projet. En outre, celles qui subissent déjà l’impact du
changement climatique peuvent connaître une accélération ou une
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
67
67
intensification de ceux-ci à cause du projet.
NES5 : Acquisition de
terres, restrictions à
l’utilisation de terres et
réinstallation involontaire
- reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le projet et
l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets
néfastes sur les communautés et les populations. L’acquisition de
terres1 ou l’imposition de restrictions à l’utilisation qui en est faite2
peuvent entraîner le déplacement physique (déménagement, perte
de terrain résidentiel ou de logement), le déplacement économique
(perte de terres, d’actifs ou d’accès à ces actifs, qui donne
notamment lieu à une perte de source de revenus ou d’autres
moyens de subsistance) , ou les deux. La «réinstallation
involontaire» se rapporte à ces effets. La réinstallation est
considérée comme involontaire lorsque les personnes ou les
communautés touchées n’ont pas le droit de refuser l’acquisition de
terres ou les restrictions à leur utilisation qui sont à l’origine du
déplacement.
NES6 : Préservation de la
biodiversité et gestion
durable des ressources
naturelles biologiques
- reconnaît que la protection et la préservation de la biodiversité et la
gestion durable des ressources naturelles biologiques sont
fondamentales pour le développement durable. La biodiversité
désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, y
compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre
espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Parce que la biodiversité
sous-tend souvent les services écosystémiques valorisés par les
humains, des effets néfastes sur la diversité biologique peuvent
avoir une incidence négative sur ces services.
NES7 : Peuples
autochtones/Communautés
locales traditionnelles
d’Afrique subsaharienne
historiquement
défavorisées
- s’assure que le processus de développement favorise le plein
respect des droits, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la
culture et des moyens de subsistance reposant sur les ressources
naturelles des Peuples autochtones/Communautés locales
traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées.
NES8 : Patrimoine culturel
- reconnaît que le patrimoine culturel permet d’assurer la continuité
entre le passé, le présent et l’avenir de façon tangible ou intangible.
Les individus s’identifient à leur patrimoine culturel comme étant le
reflet et l’expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et
traditions en constante évolution.
Nes10 : Mobilisation des
parties prenantes et
information
- reconnaît l’importance d’une collaboration ouverte et transparente
entre l’Emprunteur et les parties prenantes du projet, élément
essentiel des bonnes pratiques internationales. La mobilisation
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
68
68
effective des parties prenantes peut améliorer la durabilité
environnementale et sociale des projets, renforcer l’adhésion aux
projets, et contribuer sensiblement à une conception et une mise en
œuvre réussies du projet.
4.5 Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque
Africaine de Développement
Sauvegarde
Opérationnelle Principes complémentaires
SO 1 : Évaluation
environnementale et
sociale
- Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux (y compris
le genre) et les questions liées à la vulnérabilité aux changements
climatiques associées aux opérations d’octroi de prêts et de dons par la
Banque dans leur zone d’influence ;
- Éviter ou réduire, atténuer et compenser les impacts défavorables sur
l’environnement et sur les populations touchées ;
- Faire en sorte que les populations touchées aient accès à l’information
sous des formes convenables en temps voulu au sujet des opérations
de la Banque et soient adéquatement consultées au sujet des questions
qui peuvent les concerner.
SO 2 : Réinstallation
involontaire: Acquisition
de terres, déplacement et
indemnisation
des populations
- Éviter autant que possible la réinstallation involontaire, ou réduire les
impacts de la réinstallation dans les cas où la réinstallation involontaire
est inévitable, en étudiant toutes les conceptions de projet viables ; •
Faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent une aide
importante pour la réinstallation, de préférence au titre du projet, de
sorte que leur niveau de vie, leur capacité de production de revenue, les
niveaux de production et leurs moyens globaux de subsistance
s’améliorent par rapport aux niveaux atteints avant le projet;
- Établir un mécanisme de suivi de la performance des programmes de
réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et pour la
résolution des problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent de
façon à éviter des programmes de réinstallation mal préparés et mal
exécutés.
SO 3 : Biodiversité et
services écosystémiques
- Préserver la diversité biologique en évitant, et si cela est impossible, en
réduisant les impacts sur la biodiversité ;
- Dans les cas où certains impacts sont inévitables, chercher à restaurer
la biodiversité en mettant en œuvre, au besoin, des mesures de
compensation en vue de réaliser non pas une perte nette, mais plutôt un
gain net au plan de la biodiversité ; • Protéger les habitats naturels,
modifiés et sensibles ; et
- Préserver la disponibilité et la productivité des services écosystémiques
prioritaires en vue de cons
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
69
69
SO 4 : Prévention et
contrôle de la pollution,
gaz à effet de serre,
matières dangereuses et
utilisation efficiente des
ressources
- Gérer et réduire les produits polluants que peut générer un projet de
sorte qu’ils ne présentent pas de risques nuisibles à la santé humaine et
à l’environnement, notamment les déchets dangereux et non dangereux
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
- Établir un cadre pour utiliser de façon efficiente toutes les matières
premières et les ressources naturelles au titre d’un projet, avec un
accent particulier sur l’énergie et l’eau.
SO 5 : Conditions de
travail, santé et sécurité
- Protéger les droits des travailleurs et établir, préserver et améliorer les
relations entre les employés et les employeurs ;
- Promouvoir la conformité avec les exigences légales nationales et
effectuer une vérification préalable dans le cas où les lois nationales ne
prévoient rien ou ne vont pas dans le même sens que la SO ;
- Favoriser une large conformité avec les conventions pertinentes de
l’Organisation internationale du travail (OIT), les normes fondamentales
du travail de l’OIT et la Convention de l’UNICEF sur les droits de l’enfant
dans les cas où les lois nationales n’offrent pas une protection
équivalente ;
- Protéger les travailleurs des inégalités, de l’exclusion sociale, du travail
des enfants et du travail forcé ; et
- • Exiger la protection de la santé et de la sécurité au travail
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
70
70
5 Méthodologie de l’EIES
Cette EIES évalue les impacts environnementaux et sociaux potentiels de la construction et de l'exploitation
de la ligne de transmission Nagad-Galafi et de l’extension et l’opération du poste de Nagad. Elle présente
également les résultats de l’EIES de la ligne de transmission Galafi- Semera et du poste de Semera comme
installations connexes.
Il convient de noter que l'étude de faisabilité n'a pas identifié l'emplacement final des pylônes ni le tracé
exact du corridor. Cependant il a été défini une zone d’étude de l’emprise de 100 mètres de large, à
l'intérieur de laquelle les pylônes seront inclus. Les emplacements définitifs seront choisis par le
constructeur. Ce processus de sélection (connu sous le nom de "tower spotting") tiendra compte des
conditions géologiques, de la topographie, de l'accessibilité, de la capacité d'acquisition du terrain, de la
biodiversité locale et d'autres facteurs. Une équipe d'ingénieurs et de scientifiques effectuera des études
préalables à la construction afin d'optimiser le corridor final. Comme indiqué au chapitre précédent, le fait
que le corridor final se trouvera dans la zone d’étude de l’emprise du projet permet d'évaluer les impacts
environnementaux et sociaux avec une précision suffisante pour être conforme à la législation djiboutienne
et aux exigences de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement.
5.1 Participation du public
Les normes internationales exigent l'engagement des parties prenantes le plus tôt possible dans le
développement du projet et de poursuivre l'engagement tout au long du cycle de vie du projet afin que les
préoccupations et les impacts potentiels puissent être identifiés le plus tôt possible.
Le principe de la consultation est de s'assurer que les opinions du public sont prises en considération et
rapportées dans le Plan d’Engagement des Parties Prenantes et dans l’EIES. L'objectif est de veiller à ce
que l'évaluation soit solide, transparente et ait examiné toute la gamme des questions, ainsi qu'un niveau de
détail approprié.
La participation du public a commencé dès la phase de cadrage en avril 2020 et s’est poursuivi durant le
mois de mai 2020, et le mois d’août 2020. La liste exhaustive des réunions réalisées avec les parties
prenantes se trouvent détaillées dans le Plan d’Engagement des Parties Prenantes de cette EIES.
5.2 Etude de base sociale
La méthodologie proposée visait à fournir des données quantitatives et qualitatives sur la situation socio-
économique actuelle dans la zone du projet. Les parties prenantes du projet ont été rencontrées pour
identifier leurs préoccupations et leurs attentes concernant le projet. La méthodologie intègre les approches
suivantes :
Recherche documentaire et bibliographique
L’EDD a partagé l’EIES réalisée en mars 2017 (qui devait être mise aux normes internationales). Insuco a
également complété les sources de données secondaires en s’appuyant sur le portail de données de
l’Institut National de la Statistique de Djibouti (en particulier l’EDAM Energie de 2004 et l’Annuaire statistique
de 2019) et sur les rapports sur la situation de Djibouti de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de
Développement (AFD). Des entretiens menés avec l’EDD ont également permis de collecter des données
supplémentaires pour mieux comprendre le projet, ses étapes et sa zone d'influence et de discuter et affiner
les mesures d’atténuation proposées.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
71
71
Analyse via photo-interprétation
Insuco a réalisé une analyse de l’utilisation des sols de la zone d’étude de l’emprise du projet en s’appuyant
sur l’observation des images satellites disponibles sur Google Earth. Le cartographe responsable de cette
tâche a dans un premier temps fait une analyse rapide du tracé en identifiant les zones montrant des figures
et formes singulières. Il a transmis les données géoréférencées de ces formes à l’équipe Insuco responsable
des visites de terrain pour approfondir la compréhension via des visites in situ en avril 2020 avec prise de
photos et de commentaires. Une fois, cette première visite de terrain finalisée, le cartographe a approfondi
son analyse via photo-interprétation et a transmis une deuxième série de points à vérifier sur site. L’équipe
Insuco s’est rendue de nouveau sur le terrain en août et septembre 2020 pour visiter les points critiques
identifiés par le cartographe permettant à celui-ci de finaliser l’analyse d’occupation des sols via photo-
interprétation.Le fait que les terrains soient en milieu désertique et les visites sur le terrain ont permis de
dresser une analyse via photo-interprétation rigoureuse et non dépendante de la saisonnalité.
Visites sur le terrain
Des visites de la zone du projet ont été organisées du 27 au 29 avril 2020, du 26 au 27 août 2020 et du 3 au
7 septembre 2020. Elles visaient à identifier les parties prenantes susceptibles d'être affectées par le projet
ainsi que les principaux problèmes et impacts associés au projet proposé à travers des observations in situ
du tracé et de sa zone d’étude.
La zone du projet s’étend sur une zone importante (près de 190 km). Sur les 100 premiers kilomètres du
tracé, (entre Nagad au AP1 et Dikhil au AP22), le tracé longe des routes carrossables et reste ainsi visible
lors d’un trajet de reconnaissance en voiture. On rencontre une seule zone non-visible depuis l’axe routier
sur 3 km entre AP10 et AP11 : à cet endroit le tracé passe derrière une colline, mais la photo-interprétation a
permis de pallier le manque d’observations in situ.
De plus l’équipe Insuco a réalisé une vingtaine d’arrêts à des zones identifiées par le cartographe comme
montrant des figures et formes singulières. Les arrêts comprenaient la prise de photos, de commentaires et
de points GPS pour détailler l’observation.
Sur les 90 derniers kilomètres du tracé, (entre Dikhil au AP22 et Galafi au AP29), les routes sont fortement
endommagées et le tracé se sépare fréquemment des axes routiers, ce qui rend difficile les observations in
situ. Il s’agit de zones désertiques très faiblement peuplées pour lesquelles Insuco s’est appuyé sur la photo-
interprétation pour étudier l’occupation des sols. Cette information a été contrastée lors des groupes
discussion avec les communautés de Dikhil (AP22), Yoboki (AP25) et Galafi (AP29).
Consultations qualitatives
Des réunions ont été organisées avec les différents acteurs du projet, structurant les échanges autour des
aspects suivants :
Quelles activités du projet pourraient affecter les acteurs ?
Comment ces activités sont-elles actuellement menées ?
Comment devront-elles être modifiées avec le projet ?
Comment sont utilisées les terres dans l’emprise du projet ? Y a-t-il de l’agriculture, de l’élevage ou
d’autres activités économiques ? Y a-t-il des habitants nomades ou sédentaires ? Y a-t-il d’autres
usages d’importance pour la population (tombes en particulier) ?
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
72
72
Quelles sont les droits fonciers sur ces terres ? Quels sont les droits de propriété et les droits
d’usage ?
Dans quelle mesure est-il possible de déplacer des enclos ou des tombes ?
Quelles sont les préoccupations et les recommandations des parties prenantes interrogées
concernant ces changements ?
Les consultants ont discuté des aspects sociaux avec les parties prenantes suivantes :
Echanges continues avec l’EDD par courriel, Skype et présentiel.
Entretiens individuels avec les acteurs institutionnels au niveau national entre le 12 et le 18 mai
2020 : Ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Ministère des Finances,
Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Elevage et des Ressources Halieutiques,
Ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles, Ministère de l'Equipement et des Transports.
Entretiens individuels avec les autorités préfectorales de Dikhil et d’Ali Sabieh le 11 mai 2020 et
d’Arta le 18 mai 2020.
Groupes de discussion avec les notables de la région de Dikhil et d’Ali Sabieh le 11 mai 2020 et de
la région d’Arta le 18 mai 2020.
Groupes de discussion avec des hommes de la zone d’Holhol le 30 mai 2020, de la région de Dikhil
le 26 août 2020 et de la région d’Ali Sabieh le 27 août 2020.
Groupes de discussion avec des femmes de la région de Holhol le 7 mai 2020 et de la région de
Dikhil le 26 août 2020
Les groupes de discussions étaient séparés entre les hommes et les femmes car, dans le contexte
djiboutien, les femmes n’auraient surement pas participé en présence des hommes. Il a également été prévu
de réaliser certains groupes de discussions spécifiques avec des notables pour collecter des données sur
l’histoire de la zone, les droits fonciers coutumiers et les systèmes de gestion des conflits traditionnels.
Insuco avait également préparé des cartes simplifiées du tracé pour structurer les échanges sur l’occupation
des sols. Cependant les participants n’avaient pas les notions nécessaires pour comprendre l’outil
cartographique et Insuco a donc dû reconduire les échanges autour de considérations plus qualitatives en
prenant comme points de référence les villes et villages proches du tracé.
Il est important de noter que ces réunions ont été organisées en suivant un certain nombre de règles
sanitaires afin d’éviter de possibles contagions du COVID-19 : dans ce sens, les participants ont reçu des
masques de protection et ont été invités à se laver les mains avec une solution alcoolisée avant de
commencer la réunion11.
Enquêtes quantitatives
L'analyse quantitative de la population est essentielle pour construire une base statistique solide sur laquelle
les impacts peuvent être mesurés et suivis. L'échantillon de personnes interrogées a été défini en fonction
du temps disponible mais également des conditions sanitaires extraordinaires du moment (relatif à la
pandémie du COVID-19). Insuco a en effet considéré essentiel de limiter les interactions avec les
populations de la zone du projet, certaines vivant dans des régions avec des infrastructures sanitaires
11 Voir le plan de mobilisation des parties prenantes et les mesures anti-COVID-19 qui y sont présentées.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
73
73
limitées pouvant difficilement faire face aux cas graves de COVID-19 dans le cas de contagions. C’est
pourquoi Insuco a proposé de profiter d’enquêtes ménages réalisées en juillet 2019 à Yoboki et de
concentrer la collecte de données sur la ville de Holhol en demandant aux enquêteurs de suivre des règles
strictes de distance et de protection des personnes enquêtées. Cette proposition semblait pertinente car :
Insuco a posé les mêmes questions aux ménages de Holhol et aux ménages de Yoboki afin de
pouvoir analyser les données dans leur globalité. Ces questions permettent de dresser le profil
socio-économique des ménages et en particulier d’identifier les principales vulnérabilités.
Les enquêtes réalisées à Yoboki avaient moins de 10 mois d’ancienneté avec celles de Holhol, ce
qui représente une différence non significative pour des populations isolées n’ayant vécu aucun
changement majeur dans leurs conditions de vie. Insuco a ainsi vérifié que Yoboki n’avait pas reçu
de nouvelles infrastructures (telles que système d’eau potable, école, centre de santé ou nouvelle
route) depuis juillet 2019.
Au vu de la situation sanitaire due au COVID-19, il était essentiel de limiter les interactions avec les
populations locales, en particulier les populations de l’ouest du pays qui sont les plus isolées et avec
un accès plus limité aux centres de santé. C’est pourquoi il a été considéré pertinent de ne réaliser
que les enquêtes indispensables pour assurer la qualité de la ligne de base.
Cette méthodologie a permis de limiter les interactions avec la population tout en ayant accès à un
échantillon significatif et représentatif des communautés pouvant être potentiellement affectées par le projet.
Il est important de rappeler qu’aucune localité ne se trouve dans la zone d’étude de l’emprise du projet : il n’y
a donc pas eu d’enquêtes auprès de personnes se trouvant strictement dans la zone d’emprise du projet.
Cependant la zone d’influence a été élargie aux villes se trouvant proche du tracé de la ligne et pouvant être
impactés indirectement lors de la phase de construction et d’opération de la ligne. Les données quantitatives
ont permis de dresser le profil socio-économique de deux villes représentatives des réalités de la zone du
projet :
100 enquêtes ont ainsi été réalisées auprès de ménages de Holhol entre le 6 et 9 mai 2020. Holhol
se trouve à moins d’1 km du tracé entre AP7 et AP8 et a été choisie comme ville représentative des
populations vivant dans la partie est de la zone du projet. En 2019, la population de Holhol était
estimée à 600 ménages.
111 enquêtes ont également été réalisées auprès de ménages de Yoboki entre le 6 et le 11 juillet
2019. Yoboki se trouve à 3 km à l’est du tracé entre AP24 et AP25 et a été choisie comme ville
représentative des populations vivant dans la partie ouest de la zone du projet. En 2019, la
population de Yoboki était estimée à 1200 ménages12.
Si l'on tient compte des estimations démographiques selon lesquelles Holhol et Yoboki regroupent autour de
1800 ménages, cela signifie que l’échantillon de collecte de données est de 211 enquêtes aléatoires sur une
population de 1800. On peut donc considérer que l'enquête fournit des données quantitatives avec un
niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur réduite à 6 % avec cependant une plus grande précision
à Holhol, où 16% de la population a été enquêtée, qu’a Yoboki où 8% de la population a été rencontrée.
Le questionnaire annexé au présent rapport permet de recueillir des données sur les aspects suivants :
Structure des ménages
12 Source : Assistant du chef de village en date du 25 juillet 2019
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
74
74
Éducation
Santé (y compris l'identification du handicap)
Accès á l’électricité
Moyens de subsistance (y compris l'accès à l'eau et aux installations sanitaires et à l'électricité)
Principales activités économiques (y compris l'estimation des revenus)
Vulnérabilité
Les résultats fournissent des statistiques sur le niveau socio-économique de la population et suffisamment
de données pour informer la structure des revenus des répondants.
5.3 Etude de base environnementale
Cadre de référence
Le choix des paramètres environnementaux, des méthodes d'échantillonnage, des périmètres d'enquête,
des normes et des méthodologies générales s’est basé sur :
Les normes de du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale, notamment :
La NES1 sur l'évaluation et la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux,
et les notes d'orientation correspondantes,
La NES2 sur l’emploi et les conditions de travail
La NES3 sur l’utilisation rationnelle des ressources et la prévention de la pollution, et les notes
d'orientation correspondantes,
La NES 4 sur la santé et la sécurité des populations, et les notes d'orientation correspondantes,
La NES6 sur la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles
biologiques, et les notes d'orientation correspondantes,
La NES8 sur le patrimoine culturel, et les notes d'orientation correspondantes,
La NES10 sur la mobilisation des parties prenantes et information, et les notes d'orientation
correspondantes,
Les directives générales du Groupe de la Banque mondiale et de la SFI en matière d'environnement,
de santé et de sécurité (EHS)
Les lignes directrices EHS du Groupe de la Banque mondiale et de la SFI pour le transport et la
distribution de l'énergie électrique
Les procédures d'évaluation environnementale et sociale (ESAP)du Groupe de la Banque Africaine
de Développement, révisées en 2015.
La collecte d'informations sur l'environnement physique et biologique existant facilite la détermination de la
sensibilité de l'environnement et peut être utilisée ultérieurement comme point de référence pour déterminer
et évaluer les changements qui pourraient avoir lieu. Les enquêtes de référence et les méthodes de création
de données ont été conçues de manière à pouvoir être reproduites à des fins de suivi et évaluation et sont
expliquées en détail dans les sections correspondantes du présent rapport.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
75
75
La méthodologie générale adoptée a impliqué :
L’examen des publications, documents, rapports et cartes scientifiques existants, l’examen de l’EIES
initiale et d'autres documents techniques mis à disposition par l’EDD. La revue documentaire s'est
avérée utile pour identifier les lacunes de l'approche méthodologique de l’EIES existante, les
données à mettre à jour, ainsi que la structure générale et le contenu du rapport.
Une visite de terrain de deux jours avec l'équipe de l'EDD composée de superviseurs, d'ingénieurs
et de techniciens les 27 et 28 avril 2020 afin d'étudier les paramètres physiques et biologiques
pertinents dans la zone de projet.
Les lieux de l'enquête de base ont été sélectionnés avec l'aide de l'équipe technique de l’EDD. Le poste de
Nagad et les pylônes d’angles AP-3, AP-4, AP-5, AP-8, AP-9, AP-11, AP-12, AP-20 et AP-25 ont été choisis
pour effectuer des observations rapprochées, en fonction de leur accessibilité.
Les enquêtes de terrain ont porté sur :
L’identification et l’observation de la flore et des habitats (identification et cartographie de la
végétation et vérification sur le terrain) ;
L’identification et l’observation de la faune (identification sur le terrain) ; et
Les caractéristiques géologiques de la zone de projet : l’utilisation des terres, l’examen du paysage
et l’analyse des terrains chaque côté du tracé.
5.4 Identification et évaluation des impacts potentiels
L’identification des impacts découle de l’analyse de la description du projet, qui établit un ensemble de
facteurs d’impacts, et de la description du milieu, qui rapporte les sensibilités environnementales et sociales
avec lesquelles le projet va interagir.
Les impacts sont de deux types possibles : soit positifs (amélioration des composantes de la zone
d'influence), soit négatifs (détérioration des composantes de la zone d'influence). Que l'impact soit positif ou
négatif, il est nécessaire de déterminer la sévérité de l'impact qui se réfère aux changements causés à une
composante de l'environnement par le projet. Des mesures de bonification peuvent être proposées pour
amplifier les impacts positifs et des mesures d’atténuation doivent alors être proposées pour réduire les
impacts négatifs, dans le but de maximiser les impacts positifs et minimiser les impacts négatifs.
L'évaluation d'impact est donc une approche itérative basée sur quatre questions :
1. Prévision - Qu'arrivera-t-il aux parties prenantes, à leurs conditions de vie et à leurs activités à la
suite de la mise en œuvre du projet ?
2. Évaluation - Cet impact est-il un problème ? Quelle est sa gravité ou son importance ?
3. Atténuation et bonification - S'il est négatif, existe-t-il une solution pour éviter ou réduire ses
inconvénients ? S’il est positif, existe-t-il un moyen pour optimiser ses avantages ?
4. Évaluation des impacts résiduels - L'impact est-il encore grave après l'application des mesures
d'atténuation et ou de modification ?
Les impacts sont évalués en confrontant, d’une part, les caractéristiques et les facteurs d’impact du projet et,
d’autre part, le contexte et les éléments sensibles des composantes biophysiques et humaines de
l’environnement. Les experts en charge de cette évaluation s’appuient sur leur expérience dans des projets
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
76
76
similaires, la littérature spécialisée dans le domaine, ainsi que les directives de bonnes pratiques
internationalement reconnues et produites par les grandes banques multilatérales de développement
(Banque Mondiale, Société Financière Internationale, Banque Africaine de Développement).
Il existe de nombreuses approches pour l’estimation des impacts et les réglementations nationales, et les
standards internationaux laissent une grande liberté dans les méthodes d’appréciation comme dans
l’organisation de la présentation. Dane le cadre de la présente EIES, les impacts sur l’environnement social,
physique ou biologique sont évalués selon trois critères : (i) la probabilité d’occurrence de l’impact dans le
cadre du projet, (ii) l’importance des effets attendus d’un tel impact sans mesure corrective particulière, (iii) la
sensibilité du récepteur de l’impact.
La probabilité d’occurrence correspond à la probabilité réelle qu'un impact puisse affecter le milieu
environnemental ou le milieu social de la zone d’influence du projet. Certains impacts sont
inévitables (bruit, poussière, etc.) alors que d’autres peuvent ne survenir qu’exceptionnellement. La
probabilité est faible si l’impact peut être observé en cas de négligence ou événement accidentel. La
probabilité est moyenne si l’impact s’observe généralement quelques fois pendant la phase de
construction ou d’exploitation. La probabilité est élevée si l’impact s’observe systématiquement, si
des mesures ne sont pas efficacement mises en place.
L'importance des effets attendus sans mesure corrective est déterminée sur la base des
dimensions suivantes :
o Intensité. Elle est déterminée par l'ampleur des perturbations et des nuisances induites pour la
population et l’environnement soumis à la (ou aux) source(s) d'impact. Cette intensité dépend du
degré de perturbation (importance du bruit, de la poussière, etc.), de sa dangerosité et son
caractère irréversible. L’intensité est forte lorsque l’impact détruit l’élément touché, met en
cause son intégrité ou son utilisation ou entraîne un changement majeur de sa répartition
générale ou de son utilisation dans le milieu. L’intensité est moyenne lorsque l’impact modifie
l’élément touché sans mettre en cause son intégrité ou son utilisation, ou qu’il entraîne une
modification limitée de sa répartition générale dans le milieu. L’intensité est faible lorsque
l’impact altère faiblement l’élément sans modifier véritablement sa qualité, sa répartition
générale ou son utilisation dans le milieu.
o Etendue. L’étendue de l’impact est une indication de la superficie du territoire ou de la portion
de la population qui est touchée. L’étendue d’un impact peut être régionale, locale ou ponctuelle.
L’étendue est régionale si l’impact sur un élément est ressenti sur un vaste territoire ou s’il
touche une grande portion de la population de la zone d’étude. L’étendue est locale si l’impact
sur un élément touche une portion limitée de la zone d’étude ou de sa population. L’étendue est
ponctuelle si l’impact sur un élément est ressenti dans un espace réduit et circonscrit ou par un
nombre peu élevé de personnes.
o Durée. Il s'agit de la période de temps pendant laquelle les impacts affecteront l'environnement
naturel ou social. Elle tient compte du caractère intermittent d'un ou de plusieurs impacts. La
durée est longue lorsque l’impact est ressenti de façon continue pendant la durée de vie du
projet ou, du moins, sur une période beaucoup plus longue que la période de construction. Il
s’agit souvent d’un impact permanent et irréversible. La durée est moyenne lorsque l’impact est
ressenti de façon continue, mais sur une période de temps inférieure à la durée de vie des
équipements, c’est-à-dire quelques années, généralement entre un an et trois ans. La durée est
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
77
77
courte lorsque l’impact est ressenti pour une période de temps inférieure à une saison ou
pendant une portion limitée de la période de construction.
o Finalement la sensibilité du récepteur qui sera affecté par l’impact est déterminée par la
vulnérabilité du récepteur social ou environnemental qui est soumis à la source d’impact. Elle
peut être faible, moyenne ou forte en fonction de l’unicité ou la rareté de l’élément impacté, de la
fragilité de l’environnement naturel et social dans lequel s’insère l’élément impacté, de sa
vulnérabilité aux changements, ainsi que de la valeur accordée par les populations concernées
ou par les spécialistes environnementaux et sociaux à l’élément impacté.
Une grille d’évaluation simple est utilisée pour déterminer l’importance des effets d’un impact en s’appuyant
sur l’intégration des critères d’intensité, d’étendue et de durée. La combinaison des trois critères conduit à
un jugement global qui peut être d’importance forte, moyenne, faible ou négligeable :
Un impact d’importance forte correspond à une altération profonde de la nature ou de l’utilisation
d’un élément présent sur une grande étendue du territoire et/ou touchant une grande proportion de
la population de la zone d’étude.
Un impact d’importance moyenne correspond une altération partielle de la nature ou de l’utilisation
d’un élément présent sur une portion limitée de la zone d’étude et/ou touchant une proportion limitée
de la population de la zone d’étude.
Un impact d’importance faible ou négligeable correspond à une faible altération de la nature ou de
l’utilisation d’un élément présent dans un espace réduit ou circonscrit et/ ou touchant un groupe
restreint de personnes.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
78
78
Tableau 4- Grille d’évaluation de l’importance des impacts
Intensité Étendue Durée Importance
Forte
Régionale
Longue Forte
Moyenne Forte
Courte Forte
Locale
Longue Forte
Moyenne Forte
Courte Moyenne
Ponctuelle
Longue Moyenne
Moyenne Moyenne
Courte Faible
Moyenne
Régionale
Longue Forte
Moyenne Moyenne
Courte Moyenne
Locale
Longue Moyenne
Moyenne Moyenne
Courte Faible
Ponctuelle
Longue Moyenne
Moyenne Faible
Courte Négligeable
Faible
Régionale
Longue Moyenne
Moyenne Moyenne
Courte Faible
Locale
Longue Moyenne
Moyenne Faible
Courte Négligeable
Ponctuelle
Longue Faible
Moyenne Négligeable
Courte Négligeable
L’importance de l’impact et la sensibilité du récepteur social ou environnemental sont ensuite combinées par
le biais d’une matrice de telle sorte à obtenir la sévérité de chaque impact. Cette matrice s’applique aussi
bien aux impacts négatifs que positifs. Les critères spécifiques utilisés pour évaluer la sévérité de chaque
type d’impact sont ainsi clairement définis lors de l’évaluation des impacts.
Tableau 5- Grille d’évaluation de la sévérite des impacts
Sensibilité du récepteur
Faible Moyenne Forte
Importance
de l’impact
Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
Faible Négligeable Mineure Modérée
Moyenne Mineure Modérée Majeure
Forte Modérée Majeure Majeure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
79
79
Le niveau des variables d’évaluation de chaque impact sera détaillé et justifié sur la base des données
quantitatives et qualitatives collectées. Les évaluations des impacts seront présentées sous forme de
tableau récapitulatif. Pour faciliter l'évaluation de la nature des incidences et de leur degré d'importance, le
tableau récapitulatif des incidences a été codé par couleur.
5.5 Proposition de mesures d’atténuation et évaluation des impacts résiduels
L'objectif de l'évaluation d'impact est de s'assurer que les décisions relatives au projet sont prises en pleine
connaissance de leur impact sur les parties prenantes, mais aussi d'identifier les mesures qui peuvent être
prises pour que ces impacts soient aussi faibles que possible d'un point de vue technique et financier.
Le niveau de sévérité de l'impact permet de prioriser les mesures d’atténuation. Les impacts positifs peuvent
ne pas nécessiter de mesures d’optimisation, les impacts négatifs négligeables et mineurs peuvent ne pas
nécessiter de mesures d'atténuation spécifiques. En revanche, les impacts négatifs majeurs et moyens
nécessitent des mesures adéquates pour réduire leur importance résiduelle (importance de l'impact après
atténuation).
Tableau 6- Sévérité de l'impact et exigences en matière d'atténuation
Sévérité de
l’impact Exigences en matière d’atténuation
Négligeable L'impact potentiel est négligeable. Aucune mesure d'atténuation ou de gestion
environnementale ou sociale n'est requise.
Mineure Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. Mise en œuvre de bonnes
pratiques de gestion environnementale et sociale standard.
Moyenne
Des mesures d'atténuation spécifiques doivent être élaborées pour réduire
l'importance des impacts à des niveaux acceptables. Si l'atténuation n'est pas
possible, des mesures de compensation doivent être envisagées.
Majeure
Des mesures d'atténuation spécifiques doivent être identifiées et mises en œuvre
pour réduire l'importance des impacts à des niveaux acceptables. Si l'atténuation
n'est pas possible, les impacts négatifs de très grande importance doivent être
pris en compte dans le processus de décision du projet.
Pour atténuer un impact négatif, des solutions seront envisagées selon une hiérarchie d'atténuation :
Éviter - éliminer la source de l'impact, par exemple en déplaçant une partie du projet pour éviter un
site sensible
Réduire - réduire la source d'impact, par exemple en réduisant les poussières émises lors des
travaux de construction
Réhabiliter/réparer les dommages après l'impact, par exemple en revégétalisant une zone
endommagée pendant la construction
Compenser - remplacer une ressource perdue ou endommagée par une ressource différente de
valeur équivalente.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
80
80
Ces mesures sont destinées à éviter, réduire, compenser et/ou remédier aux effets négatifs, ou à renforcer
les effets potentiellement bénéfiques. Dans la mesure du possible, l'atténuation des effets fait partie de la
conception du projet, de sorte que les mesures peuvent être prises en compte dans l'évaluation des
incidences. L'optimisation du tracé de la ligne de transmission, qui a permis de réduire de nombreux impacts
sur les personnes, en est un exemple.
Les mesures d'atténuation et d'amélioration qui doivent être prises dans le cadre du projet sont présentées
sous la forme d'un plan de gestion environnementale et sociale qui doit ensuite être appliqué pour gérer les
différentes phases du projet.
Une fois que toutes les mesures d'atténuation ont été proposées, les impacts sont soumis à une
réévaluation finale pour déterminer la gravité des impacts résiduels.
5.6 Définition du système de suivi-évaluation du PGES
Le succès de la plupart des mesures d'atténuation des impacts sociaux est nécessairement incertain et doit
être contrôlé pour vérifier que les mesures sont mises en œuvre et qu'elles fonctionnent comme prévu. C’est
pourquoi il est proposé un système de suivi-évaluation définissant des indicateurs de suivi et des
responsables de la collecte et l’analyse des données.
Pour assurer la bonne mise en œuvre de ce système, l’EDD mobilisera un ou plusieurs experts dédiés à la
gestion des impacts environnementaux et sociaux et recrutera une maitrise d’œuvre sociale ainsi qu’une
maitrise d’œuvre environnementale (des bureaux d’études d’ingénieurs conseils) afin de procéder à la
collecte des données, leur analyse et la mise en œuvre des plans d’actions.
Dans la mesure du possible, la maitrise d’œuvre sociale sera composée de :
- Un expert social ;
- Un anthropologue / sociologue pour la question de la gestion des tombes ;
- Un archéologue ;
- Un spécialiste des questions du genre en appui ponctuel selon les besoins définis par l’expert
environnemental.;
- Un spécialiste de la santé en appui ponctuel selon les besoins définis par l’expert environnemental.
De même, la maitrise d’œuvre environnementale sera composée de :
- Un expert environnemental à plein temps ;
- Un ornithologue en appui ponctuel selon les besoins définis par l’expert environnemental.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
81
81
6 Etude de base environnementale et sociale
6.1 Etude de base sociale
6.1.1 Démographie et ethnie
La zone d’étude de l’EIES traverse trois régions djiboutiennes :
Ali Sabieh avec une population estimée à 105.941 habitants et une superficie de 2.400 km2 (44,1
hab./km2). Son chef-lieu est né il y a plus d'un siècle avec le chemin de fer reliant Djibouti à Dire
Dawa en Éthiopie.
Arta avec une population de 51.418 habitants et une superficie de 1.800 km2 (28,6 hab./km2).
Dikhil avec une population estimée à 107.916 habitants avec une superficie de 7.200 km2 (15,0
hab./km2).
Le tableau suivant présente une estimation de la population des villes et localités se trouvant dans la zone
d’influence du projet, afin de définir plus en détail la population potentiellement impactée par le projet.
Tableau 7- Population de la zone d’influence du projet
Région Localité Population Ethnie
majoritaire
Arta Chabellei 1.000 Somali
Ali Sabieh Ali Sabieh (préfecture) 14.000 Somali
Holhol (sous-préfecture) 4.000 Somali
Da’Asboyo 1.750 Somali
Goubetto 700 Somali
Doudoub Bololé 600 Somali
Dikhil Dikhil (préfecture) 12.000 Somali
Yoboki (sous-préfecture) 7.000 Afar
Mouloud (sous-préfecture) 6.000 Somali
Galafi 1.800 Afar
Dagguirou 500 Afar
Tewo 400 Afar
Ab Aïtou 250 Afar
Gour’Obbous 250 Afar
TOTAL 50.250
Source : Conseils régionaux de Arta, de Dikhil et de Ali Sabieh et mindat.org
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
82
82
Ainsi selon les données de recensement disponibles, 50.250 habitants habiteraient dans une ville ou localité
se trouvant dans la zone d’influence du projet mais aucune de ces localités ne se trouvent dans la zone
d’emprise du projet. De manière plus précise, 1.000 habitants appartiennent à la région de Arta, 21.050
habitants se trouvent dans la région d’Ali Sabieh et 28.200 habitants vivent dans la région de Dikhil.
Cependant, une forte proportion de la population de ces trois régions reste nomade et n’est donc pas
recensée dans une localité en particulier : 42% de la population de Ali Sabieh et de Arta serait nomade et ce
pourcentage atteindrait 47% à Dikhil13. Il est donc probable que la population vivant de manière permanente
ou temporaire dans la zone d’influence du projet puisse atteindre 90.000 personnes en incluant la population
nomade.
Figure 2- Population urbaine et rurale dans les régions du projet (Annuaire 2017- DISED)
Cependant les dernières conclusions de l’EDAM réalisée en 2017 reverraient à la baisse la proportion de
population nomade, qui est particulièrement difficile à estimer. Les phénomènes de sécheresse et de
désertification dont souffre Djibouti mèneraient les populations nomades à développer des stratégies de
résilience en migrant vers des régions, parfois hors des frontières du pays, où il y a des pâturages
abondants, ou en s’installant autour des villages et en abandonnant la transhumance traditionnelle au profit
des pâturages de proximité. Ainsi la population nomade pratiquant fréquemment la transhumance avec le
bétail aurait en réalité diminué à près de trois quarts entre 2009 et 2017, ce qui donnerait une population
nationale de nomades transhumants estimée par l’EDAM réalisée en 2017 à 40.987 individus répartis entre
7.647 ménages (5,35 pers./ménage) dans tout le pays. Ce chiffre est quatre fois inférieur aux données
13 Source : Annuaire statistiques Edition 2017 - DISED
Photo 2 : Vue de la localité de Tewo Photo 3 : Vue de la ville d’Ali Sabieh
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
83
83
produites dans l’annuaire statistique de 2017. Dans ce cas de figure, on pourrait estimer que la population
sédentaire et nomade dans la zone d’influence du projet soit de 60.000 personnes.
La population vivant de manière permanente ou temporaire dans la zone d’influence du projet
est comprise entre 60.000 et 90.000 personnes, avec entre 17% et 45% de nomades.
Au cas par cas et au long de l’avancée de la construction L’EDD et les maitrises d’œuvre techniques et
sociales devront porter une attention particulière aux impacts sur les populations nomades qui n’ont pas pu
être spécifiquement identifiés dans cette étude.
En ce qui concerne les aspects ethniques, on retrouve deux groupes principaux à Djibouti : les Somalis qui
forment le principal groupe ethnique du pays (60%) et les Afars qui représentent 35% de la population du
pays. Les 5% restants de la population de Djibouti sont principalement composés d'Arabes yéménites,
d'Éthiopiens et d'Européens. Les Afars et les Somalis sont musulmans dans leur quasi-totalité. Cette
distinction ethnique au sein de la population djiboutienne se retrouve également au niveau territorial. Ainsi
dans la zone d’influence du projet, les Somalis représentent la majorité de la population depuis Nagad
jusqu’à Dikhil, alors que les Afars représentent la majorité de la population à partir de Dikhil jusqu’à Galafi.
La ville de Dikhil est ainsi située à la limite des communautés Afar et Somali. Elle se caractérise par une
population sédentarisée parlant majoritairement le somali, à laquelle se joignent des caravaniers et des
personnes en transit qui sont le plus souvent Afars. Les populations nomades qui circulent périodiquement
du Nord au Sud de Djibouti seront amenées à traverser le corridor de la ligne.
Comme expliqué dans la section méthodologique, Insuco a mené des enquêtes quantitatives pour compléter
les données statistiques nationales qui ne sont disponibles que désagrégées au niveau régional et sont
parfois insuffisantes. Afin de cerner la diversité territoriale de la zone d’influence, Insuco a sélectionné deux
localités : Holhol en zone majoritairement Somali et Yoboki en zone majoritairement Afar. Les résultats sont
présentés dans les paragraphes suivants. Ils sont contrastés avec des statistiques nationales lorsque celles-
ci sont disponibles et récentes. Les ménages interrogés comptent en moyenne 6,0 personnes, et la taille des
ménages de Holhol et de Yoboki ne montre pas de différences significatives. Près de trois quarts des
ménages comptent entre 4 et 9 personnes. Ces chiffres sont comparables aux moyennes nationales : à
Djibouti, la taille moyenne des ménages est de 6,3 personnes14.La moitié des membres du ménages ont
14 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2017, DISED.
Figure 3- Taille du ménage (Enquête Insuco)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
84
84
moins de 15 ans, chiffre largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 31% de personnes ayant
moins de 15 ans15. La population de la zone du projet est donc particulièrement jeune pour le pays. Parmi la
population ayant plus de 15 ans, les femmes représentent 51% de la population ce qui est comparable à la
moyenne nationale de 50%16.
En ce qui concerne les chefs de ménages, ils ont 48 ans en moyenne (46 ans à Yoboki et 50 ans à Holhol).
Plus de la moitié des chefs de ménages ont entre 40 et 59 ans. Il n’y a pas de différence significative dans
l’âge des chefs de ménages en fonction du genre.
71% des chefs de ménages sont en mariage monogame, 14% sont veufs ou veuves, 6% divorcés, 5%
pratiquent la polygamie et 4% sont célibataires. Ce sont des chiffres très similaires à la répartition
nationale17. Si l’on compare la situation entre Yoboki et Holhol, les différences significatives sont que tous
les ménages identifiés comme polygames se trouvent à Yoboki et que la presque totalité des chefs de
ménage célibataires se trouvent à Holhol : les célibataires sont principalement des hommes militaires ou
employés par le secteur public.
70% des chefs de ménages sont des hommes et 30% sont des femmes. Le nombre de femmes cheffes de
ménages est relativement plus élevé à Yoboki (34%) qu’à Holhol (26%). Il s’agit généralement de femmes
veuves ou divorcées. Dans le cas de couples mariés, les hommes sont largement plus souvent considérés
comme le chef de ménage (84% des couples monogames ont un homme comme chef de ménage).
Finalement en ce qui concerne l’appartenance ethnique, il existe une distinction claire entre Yoboki à l’Ouest
avec 96% d’Afars et Holhol à l’Est avec 99% de Somali. Cette information est cohérente avec les données
sur les aspects ethniques partagées plus haut dans ce document, selon lesquelles de Nagad à Dikhil (zone
est), la population est majoritairement Somali, alors qu’entre Dikhil et Galafi (zone ouest), la population est
principalement Afar. A Yoboki on trouve également 3% d’Oromo, qui sont des migrants venant d’Ethiopie.
Figure 4- Age du chef de ménage en fonction du genre (Enquête Insuco)
15 Banque Mondiale, 2020.
16 Banque Mondiale, 2020
17 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2012, DISED.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
85
85
Figure 5- État civil du chef de ménage (Enquête Insuco)
Figure 6- Groupe ethnique du chef de ménage (Enquête Insuco)
6.1.2 Education
Un aspect essentiel de la ligne de base socio-économique est de caractériser le niveau d'éducation des
personnes qui seront potentiellement touchées par le projet.
En ce qui concerne les infrastructures scolaires existantes, les chefs-lieux (Ali Sabieh et Dikhil) ont des
centres scolaires depuis l’école primaire jusqu’au lycée technique ou professionnel. Dans les sous-
préfectures, on trouve des écoles primaires et des Collèges d’Enseignement Moyen (CEM) permettant aux
habitants de finaliser le secondaire sans se rendre dans une ville voisine : c’est le cas à Holhol, Yoboki,
Mouloud. Dans les localités les moins peuplées, on trouve uniquement une école primaire. Il faut remarquer
que même les localités de petite taille comme Tewo semble avoir une école primaire avec des enseignants.
Selon les résultats de l'enquête menée par Insuco, 59% des membres du ménage ayant plus de 15 ans sont
analphabètes : cela s’explique par le fait que 91% de ces personnes ne sont jamais allées à l’école. La
proportion d’analphabètes est particulièrement élevée à Yoboki (67%). L’EDAM réalisée en 2017 montre des
résultats similaires avec des taux d’analphabétisme de 58% dans la région d’Ali Sabieh (région de Holhol),
74% dans la région de Dikhil (région de Yoboki) et 70% dans la région d’Arta.
Dans l’enquête Insuco, l'âge moyen des répondants analphabètes est significativement plus élevé que celui
des répondants alphabétisés (42,6 ans contre 28,7 ans), ce qui est conforme aux données socio-
économiques nationales montrant une augmentation du taux d'alphabétisation chez les plus jeunes18.
L’enquête menée par Insuco a également permis de collecter des données plus détaillées sur l’éducation.
Ainsi, 39% des membres des ménages ayant plus de 15 ans savent lire et écrire en français : un tiers d'entre
eux sont allés jusqu'à l'école primaire, un tiers a atteint le collège et un tiers est arrivé au lycée ou a réalisé
des études universitaires. Il est en particulier intéressant de noter que 49% de la population de Holhol ayant
plus de 15 ans est alphabétisée en français. Finalement 8% de la population de plus de 15 ans sait lire et
écrire en arabe.
18 http://djibouti.opendataforafrica.org/zknahdc/socio-economic-database?regions=1000000-djibouti
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
86
86
Figure 7- Alphabétisation des membres des ménages ayant plus de 14
ans en fonction du lieu (Enquête Insuco)
Figure 8- Alphabétisation des membres des ménages ayant plus de 14
ans en fonction du genre (Enquête Insuco)
Figure 9- Niveau d’éducation des membres du ménages ayant plus de
14 ans en fonction du genre (Enquête Insuco)
Figure 10- Principales raisons d’abandon de l’école en fonction du genre
(Enquête Insuco)
L’enquête Insuco a également identifié des inégalités de genre en termes d’éducation. Ainsi le taux
d’alphabétisation est bien inferieure chez les femmes que chez les hommes (28% versus 54%) et l’écart
entre hommes et femmes est légèrement plus important à Yoboki qu’à Holhol. Ces données montrent des
inégalités supérieures à celles relevées dans les données nationales selon lesquelles 43% des femmes sont
alphabétisés et 63% des hommes le sont19.
Lorsque l’on analyse le niveau d’éducation de la population, on identifie que les femmes sont
surreprésentées dans la catégorie des personnes n’étant pas allées à l’école et de plus en plus sous-
représentées au fur et à mesure que l’on monte dans le niveau scolaire (primaire, collège, lycée, université).
La principale raison d’abandon scolaire est le mariage et le besoin de travailler pour la famille : ce sont
principalement les femmes qui souffrent de cette situation.
Le jeune âge de la population et son faible niveau d’éducation limitera l’embauche au sein de la population
locale sur ce projet aux postes ne nécessitant pas de qualification tels que le gardiennage, le ménage, etc.
6.1.3 Santé et handicap
En ce qui concerne les infrastructures sanitaires de la zone d’influence du projet, les chefs-lieux (Dikhil et Ali
Sabieh) ont des hôpitaux qui intègrent au moins un médecin. Dans le reste de la zone d’influence, on
retrouve huit postes de santé en tout dont le personnel soignant est conformé par des infirmiers sous la
19 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2017, DISED.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
87
87
responsabilité du Ministère de la Santé. Ces postes se situent dans les localités suivantes : à Chabellei dans
la région d’Arta, à Goubetto, Holhol, Da’Asboyo dans la région d’Ali Sabieh et à Mouloud, Yoboki, Ab Aïtou
et Gour’Obbous dans la région de Dikhil. Holhol compte également avec un deuxième centre de santé au
niveau du camp de réfugiés se trouvant proche de la ville. Il est important de souligner que Galafi qui a
autour de 1.800 habitants dépend de caravanes irrégulières pour les soins et n’a pas de poste de santé.
Dans le cas de problèmes de santé la population doit donc se rendre à Yoboki (40 km de distance) ou même
jusqu’à l’hôpital de Dikhil (100 km de distance) si l’infirmier de Yoboki ne peut pas apporter de solution. Ainsi
entre Yoboki et Galafi, il n’y a aucun centre de santé et la population dépend de caravanes sanitaires.
D’autre part, selon l’annuaire statistique de 2019, la capacité d’accueil des structures hospitalières est de
118 lits disponibles dans la région de Dikhil (11,0 lits pour 10.000 habitants) et 240 lits dans la région d’Ali
Sabieh (22,7 lits pour 10.000 habitants), ce qui donne des indicateurs de disponibilité des services
hospitaliers supérieurs à la moyenne africaine qui est, selon l’OMS, de 10 lits pour 10.000 habitants.
Les enquêtes Insuco ont permis de préciser l’utilisation des infrastructures sanitaires par la population dans
deux localités ayant des postes de santé sous la responsabilité du Ministère de la Santé. La grande majorité
de la population déclare se rendre à leur poste de santé lorsqu’ils sont malades et les femmes écoutées lors
des groupes de discussion de cette EIES ont déclaré que les postes de santé de leur ville avaient bien du
personnel sanitaire pour les recevoir. A Holhol, 7% des ménages déclarent également se rendre de
préférence à l’hôpital : il s’agit en réalité du centre de santé du camp de réfugiés de Holhol géré par
l’UNHCR, alors qu’à Yoboki, les ménages n’allant pas au centre communautaire sont soignés par des
caravanes médicales. Il faut noter que 20% des ménages déclarent ne pas se rendre à des structures de
santé. Ces derniers ont expliqué qu’ils n’utilisaient aucun service médical pour des raisons autres que la
distance ou la qualité des soins reçus. Ils attribuent plutôt cela à la bonne santé des membres de leur
ménage.
La venue de médecins ou d’infirmiers avec l’arrivée des travailleurs pourra s’avérer un impact positif pour la
population locale si ces personnels de santé réalisent des visites médicales auprès des habitants. Des
campagnes de sensibilisation pourront aussi pousser les ménages à se rendre plus régulièrement dans des
structures médicales.
D’autre part seuls 9% des ménages ont déclaré avoir quelqu’un atteint d’une maladie temporaire au cours
des 3 derniers mois. Ce nombre est significativement plus bas à Yoboki (4% des ménages) qu’à Holhol
(15% des ménages). Ce faible pourcentage de ménages déclarant des maladies dans leur foyer peut
expliquer pourquoi de nombreux ménages ne se rendent pas à des structures de santé.
Figure 11- Services de santé utilisés par les ménages (Enquête Insuco)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
88
88
Figure 12- Ménages avec des malades durant
les 3 derniers mois (Enquête Insuco)
Figure 13- Ménages avec des personnes à
charge (Enquête Insuco)
Figure 14- Ménages avec des personnes
handicapées (Enquête Insuco)
Il est également important d’identifier les ménages comprenant des personnes à charge ou des personnes
handicapées. Ainsi, 14% des ménages enquêtés par Insuco déclarent s’occuper de personnes à charge. Il
s’agit généralement de parents, oncles ou tantes demandant une attention particulière du fait de leur âge
avancé. La situation est significativement différente entre Yoboki et Holhol : alors qu’à Holhol (région d’Ali
Sabieh) seuls 8% des ménages ont des personnes à charge, à Yoboki (région de Dikhil) cette situation
touche 19% des ménages.
Finalement les enquêtes ont permis d’identifier les ménages ayant des personnes porteuses de handicap. Il
peut s’agir de personnes avec un handicap mental ou physique mais également souffrant de maladies
chroniques les handicapant dans la vie de tous les jours. 8% des ménages ont déclaré inclure des
personnes porteuses de handicap avec des chiffres similaires entre Yoboki et Holhol.
Les ménages ayant des personnes à charge et/ou des personnes porteuses de handicap montrent une plus
forte vulnérabilité : en effet, ces personnes leur demandent une plus forte attention et ce sont le plus souvent
les femmes qui doivent se responsabiliser de cette charge de travail supplémentaire.
Finalement les groupes de discussion menés dans le cadre de cette EIES ont été l’occasion d’identifier si la
population de la zone d’influence avait eu accès à des campagnes d’information sur le VIH/SIDA. En effet
lors d’afflux de travailleurs comme cela pourrait être le cas lors de la phase de construction de la ligne, un
des impacts potentiels peut être l’augmentation de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles
dans la zone d’influence du projet.
Selon les données de ONUSIDA20, à Djibouti, en 2019, il y avait 6.200 adultes vivant avec le VIH (56% de
femmes, 44% d’hommes) et entre 500 et 1.000 enfants. La prévalence du VIH chez les adultes âgés de 15 à
49 ans serait de 0,8 % avec une tendance à la baisse (1,6% en 2014).
Dans la zone d’étude, la dernière campagne d’information sur le VIH/SIDA aurait eu lieu à Dikhil en 2007 et
à Ali Sabieh en 2018. La population (hommes et femmes) sait qu’existe le virus du VIH/SIDA mais elle ne
connait pas nécessairement les canaux de transmission, ni les mécanismes de prévention, ni son propre
statut sérologique. Les résultats de l’enquête PAPFAM de 2012 ont ainsi montré que plus de 63% de la
population nationale et 93% des jeunes ne connaissent pas leur statut sérologique. En milieu rural, 56% des
femmes non célibataires ont déclaré avoir des connaissances sur le SIDA (alors que ce pourcentage était de
66% en 2002) et 85% des femmes ayant des connaissances sur le SIDA ne savaient pas que la non-
20 https://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/djibouti
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
89
89
utilisation de préservatif était un risque de transmission. Certaines femmes avouent que le sujet est tabou au
sein de leur couple et pensent que la religion peut guérir de la maladie.
6.1.4 Activités économiques et sources de revenus
Des questions ont été posées lors de l’enquête Insuco pour estimer les revenus des répondants : il est
important de souligner qu'elles sont basées uniquement sur des réponses déclaratives. Toutefois, les
enquêtes étaient confidentielles et les enquêteurs étaient expérimentés, ce qui a considérablement
augmenté la fiabilité des données recueillies.
La population se trouvant dans la zone d’influence du projet est une population rurale qui peut générer des
revenus à travers l’agriculture, l’élevage, une activité libérale (commerce, artisanat, restauration, etc.) ou une
activité salariée. Il faut également considérer que certaines personnes pratiquent la contrebande et n’ont
donc surement pas déclaré ces revenus.
6.1.4.1 L’agriculture
L’agriculture n’est pratiquement pas présente dans les localités enquêtées par Insuco. Seuls 1% des
ménages la pratiquent (tous se trouvent à Yoboki) et il s’agit d’une agriculture limitée à quelques centaines
de m2 du fait du manque d’eau pour l’irrigation et destinée presque exclusivement à l’autoconsommation.
Les ménages pratiquant l’agriculture génèrent en moyenne 135.333 FDJ dans l’année.
Figure 15- Activités économiques de la population active (Enquête
Insuco)
Figure 16- Ménages possédant des animaux d’élevage (Enquête
Insuco)
Il faut savoir qu’à Djibouti, le secteur agricole ne contribue que pour 0,8% du PIB. Durant la campagne 2017-
2018, la production agricole nationale a été de 9.412 tonnes sur 1.543 hectares répartis entre 1.982
exploitations. Cela correspond à des rendements élevés (6t/ha) sur des surfaces réduites (0,8
ha/exploitation sur 0,6% du territoire national). En raison du climat aride de Djibouti et de la rareté des
ressources en eau douce, seule une agriculture irriguée et saisonnière est possible. Il s’agit principalement
de plantes fourragères pour nourrir les troupeaux ou, quand les conditions le permettent, de petits jardins
cultivés pour les tomates, les oignons, les dattes, les goyaves et de l’Aloe Vera. Elle ne peut être pratiquée
que sur des superficies limitées le long des oueds mais peut atteindre des rendements importants en
particulier avec le maraichage. Elle fait face à deux enjeux majeurs :
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
90
90
D’une part, l’utilisation des eaux souterraines pour l’irrigation pose des problèmes de salinité
excessive, et ce d’autant plus avec le développement des motopompes. C’est pourquoi, selon la
FAO21, peu de localités sont favorables à des projets d’irrigation d’une certaine importance, à partir
de forages.
D’autre part, les coûts d’exploitation sont élevés ce qui se traduit par des prix plus élevés pour les
produits agricoles locaux que pour les fruits et légumes importés, ce qui limite la commercialisation
de la production locale. En effet, la quasi-totalité des agriculteurs utilisent des pompes à eau à
moteur diesel, dont l'achat (~2.000 dollars) et le fonctionnement (~1.700 dollars par hectare)
représentent des coûts importants.
Dans la zone d’influence du projet, la principale zone agricole se trouve autour de la ville de Dikhil. On
trouve également des espaces agricoles de plus faible dimension à Ali Sabieh, Doudoub Bololé, Mouloud,
Ab Aïtou, Yoboki et Tewo. Cependant l’étude d’occupation des sols réalisées dans le cadre de l’EIES et dont
les résultats sont présentés dans ce rapport n’a pas détectée de parcelles agricoles dans la zone d’étude de
l’emprise du projet.
6.1.4.2 L’élevage
A Djibouti, l’élevage, plus adapté aux conditions rigoureuses que l’agriculture, reste l’activité prédominante
du monde rural et contribue pour 2,3% du PIB national. Il est rendu possible grâce à la présence de
pâturages et la possibilité de faire pousser des plantes fourragères en milieu désertique. Selon les données
2015 du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et de la Pêche, le cheptel national est de
40.000 bovins, 50.000 chameaux, 480.000 ovins, 520.000 caprins et 6.500 ânes. Cependant les
sécheresses des dernières années auraient réduit cet effectif.
L’élevage est en majorité de type pastoral, dépendant du milieu naturel, et se pratique sur les parcours
collectifs qui représente 94% du total de la superficie terrestre du pays22. Bovins, ovins et caprins sont
élevés pour le lait, la viande et les peaux alors que les asins (dont le nombre est peu significatif) et les
camelins assurent le transport. Cependant les phénomènes de sécheresse et de désertification mèneraient
les populations nomades à développer des stratégies de résilience en se sédentarisant autour des villages.
La réduction de la mobilité du bétail par sédentarisation des pasteurs nomades a pour corolaire
l’accroissement localisé des charges animales. La croissance démographique tant humaine que celle du
cheptel a des répercussions négatives sur les parcours naturels déjà fragilisés par l’aridité du climat et les
sécheresses.
Au niveau des localités enquêtés par Insuco, les ménages rencontrés étaient des ménages sédentaires et il
n’a pas été possible d’intégrer de ménages nomades au travail de collecte. Parmi les répondants, 58% des
ménages pratiquent l’élevage et la plupart pratique un élevage de petits ruminants (principalement de
chèvres et en moindre mesure de moutons). 56% des ménages ont des chèvres, avec en moyenne 9
chèvres par ménage et 20% des ménages ont des moutons avec en moyenne 6 moutons par ménage. Ce
sont les femmes et les enfants qui s’occupent des petits ruminants. En ce qui concerne l’élevage de
ruminants de plus grande taille, aucun ménage n’a déclaré avoir des vaches. En revanche, 3% des
ménages ont déclaré avoir des chameaux (8 chameaux/ménage en moyenne) et 1% des ménages ont dit
21 FAO. 2005. AQUASTAT Profil de Pays – Djibouti (http://www.fao.org/3/i9923fr/I9923FR.pdf)
22 https://www.tralac.org/files/2012/12/MasterPlan.pdf
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
91
91
avoir des ânes (2 ânes/ménages en moyenne). Les chameaux sont exclusivement du ressort des hommes.
Il s’agit d’un élevage extensif où les ménages avec peu de têtes se contentent de nourrir les animaux dans
les parcours autour de leur logement et ceux avec un nombre plus important d’animaux les confient à un
berger ou un membre de la famille. Seuls 3% des ménages faisant de l’élevage disent vacciner leur bétail et
4% vendent une partie du lait. Les ménages pratiquant l’élevage génèrent en moyenne 94.503 FDJ dans
l’année. Cependant il faut considérer que pour la majorité de ces familles, le principal but de l’élevage n’est
pas de générer des revenus pour les dépenses quotidiennes mais de pouvoir capitaliser leurs épargnes et
d’avoir ainsi l’option de vendre un animal en cas de difficultés financières.
6.1.4.3 Les professions libérales et salariées
Au niveau national, l’enquête djiboutienne sur l’emploi, le secteur informel et la consommation (EDESIC) de
2015 et l’EDAM réalisée en 2017 fournissent des informations sur l’emploi. Dans la région d’Ali Sabieh, 25%
de la population en âge de travailler a un emploi. A Dikhil ce pourcentage atteint 26% alors que dans la
région d’Arta il n’est que de 23%. Les résultats de l’enquête menée par Insuco sont relativement similaires et
montrent que parmi la totalité de la population active23, 32% ont un emploi : 17% sont salariés, 13% exercent
des professions libérales et 3% sont des journaliers. Ainsi 68% de la population active est sans d’emploi.
Cette situation touche particulièrement les femmes (70% des femmes) alors que 58% des hommes sont
dans cette situation. Cependant, la plupart des ménages arrivent à avoir au moins un membre qui génère
des revenus pour le reste de l’unité familiale. Ainsi, 73% des ménages ont au moins un membre travaillant
comme journalier, salarié ou en profession libéral. A Holhol, ce sont 86% des ménages qui sont dans cette
situation alors qu’à Yoboki ce sont seulement 62% des ménages.
En ce qui concerne les principaux secteurs d’emploi au niveau national, 43% des employés sont dans
l’administration publique, 19% sont dans le commerce, 13% sont dans l’administration privée, 5% dans les
services domestiques et 4% dans les BTP. Au niveau des enquêtes Insuco, les deux localités choisies sont
des sous-préfectures devant avoir un nombre similaire d’employés. Cependant, Holhol compte avec
significativement plus de salariés que Yoboki : cela est dû en partie au fait que Holhol a l’école militaire « El-
Hadj Hassan Gouled » et a donc un nombre important de militaires. De son côté Yoboki a une plus forte
proportion de professions libérales et de journaliers que Holhol.
Figure 17- Activités économiques de la population active, hors agriculture
et élevage (Enquête Insuco)
Figure 18- Revenus moyens en FDJ/an en fonction du type d’activités,
hors agriculture et élevage (Enquête Insuco)
23 Selon la Direction de la Statistique et des Etudes Démographiques de Djibouti, la population active est définie comme l'ensemble des
personnes ayant 15 ans ou plus, il s’agit de l’ensemble des personnes en âge de travailler.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
92
92
La réalisation d’enquêtes ménages spécifiquement pour l’EIES a également permis de collecter des
données détaillées sur les revenus et ainsi préciser les conditions économiques des familles vivants dans la
zone d’influence du projet. Ces données sont présentées dans les paragraphes suivants.
On peut identifier des différences significatives de revenus entre les trois grands types d’activités (journalier,
libéral et salarié). Les journaliers sont ceux qui gagnent les revenus les plus faibles avec 178.375 FDJ/an
sachant qu’ils ne peuvent pas trouver une activité rémunérée tous les jours de la semaine et sont donc le
plus souvent sous-employés. Les professions libérales gagnent en moyenne 50% de plus que les journaliers
avec un revenu de 275.222 FDJ/an et les personnes à leur compte à Holhol gagnent significativement plus
que ceux de Yoboki. Finalement les salariés gagnent en moyenne 734.671 FDJ/an, un revenu largement
supérieur aux deux catégories précédentes.
Le projet aura des retombées positives sur les deux catégories d’emplois les plus précaires en augmentant
les possibilités de travail journalier ainsi que la demande pour de la restauration, Du ménage, du lavage de
vêtement, etc. touchant particulièrement les femmes qui sont plus nombreuses à exercer ce type de
profession.
Le revenu moyen des travailleurs des deux localités enquêtées est de 510.182 FDJ/an. Cependant le revenu
moyen des travailleurs à Holhol est près de deux fois plus élevé qu’à Yoboki (637.441 FDJ/an versus
381.650 FDJ/an) ce qui s’explique par le fait que Holhol a trois fois plus de salariés que Yoboki alors que les
salariés ont des revenus bien supérieurs aux autres travailleurs.
Au sein des professions libérales, les activités menées sont la restauration (vente d’aliments et de khat), le
petit commerce, les métiers de tailleur et cordonnier et les activités de taxi. Les femmes sont beaucoup plus
présentes dans les professions libérales que les hommes. Elles sont la totalité des restauratrices, 64% des
commerçants et 67% des tailleurs et cordonniers. Elles ne sont cependant pas représentées parmi les taxis
et chauffeurs qui est une activité traditionnellement masculine. Parmi les salariés, 48% d’entre eux sont des
militaires (en particulier à Holhol, où 55% des salariés sont des militaires). 30% d’entre eux sont des
employés du secteur public (école, centre de santé, administration), 19% sont des salariés du secteur privé
et 4% sont des retraités. Dans cette catégorie d’activités, les femmes sont sous-représentées. Elles ne
représentent que 4% des militaires, 19% des employés du secteur public et 15% des employés du secteur
public. Les femmes sont ainsi surreprésentées dans les professions libérales et sous-représentées chez les
salariés ; or les salariés gagnent près de deux fois plus que les libéraux. C’est pourquoi on peut identifier
une différence significative de revenus entre les hommes et les femmes : alors que les hommes gagnent en
moyenne 647.343 FDJ/an, les femmes se limitent à des revenus moyens de 274.784 FDJ/an.
Figure 19- Distribution des activités au sein des professions libérales et
participation des femmes (Enquête Insuco)
Figure 20- Distribution des activités au sein des salariés et participation
des femmes (Enquête Insuco)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
93
93
6.1.4.4 La vulnérabilité économique des ménages
Un autre aspect essentiel dans la description de la situation socio-économique des ménages est de
déterminer le nombre de personnes en-dessous du seuil de pauvreté. Pour ce faire, il est nécessaire de
calculer les revenus journaliers sur la base du nombre d'équivalents adultes (ou unités de consommation,
abrévié en « UC ») dans le ménage24. Selon les dernières publications de la Banque Mondiale à Djibouti25,
le seuil de pauvreté extrême est fixé à 1,90 USD/jour, soit l'équivalent de 400 FDJ/jour. Selon les données
collectées, 40% des ménages se situent en-dessous du seuil de pauvreté avec de profonds écarts entre
Holhol et Yoboki. Ainsi Yoboki, représentatif de la région ouest de la zone d’influence du projet, a 52% des
ménages sous le seuil de pauvreté alors que Holhol, représentatif de la partie est de la zone d’influence du
projet, n’a que 27% des ménages sous ce seuil.
Ces données sont similaires aux résultats de l’EDAM de 2017, selon lesquelles le taux d’extrême pauvreté
dans la région d’Ali Sabieh serait de 27% alors que ce taux atteindrait 53% dans la région de Dikhil.
Figure 21- Estimation des revenus journaliers par unité de consommation du ménage (Enquête Insuco)
D’autres indicateurs ont également été collectés lors de l’enquête Insuco pour apprécier la précarité
économique des ménages, en particulier l’insécurité alimentaire qui est un signe fort de précarité des
ménages.
Pour estimer le niveau d'insécurité alimentaire d'un ménage, des questions ont été posées pour savoir :
si au cours des douze derniers mois, un membre du ménage avait manqué des repas parce que le
ménage ne pouvait pas acheter suffisamment de nourriture.
combien de jours le ménage avait mangé de la viande au cours des 30 derniers jours.
A la première question, seuls 6% des ménages ont répondu "oui", avec une plus forte proportion de
ménages de Holhol que de Yoboki ayant dû sauter un repas. En ce qui concerne la deuxième question, 24%
des ménages ont déclaré n’avoir pas mangé du tout de viande durant les 30 derniers jours, avec en
particulier 41% des ménages de Yoboki ayant déclaré être dans cette situation.
24 Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par
unité de consommation à l'aide d'une échelle d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la
pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de plus de 14 ans ; 0,3 UC pour les
enfants de 14 ans et moins.
25 http://pubdocs.worldbank.org/en/783991539889703821/DJIBOUTI-MPO-AM18-french.pdf
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
94
94
Figure 22- Ménages montrant des signes d’insécurité alimentaire (Enquête
Insuco)
Figure 23- Ménages ayant reçu des aides financières de la famille
(Enquête Insuco)
Ces données sont cohérentes avec les données relevées par le PAM en 201426 selon lequel les taux
d’insécurité alimentaire sont de 24% à Ali Sabieh, 33% à Arta et de 42% à Dikhil (avec un maximum de 74%
dans la sous-préfecture de Yoboki).
Finalement, un dernier indicateur peut être révélateur de difficultés financières : il s’agit des ménages
recevant des aides financières de la famille vivant en ville ou à l’étranger. Ces envois périodiques d’argent
permettent normalement au ménage de faire face aux frais scolaires ou à des frais de santé. Il s’agit d’un
filet de sécurité lui permettant de répondre à des besoins ponctuels. 18% des ménages ont déclaré avoir
reçu de l’argent de parents durant ces 12 derniers mois et ce nombre atteint près d’un quart des ménages
de Yoboki.
La baisse du cout de l’électricité pouvant être induite par ce projet aurait donc un impact positif important sur
les populations locales. Cependant cette baisse de cout ne sera pas automatiquement liée au projet et doit
être une décision de la part de l’EDD.
6.1.5 Conditions de logement
Une part importante de la population de la zone d’influence du projet est nomade ou a été sédentarisée
depuis peu. Ces personnes vivent dans des logements démontables appelés buuls ou daybota. Il s’agit de
tentes semi-sphériques faites de branches et recouvertes de nattes qui peuvent être démontées pour bouger
de point d’eau en point d’eau en fonction de la disponibilité de pâturages pour le bétail. Dans la région d’Ali
Sabieh, les buuls représentent 25% des logements, dans la région d’Arta ils représentent 29% des
logements et dans la région de Dikhil, ce pourcentage s’élève à 58% des logements27.
Les conditions de logement reflètent souvent le niveau de revenu des ménages : par exemple, l'indice de
pauvreté multidimensionnelle (IPM) utilisé par le PNUD intègre un certain nombre de variables relatives aux
conditions de logement comme indicateur indirect pour mesurer le niveau de pauvreté des ménages (accès
à l'électricité, à l'eau potable, aux installations sanitaires, aux meubles et aux appareils ménagers)28.
Il est donc intéressant de mettre en relation les conditions de logement et le niveau de revenu des ménages.
Cela est possible à partir des données de l’enquête Insuco mais pas des statistiques nationales. Ainsi les
26 Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN)- PAM, 2014
27 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2017, DISED.
28 http://hdr.undp.org/en/2019-MPI
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
95
95
statistiques nationales de l’EDAM de 2017 apporteront des données régionales sur les caractéristiques des
logements, en incluant des données sur la population nomade, alors que les enquêtes Insuco apporteront
des données reliant conditions de logement et revenus pour les ménages sédentaires de deux localités de la
zone d’influence du projet.
Photo 4 : Exemple de buul
A Djibouti, il est courant que les maisons des ménages incluent plusieurs bâtiments : la cuisine, la douche,
les latrines et le ou les logements sont généralement des bâtiments séparés. Le bâtiment dans lequel le
ménage investit le plus est le bâtiment principal qui est le logement. Les données collectées font référence
aux matériaux du bâtiment principal.
6.1.5.1 Matériaux utilisés pour la toiture
Au niveau des statistiques régionales, la majorité des logements ont des toits en tôle, en particulier dans les
régions d’Ali Sabieh et d’Arta. Cependant les toits en chaume et paille sont également fortement présents en
particulier dans la région de Dikhil avec 45% des logements avec des toits de paille. Les toits en béton ou
tuile restent anecdotiques dans les trois régions. Ces données montrent les mêmes tendances que celles
collectées par Insuco, même si l’enquête Insuco sous-évalue la proportion des toits en chaume, du fait de la
non-prise en compte des nomades dans cette collecte de données.
Selon l’enquête Insuco réalisée auprès de ménages sédentaires, 78% des ménages ont un toit en tôle : à
Holhol tous les ménages enquêtés ont un toit en tôle alors qu’à Yoboki seuls 67% des ménages ont des toits
en tôle ou en béton et 33% des ménages ont des toits plus précaires (en chaume, bois ou bâche). Or les
ménages avec des toits en tôle ou en béton ont des revenus journaliers par unité de consommation deux
fois supérieurs aux ménages avec des toits en chaume, bois ou bâche (681 FDJ/UC/jour versus 342
FDJ/UC/jour).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
96
96
Figure 24- Matériau des toitures (EDAM 2017) Figure 25- Matériau des toitures (Enquête Insuco)
6.1.5.2 Matériaux utilisés pour les murs
Les statistiques régionales montrent une claire distinction entre Ali Sabieh où la plupart des murs sont
construits en briques (avec parfois la partie basse du mur en brique et la partie haute en bois) et la région de
Dikhil où la moitié des logements sont construits en bois ou en paille. Dans la région d’Arta, on trouve une
diversité de matériaux avec une légère prépondérance de murs en bois, paille, tôle et pierres.
De nouveau, on retrouve des tendances similaires dans les résultats de l’enquête Insuco avec tout de même
une sous-représentation des logements de type buul. En effet, 99% des logements de Holhol sont en
briques ou en pierres alors qu’à Yoboki seuls 33% des logements sont faits de ces matériaux. La plupart des
logements de Yoboki sont construits avec des murs en bois, paille ou en tôle. Les ménages avec des murs
en pierre ou en brique ont des revenus significativement supérieurs aux ménages avec des murs en bois,
paille ou en tôle (722 FDJ/UC/jour versus 443 FDJ/UC/jour).
Figure 26- Matériau des murs (EDAM 2017)
Figure 27- Matériau des murs (Enquête Insuco)
6.1.5.3 Matériaux utilisés pour les sols
Finalement au niveau des sols, les statistiques régionales montrent une tendance à plus de sols en ciment
dans les régions d’Arta et d’Ali Sabieh alors que les sols sont majoritairement nus dans la région de Dikhil.
Les sols carrelés sont, de manière générale, peu nombreux. Ces tendances sont accentuées dans les
résultats de l’enquête Insuco : 95% des sols des logements de Holhol sont en ciment ou même carrelé, alors
que seuls 23% des logements de Yoboki utilisent les mêmes matériaux. Et une corrélation existe de
nouveau entre les matériaux du sol et le niveau de revenu : les ménages avec des sols cimentés ou carrelés
atteignent 760 FDJ/UC/jour alors que les ménages avec des sols en terre ne gagnent en moyenne que 439
FDJ/UC/jour.
Figure 28- Matériau des sols (EDAM 2017)
Figure 29- Matériau des sols (Enquête Insuco)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
97
97
6.1.5.4 Approvisionnement en eau
Au niveau régional, la région d’Ali Sabieh est celle avec le plus de branchements d’eau que ce soit dans le
logement ou partagés dans une cour. Dans les régions d’Arta et de Dikhil on trouve plutôt un
approvisionnement en eau depuis une fontaine publique ou directement d’un forage. L’usage des camions-
citernes et des eaux de surface (oued, mare, etc.) est faible et se limite principalement à la région de Dikhil.
Figure 30- Sources d’eau des ménages (EDAM 2017)
Les résultats de l’enquête Insuco montrent une plus forte proportion de branchements et une plus faible
représentation des fontaines et forages. De nouveau cela doit être dû au fait que l’enquête n’a pris en
compte que des ménages sédentaires alors que les ménages nomades sont plus susceptibles de
s’approvisionner en eau au niveau de forages. Aucun forage ou point d’eau n’a été identifié sur la zone
d’emprise du corridor.
Selon les résultats des enquêtes Insuco, 39% des ménages ont leur propre branchement privé et 27% ont
un branchement extérieur par tuyau, c’est-à-dire un branchement partagé raccordé au branchement d'un
voisin. 25% des ménages ne sont pas raccordés au réseau d'eau et utilisent des bornes-fontaines ou des
puits. Enfin 9% des ménages remplissent leurs bidons chez un voisin.
La relation entre le type d'approvisionnement en eau et le niveau de revenu est significative : les revenus les
plus élevés (708 FDJ/UC/jour) ont des branchements privés ou partagés, les revenus les plus faibles
dépendent des robinets des voisins (251 FDJ/UC/jour) tandis que les revenus intermédiaires se rendent aux
puits et au forage (522 FDJ/UC/jour).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
98
98
Figure 31- Sources d’eau des ménages (Enquête Insuco)
Figure 32- Difficultés d’accès à l’eau (Enquête Insuco)
6.1.5.5 Installations sanitaires
Il est également important d’identifier les installations sanitaires que possède le logement. De nouveau les
statistiques régionales montrent de fortes disparités entre l’est et l’ouest de la zone d’influence du projet.
Ainsi dans les régions d’Arta et d’Ali Sabieh, plus des trois quarts des ménages ont des installations
sanitaires plus ou moins sophistiquées. En revanche, dans la région de Dikhil plus de la moitié des ménages
n’ont pas de structures sanitaires.
Figure 33- Types de toilettes (EDAM 2017)
Figure 34- Types de toilettes (Enquête Insuco)
Les enquêtes Insuco montrent des résultats similaires bien que légèrement plus contrastés : ainsi alors que
tous les ménages enquêtés de Holhol ont des latrines ou des douches, 47% des ménages de Yoboki n’ont
aucune installation, ce qui est un signe fort de déficit d'hygiène. De nouveau ces différences reflètent des
différences de revenus : les ménages avec des installations sanitaires gagnent en moyenne 723
FDJ/UC/jour alors que les ménages sans installation gagnent en moyenne 311 FDJ/UC/jour.
6.1.5.6 Conclusions sur la relation entre revenus en conditions de logement dans la zone
d’influence du projet
On peut identifier des différences de conditions de logement qui semblent être en lien direct avec le niveau
de revenus des ménages. La majorité des ménages de Holhol (et plus largement de la région d’Ali Sabieh),
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
99
99
représentatifs de la partie est de la zone d’influence du projet ont des logements avec les murs en briques et
le sol cimenté et possèdent des infrastructures sanitaires, signe d’un niveau d’investissement relativement
important ; alors que les ménages de Yoboki (et plus largement de la région de Dikhil), représentatifs de la
partie ouest de la zone d’influence du projet ont le plus souvent des logements avec les murs en paille et
bois et le sol en terre et ne possèdent pas toujours d’infrastructure sanitaire, montrant un niveau
d’investissement significativement inférieur. Dans cette région, les buuls représentent plus de la moitié des
logements.
Photo 5 : Exemple de maison en pierre
Photo 6 : Exemple de maison en ciment
Photo 7 : Exemple de maison en tôle
Photo 8 : Exemple de maison en bâche
6.1.6 Conditions d’accès à l’électricité
L’accès à l’électricité est un aspect essentiel de cette EIES sachant que le projet étudié a justement pour
objectif d’améliorer l’approvisionnement en électricité de Djibouti.
La zone d’influence du projet fait partie de la subdivision Sud de l’EDD qui est composée d’un effectif de 48
agents et gère la clientèle, la production, ainsi que la maintenance des réseaux électriques. Les localités de
la zone d’influence reliées au réseau national sont les chefs-lieux d’Ali Sabieh et Dikhil et les sous-
préfectures d’Holhol et de Mouloud. La ville de Dikhil dispose également de sa propre centrale thermique
avec une puissance effective de 2000 KW qui complète l’interconnexion avec la centrale de Djibouti. Selon
l’EDD, Dikhil a actuellement 1.271 abonnés dont 253 sont des contrats résiliés non actifs, Ali Sabieh a 1.848
clients dont 281 sont des contrats résiliés non actifs. La tarification n’est pas la même que celle pratiquée
dans la capitale : il s’agit d’un tarif basse tension unique pour tout le monde (domestique, commerce,
administration). Selon l’Arrêté n°2007-0629/PR/MERN du 16 juillet 2007 sur la Structure du tarif de
l’électricité, les consommations sont facturées 65 FDJ/kWh sur la première tranche de consommation (qui
varie en fonction de la puissance souscrite par le client) puis 55FDJ/kWh sur les consommations qui
dépassent le seuil de la première tranche.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
100
100
Les autres localités de la zone d’influence du projet ne sont pas reliées au réseau : en particulier, aucune
localité à l’ouest de Dikhil n’a accès au réseau de l’EDD. Certains sites ont reçu l’appui de projets
d’électrification par énergie solaire comme c’est le cas de Chabellei, Goubetto et Yoboki dans le cadre du
Projet intégré d’électrification par énergie solaire de 10 villages de la République de Djibouti financé entre
2009 et 2012. Cependant les effets de ces projets ne sont pas toujours durables.
Sachant que le présent projet ne prévoit pas d’augmenter la couverture du réseau électrique à de nouvelles
localités, on peut estimer que le projet pourrait bénéficier au maximum à environ 20.000 personnes vivant
dans la zone d’influence du projet, si l’on prend en compte que le réseau EDD permettrait d’approvisionner
la moitié de la population vivant dans les localités desservies par l’EDD. Entre 40.000 et 70.000 personnes
resteront en dehors du réseau EDD. Parmi les 20.000 personnes vivant dans les localités desservies, toutes
n’auront pas non plus le pouvoir d’achat pour se permettre d`accéder au réseau, à moins que l’EDD propose
des tarifications spécifiques pour certaines tranches de la population défavorisée, comme c’est le cas à
Djibouti-ville.
En 2004, la DISED a publié une enquête Energie auprès des ménages qui permet d’apporter des données
complémentaires sur les problématiques de tarification. Les données ne sont pas disponible désagrégées
par région mais il est fait la distinction entre Djibouti-ville et le reste du pays. Les résultats présentés
correspondent donc aux données pour le reste du pays.
Dans l’intérieur du pays, les principales sources d’énergie utilisés, tout usage confondu, sont le kérosène et
le charbon. Selon cette enquête, l’électricité ne serait utilisée que par 34% des ménages se trouvant hors de
Djibouti-ville. Parmi les 34% de ménages utilisant l’électricité, leur consommation annuelle est de 6.114
MJ/an29.
Figure 35- Sources d’énergie des ménages (EDAM-Energie 2004)
Figure 36- Consommation annuelle en MJ par ménage (EDAM-Energie
2004)
Figure 37- Consommation annuelle du pays hors Djibouti-ville en millions
de MJ (EDAM-Energie 2004)
Figure 38- Prix moyen des sources d’énergie en FDJ/MJ (EDAM-
Energie 2004)
29 Comme point de comparaison, en France la consommation annuelle d’électricité est autour de 15.000 MJ/ménage.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
101
101
La consommation d’électricité reste donc limitée tant en nombre de ménages qu’en consommation par
ménage. La consommation annuelle de l’intérieur du pays en électricité est de 15,8 millions de MJ : cela ne
représente que 8% de l’énergie utilisée. C’est le kérosène qui est la première source d’énergie des ménages
(42%), suivi du bois (33%) qui reste la principale source d’énergie pour les ménages les plus pauvres. Ces
résultats peuvent en partie être expliqués par le fait que le réseau de l’EDD n’arrive qu’à un nombre limité de
villes de l’intérieur du pays mais ils sont également à mettre en relation avec le prix des sources d’énergie.
En effet, alors que le kérosène ne coute que 2,2 FDJ/MJ et le bois ne dépasse pas 1,7 FDJ/MJ, l’électricité
coûte 11,8 FDJ/MJ : l’énergie électrique est ainsi entre 5 et 7 fois plus cher que le kérosène et le bois.
Rappelons que, selon l’EDAM 2017, le taux d’extrême pauvreté dans la région d’Ali Sabieh serait de 27% et
que ce taux atteindrait 53% dans la région de Dikhil. Ainsi une part importante de la population ne peut pas
se permettre d’accéder à l’électricité au prix actuel du mégajoule.
Selon les résultats de l’EDAM Energie 2004, la majorité les ménages ayant accès à l’électricité trouvent les
prix pratiqués par l’EDD très chers. La plupart d’entre eux considèrent qu’un prix abordable du kWh serait
une réduction de 40 à 50% des tarifs actuels. Or si l’on compare le prix du kWh à Djibouti avec d’autres pays
africains30, le prix du kWh à Djibouti est justement deux fois plus cher que des pays comme l’Uganda,
l’Ethiopie ou le Sénégal qui ont des niveaux de développement humain comparables31.
Une baisse des couts de l’électricité participerait à l’augmentation de l’usage de cette énergie par les
ménages les plus vulnérables notamment pour l’éclairage, impliquant des impacts positifs la qualité de vie
donnant la possibilité d’ouvrir un commerce de nuit, de faire ses devoirs sans lumière naturelle ou en
améliorant le sentiment de sécurité par exemple.
Figure 39- Répartition des ménages selon la réduction du prix du kWh d'électricité jugée abordable (EDAM-Energie 2004)
Les statistiques régionales permettent également d’apprécier les disparités en matière d’accès à l’électricité.
46% des ménages d’Ali Sabieh ont accès au réseau national puisque trois de ces villes principales (Ali
Sabieh, Holhol et Mouloud) sont branchées au réseau. En revanche moins de 20% des ménages d’Arta et
de Dikhil s’éclairent avec le réseau car, dans ces deux régions, seuls les chefs-lieux (Dikhil et Arta) font
partie du réseau de l’EDD.
30 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) Energie 2004, DISED.
31 Djibouti a un IDH de 0,474, l’Ethiopie a un IDH de 0,463, le Sénégal a un IDH de 0,505 et l’Ouganda a un IDH de 0,516.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
102
102
Figure 40- Sources d’éclairage des ménages (EDAM 2017)
Les principales alternatives au réseau sont les panneaux solaires, le bois de feu et le pétrole lampant
(kérosène). Cependant il faut rappeler que l’éclairage électrique avec une ampoule simple donne 10 fois
plus de lumière qu’une lampe à kérosène (avec moins de consommation d’énergie) et 50 fois plus qu’une
bougie. Les lampes à kérosène sont normalement utilisées pour se déplacer sans problèmes dans la maison
alors que l’éclairage électrique permet de lire et d’étudier le soir.
L’enquête Insuco permet d’analyser plus en détail Yoboki et Holhol qui vivent deux situations très
différentes. Holhol est raccordé au réseau électrique depuis 2019 par l'entreprise publique EDD (Electricité
de Djibouti), et 97% des ménages de Holhol utilisent le réseau électrique comme principale source
d'électricité. En revanche Yoboki n’est pas raccordé au réseau électrique mais a bénéficié ces dernières
années d’un programme de développement de l’énergie solaire, et la population s’appuie sur les batteries et
les panneaux solaires pour accéder á l’électricité mais 48% des ménages de Yoboki n’ont aucune source
d’électricité. Il s’agit des ménages les plus pauvres de Yoboki : en effet les ménages de Yoboki avec de
l’électricité ont des revenus moyens de 587 FDJ/UC/jour alors que les ménages de Yoboki sans électricité
ont des revenus moyens de 346 FDJ/UC/jour.
Figure 41- Sources d’électricité des ménages (Enquête Insuco)
En relation avec l’accès ou non au réseau, le niveau d’équipement électrique diffère fortement entre Holhol
et Yoboki. Ainsi selon les données collectées, 44% des ménages ont des ventilateurs, 36% ont des
télévision, 29% ont des antennes TV et 22% ont des réfrigérateurs mais la quasi-totalité de ces ménages se
trouvent à Holhol. Cependant cette différence d’équipement peut également être mise en relation avec une
différence de revenus. Alors que les ménages avec une télévision ont un revenu journalier moyen de 874
FDJ/UC/jour, les ménages sans télévision ont un revenu moyen presque deux fois plus faible (476
FDJ/UC/jour).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
103
103
En ce qui concerne les téléphones, le téléphone portable à touche est assez répandu dans les ménages que
ce soit à Yoboki ou à Holhol. En ce qui concerne le smartphone, 24% des ménages en possèdent
(principalement à Holhol). Si on combine les ménages avec des téléphones portables à touche et des
smartphones, il apparait que 70% des ménages ont un appareil pouvant recevoir des SMS, ce qui est
intéressant à savoir si l’EDD décide de réaliser des campagnes d'information par l'envoi de SMS lors de la
mise en œuvre du projet.
Figure 42- Niveau d'équipement des ménages (Enquête Insuco)
6.1.7 Collectifs vulnérables
Il est essentiel d’identifier les personnes vivant dans la zone d’influence du projet pouvant être dans une
situation de vulnérabilité. Les données présentées dans les paragraphes précédents de l’étude de base ont
pu montrer que la population de la zone d’influence du projet, et en particulier celle vivant à l’ouest, est une
population vulnérable. Le taux d’extrême pauvreté serait de 53% dans la région de Dikhil et de 27% dans la
région d’Ali Sabieh32. De même, les taux d’insécurité alimentaire sont de 24% à Ali Sabieh, 33% à Arta et de
42% à Dikhil (avec un maximum de 74% dans la sous-préfecture de Yoboki)33. La population de Dikhil
montre ainsi des indices de vulnérabilité particulièrement élevés.
Mais au-delà d’une répartition géographique des personnes vulnérables, il est possible d’identifier deux
collectifs avec des vulnérabilités spécifiques : il s’agit de la population nomade, d’une part, et des migrants,
d’autre part. On peut également considérer que les femmes forment un collectif avec une plus forte
vulnérabilité que les hommes ; c’est pourquoi les inégalités femmes-hommes sont traitées dans la section
suivante dédiée au genre.
6.1.7.1 Situation des populations nomades
Le premier collectif vulnérable est la population nomade. Selon l’annuaire 2017 de la DISED, 42% de la
population de Ali Sabieh et de Arta serait nomade et ce pourcentage atteindrait 47% à Dikhil34. Selon les
estimations présentées dans la section sur la démographie de ce rapport, les nomades représenteraient
entre 10.000 et 40.000 personnes vivant au moins une partie de l’année dans la zone d’influence du projet.
Ce collectif est directement impacté par le changement climatique qui se matérialise à Djibouti par une
hausse significative de la température moyenne ainsi que par l’irrégularité dans le temps et dans l’espace
32 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2017, DISED.
33 Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN) 2014, PAM.
34 Annuaire statistiques Edition 2017, DISED
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
104
104
des précipitations. Il en résulte souvent de longues sécheresses qui alternent avec des périodes de fortes
pluies, avec parfois des orages violents qui provoquent des crues très importantes, ce qui accélère le
phénomène d’érosion des sols déjà fragilisés par la sécheresse.
Cette situation conduit les nomades à une recherche effrénée de pâturages pour leur bétail et une
concentration des cheptels sur les parties arrosées du pays, d’où une surconsommation des pâturages et
son corolaire, la destruction des sols. La régénération du sol et de la végétation est alors compromise ce qui
facilite la désertification que l’érosion d’origine pluviale et éolienne vient intensifier. Les zones de pâturages
diminuent et les populations nomades doivent alors vendre ou voir mourir une partie de leur cheptel, alors
même que le capital animalier a toujours constitué leur source principale de revenus.
La perte de cheptel a fortement contribué à générer une situation de vulnérabilité extrême de cette partie de
la population rurale, qui n’a pas de sources alternatives de revenus pour acheter de la nourriture. La
combinaison pauvreté structurelle et chocs récurrents (prix élevés de la nourriture et faibles pluies) a conduit
à des ventes de bétail anormales et une précarisation des conditions de vie des nomades. En 2014, plus de
98% des ménages nomades appartenaient aux deux quintiles les plus pauvres de la population, et les
nomades représentaient le plus grand pourcentage des ménages en insécurité alimentaire avec 42% en
insécurité alimentaire sévère et 32% en insécurité alimentaire modérée35.
Depuis 2010, ont d’ailleurs lieu des déplacements massifs de nomades qui ont été regroupés sur des sites
au nord du pays dans la région de Tadjourah (Grabtisan, Margoïta) et au sud à Beya Ad (région d’Ali
Sabieh). Ces populations, qui ont perdu tout leur cheptel, ont dû abandonner leurs terres et sont entièrement
assistées par des programmes d’aides du PAM, de l’État ou de donations provenant des philanthropes des
pays du Golf.
D’autre part, le fait que ce collectif se déplace constamment de point d’eau en point d’eau rend difficile leur
suivi. Il est ainsi difficile voire impossible de scolariser les enfants et leurs campements sont rarement
proches des grandes villes, ce qui limite leur accès aux centres de santé. Leur mode de vie ne leur permet
pas non plus d’avoir accès au réseau électrique de l’EDD et ils ne se bénéficieront donc pas des principaux
impacts positifs du présent projet.
En ce qui concerne leur implication dans le présent projet, la NES10 de la Banque Mondiale exige la
réalisation de processus d’information et de consultation des populations qui seront impactées par le projet
et dont le collectif nomade fait partie. Cela représentera un défi particulièrement important sachant que cette
population est en mouvement constant entrant et sortant de la zone d’influence du projet.
6.1.7.2 Situation des migrants
Le deuxième collectif vulnérable traversant la zone d’influence du projet est le collectif des migrants. Il n’a
pas été intégré jusqu’à présent aux données socio-économiques présentées dans ce rapport.
En 2019, 215.710 mouvements de migrants ont été identifiés par les points de suivi mis en place par l’OIM à
Djibouti36. Presque tous ces mouvements étaient des ressortissants éthiopiens qui passaient par Djibouti
pour se rendre dans la péninsule arabe.
35 Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN) 2014, PAM.
36 Migration Snapshot 2019, OIM.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
105
105
Djibouti est un pays de transit très important pour la migration dans l'Est et la Corne de l'Afrique en raison de
sa proximité géographique avec la Péninsule. Les migrants entrent à Djibouti par divers postes frontières,
principalement par Galafi et Balho à l'ouest, ou par Assamo au sud. De nombreux migrants peuvent choisir
de rester à Djibouti ville, ou à Obock ville, pour travailler et gagner suffisamment d'argent pour la suite de
leur voyage. Les migrants passent par Djibouti avec l'aide de facilitateurs et de contrebandiers. Le coût du
voyage ainsi que les points de rassemblement à Obock où les migrants attendent la suite de leur transport
varient en termes de coût et de lieu selon l'appartenance ethnique du migrant. En ce qui concerne l’âge et le
sexe des migrants, 67% sont des hommes, 20% sont des femmes, 10% sont des garçons de moins de 18
ans et 3% sont des filles de moins de 18 ans. 4% des migrants sont des enfants non accompagnés et 1%
ont moins de 5 ans.
Les raisons de la migration sont 98% pour des raisons économiques, 1% des mouvements forcés par des
conflits et 1% des mouvements locaux de courte durée. Les moyens de transport utilisés sont peu
nombreux : en effet, les trois quarts des mouvements se font à pied, 16% se font en bus, 4% en camion, 3%
en voiture ou taxi et 2% en train.
Carte 5- Routes migratoires passant par Djibouti (OIM)
Trois routes migratoires venant d’Ethiopie passent dans la zone d’influence du projet qui a été matérialisée
dans la carte des routes migratoires par un trait discontinu rouge. La première route migratoire traversant la
zone d’influence est celle entrant par Galafi, passant par Yoboki pour ensuite sortir de la zone d’influence et
se dirigeait vers le nord. La deuxième route traversant la zone d’influence passe la frontière de Djibouti par
Assamo au sud et entre dans la zone d’influence au niveau de Dikhil. Elle reste dans la zone d’influence
pendant quelques km pour ensuite ressortir et se diriger vers Ar Oussa. Finalement la troisième route est
celle entrant à Djibouti au niveau de Guelileh et rejoignant la zone d’influence du projet à partir d’Ali Sabieh
jusqu’à Nagad en longeant le tracé du chemin de fer.
D’autre part, Djibouti accueille près de 30.000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement originaires
d'Ethiopie, d'Erythrée, de Somalie et, plus récemment, du Yémen. Le gouvernement de Djibouti assure la
protection des réfugiés par le biais de réformes législatives et a adopté le Cadre global d'intervention pour
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
106
106
les réfugiés, une initiative des Nations Unies qui vise à préserver le bien-être des communautés d'accueil et
des réfugiés. En 2017, une nouvelle loi nationale sur les réfugiés est entrée en vigueur et des décrets ont
été promulgués pour assurer l'intégration des réfugiés dans les systèmes nationaux tels que la santé,
l'éducation et le marché du travail.
La zone d’influence inclut un camp de l’UNHCR à Holhol qui avait été fermé en 2006 après le rapatriement
volontaire massif des réfugiés somaliens et a été réouvert en 2012 pour désengorger le camp d’Ali Adde.
Les Nations Unies ont procédé à la réhabilitation complète du site en rénovant l'entrepôt destiné au stockage
des vivres, en réparant le forage et en renforçant le réseau de fourniture d'eau potable. Il a été également
construit sur le site un centre de santé, une école primaire, des latrines communautaires ainsi que de
nouveaux bureaux. Actuellement le camp de Holhol accueille autour de 2.500 réfugiés dont 90% viennent de
Somalie, 9% viennent d’Erythrée et 1% viennent d’Ethiopie.
La population locale de Holhol montre un certain nombre de préoccupations liés à la présence de réfugiés :
elle s’inquiète de la pression croissante sur les ressources en eau et les ressources forestières (bois de
chauffe et bois d’œuvre pour les habitations), des risques sanitaires liés au VIH/SIDA (entre populations
locales et réfugiés), de l’accaparement de certains emplois par les réfugiés à la place des jeunes résidents
et de l’insécurité37.
6.1.8 Inégalités femmes- hommes
Au niveau national, près d’un ménage sur quatre (22%) est sous la responsabilité d’une femme. En milieu
rural, ce pourcentage augmente à 26% des ménages avec des cheffes de ménage. D’une manière générale,
les femmes accèdent au statut de cheffe de ménage par le veuvage, par le divorce ou lorsque le conjoint a
migré : 47% des cheffes de ménage sont veuves, 24% ont leur conjoint qui a migré pour fournir un appui à la
famille et 11% sont divorcées38. Cependant il ne semble pas que le genre du chef de ménage impacte
significativement le niveau de pauvreté monétaire39. Ainsi en 2013, l’incidence de pauvreté extrême était de
23% pour les ménages dirigés par un homme et de 24% pour les ménages dirigés par une femme.
L’incidence de pauvreté globale était respectivement de 41% et de 40%.
En revanche, on peut identifier un nombre important d’inégalités entre femmes et hommes au niveau
individuel dans l’éducation, l’emploi, la répartition des tâches familiales ou la participation dans les instances
de décisions.
Ainsi, malgré des campagnes nationales d’alphabétisation, le taux d’analphabétisme adulte des femmes
reste 20 points supérieurs à celui des hommes : 57% des femmes et 37% des hommes sont analphabètes40.
Selon l’enquête Insuco réalisée à Holhol et Yoboki, les femmes sont surreprésentées dans la catégorie des
personnes n’étant pas allées à l’école et de plus en plus sous-représentées au fur et à mesure que l’on
monte dans le niveau scolaire (primaire, collège, lycée, université). La principale raison d’abandon scolaire
37 Information collectée auprès des habitants de Holhol en mars 2020 dans le cadre de l’élaboration du CGES du “Projet de Réponse en
Développement aux Impacts liés aux Déplacements dans la Corne de l’Afrique”
38 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2012, DISED.
39 Un ménage est en situation de pauvreté globale si ses ressources sont insuffisantes pour couvrir, sans sacrifice, à la fois ces besoins
alimentaires et non-alimentaires. Un ménage est en situation de pauvreté extrême s’il est forcé de sacrifier une partie de ses besoins
alimentaires essentiels pour couvrir ses besoins non-alimentaires de base.
40 Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM) 2017, DISED.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
107
107
est le mariage et le besoin de travailler pour la famille. Le mariage précoce est ainsi un facteur essentiel
dans l’abandon scolaire des jeunes filles. Officiellement la célébration d’un mariage précoce41 est tolérée à
Djibouti avec l’approbation des tuteurs ou d’un juge dans le pays est un mariage précoce. Selon l’EDAM de
2012, 26% des femmes vivant en milieu rural ont ainsi subi un mariage précoce, certains parents préférant
marier leurs filles tôt par peur d'une grossesse hors mariage.
Au niveau de l’emploi, le chômage affecte significativement plus les femmes que les hommes : selon l’EDAM
de 2017, le taux de chômage est de 63% chez les femmes contre 38% chez les hommes. Deux raisons
peuvent être évoquées pour expliquer cette situation :
la persistance du poids des traditions et des cultures selon lesquelles la femme doit avant tout
s’occuper de son foyer : en effet la répartition des tâches familiales mène à une surcharge pour les
femmes qui s’occupent des enfants, des corvées d’eau et de bois, de la préparation des repas, du
ménage, de la conduite des petits ruminants alors que l’homme a la responsabilité de gérer les
chameaux et vaches, de mener les activités agricoles, de trouver un emploi et de rapporter des
revenus au ménage. Cependant les emplois sont rares et, en pratique, les femmes doivent
également participer à la génération de revenus de la famille en conduisant des activités informelles.
la non-structuration et l’inadéquation du marché du travail qui ne favorise pas l’insertion
professionnelle de la femme. Les femmes rencontrent différents obstacles qui compliquent l’accès
au secteur de l’emploi (faible éducation, difficulté de recrutement dans des secteurs
traditionnellement masculins comme le transport, le BTP, l’énergie, risques de discrimination et/ou
de harcèlement sur le lieu de travail). C’est pourquoi celles qui travaillent se tournent principalement
vers le secteur informel où elles représentent 74% des emplois42. Dans le secteur informel, les
femmes sont plus nombreuses dans les activités de commerce et plus particulièrement dans le
commerce de détail du khat (89%), le commerce de détail hors khat (73%) et le commerce de gros
(72%). Selon l’enquête Insuco réalisée à Holhol et Yoboki, les femmes ne représentent que 4% des
militaires, 19% des employés du secteur public et 15% des employés du secteur privé. Elles sont
ainsi surreprésentées dans le secteur informel et sous-représentées chez les salariés.
Finalement il est important de parler des violences basées sur le genre subies par les femmes djiboutiennes.
A Djibouti, les mutilations génitales féminines (MGF) restent très présentes dans toutes les régions du pays
et dans toutes les couches. Selon le PAPFAM de 2012, la prévalence des MGF est ainsi de 78%. Les
conséquences des MGF sont très néfastes sur la santé de femme et même parfois des nouveau-nés : les
MGF peuvent provoquer de graves hémorragies et des problèmes urinaires, et par la suite des kystes, des
infections, la stérilité, des complications lors de l'accouchement, l'incontinence urinaire et fécale, et accroître
le risque de décès du nouveau-né.
Les femmes sont également nombreuses à subir des violences conjugales. Le PAPFAM de 2012 a collecté
des données sur la perception et l’attitude des femmes vis-à-vis de certaines violences conjugales et a
montré que plus de la moitié des femmes non-célibataires de 15 à 49 ans trouvaient justifié qu’un mari
puisse battre sa femme.
41 Tout mariage célébré avec un individu de moins de 18 ans, selon la définition en vigueur à Djibouti.
42 Enquête Djiboutienne sur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation (EDESIC) 2015, DISED.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
108
108
Figure 43- Raisons justifiées par les femmes pour qu’un mari batte sa femme
L’enquête souligne le fait que l’« on voit qu’on est bien ici dans un schéma de soumission de la femme au
mari. L’acception éventuelle et la justification d’une telle violence par une majorité de femmes mariées, quel
que soit le milieu, le niveau scolaire et le statut de bien être, ne peuvent s’expliquer que par le poids de la
société, de la culture et de la religion. »
6.1.9 Gestion du foncier
6.1.9.1 Ressources juridiques pour stabiliser ou garantir les droits fonciers dans les zones
rurales
En 1991, plusieurs lois ont été votées par l’Assemblée nationale, modifiant sensiblement le système
domanial et foncier43. Cependant, ces dispositions ne concernent que le périmètre urbain de l’agglomération
de Djibouti. L’ancienne législation formalisée entre 1909 et 1939 doit donc continuer, en principe, à
s’appliquer dans le reste du pays, en particulier dans la zone d’emprise du présent projet44.
La situation domaniale et foncière demeure largement marquée par la présence de l’État. Cela est dû à la
présomption de domanialité qui profite à celui-ci et qui concerne tous les terrains non appropriés
privativement. Le domaine public de l’État, inaliénable et imprescriptible, est composé d’éléments naturels
(rivages, cours et points d’eau, etc.) et artificiels (zones et équipements déterminés par la loi ou ayant fait
l’objet d’une procédure de classement, ainsi que les servitudes y attenantes). Le domaine privé de l’État est
constitué de tous les terrains immatriculés au nom de l’État mais aussi de l’ensemble des terrains qui ne font
pas partie du domaine public, et qui n’appartiennent pas de manière claire (existence d’un titre foncier), à
des tierces personnes, publiques ou privées, ce qui inclut notamment les terrains dits vacants et sans
maître. Finalement il existe une troisième catégorie de terres qui sont les terres immatriculées au nom de
particuliers ou de personnes morales ou de l’Etat. Ces terres se concentrent principalement dans
l’agglomération de Djibouti et, en moindre mesure, dans les autres chefs-lieux de région. Il faut cependant
souligner que les terres immatriculées sont soumises à toutes les servitudes nécessitées par l’établissement,
l’entretien et l’exploitation des réseaux d’énergie électrique classés dans le domaine public et aucune
indemnité n’est due aux propriétaires pour les servitudes établies.
43 Loi n° 171/AN/91 2eL du 10 octobre 1991, portant fixation et organisation du domaine public ; loi n° 172/AN/91 2eL du 10 octobre
1991, réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique ; loi n° 173/AN/91 2eL du 10 octobre 1991, portant organisation du
domaine privé de l’État ; loi n° 176/AN/91 2e L du 10 octobre 1991, portant création d’un cahier des charges spécial applicable aux
Anciens quartiers et à Balbala ; loi n° 177/AN/91 2eL du 10 octobre 1991, portant organisation de la propriété foncière ; loi n° 178/AN/91
2eL du 10 octobre 1991, fixant les modalités d’application des lois relatives au régime foncier
44 Cf. loi n° 178/AN/91 2eL. Cette ancienne législation consiste essentiellement dans des textes coloniaux, certains remontant parfois à
près d’un siècle. Ce dispositif instauré par l’Administration française consistait de manière assez classique dans l’immatriculation pour
les biens appropriés et pour des modes d’accès domaniaux associant droit d’occupation provisoire et mise en valeur dans un délai de
temps limité.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
109
109
En ce qui concerne les terres rurales du domaine de l’Etat, elles peuvent être attribuées, sous forme de
concession provisoire, par décret pris en Conseil des ministres et sur proposition du Ministre chargé des
Domaines, après avis d’une Commission foncière mise en place au niveau central.
Toute personne ou entité désirant un terrain rural doit adresser une demande au Ministre chargé des
Domaines, par l’intermédiaire du préfet de la région où se trouve le terrain. Le préfet établit alors un cahier
des charges après consultation des services administratifs compétents. Le cahier des charges est basé à la
fois sur l'exploitation projetée et sur les conditions locales, et fixe le délai d'aménagement des terres et la
durée de la concession. Le document doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines avant d’être
présenté en conseil des Ministres.
Après publication de l’arrêté stipulant le bénéficiaire de la concession provisoire et l’usage du terrain, le
concessionnaire a la possibilité d’accéder à la propriété du terrain si la parcelle est mise en valeur, elle est
d’un seul tenant et elle ne dépasse pas cent hectares. Si le terrain excède cette superficie, le
concessionnaire peut tout de même se voir attribuer la parcelle mise en valeur sous la forme d’un bail
emphytéotique. L'administration garde toujours la possibilité de récupérer à tout moment le libre usage des
terres qui seraient nécessaires pour les besoins des services de l'Etat ou pour tout travail d'intérêt public.
6.1.9.2 Principes coutumiers de la gestion foncière
A Djibouti, la terre appartient à l’Etat mais le droit coutumier sur le foncier est bien réel et il coexiste avec la
législation foncière moderne. En cas de conflit, seule la législation foncière moderne a un pouvoir juridique,
mais en pratique, les autorités de l’Etat tiennent compte des usages coutumiers dans la gestion foncière.
Ainsi, en milieu rural, les autorités coutumières restent très présentes dans la gestion des conflits fonciers et
l'utilisation des terres, notamment des parcours et des forêts reliques.
Le présent projet intervient dans deux contextes : des zones principalement habitées par la communauté
Somali depuis Nagad jusqu’à Dikhil (de AP1 à AP22) et des zones principalement habitées par la
communauté Afar entre Dikhil et Galafi (de AP22 à AP29). L’organisation sociopolitique de ces
communautés est hiérarchisée et structurée en confédération.
La communauté Somali de la zone d’influence du projet fait majoritairement partie de la confédération des
Issas qui se subdivisent en clans. Tous les clans reconnaissent l’autorité d’un Ougas qui réside à Dire Dawa
en Ethiopie. Son autorité traditionnelle s’exerce sur tous ses sujets somalis-issas qu’ils soient en Éthiopie, à
Djibouti ou en Somalie. Il dispose du pouvoir coutumier pour protéger et sauvegarder les modes de vie et les
règles de cette communauté. Au niveau des clans, les décisions sont prises par des assemblées de
notables. L'appartenance à ces assemblées ne résulte pas d'élection, mais d'un consensus toujours
révocable accordé à chacun par sa fraction ou son groupe familial. C'est une de ces assemblées qui choisit
l'Ougas.
La communauté Afar de la zone d’influence du projet fait majoritairement partie de la confédération des
Debnés qui se subdivisent également en clans. Elle s’organise en sultanats, unités territoriales et politiques,
coiffées par un sultan nommé à vie. Celui-ci est secondé par un vizir, son héritier présomptif. Le principal
sultanat de la zone d’influence du projet est le Sultanat de Gobaad correspondant à la région de Dikhil.
Selon les droits coutumiers, le sultan dispose du territoire se trouvant sous son influence et dont il se
considère le propriétaire. Il en concède la jouissance en accordant aux différents chefs de clan des terrains
de parcours. Contrairement à d'autres régions où les droits de pâturage sont soumis à une taxe qui revient
au sultan, dans la zone Debné ces pratiques ne semblent pas avoir lieu. Les chefs de clan sont
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
110
110
responsables de leur « sous-parcours » (au sein du parcours commun de la confédération), qui devient un
lieu privilégié de rassemblement, d’attache et de séjour pour leur clan. Ils se doivent de faire respecter les
espaces de mise en repos, l’itinéraire transhumance et les accords avec les autres clans.
Les accords avec les autres clans sont d’ailleurs multiples et difficiles à comptabiliser que ce soit en zone
Afar ou Somali. Ils sont fondés sur un principe de base de solidarité entre éleveurs au sein d’une même
confédération. Chaque clan peut se rendre sur un territoire qui n’est pas le sien, mais faisant partie du
territoire de sa confédération. Sur les territoires d’influence du projet (Issa entre AP1 et AP22 et Debné entre
AP22 et AP29), tous les membres des clans d’une même confédération jouissent ainsi d'un large éventail de
droits dont :
La libre circulation des personnes et des troupeaux
Le libre accès aux pâturages sur le territoire
Le droit de s'installer et de créer des camps temporaires sur tout le territoire
Le libre accès aux points d'eau et aux enclos (avec néanmoins l'obligation morale d'informer les
autorités coutumières les plus proches de son intention d'abreuver les animaux ou d’utiliser l’enclos)
Le droit de collecter des ressources sur le territoire en fonction de ses besoins (par exemple le bois
de chauffage et le bois de construction) et d'en tirer librement profit (par exemple en vendant des
fagots de bois).
Les membres d’une même confédération peuvent ainsi circuler librement et jouir des ressources communes,
sans que les délimitations des sous-parcours (au niveau clanique) n’aient d'implications majeures en termes
de principes et de pratiques de l'espace pastoral. En revanche, si des enjeux plus importants apparaissent,
comme par exemple de grands investissements et des projets d'infrastructure, un discours local peut
apparaitre faisant valoir la proximité géographique et la longue occupation historique de la zone par un clan
spécifique comme justification d'un accès privilégié aux bénéfices du projet.
Ce système de libre circulation et d'accès aux ressources sur l'ensemble du territoire offre aux éleveurs une
grande liberté de mouvement entre les différentes zones afin de trouver les meilleurs pâturages. Les choix
se font en fonction des conditions agroécologiques et de la répartition des pluies, avec toutes les
informations disponibles. La diffusion des téléphones portables a d’ailleurs grandement facilité la prise de
décision des personnes qui se déplacent avec leurs troupeaux.
Toutefois, le libre accès aux ressources ne signifie pas qu'il n'y ait pas de réglementation, et les autorités
coutumières locales veillent à ce que les principes de base de la gestion des ressources soient respectés.
En pratique, elles interviennent dans deux types de situations : en cas de conflit lié à l'utilisation des
ressources pastorales (auquel cas elles peuvent décider de sanctions), et lorsque des « étrangers »
accèdent au territoire. Sont considérés comme « étrangers » les membres de clans qui n'appartiennent pas
à la confédération. Ils peuvent avoir accès au territoire, mais cet accès est conditionné par un accord verbal
donné par une autorité représentant la confédération : l'Okal général, ou l'un des notables locaux qui se
référera à l'Okal général.
La gestion pastorale entre les confédérations se soucie avant tout de la survie du bétail et est modulée en
fonction de l’état des ressources. En période normale (de non-sécheresse), l’utilisation des parcours est
strictement réglementée au sein de chaque confédération, afin de les gérer durablement. En temps de crise
et de soudure le parcours peut être ouvert aux éleveurs « étrangers », mais les cheptels des voisins ne sont
admis dans les pâturages qu’en vertu d’accords de réciprocité. En cas de conflit, le droit coutumier régie
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
111
111
l’autorégulation sociale. La peur de la honte est une valeur centrale relevée dans les différentes sociétés
pastorales dont les règles et les codes sont transmis d’une génération à l’autre exclusivement par l’oralité.
Le respect de ces règles assure la cohésion sociale. Sous peine d’exclusion, l’individu se doit de craindre le
jugement social et d’en supporter le poids.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
112
112
6.1.10 Occupation des sols
Sur l’ensemble de la zone d’étude de l’emprise du projet il a été identifié :
47 enclos, certains paraissant en état d’abandon. La population locale considère qu’il n’y a pas de
problème pour déplacer ou détruire un enclos à cause du projet, tant que le propriétaire est
compensé.
517 tombes. La communauté Somali considère qu’il n’y a pas de problème pour déplacer une tombe
à cause du projet, tant que le propriétaire est compensé. Cette pratique a déjà eu lieu sur leur
territoire dans le cadre d’un autre projet de construction d’infrastructures. En revanche la
communauté Afar considère que les tombes sont sacrées et ne doivent pas être déplacées.
2 logements buuls appartenant à un même campement nomade. Les buuls sont des logements
démontables qui permettent aux pasteurs nomades de se déplacer toute l’année pour suivre les
pluies et trouver des pâturages. Le campement nomade identifié pourrait donc ne plus être au même
endroit lors de la mise en œuvre du projet mais il pourrait également y avoir d’autres campements
nomades nouveaux.
2 arbres exceptionnels pouvant mesurer plus de 4 mètres de hauteur. La zone du projet fait partie de
l’écorégion des prairies et des arbustes xériques éthiopiens qui se caractérise principalement par
des herbes, des arbustes et des arbres dispersés et de faible envergure (principalement des
Acacias). C’est pourquoi il est rare de trouver des arbres mesurant plus de 4 mètres de hauteur.
Les paragraphes suivants présentent une analyse plus détaillée de l’occupation des sols en suivant le tracé
de la ligne. La série de cartes illustre le statut d’occupation des sols et l'état de développement socio-
économique de la zone d’étude du projet, en incluant les routes, les localités, la fourniture de services
d’éducation, de santé et d’électricité et l’emplacement des activités agricoles et des sites archéologiques.
Il est difficile de prévoir à l’avance les parcours de transhumance qui dépendent de nombreux facteurs
(climat, réunion religieuse etc.) mais des populations nomades traversent régulièrement le corridor du nord
au sud.
Le corridor retenu pour la ligne de transmission part du poste de Nagad, prend la direction sud-ouest puis
longe la ligne existante de 230 kV OHL Nagad-Holhol, près de la ville de Holhol. Sur cette première section
du corridor (entre AP1 et AP6), la zone d’étude traverse une zone désertique avec une dizaine d’enclos et
des tombes circulaires. Au niveau de Goubetto, un arbre pouvant atteindre plus de 4 mètres de hauteur a
été recensé. Sur le reste du tronçon la végétation est plus basse et reste une végétation arbustive
clairsemée. Entre AP4 et AP6, le tracé passe juste au sud de l’aire protégée de Djalelo.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
113
113
Le tracé proposé contourne ensuite Holhol par le nord et continue près de l'ancienne voie ferrée jusqu'à
Da’Asboyo, d'où la ligne part en direction de l'ouest pour trouver son chemin vers le désert du Grand Bara.
En entrant dans le désert, le tracé de la ligne prend une direction sud-ouest, traverse les lignes électriques
existantes, la route nationale 5 et la route nationale 1 et continue parallèlement à la route nationale 1 jusqu'à
Dikhil. Sur cette deuxième section du corridor (entre AP6 et AP20), on trouve une quinzaine d’enclos, tous
concentrés avant le pylône AP15 qui représente le point d’entrée du tracé dans le désert du Grand Bara. Les
tombes sont également relativement nombreuses sur cette section, en particulier entre Holhol et Da’Asboyo
(AP10 et AP11). Près de Da’Asboyo (AP12 et AP13), un arbre pouvant atteindre plus de 4 mètres de
hauteur a été recensé. Sur le reste du tronçon la végétation se caractérise principalement par des herbes,
des arbustes et des arbres dispersés et de faible envergure (principalement des Acacias). De AP15 à AP20,
le tracé traverse le Grand Bara et on n’identifie quasiment aucune végétation et aucun bien sur la zone
d’étude, à part quelques tombes lorsque l’on se rapproche de Dikhil. Le tracé final a été modifié pour passer
plus au nord de Holhol que le tracé initial et minimiser ainsi tout impact actuel et futur sur la population
locale. Entre AP 14 et AP16, le tracé a également été modifié pour éviter la concession attribuée au projet
de Centrale photovoltaïque du Grand Bara.
La ville de Dikhil est ensuite contournée au nord et la ligne change de direction pour se diriger vers le nord-
ouest, et continue parallèlement à la route nationale 1 jusqu'à Yoboki. À Yoboki, après le croisement de la
route nationale 1, la ligne change de direction vers l'ouest en suivant parallèlement la route nationale 1
jusqu'à Galafi à la frontière éthiopienne.
Carte 6- Cartographie de l'étude base sociale (tronçon 1)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
114
114
Sur la troisième section du tracé (entre AP20 et AP29), ont été identifiés une vingtaine d’enclos et un
nombre important de tombes en particulier entre AP22 et AP24 en sortant de Dikhil vers Yoboki et entre
AP27 et AP28 avant d’arriver à Galafi. Deux daboytas appartenant à un même campement nomade au
niveau du pylône AP28 étaient également dans la zone d’étude au moment de l’analyse des données.
L’étude de base environnementale considère également que près de Tewo et Yoboki (AP24 et AP25), les
conditions se donnent pour supporter la croissance d'arbres de plus de 4 mètres de haut. Aucun arbre de ce
type n’a été directement identifié dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Cependant on peut trouver
quelques plaques d'Hyphaene thebaica aux abords de la zone, près de petites zones humides.
Carte 7- Cartographie de l'étude base sociale (tronçon 2)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
115
115
Il est important de souligner que ce tronçon traverse trois espaces de parcours de la confédération Debné.
Le tracé traverse un premier parcours de Dikhil jusqu’à Gour’Obbous (entre AP22 et AP23). C’est une zone
avec d’importants mouvements nord-sud de nomades et transhumants se déplaçant entre les plaines de
Gobaad et de Hanlé et devant traverser le tracé de la ligne de transmission. Le tracé traverse ensuite un
deuxième parcours (entre AP 23 et AP 26). Il s’agit du parcours de Hanlé caractérisé par une vaste plaine
couvrant une superficie de 700 km2 prenant naissance à 350 m d’altitude sur les terrasses alluviales de
l’oued Hanlé et terminant à 110 m d’altitude dans la plaine de Galafi. Elle présente un fort potentiel pastoral
et la population locale est plus ou moins sédentaire avec des villages et campements fixes. Les
campements semi-sédentaires sont concentrés autour des points d’eau, forages et écoles notamment à
Garabeyyis, Hanlé 1, Hanlé 2, Hanlé 3, Yobok, Oudguinni, Agna. Tous ces campements se trouvent en
dehors de la zone d’étude de l’emprise du projet. Finalement le tracé de la ligne traverse le parcours de
Yager (entre AP 26 et AP29) Sur ce parcours, vit une population nomade et pastorale se déplaçant au gré
des pâturages et ne montrant pas comme dans la plaine de Hanlé de semi-sédentarisation. Les buuls ou
daboytas identifiés dans la zone d’étude se trouve dans ce parcours et sont donc très certainement des
campements nomades.
6.1.11 Patrimoine culturel
Selon la NES8 du Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale, le terme « patrimoine culturel
» englobe les formes matérielles et immatérielles dudit patrimoine, qui peuvent être reconnues ou
valorisées aux niveaux local, régional, national et mondial, notamment :
Carte 8- Cartographie de l'étude base sociale (tronçon 3)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
116
116
- Le patrimoine culturel matériel désigne des objets physiques mobiliers ou immobiliers,
des sites, des structures ou groupes de structures, ainsi que des éléments naturels et
des paysages importants sur le plan archéologique, paléontologique, historique,
architectural, religieux, esthétique ou culturel. Le patrimoine culturel matériel peut se
trouver en milieu urbain ou rural, en surface, dans le sous-sol et sous l’eau ;
- Le patrimoine culturel immatériel désigne des pratiques, des représentations, des
expressions, des savoirs, et des compétences — ainsi que les instruments, objets,
artefacts et espaces culturels associés — reconnus par les communautés et les groupes
comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
(BM, 2018)
L’étude d’occupation des sols a permis d’identifier 517 tombes dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Il
s’agit de structures circulaires en pierre mesurant entre quelques centimètres et quelques mètres de
diamètre, en fonction du statut social du défunt : les enfants sont enterrés sous les cercles de plus petite
taille alors que les chefs de clans sont enterrés sous les cercles de plus grande taille. Dans tous les cas, la
dépouille est orientée vers La Mecque comme le dicte la religion musulmane. Les tombes peuvent être
isolées ou organisées en cimetière avec un regroupement de plusieurs dizaines de tombes au même
endroit, certains cercles de pierres pouvant se toucher ou même s’entremêler.
La communauté Somali rencontrée pour la formulation de l’EIES considère qu’il n’y a pas de problème pour
déplacer une tombe à cause du projet, tant que le propriétaire est compensé. Cette pratique a déjà eu lieu
sur leur territoire dans le cadre d’un autre projet de construction d’infrastructures. En revanche la
communauté Afar considère que les tombes sont sacrées et ne doivent pas être déplacées.
Parmi les structures circulaires identifiables dans le paysage djiboutien, la plupart sont des tombes
relativement récentes qui sont considérées comme des sites d’héritage culturel mais certaines de ces
structures peuvent aussi être des tumulus ou awellos en langue locale « tas de pierres rassemblées par les
ancêtres » qui sont des complexes funéraires anciens qui remontent à environ 3000 ans avant J-C, devant
être considérés comme des sites archéologiques. Les tumuli sont faits de roches volcaniques noires issues
de magma refroidi en contact avec l’air ou l’eau. On décèle deux formes de tumulus :
Les tumuli qui sont édifiés de façon plate et circulaire avec des pierres juxtaposées les unes à côté
des autres et avec des stèles aux extrémités. Ces formes de tumulus se trouvent dans les régions
de plaines. Ils se distinguent des tombes plus récentes par le fait qu’ils sont de taille plus imposante
et que la totalité du cercle est rempli de pierres, alors que les tombes plus récentes ne font que le
tour du cercle en pierre ou ont quelques cercles concentriques.
Les tumuli qui ont une forme pyramidale et demandent ainsi un nombre important de pierres
superposées les unes sur les autres. Ces formes de tumulus se trouvent dans les régions
montagneuses. La taille de ce tumulus s’élève de 2 à 3 m de hauteur et une vingtaine de mètres de
large. Ils se distinguent fortement des tombes plus récentes par le fait qu’ils s’élèvent à plus de 2
mètres, alors que les tombes récentes restent au niveau du sol.
L’édification des tumuli obéissait au respect des rites funéraires propres aux populations de cette époque
mais relativement similaires aux principes qui continuent à être suivis par la population nomade. Selon le
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
117
117
statut social de la personne inhumée, si celle-ci était importante (ex : roi, chef coutumier, chef spirituel), il
fallait l’inhumer dans un tumulus imposant et orné de biens précieux (ses pierres précieuses, son sabre, ses
biens matériels). En revanche, les personnes n’ayant pas un statut social élevé, avaient droit à des simples
sépultures ordinaires. La construction d’un tumulus était également réalisée suivant le sexe de la personne
qui devrait y être inhumée. Pour celui d’un homme, le tumulus comprenait deux stèles placées aux
extrémités. Pour celui de la femme, en plus deux stèles, une troisième était placée au centre.
La majorité des awellos se trouve près de la ville de Randa dans la région de Tadjourah, près de la ville
Da’Asboyo dans la région d’Ali-Sabieh et dans le bassin du Gobaad, proche du lac Abbeh. Ils peuvent
également être visibles de manière plus isolée sur le reste du territoire.
Photo 9 : Awello dans la région de Tadjourah (Source : Benoit Poisblaud)
La zone d’emprise du projet ne traverse pas les principales zones rassemblant des awellos. L’étude
d’occupation a identifié de nombreuses tombes dans la zone d’étude de l’emprise mais elle n’a pas recensé
d’awellos. Cependant les archéologues s’accordent sur le fait que les awellos ont été utilisés par les
populations pour construire des enclos ou même d’autres tombes plus récentes ce qui peut avoir modifié
leur morphologie. Il sera donc essentiel d’intégrer une étude plus détaillée des tombes dans la zone
d’emprise finale du projet afin d’éviter tout dommage à un awello45.
Au-delà des awellos, Djibouti abrite de multiples sites archéologiques, principalement paléolithiques. Jusqu'à
présent, aucune politique ou programme de conservation spécifique n'a été mis en place pour protéger et
conserver ces découvertes. Cependant, d’après les entretiens menés avec les parties prenantes du projet et
les populations locales, ainsi que selon l’information bibliographique disponible aucun site ne se trouve dans
la zone d’étude de l’emprise du projet.
45 Cette étude devrait être intégrée à la formulation du PAR du projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
118
118
Carte 9- Principaux sites archéologiques de Djibouti, 201346
Les sites le plus proches de la zone d’emprise sont :
Le site de Anabo Koma abritant des fossiles du Pléistocène de Palaeoloxodon recki, Hippopotamus
cf. gorgops, Heterobranchus sp. se trouvant à 13 km au sud-ouest de Dikhil et à 12 km au sud-ouest
de la zone d’étude entre AP22 et AP23.
Le site d’Armakato, gisement du Paléolithique Inférieur avec de nombreuses vestiges de l’industrie
lithique (bifaces, racloirs, perçoirs, grattoirs, etc.). Il se trouve à 1,5 km au nord de Da’Asboyo et 600
mètres au nord de la zone d’étude entre AP11 et AP12 (au nord de Da’Asboyo).
Le site de Chekeyti-3, avec de nombreux ossements d’hippopotames et une abondante production
lithique du Paléolithique inférieur, se trouvant à 14 km au sud-ouest de Dikhil et à 12 km au sud-
ouest de la zone d’étude entre AP22 et AP23.
Le site de l’oued Douré, gisement du Paléolithique inférieur où ont été récoltées près de 400 pièces
en 1990, parmi lesquelles des bifaces et hachereaux.se trouvant à 4 km à l’est de Da’Asboyo et 2,6
km au sud de la zone d’étude au niveau de l‘AP11.
L’agglomération en pierre d’Handoga proche de l’oued Chekheyti se trouvant à 13 km au sud-ouest
de Dikhil et à 11 km au sud-ouest de la zone d’étude entre AP22 et AP23. Il s’agit d’une
agglomération d’une centaine de cases en pierre équarries de forme circulaire datées entre 4000 et
3000 ans avant J.C.
Le site de peintures rupestres du Grand Bara datées entre 3000 et 2000 ans avant J.C. et
représentant représentent des éléphants, des oryx et des girafes. Il se trouve à 6 km au nord-est de
Doudoub Bololé et 800 mètres au nord de la zone d’étude entre AP14 et AP15.
46 Djibouti Contemporain, Amina Saïd Chiré, KARTHALA Editions, 2013
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
119
119
Finalement, bien que Djibouti n’ait aucun patrimoine inscrit à l’UNESCO, il est important de mentionner la
liste indicative des biens présentée à l’UNESCO et que l’Etat de Djibouti considère comme étant un
patrimoine culturel et/ou un patrimoine naturel de valeur universelle exceptionnelle. La majorité des sites de
patrimoine culturel se trouve au nord du pays, dans les régions de Tadjourah et d’Obock. Cependant
certains sites se trouvent proche de la zone d’emprise du projet. Il s’agit des awellos et de l’aire naturelle
protégée de Djalelo. Le cas des awellos a déjà été traité dans les paragraphes précédents. En ce qui
concerne l’aire protégée de Djalelo, le tracé de la ligne a été modifiée entre AP4 et AP6 pour éviter ce site.
Tableau 8- Liste indicative des sites de patrimoine culturel
Sites Régions
Tumulus (Awello) Ali-Sabieh (oued Douré, à 10 km au sud d’Ali Sabieh) et
Tadjourah (près de la ville de Randa, à 80 km au nord-est de
Yoboki)
Gravures Rupestre d’Abourma Tadjourah (à 60 km au nord-ouest de Yoboki)
Paysage urbain historique de la ville de
Djibouti et ses bâtiments spécifiques
Djibouti-Ville
Lac Assal Tadjourah (à 35 km au nord-ouest de Yoboki)
Iles Moucha et Maskali En mer, dans le Golfe de Tadjourah
Paysages naturels de la région d’Obock Obock
Parc National de la forêt du Day Tadjourah (à 70 km au nord-ouest de Yoboki)
Aire naturelle terrestre protégée
d’Assamo
Ali Sabieh (à 30 km au sud-est d’Ali Sabieh)
Aire naturelle protégée de Djalelo Arta (proche de Holhol)
Lac Abbeh : son paysage culturel, ses
monuments naturels et son écosystème
Dikhil (à 30 km au sud-ouest de Tewo)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
120
120
6.2 Etude de base de l’environnement physique
6.2.1 Géographie et topographie
La topographie générale du tracé proposé pour la ligne de transmission Semera-Nagad est principalement
composée de terrains plats, de collines à plaines, avec quelques pentes douces, mélangées à des collines
basses et des montagnes de moyenne altitude, entrecoupées de vallées et de grandes zones d'acacias
clairsemés, d'arbustes mixtes et de quelques petits jardins développés dans les vallées plus larges où la
nappe phréatique est plus facilement accessible.
L'altitude de cette région varie entre 51 m (altitude minimale) et 686 m (altitude maximale). On peut noter
l’altitude des points suivants :
Le point le plus bas se situe à l'emplacement du nouveau poste de Nagad proposée à environ 51m.
L’altitude près de Holhol City en d’environ 460 m.
L’altitude près de Dikhil varie entre 300 et 600 m (montagnes).
Galafi se situe à une altitude variant de 150 à 300m
Figure 44 : Profil du niveau d'élévation du tracé de la ligne électrique d'Est en Ouest (km0 correspond au poste de
Nagad et km190 à la frontière entre Djibouti et l’Ethiopie)
6.2.2 Climat
Le climat de Djibouti est semi-aride à aride. Il est aride dans les régions côtières du nord-est et semi-aride
dans les parties centrale, nord, ouest et sud. Le sous-type de la classification climatique de Köppen pour ce
climat est "climat tropical et subtropical désertique47.
47 Kottek et al. 2006
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
121
121
Figure 45 : Les types de climat à Djibouti selon Köppen
Source : World Weather
Le climat de Djibouti varie selon les régions du pays. L'intérieur du pays est chaud, avec des températures
moyennes supérieures à 30°C pendant les mois d'été de mai à septembre. Les nuits sont généralement
chaudes, avec des températures moyennes autour de 17°C. Au plus fort de la saison chaude, les
températures peuvent atteindre 45°C. La saison plus fraîche va d'octobre à mars/avril, avec des
températures moyennes de 25 °C. Les températures moyennes se situent autour de 24-25°C et les mois les
plus humides sont avril, juillet et août, avec une moyenne mensuelle de 30 mm. Janvier, juin et décembre
sont les mois les plus secs, avec des précipitations moyennes de 10 mm ou moins. L'humidité est très
élevée, avec des pics de 90 %. Les précipitations sont en grande partie régulées par la zone de
convergence intertropicale (ZCIT) et le climat est également sensible aux effets du phénomène El Niño. Le
pays connaît également des inondations catastrophiques occasionnelles. Les précipitations sont inférieures
à 400 m3/an/par habitant. Par conséquent, Djibouti est classé comme un pays pauvre en eau48.
48 Wilby et al. (2010) Confronting climate variability and change in Djibouti through risk management. Geologically Active – Williams et
al. (eds) ISBN 978‐ 0‐ 415‐ 60034‐ 7
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
122
122
Figure 46: Températures et précipitations moyennes à Djibouti (1905-2015)
Source : Groupe de la Banque Mondiale
Figure 47:Moyenne annuelle des précipitations à Djibouti
Source : Earthwise, British Geological Survey
Durant la saison fraîche qui commence d'octobre à avril, le vent souffle du nord-est au sud-est, venant de
l'océan Indien ou du sud de l'Arabie. Ces vents sont des alizés. L'alizé est frais et humide, jamais violent, et
il apporte parfois de la pluie.
La saison chaude qui commence en mai et se termine en septembre se caractérise par un vent chaud
violent et sec, le "Khamsin". Il souffle généralement dans la journée et s'apaise à la tombée de la nuit. Il est
ensuite suivi d'un léger vent d'est : la brise de mer.
Les vents dominants à Djibouti viennent généralement de l'est. Dans la zone du projet, le vent vient de l’est
et du est-sud-est et la vitesse moyenne du vent est de 9,85 ms-1, mesurée à une hauteur de 59 m.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
123
123
Figure 48 : Distribution de la vitesse du vent à Djibouti à une hauteur de 60m
Source : CERD
6.2.3 Qualité de l’air
Le tracé proposé dans la zone d'étude est éloigné de toute zone industrielle et de tout établissement
humain. Toutefois, sur certains tronçons, les lignes de transmission sont parallèles à la route nationale et
ces zones sont sujettes à la pollution automobile. De plus, en raison du climat et du type de sol sec et des
conditions venteuses, les niveaux de poussière en suspension dans l'air peuvent être élevés. Le tableau ci-
dessous indique l'indice de la qualité de l'air dans la zone du projet. Le principal polluant identifié est le
PM2.5. La qualité de l'air varie de "modérée" à "insalubre pour les groupes sensibles".
Tableau 9 : Indice de la qualité de l’air dans la zone de projet
Source : Données en temps réel par satellite49
Lieu AQI Principal polluant
Djibouti 95 PM2.5
Ali Sabieh 112 PM2.5
Dikhil 97 PM2.5
Galafi 93 PM2.5
6.2.4 Bruit ambient
Une partie importante de l'étude d'impact acoustique consiste à quantifier et à comprendre l'environnement
acoustique existant, et en particulier à mesurer les niveaux sonores perçus par les récepteurs
potentiellement sensibles. L'acoustique de l'environnement peut être définie comme le contexte prédominant
en l'absence de projet. Les données scientifiques disponibles sur l'environnement sonore dans la zone
49 https://www.iqair.com/ 22 Septembre 2020
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
124
124
d'étude sont des niveaux sonores enregistrés pendant une période de 48 heures. Les niveaux sonores
enregistrés se situaient entre 35 dB (A) et 63 dB (A) pendant la journée, et entre 45 et 75 dB (A) la nuit en
raison des activités sur le site et du vent.
Il n'existe pas de directives de la Banque Mondiale sur les niveaux sonores spécifiques aux activités de
construction. Cependant, il est considéré comme une bonne pratique pour les périodes de construction de
plus de deux ans de respecter les niveaux de la directive de la SFI de 55 dB (A) pendant la journée.
Pendant la phase d'exploitation, les recommandations de la SFI en matière de standards environnementaux
et sociaux stipulent que dans les environnements où les niveaux de bruit ambiant dépassent déjà un niveau
de 55 dB(A) le jour et/ou 45 dB(A) la nuit, les émissions sonores ne doivent pas entraîner une augmentation
du niveau de bruit ambiant dans une zone résidentielle de 3 dB(A) ou plus, déterminé pendant l'heure la plus
bruyante d'une période de 24 heures.
Il existe une limite de bruit standard acceptable tant au niveau national que mondial (ne dépassant pas 55
dB pendant le jour et 45 dB pendant la nuit). Les zones couvertes lors de la visite sur le terrain sont
éloignées des établissements industriels et des établissements humains. La principale source de bruit sera
le trafic routier et la pollution sonore due à la construction des lignes de transmission sera temporaire et
limitée.
6.2.5 Géologie et sols
Formé à l'origine par l'action volcanique à la suite du soulèvement et à la formation de failles dans la façade
de l'Afrique de l'Est et dans la vallée du Rift, Djibouti possède une série de hauts plateaux arides entourant
des failles, au sein desquels il existe des plaines basses. De nombreuses zones présentent d'épaisses
couches de coulées de lave. Djibouti compte trois régions principales : la plaine côtière, qui se trouve à
moins de 200 m au-dessus du niveau de la mer ; les montagnes, dont l'altitude moyenne est d'environ 1000
m ; et le plateau situé derrière les montagnes, qui s'élève de 300 à 1500 m. Le point culminant, le mont
Moussa Ali, mesure 2028 m à la frontière nord. Le lac Assal, à 155 m au-dessous du niveau de la mer, est le
point le plus bas d'Afrique et le deuxième plus bas du monde.
Le terrain est nu, sec, désolé et marqué par des falaises abruptes, des ravins profonds, des sables brûlants
et des arbustes épineux. Les eaux souterraines sont très peu abondantes, sauf dans une zone située le long
de la frontière sud avec la Somalie. Djibouti est donc dépendant des aquifères souterrains salins pour ses
besoins en eau. Les tremblements de terre sont fréquents (Encyclopédie des Nations).
La géologie de la région du projet est complexe en raison de l'augmentation des activités sismiques et
volcaniques. Elle est dominée par des basaltes articulés, vésiculaires et altérés (formés à partir de fissures
éruptives) et des scories. La figure ci-dessous montre la géologie et le sol typiques du site du projet.
Les coulées de lave ont créé une stratification subhorizontale avec une épaisseur très hétérogène. Une
seule coulée de lave peut avoir une épaisseur de 1 à 25 mètres. En raison des processus volcaniques, le
basalte peut être encastré entre les couches scoriatiques qui suivent chaque coulée de lave et qui ont une
texture vésiculaire caractéristique.
La majeure partie de Djibouti est composée de roches volcaniques quaternaires et tertiaires. Le long de la
côte, on trouve des récifs coralliens et d'autres sédiments côtiers et alluviaux d'âge quaternaire et les
sédiments alluviaux quaternaires de diverses épaisseurs sont assez répandus dans les oueds.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
125
125
Structurellement, Djibouti forme une dépression triangulaire causée par les tendances tectoniques générales
des grandes vallées du Rift en Afrique de l'Est. Celles-ci s'étendent du nord au sud et du nord-ouest au sud-
est et ont créé un relief fragmenté complexe, composé de hauts blocs et de zones de subsidence, où l'on
trouve parfois des lacs (Schlüter, 2006).
Figure 49 : Géologie de Djibouti
Source : Earthwise, British Geological Survey
La zone de projet a un climat désertique caractérisé par une végétation pauvre. Les sols du pays sont
généralement peu évolués en raison du climat sec, peu épais, très pauvres en matière organique et très
pierreux. Certains sols du pays sont très hétérogènes, généralement formés par des dépôts de colluvions de
cônes alluviaux et des sols alluviaux stratifiés à texture argileuse et limoneuse. Dans certaines régions, les
sols sur le substratum rocheux entrent dans trois catégories de sols bruns (provenant du basalte), de
lithosols et de sables coralliens calcaires. Les lithosols sont des rhyolites provenant du sol et sont plus
acides et pauvres en particules fines que les sols dérivés du basalte. Les sols salins représentent 5 % de la
surface où les sols sont soumis à une masse d'eau salée. Les grands types de sols de Djibouti sont
présentés dans la figure ci-dessous (FAO 2015).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
126
126
Figure 50 : Type de sols à Djibouti
Source : FAO, 2015
La zone du projet est composée de roches volcaniques quaternaires et tertiaires et les sédiments alluviaux
quaternaires de différentes épaisseurs sont assez répandus dans les oueds. Deux grands types de sols
peuvent être identifiés. Sur les plateaux et sur les pentes, des sols caillouteux très peu profonds sur des
roches dures, les leptosols, prédominent. Dans les vallées et les oueds, on trouve des fluvisols. Les
leptosols des montagnes et des plateaux se sont développés en raison de l'érosion continue par le vent et
l'eau. Ces sols ont moins de 10 centimètres d'épaisseur, contiennent de grandes quantités de graviers, ne
présentent que peu ou pas de strates, contiennent peu de matières organiques et sont sensibles à
l'exploitation de l'eau et à la dessiccation. Les leptosols sont très sensibles à l'érosion et ne conviennent ni à
l'agriculture ni aux pâturages. Néanmoins, ils sont utilisés comme pâturages dans le paysage. Les fluvisols
des oueds conviennent à la culture des légumes et des arbres fruitiers. Selon les résultats de l'analyse des
sols dans la zone étudiée, le pH du sol (H2O) est supérieur à 7,5, ce qui indique que le sol est alcalin. Outre
le nitrate, l'azote et le potassium hydrosoluble sont présents en quantités négligeables (JICA, 2014).
L'érosion des sols est un problème courant dans de nombreuses régions du pays. Les causes sont multiples
et le facteur sous-jacent est la perte de la couverture du sol par la déforestation en raison des activités
socio-économiques, en particulier le surpâturage. Le surpâturage expose le sol à des agents d'érosion tels
que le vent et le ruissellement de surface après de fortes précipitations. La désertification est aggravée par
l'aridité du climat due aux longues sécheresses qui entraînent la disparition de la végétation et exposent le
sol à l'érosion éolienne et hydrique. Le taux moyen de perte de sol par érosion hydrique pour toutes les
classes de couverture terrestre est estimé à 12,3 t/ha/an pour Djibouti (Fenta et al., 2020).
Cependant, selon le système de surveillance de la maintenance des lignes électriques existantes dans la
zone d'étude, les incidences de l'érosion du sol à proximité des pylônes des lignes de transmission
existantes sont très faibles, c'est-à-dire que moins de 2 % des pylônes sont touchés par l'érosion du sol sur
une période de 10 ans. Aucun glissement de terrain n'a été signalé à proximité des pylônes des lignes de
transmission existantes.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
127
127
6.2.6 Hydrogéologie
Djibouti est un pays aride avec des précipitations faibles et irrégulières et des ressources en eau de surface
limitées. Le pays dépend presque entièrement des eaux souterraines pour la boisson et l'irrigation.
L'augmentation de la demande en eau a entraîné une exploitation intensive des eaux souterraines provenant
principalement d'aquifères volcaniques dans tout le pays, avec pour conséquence une baisse du niveau des
eaux souterraines et une détérioration de leur qualité. Les sécheresses périodiques de ces dernières
années, avec une recharge réduite des aquifères, ont mis encore plus de pression sur la durabilité des
ressources en eau souterraine50.
La carte hydrogéologique présentée ci-dessous est une version simplifiée du type et de la productivité des
principaux aquifères au niveau national.
Figure 51 : Hydrogéologie de Djibouti
Source: Earthwise, British Geological Survey
Il existe deux principaux types d'aquifères à Djibouti : les aquifères de roche volcanique à l'échelle locale et
régionale et les aquifères sédimentaires non consolidés, y compris les alluvions d'oueds peu profonds et les
aquifères de plaine alluviale (Jalludin et Razack 2004).
On trouve également des grès sédimentaires consolidés du Jurassique et du Crétacé, mais ils sont encore
mal exploités (Jalludin et Razack 2004).
La forte évapotranspiration combinée à des pluies intermittentes et généralement abondantes signifie qu'une
très faible proportion des précipitations s'infiltre directement dans les eaux souterraines pour les recharger.
50 Earthwise, British Geological Survey
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
128
128
Cependant, la recharge indirecte s'infiltrant à partir de flux fluviaux éphémères dans les oueds est une
source de recharge importante.
Les niveaux des eaux souterraines fluctuent naturellement selon les saisons, de nombreux puits peu
profonds s'asséchant pendant la saison sèche. Les sécheresses prolongées entraînent une baisse à plus
long terme du niveau des eaux souterraines.
Quantité d'eau souterraine : La surexploitation des eaux souterraines est un problème reconnu
dans différentes régions de Djibouti. Le niveau estimé de surexploitation en 2005 était de 15 millions
de m3/an (FAO AQUASTAT 2005). Les aquifères alluviaux des oueds utilisés de manière intensive
pour l'eau domestique, l'irrigation et l'approvisionnement du bétail sont souvent surexploités.
Qualité des eaux souterraines : La salinité est élevée. En 2005, plus de la moitié des forages de
Djibouti ont été enregistrés comme présentant une salinité supérieure à 900mg/l et parfois jusqu'à
1200mg/l. À cette époque, seules les eaux souterraines du nord-ouest du pays présentaient des
niveaux ioniques inférieurs aux normes d'utilisation pour l'irrigation. Les niveaux élevés de bore sont
les plus courants (FAO AQUASTAT 2005). Lorsque les eaux souterraines sont utilisées pour
l'agriculture, les taux élevés d'évapotranspiration et les retours d'irrigation minéralisés ont contribué
à l'augmentation de la salinité dans les aquifères alluviaux peu profonds et dans les roches
volcaniques plus profondes (Ahmed et al 2018). L'urbanisation rapide et le manque d'installations
sanitaires adéquates ont contribué à la dégradation de la qualité des eaux souterraines (Ahmed et al
2017). La concentration en nitrates est élevée dans de nombreuses régions, tant dans les aquifères
alluviaux que volcaniques. La plupart du temps, elle est naturelle, reflétant les contrôles évaporatifs
et biochimiques dans les zones arides, mais une partie de ce problème peut être due à la
contamination locale par le bétail ou les déchets humains (Awaleh et al 2017).
Eaux de surface : Djibouti n'a pas de rivières pérennes. Le système hydrographique est divisé en
deux zones, l'une se drainant vers la mer Rouge ou le golfe d'Aden, l'autre vers les plaines
occidentales du pays. Les précipitations sont faibles et irrégulières et se présentent généralement
sous forme de fortes tempêtes entraînant des inondations. Des rivières éphémères coulent après les
précipitations. Il existe deux importants lacs hypersalins qui sont les points de convergence des
bassins de drainage internes, le lac Assal au centre de Djibouti et le lac Abbeh au sud-ouest, à la
frontière avec l'Éthiopie.
Eaux de surface dans la zone du projet :
Les oueds : La zone du projet comprend des oueds, qui sont des lits de rivière asséchés de
façon permanente ou intermittente et qui ne contiennent de l'eau que lorsque de fortes
pluies se produisent.
Les zones humides temporaires du Grand et du Petit Bara : Le Grand Bara et le Petit Bara
sont les restes de lits de lacs asséchés répartis dans la région d'Ali Sabieh, la région d'Arta
et la région de Dikhil. Ils forment de vastes plaines arides au centre de Djibouti et marquent
la délimitation de la partie volcanique du pays par rapport à la partie sédimentaire. L'argile
dont elles sont formées est mal drainée et l'eau s'y accumule à la saison des pluies, ce qui
entraîne la croissance des herbes.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
129
129
Photo 10 : Grand Bara en période de fortes précipitations
Source : visite de terrain en avril 2020
Les zones humides permanentes de Hanlé et Galafi : Les plaines de Hanlé et de Galafi présentent une
grande dépression alluviale avec un maquis d'acacias étendu, des oueds peu profonds et de vastes zones
sablonneuses avec des collines basses dispersées, bordées de montagnes aux flancs abrupts. La région
abrite une eau douce permanente qui retient une végétation plus dense, comme des palmiers et des
parcelles de marais.
Figure 52 : Répartition des ressources en eaux souterraines et eau de surface à Djibouti
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
130
130
130
6.3 Etude de base de l’environnement biologique
L'environnement biologique de la zone d'étude du projet a été évalué à l'aide des informations scientifiques
disponibles et des données enregistrées lors des enquêtes de terrain au cours desquelles les types d'habitat
du site du projet, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les espèces de flore
rencontrées ont été identifiés et enregistrés.
6.3.1 Habitats naturels
La zone d’étude correspond à un corridor de 1km de large le long du tracé de la ligne électrique et abrite
plusieurs habitats naturels répartis entre la plaine côtière à l’ouest et la frontière éthiopienne de la manière
suivante :
Steppe arbustive de Rhigozum somalense (superficie de 3,1 km2)
Steppe arborée d’Acacia mellifera (superficie de 46,8 km2)
Steppe herbeuse (superficie de 91,4 km2)
Steppe arborée d’Acacia tortilis (superficie de 20,5 km2)
Dépressions inondables (superficie de 9,5 km2)
Zones subdésertiques ou sans végétation (superficie de 17,7 km2)
Les trois habitats naturels de steppe herbeuse, steppe arborée d’Acacia mellifera et steppe arborée d’Acacia
tortilis représentent plus de 84% de la zone d’étude du projet. Les steppes sont des formations végétales
constituées d’un tapis végétal discontinu d'herbacées vivaces entre lesquelles se développent des annuelles
durant les périodes pluvieuses avec une strate ligneuse souvent clairsemée.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
131
131
131
Carte 10 : Carte des principaux habitats naturels traversés par la zone d'étude
La steppe herbeuse occupe 48% de la zone d’étude. Ce type de steppe est une formation végétale
dominée par les espèces herbacées, dépourvue en général de strate ligneuse avec un couvert très faible. Le
plus souvent, on la rencontre sur les plateaux de moyenne altitude, sur les collines, et tout particulièrement
dans les plaines et les dépressions. La diversité floristique de cette formation varie en fonction de la
pluviométrie et du degré de dégradation des terres.
Les steppes arborées d’Acacia mellifera et d’Acacia tortilis occupent respectivement 25% et 11% de la
zone d’étude. La strate ligneuse de cette formation est composée d'arbres de plus de 4 mètres de hauteur
ou présentant un tronc unique d'au moins un mètre de hauteur. Le couvert ligneux varie de 5 à 20%, dans
certains cas il peut atteindre 60%. La strate basse est constituée par un tapis végétal discontinu d'herbacées
vivaces entre lesquelles végètent diverses annuelles durant les périodes de pluies.
La steppe arbustive de Rhigozum somalense occupe seulement 2% de la zone d’étude. La strate
ligneuse de cette formation est constituée d'arbustes d'un à quatre mètres de hauteur qui se ramifient en
général près de la base. Le couvert ligneux de cette formation varie de 1 à 20%. Très souvent la strate
ligneuse est accompagnée d'une strate buissonnante. Le tapis herbacé est réduit, en période sèche, à
quelques chaméphytes suffrutescents et à des buissons généralement broutés. Les taux de couverture sont
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
132
132
132
variables. En période de pluie, la steppe se couvre d'une grande diversité floristique, des annuelles surtout
éphémères. Elle constitue une zone de pâturage assez médiocre.
6.3.2 Flore
Les principales formations steppiques de la zone d’étude sont caractérisées par les arbres Acacia mellifera
et Acacia tortilis et l’arbustre Rhigozum somalense qui sont présentés ci-dessous.
L’Acacia mellifera est un arbre dense très épineux communs à Djibouti pouvant atteindre parfois 6 à 9 m de
haut. Il est répandu dans la brousse sèche, les plaines épineuses et les prairies boisées. C’est une espèce
d’arbre fixatrice d'azote à racines peu profondes et ses feuilles riches en protéines fournissent un broutage
utile. Cet arbre est apprécié comme bois de feu et aussi pour fabriquer du charbon de bois, son bois étant
dur. Les tiges deviennent rarement plus épaisses que le bras d'un être humain, mais elles sont appréciées
pour fabriquer des poteaux de clôture et des poignées de hache et de pioche. Dans son aire de répartition
naturelle, il est également utilisé pour les clôtures vivantes et donne une gomme comestible. Il fleurit
abondamment et est une plante précieuse pour les abeilles, son épithète spécifique mellifera faisant
référence à la production de miel.
Photo 11 : Acacia mellifera
L’Acacia tortilis est un arbre pouvant atteindre 8 à 10 m à port étalé en parasol. C’est une espèce très
fréquente à Djibouti. On le rencontre dans les oueds en mélange avec Acacia asak et, au niveau des
plaines, des plateaux et des collines, en association avec Acacia mellifera. Cette espèce présente un intérêt
fourrager, ses feuilles et ses fruits étant recherchés de tous les herbivores domestiques et en particulier des
chèvres et des dromadaires. Les fruits se développent une fois par an. Pour descendre ces fruits, qu'ils
récoltent sur un tissu en vue de les stocker pour la période de disette, les pasteurs utilisent une sorte de
bâton long de sept à huit mètres en forme d’hameçon, en exerçant une forte pression sur le bâton vers le
bas. Parfois les bergers frappent l’arbre ce qui entraîne la destruction des branches.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
133
133
133
Photo 12 : Acacia tortilis
Le Rhigozum somalense est un arbuste de la famille des Bignoniaceae atteignant 2 à 3 m de hauteur. Il est
abondant à Djibouti sur les collines, les plateaux et dans les oueds le long de la côte. Le Rhigozum
somalense occupe souvent l’étage inférieur à la steppe arborée d’Acacia mellifera. Le Rhigozum constitue
une espèce qui s’adapte à la sécheresse, reverdit à la moindre pluie et fournit par ses feuilles et ses fruits un
fourrage apprécié des caprins et des ovins. La plante est donc exposée à un surpâturage extensif d’où une
régression de l’espèce lorsque la densité animale d’élevage est élevée. Le Rhigozum somalense fait partie
de la souche d’endémisme Somalie-Masai et peut à ce titre être considéré comme une espèce endémique
régionale de Djibouti et de la Somalie. Ces espèces endémiques régionales devraient faire l'objet d'une
attention particulière par les acteurs de la conservation et les Autorités de Djibouti.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
134
134
134
Photo 13 : Rhigozum somalense
A part les arbres et arbustes dominants des formations de steppes (Acacia mellifera, Acacia tortilis et
Rhigozum somalense) occupant la zone d’étude, les observations de terrain ont pu confirmer la présence
des espèces végétales suivantes dans la zone d’étude :
Aizoon Canariense
Balanites rotundifoli
Calotropis procera
Hyphaene thebaica
Prosopis Chilensis
Senna Alexandrina
Solanum Somalense
Aristolochia bracteolala
Anticharis Glandulosa
Cymbopogon schoenanthus
Aerva javanica
Cas du Prosopis chilensis:
La plaine de Djibouti fait partie des zones les plus affectées par le Prosopis qui a envahi de nombreuses
régions du pays. Originaire d’Amérique (de l’Argentine jusqu’au sud des Etats-Unis), le Prosopis compte 40
espèces différentes. A la suite à son introduction en Afrique et dans d’autres régions du monde (dans le
cadre de projets de lutte contre la désertification au cours des années 1990), plusieurs espèces sont
devenues envahissantes dans les zones subtropicales et à Djibouti en particulier. Les espèces
majoritairement présentes dans la zone d’étude sont Prosopis chilensis et Prosopis juliflora. Ces espèces
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
135
135
135
ont été introduites à l’origine avec plusieurs objectifs : augmenter les sources d’énergie (charbon de bois),
stabiliser les sols afin de lutter contre l’érosion et accroître les ressources fourragères disponibles pour
l’élevage (la gousse des prosopis pouvant constituer une source d’alimentation complémentaire pour le
bétail).
Il s’est avéré rapidement que les espèces de Prosopis devenues envahissantes (notamment grâce à leur
forte capacité de résistance à la sécheresse et de développement de racines plus profondes que la flore
originale locale) ont provoqué des conséquences graves sur l’environnement : réduction de la diversité
biologique végétale et animale à l’endroit de son implantation, formation de forêts impénétrables limitant la
libre circulation des troupeaux, captation des eaux de long des cours d’eau. La plante produit, en grande
quantité, des gousses qui se dispersent rapidement par le biais des écoulements (lors des crues des oueds
notamment) et surtout par le biais des animaux se déplaçant sur une plus grande échelle (domestiques et
sauvages), et dont le passage des gousses par l’appareil digestif accélère leur capacité de germination.
Photo 14 : Prosopis Chilensis
6.3.3 Faune
La majeure partie de la flore et de la faune signalée dans la zone du projet est typique des zones
désertiques et semi-désertiques.
6.3.3.1 Mammifères
La diversité des mammifères sauvages dans l'ensemble de la zone d'étude est faible en raison de la
dégradation des habitats naturels due principalement à la désertification, au surpâturage des animaux
domestiques et aux conséquences du changement climatique.
Les mammifères sauvages existant actuellement dans la zone sont : le dik-dik de Beira Salt (Madoqua
saltiana), la gazelle de Pelzeln (Gazella dorcas pelzelni), la gazelle de Soemmering (Nanger soemmerringii),
le gerenuk (Litocranius walleri), le singe (Cerceopithecus aethiops) ; la hyène (Crocuta crocuta) ; le
céphalophe (Sylvi Capra spp) ; le chat sauvage (Felis lybica - Lepus Sp) ; le loir (Graphinu parvus) ; et le
lièvre d'Abyssinie (Lepus habessinicus).
Le Grand Bara fait partie de l'écorégion éthiopienne des prairies et des arbustes xériques (la zone d'étude
passe à proximité directe du Grand Bara au sud). Les grands mammifères présents au Grand Barra
comprennent l'antilope de Beira (Dorcatragus megalotis), la gazelle dorcas (Gazella dorcas), la gazelle de
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
136
136
136
Soemmerring (Nanger soemmerringii), le dik-dik de Salt (Madoqua saltiana) et le gerenuk (Litocranius
walleri). La gerbille de Berbera (Gerbillus acticola) est endémique à cette région.
Des animaux domestiques tels que le dromadaire (Camelus dromedarius), les moutons et les chèvres ont
également été observés en train de paître le long de la route dans la zone d'étude.
Répartition des principales espèces de mammifères présentes dans la zone d'étude
- Beira : La répartition actuelle de la population de Beira est limitée à la région montagneuse au sud
d'Ali-Sabieh. En raison de la pression exercée par la coupe de bois et le pâturage, la densité et la
présence même de la population fluctuent. La population de Djibouti est continue avec celle de
l'Ethiopie dans la région d'Aysha. La zone protégée de Djalélo est également un biotope essentiel
pour l'antilope de Beira51.
Carte 11 : Distribution de beira
51 UNESCO, https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5964
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
137
137
137
- Le dik-dik de Salt : La répartition du dik-dik de Salt (Madoqua saltiana) est géographiquement très
large, mais limitée aux bords des oueds, aux lignes de drainage et aux vallées d'une part, et aux
massifs végétalisés d'autre part (Goda, Mabla). La population est certainement en déclin dans de
nombreuses zones qui sont surpâturées ou envahies de prosopis.
Carte 12 : Carte de répartition de l'antilope Dik Dik avec la localisation de la zone d'étude
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
138
138
138
- La gazelle de Pelzeln : La gazelle de Pelzeln (Gazella dorcas pelzelni) est très largement répandue
à Djibouti dans tous les habitats et à toutes les altitudes. Elle est régulièrement braconnée mais
sans réel impact sur l'ensemble de la population.
Carte 13 : Carte de répartition de la Gazelle Pelzeln avec la localisation de la zone d'étude
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
139
139
139
- La gazelle de Soemmering : La répartition de la gazelle de Soemmerring (Nanger soemmerringii)
doit encore être définie avec précision, en tenant compte de la mobilité des groupes. L'espèce
semble être en lent déclin dans certaines zones (Grand Bara et Petit Bara).
Carte 14 : Carte de répartition de la gazelle Soemmerring avec la localisation de la zone d'étude
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
140
140
140
- Le gerenuk: Le gerenuk (Litocranius walleri) est confiné à la partie sud de Djibouti. L'étendue nord-
ouest de son aire de répartition reste à confirmer. C'est l’espèce de gazelle la moins nombreuse et
elle semble en outre sensible aux perturbations répétées et surtout à la déforestation.
Carte 15 : Carte de repartition de la Gazelle Gerenuk avec la localisation de la zone d'étude
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
141
141
141
- Les prédateurs : Les données disponibles relatives à la répartition des mammifères prédateurs
confirment la présence dans la zone d’étude de hyènes (Crocuta crocuta), leopards (Panthera
pradus) et guépards (Acinonyx jubatus).
-
Carte 16 : Carte de répartition des mammifères prédateurs avec la localisation de la zone d'étude
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
142
142
142
- Le Sengi somalien (Elephantulus revoilii) : Le Sengi somalien a été redécouvert plus de 50
ans après son dernier enregistrement. Alors que cette espèce, également connue sous le
nom de musaraigne éléphant de Somalie, est historiquement documentée comme
endémique à la Somalie, les nouveaux enregistrements proviennent de Djibouti et
élargissent ainsi l'aire de répartition connue de l'espèce dans la Corne de l'Afrique. On a
émis l'hypothèse que le Sengi de Somalie est une espèce rupicole (pétrophilique) sur la
base des coordonnées de collection des spécimens historiques des musées qui se trouvent
généralement dans les écosystèmes montagneux du nord de la Somalie. A Djibouti, toutes
les preuves de la présence de Sengis somaliens proviennent d'habitats aux substrats
rocheux et à la végétation relativement clairsemée où le potentiel d'abri prédominant se
trouve parmi les rochers. Une caractérisation rupicole du Sengis somalien est valable, du
moins à Djibouti.
Carte 17 : Localités du Sengi somalien (musaraigne éléphant)
Source : Heritage et at,2020
6.3.3.2 Reptiles
Les espèces de reptiles présentes dans la zone d'étude comprennent Agama Spinosa, Hemidactys
flaviviridis, Acanthocerus annectans et Hemidactys yerburn. Acanthocerus annectans a été repéré lors de la
visite sur le terrain.
Deux reptiles endémiques sont également présents dans la zone d'étude près du Grand Bara :
Le gecko à feuilles d'Arnold (Hemidactylus arnoldi)
Le gecko des sables du nord (Tropiocolotes somalicus)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
143
143
143
6.3.3.3 Insectes
Les principales espèces d'insectes présentes dans la zone d'étude comprennent Colotis danae eupompe,
Colotis halimede, Iolaus tajoraca, Deudorix livia, Tarucus rosacea, Ypthima asterope, Spialia doris, des
criquets et des sauterelles.
6.3.3.4 Oiseaux
Malgré sa petite taille et le nombre très limité d'études ornithologiques, Djibouti est considéré comme un
hotspot international pour l'avifaune avec une liste impressionnante de 287 espèces d'oiseaux. La clé de
cette variété est la situation de Djibouti au point de rencontre entre la vallée du Rift africain, le point le plus
étroit le long de la mer Rouge (le détroit de Bab el Mandeb) et près de la péninsule arabique. Le pays abrite
donc un mélange intéressant d'espèces africaines et moyen-orientales et se trouve sur la principale voie de
migration paléoartique et africaine pour les oiseaux qui nichent en Europe de l'Est, en Russie et en Asie
occidentale et qui hivernent en Afrique orientale et australe (Club des oiseaux africains).
Les espèces de niveau trophique supérieur, telles que les grands prédateurs, jouent souvent un rôle clé
dans la formation des écosystèmes naturels. Par exemple, les oiseaux qui planent offrent d'importants
services écologiques, en particulier dans les paysages agricoles où ils contrôlent les populations de
ravageurs, tels que les rongeurs et les criquets, et éliminent les charognes. Au total, 37 espèces d'oiseaux
planeurs, principalement des rapaces, mais aussi des cigognes, des ibis et des pélicans, migrent à travers la
voie de migration Vallée du Rift / Mer Rouge dans l'un des plus grands spectacles de la nature. C'est la
deuxième voie de migration la plus importante au monde, avec plus de 1,5 million d'oiseaux de 37 espèces
qui migrent entre leurs aires de reproduction en Eurasie et leurs aires d'hivernage en Afrique chaque année.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
144
144
144
Carte 18 : Couloirs de migration d'oiseaux planneurs
La zone d’étude est située dans ce couloir de migration d’oiseaux et les zones importantes pour la
conservation des oiseaux (présentées ci-dessous) constitue des aires de repos importantes. La préservation
des habitats naturels et des zones humides (oueds) est donc importante pour la protection des espèces
d’oiseaux empruntant les couloirs de migration. Ces couloirs de migration sont principalement utilisés au
printemps et à l’automne lors des déplacements des aires de reproduction vers les zones d’hivernage.
Djibouti se trouve dans le biome Somali-Masaï et 17 des 129 espèces limitées à ce biome sont connues.
Des éléments de deux autres assemblages restreints au biome sont également présents, y compris 10 des
29 espèces qui sont restreintes au biome saharien et quatre des 16 qui sont restreintes au biome sahélien.
Le nombre de rapaces migrateurs qui passent régulièrement par Djibouti, traversant la mer Rouge depuis le
Yémen, est d'importance internationale (Magin). Le nombre de rapaces migrateurs qui passent
régulièrement par Djibouti, en traversant la mer Rouge depuis le Yémen, est d'importance internationale
(Magin). Plus de 246 000 individus de 28 espèces ont été dénombrés en octobre-novembre 1987, passant
au-dessus de la côte nord pendant une période de 38 jours, ce qui en fait l'un des plus importants goulets
d'étranglement de la migration en Afrique (Welch et Welch 1992). Les espèces les plus nombreuses étaient
Buteo buteo (98 339) et Aquila nipalensis (76 586, EN), le Circus macrourus (NT), Aquila clanga (VU), Aquila
heliaca (VU) et Falco naumanni (VU) étant également recensés. En plus des rapaces, on y a également
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
145
145
145
observé de plus petits nombres de Ciconia nigra, Grus grus et de nombreuses espèces de passereaux sur
le passage.
Parmi ces espèces, 12 sont listés dans les annexes de la convention sur les espèces migratrices sauvages
comme en danger ou dans un état de conservation défavorable et devant faire l’objet de mesures
particulières tels qu’un monitoring spécifique, des plans de gestion appropriés incluant la conservation de
leurs habitats. Ces 12 espèces sont indiquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous.
Les 37 espèces d’oiseaux planneurs migrateurs empruntant chaque année ce corridor international de
migration traversant la zone d’étude sont les suivants :
Noms communs Noms scientifiques Photos
Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla
Cigogne blanche Ciconia ciconia
Pelican blanc
Pelecanus onocrotalus*
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
146
146
146
Aigle des steppes
Aquila nipalensis*
Faucon concolor
Falco concolor
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Faucon sacre
Falco cherrug*
Faucon kobez
Falco vespertinus*
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
147
147
147
Milan royal
Milvus milvus
Faucon pelerin
Falco peregrinus
Busard pâle
Circus macrourus
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus*
Bondrée orientale
Pernis ptilorhyncus
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
148
148
148
Ibis chauve
Geronticus eremita*
Busard cendré
Circus pygargus
Buse féroce
Buteo rufinus
Epervier à pieds courts
Accipiter brevipes
Aigle pomarin
Clanga pomarina
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
149
149
149
Faucon cécerellette
Falco naumanni*
Faucon lanier
Falco biarmicus
Busard Saint-Martin
Circus cyaneus
Aigle criard
Clanga clanga*
Autour des palombes
Accipiter gentilis
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
150
150
150
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Epervier d’Europe
Accipiter nisus
Faucon hobereau
Falco subbuteo
Vautour fauve
Gyps fulvus
Grue cendrée
Grus grus*
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
151
151
151
Buse variable
Buteo buteo
Faucon d’Eleonore
Falco eleonorae
Vautour percronptère
Neophron percnopterus*
Aigle impérial
Aquila heliacal*
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
152
152
152
Aigle botté
Hieraaetus pennatus
Cigogne noire
Ciconia nigra*
Milan noir
Milvus migrans
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
153
153
153
Etant donné l’importance internationale de ce couloir de migration d’oiseaux planneurs, l’ONG Birdlife
International en collaboration avec le PNUD et le GEF ont rassemblé toutes les informations scientifiques
disponibles au sein d’un outil de planification de la sensibilité écologique spécifique pour les oiseaux
planneurs migrateurs52 dont les résultats clés sont présentés dans les cartes ci-dessous:
Carte 10: Carte de sensibilité écologique pour les oiseaux planneurs migrateurs avec la localisation de la zone d'étude
52 http://migratorysoaringbirds.undp.birdlife.org/en/sensitivity-map#gsc.tab=0
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
154
154
154
Carte 11: Zoom de la carte de sensibilité écologique des oiseaux planneurs avec la localisation de la zone d'étude
Ces deux cartes conçues grâce à l’outil de cartographie de sensibilité écologique relative aux oiseaux
planneurs migrateurs permet de voir que la zone d’étude est :
Localisée à proximité d’un site important pour les oiseaux migrateurs comme l’Aire Importante pour
les Oiseaux (IBA) de « Ali Sabieh Assamo » ;
Localisée à proximité de deux aires protégées terrestres importantes pour la biodiversité dont
l’avifaune migratrice : Djalelo et Assamo ;
Traversée par de nombreux vols d’oiseaux planneurs migrateurs qui ont été suivis par satellite ;
notamment entre Djalelo et Dikhil et à proximité de Yoboki.
La carte ci-dessous extraite de l’outil de cartographie de la sensibilité pour les oiseaux migrateurs planneurs
permet de bien visualiser la densité de vols d’oiseaux migrateurs (trait en pointillé noir) dans et autour de
l’Aire Importante pour les Oiseaux (IBA) de « Ali Sabieh Assamo ». Etant donné que les oiseaux volent à
l’intérieur, autour et en direction de cette IBA, la partie de la zone d’étude localisée au nord de l’Aire
Importante pour les Oiseaux (IBA) de « Ali Sabieh Assamo » est particulièrement sensible étant donné le
danger qu’une ligne électrique de haute tension peut représenter pour l’avifaune en question.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
155
155
155
Carte 12: Carte extraite de l'outil de cartographie de la sensibilité pour les oiseaux planneurs migrateurs, développé par
Birdlife International en collaboration avec le PNUD et le GEF
La zone importante pour les oiseaux - ZICO de " Ali Sabieh Assamo " est située à environ 120 km de la
capitale de Djibouti et à 10 km du couloir de la ligne de transmission. Il s'agit d'une zone limitrophe de
l'Ethiopie et de la Somalie, composée de basses collines et de montagnes de moyenne altitude. Elle est
traversée par des oueds et comporte de grandes zones d'acacias clairsemés, des arbustes mixtes et
quelques petits jardins développés dans les oueds plus larges où la nappe phréatique est accessible. En
raison de sa situation géographique à la frontière avec l'Éthiopie et la Somalie, la diversité des espèces
d'oiseaux sur ce site montre un mélange qui diffère des autres ZICO de Djibouti. Les oueds avec des
arbustes d'acacia abritent le Crombec du Nord Sylvietta brachyura, la Fauvette arabe Sylvia leucomelaena,
le Robin des Bois Cercotrichas podobe, le Batis orientalis à tête grise, Trachyphonus margaritatus à poitrine
jaune et Barbican à gorge noire Tricholaema melanocephala, Eperlan à cou jaune Francolinus leucoscepus,
et Pie-grièche écorcheur Rhodophoneus cruentus. Les oueds avec des plaques de Tamarix abritent des
espèces d'engoulevents (peut-être européens et nubiens). Les jardins abritent un grand nombre de Bulbul
de Somalie Pycnonotus barbatus somaliensis, Tisserin de Rüppell Ploceus galbula, Souris à nuque bleue
Urocolius macrourus, Martin-pêcheur à tête grise Halcyon leucocephala, Buphagus erythrorhynchus, Estrilda
rhodopyga, Pytilia melba, Cinnyris habessinicus, C.variable venustus et l'étourneau sansonnet Creatophora
cinerea. C'est la seule zone de Djibouti où le cimeterre abyssin Rhinopomastus minor, le Souimanga à dos
violet Anthreptes orientalis et l'Autour chanteur Melierax poliopterus ont été observés. En outre, la zone
abrite deux espèces de mammifères menacées au niveau mondial : Le léopard Panthera pardus et l'antilope
Beira Dorcatragus megalotis. La présence d'espèces à biomasse limitée à Ali Sabeih est :
A02 - Biome Sahara-Sindiens : Ammomanes deserti, Cercomela melanura
A03 - Biome du Sahel : Trachyphonus margaritatus
A08 - Biome Somali-Masai : Melierax poliopterus, Francolinus leucoscepus, Neotis heuglinii,
Rhinopomastus minor, Tricholaema melanocephala, Lanius somalicus, Rhodophoneus cruentus,
Anthreptes orientalis, Ploceus galbula
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
156
156
156
Comme présenté sur la carte ci-dessous, la zone d’étude traverse deux potentielles zones importantes pour
la conservation des oiseaux à Djibouti (ZICO):
Hanlé Gamarre
Ougoul Kabah Kabah
Carte 13: Carte des Zones importantes pour la conservation des oiseaux de Djibouti avec la localisation de la zone
d'étude
Les plaines de Hanlé et de Gamarre présentent une grande dépression alluviale avec un maquis d'acacias
étendu, des oueds peu profonds et de vastes zones sablonneuses avec des collines basses dispersées,
bordées de montagnes aux flancs abrupts. La région abrite une eau douce permanente qui retient une
végétation plus dense, comme des palmiers et des parcelles de marais. Il y a une petite population
d'autruches Struthio camelus qui se reproduit et les zones d'eau douce abritent un petit nombre d'oiseaux
aquatiques nicheurs tels que le Vanneau à éperons Vanellus spinosus, le Pluvier à trois bandes Charadrius
tricollaris, la Marouette noire Amaurornis avirostra et l'Oie d'Égypte Alopochen aegyptiaca. Le Cormoran des
roseaux Phalacrocorax africanus, le Martin-pêcheur malachite Alcedo cristata et le Coucal à sourcils blancs
Centropus superciliosus ont tous été trouvés ici - les seuls signalements connus à Djibouti.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
157
157
157
Parmi les oiseaux observés lors de la visite sur le terrain dans la zone d'étude, on trouve la tourterelle à
collier (Streptopelia roseogrisea), le tétras à ventre marron (Pterocles exustus), la tourterelle de Namaqua
(Oena capensis) et le tisserand de Rüppell (Ploceus galbula).
Les données et informations disponibles sur les espèces de faune et de flore présentes dans la zone d’étude
ont permis d’identifier les espèces pouvant objectivement être considérées comme menacées en se basant
sur le statut de conservation défini par la Liste Rouge de l’UICN.
6.3.3.5 Espèces menacées
Selon les informations à ce jour disponibles, pour ce qui concerne la flore :
Aucune espèce végétale de la zone d’étude n’est considérée comme menacée d’extinction,
espèces végétales de la zone d’étude sont considérée comme représentant une préoccupation
mineure.
Espèces végétales Statut Liste Rouge UICN
Acacia mellifera Préoccupation mineure
Acacia tortilis Préoccupation mineure
Rhigozum somalense Préoccupation mineure
Aizoon Canariense
Balanites rotundifoli
Calotropis procera
Hyphaene thebaica Préoccupation mineure
Prosopis Chilensis Préoccupation mineure
Senna Alexandrina Préoccupation mineure
Solanum Somalense
Aristolochia bracteolala
Anticharis Glandulosa
Cymbopogon schoenanthus
Aerva javanica
Selon les informations à ce jour disponibles, pour ce qui concerne la faune:
4 espèces animales de la zone d’étude sont considérée comme en danger d’extinction ; il s’agit des
quatre espèces d’oiseaux suivantes :
Aigle des Steppes Aquila nipalensis
Faucon sacre Falco cherrug
Ibis chauve Geronticus eremita
Vautour perconptère Neophron percnopterus
10 espèces animales de la zone d’étude sont considérée comme vulnérable ;
5 espèces animales de la zone d’étude sont considérée comme quasi menacée ;
73 espèces animales de la zone d’étude sont considérée comme représentant une préoccupation
mineure.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
158
158
158
Espèces animales Statut Liste Rouge UICN
Mammifères
Madoqua saltiana Préoccupation mineure
Gazella dorcas Vulnérable
Nanger soemmerringii Vulnérable
Litocranius walleri Quasi menacé
Cereopithecus aethiops Préoccupation mineure
Crocuta crocuta Préoccupation mineure
Sylvi Capra
Felis lybica
Graphinu parvus
Lepus habessinicus Préoccupation mineure
Dorcatragus megalotis Vulnérable
Gerbillus acticola Données insuffisantes
Panthera pradus Vulnérable
Acinonyx jubatus Vulnérable
Elephantulus revoilii Données insuffisantes
Reptiles
Agama Spinosa Préoccupation mineure
Hemidactys flaviviridis
Acanthocerus annectans
Hemidactys yerburn
Hemidactylus arnoldi Données insuffisantes
Tropiocolotes somalicus
Insectes
Colotis danae eupompe
Colotis halimede
Iolaus tajoraca
Deudorix livia
Tarucus rosacea
Ypthima asterope Préoccupation mineure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
159
159
159
Spialia doris
Oiseaux
Buteo buteo Préoccupation mineure
Aquila nipalensis En danger
Circus macrourus Quasi menacé
Aquila clanga Vulnérable
Aquila heliaca Vulnérable
Falco naumanni Préoccupation mineure
Ciconia nigra Préoccupation mineure
Grus grus Préoccupation mineure
Haliaeetus albicilla Préoccupation mineure
Ciconia ciconia Préoccupation mineure
Pelecanus onocrotalus Préoccupation mineure
Circus aeruginosus Préoccupation mineure
Falco concolor Vulnérable
Circaetus gallicus Préoccupation mineure
Falco cherrug En danger
Falco vespertinus Quasi menacé
Milvus milvus Quasi menacé
Falco peregrinus Préoccupation mineure
Circus macrourus Quasi menacé
Pandion haliaetus Préoccupation mineure
Pernis ptilorhyncus Préoccupation mineure
Geronticus eremita En danger
Circus pygargus Préoccupation mineure
Buteo rufinus Préoccupation mineure
Accipiter brevipes Préoccupation mineure
Clanga pomarina Préoccupation mineure
Falco naumanni Préoccupation mineure
Falco biarmicus Préoccupation mineure
Circus cyaneus Préoccupation mineure
Clanga clanga Vulnérable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
160
160
160
Accipiter gentilis Préoccupation mineure
Pernis apivorus Préoccupation mineure
Accipiter nisus Préoccupation mineure
Falco subbuteo Préoccupation mineure
Gyps fulvus Préoccupation mineure
Falco eleonorae Préoccupation mineure
Neophron percnopterus En danger
Aquila heliaca Vulnérable
Falco tinnunculus Préoccupation mineure
Hieraaetus pennatus Préoccupation mineure
Milvus migrans Préoccupation mineure
Sylvietta brachyura Préoccupation mineure
Sylvia leucomelaena Préoccupation mineure
Cercotrichas podobe Préoccupation mineure
Batis orientalis Préoccupation mineure
Trachyphonus margaritatus Préoccupation mineure
Tricholaema melanocephala Préoccupation mineure
Francolinus leucoscepus Préoccupation mineure
Rhodophoneus cruentus Préoccupation mineure
Pycnonotus barbatus Préoccupation mineure
Ploceus galbula Préoccupation mineure
Urocolius macrourus Préoccupation mineure
Halcyon leucocephala Préoccupation mineure
Buphagus erythrorhynchus
Estrilda rhodopyga Préoccupation mineure
Pytilia melba Préoccupation mineure
Cinnyris habessinicus Préoccupation mineure
Creatophora cinerea Préoccupation mineure
Rhinopomastus minor Préoccupation mineure
Anthreptes orientalis Préoccupation mineure
Ammomanes deserti Préoccupation mineure
Cercomela melanura Préoccupation mineure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
161
161
161
Trachyphonus margaritatus Préoccupation mineure
Melierax poliopterus Préoccupation mineure
Neotis heuglinii Préoccupation mineure
Rhinopomastus minor Préoccupation mineure
Tricholaema melanocephala Préoccupation mineure
Lanius somalicus Préoccupation mineure
Rhodophoneus cruentus Préoccupation mineure
Anthreptes orientalis Préoccupation mineure
Ploceus galbula Préoccupation mineure
Struthio camelus Préoccupation mineure
Vanellus spinosus Préoccupation mineure
Charadrius tricollaris Préoccupation mineure
Alopochen aegyptiaca Préoccupation mineure
Phalacrocorax africanu Préoccupation mineure
Alcedo cristata
Centropus superciliosus Préoccupation mineure
Streptopelia roseogrisea Préoccupation mineure
Pterocles exustus Préoccupation mineure
Oena capensis Préoccupation mineure
Ploceus galbula Préoccupation mineure
6.3.3.6 Zones protégées situées dans et autour de la zone d'étude
Zones protégées dans la zone d'influence directe et indirecte :
Djibouti a adopté une stratégie et des plans d'action nationaux pour la biodiversité en 2000. Le NBSAP de
Djibouti est largement compatible avec les objectifs du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et
ses cibles Aichi. Le NBSAP poursuit également de manière significative la création de zones protégées et
des activités plus ciblées en matière de régénération et/ou de protection au sein des pépinières ou des
périmètres agropastoraux. Il existe actuellement 7 zones nationales protégées (4 terrestres, 3 marines) à
Djibouti, comme le montre la carte ci-dessous.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
162
162
162
Carte 14: Réseau national d'aires protégées avec la localisation de la zone d'étude
La zone d'étude est située à proximité de deux zones protégées : Djalelo et Assamo.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
163
163
163
Zone protégée de Djalélo
La ligne de transport d'électricité proposée évite la zone protégée de Djalélo (comme le montre la carte ci-
dessous).
Carte 15: Carte de l'aire protégée de Djalélo montrant que le projet de ligne électrique l’évite au sud-est
La zone protégée de Djalélo est située dans la région d'Arta, à 40 km de la capitale Djibouti. Elle couvre une
superficie d'environ 45 km² et abrite la gazelle de Waller aussi appelée Gerenuk, (Litocranius walleri) ou
encore "gazelle girafe", une espèce endémique. C'est une espèce d'antilope qui possède de longues et fines
pattes et un cou élancé, ce qui lui vaut son surnom. La particularité de cette espèce d'antilope est aussi sa
capacité à se tenir à une grande hauteur. La gazelle de Waller ne consomme pas d'herbes, mais se nourrit
de feuilles d'acacia, de pousses, de bourgeons, de fruits et de fleurs. Cette gazelle vit surtout dans la région
de l'Afrique de l'Est (Djibouti, Ethiopie, Somalie et Kenya).
La zone protégée de Djalélo est un biotope essentiel pour la gazelle de Waller mais aussi pour d'autres
espèces menacées comme l'antilope de Beira, la gazelle de Soemmering, la gazelle de Pelzeln et le dik-dik
de Salt53.
53 UNESCO, https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5964
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
164
164
164
L'aire protégée du Djalélo a été officiellement créée par un décret national de la Présidence de la
République de Djibouti en 201154. Ce statut juridique vise à limiter la destruction de l'habitat naturel des
espèces endémiques, à préserver leur espace de vie et à permettre aux espèces de se multiplier à l'abri des
effets des activités humaines perturbatrices (chasse, déforestation, affaiblissement de la biodiversité
environnante.
D'après la Norme Environnementale et Sociale nº6 de la BM intitulée "Préservation de la biodiversité et
gestion durable des ressources naturelles biologiques", il est prévu dans les cas où des projets affecte des
Zones protégées juridiquement et reconnues à l’échelle internationale comme étant riches en biodiversité,
comme c'est le cas de l'aire protégée de Djalelo, les aspects suivants :
Lorsque le projet est mis en œuvre à l’intérieur d’une zone protégée juridiquement, dont le
classement en zone protégée est en cours, ou qui est reconnue comme telle à l’échelle régionale ou
internationale, ou est susceptible d’affecter négativement une telle zone, l’Emprunteur veillera à ce
que toutes les activités entreprises soient compatibles avec le statut juridique de la zone protégée et
les objectifs d’aménagement de celle-ci. L’Emprunteur déterminera et évaluera également les effets
néfastes potentiels du projet et appliquera le principe de hiérarchie d’atténuation de manière à éviter
ou à atténuer ceux qui pourraient compromettre l’intégrité, nuire aux objectifs de conservation ou
réduire l’importance de la biodiversité d’une telle zone.
L’Emprunteur :
Démontrera que les aménagements prévus dans ces zones sont permis en vertu de la loi ;
Se conformera à tout plan d’aménagement agréé par les pouvoirs publics pour de telles zones ;
Consultera les maîtres d’œuvre et les responsables de la zone protégée, les parties touchées par le
projet, y compris les peuples autochtones, et les autres parties concernées, sur la formulation de
plans concernant le projet proposé, sa conception, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, et
les associera à ces activités, le cas échéant ; et
Mettra en œuvre d’autres programmes, au besoin, en vue de promouvoir et renforcer les objectifs de
préservation de la biodiversité et la bonne gestion de cette zone."
La NES 6 de la BM n'implique donc pas nécessairement d'éviter que un projet soit développé dans une aire
protégée. Toutefois, considérant le contexte de Djibouti et étant donné le nombre extrêmement réduit d'aires
protégées terrestres au niveau national (seulement deux aires protégées terrestres officielles: Djalélo et
Assamo), la faible proportion du territoire national couverte par des aires protégées (seulement 1,57 % du
territoire national pour Djibouti ce qui est très inférieur aux objectifs de 17% de l’Objectif 11 d’Aichi de la
Convention Internationale sur la Diversité Biologique) et le fait que le tracé du projet n'affecte que le coin
sud-est de l'aire protégée, il serait souhaitable que le tracé soit légèrement décalé vers le sud-est pour
contourner et éviter de traverser l'aire protégée de Djalelo.
Zone protégée d'Assamo
La zone protégée d'Assamo est située à 12 km au sud-est de la zone d'étude. Ce site naturel comprend une
région légèrement boisée et vallonnée dans le sud-est du pays, à proximité de la frontière avec l'Éthiopie. La
majeure partie du site est à végétation clairsemée avec des Acacia de faible hauteur (4-5 m) et une
54 Décret N° 2011-0236/PR/MHUE portant création de deux aires protégées terrestres
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
165
165
165
couverture herbacée saisonnière ; la végétation est plus dense dans les nombreux petits oueds, avec parfois
de grands Ficus. Il y a des établissements à Ali Addé et Assâmo, avec de petits jardins cultivés dans l'oued
à Assâmo. L'ensemble du site est utilisé pour le pâturage du bétail ; la population humaine a été fortement
augmentée ces dernières années par plusieurs milliers de réfugiés de Somalie. Parmi les mammifères, on
trouve des traces de Dorcatragus megalotis (VU) à deux endroits du site, tandis que Papio hamadryas
(LR/nt), Litocranius walleri (LR/cd) et l'arbre Dracaena ombet (EN) sont également présents (Magin).
L'aire protégée d'Assamo a été officiellement créée par un décret national de la Présidence de la République
de Djibouti en 201155. Ce statut juridique vise à limiter la destruction de l'habitat naturel des espèces
endémiques, à préserver leur espace de vie et à permettre aux espèces de se multiplier à l'abri des effets
des activités humaines perturbatrices (chasse, déforestation, affaiblissement de la biodiversité environnante.
Initiative Internationale de la Grande Muraille Verte
La carte ci-dessous montre que la zone d’étude du projet est localisée à l’intérieur de la zone prévue pour la
mise en œuvre de la composante nationale de la Grande Muraille Verte56.
Carte 16: Carte de localisation de la composante nationale de Grande Muraille Verte avec la localisation de la zone
d'étude
55 Décret N° 2011-0236/PR/MHUE portant création de deux aires protégées terrestres
56 http://grandemurailleverte.org/
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
166
166
166
En 2011, le Gouvernement de la République de Djibouti, à travers le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme,
de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MHUEAT) a élaboré une stratégie de mise en œuvre
de la composante nationale de la grande muraille verte (GMV) avec l’appui du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Forum Forestier Africain (AFF).
Le tracé de la GMV en République de Djibouti parcourt une distance de 209 km et couvre une superficie
totale estimée à 342826 ha. La stratégie entend assurer une plus grande maîtrise des eaux de surface et
souterraines, pour le développement de la couverture végétale, les techniques de petite irrigation, et la
gestion rationnelle des ressources naturelles. Sur la base d’une démarche participative, le plan d’action de
mise en œuvre de cette stratégie permettra :
la réalisation de plusieurs ouvrages de mobilisation des eaux (retenues, seuils, micro-barrages)
permettant l’irrigation de nouvelles superficies,
des actions d’agroforesterie, d’amélioration des pâturages et de récupération de terres dégradées et
de reboisement,
la création dans les plaines de périmètres agrosylvopastoraux irrigués à partir des eaux
souterraines,
la réalisation de nouveaux puits pastoraux, la construction de parcs de vaccination, l’aménagement
des oueds, le balisage de couloirs pour le bétail,
la construction de pistes d’accès, de boutiques d’intrants et de puits villageois,
l’électrification des villages ruraux et des campements en énergie solaire,
l’appui conseil, la vulgarisation, et la formation au profit des exploitants agricoles.
La mise en œuvre du projet de ligne électrique à haute tension devra prendre en compte cette initiative
internationale de la Grande Muraille Verte étant donné le chevauchement de la localisation des deux projets.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
167
167
167
6.4 Evaluation des impacts potentiels
6.5 Evaluation des impacts sociaux et justification de leur importance
6.5.1 Impact 1- Amélioration de l’approvisionnement en électricité
Un système de transport d'électricité fiable est essentiel à la poursuite du développement économique du
pays. Le projet de construction de la ligne entre Nagad et Galafi et d’extension du poste de Nagad permettra
d’accroître la fiabilité de l'approvisionnement en électricité de Djibouti et contribuera ainsi au développement
économique à long terme du pays. Cet impact ne se produira qu’une fois que la ligne sera mise en
fonctionnement, c’est à dire lors de la phase d’opération.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 1 est évalué comme positif et ayant une
sévérité forte pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne- L’intensité est évaluée comme moyenne car ce projet permettra d’améliorer la
fiabilité de l’approvisionnement en électricité du réseau actuel.
Étendue régionale- L’étendue est évaluée comme régionale car le projet prévoit d’améliorer
l’approvisionnement en électricité de l’ensemble des abonnés à Djibouti, ville composée d’une
grande partie de la population nationale. Cependant il n’est pas prévu d’augmenter la couverture du
réseau qui ne couvre qu’une portion limitée de la population vivant dans la zone du projet : seules
quatre localités (Holhol, Ali Sabieh, Mouloud et Dikhil) ont accès au réseau dans leur centre-ville.
Durée longue- L’impact devrait être ressenti de façon continue durant toute la durée d’opération de
la ligne et du poste qui sera de 40 ans.
Probabilité d'occurrence élevée- Cet impact est directement lié à l’atteinte de l’objectif du projet. Si
le projet devait voir le jour, cet impact aurait donc une probabilité très élevée de se réaliser.
Sensibilité moyenne- L’électricité est perçue comme un service essentiel par la population de la
zone du projet. Cependant il n’est pas prévu de proposer des tarifs bonifiés pour les tranches de la
population les plus défavorisés. La population ayant des difficultés pour payer la facture d’électricité
ou n’ayant pas la capacité financière de s’abonner ne ressentira donc pas l’amélioration de
l’approvisionnement en électricité.
6.5.2 Impact 2- Création d'emplois directs et indirects liés au projet
Comme décrit dans la description du projet, lors de la phase de construction de 24 mois, le projet prévoit
d’employer 70 à 100 travailleurs au niveau de la construction du poste de Nagad et 250 à 400 travailleurs au
niveau de la construction de la ligne de transmission. Des prestataires et sous-traitants seront également
sollicités créant des emplois indirects liés au projet. D’autre part, les employés directs et indirects du chantier
consommeront des biens et services ce qui devrait conduire à des emplois induits, en particulier en
restauration57. En général on peut considérer qu'un emploi dans le BTP crée un autre emploi indirect ou
57 Les définitions des emplois directs, indirects et induits sont les suivantes :
Emplois directs : Ce sont, par exemple pour la phase travaux, les emplois créés ou confortés par les entreprises impliquées
dans le chantier.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
168
168
168
induit dans le reste de l'économie58. Cependant dans le cas de ce projet il faut s’attendre à moins du fait que
les travaux sur une telle ligne de transport d’énergie se réalisent majoritairement sur les sites de stockage
des équipements et sur une emprise linéaire limitant les retombées économiques locales. De plus ces
retombées seront d’autant moindres que dans le cas particulier de Djibouti, 80% de la population est
concentrée dans la ville.
Lors de la phase d’opération d’environ 40 ans, le nombre de travailleurs directs devrait être de l’ordre de
quatorze. Six personnes se chargeront des visites, inspections et réparations de la ligne et huit se
chargeront de l’opération et surveillance du poste de Nagad. Il ne devrait pratiquement pas avoir besoin de
sous-traiter des activités d’opération, limitant fortement les emplois indirects et induits durant cette phase.
On peut donc estimer que la création d'emplois liée au projet sera :
pendant la phase de construction (24 mois) : entre 320 et 500 emplois directs et entre 320 et 500
emplois indirects et induits dans le reste de l'économie pour un total de 640 à 1.000 emplois liés au
projet au maximum
pendant la phase d'opération (40 ans) : 14 emplois directs et un nombre surement inférieur
d’emplois indirects et induits pour un total d’emplois liés au projet restant sous la vingtaine.
Les personnes les plus susceptibles de bénéficier des possibilités d'emploi direct et indirect sont celles qui
ont suivi une formation dans des domaines techniques et professionnels en relation avec le BTP ou le
secteur électrique : ce seront donc surement, pour la plupart, des personnes venant de Djibouti-ville ou
même de l’étranger. Lors des groupes de discussion, les populations locales (hommes et femmes) ont
formulé leur intérêt pour avoir un emploi pendant les travaux. La zone d’influence du projet montre un taux
d’inactivité bien supérieur aux données nationales avec 68% de la population active sans aucune activité
génératrice de revenus et la création d’emplois est donc un point crucial pour la région. Cependant les
niveaux d’éducation sont faibles (taux d’analphabétisme de 58% dans la région d’Ali Sabieh, de 74% dans la
région de Dikhil et de 70% dans la région d’Arta) et l’emploi destiné aux populations de la zone d’influence
du projet sera surement fortement limité. Les activités destinées à la main-d’œuvre non spécialisée devraient
se limiter au défrichage, au transport de matériel, au gardiennage des équipements et au fonctionnement
des campements (nettoyage, lavage du linge, restauration). En se référant à des projets antérieurs mis en
place par l’EDD, on peut estimer à 15% la part d’employé locaux dans la main d’œuvre.
En ce qui concerne les emplois induits pendant la phase de construction, il est probable que les populations
se trouvant dans les villes proches de la ligne puissent en bénéficier (population de la zone d’influence
sociale du projet), en particulier les femmes. Ainsi les restauratrices et les commerçantes auront
l’opportunité de vendre leurs produits aux travailleurs du projet et les femmes de ménage, cuisinières et
lavandières pourraient être employées dans les camps de travailleurs. Les enquêtes Insuco permettent
d’estimer le nombre de restauratrices et commerçantes dans la zone d’influence du projet :
Emplois indirects : Ce sont les emplois créés ou confortés destinés à réaliser les commandes de l'activité créée (ex :
fourniture de béton ou de sable pour les ouvrages). Il s’agit de sous-traitants et fournisseurs.
Emplois induits : Ce sont les emplois créés ou confortés par la demande en consommation des salariés comptés dans les
emplois directs et indirects. (ex : restauration, hôtellerie, commerce en général)
58 « Étude relative aux emplois directs et indirects du BTP, des transports et de la filière environnement ». Étude réalisée par le BIPE
pour le MEDAD (SG/ DAEI/BASP) - décembre 2007
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
169
169
169
Nombre de restauratrices : le pourcentage de personnes de 15 ans et plus étant des femmes
restauratrices est de 5% à Holhol et de 9% à Yoboki. En extrapolant avec les données de population
sédentaire, on peut considérer que la région d’Ali Sabieh devrait avoir autour de 500 restauratrices
et la région de Dikhil devrait avoir autour de 1.200 restauratrices.
Nombre de commerçantes : le pourcentage de personnes de 15 ans et plus étant des femmes
commerçantes est de 1% à Holhol et de 3% à Yoboki. En extrapolant avec les données de
population sédentaire, on peut considérer que la région d’Ali Sabieh devrait avoir autour de 130
commerçantes et la région de Dikhil devrait avoir autour de 480 commerçantes.
Lors des groupes de discussion, les femmes restauratrices et commerçantes ont formulé leur intérêt à
pouvoir vendre leurs produits aux travailleurs des chantiers. Cependant deux aspects pourraient limiter ces
effets positifs du projet sur l’économie locale :
Il faut rappeler que les ressources alimentaires sont rares dans la zone d’influence. En effet, comme
décrit dans la ligne de base sociale, les taux d’insécurité alimentaire sont de 24% à Ali Sabieh, 33%
à Arta et de 42% à Dikhil (avec un maximum de 74%dans la sous-préfecture de Yoboki). Toutes les
femmes restauratrices et commerçantes n’auront donc pas la capacité de profiter des impacts
positifs du projet.
Une augmentation significative de la demande de biens et de services due à l'afflux de main-
d'œuvre peut entraîner une hausse des prix locaux et/ou un évincement des consommateurs de la
communauté. Ainsi l’augmentation de la demande pourrait conduire les restauratrices et
commerçantes à augmenter les prix de vente et précariser les consommateurs locaux.
Il est donc probable que la création d’emploi soit ressentie au niveau des emplois directs et indirects mais
que les retombées sur la population locale en termes d’emplois induits soient limitées.
L’impact 2 est évalué comme positif et ayant une sévérité mineure durant la phase de construction et durant
la phase d’opération pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne- L’intensité est évaluée comme moyenne car si ce projet produira un
changement majeur pour les personnes employées en leur permettant d’augmenter leurs revenus, la
durée de ces emplois sera limitée dans le temps (travaux prévus sur deux ans). Ceci est tout de
même important car Djibouti présente un sous-emploi de la population.
Étendue ponctuelle pendant la construction et l’opération- Lors de la phase de construction, le
nombre d’emplois créés en lien avec le projet sera significatif mais il s’agira principalement de
travailleurs venant de Djibouti-ville ou de l’étranger. Les retombées sur la population locale seront
faibles et on peut considérer que cet impact ne devrait toucher qu’une portion limitée de la zone
d’étude et de sa population. Lors de la phase d’opération, les besoins en main d’œuvre seront
beaucoup plus limités, et l’étendue est également considérée comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction et d’opération de la ligne et du
poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée comme moyenne et la durée de
la phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence moyenne- Le nombre d’emplois directs créés sera très probablement
similaire aux projections de l’EDD pour que la construction puisse se réaliser correctement.
Cependant les emplois indirects et induits dépendront, d’une part de la demande (conditions de vie
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
170
170
170
des travailleurs et possibilité qu’ils se rendent dans les villes proches pour utiliser les services
existants) et, d’autre part de l’offre (capacité des restauratrices et commerçantes de capter cette
nouvelle clientèle).
Sensibilité faible- Les populations locales rencontrées ont certes montré un grand intérêt à
travailler dans le chantier de construction ou à faire du commerce avec les travailleurs migrants.
Cependant, la population locale montre des niveaux d’éducation faible limitant son employabilité
dans le chantier et des niveaux d’insécurité alimentaire élevés limitant sa capacité à fournir des
services de restauration aux travailleurs des campements.
6.5.3 Impact 3- Restriction des usages dans le corridor du projet
Les lignes de transmission comportent une zone de sécurité de chaque côté des conducteurs où les usages
sont restreints. Dans le cas du présent projet, il a été défini une zone d’emprise du projet de 40 mètres de
large et 190 km de long avec des usages restreints qui sont les suivants :
Il ne pourra y avoir aucun logement ou habitation occupée. Si des personnes vivaient actuellement
dans la zone d’emprise, elles devraient être compensées, expropriées et se déplacer - c'est ce qu'on
appelle un "déplacement physique" ou une "réinstallation".
Seuls les arbres mesurant moins de 4 mètres de hauteur pourront être maintenus. Si des arbres
devaient mesurer plus de 4 mètres de hauteur, ils devraient être coupés ou élagués et leur perte
devrait être compensée à leurs usagers et ayants-droits.
Il sera possible de pratiquer l'agriculture et l’élevage. S’il y avait des parcelles agricoles, des points
d’eau, des enclos à bétail ou des zones de pâturage dans la zone d’emprise, la population pourrait
continuer à les utiliser normalement.
Il sera possible de continuer à se rendre sur les sites d’héritage culturel. La population pourra, en
particulier, continuer à se rendre sur les tombes se trouvant dans la zone d’emprise du projet.
Il sera possible de traverser librement la zone. Le projet ne devrait donc pas perturber les habitudes
de la population nomade et des migrants qui sont des collectifs identifiés comme vulnérables dans
l’étude de base sociale et qui traversent en de nombreux points la zone d’emprise du projet.
La zone d’emprise du projet où seront appliquées ces restrictions d’usage correspondra au corridor de la
ligne de transmission de 190 km de long et 40 mètres de large partant du poste de Nagad, contournant
Holhol, Da’Asboyo, Dikhil et Yoboki et arrivant jusqu'à Galafi à la frontière éthiopienne59. Ce corridor sera
inclus dans la zone d’étude de l’emprise de 100 mètres de large.
Il est important de souligner que l’impact 3 ne comprend pas les pertes temporaires de terres évaluées dans
l’impact 4 ni les pertes permanentes de terres évaluées dans l’impact 5 de l’EIES.
L’étude d’occupation des sols de la zone d’étude de l’emprise du projet qui est présentée dans l’étude de
base sociale et dont le processus de réalisation est précisé dans la section méthodologique de l’EIES
permet de conclure les points suivants sur l’impact 3 :
59 La zone d’emprise du poste de Nagad est traitée dans l’impact 5 car il est considéré de manière conservatrice que la totalité de la
parcelle sera utilisée de manière permanente par le projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
171
171
171
Aucun logement fixe ne se trouve dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Afin d’éviter de
perturber la population locale, le tracé a justement été modifié pour éviter tout logement. En ce qui
concerne les logements nomades de type buul, la photo-interprétation et les visites de terrain ont
permis de détecter deux daybokals d’un même campement dans la zone d’étude de l’emprise du
projet entre AP28 et AP29. Cependant les nomades se déplacent constamment en fonction des
pluies et ces campements ne sont donc plus nécessairement au même endroit actuellement. Il faut
souligner que cette mobilité rend plus aisée le fait qu’aucun logement de ce type ne s’installe durant
la phase d’opération.
Aucune parcelle agricole ne se trouve dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Certes, il existe
des jardins d’arbres fruitiers et de cultures maraichères dans la zone d’influence sociale (au niveau
d’Ali Sabieh ou Mouloud par exemple) mais aucun ne se trouve dans la zone d’étude de l’emprise.
Cependant, si, dans le futur, la population souhaitait implanter des jardins dans la zone d’emprise du
projet, cela ne poserait pas de problèmes car l’agriculture y est autorisée.
47 d’enclos en pierre ont été identifiés dans la zone d’étude, certains paraissant être à l’abandon et
d’autres étant utilisés périodiquement pour parquer le bétail. Il est prévu de permettre aux éleveurs
de continuer leurs activités d’élevage dans la zone d’emprise. Ces enclos seront donc toujours
utilisables durant la phase de construction et d’opération.
Selon une première estimation réalisée dans le cadre de cette EIES, 517 tombes se trouvent dans la
zone d’étude de l’emprise du projet, ce qui correspond à environ 2,7 tombes par km de tracé de
ligne. Il s’agit de tombes avec un enclos de pierre circulaire qui peuvent être isolées ou groupées
pour former des cimetières. Dans la zone de restriction d’usage, il est prévu de maintenir les tombes
existantes en l’état et de permettre à la population de se rendre sur les tombes lorsqu’elle le
souhaite. Il sera également possible d’enterrer de nouvelles personnes.
Photo 15 : Exemple de tombes en pierre
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 3 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant la phase de construction et négligeable durant la phase d’opération pour les
raisons suivantes :
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
172
172
172
Intensité moyenne pendant la phase de construction et faible durant la phase d’opération-
L’intensité est évaluée comme faible durant la phase d’opération car les restrictions proposées ne
devraient pas altérer l’usage actuel des terres impactées. En effet comme présenté précédemment,
les éléments se trouvant dans la zone d’étude de l’emprise sont des tombes, des enclos et des
arbres ligneux de faible taille. Or la population pourra toujours parquer les animaux dans la zone
d’emprise ou se rendre sur les tombes si elle le souhaite. Pendant la phase de construction, les
activités de câblage pourraient endommager les enclos et les tombes, si le constructeur ne prend
pas de mesures de protection. Dans ce cas des pierres pourraient être déplacées, ce qui doit être
considéré comme une intensité moyenne, en particulier dans le cas de la détérioration d’une tombe.
Étendue locale pendant la phase de construction et ponctuelle durant la phase d’opération-
Bien que la superficie subissant des restrictions soit importante, il s’agit d’une zone inhabitée et les
restrictions d’usage ne devraient pas affecter la population durant la phase d’opération. On peut
s’attendre à ce que la construction se fasse relativement rapidement à chaque point du corridor
puisque le chantier avancera sur l’ensemble de l’emprise linéaire en courtes interventions
ponctuelles mais les travaux pouvant nécessiter des allers-retours aux points de construction et
pouvant aussi prendre du retard, il est préférable de considérer l’impact durant toute la phase de
construction. Ainsi Durant la phase de construction, en l’absence de mesures d’atténuation, les
restrictions d’usage pourraient affecter une partie de la population qui utilisent les 47 enclos
identifiés ou souhaitent se rendent sur les 517 tombes identifiées.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- Même si la construction
devrait avoir lieu de manière ponctuelle le long du corridor, il est plus prudent de considérer que
l’impact devrait être ressenti de façon continue durant toute la durée de construction (2 ans) de la
ligne. Les interventions d’entretien et de maintenance sur la ligne pendant la phase d’opération
seront cependant ponctuelles.
Probabilité d'occurrence élevée- Cet impact est une mesure nécessaire de sécurité dans un projet
avec ces caractéristiques. Si le projet devait voir le jour, cet impact aurait donc une probabilité
élevée de se réaliser.
Sensibilité moyenne pendant la phase de construction et faible pendant la phase d’opération-
Deux collectifs vulnérables (les migrants et nomades) utilisent la zone d’emprise du projet,
cependant les restrictions d’usage proposées ne modifieront pas leurs comportements actuels : ils
pourront continuer à traverser la zone d’emprise tout au long du projet. D’autre part, les populations
locales rencontrées ont considéré qu’une part importante des enclos n’étaient plus utilisés du fait de
la sédentarisation des nomades et qu’ils ne se rendaient qu’occasionnellement sur les tombes (une
fois par an pour réaliser des invocations). Ainsi les biens pouvant être endommagés lors des
mesures de câblage ne font l’objet que de peu d’attention de la part des populations. Cependant
sachant que sans mesure d’atténuation, ce sont des tombes qui pourraient être endommagées, il
semble préférable de proposer une sensibilité moyenne du récepteur pendant la construction.
6.5.4 Impact 4- Perte temporaire de terres destinées aux campements de
travailleurs, aux aires de stockage et aux routes d’accès
Comme détaillé dans la description du projet, lors de la phase de construction, l’entreprise contractante aura
besoin d’aménager des routes d’accès, des campements de travailleurs et des zones de stockage des
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
173
173
173
matériaux de construction. Ces espaces ne seront utilisées que temporairement et seront ensuite restitués
en fin de construction. L’entreprise contractante devra également proposer un plan de fermeture des
campements pour s’assurer que les espaces sont restitués dans l’état initial et que la perte de ces espaces
n’est que temporaire.
A ce stade du projet, il n’est pas possible de savoir avec exactitude où se situeront ces différents éléments,
mais ils seront dans la zone d’étude de l’emprise de la ligne de transmission (corridor de 100 mètres de
largeur et de 190 km de longueur). Or d’après l’étude d’occupation des sols, aucun logement fixe ni parcelle
agricole ne se trouvent dans cette zone donc les pertes temporaires n’affecteront aucun logement ni culture
ou plantation fruitière. En revanche il est possible que des enclos, des arbres ligneux spontanés et des
tombes puissent être affectés. Si cela devait avoir lieu, la première mesure serait d’éviter de détruire ces
biens en les contournant ou protégeant et, si cela n’est pas possible, de compenser les pertes économiques
et/ou culturelles60, conséquences de la perte de ces biens.
Selon les groupes de discussion conduits lors de l’élaboration de l’EIES, beaucoup d’enclos de la zone du
projet sont aujourd’hui abandonnés et il n’y aurait pas de problème pour les déplacer ou les détruire, tant
que la communauté est compensée et incluse dans le projet. En ce qui concerne les tombes, autour de 275
tombes ont été recensées en zone Issa dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Or la population Issa
rencontrée a considéré qu’il n’y aurait pas de problème pour déplacer les tombes, tant que la famille de la
personne enterrée est compensée et que les autorités coutumières (appelées okals) participent au
processus. En revanche, la population Afar a considéré que les tombes ne devaient pas être déplacées car
la religion et la tradition ne permettent pas de déplacer les os de leurs ancêtres. Or, autour de 240 tombes
ont été détectées en zone Afar dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Il sera donc impératif d’éviter ces
tombes lors de l’identification des zones d’acquisition temporaire.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 4 ne se produira que durant la phase de
construction. Il est évalué comme négatif et ayant une sévérité faible pour les raisons suivantes :
Intensité faible- L’intensité est évaluée comme moyenne car la zone d’emprise du projet est une
zone désertique avec peu d’arbres ou de structures existantes (enclos ou tombes). Même en
absence de mesures d’atténuation, l’entreprise contractante ne devrait donc endommager que peu
de biens (arbres, enclos, tombes) lorsqu’il implantera les espaces de stockage, les campements de
travailleurs ou les routes d’accès.
Étendue ponctuelle- L’étendue est évaluée comme ponctuelle car les surfaces souffrant de cet
impact sont réduites.
Durée moyenne- Les travailleurs se déplaceront le long de la ligne au fur et à mesure que la
construction avancera : ils ne devraient donc pas être présents à un même point durant toute la
construction. Cependant il est préférable de considérer de manière conservatrice que l’impact
pourrait être ressenti durant toute la durée de construction.
Probabilité d'occurrence élevée- Cet impact est une mesure nécessaire pour mettre en œuvre les
activités de construction. Si le projet devait voir le jour, cet impact aurait donc une probabilité très
élevée de se réaliser.
60 Les risques de détérioration des tombes font l’objet d’une analyse particulière dans l’impact 15 sur le risque de détérioration de sites
de patrimoine culturel et d’héritage culturel.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
174
174
174
Sensibilité forte- Il n’y aurait pas de problème pour déplacer ou détruire les enclos contre
compensation. Les tombes Issa pourraient également faire l’objet d’un déplacement contre
compensation. En revanche, les Afars ne souhaitent pas que leurs tombes soient déplacées. C’est
pourquoi il faut considérer que la sensibilité du récepteur est forte face aux potentiels effets de cet
impact.
6.5.5 Impact 5- Perte permanente de terres dans la zone d’emprise des pylônes,
du poste et des routes d’accès pour l’entretien
Des terrains devront être acquis de manière permanente pour implanter les pylônes de la ligne de
transmission, construire le poste de Nagad et faire passer les routes d’accès pour l’entretien de la ligne.
En ce qui concerne le poste de Nagad, l’EDD a reçu en 2015 un droit de concession provisoire de l’Etat pour
une parcelle urbaine non bâtie de 8 hectares (240 x 340 m)61 à Nagad, à environ 5 km de l'aéroport
international de Djibouti, à proximité d'une route goudronnée menant vers la frontière éthiopienne en
direction du sud-ouest. Il s’agit d’une terre vacante appartenant à la République de Djibouti sans aucun
usager identifié autre que l’EDD. Cet espace serait utilisé pour la construction du poste de Nagad. Sa
superficie est considérée comme suffisante pour le poste de 230 kV et les futures extensions.
En ce qui concerne la construction de la ligne, il est prévu d’installer 547 pylônes sur tout le tracé. Cela
demandera l’acquisition permanente de 68,74 hectares dans la zone d’étude de l’emprise du projet,
correspondant à une surface de 1256 m2 par pylône. Même si le tracé de la ligne est déjà connu, il n’est pas
possible à ce stade du projet de préciser les emplacements des pylônes, et les routes d’accès et donc de
connaître avec exactitude le besoin d’acquisition des terres pour la construction de la ligne. L’EDD est en
cours d’obtention d’une concession provisoire de l’Etat pour un corridor de 100 mètres de large et 190 km de
long dans lequel se trouvent les parcelles à acquérir. Cependant, ces terrains font également l’objet d’une
gestion et d’une mise en valeur coutumière répondant aux principes de la Confédération Issa entre Nagad et
Dikhil et répondant aux principes de la Confédération Debné entre Dikhil et Galafi. L’étude d’occupation des
sols nous permet d’affirmer qu’aucun logement fixe ni parcelle agricole ne se trouvent dans la zone d’étude
de l’emprise. Les acquisitions permanentes de terres n’engendreront donc pas de réinstallation physique ni
de pertes d’activité agricole. L’équipe de l’EIES qui s’est rendue sur le terrain a confirmé qu’il n’y a pas
d’occupation coutumière ou illégale et qu’aucun actif privé n’existe sur les terrains. En revanche il est
possible que des enclos, des arbres spontanés et des tombes puissent être affectés. Si cela devait avoir
lieu, la première mesure serait d’éviter de détruire ces biens en déplaçant légèrement les pylônes et, si cela
n’est pas possible, de compenser les pertes économiques et/ou culturelles62, conséquences de la perte de
ces biens. Comme expliqué dans l’impact précédent, il n’y aurait pas de problème pour déplacer ou détruire
des enclos qui sont souvent inutilisés, tant que la communauté est compensée et incluse dans le projet. La
population Issa n’a pas non plus de réticences pour le déplacement des tombes. En revanche, la population
Afar ne le souhaite pas. A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 5 n’aura pas
lieu durant la phase d’opération et peut être évalué de manière conservatrice comme négatif et ayant une
sévérité faible durant la phase de construction pour les raisons suivantes :
61 Titre foncier numéro 20149 inscrit le 3 décembre 2015
62 Les risques de détérioration des tombes font l’objet d’une analyse particulière dans l’impact 15 sur le risque de détérioration de sites
de patrimoine culturel et d’héritage culturel.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
175
175
175
Intensité faible- L’intensité est évaluée comme moyenne. Au niveau de Nagad, les terrains
appartiennent déjà à l’EDD à travers une concession63. Au niveau de la ligne de transmission
(pylônes et routes d’accès), l’EDD devra acquérir des terrains ayant une propriété coutumière
clanique. Cependant, les terrains à acquérir seront des terrains en zone désertique de surfaces
réduites et espacées de plusieurs centaines de mètres les uns des autres. Même en absence de
mesures d’atténuation, peu de terrains à acquérir devraient avoir un arbre, un enclos ou une tombe.
Étendue ponctuelle- L’étendue est évaluée comme ponctuelle car les surfaces souffrant de cet
impact sont réduites.
Durée moyenne- L’impact devrait être ressenti de façon continue durant toute la durée de
construction de la ligne et du poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée
comme moyenne.
Probabilité d'occurrence élevée- Cet impact est une mesure nécessaire pour mettre en œuvre les
activités de construction. Si le projet devait voir le jour, cet impact aurait donc une probabilité très
élevée de se réaliser.
Sensibilité moyenne- Il n’y aurait pas de problème pour déplacer ou détruire les enclos contre
compensation. Les tombes Issa pourraient également faire l’objet d’un déplacement contre
compensation. En revanche, les Afars ne souhaitent pas que leurs tombes soient déplacées.
Cependant il sera possible de modifier l’emplacement des pylônes pour éviter l’emplacement de ces
tombes d’autant plus que les tombes afars sont regroupés en cimetières plus facilement
identifiables. C’est pourquoi il faut considérer que la sensibilité du récepteur est moyenne face aux
potentiels effets de cet impact, à condition que les mesures de gestion soit correctement mise en
œuvre avec l’appui d’experts anthropologue et archéologue.
6.5.6 Impact 6- Tensions sociales dues à des comportements inappropriés de
travailleurs extérieurs
Lors de la phase de construction, le projet prévoit d’employer 70 à 100 travailleurs au niveau du poste de
Nagad et 250 à 400 travailleurs au niveau de la construction de la ligne. Le poste de Nagad est situé près de
l’aéroport mais dans une zone encore non urbanisée, aucune tensions sociales spécifiques ne sont donc à
prévoir. Il est prévu d’installer une ou deux base(s)-vie ainsi que des camps satellites entre lesquels les
travailleurs circuleront. Il est donc très peu probable que 400 travailleurs soient au même endroit au même
moment. Lors de la phase d’opération, le nombre de travailleurs devrait être de l’ordre de quatorze
personnes : six se chargeront des visites, inspections et réparations de la ligne et huit se chargeront de
l’opération et surveillance du poste de Nagad. Le comportement inapproprié de certains travailleurs
extérieurs à la région peut entraîner une rupture de la cohésion de la communauté locale, en particulier des
petites communautés. Cela peut se produire par un comportement inhabituel ou violent, comme par exemple
l’abus d’alcool ou des propos déplacés envers la population en raison de différences religieuses, culturelles
ou ethniques. Des tensions préexistantes au sein de la communauté locale peuvent être exacerbés par
l’arrivée de personnes externes et les conflits ethniques peuvent être aggravés si les travailleurs d'un groupe
s'installent sur le territoire de l'autre.
63 Le titre foncier de la parcelle de Nagad est présenté en annexe de l’EIES.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
176
176
176
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 6 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant la phase de construction et négligeable durant la phase d’opération pour les
raisons suivantes :
Intensité moyenne- L’intensité est évaluée comme moyenne car cet impact pourrait certes toucher
la population se trouvant dans la zone d’influence du projet mais ne devrait pas entrainer un
changement majeur pour les personnes touchées.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Lors de la phase de
construction, l’étendue est évaluée comme locale car cet impact ne devrait toucher qu’une portion
limitée de la zone d’étude et de sa population, celle se trouvant en relation directe avec les
travailleurs du chantier. Lors de la phase d’opération le nombre de travailleurs externes se rendant
sur site sera beaucoup plus limité et l’impact devrait être ressenti dans un espace réduit et
circonscrit et par un nombre peu élevé de personnes, c’est pourquoi l’étendue est alors considérée
comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et moyenne pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme
moyenne. En revanche, pendant la phase d’opération (40 ans), l’impact ne sera ressenti que de
manière ponctuelle lorsque les agents réaliseront des missions d’entretien et de supervision ce qui
devrait avoir lieu une ou deux fois par an. La durée est donc également considérée comme
moyenne durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des habitudes et comportements des travailleurs externes et de leur niveau
d’interaction avec les populations locales. Cependant le fait que le pourcentage de travailleurs
locaux sera restreint et que la population locale n’ait jamais été confrontée à des comportements
étrangers sont des facteurs de risque supplémentaires. La probabilité descendra lors de la phase
d’opération car les interactions avec les populations locales seront fortement réduites.
Sensibilité moyenne pendant la construction et faible pendant l’opération- Les populations
rencontrées n’ont pas montré de préoccupations autour de l’afflux de travailleurs. Les femmes ont
au contraire considéré que cela représentait une opportunité de commerce pour elles. Cependant
les populations rurales ne sont pas habituées à recevoir un afflux important d’étrangers (250 à 400
travailleurs pour la construction de la ligne alors que neuf des quatorze localités de la zone
d’influence du projet ont moins de 2.000 habitants). Certains de ces travailleurs pourraient avoir des
comportements inappropriés selon leurs coutumes et principes et les okals qui gèrent les conflits de
la vie courante selon les règles traditionnelles ne se verront peut-être pas reconnaitre leur légitimité
par des migrants relativement nombreux et venant de Djibouti-ville ou même de l’étranger. Pendant
la phase d’opération, le groupe de travailleurs sur la ligne sera réduit à six personnes en charge des
visites, inspections et réparations de la ligne : les mécanismes de gestion communautaire64 pourront
plus aisément absorber ce nombre d’étrangers.
64 On entend comme mécanisme de gestion communautaire les systèmes traditionnels de gestion des conflits impliquant
traditionnellement les okals (autorités coutumières) et, si besoin, les cadis (juges musulmans).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
177
177
177
6.5.7 Impact 7- Augmentation des violences basées sur le genre du fait de l’afflux
de travailleurs extérieurs
Les travailleurs des projets d'infrastructure sont majoritairement jeunes et masculins. Ceux qui arrivent sont
célibataires ou séparés de leur famille ou de leur conjoint, et se trouvent en dehors de leur sphère habituelle
de contrôle social. En outre, dans les zones rurales, la présence des forces de l'ordre est souvent faible et
elles peuvent ne pas être suffisamment équipées pour faire face à l'augmentation temporaire de la
population locale.
Cette situation peut conduire à un éventail de comportements inacceptables et/ou illicites de certains
travailleurs extérieurs à la région tels que le vol, les agressions physiques, la toxicomanie ou même des
violences basées sur le genre. Les VBG peuvent être des avances agressives non désirées, du harcèlement
sexuel envers des femmes et des filles et de la violence sexiste contre les femmes et les enfants. Le risque
de harcèlement sexuel est probablement plus élevé pour les femmes locales, en particulier pour les jeunes
femmes et les filles, mais il existe aussi pour les garçons. Un afflux important de main-d'œuvre masculine
peut également entraîner une augmentation des relations sexuelles d'exploitation65 et de la traite des êtres
humains, les femmes et les jeunes filles étant alors contraintes de se prostituer66.
Dans le cas du présent projet, le nombre de travailleurs sera fortement limité lors de la phase d’opération (de
l’ordre de quatorze personnes pour la totalité du projet). En revanche, le nombre de travailleurs sera plus
important lors de la phase de construction : il y aura entre 70 et 100 employés directs au niveau de Nagad et
entre 250 à 400 employés sur le chantier de construction de la ligne. Il s’agira d’un afflux de travailleurs
limité et concentré dans le temps puisque les travailleurs seront logés dans des campements qui se
déplaceront en fonction du progrès de la construction : ce ne sera donc pas toujours la même population qui
sera en contact avec les travailleurs du chantier.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 7 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité majeure durant la phase de construction et une sévérité mineure durant la phase d’opération
pour les raisons suivantes :
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car bien que cet impact ne devrait toucher qu’un
nombre limité de personnes, il produirait un changement majeur chez les survivants de violences
basées sur le genre.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Lors de la phase de
construction, l’étendue est évaluée comme locale car cet impact ne devrait toucher qu’une portion
limitée de la zone d’étude et de sa population, celle se trouvant en relation directe avec les
travailleurs du chantier. Lors de la phase d’opération, le nombre de travailleurs externes se rendant
sur site sera beaucoup plus limité et l’impact devrait être ressenti dans un espace réduit et
circonscrit et par un nombre peu élevé de personnes, c’est pourquoi l’étendue est alors considérée
comme ponctuelle.
65 L'exploitation sexuelle est définie comme tout abus ou tentative d'abus d'une situation de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou
de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de tirer un profit monétaire, social ou politique de l'exploitation
sexuelle d'une autre personne. Dans les opérations/projets financés par la Banque Mondiale, l'exploitation sexuelle se produit lorsque
l'accès à des biens, des travaux, des services financés par la Banque est utilisé pour en tirer un gain sexuel.
66 Managing the risks of adverse impacts on communities from temporary project induced labor influx. World Bank, 2016.
(http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
178
178
178
Durée moyenne pendant la construction et moyenne pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme
moyenne. En revanche, pendant la phase d’opération (40 ans), l’impact ne sera ressenti que de
manière ponctuelle lorsque les agents réaliseront des missions d’entretien et de supervision ce qui
devrait avoir lieu une ou deux fois par an. La durée est donc également considérée comme
moyenne durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en l’absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des habitudes et comportements des travailleurs externes et de leur niveau
d’interaction avec les populations locales. Cependant le fait que le pourcentage de travailleurs
locaux sera restreint à environ 15% des travailleurs totaux et que la population locale n’ait jamais été
confrontée à des comportements étrangers sont des facteurs de risque supplémentaires. La
probabilité descendra lors de la phase d’opération car les interactions avec les populations locales
seront fortement réduites.
Sensibilité forte pendant la construction et faible pendant l’opération - Comme expliqué dans
l’impact précédent, les populations rencontrées ont considéré que l’afflux de travailleurs représentait
une opportunité plus qu’une préoccupation. Cependant elles ne sont pas habituées aux interactions
avec des travailleurs extérieurs et elles n’évaluent pas nécessairement qu’elles peuvent manquer de
forces de l'ordre pour assurer leur sécurité face à des comportements illicites ou ne pas avoir accès
à des infrastructures sanitaires pour traiter les VBG. De plus les relations femmes-hommes montrent
de fortes inégalités avec une majorité de femmes qui suit un schéma de soumission face aux VBG
en acceptant et justifiant par exemple les violences conjugales67. S’agissant d’une problématique
délicate, la sensibilité est considérée comme forte durant la phase de construction. Pendant la
phase d’opération, le groupe de travailleurs sur la ligne sera réduit à six personnes : la police et
gendarmerie locale et les mécanismes de gestion communautaire pourront plus aisément absorber
ce nombre d’étrangers.
6.5.8 Impact 8- Augmentation de l'incidence des maladies transmissibles, en
particulier les maladies sexuellement transmissibles
Les risques sanitaires généralement associés aux projets de développement sont ceux liés aux mauvaises
conditions d'hygiène et de vie et aux infections à transmission vectorielle et à transmission sexuelle. Les
maladies transmissibles les plus préoccupantes pendant la phase de construction en raison de la mobilité de
la main-d'œuvre sont les maladies sexuellement transmissibles (MST), telles que le VIH/sida.
Ainsi, l'augmentation du nombre de travailleurs extérieurs se relationnant avec les populations rurales
pourrait mener à une augmentation du VIH/sida et/ou d'autres maladies transmissibles (comme le choléra)
au sein de la population locale.
A partir de l’information analysée durant l’EIES, l’impact 8 est évalué comme négatif et ayant une sévérité
majeure durant la phase de construction et la phase d’opération pour les raisons suivantes :
67 Voir la section sur les inégalités femmes-hommes et les résultats du PAPFAM de 2012.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
179
179
179
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car une personne porteuse de maladie
sexuellement transmissible (MST) ou du choléra est contaminée à vie et elle peut être handicapée
ou mourir des conséquences de la maladie transmise. Toutes les MST ne sont pas mortelles et
certaines peuvent être traitées mais l’accès au soin dans ces régions est limité.
Étendue ponctuelle- Même en absence de mesures d’atténuation, l’étendue est évaluée comme
ponctuelle car cet impact ne devrait être ressenti que dans un espace réduit et circonscrit et par une
très faible proportion de la population de la zone d’influence du projet que ce soit lors de la phase de
construction ou d’opération.
Durée moyenne pendant la construction et moyenne pendant l’opération- Le risque
d’augmentation de l’incidence des maladies transmissibles devrait être ressentie de façon continue
durant toute la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme moyenne. En revanche,
pendant la phase d’opération (40 ans), le risque d’augmentation de l’incidence des maladies
transmissibles ne sera ressenti que de manière ponctuelle lorsque les agents réaliseront des
missions d’entretien et de supervision ce qui devrait avoir lieu une ou deux fois par an. La durée est
donc également considérée comme moyenne durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération -
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des habitudes et comportements des travailleurs externes et de leur niveau
d’interaction avec les populations locales. La probabilité descendra lors de la phase d’opération car
les interactions avec les populations locales seront fortement réduites.
Sensibilité forte- Selon les données de ONUSIDA68, à Djibouti, la prévalence du VIH chez les
adultes âgés de 15 à 49 ans serait de 0,8 % avec une tendance à la baisse (1,6% en 2014).
Cependant, les connaissances sur les risques de transmission du SIDA sont limitées et les
campagnes d’information peu nombreuses dans la zone du projet, en particulier dans la région de
Dikhil. Certaines femmes rencontrées lors de l’élaboration de l’EIES avouent que le sujet est tabou
au sein de leur couple et pensent que la religion peut guérir de la maladie. La population locale
montre donc une forte vulnérabilité face aux risques de transmission de maladies transmissible, en
particulier des MST, du fait de son manque de connaissance et des inégalités femmes-hommes
dans la société. S’agissant d’une problématique délicate, la sensibilité est considérée comme forte.
6.5.9 Impact 9- Augmentation de l’incidence de la COVID-19
Dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19 et en envisageant le scénario le plus pessimiste
dans lequel la pandémie n’a pas été maitrisée, l’afflux de travailleurs peut conduire à une augmentation de
l’incidence du COVID-19 au sein de la population locale.
A partir de l’information analysée durant l’EIES, l’impact 9 est évalué comme négatif et ayant une sévérité
majeure durant la phase de construction et la phase d’opération pour les raisons suivantes :
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car une personne du COVID- 19 peut mourir
des complications de la maladie surtout dans les zones du projet où l’accès aux soins peut être
limité.
68 https://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/djibouti
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
180
180
180
Étendue ponctuelle- Même en absence de mesures d’atténuation, l’étendue est évaluée comme
ponctuelle car cet impact ne devrait être ressenti que dans un espace réduit et circonscrit et par une
très faible proportion de la population de la zone d’influence du projet que ce soit lors de la phase de
construction ou d’opération.
Durée moyenne pendant la construction et moyenne pendant l’opération- Le risque
d’augmentation de l’incidence de la COVID-19 devrait être ressentie de façon continue durant toute
la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme moyenne. En revanche, pendant la
phase d’opération (40 ans), le risque d’augmentation de l’incidence de la COVID-19 ne sera ressenti
que de manière ponctuelle lorsque les agents réaliseront des missions d’entretien et de supervision
ce qui devrait avoir lieu une ou deux fois par an. La durée est donc également considérée comme
moyenne durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération -
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact peut ne pas avoir lieu. Cela dépendra de la
situation nationale de propagation du virus ainsi que des habitudes sanitaires des travailleurs. La
probabilité descendra lors de la phase d’opération car le nombre de travailleurs ainsi que les
interactions avec les populations locales seront fortement réduites.
Sensibilité forte- A Djibouti, la circulation de la COVID-19 est encore limitée mais selon la date de
début des travaux, l’augmentation de la circulation de travailleurs venant de la ville et des contacts
avec les populations locales, une probabilité importante de propagation du virus est à anticiper.
6.5.10 Impact 10- Augmentation des risques d’accidents pour la population
locale
Les risques d’accidents pour la population pourraient être des types suivants :
Le trafic du projet pourrait interférer avec le trafic public normal et pourrait entraîner une
augmentation des accidents (avec des personnes ou des animaux).
L'accès non contrôlé ou mal contrôlé aux sites de travail pourrait exposer les populations à des
accidents, notamment dans les zones proches des excavations ou autour des équipements et des
véhicules lourds.
Les pylônes électriques présenteront des risques de chute et d'électrocution pour toute personne
grimpant dessus une fois qu'ils seront en place et sous tension. Il s'agit d'un risque particulièrement
important pour les jeunes enfants et les adolescents.
Des conducteurs électriques tombés à cause de vents violents ou d'une défaillance de la tour
pourraient également représenter un danger d’électrocution si une personne les touche.
Il faut cependant noter que les lignes de transmission ne sont pas nouvelles dans la zone puisqu'il existe
déjà une ligne parallèle à la ligne proposée.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 9 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant les phases de construction et d’opération pour les raisons suivantes :
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car toute personne subissant un des accidents
décrits précédemment pourrait être gravement blessé voire mourir des séquelles de l’accident.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
181
181
181
Étendue ponctuelle- Même en absence de mesures d’atténuation, l’étendue est évaluée comme
ponctuelle car cet impact ne devrait être ressenti que dans un espace réduit et circonscrit et par une
très faible proportion de la population de la zone d’influence du projet, que ce soit lors de la phase
de construction ou d’opération.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction et d’opération de la ligne et du
poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée comme moyenne et la durée de
la phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence faible- Même en l’absence de mesures d’atténuation, cet impact ne
devrait que rarement avoir lieu. Cela dépendra des habitudes et des comportements des populations
locales. Cet impact est également plus probable là où la ligne de transmission se trouve à proximité
des zones habitées.
Sensibilité moyenne- Les populations rencontrées ont parfois mentionné leurs préoccupations
autour des risques d’accident, en particulier les risque d’électrocution lors de l’opération de la ligne.
Elles considéraient que le risque existait principalement si la ligne passait aux abords de leurs
logements et leurs lieux de vie. Or le tracé de la ligne a justement été retravaillé pour s’éloigner des
localités.
6.5.11 Impact 11- Impacts des champs électromagnétiques sur la santé de la
population
Un champ électromagnétique (CEM) est émis par tout appareil électrique, y compris les lignes électriques.
En 1998, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) a
recommandé une limite d'exposition résidentielle aux CEM de 833 mG. Or les niveaux de CEM à 20 mètres
d'une ligne de transmission de 500 kV sont de 29,4 mG, diminuant à 12,6 mG à 30 mètres de la ligne69. Sur
la base de ces données, mêmes les résidents vivant à la limite de la zone d’emprise subiront des CEM plus
de soixante fois inférieurs aux niveaux limites préconisés par la CIPRNI.
Dans la zone d’emprise, il est possible de se demander si des expositions prolongées sur une longue
période pourraient entraîner certains risques. Cependant l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
conclu dans son rapport de juin 2007 sur les CEM et la santé (OMS, 2007) qu'aucun effet néfaste sur la
santé, y compris le cancer, n'a été signalé, même après une exposition à des niveaux élevés de champs
électriques et magnétiques. Dans l'ensemble, la recherche n'établit pas que l'exposition aux CEM cause ou
contribue à une quelconque maladie ou affection.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 10 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité mineure durant la phase d’opération pour les raisons suivantes :
Intensité faible- L’intensité est évaluée comme faible car dans l'ensemble, la recherche n'établit pas
que l'exposition aux CEM cause ou contribue à une quelconque maladie ou affection.
Étendue ponctuelle- Même en absence de mesures d’atténuation, l’étendue est évaluée comme
ponctuelle car cet impact ne devrait toucher qu’une très faible proportion de la population de la zone
69 Rapport de juin 2002 du National Institute of Environmental Health Sciences des États-Unis intitulé "EMF, Electric and Magnetic
Fields Associated with the Use of Electric Power"
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
182
182
182
d’influence du projet. En effet, aucune personne ne réside de manière permanente dans la zone
d’étude de l’emprise du projet.
Durée longue- L’impact ne sera pas ressenti pendant la phase de construction et devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée d’opération de la ligne et du poste. La durée de la
phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence élevée- Cet impact est une conséquence directe de la mise sous-tension
de la ligne. Si le projet devait voir le jour, cet impact aurait donc une probabilité très élevée de se
réaliser.
Sensibilité moyenne- Les populations rencontrées ont mentionné leur préoccupation autour des
risques que pourraient représenter les champs électromagnétiques. Elles considéraient que le
risque existait principalement si la ligne passait aux abords de leurs logements et leurs lieux de vie.
Or le tracé de la ligne a justement été retravaillé pour s’éloigner des localités.
6.5.12 Impact 12- Pression accrue sur les services de base du fait de l’afflux de
travailleurs
L'afflux de travailleurs peut générer une demande supplémentaire pour la fourniture de services publics, tels
que l'eau, l'électricité, les services médicaux, les transports, l'éducation et les services sociaux. Les
répercussions se feront d’autant plus ressentir dans les communautés rurales, isolées ou de petite taille. La
demande accrue de services communautaires par les travailleurs du projet venant de l'extérieur de la région
pourrait ainsi diminuer la disponibilité de ces services pour les populations locales.
Il faut cependant noter que les travailleurs seront probablement logés dans des camps disposant de leurs
propres services d’eau, d’assainissement et d’électricité. Une mesure à favoriser afin de limiter la pression
sur les ressources locales, notamment concernant les bonnes pratiques en matière d’assainissement.
Il faut en particulier noter que l’accès à l’eau potable représente actuellement une problématique importante
pour les populations locales. Dans la zone du projet, 34% des ménages considèrent que
l’approvisionnement est actuellement insuffisant (50% à Yoboki et 16% à Holhol) et 24% considèrent que les
points d’eau sont trop fréquentés (21% à Yoboki et 27% à Holhol). La surutilisation des points d’eau est donc
déjà actuellement une difficulté des populations.
D’autre part, les déchets domestiques et humains générés par les campements pour le personnel du projet
pourraient nuire à l'assainissement dans la région et pourraient polluer l'environnement s'il n'est pas bien
géré. La contamination de la nappe phréatique par le campement est en particulier un risque à prendre en
compte lors du choix de l’implantation du site.
Finalement, trois impacts liés au projet pourraient conduire à une charge supplémentaire pour les
ressources sanitaires locales. Il s’agit de l’augmentation des VBG, l’augmentation de l’incidence des
maladies contagieuses et l’augmentation des accidents. Pour faire face à ces impacts, les services de santé
devront soigner la population locale mais également certains travailleurs ne souhaitant se rendre dans
l'établissement médical du projet et voulant s'adresser à la place, de manière anonyme, aux prestataires
médicaux locaux.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 11 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant la phase de construction et une sévérité négligeable durant la phase
d’opération pour les raisons suivantes :
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
183
183
183
Intensité moyenne pendant la construction et faible pendant l’opération- Durant la phase de
construction, l’intensité est évaluée comme moyenne car cet impact pourrait certes toucher la
population se trouvant dans la zone d’influence du projet mais ne devrait pas entrainer un
changement majeur pour les personnes touchées qui devraient toujours pouvoir avoir accès aux
services de base mais avec probablement plus de difficultés. Durant la phase d’opération, seuls
quatorze employés de l’EDD réaliseront des missions périodiques sur le terrain. Leur présence ne
devrait pas perturber les services de base, même sans mesure d’atténuation.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Lors de la phase de
construction, l’étendue est évaluée comme locale car cet impact ne devrait toucher qu’une portion
limitée de la zone d’étude et de sa population, celle se trouvant en relation directe avec les zones de
campements. Lors de la phase d’opération le nombre de travailleurs externes se rendant sur site
sera beaucoup plus limité et pour des temps réduits. L’impact devrait être ressenti dans un espace
réduit et circonscrit et par un nombre peu élevé de personnes, c’est pourquoi l’étendue est alors
considérée comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et moyenne pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme
moyenne. En revanche, pendant la phase d’opération (40 ans), l’impact ne sera ressenti que de
manière ponctuelle lorsque les agents réaliseront des missions d’entretien et de supervision ce qui
devrait avoir lieu une ou deux fois par an. La durée est donc également considérée comme
moyenne durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des conditions d’aménagement des campements de travailleurs. La probabilité
descendra lors de la phase d’opération car les interactions avec les populations locales seront
fortement réduites.
Sensibilité moyenne- La population rencontrée n’a pas soulevé ce point durant les espaces de
consultation. Cependant l’étude de base sociale a montré que les services de base locaux sont
limités : l’approvisionnement en eau représente en particulier une vraie problématique pour les
populations de la zone du projet et certaines localités ont déjà des difficultés avec le débit de leurs
forages.
6.5.13 Impact 13- Risques de discrimination et de non-égalité des chances des
travailleurs
Le droit du travail djiboutien interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur le sexe, l'âge, la
race, la couleur, le milieu social, la nationalité ou l'ascendance nationale, la participation à un syndicat ou les
opinions politiques et religieuses ; et le code du travail interdit explicitement la discrimination fondée sur le
handicap au travail. En ce qui concerne la discrimination fondée sur la nationalité, la loi prévoit que les
travailleurs migrants étrangers qui obtiennent des permis de séjour et de travail bénéficient des mêmes
protections juridiques et des mêmes conditions de travail que les citoyens. En janvier 2017, l'Assemblée
Nationale a adopté une loi sur les réfugiés officialisant le droit au travail des réfugiés, et elle a adopté deux
décrets d'application de cette loi en décembre 2017. Cependant le risque demeure que les candidats et les
employés fassent l'objet d'une discrimination fondée sur des caractéristiques telles que la nationalité,
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
184
184
184
l'appartenance ethnique, la langue, le handicap, ou le sexe que ce soit lors du processus de recrutement ou
en raison de possibilités de carrière réduites.
Le projet emploiera entre 320 et 500 travailleurs durant la phase de construction et 14 personnes durant la
phase d’opération. Lors de la phase de construction, le projet devra donc mener un large processus de
recrutement qui pourrait créer des discriminations si la caractéristique spécifique de la personne devenait un
facteur de décision pour l'attribution d'un emploi.
Il est prévu que les emplois ciblent une majorité de personnes ayant suivi une formation dans des domaines
techniques et professionnels en relation avec le BTP ou le secteur électrique. Comme le niveau moyen
d’éducation des populations de la zone du projet est faible, il est probable que les recrutements locaux
soient limités et que la majorité des personnes recrutées viennent de Djibouti-ville ou même de l’étranger. Il
restera des activités destinées à de la main-d’œuvre non spécialisée pour le défrichage, le transport de
matériel, le gardiennage des équipements et le fonctionnement des campements (nettoyage, restauration),
pour lesquelles il sera essentiel de ne pas discriminer la population locale voir de mettre en œuvre une
véritable politique de recrutement local.
La discrimination des femmes sera également particulièrement critique du fait que les normes culturelles
djiboutiennes limitent les opportunités de formation des femmes, que la construction et l’énergie sont des
secteurs traditionnellement masculins et que les femmes qui réussissent à trouver un emploi dans des
domaines techniques risquent d’être victimes sur leur lieu de travail de discrimination, voire de harcèlement
sexuel70 ou d’abus sexuel71. La discrimination des femmes sur le lieu de travail peut être lié au non-octroi
d'un congé de maternité et de pauses d'allaitement72 mais également à cause de l’absence de toilettes et de
douches suffisantes, adaptées et séparées entre les hommes et les femmes.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 12 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité majeure durant la phase de construction et une sévérité modérée durant la phase d’opération
pour les raisons suivantes :
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car si une personne était touchée par cet
impact, cela signifierait qu'elle pourrait ne pas accéder à un poste à l’EDD en raison de son genre,
sa race, sa nationalité, sa religion ou son handicap. Cela doit être considérée comme un
changement majeur pour les personnes touchées en les empêchant d’augmenter leurs revenus.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Les personnes
potentiellement concernées sont celles qui participent au processus de recrutement de l’EDD. Lors
de la phase de construction, l’étendue est évaluée comme locale car le nombre d’emplois crées en
lien avec le projet sera significatif même s’il s’agira principalement de travailleurs venant de Djibouti-
ville ou de l’étranger et que les retombées sur la population locale risquent d’être faibles. Lors de la
70 Le harcèlement sexuel est défini comme des avances sexuelles malvenues, des demandes de faveurs sexuelles et tout autre
comportement verbal ou physique de nature sexuelle de la part du personnel du contractant avec le personnel d'autres contractants ou
de l'employeur.
71 L'abus sexuel est défini comme l'intrusion physique de nature sexuelle, réelle ou menacée, que ce soit par la force ou dans des
conditions inégales ou coercitives.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
185
185
185
phase d’opération les besoins en main d’œuvre seront beaucoup plus limités, c’est pourquoi
l’étendue est alors considérée comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction et d’opération de la ligne et du
poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée comme moyenne et la durée de
la phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des politiques de gestion des ressources humaines de l’EDD. La probabilité
descendra lors de la phase d’opération car le nombre de recrutements sera très limité.
Sensibilité forte en phase de construction et moyenne en phase d’opération- Les inégalités
femmes-hommes sont importantes dans la société djiboutienne et les femmes sont vulnérables à
des risques de discrimination et ce d’autant plus que la construction et l’énergie sont des secteurs
traditionnellement masculins. Lors de la phase de construction, le fait que les travailleurs doivent
loger dans des campements représentera un obstacle supplémentaire pour les femmes qui
pourraient craindre d’être séparées de leur famille et de loger avec d’autres hommes étrangers.
6.5.14 Impact 14- Risques de conditions de travail non adéquates
Les conditions de travail de l’EDD sont encadrées par le Code du Travail de Djibouti, le Règlement intérieur
de l’EDD qui définit les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et la discipline sur le lieu de travail et
applicables à tous ses travailleurs et le manuel d’entretien des lignes à haute tension de l’EDD qui définit les
principes de maintenance et d’entretien des lignes en énonçant certaines mesures de sécurité. Des
conditions de travail correctes doivent s’appliquées pour la main d’œuvre associée aux travaux mais aussi
pour les employés des prestataires et fournisseurs principaux.
Cependant, de mauvaises pratiques de gestion du travail de la part de la maitrise d’œuvre technique et/ou
des sous-traitants peuvent conduire à des situations où les travailleurs du projet sont exploités. Cela peut se
produire si l’employeur ne dispose pas de procédures écrites de gestion du travail ou ne conclut pas de
contrats écrits informant les travailleurs des rémunérations, des heures de travail et des congés, ainsi que
des autres informations requises par la législation djiboutienne et la NES2 de la Banque Mondiale. La
définition des heures de travail et la mise en œuvre de procédures de gestion du stress lié à la chaleur
seront particulièrement importantes sachant que les employés travailleront en zone désertique avec des
températures pouvant dépasser les 45°Cpendant les mois de juillet et août.
Une attention particulière doit être apportée sur la protection de la main d’œuvre et notamment le travail des
enfants ainsi que le travail forcé et l’exploitation de la main d’œuvre illégale comme les migrants illégaux.
D’autre part, ne pas donner aux travailleurs la possibilité d'exprimer leurs préoccupations peut également
entraîner leur mécontentement et affecter leur productivité. Lorsque les travailleurs sont autorisés à exprimer
librement leurs opinions et à faire connaître leurs griefs à la direction, en sachant que celle-ci prendra les
mesures nécessaires, cela peut conduire à des conditions de travail plus efficaces et plus sûres et accroître
la satisfaction des travailleurs.
Finalement, il est important de rappeler que, durant la phase de construction, la plupart des travailleurs
seront logés dans des campements aménagés par la maitrise d’œuvre technique, qui devront être des
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
186
186
186
installations adaptées avec des cantines, des installations sanitaires et des aires de repos convenables qui
tiennent compte des besoins physiques, sociaux et culturels des employés (en particulier en termes de
logement et restauration). Il sera également nécessaire d’intégrer des mesures de prévention contre le
COVID-19.
Des aménagements exigus et insalubres peuvent provoquer des maladies chez les travailleurs, ce qui peut
entraîner une augmentation de la rotation du personnel ainsi qu'une réduction de la productivité. De même,
une eau et/ou des installations sanitaires inadéquates peuvent affecter la santé des travailleurs, contaminer
le sol et les eaux de surface, et entraîner des maladies chez les travailleurs.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 13 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant la phase de construction et durant la phase d’opération pour les raisons
suivantes :
Intensité moyenne- L’intensité est évaluée comme moyenne car si un travailleur était touché par
cet impact, cela signifierait que ces conditions de travail ne seront pas conformes aux prescriptions
du droit djiboutien et aux standards de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de
Développement (en particulier la NES2), en termes de salaires, heures de travail, avantages
sociaux, conditions de logement. Cet impact serait certes important mais ne devrait pas entrainer un
changement majeur pour les personnes touchées qui devraient toujours pouvoir travailler.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Les personnes
potentiellement concernées sont celles qui travaillent directement ou indirectement sur le projet. Lors
de la phase de construction, l’étendue est évaluée comme locale car le nombre d’emplois en lien
avec le projet devrait être important et toucher une partie de la zone d’étude et de sa population.
Lors de la phase d’opération les besoins en main d’œuvre seront beaucoup plus limités. L’impact
devrait être ressenti dans un espace réduit et circonscrit et par un nombre peu élevé de personnes,
c’est pourquoi l’étendue est alors considérée comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction et d’opération de la ligne et du
poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée comme moyenne et la durée de
la phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des politiques de gestion des ressources humaines de l’EDD, du constructeur et de
ses sous-traitants. La probabilité descendra lors de la phase d’opération car le nombre d’emplois liés
au projet sera très limité.
Sensibilité moyenne- Djibouti a certes un cadre législatif protégeant le travailleur en termes de
temps de travail, heures supplémentaires, congés, protection sociale, etc. Cependant le chômage
est élevé et la population, en particulier les jeunes, cherche à tout prix à trouver un emploi et cela
sert parfois de prétexte aux employeurs pour remettre en cause et ne pas respecter les droits des
travailleurs.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
187
187
187
6.5.15 Impact 15- Expositions des travailleurs à des risques physiques et
chimiques
La construction et l’opération du poste de Nagad et de la ligne de transmission présentent des risques liés
aux caractéristiques du projet qui sont les suivants :
Risques de chutes d’altitude lors du travail sur les pylônes, les chutes d’altitude étant parmi les
causes les plus fréquentes de blessures mortelles ou invalidantes sur les sites de construction.
Risque d’électrocution au niveau du poste de Nagad ou lors de la mise sous tension et de l’entretien
de la ligne, sachant que les véhicules ou les objets métalliques à proximité immédiate des fils
électriques peuvent provoquer un arc électrique entre les fils et l'objet, sans contact réel.
Risques de chute dans des excavations non marquées lors de l’implantation des pylônes.
Risques de blessures lors de l’utilisation d’outils et équipements tranchants.
Des conditions de travail dangereuses pourraient exposer les travailleurs à des risques de blessure ou de
mort. Il peut s’agir d’un accès non protégé à des endroits dangereux, de mauvaises pratiques et un mauvais
équipement pour les opérations, une mauvaise sécurité électrique (travailleurs non formés, outils
inadéquats, etc.), des protections inadéquates sur les outils et l'équipement (scies non protégées, etc.) et
d'autres mauvaises pratiques. En outre, les entreprises contractantes pourraient ne pas fournir gratuitement
aux travailleurs des équipements de protection individuelle adéquats, notamment des protections pour la
tête, les mains, les oreilles, les yeux et les pieds, et pourraient ne pas former suffisamment les travailleurs
aux risques liés à leur travail et à la manière d'assurer leur sécurité au travail.
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 14 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité majeure durant la phase de construction et une sévérité modérée durant la phase d’opération
pour les raisons suivantes :
Intensité forte- L’intensité est évaluée comme forte car si un travailleur était touché par cet impact,
cela signifierait qu'il pourrait être blessé ou même mourir dans un accident du travail ou en raison de
conditions de travail défavorables à sa santé.
Étendue locale pendant la construction et ponctuelle pendant l’opération- Les personnes
potentiellement concernées sont celles qui travaillent directement ou indirectement sur le projet. Lors
de la phase de construction, l’étendue est évaluée comme locale car le nombre d’emplois en lien
avec le projet devrait être important et toucher une partie de la zone d’étude et de sa population.
Lors de la phase d’opération les besoins en main d’œuvre seront beaucoup plus limités. L’impact
devrait être ressenti dans un espace réduit et circonscrit et par un nombre peu élevé de personnes,
c’est pourquoi l’étendue est alors considérée comme ponctuelle.
Durée moyenne pendant la construction et longue pendant l’opération- L’impact devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction et d’opération de la ligne et du
poste. La durée de la phase de construction (2 ans) est considérée comme moyenne et la durée de
la phase d’opération (40 ans) est considérée comme longue.
Probabilité d'occurrence moyenne en phase de construction et faible en phase d’opération-
Même en absence de mesures d’atténuation, cet impact ne devrait pas nécessairement avoir lieu.
Cela dépendra des politiques de sécurité de l’EDD, du constructeur et de ses sous-traitants. La
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
188
188
188
probabilité descendra lors de la phase d’opération car le nombre d’emplois liés au projet sera très
limité.
Sensibilité moyenne- Djibouti a certes un cadre législatif protégeant le travailleur en termes de
prévention des risques au travail. Cependant le chômage est élevé et la population, en particulier les
jeunes, cherche à tout prix à trouver un emploi et cela sert parfois de prétexte aux employeurs pour
remettre en cause et ne pas respecter les droits des travailleurs.
6.5.16 Impact 16- Risque de détérioration de sites de patrimoine culturel et
d’héritage culturel
Les sites de patrimoine culturel désignent :
des objets physiques mobiliers ou immobiliers, des sites, des structures ou groupes de
structures, ainsi que des éléments naturels et des paysages importants sur le plan
archéologique, paléontologique, historique, architectural, religieux, esthétique ou culturel.
(NES 8, Banque Mondiale)
D’après les visites de terrain et les interprétations d’images satellite utilisant Google Earth, 517 tombes en
pierre (considérées comme des sites de patrimoine culturel) se trouvent dans la zone d’étude de l’emprise
du projet de 100 mètres de large et de 190 km de long. Il s’agit de tombes avec un enclos de pierre
circulaire.
Il est prévu de maintenir ces tombes en l’état, sachant qu’il sera possible pour la population de se rendre sur
les tombes si elle le souhaite. Il est cependant possible que des tombes puissent être affectés : elles
pourraient être endommagées lors du câblage de la ligne ou pourraient se trouver sur l’emplacement d’un
pylône. Si cela devait avoir lieu, la première mesure serait d’éviter de détruire ces biens en exigeant à la
maitrise d’œuvre technique de réparer les dommages causés lors du câblage ou en déplaçant légèrement
les pylônes. Si cela n’est pas possible, la population Issa considère qu’il n’y aurait pas de problème pour
déplacer les tombes, tant que la famille de la personne enterrée est compensée et que les autorités
coutumières participent au processus. En revanche la population Afar dit que les tombes ne devaient pas
être déplacées car la religion et la tradition interdisaient de déplacer les os de ses ancêtres. Il faut rappeler
qu’autour de 277 tombes ont été détectées en zone Issa et 240 en zone Afar.
Finalement, il est important de rappeler qu’aucun site archéologique n’a été détecté dans la zone d’étude de
l’emprise du projet. Cependant les archéologues s’accordent sur le fait que les awellos ont été utilisés par
les populations pour construire des enclos ou même d’autres tombes plus récentes ce qui peut avoir modifié
leur morphologie et qu’ils soient confondus avec des tombes plus récentes. Il sera donc essentiel d’intégrer
une étude plus détaillée des tombes dans la zone d’emprise finale du projet effectuée par un archéologue de
la maitrise d’œuvre sociale afin d’éviter tout dommage à un awello73.
73 Cette étude devrait être intégrée à la formulation du PAR du projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
189
189
189
Photo 16 : Exemple de tombe en pierre, site de patrimoine culturel
A partir de l’information collectée et analysée durant l’EIES, l’impact 15 est évalué comme négatif et ayant
une sévérité modérée durant la phase de construction pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne- L’intensité est évaluée comme moyenne car un certain nombre de tombes se
trouvent dans la zone d’emprise du projet. Il n’est pas prévu de les détruire ou les déplacer à cause
des travaux et elles pourront toujours être visitées par la population, même si elles sont dans la zone
d’emprise. Cependant, dans de rares exceptions, certaines tombes pourraient être endommagées
par le câblage ou devoir être déplacées si l’évitement n’est pas possible. Il s’agit d’un point sensible
pour la population qui demanderait une attention particulière et l’étude approfondie des tombes
pourrait faire apparaitre un awello parmi les biens potentiellement affectés par le projet.
Étendue ponctuelle pendant la phase de construction- Bien que la zone d’emprise du projet soit
importante, les sites de patrimoine culturel risquant d’être détériorés sont très réduits.
Durée moyenne pendant la construction- Le risque de détérioration de tombes devrait être
ressenti de façon continue durant toute la durée de construction (2 ans) qui est considérée comme
moyenne. L’impact ne devrait pas être ressenti durant la phase d’opération.
Probabilité d'occurrence faible- Il n’est pas prévu d’endommager ou de déplacer des tombes dans
le cadre des activités de construction. La probabilité de se réaliser est donc faible.
Sensibilité forte- Les tombes Issa pourraient faire l’objet d’un déplacement contre compensation.
En revanche, les Afars ne souhaitent pas que leurs tombes soient déplacées. C’est pourquoi il faut
considérer que la sensibilité du récepteur est forte face aux potentiels effets de cet impact.
6.6 Tableau synthèse de l’évaluation des impacts sociaux
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
190
190
190
Tableau 10 : Evaluation des impacts sociaux du projet
Description de l'impact Stade du
projet
Analyse de l’impact Importanc
e de
l’impact
Sensibilité
du
récepteur
Sévérité
de l’impact Intensité Etendue Durée Probabilit
é
IMPACTS SUR LES CONDITIONS ECONOMIQUES
Impact 1- Amélioration de l’approvisionnement en
électricité
Opération Moyenne Locale Longue Elevée Positive
moyenne
Moyenne Positive
modérée
Impact 2- Création d'emplois directs et indirects liés
au projet
Construction Forte Ponctuell
e
Moyenne Moyenne Positive
moyenne
Faible Positive
mineure
Opération Forte Ponctuell
e
Longue Moyenne Positive
moyenne
Faible Positive
mineure
IMPACTS SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS
Impact 6- Tensions sociales dues à des
comportements inappropriés de travailleurs extérieurs
Construction Moyenne Locale Moyenne Moyenne Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Opération Moyenne Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
faible
Faible Négligeable
Impact 7- Augmentation des VBG du fait de l’afflux de
travailleurs extérieurs
Construction Forte Locale Moyenne Moyenne Négative
forte
Forte Négative
majeure
Opération Forte Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
moyenne
Faible Négative
mineure
Impact 8- Augmentation de l'incidence des maladies
transmissibles, en particulier des MST
Construction Forte Ponctuell
e
Moyenne Moyenne Négative
moyenne
Forte Négative
majeure
Opération Forte Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
moyenne
Forte Négative
majeure
Impact 9 – Augmentation de l’incidence de la COVID-
19
Construction Forte Ponctuell
e
Moyenne Moyenne Négative
moyenne
Forte Négative
majeure
Opération Forte Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
moyenne
Forte Négative
majeure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
191
191
191
Description de l'impact Stade du
projet
Analyse de l’impact Importanc
e de
l’impact
Sensibilité
du
récepteur
Sévérité
de l’impact Intensité Etendue Durée Probabilit
é
Impact 10- Augmentation des risques d’accidents
pour la population locale
Construction Forte Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Opération Forte Ponctuell
e
Longue Faible Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Impact 11- Impacts des champs électromagnétiques
sur la santé de la population
Opération Faible Ponctuell
e
Longue Elevée Négative
faible
Moyenne Négative
mineure
Impact 12- Pression accrue sur les services de base
du fait de l’afflux de travailleurs
Construction Moyenne Locale Moyenne Moyenne Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Opération Faible Ponctuell
e
Moyenne Faible Négligeabl
e
Moyenne Négligeable
IMPACTS SUR LA SANTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS
Impact 13- Risques de discrimination et de non-égalité
des chances des travailleurs
Construction Forte Locale Moyenne Moyenne Négative
forte
Forte Négative
majeure
Opération Forte Ponctuell
e
Longue Faible Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Impact 14- Risques de conditions de travail non
adéquates
Construction Moyenne Locale Moyenne Moyenne Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Opération Moyenne Ponctuell
e
Longue Faible Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
Impact 15- Expositions des travailleurs à des risques
physiques et chimiques
Construction Forte Locale Moyenne Moyenne Négative
forte
Moyenne Négative
majeure
Opération Forte Ponctuell
e
Longue Faible Négative
moyenne
Moyenne Négative
modérée
IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
Impact 16- Détérioration de sites de patrimoine
culturel et d’héritage culturel
Construction Moyenne Ponctuell
e
Moyenne Faible Négative
faible
Forte Négative
modérée
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
192 192 192
6.7 Identification des impacts environnementaux et justification de leur
importance
Activités génératrices d'impact général
Phase de construction
Les activités associées au développement et à la construction de la transmission et de la distribution
d'électricité comprennent le défrichage des terres pour l'emprise des lignes de transmission, la
construction de routes d'accès ou leur modernisation, les zones de rassemblement de l'équipement, la
construction du poste de Nagad, la préparation du site et l'installation des composants des lignes de
transmission. Ces activités pourraient conduire à :
La production de déchets de chantier et de camps de construction ;
Le contrôle de l'érosion du sol et des sédiments dans les zones d'approvisionnement en
matériaux et les activités de préparation du site ;
L’émission de poussières fugitives et autres émissions gazeuses (par exemple, provenant de
la circulation des véhicules, des activités de défrichement et des stocks de matériaux) ;
L’émission de bruit des équipements lourds et de la circulation des camions ;
La manipulation de matières dangereuses et de déversements d'hydrocarbures associés au
fonctionnement de l'équipement lourd et aux activités de ravitaillement en carburant ;
Le défrichage de la végétation naturelle le long de la ligne électrique.
Phase d’exploitation
Les activités opérationnelles peuvent comprendre l'entretien de l'emprise, l'accès aux lignes de
transmission, aux pylônes et aux postes (par exemple, les sentiers à faible impact ou les routes
d'accès nouvelles/améliorées) et la gestion de la végétation. Les mises à niveau et l'entretien des
infrastructures existantes sont prises en compte tout au long du cycle de vie du projet. L'exploitation
des lignes de distribution d'électricité sous tension et des postes peut générer les impacts suivants,
spécifiques à l'industrie :
Exposition à des matières dangereuses,
Collision avec des lignes électriques,
Électrocution,
Interférences électromagnétiques,
Aménagement visuel,
Bruit et ozone,
Sécurité de la navigation aérienne
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
193 193 193
6.7.1 Impact 1 - Dégradation de la qualité de l'air
Les emplacements proposés dans la zone d'étude sont éloignés des zones industrielles et des
établissements humains. Cependant, certains pylônes seront situés en parallèle de la Route Nationale
n°1 et ces zones sont sujettes à la pollution des véhicules. En raison également du climat sec, du type
de sol et des conditions venteuses, les niveaux de poussière en suspension dans l'air peuvent être
élevés. Actuellement, la qualité de l'air varie de « modérée » à « insalubre pour les groupes sensibles
».
Au cours de la phase de construction, les émissions d’air produites par les activités de construction et
l’utilisation de véhicules seront les suivantes : Des émissions fugitives provenant du défrichage du site, du creusement, du remplissage, de
la manipulation des matériaux, du transport, de l’utilisation de machines de construction, etc.
Des émissions fugitives de poussières provenant de l’utilisation des véhicules
le long des routes non pavées ;
Des émissions de poussières dues au dynamitage de roches ;
Des émissions de gaz d’échappement due à l'augmentation du volume du trafic
routier utilisé pour le transport de construction matériel ;
Les émissions provoquées par les générateurs diesel.
Pendant la phase d'exploitation, il n'y aura pas d'émissions gazeuses provenant des zones
d'exploitation. Les émissions gazeuses et de poussières fugitives seront très réduites en raison du
déplacement occasionnel des véhicules de maintenance.
L'impact sur la qualité de l'air est évalué comme négatif et d'une sévérité mineure pendant la phase de
construction et négatif et d'une sévérité négligeable pendant la phase d'exploitation :
Intensité élevée pendant la phase de construction et faible intensité pendant la phase
d'exploitation : L'intensité est évaluée comme étant aussi élevée que pendant la phase de
construction car les activités de construction sur le site entraîneront des émissions de
poussière importantes. L'intensité est évaluée comme étant faible pendant la phase
d'exploitation car il n'y aura pas d'émissions gazeuses le long de la ligne électrique.
Etendue locale : L’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet à la fois.
Durée courte : La durée est courte parce que l'impact sera ressenti pendant une période très
limitée pendant la phase de construction.
Probabilité d'occurrence élevée : Cet impact est directement lié à l'activité de construction
sur le site et a une très forte probabilité d'occurrence.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
194 194 194
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car il n'y a pas de zones écosensibles
ou d'établissements résidentiels à proximité.
6.7.2 Impact 2 – Emission de bruit et de nuisance sonore
La SFI ne donne pas de directives en ce qui concerne le niveau de bruit spécifique aux activités de
construction. Cependant, il est considéré comme une bonne pratique pour les périodes de
construction de plus de deux ans de respecter les niveaux de 55 dB(A) de la directive de la SFI
pendant la journée. Pendant la phase d'exploitation, les lignes directrices générales de la SFI en
matière de standards environnementaux et sociaux stipulent que dans les environnements où les
niveaux de bruit ambiant dépassent déjà un niveau de 55 dB(A) pendant la journée et/ou 45 dB(A)
pendant la nuit, les émissions sonores ne doivent pas entraîner une augmentation du niveau de bruit
ambiant dans une zone résidentielle de 3 dB(A) ou plus, déterminé pendant l'heure la plus bruyante
d'une période de 24 heures.
Pour que le bruit génère un risque il faut qu’il existe des espèces sensibles à proximité or ce n’est que
rarement le cas étant donné la situation physique de la ligne et du poste.
Tableau 11 : Niveaux sonores typiques à plusieurs distances des équipements de travaux publics en Db(A),
Source : Geosolve & Certiprojecto (2009)
Equipment
Distance to Noise Source
15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500
m
Excavators 85 81 75 67 58 52
Heavy
Trucks 82 78 72 64 55 49
Generators 77 73 67 59 50 44
Compressor
s 80 76 70 62 53 47
Pendant la phase de construction, le bruit généré émanera principalement du fonctionnement des
machines et des véhicules de construction et des activités entreprises dans le cadre de chaque emploi
spécifique. Les activités de construction spécifiques qui sont susceptibles de générer des émissions
sonores sont notamment :
l'ouverture des routes d'accès,
le dégagement de l'emprise,
le montage des pylônes de transmission,
la construction du poste de Nagad,
le déplacement et le fonctionnement des véhicules et des machines,
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
195 195 195
le déplacement des véhicules lourds et le fonctionnement des machines sur le lieu de travail,
dans les chantiers ou en transit, etc.
En outre, les installations aériennes et les autres équipements à déployer dans la sous-station
impliqueront un trafic de camions, ce qui entraînerait des émissions sonores temporaires.
Figure 53- Typical Construction Noise Levels (Source OSHA 2003)
Pendant la phase d'exploitation, différent type de bruit pourra être généré :
Des bourdonnements ou des ronflements pourront être entendus autour des transformateurs
ou des lignes électriques à haute tension et produire des effets corona. Le potentiel d'impact
du bruit éolien/corona provenant de la ligne de transmission a été considéré comme peu
probable, il n'a donc pas été évalué dans cette étude.
Des mouvements de véhicules entrainant du bruit pendant les opérations de maintenance.
L'impact des émissions sonores est évalué comme négatif et d'une sévérité faible pendant la phase
de construction et comme négatif et d'une sévérité négligeable pendant la phase d'exploitation pour
les raisons suivantes :
Intensité moyenne pendant la phase de construction et faible intensité pendant la
phase d'exploitation : l'intensité est considérée comme moyenne pendant la phase de
construction car bien que le fonctionnement des machines et des véhicules de construction
sera source de bruit il est peu probable que des espèces sensibles soient à proximité.
L’intensité est considérée comme faible pendant la phase d'exploitation.
Etendue locale : l’étendue est locale, car l'impact affectera une zone limitée du site du projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
196 196 196
Durée courte : La durée est courte car l'impact sera ressenti pendant une période très limitée
pendant la phase de construction et également pendant la phase d'exploitation en raison de la
circulation des équipements de maintenance.
Probabilité d'occurrence forte : Cet impact est directement lié à l'activité de construction sur
le site et a une très forte probabilité d'occurrence.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car il n'y a pas de zones écosensibles
ou d'établissements résidentiels à proximité :
1. Poste de Nagad : Certaines agglomérations résidentielles ont été identifiées entre
200 m et 500 m de la sous-station. Cependant, les niveaux de bruit devraient se
situer dans les limites admissibles recommandées par la SFI. La SFI recommande
55 dBA pendant la journée et 45 dBA pendant la nuit comme directives de niveau
sonore. Ainsi, la sensibilité du récepteur est faible.
2. Zone d’emprise : La sensibilité des récepteurs est généralement faible car les
récepteurs sensibles situés à proximité immédiate de l'emprise sont rares le long
du corridor du projet, à l'exception de la zone écosensible de Djalelo qui sera évité
par le tracer de la ligne.
6.7.3 Impact 3 - Impact sur la géologie et la géomorphologie
La zone du projet est composée de roches volcaniques quaternaires et tertiaires et les sédiments
alluviaux quaternaires de différentes épaisseurs sont assez répandus dans les oueds. Deux grands
types de sols peuvent être identifiés. Sur les plateaux et sur les pentes, des sols caillouteux très peu
profonds sur des roches dures, les leptosols, prédominent. Dans les vallées et les oueds, on trouve
des fluvisols. Les leptosols dans les montagnes se sont développés en raison de l'érosion continue
par le vent et l'eau. Ces sols ont moins de 10 centimètres d'épaisseur, contiennent de grandes
quantités de graviers, ne présentent que peu ou pas de strates, contiennent peu de matières
organiques et sont sensibles à l'exploitation de l'eau et à la dessiccation. Les leptosols sont très
sensibles à l'érosion et ne conviennent ni à l'agriculture ni aux pâturages. Néanmoins, ils sont utilisés
comme pâturages dans le paysage. L'étude d'impact géologique vise à évaluer l'impact que le projet
proposé aura sur l'environnement géologique, qui comprend la roche mère et le profil naturel du sol.
Pendant la phase de construction, les excavations nécessaires à la fondation du pylône sont la seule
activité du projet susceptible d'interférer dans le substrat géologique. Pendant l'excavation des
fondations du pylône, le débroussaillage et le nivellement du sol seront effectués afin de permettre
l'accès des véhicules aux pylônes. Selon l'emplacement, cela peut favoriser l'érosion du sol. Celle-ci
sera localisée et ne devrait pas constituer une perturbation linéaire étendue.
La phase opérationnelle ne devrait pas affecter, ou être affectée par la géologie et la géomorphologie.
Aucun impact sur la géologie ou la géomorphologie n'a donc été identifié pour la phase opérationnelle.
L'impact sur la géologie et la géomorphologie est évalué comme négatif et d'une sévérité mineure
pendant la phase de construction pour les raisons suivantes :
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
197 197 197
Intensité moyenne : L'intensité est évaluée comme moyenne car pendant la phase de
construction, l'activité du projet entraînera un changement limité de la géomorphologie étant
donné sa répartition générale dans l'environnement.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet à la fois.
Durée longue : la durée est longue car la plupart des changements géomorphologiques
seront permanents.
Probabilité d’occurrence élevée : Cet impact est directement lié à l'activité de construction
sur le site et a une très forte probabilité d'occurrence.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car les caractéristiques
géomorphologiques sont largement réparties dans la zone du projet. Il n'y a pas de zones
écosensibles ni d'établissements résidentiels à proximité.
6.7.4 Incidence 4 - Changements dans les processus de sédimentation
Pendant la phase de construction, les travaux de déblaiement et de terrassement exposeront le
matériau géologique aux agents d'altération. Dans la zone du projet, cet aspect revêt une importance
particulière étant donné les formations géologiques qui se produisent, c'est-à-dire les dépôts
quaternaires - en particulier les sols non consolidés, qui sont particulièrement sensibles à l'action du
vent. Pendant la phase de construction, il pourrait également y avoir une augmentation de l'érosion
hydrique là où la végétation est défrichée, exposant ainsi le sol aux précipitations et au ruissellement
de surface.
Pendant la phase d'exploitation, il n'y aura pas d'impact spécifique sur les processus de
sédimentation.
L'impact sur les processus de sédimentation est évalué comme négatif et d'une sévérité mineure
pendant la phase de construction :
Intensité élevée : L'intensité est considérée comme élevée car les actions de défrichement et
de terrassement entraîneront l'exposition des matériaux géologiques aux agents d'altération.
Etendue locale : L’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet à la fois.
Durée courte : La durée est courte car la plupart des changements seront limités dans le
temps pendant la phase de construction.
Probabilité d'occurrence élevée : Cet impact est directement lié à l'activité de construction
sur le site et a une très forte probabilité d'occurrence.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible. Il n'y a pas de zones écosensibles ou
d'établissements résidentiels à proximité.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
198 198 198
6.7.5 Impact 5 - Augmentation de l'érosion et du compactage des sols
Pendant la phase de construction, les activités suivantes pourraient avoir des impacts importants sur
les ressources du sol et l'utilisation des terres :
Le défrichement de la végétation pour l'établissement de l'emprise : supprimer la couverture
végétale pourrait augmenter l'érosion du sol ;
La modification du terrain et le déplacement des véhicules et des machines : ces activités de
construction peuvent entraîner une érosion du sol en supprimant la couverture végétale et en
compactant les sols.
La production de déchets et la manipulation de substances dangereuses : une gestion ou une
manipulation inadéquate des déchets et des substances dangereuses pourra entraîner des
déversements ou des fuites accidentels, avec une contamination potentielle des sols.
Le mélange des sols, l'érosion, l'orniérage et le compactage sont des impacts interdépendants
associés à la construction et peuvent affecter considérablement la régénération future de la
végétation. Les sols peuvent être mélangés pendant l'excavation des fondations des pylônes.
En plus des excavations, l'érosion et le compactage du sol peuvent également résulter du
mouvement des machines et des véhicules de construction lourds, tant sur les sites de travail
et les chantiers que sur les voies d'accès aux sites de travail, lorsque des routes non pavées
sont utilisées.
Pendant la phase d'exploitation, la principale activité susceptible d'affecter les sols est le défrichement
de la végétation pour l'entretien de l'emprise. La suppression de la couverture végétale peut
également permettre d'accroître l'érosion des sols. Comme la majorité des sites ne sont pas très
végétalisés, l'impact des activités du projet pendant la phase d'exploitation peut être très limité.
L'impact est évalué comme négatif et d'une sévérité moyenne pendant la phase de construction et
comme négatif et d'une sévérité mineure pendant la phase d'exploitation pour les raisons suivantes :
Intensité élevée : L'intensité est considérée comme élevée pendant la phase de construction
car le sol est mal protégé et est très sensible à l'érosion car la couverture végétale est rare.
L'intensité est évaluée comme moyenne pendant la phase d'exploitation, car les impacts sur
le sol seront très limités lorsque la ligne électrique sera en place.
Etendue locale : L’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet et sera limité aux pylônes et à d'autres zones localisées où des mouvements intenses
de machines lourdes sont attendus,
Durée moyenne : La durée est moyenne car le sol se régénère lentement après la fin de la
construction.
Probabilité d'occurrence forte : Cet impact est directement lié à l'activité de construction sur
le site et a une très forte probabilité d'occurrence.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
199 199 199
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car le site ne supporte pas beaucoup
de végétation et pas d’activité anthropique importante. Le sol est de très mauvaise qualité
agricole avec une faible teneur en matière organique sur le site du projet et dans le couloir de
la ligne de transmission. Néanmoins, les sols sont utilisés comme pâturages par les pasteurs.
6.7.6 Impact 6 – Contamination des sols
La contamination des sols peut résulter de pratiques de gestion des déchets non rationnelles. Les
déchets dangereux peuvent être facilement inflammables, corrosifs, réactifs ou toxiques. Ils peuvent
également présenter d'autres caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui constituent un
risque potentiel pour la santé humaine et l'environnement s'ils sont mal gérés. Une manipulation ou
une gestion inadéquate des substances dangereuses, ou un mauvais entretien des véhicules et des
machines, peuvent également entraîner des déversements ou des fuites de contaminants, avec une
contamination potentielle des sols.
Pendant les phases de construction et d'exploitation, l'impact d'une éventuelle contamination des sols
est évalué comme négatif et d'une sévérité mineure pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne : L'intensité est évaluée comme moyenne car pendant la phase de
construction, les activités de construction entraîneront une modification limitée de la qualité du
sol en raison de sa répartition générale dans l'environnement.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet à la fois.
Durée moyenne : La durée est moyenne car la contamination éventuelle des sols prendra un
certain temps à se rétablir.
Probabilité d'occurrence faible : Cet impact ne peut se produire qu'à la suite d'un
déversement accidentel de matières dangereuses dans la zone du projet et cet impact ne se
manifestera qu'en cas de déversement accidentel ou si une gestion inadéquate des déchets
et des substances dangereuses est vérifiée.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible en raison de la faible distribution
florale et faunique.
6.7.7 Impact 7 – Changement du paysage et impacts visuels
Phase de construction
La construction du projet impliquera plusieurs activités qui affecteront potentiellement le paysage de la
zone d'influence du projet. Les activités qui devraient avoir une plus grande influence sur l'élément
visuel pendant la construction seront :
La construction du poste de Nagad
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
200 200 200
L’installation de pylônes et le défrichement de la végétation dans leur emprise ;
La présence de camps de travailleurs temporaires et la présence d'équipements et de
véhicules associés.
Ces actions auront un impact visuel pour les observateurs. Il s'agit d'un effet temporaire qui n'aura un
impact que pendant la courte période de construction. Cet impact peut être décrit comme une
dégradation temporaire du paysage sur les sites de travail, due à :
Une dégradation temporaire de la valeur du paysage ;
Une modification de la tranquillité du paysage environnant ;
Une pollution lumineuse localisée ;
La modification du caractère sauvage du paysage et la création d'éléments visuels dominants.
Les impacts esthétiques pendant la phase de construction seront limités aux zones de travail.
Les impacts paysagers et visuels sont jugés négatifs et d'une sévérité mineure pendant la phase de
construction pour les raisons suivantes :
Intensité élevée : L'intensité est jugée élevée en raison de plusieurs activités de construction
entraînant des modifications importantes du paysage.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact affectera une partie limitée de la zone du
projet à la fois, car l'impact sera ressenti au niveau du poste, le long de l'emprise et des routes
d'accès.
Durée courte : La durée est courte car cet impact ne concernera que la courte phase de
construction
Probabilité d'occurrence forte : L'impact sur le paysage est directement lié aux activités de
construction.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car la valeur du paysage du projet est
considérée comme faible.
Phase opérationnelle
Pendant la phase opérationnelle, le projet générera des impacts visuels sur le paysage en raison de :
la présence d'infrastructures (pylônes, ligne électrique, bâtiments) ;
la présence d'une emprise permanente sous la ligne aérienne.
Cet impact peut être considéré comme une altération permanente du paysage, due à :
la modification de la tranquillité du paysage environnant ;
Une pollution lumineuse localisée ;
La modification du caractère sauvage en raison de la création d'éléments visuels dominants.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
201 201 201
La présence et le déplacement occasionnels de véhicules de maintenance sur le site du projet
L'effet esthétique global d'une ligne de transmission est susceptible d'être négatif pour la plupart des
gens, en particulier lorsque les lignes proposées traversent des paysages naturels. Les hautes
structures en acier peuvent sembler disproportionnées et non compatibles avec les paysages
naturels.
Les impacts paysagers et visuels sont jugés négatifs et d'une gravité modérée pendant la phase
d'exploitation pour les raisons suivantes :
Intensité élevée : L'intensité est jugée élevée en raison des modifications substantielles du
paysage dues à la présence de la ligne électrique et des pylônes.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact sera ressenti à proximité immédiate de la
ligne de transmission et des postes.
Durée longue : La durée est longue car l'impact sera ressenti de manière continue pendant
toute la durée de vie de la ligne de transmission.
Probabilité d'occurrence forte : L'impact sur le paysage est directement lié à la présence
des lignes électriques et du poste de Nagad.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car la valeur du paysage du projet est
considérée comme faible.
6.7.8 Impact 8 - Modifications potentielles du schéma de ruissellement naturel
des eaux
Il n'y a pas de caractéristiques permanentes connues des eaux de surface sur le site du projet.
Cependant, il existe un réseau de canaux de surface éphémères (oueds) qui, en raison du climat
aride, ne contiennent que rarement de l'eau. Le réseau d'oueds sera quelque peu modifié pendant la
construction des routes d'accès au site. Les eaux souterraines ne seront pas affectées par le projet.
Le tracé de la ligne de transmission proposée ne contient aucune masse d'eau de surface
permanente, et les activités pourraient générer deux impacts potentiels différents sur ces ressources
en eau temporaires :
Les changements des schémas de ruissellement naturels - causés par les changements
de topographie et d'hydrographie résultant du défrichement de la végétation, des
excavations et de la construction des routes d'accès ;
La pollution des eaux de surface et souterraines - potentiellement causée par des rejets
ou des déversements accidentels de substances toxiques et une gestion inadéquate des
déchets.
En raison de la nature et de l'étendue du projet, les impacts sur les ressources en eau
seront plus importants pendant la phase de construction.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
202 202 202
Pendant la phase de construction, les changements sur le ruissellement naturel peuvent
se produire principalement en raison :
Du défrichement de la végétation sur les berges des oueds, les plaines inondables et les
zones humides ;
des excavations pour la construction de pylônes sur les rives des oueds, les plaines
inondables et les zones humides ;
des constructions des routes d'accès.
L'impact sur les changements potentiels du schéma d'écoulement naturel des eaux est évalué comme
négatif et d'une sévérité négligeable pour les raisons suivantes :
Faible intensité : L'intensité est jugée aussi faible que les activités de construction peuvent
légèrement modifier le profil naturel des eaux de ruissellement.
Etendue locale : Le champ d'application est local car les modifications du débit naturel ne
peuvent être pertinentes que dans la section du canal d'eau où les activités de construction
auront lieu.
Durée courte : En raison de la nature et de l'étendue des activités de construction, on
s'attend à ce que cet impact négatif soit de courte durée, car une fois les activités de
construction terminées, les cours d'eau retrouveront pour la plupart leur débit normal.
Probabilité d'occurrence élevée : L'impact sur les changements potentiels du modèle
naturel d'écoulement des eaux est directement lié aux activités de construction et se produira
probablement à l'échelle locale.
Sensibilité faible : La sensibilité du récepteur est faible car l'élément touché reviendra à son
état naturel après l'activité de construction et n'aura aucun impact sur l'écologie de la zone du
projet.
6.7.9 Impact 9 – Emission de gaz à effet de serre (GES)
Cette section est une évaluation de l'impact potentiel des activités du projet sur le changement
climatique :
- Phase de construction : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux
activités de construction.
- Phase d'opération : Une énergie propre et renouvelable sera produite en évitant la
consommation de produits de substitution plus émetteurs de GES.
Comme le changement climatique affecte les récepteurs mondiaux, l'ampleur de l'impact et la
sensibilité des ressources/récepteurs ne peuvent pas être déterminées de la même manière que pour
d'autres sujets. Pour cette raison, l'importance des impacts est uniquement déterminée comme étant
significative ou non significative.
Phase de construction
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
203 203 203
L'estimation annuelle des émissions de GES sur la durée de vie du projet est très probablement
inférieure à la valeur seuil d'importance de la SFI, qui est de 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de
carbone (tCO2e) par an. Par conséquent, l'impact est considéré comme non significatif.
Phase d'exploitation
Les installations de lignes de transport d'électricité ne génèrent généralement pas d'émissions
importantes pendant leur fonctionnement. En outre, l'énergie produite à partir de sources
renouvelables permet d'éviter des émissions qui, autrement, proviendraient en tout ou en partie de
sources à plus forte intensité de carbone et plus émettrices de GES. Comme le projet est un projet de
production d'énergie renouvelable, on considère que les émissions de sa phase d'exploitation
remplacent les émissions qui, autrement, proviendraient d'autres technologies de production
d'électricité. Cela devrait avoir un impact positif sur le changement climatique.
La ligne de transmission transportera de l'électricité produite par des énergies propres, principalement
l'hydroélectricité.
La fourniture d'électricité en provenance d'Ethiopie couvre 70% des besoins énergétiques de Djibouti.
Le reste de la demande d'alimentation électrique de Djibouti est couvert principalement par l'énergie
thermique. Les centrales électriques fonctionnelles existantes sont alimentées au fuel et au diesel
pour produire l'électricité de base. Djibouti dispose actuellement d'une capacité de production installée
de 100 MW, dont seulement 57 MW ont une disponibilité fiable. Environ 42% de la population a accès
à l'électricité.
Un meilleur accès à une énergie adéquate et abordable permettant aux ménages et l'industrie de
diminuer la consommation de bois de chauffe permettra de limiter et peut-être de diminuer la
déforestation et contribuera à la conservation du couvert végétal à Djibouti.
L'accès à une énergie abordable peut faciliter la création d'une économie verte en fournissant de
l'énergie propre pour des transports, une production industrielle et des méthodes agricoles efficaces,
avec le potentiel de réduire les émissions polluantes mondiales, régionales et locales telles que le CO,
le CO2, les PM NOX et le SOX dans l'atmosphère. Ces éléments ne sont pas rependus à Djibouti
mais l’accès à une énergie plus fiable et stable permettrait leur développement.
L'impact des émissions de gaz à effet de serre est évalué comme positif et d'une sévérité majeure
pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne : L'intensité est jugée moyenne car le projet contribuera seulement en
partie à l'accès à une énergie abordable pour contribuer à créer une économie verte en
fournissant une énergie plus propre pour des transports, une production industrielle et des
méthodes agricoles efficaces
Etendue régionale : La portée est régionale car l'impact se fera sentir au niveau national,
dans tout le pays.
Durée longue : La durée est longue car l'impact sera ressenti de manière continue pendant
les 40 ans de vie de la ligne et du poste de Nagad.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
204 204 204
Probabilité de survenance moyenne : L'impact est directement lié à la réalisation de
l'objectif du projet cependant la baisse du prix de l’électricité n’est pas une condition
obligatoire du projet
Sensibilité élevée : La sensibilité est élevée car l'électricité est un élément essentiel de la vie
des gens et de l'économie d'une nation.
6.7.10 Impacts sur la biodiversité
Activités génératrices d'impact
La phase de construction du projet comprendra tous les travaux de génie civil mandatés pour
l'établissement de la ligne de transmission et des postes, couvrant ainsi un large éventail d'activités de
construction. Les principales activités qui pourraient avoir une incidence sur la biodiversité sont les
suivantes
Le défrichement de la végétation et la modification des terres : Ceci est nécessaire pour
établir l'emprise et préparer le terrain pour la construction des fondations des pylônes, du
poste de Nagad, des routes d'accès et des camps de construction. Cela entraînera une perte
directe d'habitat et de végétation, avec un impact ultérieur sur la faune qui dépend de ces
habitats. Le défrichement de la végétation entraînera également la destruction des aires
d'alimentation, de reproduction et de perchage de la faune, en particulier des oiseaux et des
mammifères.
Les travaux de terrassement : Il s'agit principalement des excavations nécessaires à la
construction des fondations des pylônes et du poste de Nagad, mais aussi de certaines
coupes et remblais qui peuvent être nécessaires pour construire les routes d'accès. Cette
activité entraînera également la perte directe d'habitats, comme dans le cas du défrichement
de la végétation et de la modélisation des terres, et entraînera une augmentation des
émissions de poussière, avec un étouffement potentiel de la végétation dans les aires
entourant les zones de construction.
Le mouvement et fonctionnement des véhicules et des machines : Le mouvement des
véhicules et le fonctionnement des machines peuvent entraîner une dégradation
supplémentaire de la végétation. Ils sont également sources de fuites et de déversements
potentiels de contaminants sur le sol et dans l'eau, et sont aussi une source d'émissions
lumineuses et sonores, qui, associées à une présence anthropologique accrue, entraîneront
des perturbations sur la faune terrestre et pourrait provoquer le déplacement de la faune des
zones proches des chantiers. Le mouvement des machines et des véhicules augmente
également les risques de collision avec les animaux, avec un risque accru de mortalité de la
faune. L'importation potentielle de véhicules de construction, qui pourraient être contaminés
par des graines de plantes exotiques, pourrait entraîner la propagation de plantes exotiques et
la dégradation de l'habitat
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
205 205 205
La présence d'une importante main-d'œuvre dans le secteur de la construction : La
présence d'une main-d'œuvre importante dans le secteur de la construction et l'afflux potentiel
de personnes à la recherche d'un emploi peuvent entraîner une augmentation du risque
d'incendie et d'exploitation des ressources naturelles, avec des répercussions sur l'habitat et
la végétation et une augmentation de la mortalité de la faune due à la chasse.
La biodiversité menacée de la zone d'étude :
Les données et informations disponibles sur les espèces de flore et de faune présentes dans la zone
d'étude ont permis d'identifier les espèces qui peuvent objectivement être considérées comme
menacées sur la base du statut de conservation défini par la liste rouge de l'UICN.
Flore
Aucune espèce végétale de la zone d'étude n'est menacée d'extinction.
Faune
Cinq espèces de mammifères dans la zone d'étude sont considérées comme vulnérables (selon la
classification de l'UICN). Elles le sont : Gazella dorcas, Nanger soemmerringii, Dorcatragus megalotis,
Panthera pradus, Acinonyx jubatus. Le Sengi de Somalie (Elephantulus revoilii) a été redécouvert
dans la zone du projet plus de 50 ans après son dernier enregistrement. Deux reptiles endémiques
sont également présents dans la zone d'étude près du Grand Bara, à savoir le gecko à feuilles
d'Arnold (Hemidactylus arnoldi) et le gecko des sables du Nord (Tropiocolotes somalicus).
Quatre espèces d'oiseaux migrateurs de vol à voile signalées dans la zone d'étude sont classées
comme espèces menacées :
l’aigle des steppes (Aquila nipalensis)
le faucon sacré (Falco cherrug)
l’ibis chauve (Geronticus eremita)
le vautour percnoptère (Neophron percnopterus)
3 espèces d'oiseaux signalées dans la zone d'étude sont classées comme espèces vulnérables :
L’aigle criard (Aquila clanga)
L’aigle impérial (Aquila heliaca)
Le faucon concolore (Falco concolor)
6.7.10.1 Impact 10 - Perte directe d'unités de végétation et d'habitats
Quelques hectares de végétation arbustive clairsemée se trouvent dans la zone d’étude de l’emprise
du projet. L’étude de base environnementale a identifié que la zone du projet fait partie de l’écorégion
des prairies et des arbustes xériques éthiopiens. La végétation se caractérise principalement par des
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
206 206 206
herbes, des arbustes et des arbres dispersés et de faible envergure (principalement des Acacias). Les
zones pouvant supporter la croissance d'arbres de plus de 4 mètres de haut se trouvent près de
Goubetto (entre AP3 et AP4), près de Da’Asboyo (AP12 et AP13), près de Tewo et Yoboki (AP24 et
AP25). Au niveau de Goubetto, un arbre a ainsi été identifié dans la zone d’étude comme pouvant
atteindre plus de 4 mètres et au niveau de Da’Asboyo un autre arbre a également été géoréférencé
montrant des caractéristiques similaires. Au niveau de Tewo et Yoboki, il ne semble pas y avoir
d’arbres de plus de 4 mètres directement dans la zone d’étude de l’emprise du projet. Cependant on
peut trouver quelques plaques d'Hyphaene thebaica aux abords de la zone, près de petites zones
humides
Les principales formations steppiques de la zone d'étude sont caractérisées par la présence d'Acacia
mellifera, d'Acacia tortilis et de l'arbuste Rhigozum somalense.
L'Acacia mellifera est une espèce d'arbre à racines peu profondes fixant l'azote et ses feuilles riches
en protéines fournissent un pâturage utile. Cet arbre est apprécié comme bois de chauffage et pour la
fabrication de charbon de bois, car son bois est dur. Dans sa forme naturelle, il est également utilisé
pour les clôtures vivantes et il fournit également une gomme comestible. Il fleurit abondamment et est
une plante précieuse pour les abeilles, son épithète spécifique mellifera faisant référence à la
production de miel.
L'Acacia tortilis est réputé pour être un grand producteur de fourrage, ses feuilles et ses fruits étant
recherchés par tous les herbivores domestiques, en particulier les chèvres et les dromadaires.
Le Rhigozum somalense fournit des feuilles et des fruits fourragers, qui intéressent les chèvres et les
moutons. Le Rhigozum somalense fait partie de la souche endémique Somalie-Masaï et peut être
considérée comme une espèce régionale endémique à Djibouti et en Somalie. Ces espèces
endémiques régionales devraient faire l'objet d'une attention particulière de la part des écologistes et
des autorités de Djibouti. Aucune espèce végétale de la zone d'étude n'est menacée d'extinction.Cinq
espèces de mammifères dans la zone d'étude sont considérées comme vulnérables (selon la
classification de l'UICN). Elles le sont : Gazella dorcas, Nanger soemmerringii, Dorcatragus megalotis,
Panthera pradus, Acinonyx jubatus. Deux reptiles endémiques sont également présents dans la zone
d'étude proche du Grand Bara, à savoir le gecko à feuilles d'Arnold (Hemidactylus arnoldi) et le gecko
des sables du Nord (Tropiocolotes somalicus). Le Sengi de Somalie (Elephantulus revoilii) a été
redécouvert dans la zone du projet plus de 50 ans après son dernier enregistrement.
La sensibilité de toutes les autres ressources de la biodiversité terrestre (à l'exception des oiseaux et
des chauves-souris) dans la zone d'influence du projet est évaluée comme étant faible par les études
de base.
Compte tenu de la présence de quelques espèces vulnérables et du fait que les habitats et la majorité
des espèces présentes sur le site sont communs et répandus dans tout Djibouti, la sensibilité des
récepteurs peut être considérée comme moyenne.
L'impact sur la perte directe d'unités de végétation et d'habitats est évalué comme négatif et d'une
sévérité modérée pour les raisons suivantes :
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
207 207 207
Intensité élevée : L'intensité est jugée élevée car la végétation sous la zone des postes et de
l'emprise sera supprimée.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact ne sera ressenti qu'à l'intérieur de la zone
des postes et de l'emprise.
Durée longue : La durée est longue car l'impact se fera sentir tout au long des phases de
construction et d'exploitation.
Probabilité d'occurrence élevée : L'impact est directement lié aux activités du projet, à la
fois pendant les phases de construction et d'exploitation.
Sensibilité faible : La sensibilité est faible car le corridor présente peu de végétation et la
présence de quelques espèces vulnérables sur le site est commune et répandue dans tout
Djibouti.
6.7.10.2 Impact 11 - Exclusion d'espèces de faune en raison de l'augmentation des perturbations
Toutes les activités de construction entraîneront une augmentation du bruit, des mouvements et des
perturbations en général. Il en résultera une perturbation des espèces animales et, par conséquent,
une exclusion potentielle de la faune autour de la zone d'étude. Cela peut également entraîner
l'abandon des sites de perchage pour les oiseaux et des lieux de rassemblement.
Cet impact ne sera pertinent que pendant la phase de construction car les espèces de faune
conduisant à l'exclusion en raison de l'augmentation des perturbations pendant la phase d'exploitation
peuvent être considérées comme négligeables.
Compte tenu de ce qui précède, cet impact sur l'exclusion d'espèces animales due à l'augmentation
des perturbations est jugé négatif et d'une sévérité mineure pendant la phase de construction pour les
raisons suivantes :
Intensité moyenne : l'intensité est jugée moyenne car l'impact entraînera des changements
limités dans l'environnement compte tenu des espèces potentiellement présentes.
Etendue locale : La portée est locale car l'impact ne sera ressenti que dans la zone du projet.
Durée courte : La durée est courte, car l'impact ne sera limité que pendant la phase de
construction et comme les perturbations prendront fin après la construction et que la faune
aura tendance à revenir dans ces zones.
Probabilité d'occurrence élevée : L'impact est directement lié aux activités du projet, tant
pendant la phase de construction que pendant la phase d'exploitation.
Sensibilité moyenne : La sensibilité est moyenne car la présence de quelques espèces
vulnérables sur le site est commune et répandue dans tout Djibouti et l'impact serait donc au
mieux moyen.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
208 208 208
6.7.10.3 Impact 12 - Augmentation de la mortalité des espèces de faune due aux
mouvements de véhicules et aux activités de construction
L'augmentation du trafic automobile, en particulier pendant la phase de construction du projet et, dans
une mesure limitée, pendant la phase d'exploitation du projet, entraînera une probabilité accrue
d'augmentation de la mortalité de la faune, en particulier de la faune lente ou cryptique le long des
routes.
Compte tenu des mouvements de véhicules et des activités de construction, l'impact sur la mortalité
accrue de la faune est évalué comme négatif et d'une sévérité négligeable pendant la phase de
construction et d'exploitation pour les raisons suivantes :
Intensité faible : l'intensité est évaluée comme faible car l'impact sur la mortalité de la faune
due à l'augmentation des mouvements de véhicules et des activités de construction sera
limité. En outre, la répartition des espèces est principalement uniforme dans tout le pays.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact ne sera ressenti que dans la zone du projet.
Durée courte : La durée est courte car l'impact ne sera limité que pendant la phase de
construction et la circulation des équipements de maintenance pendant la phase
d'exploitation.
Probabilité d'occurrence forte : L'impact est directement lié aux activités du projet,
principalement pendant la phase de construction.
Sensibilité moyenne : La sensibilité est moyenne car la présence de quelques espèces
vulnérables sur le site est commune et répandue dans tout Djibouti. Par conséquent, la
sensibilité de l'impact serait au mieux moyenne.
6.7.10.4 Impact 13 - Fuites / déversements accidentels entraînant la dégradation de l'habitat
Il existe des possibilités de fuites d'huile, de lubrifiants et d'autres matériaux de ce type pendant la
phase de construction. Les véhicules qui amèneront les matériaux de construction, les ouvriers, etc.
sur le site, utiliseront du carburant. De même, des produits comme les peintures et les vernis seront
utilisés pendant les phases de construction et de finition. Ces fuites, bien que limitées à de petites
zones, contamineront l'écosystème et pourraient également avoir un impact secondaire sur la
biodiversité résidente.
Cet impact serait plus prononcé pendant la phase de construction et probablement négligeable
pendant la phase d'exploitation. Par conséquent, l'impact d'une fuite ou d'un déversement accidentel
sur les habitats naturels est évalué comme étant d'une sévérité négligeable pendant la phase de
construction pour les raisons suivantes :
Intensité faible : L'intensité est jugée faible car, si une fuite devait se produire, elle serait
limitée à une zone définie. En outre, compte tenu du projet, peu de quantités de pétrole, de
lubrifiants ou de peintures devraient être stockées.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
209 209 209
Etendue locale : l’étendue est locale, car l'impact ne se fera sentir que dans la zone du
projet.
Durée courte : La durée est courte, car l'impact ne sera que limité dans le temps.
Probabilité d’occurrence élevée : L'impact est directement lié aux activités du projet,
principalement pendant la phase de construction.
Sensibilité faible : La sensibilité devrait être faible.
6.7.10.5 Impact 14 - Augmentation de la mortalité des oiseaux migrateurs planneurs par
électrocution et collision
La voie de migration de la vallée du Rift et de la mer Rouge, qui longe l'Afrique de l'Est et le Moyen-
Orient, est la deuxième plus importante voie de migration au monde pour les oiseaux migrateurs
planeurs tels que les rapaces, les cigognes, les pélicans et les ibis. Plus de 1,5 million d’oiseaux
migrateurs planeurs appartenant à 37 espèces, dont cinq sont menacées au niveau mondial,
empruntent chaque année ce corridor entre leurs zones de reproduction en Europe et en Asie
occidentale et leurs zones d'hivernage en Afrique (BirdLife International, 2015). L'itinéraire de
migration traverse onze pays : Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Jordanie, Liban, Palestine, Arabie
saoudite, Soudan, Syrie et Yémen.
Djibouti est une région riche sur le plan ornithologique, mais la recherche sur les oiseaux est limitée.
Cependant, malgré le nombre relativement faible de visites d'ornithologues et d'ornithologues
amateurs, la petite taille du pays (23 180 km2) et un climat tropical désertique et semi-désertique très
rude, Djibouti possède une liste de 364 espèces74, dont 12 espèces globalement menacées, quatre
d'entre elles étant en danger critique d'extinction, trois en danger et cinq vulnérables75.
L'impressionnante diversité des oiseaux que l'on trouve à Djibouti est en partie due à sa localisation à
l'extrémité nord de la vallée du Rift africain et à la jonction des voies de migration d'Afrique de l'Est et
de la mer Rouge76. Plus d'un tiers des espèces d'oiseaux identifiées à Djibouti sont des migrants77.
Le réseau de lignes de transmission électrique existant à travers la vallée du Rift / la voie de migration
de la mer Rouge doit être étendu pour répondre aux besoins en énergie abordable et à la croissance
des ressources énergétiques renouvelables et conventionnelles dans la région. Cette expansion
nécessite la construction de nouvelles lignes électriques et la modernisation des réseaux de
transmission existants. Des lignes de transmission mal acheminées et mal situées et une mauvaise
conception peuvent avoir des répercussions importantes sur les oiseaux migrateurs en plein essor.
Les principales menaces sont les collisions et l'électrocution, bien que la perte et la perturbation de
74 www.africanbirdclub.org/countries/Djibouti/species
75 BirdLife International, 2018
76 PNUD 2006
77 Welch & Welch 1999 ; Buechley et al, 2017
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
210 210 210
l'habitat puissent également constituer un problème. Le nombre exact d'oiseaux tués par collision ou
électrocution est difficile à estimer, bien qu'on estime que jusqu'à 10 000 électrocutions et plusieurs
centaines de milliers de collisions se produisent chaque année dans la région Afrique-Eurasie78.
Il existe des cas documentés de mortalité importante le long de la vallée du Rift et de la voie de
migration de la mer Rouge79. La fréquence des collisions est considérée comme un facteur
contribuant au déclin continu de la population de plusieurs espèces de grues, d'outardes et de
rapaces diurnes. Les interactions des oiseaux avec les lignes électriques peuvent également entraîner
des pertes économiques et une réduction de la disponibilité de l'électricité. Au niveau des
consommateurs, les collisions avec les oiseaux et leur comportement de perchage peuvent provoquer
des pannes de courant et nécessiter des réparations coûteuses. Minimiser les risques de collision et
d'électrocution des oiseaux est donc une solution gagnante pour la biodiversité et le secteur de
l'électricité.
La zone d'étude se trouve dans le corridor de migration des oiseaux, qui accueille une activité
importante au printemps et à l'automne lorsque la population aviaire en migration se déplace des aires
de reproduction vers les aires d'hivernage.
La zone d'étude :
Se situe à proximité d'un site important pour les oiseaux migrateurs - «Ali Sabieh Assamo»
(« Important Bird Area (IBA) »),
Se situe à proximité de deux aires protégées terrestres - Djalelo et Assamo, qui sont des sites
importants de biodiversité, y compris pour l'avifaune migratrice,
Est traversée par de nombreux vols d’oiseaux migrateurs qui ont été suivis par
satellite; surtout entre Djalelo et Dikhil et près de Yoboki
Traverse deux zones potentiellement importantes pour la conservation des oiseaux à Djibouti
(ZICO) - Hanle Gamarre et Ougul Kabah Kabah
Pendant la phase de construction, les activités qui peuvent avoir un impact significatif sur les
oiseaux comprennent : le défrichage de la végétation pour la pose de la ligne de transport d'électricité,
la construction des routes d'accès, du transformateur, du poste de Nagad et les aires de
dépôt. L'activité de construction et le bruit liés à ces activités auront un impact sur la population
aviaire.
Pendant la phase d'exploitation, une fois les pylônes installés et les lignes de transport en place, ces
structures permanentes (pylônes et lignes électriques) auront un impact sur la population aviaire
locale mais relativement plus sur les oiseaux migrateurs car le projet se situe sur la voie de migration
78 Prinsen et al. 2011
79 Angelov et al. 2011, Shobrak 2012
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
211 211 211
entre la Vallée du Rift et la Mer Rouge. L'activité d'entretien régulier consistant à enlever la végétation
dans la zone du site aura également un certain impact.
Dans les phases de construction et d'exploitation, les activités liées à la présence de la main-
d'œuvre de construction auront un impact sur la population aviaire.
Les impacts directs sur les oiseaux sont principalement associés aux lignes moyenne et haute
tension:
Les lignes électriques ou de transmission à haute tension (60 kV à 700 kV) forment l'épine
dorsale de nombreux réseaux nationaux. La conception de lignes électriques à haute tension
le long d'un plan vertical (vers le haut) avec des câbles de faible visibilité est associée à des
risques de collision, en particulier dans des conditions météorologiques défavorables. Un
risque de collision plus élevé est associé au fil de terre (blindage) fin, qui se trouve au-dessus
du fil conducteur haute tension plus épais. Comme ceux-ci sont généralement connectés à
des pylônes avec de longs isolateurs suspendus, le risque d'électrocution sur les lignes
électriques à haute tension est généralement faible.
Les lignes électriques à moyenne et basse tension ou les lignes de distribution (~ 1 kV à 60
kV) sont plus susceptibles de provoquer une électrocution, lorsque les oiseaux finissent par
établir une connexion entre deux composants sous tension. Ce risque d'électrocution est le
plus associé aux poteaux et aux zones perchées. Il existe également un risque de collision,
mais relativement moindre par rapport aux lignes électriques haute tension, car les
conducteurs sont disposés à la même hauteur et, par rapport aux lignes électriques haute
tension, situé à proximité du sol.
Les oiseaux, et en particulier les oiseaux migrateurs planneurs, sont connus pour être
sensibles aux électrocutions et aux collisions avec les lignes de transmission aériennes. La
majorité des collisions se produisent par mauvais temps et avec le fil supérieur qui est plus fin
et plus difficile à voir pour les oiseaux. Les grandes espèces d'oiseaux perchés, comme les
rapaces, sont plus sensibles à l'électrocution, car leur plus grande envergure signifie qu'ils
sont plus susceptibles de créer un court-circuit entre un câble sous tension et un autre
composant, ce qui entraîne l'électrocution.
L'impact sur l'augmentation de la mortalité des oiseaux migrateurs en vol plané due à l'électrocution et
aux collisions en raison de la présence d'une ligne de transmission aérienne est évalué comme
négatif avec une sévérité élevée pour les raisons suivantes :
Intensité forte : L'intensité est considérée comme forte car la ligne de transmission se situe
sur la voie de migration des oiseaux impactant leurs habitats mais aussi créant un risque de
collision et d’électrification.
Etendue régionale : l’étendue est régionale car l'impact doit être pris en compte tout au long
de la zone du projet qui traverse la voie de migration des oiseaux volants et particulièrement
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
212 212 212
près des points importants pour les oiseaux près des sites d'Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki,
Hanle Gamarre et Ougul Kabah Kabah ;
Durée longue : La durée est longue car le risque d'électrocution et de collision sera présent
pendant toute la durée du projet.
Probabilité d'occurrence forte : La collision ou l'électrocution peut se produire
quotidiennement pendant la saison de migration (automne et printemps) lorsque les oiseaux
se perchent sur la ligne de transmission ou entrent en collision avec elle.
Sensibilité élevée : La sensibilité est jugée élevée car la zone du projet est située à l'intérieur
de la voie de migration des oiseaux planeurs (qui est la deuxième voie de migration des
oiseaux migrateurs au monde) et plusieurs zones importantes pour les oiseaux sont situées à
proximité de la zone du projet, comme les sites d'Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle
Gamarre et Ougul Kabah Kabah.
6.7.10.6 Impact 15 - Défrichement de la végétation entraînant la perte d'habitats et d'espèces
Pendant la construction, la végétation sous le site du projet proposé sera défrichée. Cela entraînera
une perte d'habitat de soutien pour les espèces d'oiseaux résidentes.
De nombreuses espèces d'oiseaux nichant au sol seront affectées par la perte et la perturbation de
l'habitat pendant la construction. Cela entraînera une réduction du nombre d'individus occupant la
zone, mais à part une petite réduction due à la perte permanente d'habitat, les effectifs se rétabliront à
des niveaux proches des niveaux de base après l'achèvement des travaux de construction.
L'impact du défrichement de la végétation pendant la phase de construction est évalué comme négatif
et d'une sévérité mineure pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne : L'intensité est considérée comme moyenne car l'impact n'entraînera
qu'un changement limité.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact sera limité à des zones restreintes.
Durée courte : La durée est courte car le défrichement de la végétation sera limité pendant la
phase de construction.
Probabilité d'occurrence élevée : La probabilité d'occurrence est élevée, car le déblaiement
de la végétation est une activité obligatoire. La perte de végétation entraînera à terme la perte
d'habitats et d'espèces, mais à court terme.
Sensibilité moyenne : La sensibilité des récepteurs est moyenne pour la population aviaire
locale, car la zone d'influence du projet abrite plusieurs espèces d'oiseaux résidentes qui sont
importantes au niveau national, bien qu'il existe de grandes zones d'habitat similaire dans les
environs qui peuvent abriter des espèces d'oiseaux similaires et qui peuvent être utilisées par
les oiseaux déplacés du site du projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
213 213 213
6.7.10.7 Impact 16 - Activité et bruit entraînant une perturbation des espèces
Pendant la phase de construction, la présence de main-d'œuvre et de véhicules, des niveaux de bruit
élevés, la formation de poussière pourraient entraîner une perturbation temporaire de la population
d'oiseaux et de mammifères résidente autour du site du projet, ce qui pourrait entraîner la perte
d'habitats d'alimentation ou de nidification.
Le bruit ambiant a un impact sur la population aviaire résidente en la déplaçant de ses habitats par la
perturbation et l'interférence de ses vocalisations. Cela peut perturber leur saison de reproduction,
lorsque les oiseaux sont les plus bruyants. Il est peu probable qu'il ait un impact à long terme sur
l'assemblage de reproduction une fois la construction terminée. Les oiseaux migrateurs passant sur le
site seront probablement moins affectés que les oiseaux résidents.
L'impact de l'activité et du bruit pendant la phase de construction est évalué comme négatif et d'une
sévérité modérée pour les raisons suivantes :
Intensité forte : L'intensité est jugée forte car toutes les activités de construction
entraîneront une augmentation significative du bruit et des perturbations en général.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact sera limité à des zones restreintes.
Durée courte : La durée est courte car l'activité et le bruit entraînant une perturbation des
espèces seraient plus prononcés pendant la phase de construction.
Probabilité d'occurrence élevée : La probabilité d'occurrence est élevée car pendant la
phase de construction, une activité et un bruit accrus seraient inévitables.
Sensibilité moyenne : La sensibilité des récepteurs est moyenne pour la population aviaire
locale car la zone d'influence du projet abrite plusieurs espèces d'oiseaux résidentes qui sont
importantes au niveau national. Il existe cependant de grandes zones d'habitat similaire dans
les environs qui peuvent abriter des espèces d'oiseaux similaires et qui peuvent être utilisées
par les oiseaux déplacés du site du projet.
6.7.11 Impact 17 - Menace de l'intégrité d'une zone protégée terrestre traversée par la
ligne électrique
Dans un premier temps, la ligne de transport d'électricité proposée devait traverser la zone protégée
de Djalélo. La zone protégée de Djalélo a été officiellement créée par un décret national de la
Présidence de la République de Djibouti en 2011 (Décret N° 2011-0236/PR/MHUE portant création de
deux aires protégées terrestres.) Ce statut juridique vise à limiter la destruction de l'habitat naturel des
espèces endémiques, à préserver leur espace de vie et à permettre aux espèces de se multiplier à
l'abri des effets des activités humaines perturbatrices (chasse, déforestation, affaiblissement de la
biodiversité environnante).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE
L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
214 214 214
Le paragraphe 17 du critère de performance 6 de la SFI indique "dans les zones d'habitat essentiel, le
client ne mettra en œuvre aucune activité du projet à moins que tous les éléments suivants ne soient
démontrés" :
Il n'existe aucune autre alternative viable dans la région pour le développement du projet sur
des habitats modifiés ou naturels qui ne sont pas critiques ;
Le projet n'entraîne pas d'impacts négatifs mesurables sur les valeurs de biodiversité pour
lesquelles l'habitat essentiel a été désigné, et sur les processus écologiques qui soutiennent
ces valeurs de biodiversité ;
Le projet n'entraîne pas de réduction nette de la population mondiale et/ou nationale/régionale
d'une espèce en danger critique d'extinction ou en voie de disparition sur une période de
temps raisonnable ; et
Un programme de suivi et d'évaluation de la biodiversité robuste, bien conçu et à long terme
est intégré au programme de gestion du client".
La NES 6 de la BM n'implique donc pas nécessairement d'éviter qu'un projet soit développé dans une
aire protégée. Toutefois, considérant le contexte de Djibouti caractérisé par un nombre réduit d'aires
protégées terrestres au niveau national (seulement deux aires protégées terrestres officielles : Djalélo
et Assamo), la faible proportion du territoire national couverte par des aires protégées (seulement 1,
57 % du territoire national pour Djibouti ce qui est très inférieur aux objectifs de 17% de l'Objectif 11
d'Aichi de la Convention Internationale sur la Diversité Biologique) et le fait que le tracé du projet
n'affecte que le coin sud-est de l'aire protégée, il a été décidé que le tracé soit légèrement décalé
vers le sud-est pour contourner et éviter de traverser l'aire protégée de Djalelo.
Sans la modification du tracé, l'impact du projet sur l'intégrité de la zone terrestre protégée de Djalelo
aurait été évalué comme négatif et d'une sévérité majeure pour les raisons suivantes :
Intensité moyenne : L'intensité est considérée comme moyenne car l'impact n'entraînera
qu'un changement limité.
Etendue locale : l’étendue est locale car l'impact sera limité à des zones restreintes.
Durée longue : La durée est longue car les pylônes et la ligne électrique resteront en place
pendant une longue période.
Probabilité d'occurrence élevée : La probabilité d'occurrence est élevée car la localisation
du projet proposé traverse effectivement la zone protégée de Djalelo.
Sensibilité élevée : La sensibilité des récepteurs est considérée comme élevée car Djalelo
est l'une des deux seules zones terrestres protégées classées par la législation nationale à
Djibouti.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
215 215
6.8 Tableau synthèse de l’évaluation des impacts environnementaux
Description de l'impact Stade du
projet
Analyse de l’impact Importance
de l’impact
Sensibilité
du
récepteur
Sévérité de
l’impact Intensité Etendue Durée Probabilité
IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
Impact 1 – Dégradation de la qualité de l'air Construction Elevée Locale Courte Elevée Moyenne Faible
Négative
Mineure
Opération Faible Locale Courte Elevée Négligeable Faible Négligeable
Impact 2 – Emission de bruit et de nuisance sonore Construction Elevée Locale Courte Elevée Moyenne Faible
Négative
Mineure
Opération Faible Locale Courte Elevée Négligeable Faible Négligeable
IMPACT SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS
Impact 3 – Impact sur la géologie et la géomorphologie Construction Moyenne Locale Longue Elevée Moyenne Faible Négative
Mineure
Impact 4 - Changements dans les processus de
sédimentation Construction Elevée Locale Courte Elevée Moyenne Faible
Négative
Mineure
Impact 5 - Augmentation de l'érosion et du compactage des
sols
Construction Elevée Locale Moyenne Elevée Elevée Faible Négative
Moyenne
Opération Moyenne Locale Moyenne Elevée Moyenne Faible Négative
Mineure
Impact 6 – Contamination des sols
Construction Moyenne Locale Moyenne Faible Moyenne Faible Négative
Mineure
Opération Moyenne Locale Moyenne Faible Moyenne Faible Négative
Mineure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
216 216
IMPACT SUR LE PAYSAGE ET IMPACT VISUEL
Impact 7 - Changement du paysage et impacts visuels
Construction Elevée Locale Courte Elevée Moyenne Faible Négative
Mineure
Opération Elevée Locale Longue Elevée Elevée Elevée Négative
Modérée
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
Impact 10 - Perte directe d'unités de végétation et d'habitats Construction
Elevée Locale Longue Elevée Elevée Faible Négative
modéré Opération
Impact 11 - Exclusion d'espèces de faune en raison de
l'augmentation des perturbations Construction Moyenne Locale Courte Elevée Faible Moyenne
Négative
Mineure
Impact 14 - Augmentation de la mortalité des oiseaux
migrateurs planneurs par électrocution et collision
Construction Moyenne Régionale Longue Elevée Elevée Elevée
Négative
Majeure Opération
Impact 15 - Défrichement de la végétation entraînant la
perte d'habitats et d'espèces
Construction Moyenne Locale Courte Elevée Faible Moyenne
Négative
Mineure Opération
Impact 16 - Activité et bruit entraînant une perturbation des
espèces Construction Moyenne Locale Courte Elevée Faible Moyenne
Négative
Mineure
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
217
7 Plan de gestion environnemental et social
Les sections précédentes de l’étude d’impact environnemental et social ont permis dans un premier temps
de caractériser le milieu dans lequel le projet doit être implanté et de décrire le projet. Dans un deuxième
temps, les impacts potentiels du projet, aussi bien positifs que négatifs ont été identifiés et leur sévérité
déterminée en fonction de l’importance des effets de l’impact et de la sensibilité du récepteur.
Cette section a pour objectif de proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’amélioration
des impacts positifs et de structurer les réponses du projet face à ces impacts au sein d’un Plan de gestion
Environnementale et Sociale (PGES). Le développement d’un PGES est nécessaire pour les études
d’impact détaillées en République de Djibouti. C’est également une exigence du Cadre Environnemental et
Social de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement.
Le PGES est un plan spécifique au projet, au site et au moment, élaboré pour garantir que le projet est mis
en œuvre d'une manière durable sur le plan environnemental et social, dans lequel tous les entreprise
contractantes et sous-traitants comprennent les risques environnementaux et sociaux potentiels découlant
du projet proposé et prennent les mesures appropriées pour gérer ce risque de manière adéquate. Le plan
et sa compréhension seront suivis par l’Expert Environnemental et Social de l’EDD.
Ce PGES sera mis à la disposition des entreprise contractantes qualifiés qui feront une offre pour la
construction du projet. Cela permettra de s'assurer que les coûts environnementaux et sociaux sont pris en
compte dans leur calcul. L'entreprise contractante retenu devra proposer son propre PGES et ses propres
méthodes de travail qui garantiront une construction sûre du projet en assurant la conformité aux normes
nationales et internationales applicables.
Le PGES comprendra les points suivants :
La présentation des impacts et de leurs mesures d’atténuation ou d’amélioration pour chaque phase
du projet
Une proposition de structuration générale des actions à mettre en œuvre pour les atténuations
La description des mesures opérationnelles pour la mise en œuvre du PGES et une estimation
budgétaire.
7.1 Structuration des mesures d’atténuation
Concernant les aspects sociaux, les Plans d’Action suivants sont nécessaires pour articuler les mesures
d’atténuation :
Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) : Il doit permettre dès la phase d’étude de
structurer les messages à l’attention des partenaires et autres acteurs de la zone, en vue d’une
intégration du projet. Le plan doit en particulier aborder les enjeux d’information et consultation de la
population locale en ce qui concerne les impacts sur l’utilisation des terres et les impacts sur la
santé et sécurité des communautés. Le PMPP est présenté en annexe de l’EIES comme un
document indépendant.
Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) : Il a pour objectif de traiter tous les impacts liés aux
restrictions d’usage et aux acquisitions temporaires et permanentes de terres. Un nombre restreint
de personnes pourrait ainsi être affecté par un déplacement économique à cause de dégradation
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
218
d’enclos ou d’arbres et de déplacement de tombes du fait de l’acquisition temporaire ou permanente
de terres. Toutes les acquisitions de terres se feront à l’intérieur de la zone d’étude de l’emprise du
projet mais seule une faible proportion de cette zone subira des acquisitions : à ce stade du projet,
les emplacements exacts des acquisitions ne sont pas définis car ils devront être proposés par le
constructeur après une dernière visite de terrain. C’est pourquoi il est proposé de formuler un Cadre
de Politique de Réinstallation et non un Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Le CPR apportera les
grands principes à suivre lors de la formulation postérieure du PAR, et présente un système de
gestion des plaintes pour les communautés locales. Il est présenté en annexe de l’EIES comme un
document indépendant.
Manuel de gestion de la main-d’œuvre (MGM) : Le manuel présente les politiques et procédures
de gestion de la main-d’œuvre et propose un mécanisme de gestion des plaintes. Il doit en
particulier définir une politique de recrutement avec des critères de sélection clairs et transparents et
facilitant le recrutement des femmes. Il doit également présenter les exigences en termes de santé
et sécurité pour atténuer les expositions des travailleurs à des risques physiques et chimiques. Il
définit un code de conduite pour prévenir les incidents d’abus et d’exploitation sexuelle et interdire
toute relation avec des mineurs. Il peut considérer l’opportunité de former et de fidéliser une main-
d’œuvre de qualité de la zone du projet. Le MGM est présenté en annexe de l’EIES comme un
document indépendant.
Plan d’action contre les violences basées sur le genre (PA-VBG) : Ce plan d’action permet
d’apporter des stratégies d’atténuation vis-à-vis de l’augmentation possible des comportements
inappropriés, des VBG et des maladies sexuellement transmissibles, du fait de l’afflux de travailleurs
extérieurs dans des zones rurales et isolées. Le PA-VBG est présenté en annexe de l’EIES comme
un document indépendant.
Cahier des clauses environnementales et sociales : Il est élaboré par l’EDD et est présenté en
annexe de cette EIES comme document indépendant. Il détermine les lignes directrices et
spécifications techniques devant être suivies par la maitrise d’œuvre technique (l’entreprise
contractante en charge de la construction) en ce qui concerne les aspects sociaux :
o Maintenir le corridor de sécurité de la ligne de 40 m de large dans la zone d’étude de
l’emprise de 100 mètres de large.
o Minimiser et respecter les zones d’acquisition temporaires et permanentes en essayant d’éviter
les enclos, les tombes et les arbres.
o N’endommager aucun bien (arbre, enclos, tombe) durant le câblage ou s’engager à réhabiliter
les biens endommagés.
o Suivre les exigences de santé et sécurité au travail de la législation djiboutienne, de la BM et de
la BAD en incluant la fourniture d’équipement adéquat et gratuit aux travailleurs et en équipant
les pylônes de dispositifs anti-escalade et de panneaux d’avertissement.
o Proposer un plan de gestion et de fermeture des campements de travailleurs assurant des
conditions de logement conformes aux normes internationales (eau potable gratuite, toilettes,
cantine, zone de repos, etc.) et des installations sanitaires et des systèmes d’eau potable et de
gestion des déchets indépendants des services locaux existants.
o Proposer un plan de gestion du trafic qui prévoit la formation des conducteurs, la sécurité des
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
219
véhicules, la planification des itinéraires et la coordination avec les autorités, si besoin.
o S’assurer que les sous-traitants respectent les points précédents.
Concernant les aspects environnementaux, les Plans d’Action suivants sont nécessaires pour articuler les
mesures d’atténuation :
Plan de gestion des déchets : il fournira les lignes directrices à l'équipe du projet, aux entreprise
contractantes et aux sous-traitants pour gérer efficacement les déchets (solides, liquides et
dangereux), les débris et les matériaux générés (chutes) par les activités de construction et les
installations auxiliaires telles que les camps de travailleurs. Le plan de gestion des déchets du projet
doit planifier la séparation de tous les flux de déchets par type ou catégorie afin d'éviter des effets
combinés potentiellement indésirables et de faciliter la réutilisation, le recyclage, la récupération
et/ou l'élimination de ces déchets. Toutes les catégories de déchets doivent être évaluées et les
principes suivants doivent être appliqués :
o Réduction : La réduction de la consommation des matières premières est la première étape
pour réduire la production de déchets. Pour mettre ce principe en pratique, tous les
processus et matériaux utilisés seront évalués sur la base d'une éventuelle réduction de
l'utilisation des matières premières ;
o Réutilisation des matériaux, via d'autres activités et/ou par d'autres parties prenantes ;
o Recyclage : Le recyclage est la prochaine option envisagée pour une gestion réussie des
flux de déchets ;
o Récupération : La récupération des matières réutilisables ou l'énergie en tant que sous-
produit fait partie du processus de réduction des déchets ;
o Elimination des déchets : Cette dernière option est appliquée lorsque les principes
précédemment décrits ne sont plus applicables ou pratiques. Dans la mesure du possible, le
tri sera effectué à la source et les déchets triés seront stockés dans un lieu dédié (poubelle,
bennes à ordures) du site.
Les déchets à éliminer devront être transportés vers des installations de gestion des déchets appropriées
afin d'éviter leur dispersion le long de la zone du projet et dans la nature.
Plan de prévention de la pollution : L'objectif du plan de prévention de la pollution est de traiter les
impacts des activités liées au projet sur la qualité de l'air et d'éviter la contamination de
l'environnement. Il suggère d'appliquer des mesures de contrôle nécessaires pour prévenir ou
réduire la pollution. Le plan de prévention de la pollution doit être basé sur les mesures d'atténuation
suivantes :
o Les émissions de poussières provenant de diverses activités telles que l'excavation, le
transport de matériaux (chargement et déchargement) et le déplacement de véhicules (sur
des routes non pavées) peuvent être réduites au minimum grâce aux à l’exécution des
bonnes pratiques standards des chantiers de construction,
o Il y aura des émissions de poussière et d'échappement dues au déplacement des véhicules
d'entretien, qui seront minimisées grâce aux limites de vitesse imposées sur le site, c'est-à-
dire ne pas dépasser les 40 km/heure sur les routes poussiéreuses ou 20 km/heure sur les
zones non consolidées,
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
220
o Les émissions des véhicules seront contrôlées grâce à un entretien approprié des véhicules,
o Si une fuite se produit, un kit d'urgence et une procédure doivent être utilisés pour réduire
immédiatement la propagation du polluant,
o Interdire le rejet de tout type d'eau résiduelle non traitée dans le sol et/ou les ressources en
eau (masses d'eau saisonnières, aquifères, etc.),
o Interdire le déversement de tout type d'eau résiduelle non traitée dans le sol et/ou les
ressources en eau (plans d'eau saisonniers, aquifères, etc.),
o Limiter autant que possible l'éclairage du chantier en dehors des heures normales de travail
au minimum requis pour la sûreté et la sécurité ;
o Maintenir le site et son enceinte en ordre.
Plan de gestion des sols : Le plan de gestion des sols traite des impacts sur la géologie, la
géomorphologie, les processus géologiques et le paysage. La mise en œuvre du plan de gestion
des sols vise à réduire tous les impacts négatifs sur l'environnement et doit être composée des
mesures d'atténuation suivantes :
o Limiter et restreindre le défrichement de la végétation et le raclement de la terre aux zones
strictement nécessaires à la construction,
o Stocker la terre végétale avant les activités de terrassement pour la réutiliser plus tard dans
des travaux de réhabilitation,
o Protéger les sols stockés temporairement,
o Réduire au minimum l'exposition du sol pendant les périodes de fortes pluies lors des
excavations et des activités de terrassement,
o Respecter les routes existantes, si possible, pour minimiser les impacts sur les sols intacts,
o Prioriser l'utilisation des chemins existants pour accéder aux sites de travail,
o Veiller à ce que toutes les lignes électriques ainsi que les zones de construction des postes
fassent l'objet d'un examen adéquat et approfondi par des ingénieurs géotechniciens et des
géologues afin de détecter de potentiels sols expansibles/affaissés et des zones
potentiellement instables avant la construction,
o Éviter la construction de pylônes dans les plaines et les zones où le terrain est en pente afin
de réduire les risques d'érosion du sol par la pluie et le vent.
Plan de gestion de la biodiversité : Le plan de gestion de la biodiversité vise à proposer diverses
options pour protéger les espèces et la valeur de l'habitat de la zone du projet :
o Limiter strictement le défrichement de la végétation aux zones requises, en particulier dans
les zones d'habitats naturels,
o Dans la mesure du possible, mettre les arbres coupés à la disposition des communautés
locales pour qu'elles les ramassent et les réutilisent comme matériaux de construction ou à
d'autres fins,
o Éviter de situer les camps de construction près des habitats naturels,
o Éviter d'installer des pylônes et des routes d'accès dans les oueds,
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
221
o Réhabiliter et revégétaliser les routes d'accès temporaires et les zones de travail dans la
mesure du possible,
o Le tracé de la ligne de transmission chevauche la zone du projet de la Grande Muraille
Verte. La perte de couverture végétale peut être compensée par la plantation d'arbres
locaux dans le cadre d'initiatives d'agroforesterie et de reboisement en partenariat avec le
projet de la Grande Muraille Verte,
o Les activités de défrichement seront accompagnées par un spécialiste en écologie/biologie
pour détecter tout site important de perchage et/ou de reproduction à proximité des zones
de défrichement et mettre en œuvre des mesures de précaution,
o Lorsque cela est possible, éviter les travaux durant la nuit,
o Minimiser au maximum l'éclairage dans les camps de construction,
o Des restrictions de vitesse sur les sites seront mises en place et devront être respectées,
o Entreprendre une formation de sensibilisation des conducteurs sur les espèces présentes
dans la zone qui peuvent être percutées par des véhicules,
o Mettre en place un système d'exploitation forestière exigeant aux travailleurs ainsi qu'aux
conducteurs de véhicule qu'ils signalent tout incident ou collision avec des espèces
animales. Cela permettra d'identifier et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation
supplémentaires si nécessaire (par exemple, utilisation de brise-vitesse près des zones
identifiées comme à haut risque, clôtures, réflecteurs de lumière),
o Vérifier les zones de construction chaque matin afin de détecter les reptiles, en particulier les
serpents, qui auraient pu pénétrer dans les zones de construction, les tranchées, etc.
pendant la nuit,
o Éviter, dans la mesure du possible, les dynamitages et les martèlements de pierres pendant
la saison de reproduction,
o Modifier légèrement la localisation de la ligne électrique pour éviter de traverser la zone
protégée de Djalelo en déplaçant un pylône dans la direction sud-est afin de s'assurer que
la ligne électrique ne traversera pas la zone protégée et respectera une zone tampon de 1
km de distance.
Mesures d'atténuation des risques concernant les d'oiseaux migrateurs : Des mesures
d'atténuation spécifiques devraient être mises en œuvre pour traiter les impacts négatifs potentiels
du projet sur les oiseaux migrateurs principalement dans les sections des projets situées à proximité
des zones sensibles aux oiseaux (Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul Kabah
Kabah) :
Réduire les risques de collision :
o Utiliser des déflecteurs d'oiseaux dans les zones à fort impact, en particulier le long des
voies de migration. Ces déflecteurs devraient augmenter la visibilité de la ligne en
épaississant l'apparence de la ligne d'au moins 20 cm sur une longueur de 10 à 20cm;
o Des marqueurs doivent être mobiles, de couleurs alternées (par exemple noir et blanc),
contraster avec le paysage, dépasser au-dessus et en dessous de la ligne et être placés à
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
222
5-10 m l'un de l'autre ;
o Enlever le mince fil neutre ou de terre (blindage) au-dessus des lignes de transmission à
haute tension lorsque cela est possible, et lorsque cela n'est pas possible, marquer la ligne
pour la rendre plus visible ;
o Regrouper les fils à haute tension et utiliser des entretoises pour accroître la visibilité.
Réduire les risques d’électrocution :
o Concevoir des lignes électriques et des pylônes adaptés pour réduire le risque
d'électrocution,
o Suspendre des isolateurs sous les poteaux, à condition que la distance entre un perchoir
probable (principalement le bras) et les parties sous tension (conducteurs) soit d'au moins
70 cm,
o Recouvrer les isolateurs avec un matériau non conducteur et utiliser un matériau non
conducteur pour fixer les isolateurs aux poteaux,
o Isoler les câbles à proximité des poteaux, sur au moins 70 cm des deux côtés et autour des
zones de perchage, et jusqu'à au moins 140 cm dans les zones où se trouvent
d'importantes volées d'oiseaux,
o Lorsque le poteau est en acier, isoler toutes les lignes conductrices,
o Sur les structures de traction où des câbles sont utilisés, au moins deux fils de connexion
doivent être suspendus sous la traverse et le troisième doit être isolé, ou tous les câbles
doivent être isolés,
o Prévoir des plates-formes de nidification et de perchage sûres au-dessus des poteaux, à
une hauteur minimale de 70 cm au-dessus des éléments sous tension, ou plus haut selon
les espèces présentes,
o L'espacement entre les conducteurs ne doit pas être inférieur à 140 cm, et 70 cm entre les
sites de perchage et les composants sous tension,
o Dans les zones où se trouvent des grandes volées d'oiseau, l'espacement entre les
composants sous tension ou l'isolation devrait être supérieur à 2,7 m horizontalement et à
1,8 m verticalement,
o Prévoir des zones de perchage sûres et utiliser des techniques de gestion des perchoirs ;
o Mener des enquêtes post-construction (recherches de carcasses et enquêtes de mortalité et
évaluation des perturbations et des déplacements) sur les points chauds prévus et connus
(tels que les zones sensibles aux oiseaux d'Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre
et Ougul Kabah Kabah) à intervalles rapprochés pendant au moins trois ans
Plan de sécurité, santé et environnement : se référer au manuel de gestion de la main
d’œuvre
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
223
7.2 Responsabilités et rôles des parties prenantes
Entité Responsabilité Outils Fréquence Superviseur
Unité de projet
EDD
Responsable HSE
Contrôle de la mise
en œuvre des plans
d’actions et des
mesures
d’atténuations
Clauses environnementales et
sociales à inclure aux DAO et
contrats des entreprises
contractantes
Avant le début de
la construction
Banque Mondiale
Maitrise d’œuvre
sociale et
environnementale
Rapport de suivi de l’entreprise
contractante Trimestriel
Visite de supervision des sites
de construction et des
campements
Trimestriel
Réunions régulières avec
l’entreprise contractante et les
ingénieurs conseils
Trimestriel
Atténuation et gestion
des impacts
Rapport de suivi des accidents /
incidents / infractions de
l’entreprise contractante et des
sous-traitants
Mensuel
Rencontre avec les
communautés locales
Trimestriel ou à
chaque demande
explicite
Entreprises
contractantes
Respect et mise en
œuvre des plans
d’actions et des
mesures d’atténuation
Clauses environnementales et
sociales à inclure aux DAO et
contrats des sous-traitants et
fournisseurs
A chaque appel
d’offre, contrat ou
commande
Unité de gestion
de l’EDD
Ingénieurs
Conseils
Contrôle de la mise
en œuvre des plans
d’actions et des
mesures
d’atténuations par les
sous-traitants
Rapport de suivi des accidents /
incidents / infractions de
l’entreprise contractante et des
sous-traitants
Mensuel
Rédaction du rapport
de suivi du PGES
Rapports de maintenance des
machines et des véhicules
Rapports d’incidents
Trimestriel
Recrutement
d’experts HSE sur
chaque site et
contrôle de leurs
actions
Présence d’équipement de
signalisation et de sécurité
appropriés
Compte-rendu des formations
Mensuel
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
224
Mise en œuvre et
respect du code de
conduite des
travailleurs
Mécanisme de gestion des
plaintes
Suivi des plaintes
Rapports d’incidents
A chaque plainte
Mensuel
Mensuel
Contrôle du
recrutement des
travailleurs et
validation de leur
formation HSE
Contrats, dossiers d’entretiens
Liste de participants et compte-
rendu des formations
Trimestriellement
ou dès
recrutement
important
Ingénieurs
Conseils
Validation du design
et suivi du système
de compensations
Etude du tracé et évitement des
zones sensibles
Compensations : contrats
signés avec les personnes
affectées
Avant le début de
la construction
Renforcement des
capacités et
sensibilisation des
travailleurs
Liste de participants et compte-
rendu des réunions / formations Mensuel
Entreprise
contractante
Maitrise d’œuvre
sociale et
environnementale
Unité de projet de
l’EDD
Proposition de
mesures pour garantir
l’exécution des plans
d’actions
Clauses environnementales et
sociales à inclure aux DAO et
contrats
A chaque appel
d’offre, contrat ou
commande
Analyse et validation
des résultats des
mesures HSE
Visites d’inspection sur les sites
Mesure sur le terrain des
différents paramètres
environnementaux et de
sécurité
Salaires et contrats de travail
signés du personnel
Rapport des infirmiers ou
médecins sur place
Trimestriel ou à
chaque évènement
marquant
Gestion des plaintes
Mécanisme de gestion des
plaintes
Suivi des plaintes
A chaque plainte
Mensuel
Rédaction du rapport
de suivi du PGES
Rapports de maintenance des
machines et des véhicules
Rapports d’incidents
Trimestriel
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
225
Maitrise d’œuvre
sociale et
environnementale
Renforcement des
capacités de l’unité
de gestion projet de
l’EDD
Liste de participants et compte-
rendu des réunions / formations Mensuel
Banque mondiale
Unité de gestion
de projet de
l’EDD
Valider les rapports
de suivi du PGES
Rapport de suivi de l‘entreprise
contractante
Mesure sur le terrain des
paramètres
Trimestriel
Supervision de la
gestion des impacts
sociaux
Echange avec les travailleurs et
communautés locales
Suivi des plaintes
Trimestriel ou pour
un évènement
marquant
Supervision de la
gestion
environnementale
Analyse et contrôle des
paramètres sur le terrain Trimestriel
Audit indépendant Evaluation de fin de
projet
Rapports sur les études
écologiques post construction Dans l’année qui
suit la fin de la
construction
Unité de projet de
l’EDD
Banque Mondiale Rapport de suivi des plaintes et
incidents
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
226
7.3 Mesures d’atténuation et impacts résiduels
Le niveau de sévérité de l'impact permet de prioriser les mesures d’atténuation. Les impacts positifs peuvent
ne pas nécessiter de mesures d’optimisation, les impacts négatifs négligeables et mineurs peuvent ne pas
nécessiter de mesures d'atténuation spécifiques. En revanche, les impacts négatifs majeurs et moyens
nécessitent des mesures adéquates pour réduire leur importance résiduelle (importance de l'impact après
atténuation).
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Tableau 12- Mesures d’atténuation et impacts sociaux résiduels du projet
80 Manuel de Gestion de la Main-d’œuvre
Description de l'impact Stade du
projet
Sévérité de
l’impact Mesures d’atténuation ou d’optimisation Plans d’actions Responsabilité
Impact
résiduel
IMPACTS SUR LES CONDITIONS ECONOMIQUES
Impact 1- Amélioration de
l’approvisionnement en électricité Opération
Positive
modérée
Mesures d’optimisation :
- Proposer un tarif du kwh aménagé et accessible aux
populations locales
- EDD Positif
Impact 2- Création d'emplois directs
et indirects liés au projet
Construction Positive
mineure
Mesures d’optimisation :
- Favoriser les populations locales et les femmes lors des
processus de recrutement
- Promouvoir des conditions de travail sûres et saines
MGM80
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Positif
Opération Positive
mineure Positif
IMPACTS SUR L’UTILISATION DES TERRES
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
81 Si le couloir de sécurité ne se maintenait pas dans la zone d’emprise du projet il faudrait actualiser l’étude d’occupation des sols et en particulier s’assurer qu’aucun logement ne se trouve dans la nouvelle zone.
82 Cadre de Politique de Réinstallation
83 Plan de Mobilisation des Parties Prenantes
Impact 3- Restriction des usages et
pertes potentielles dans le corridor
du projet
Construction Négative
modérée
- Maintenir le corridor de sécurité de la ligne de 40 m de large
dans la zone d’emprise81
- Exiger à la maitrise d’œuvre technique de n’endommager
aucun bien durant le câblageEn cas de destruction,
compenser les pertes économiques et culturelles selon le
CPR
- Concerter des actions de développement avec les localités
riveraines comme reconnaissance d’un droit de servitude
- Informer les populations nomades et les accompagner dans
le déplacement de leurs logements sur quelques dizaines
de mètres pour éviter qu’ils résident sous les câbles
électriques.
- Informer et consulter la population
Cahier des charges
CPR82
PMPP83
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs
ConseilsMaitrise
d’œuvre sociale
Négatif
mineur
Opération Négligeable Informer la population sur les restrictions qui ne modifieront pas
les usages actuels
CPR
PMPP EDD Négligeable
Impact 4- Perte temporaire de terres
(campements, stockage, accès) Construction
Négative
modérée
- Minimiser et marquer les zones d’acquisition et exiger aux
travailleurs de les respecter
- Eviter d’inclure des biens économiques ou culturels dans les
zones et compenser les biens détruits
- Encadrer l’installation des camps temporaires dans des
zones adéquates
- Exiger au constructeur un plan de fermeture des
campements spécifiant les opérations de réhabilitation des
terrains
- Informer et consulter la population
Cahier des charges
CPR
Plan de fermeture
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale
Négatif
mineur
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
84 Les okals sont les leaders communautaires.
85 Manuel de Gestion de la Main d’œuvre
86 Plan d’action contre les violences basées sur le Genre
Impact 5- Perte permanente de
terres (pylônes, poste de Nagad et
routes)
Construction Négative
modérée
- Minimiser et marquer les zones d’acquisition et exiger aux
travailleurs de les respecter.
- Eviter d’inclure des biens économiques ou culturels dans les
zones et compenser les biens détruits.
- Informer et consulter la population
Cahier des charges
CPR
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Négatif
mineur
IMPACTS SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS
Impact 6- Tensions sociales dues à
des comportements inappropriés de
travailleurs extérieurs
Construction Négative
modérée
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite.
- Former les employés sur les comportements inappropriés et
les sanctions encourues.
- Consulter les okals84 pour identifier de possibles incidents et
s’accorder sur des mesures correctives
MGM85
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale
Négatif
mineur
Opération Négligeable - Consulter les okals pour identifier de possibles incidents Négligeable
Impact 7- Augmentation des VBG du
fait de l’afflux de travailleurs
extérieurs
Construction Négative
majeure
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite
- Former les employés sur les comportements inappropriés et
les sanctions encourues.
- Mettre en œuvre des actions de prévention et protection
contre les VBG
- Consulter les okals pour identifier des préoccupations
MGM
PA- VBG86
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs
ConseilsMaitrise
d’œuvre sociale –
expert genre
Négatif
mineur
Opération Négative
mineure - Consulter les okals pour identifier des préoccupations PMPP EDD
Négatif
mineur
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Impact 8- Augmentation de
l'incidence des maladies
transmissibles, en particulier des
MST
Construction Négative
majeure
- Interdire aux travailleurs de se rendre dans les localités
riveraines et leur exiger de respecter un code de bonne
conduite
- Sensibiliser les travailleurs et la population riveraine aux
pratiques sexuelles sûres
- Consulter les okals pour identifier des préoccupations
MGM
PA- VBG
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale – expert santé
Négatif
mineur
Opération Négative
mineure - Consulter les okals pour identifier des préoccupations EDD
Négatif
mineur
Impact 9- Augmentation de
l'incidence de la COVID-19
Construction Négative
majeure
- Sensibiliser les travailleurs et les communautés aux
protocoles sanitaires adéquates et aux signes de la maladie ; -
Isoler les personnes présentant des symptômes ;- Faire
intervenir le personnel de santé des travailleurs auprès de la
population locale ;
-
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale – expert santé
Négatif
mineur
Opération Négative
mineure
Négatif
mineur
Impact 9- Augmentation des risques
d’accidents pour la population
locale
Construction Négative
modérée
- Exiger à l’entreprise contractante un plan de gestion du
trafic
- Marquer et sécuriser les zones de construction et limiter les
points d’accès
- Equiper les pylônes de dispositifs anti-escalade et de
panneaux d’avertissement avec des symboles graphiques
Plan de gestion du
trafic
Cahier des charges
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Négatif
mineur
Opération Négative
modérée
- Informer la population locale des dangers que représente la
nouvelle ligne de transmission PMPP EDD
Négatif
mineur
Impact 10- Impacts des champs
électromagnétiques Opération
Négative
mineure
- Pas de mesure proposée car l’impact est déjà considéré
comme mineur
Négatif
mineur
Impact 11- Pression accrue sur les
services de base du fait de l’afflux
de travailleurs
Construction Négative
modérée
- Exiger à l’entreprise contractante de proposer des
installations sanitaires et des systèmes d’eau potable et de
gestion des déchets indépendants des services locaux
existants.
- Consulter les okals pour identifier de possibles incidents et
s’accorder sur des mesures correctives
Cahier des charges
PMPP
EDD
Maitrise d’œuvre
sociale
Négatif
mineur
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
87 Cependant, il est important de savoir que certains postes peuvent ne pas être occupés par des femmes pour des raisons sociales.
88 Voir Workers' Accommodation: Processes and Standards de la Banque Mondiale
Opération Négligeable - Pas de mesure proposée car l’impact est déjà considéré
comme négligeable Négligeable
IMPACTS SUR LA SANTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS
Impact 12- Risques de
discrimination des travailleurs
Construction Négative
majeure
- Définir une politique de recrutement, des critères de
sélection et des possibilités de formation clairs et
transparents
- A compétences égales, promouvoir le recrutement des
populations locales, des jeunes et des femmes87
- Proposer des mesures de prévention contre le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail
MGM
PA-VBG
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs
ConseilsMaitrise
d’œuvre sociale
Négatif
mineur
Opération Négative
modérée
Négatif
mineur
Impact 13- Risques de conditions de
travail non adéquates
Construction Négative
modérée
- Définir les principes de gestion des employés de l'entreprise
contractante et sous-traitants.
- Assurer un mécanisme de gestion des griefs anonyme et
connu des employés
- Loger les travailleurs selon les normes internationales88
(eau potable gratuite, toilettes, cantine, zone de repos, etc.).
- Exiger à l’entreprise contractante de faire respecter les
points précédents par les sous-traitants
Cahier des charges
MGM
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale
Négatif
mineur
Opération Négative
modérée
- Définir les principes de gestion des employés
- Assurer un mécanisme de gestion des griefs anonyme et
connu des employés
MGM
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Négatif
mineur
Impact 14- Expositions des
travailleurs à des risques physiques Construction
Négative
majeure
- Suivre les exigences de santé et sécurité au travail de la
législation djiboutienne, de la BM et de la BAD
Cahier des charges
MGM
EDD
Entreprise contractante
Négatif
mineur
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
et chimiques
Opération Négative
modérée
- Exiger aux sous-traitants de se conformer aux mêmes
exigences que l’entreprise contractante
- Fournir un équipement adéquat et gratuit aux travailleurs
(gants, lunettes, casque, harnais, etc.)
- Former tous les travailleurs sur les exigences de santé et de
sécurité au travail
- Equiper les pylônes d'un système d'identification
permanente
- Proposer des inspections de ligne via des drones pour
diminuer les risques de chute
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale
Négatif
mineur
IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
Impact 15- Détérioration de sites
d’héritage culturel Construction
Négative
modérée
- Réaliser une étude détaillée des tombes recensées dans le
PAR pour identifier de potentiels awellos.
- Eviter d’inclure des biens culturels dans les zones
d’acquisition temporaire et permanente
- Compenser et déplacer les biens ne pouvant être évités
- Informer et consulter les okals et la population durant tout le
processus
Cahier des charges
CPR
PMPP
EDD
Entreprise contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
sociale –
anthropologue /
archéologue
Négative
mineur
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Tableau 13 : Mesures d’atténuation et impacts environnementaux résiduels du projet
Description de l'impact Stade du
projet
Sévérité de
l’impact Mesures d’atténuation ou d’optimisation Plans d’actions Responsabilité
Impact
résiduel
IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
Impact 1 – Dégradation de la qualité
de l'air
Construction Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise pour la
phase de construction, mais la mise en œuvre de bonnes
pratiques de gestion environnementale et sociale standard
suffira.
- Les émissions fugitives de poussières provenant de diverses
activités telles que l'excavation, le transport de matériaux
(chargement et déchargement) et le déplacement de véhicules
(sur des routes non pavées) peuvent être réduites au minimum
grâce aux bonnes pratiques standard des chantiers de
construction.
Plan de prévention de
la pollution
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
Opération Négligeable
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise pour la
phase de construction, mais la mise en œuvre de bonnes
pratiques de gestion environnementale et sociale standard
suffira.
- Il y aura des émissions de poussières gazeuses et fugitives
dues au déplacement des véhicules de maintenance, qui
seront réduites au minimum grâce à des limitations de vitesse
sur le site, c'est-à-dire ne dépassant pas 40 km/h le long des
routes poussiéreuses ou 20 km/h le long des zones non
consolidées.
- Les émissions des véhicules seront contrôlées grâce à un
entretien approprié des véhicules.
Plan de prévention de
la pollution
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
Impact 2 – Emission de bruit et de
nuisance sonore Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise et la
mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
environnementale standard suffira.
- Protection auditive (bouchons d'oreille) pour les travailleurs
Plan de gestion
environnemental
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
de la construction.
Opération Négligeable Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. Négligeable
IMPACT SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS
Impact 3 – Impact sur la géologie et
la géomorphologie Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques de gestion environnementale
standard est recommandée :
- Réaliser une évaluation ou une étude géotechnique pour la
conception détaillée des pylônes et du poste de Nagad ;
- Restreindre les activités de terrassement aux zones de
construction strictement nécessaires
Plan de gestion des
terres EDD Négligeable
Impact 4 - Changements dans les
processus de sédimentation Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise
La mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
environnementale standard est recommandée :
- Limiter le défrichement de la végétation et le décapage de la
couche arable aux zones strictement nécessaires ;
- S'en tenir aux routes existantes, lorsque cela est possible,
pour minimiser les impacts sur les sols non perturbés ;
- Minimiser l'exposition du sol pendant les périodes de fortes
pluies lors des excavations et des activités de terrassement ;
- Veiller à ce que toutes les zones de construction de lignes
électriques et de postes fassent l'objet d'un examen adéquat
par des ingénieurs géotechniques et des géologues afin de
détecter les sols expansibles/affaissés et les zones
potentielles d'instabilité des pentes avant la construction.
Plan de gestion des
terres
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Impact 5 - Augmentation de l'érosion
et du compactage des sols
Construction Négative
Modéré
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Privilégier l'utilisation des voies d'accès existantes pour
accéder aux sites de travail ;
- Limiter le défrichement de la végétation et l'enlèvement de la
couche arable aux zones strictement nécessaires à la
construction ;
- Décaper et stocker la terre végétale avant les activités de
terrassement pour la réutiliser ultérieurement dans les travaux
de réhabilitation ;
- Protéger les sols stockés provisoirement dans le cadre du
Plan de gestion environnementale ;
- Éviter la construction de pylônes dans les basses terres et
les zones de pente importantes afin de réduire les risques
d'érosion du sol par la pluie et le vent.
Plan de gestion des
terres
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négative
Mineure
Opération Négative
Mineure
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Privilégier l'utilisation des voies d'accès existantes pour
accéder aux sites de travail ;
- Limiter le défrichement de la végétation et l'enlèvement de la
couche arable aux zones strictement nécessaires à la
construction ;
- Décaper et stocker la terre végétale avant les activités de
terrassement pour la réutiliser ultérieurement dans les travaux
de réhabilitation ;
- Protéger les sols stockés provisoirement dans le cadre du
Plan de gestion environnementale ;
- Éviter la construction de pylônes dans les basses terres et
les zones de pente importantes afin de réduire les risques
d'érosion du sol par la pluie et le vent.
Plan de gestion des
terres
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Impact 6 – Contamination des sols
Construction Négative
Mineure
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Si un déversement se produit, un kit et une procédure
d'urgence doivent être utilisés pour réduire immédiatement la
propagation potentielle du déversement ;
- Interdire le déversement de tout type d'eau résiduelle non
traitée dans le sol et/ou les ressources en eau (rivières,
ruisseaux, sources, lagunes, aquifères, etc.) ;
- Élaborer un plan de gestion des déchets, en suivant les
lignes directrices fournies dans le PGES.
Plan de prévention de
la pollution
Plan de gestion des
déchets
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
Opération Négative
Mineure
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Si un déversement se produit, un kit et une procédure
d'urgence doivent être utilisés pour réduire immédiatement la
propagation potentielle du déversement ;
- Interdire le déversement de tout type d'eau résiduelle non
traitée dans le sol et/ou les ressources en eau (rivières,
ruisseaux, sources, lagunes, aquifères, etc.) ;
- Élaborer un plan de gestion des déchets, en suivant les
lignes directrices fournies dans le PGES.
Plan de prévention de
la pollution
Plan de gestion des
déchets
EDD Négligeable
IMPACT SUR LE PAYSAGE ET IMPACT VISUEL
Impact 7 - Changement du paysage
et impacts visuels Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise, mais la
mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
environnementale standard est recommandée. Plusieurs
mesures peuvent cependant être appliquées pour réduire,
dans la mesure du possible, les effets négatifs pendant la
phase de construction. Il s'agit notamment des mesures
suivantes
- Limiter le défrichement et l'occupation des sols au minimum
nécessaire pour les travaux ;
- Limiter l'éclairage du chantier en dehors des heures normales
de travail, autant que possible, au minimum nécessaire pour la
Plan de gestion des
terres
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
sécurité et la sûreté ; et
- Maintien de la propreté et du confinement du site.
Opération Négative
Moyenne
Tous les effets paysagers et visuels ne peuvent pas être
atténués de manière pratique pendant la phase de
construction et d'opération en raison de la visibilité de certains
éléments de construction.
En raison de la hauteur de la plupart des éléments du projet,
du paysage ouvert et de l'absence de végétation naturelle, il
ne sera pas possible de réaliser un écran visuel avec de la
végétation et il est peu probable que l'on puisse atténuer les
éventuels effets paysagers et visuels pendant l'opération. En
outre, il est peu probable qu'une plantation s'établisse et
atteigne les hauteurs nécessaires à l'écran, en raison des
conditions climatiques difficiles existantes.
Plan de gestion des
terres EDD
Négative
Moyenne
IMPACT SUR L’EAU
Impact 8 - Modifications du schéma
de ruissellement naturel des eaux Construction Négligeable Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise.
Plan de prévention de
la pollution
Plan de gestion des
déchets
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Impact 10 - Perte directe d’unités de
végétation et d’habitats
Construction
Négative
Majeure
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Limiter strictement le défrichement de la végétation aux
zones requises, en particulier dans les zones d'habitats
naturels ;
- Dans la mesure du possible, mettre les arbres coupés à la
disposition des communautés locales pour qu'elles les
ramassent et les utilisent comme matériaux de construction ou
à d'autres fins ;
- Éviter d'installer des camps de construction et des terriers
dans les habitats naturels ;
- Éviter d'installer des pylônes et des routes d'accès dans les
oueds.
- Réhabiliter et revégétaliser la zone aussi tôt que possible ;
- Le tracé de la ligne de transmission chevauche la zone du
projet de la Grande Muraille Verte. La perte de couverture
végétale peut être compensée par la plantation d'arbres
indigènes dans le cadre d'initiatives d'agroforesterie et de
reboisement en partenariat avec le projet de la Grande
Muraille Verte.
Plan de gestion de la
biodiversité
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs
ConseilsMaitrise
d’œuvre
environnementale
Négative
Mineure
Opération
IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques environnementales standard
suffira, telles que :
- Limiter le défrichement de la végétation aux zones requises,
en particulier dans les zones d'habitats naturels et les oueds ;
- Dans la mesure du possible, de nouveaux accès seront créés
sur la base des accès existants ;
- Les activités de défrichement de la végétation seront
accompagnées par un spécialiste en écologie/biologie pour
détecter tout site de perchage et/ou de reproduction important
à proximité des zones de défrichement et mettre en œuvre des
mesures de précaution ;
- Éviter autant que possible les travaux de construction
pendant la nuit;
- Minimiser l'éclairage dans les camps de construction ;
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets.
Plan de gestion de la
biodiversité
Plan de gestion des
déchets
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
Impact 11 - Exclusion d'espèces de
faune en raison de l'augmentation
des perturbations
Opération
Impact 12 – Augmentation de la
mortalité des espèces de faune due
aux mouvements de véhicules et aux
activités de construction
Construction
Négative
Mineure
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques environnementales standard
suffira. Les mesures d'atténuation inhérentes et les meilleures
pratiques suivantes doivent être intégrées dans la construction
du projet :
- Des restrictions de vitesse sur le site seront mises en place,
que tous les conducteurs de véhicules devront respecter.
Plan de gestion de la
biodiversitél
Plan de sécurité,
santé et
environnement
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
Opération
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
- Entreprendre une formation de sensibilisation des
conducteurs sur les espèces présentes dans la zone qui
peuvent être affectées par les collisions de véhicules.
- Mettre en place un système d'exploitation forestière exigeant
des travailleurs de la construction et des conducteurs qu'ils
signalent toute observation ou collision d'espèces de faune et
permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures
d'atténuation supplémentaires si nécessaire (par exemple,
utilisation de brise-vitesse près des zones identifiées comme à
haut risque, clôtures, réflecteurs de lumière).
- Vérifier les relevés des zones de construction chaque matin
afin de détecter les reptiles, en particulier les serpents, qui
auraient pu pénétrer dans les zones de construction, les
tranchées, etc. pendant la nuit.
Impact 13: Fuites / déversements
accidentels entraînant la dégradation
de l'habitat
Construction
Négligeable
Aucune mesure d'atténuation ou de gestion environnementale
ou sociale n'est requise. Les lignes directrices générales en
matière d'ESS doivent être suivies.
Plan de gestion des
déchets
Plan de prévention de
la pollution
Négligeable
Opération
Impact 14 - Augmentation de la
mortalité des oiseaux migrateurs
planneurs par électrocution et
collision
Construction Négative
Majeure
Les mesures d'atténuation suivantes devraient être mises en
œuvre pour réduire les risques de collision et d'électrocution
principalement dans les sections des projets situées à
proximité des zones sensibles aux oiseaux (Assamo, Djalelo,
Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul Kabah Kabah) :
Réduire les risques de collision :
- Utilisation de déflecteurs d'oiseaux dans les zones à fort
Plan de gestion de la
biodiversité
Plan de sécurité,
santé et
environnement
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale –
ornithologue
Négative
Moyenne
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
impact, en particulier le long des voies de migration. Ceux-ci
devraient augmenter la visibilité de la ligne en épaississant
l'apparence de la ligne d'au moins 20 cm sur une longueur de
10-20 cm ;
- Les marqueurs doivent être mobiles, de couleurs contrastées
(par exemple noir et blanc), contraster avec le fond, dépasser
au-dessus et en dessous de la ligne et être placés à 5-10 m
l'un de l'autre ;
- Enlever le mince fil neutre ou de terre (blindage) au-dessus
des lignes de transmission à haute tension lorsque cela est
possible, et lorsque cela n'est pas possible, marquer la ligne
pour la rendre plus visible ;
- Regrouper les fils à haute tension et utiliser des entretoises
pour accroître la visibilité ;
Réduire le risque d'électrocution :
- Concevoir des lignes électriques et des pylônes associés
pour réduire le risque d'électrocution,
- Suspendre les isolateurs sous les bras et les poteaux, à
condition que la distance entre un perchoir probable
(principalement le bras) et les parties sous tension
(conducteurs) soit d'au moins 70 cm ;
- Recouvrement des isolateurs verticaux avec un matériau non
conducteur et l'utilisation d'un matériau non conducteur pour
fixer les isolateurs aux poteaux ;
- Isoler les câbles à proximité des poteaux, sur au moins 70
cm des deux côtés et autour des zones de perchage, et
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
jusqu'à au moins 140 cm dans les zones où se trouvent de
grands oiseaux en vol ;
- Lorsque le poteau est en acier, isoler toutes les lignes
conductrices ;
- Sur les structures de traction où des cavaliers sont utilisés,
au moins deux fils de liaison doivent être suspendus sous la
traverse et le troisième doit être isolé, ou tous les cavaliers
doivent être isolés ;
- Prévoir des plates-formes de nidification et de perchage
sûres au-dessus du poteau, à une hauteur minimale de 70 cm
au-dessus des éléments sous tension, ou plus haut selon les
espèces présentes ;
- L'espacement entre les conducteurs ne doit pas être inférieur
à 140 cm, et 70 cm entre les sites de perchage et les
composants sous tension ;
- Dans les zones où se trouvent de grands oiseaux planeurs,
l'espacement entre les composants sous tension ou l'isolation
devrait être supérieur à 2,7 m horizontalement et à 1,8 m
verticalement ;
- prévoir des zones de perchage sûres et utiliser des
techniques de gestion des perchoirs.
Mener des enquêtes post-construction (recherches de
carcasses et enquêtes de mortalité et évaluation des
perturbations et des déplacements) sur les points chauds
prévus et connus (tels que les zones sensibles aux oiseaux
d'Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul
Kabah Kabah) à intervalles rapprochés pendant au moins trois
ans.
Opération
Impact 15 - Défrichement de la
végétation entraînant la perte Construction
Négative
Mineure
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en
œuvre pendant la phase de construction du projet :
Plan de gestion de la
biodiversité
EDD
Entreprise Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
d'habitats et d'espèces
Opération
- Des études de contrôle des oiseaux nicheurs devraient être
entreprises avant le déblaiement de toute végétation. Si des
nids actifs sont enregistrés, le nettoyage de la végétation doit
être retardé jusqu'à ce que la nidification soit terminée et que
la zone de nidification soit protégée des perturbations dans un
rayon défini par un ornithologue dûment qualifié.
- Les pylônes et les voies d'accès ont été situés en dehors des
canaux des oueds dans la mesure du possible.
- La perte d'habitat sera limitée au minimum nécessaire pour
une mise en œuvre sûre des travaux.
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Impact 16 - Activité et bruit
entraînant une perturbation des
espèces
Construction Négative
Mineure
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en
œuvre pendant la phase de construction du projet :
- Éviter, dans la mesure du possible, le dynamitage et le
martèlement des roches pendant la saison de reproduction.
- Le PGE détaillera les mesures de meilleures pratiques, y
compris celles ci-dessus et d'autres à mettre en œuvre pour
réduire le risque d'impacts secondaires sur les oiseaux,
notamment pour contrôler la poussière, le bruit et l'activité
générale.
Plan de gestion ee la
biodiversité
EDD
Entreprise
contractante
Ingénieurs Conseils
Maitrise d’œuvre
environnementale
Négligeable
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
244
7.4 Mesures opérationnelles envisagées
7.4.1 Dispositif de mise en œuvre et renforcement des capacités
Il est essentiel que toutes les parties prenantes du projet connaissent et participent à la mise en œuvre du PGES,
sachant que certaines auront des rôles et responsabilités majeures.
L’EDD a ainsi la responsabilité globale de la correcte mise en œuvre du PGES. Elle doit pour cela veiller à ce
que :
Les spécifications techniques des clauses environnementale et sociale produit par l’EDD sont
correctement prises en compte dans la conception finale du projet
Les mesures d’atténuation du PGES sont mises en œuvre par toutes les parties prenantes du projet et en
particulier par la maitrise d’œuvre technique et ses sous-traitants et atteignent les effets attendus.
La maitrise d’œuvre sociale (Bureau d’études) responsable de la supervision de la construction
accompagnera la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts sociaux. L’équipe comprendra
un expert social à plein temps chargé de contrôler et documenter que la maitrise d’œuvre technique
respecte les mesures de protection environnementale et sociale du PGES, du PMPP, du plan VBG et du
plan de gestion de la main d’œuvre. Cet expert sera appuyé par un anthropologue, un archéologue, un
spécialiste des questions liées au genre et un spécialiste de la santé. Ces experts assureront le bon
déroulement des séances de sensibilisation auprès des travailleurs et des communautés.
La maitrise d’œuvre environnementale (bureau d’études) responsable de la supervision de la construction
accompagnera la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts environnementaux. L’équipe
comprendra un expert environnemental à plein temps chargé de contrôler et documenter que la maitrise
d’œuvre technique respecte les mesures de protection environnementale et sociale du PGES. Cet expert
sera appuyé par un ornithologue.
Des séances de formations sur les codes de conduite ainsi que les mesures et protocoles de lutte contre
la propagation de la COVID-19 soient mises en place.
Les Experts Environnement et Social de l’EDD devront réaliser un suivi interne de ces différents points en vue de
garantir la prise en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans le projet. La mission des
Experts devrait s’articuler autour des axes suivants : (i) veiller à l’application des mesures d’atténuation
environnementales et sociales ; (iii) coordonner les activités de formation et de sensibilisation des parties
prenantes sur la nécessité de la prise en compte des questions environnementales et sociales ; (iv) effectuer la
supervision périodique de la mise en œuvre du PGES du Projet.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
245
La Direction de l'Environnement et du Développement Durable (DEDD) du Ministère de l'Urbanisme, de
l'Environnement et du Tourisme devra également jouer un rôle majeur de suivi externe du PGES, conformément
au cadre légal djiboutien. Elle devra ainsi assurer un rôle de contrôle régalien (inspection) en « veillant au respect
des règles de bonne gestion et des normes tant nationales qu’internationales » et « en assurant le suivi de la
conduite de la procédure d’étude d’impact environnemental ».
Finalement il faudra s’assurer que les parties prenantes du projet sont capables de participer à la bonne mise en
œuvre et au suivi des mesures sociales et environnementales présentées dans le PGES. Pour ce faire, l’expert
Environnement et Social de l’EDD devra coordonner un processus de renforcement des capacités des parties
prenantes du Projet en s’appuyant sur des formateurs externes.
Un premier bloc de formation initiale sera destiné à tous les travailleurs impliqués dans le projet : agents de l’EDD
engagés dans le projet, travailleurs de l’entreprise de construction, sous-traitants et prestataires de services
externes. Les modules de formation initiale comprendront la santé et la sécurité, la sensibilisation à
l'environnement, le code de conduite des travailleurs, l'engagement des parties prenantes et les mécanismes de
réclamation. Ils seront élaborés en s’appuyant sur l’information présentée dans les plans du PGES et prendront
en compte le niveau d'éducation et les préférences linguistiques des participants. Ces formations permettront
d’assurer que tous les travailleurs impliqués dans le projet connaissent et peuvent appliquer les principales
procédures et mesures du PGES. Les sous-traitants devront réaliser la formation de leur personnel, sous réserve
de validation par le responsable HSE du projet, et tiendront des registres vérifiables de la formation dispensée
Un deuxième bloc de formation avancée permettra de proposer des séances de perfectionnement et/ou
approfondissement pendant toute la durée du Projet. Les travailleurs spécialisés seront ainsi invités à suivre une
formation approfondie et ciblée sur leur responsabilité spécifique. La formation sera axée sur les mesures
d'atténuation environnementale et sociale à mettre en œuvre sur le site. Si nécessaire, le responsable HSE
pourra faire appel aux services d'un formateur professionnel pour présenter le contenu technique du PGES. Ces
formations seront conçues en fonction des domaines d’activités, de la spécialisation et des responsabilités de
chacun, du type de travail effectué, du degré d’interaction avec les communautés locales, de l’exposition aux
risques, etc. Elles permettront aux employés et partenaires du projet d’améliorer leurs connaissances et leurs
compétences sur des questions qu’ils doivent gérer régulièrement.
Un troisième bloc de formation communautaire sera destiné aux acteurs communautaires : les autorités locales et
les agents des entreprises de services chargés de l’application des mesures environnementales et sociales. Ces
formations reprendront les grandes lignes des modules de la formation initiale.
Les formations seront renforcées par la préparation d'affiches placées dans les lieux fréquentés par le personnel,
tels que les réfectoires et les bureaux. Les dossiers de formation seront tenus par le responsable HSE et
l'efficacité des programmes de formation sera évaluée dans le cadre des procédures d'audit interne.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
246
7.4.2 Dispositif de suivi et évaluation du PGES
Un système de suivi et d'évaluation doit permettre de contrôler le niveau de mise en œuvre des différentes
actions du PGES et d'évaluer leur mise en œuvre, leur pertinence et leur efficacité au fur et à mesure de leur
réalisation. Le système géré en interne doit permettre d'adapter les propositions lorsque cela est nécessaire.
Un rapport annuel de suivi sera élaboré par l’unité de gestion de projet de l’EDD pendant la phase de
construction puis pendant la phase d'exploitation afin d'analyser les indicateurs collectés et de proposer des
mesures d'atténuation supplémentaires si nécessaire. Un audit environnemental et social sera réalisé par une
organisation indépendante avant la clôture du projet. Il permettra de vérifier les principaux indicateurs d'impact.
Les activités de suivi comprennent :
Des visites régulières sur le site permettent d'observer la gestion des dispositions du PGES ;
Analyse des différents paramètres environnementaux et de sécurité ;
Échantillonnage des sites pour analyser la conformité aux exigences en matière d'ESS ;
Réunions régulières sur le site avec l'EDD et le contractant pour discuter des préoccupations en matière
de normes Environnementales et sociales.
Ces activités garantiront une mise en œuvre et une gestion efficace des mesures d'atténuation proposées. En
outre, les nouveaux et imprévus impacts identifiés, non examinés dans le PGES, seront facilement enregistrés et
traités tout au long du projet. L’entreprise contractante et l’entreprise en charge de la supervision des travaux
(ingénieurs conseils) devront employer responsable HSE local et des superviseurs NES locaux spécifiques au
site pour assurer la conformité avec PGES. L’ingénieur Conseil nommé par l’entreprise contractante veillera
également à ce que des mesures d'atténuation soient mises en œuvre tout au long des phases du projet.
Le dispositif de suivi / évaluation de la gestion environnementale, sanitaire et sociale proposera des activités de
contrôle qui seront menées durant toutes les phases du projet. L'entreprise contractante et l’ingénieur conseil
seront mandaté pour proposer des mesures qui garantiront l'exécution du dispositif pendant la phase de
construction. Les experts en environnement et social de l’EDD qui guiderons et superviseront le contractant dans
la mise en œuvre du PGES. Les experts feront régulièrement rapport à l'EDD sur le respect du PGES par le
contractant. Le niveau de contrôle périodique à l'achèvement des activités de construction sera déterminé lors de
la phase opérationnelle.
7.4.2.1 Contrôle interne
La responsabilité d'effectuer régulièrement un contrôle interne des projets proposés dans la gestion du PGES et
les normes environnementales et sociales prévues dans le contrat incombe à l’entreprise contractante.
L'évaluation du niveau de conformité à la gestion des risques environnementaux et sociaux sera guidée par un
programme détaillé du PGES approuvé par l’entreprise contractante. Les objectifs du contrôle et de l'audit interne
seront :
Identifier les lacunes dans la mise en œuvre du PGES par le contractant
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
247
Assurer le respect des exigences légales
Guider le contractant dans la gestion des exigences NES de temps à autre en cas d'impacts
imprévus
L’entreprise contractante poursuivra le processus de surveillance pendant les phases d'exploitation et de
démantèlement des projets en veillant à ce que les paramètres environnementaux minimums admissibles soient
maintenus. Ces paramètres sont inclus dans les plans suivants :
Plan de gestion des déchets (surveillance de la gestion des déchets solides et liquides) ;
Plan de prévention de la pollution (surveillance de la qualité de l'air) ;
Gestion du bruit (surveillance des niveaux de bruit) ;
Plan de gestion des terres (surveillance de l'érosion et de la conservation des sols) ;
Plan de gestion de la biodiversité ;
Plan de santé et de sécurité environnementale.
Formation de la main-d'œuvre
L’entreprise contractante doit contrôler le recrutement des travailleurs afin de s'assurer qu'ils sont correctement
formés à la gestion de l'ESS en plus des compétences spécifiques requises pour leur description de poste. Le
contractant doit contrôler régulièrement la formation d'initiation et les dossiers d'entretiens. Le contractant doit
également former des superviseurs ESS spécifiques au site pour faire appliquer les formations.
Suivi de la prévention des accidents / gestion de la santé
L’entreprise contractante fera appel aux services d'un ingénieur conseil indépendant en matière d'environnement,
de santé et de sécurité pour effectuer des audits fréquents sur le contractant pendant la mise en œuvre du projet.
L’ingénieur conseil effectuera des visites d'inspection régulières sur le site (la fréquence sera convenue avec le
contractant) afin de contrôler la manière dont le contractant gère sa main-d'œuvre et ses activités en matière de
prévention des accidents et de gestion de la santé.
Le responsable de la sécurité doit, quant à lui, veiller à ce que les travailleurs disposent à tout moment
d'équipements de signalisation et de sécurité appropriés.
Les indicateurs qui seront utilisés dans l'évaluation de la prévention des accidents et de la gestion des risques
pour la santé comprennent :
Fourniture d'équipements de protection individuelle adéquats aux travailleurs durant toute la phase
du projet
Présence de panneaux d'avertissement et de sécurité affichés sur les sites et sur la structure des
pylônes en cours de montage
Des installations adéquates de collecte et traitement des déchets humains et un système
d'assainissement opérationnel présents sur les sites
Sensibilisation de la communauté locale aux risques sécuritaires liés au projet
Compilation de dossiers sur les accidents/incidents réels qui ont été rencontrés
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
248
Élaboration de rapports de santé tout au long du projet
7.4.2.2 Contrôle externe
L'organisme national de gestion de l'environnement délivre l'approbation pour la mise en œuvre du projet
proposé. En outre, il veille à ce que les mesures d'atténuation prévues soient mises en œuvre dans le cadre de
l'exécution du projet. Les autorités concernées assurent la surveillance des organismes d'exécution en examinant
les rapports de surveillance. L’entreprise contractante doit donc fournir à l'organisme des rapports annuels sur
l'état d'avancement de la gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité.
7.4.2.3 Audits Environnementaux (AE)
Les audits environnementaux réalisés durant toute la phase de la mise en œuvre du projet sont essentiels pour
garantir la conformité totale vis à vis exigences du PGES. L'objectif de l'évaluation environnementale sera
d'établir si le contractant respecte les exigences environnementales et applique la législation en vigueur. L'objectif
de l'AE est de déterminer dans quelle mesure les activités et les programmes sont conformes au plan de gestion
environnementale approuvé. Un consultant indépendant doit être engagé pour superviser la gestion
environnementale tout au long du projet.
7.4.3 Indicateurs de suivi-évaluation des mesures d’atténuation sociale
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
249
Tableau 14- Système de suivi-évaluation des mesures d’atténuation sociales
Description de
l'impact
Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi Sources de vérification
IMPACTS SUR L’UTILISATION DES TERRES ET LES POSSIBLES DEPLACEMENTS
Impact 3-
Restriction des
usages et pertes
potentielles dans
le corridor du
projet
- Exiger à la maitrise d’œuvre
technique de n’endommager
aucun bien durant le câblage
- En cas de destruction,
compenser les pertes
économiques et culturelles
- Concerter des actions de
développement avec les
localités riveraines
- Informer et consulter la
population
- Nombre de biens affectés,
réparés, compensés (par
type de bien)
- Nombre de personnes
compensées et montant des
compensations (par type de
bien)
- Montants engagé et
décaissé en actions de
développement
- Nombre de réunions
communautaires (par lieu)
- Rapport de suivi du CPR
- Contrats signés avec les
personnes affectées
- Rapport financier des actions de
développement
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
Impact 4- Perte
temporaire de
terres
(campements,
stockage, accès)
- Minimiser, marquer et
respecter les zones
d’acquisition.
- Eviter d’inclure des biens
dans les zones et compenser
les biens détruits.
- Exiger un plan de fermeture
des campements
- Informer et consulter la
population
- Nombre de biens affectés,
réparés, compensés (par
type de bien)
- Nombre de personnes
compensées et montant des
compensations (par type de
bien)
- Plan de fermeture élaboré et
validé
- Nombre de réunions
communautaires (par lieu)
- Rapport de suivi du CPR
- Contrats signés avec les
personnes affectées
- Rapport financier des actions de
développement
- Plan de fermeture validé
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
Impact 5- Perte
permanente de
terres (pylônes,
poste de Nagad et
routes)
- Minimiser, marquer et
respecter les zones
d’acquisition
- Eviter d’inclure des biens
dans les zones et compenser
les biens détruits.
- Informer et consulter la
population
- Nombre de biens affectés,
réparés, compensés (par
type de bien)
- Nombre de personnes
compensées et montant des
compensations (par type de
bien)
- Nombre de réunions
communautaires (par lieu)
- Rapport de suivi du CPR
- Contrats signés avec les
personnes affectées
- Rapport financier des actions de
développement
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
250
IMPACTS SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS
Impact 6-
Tensions sociales
dues à des
comportements
inappropriés de
travailleurs
extérieurs
- Interdire aux travailleurs de se
rendre dans les localités et
leur exiger un code de bonne
conduite
- Former les employés sur les
comportements inappropriés
et les sanctions encourues
- Consulter les okals sur de
possibles incidents
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une sensibilisation sur
le code de conduite
- Nombre d’infractions au
code de conduite reportées
- Nombre de réunions avec
les okals (par lieu)
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
- Rapport de suivi des infractions
de l’entreprise contractante et
ses sous-traitants
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
Impact 7-
Augmentation de
l'incidence des
maladies à
transmission
vectorielle et des
maladies
contagieuses
- Interdire aux travailleurs de se
rendre dans les localités et
leur exiger un code de bonne
conduite
- Former les employés sur les
comportements inappropriés
et les sanctions encourues
- Mettre en œuvre des actions
contre les VBG
- Consulter les okals pour
identifier des préoccupations
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une sensibilisation sur
le code de conduite
- Nombre d’infractions au
code de conduite reportées
en lien avec une VBG
- Nombre de réunions avec
les okals (par lieu)
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
- Rapport de suivi des infractions
de l’entreprise contractante et
ses sous-traitants
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
Impact 8-
Augmentation de
l'incidence des
maladies
transmissibles, en
particulier des
MST
- Interdire aux travailleurs de se
rendre dans les localités et
leur exiger un code de bonne
conduite
- Sensibiliser les travailleurs et
la population aux pratiques
sexuelles sûres
- Consulter les okals pour
identifier des préoccupations
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une sensibilisation sur
les MST
- Nombre de personnes
locales ayant reçu une
sensibilisation sur les MST
(par âge, sexe et lieu)
- Nombre de réunions avec
les okals (par lieu)
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
251
Impact 9-
Augmentation de
l'incidence de la
COVID-19
- Sensibiliser les travailleurs et
les populations aux protocoles
sanitaires ;
- Campagnes d’information
pour reconnaitre les
symptômes du virus et
isolement des personnes
malades ;
- Mise en place d’infirmeries
sur les bases-vies et visite
médicale auprès des
populations locales.
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une sensibilisation sur
le mode de transmission du
virus ;
- Nombre d’infirmiers ou de
médecins accompagnant les
travailleurs ;
- Nombre de personnes
montrant les symptômes du
virus.
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
- Rapport des infirmiers ou
médecins sur place.
Impact 10-
Augmentation des
risques
d’accidents pour
la population
locale
- Exiger à l’entreprise
contractante un plan de
gestion du trafic
- Marquer et sécuriser les
zones de construction
- Equiper les pylônes de
dispositifs anti-escalade et de
panneaux
- Informer la population locale
des dangers de la ligne
- Nombre d’accidents parmi la
population locale
- Présence du marquage
exigé sur les sites de
construction et les pylônes
- Nombre de réunions
communautaires (par lieu)
- Rapport de suivi des accidents
de l’entreprise contractante
- Visite de supervision des sites
de construction
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
Impact 11-
Pression accrue
sur les services
de base du fait de
l’afflux de
travailleurs
- Exiger à l’entreprise
contractante de proposer des
services de base
indépendants des services
locaux existants.
- Consulter les okals pour
identifier des incidents
- Poste de santé ouvert dans
les camps
- Systèmes d’eau potable
dans les camps
- Mécanisme de gestion des
déchets des camps
- Nombre de réunions avec
les okals (par lieu)
- Visite de supervision des
campements
- Liste de participants et compte-
rendu des réunions
IMPACTS SUR LA SANTE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
252
Impact 12-
Risques de
discrimination
des travailleurs
- Définir une politique de
recrutement claire et
transparente
- Promouvoir le recrutement
des populations locales, des
jeunes et des femmes
- Proposer des mesures de
prévention contre le
harcèlement sexuel
- Nombre d'emplois directs
(par sexe, âge et lieu de
résidence)
- Nombre de travailleurs
formés sur le harcèlement
(par sexe, âge et lieu de
résidence)
- Salaires et contrats de travail
signés du personnel
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
Impact 13-
Risques de
conditions de
travail non
adéquates
- Définir les principes de
gestion des employés de
l'entreprise contractante et
sous-traitants
- Assurer un mécanisme de
gestion des griefs anonyme et
connu des employés
- Loger les travailleurs selon les
normes internationales
- Exiger à l’entreprise
contractante de faire
respecter les points
précédents par les sous-
traitants
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une fiche de paie et un
contrat de travail
- Nombre d'heures
supplémentaires payées et
nombre de congés payés
- Nombre de plaintes posées
et traitées
- Adéquation des campements
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une formation sur le
MGM
- Salaires et contrats de travail
signés du personnel
- Rapport de suivi des plaintes de
l’entreprise contractante et des
sous-traitants
- Visite de supervision des
campements
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
Impact 14-
Expositions des
travailleurs à des
risques
physiques et
chimiques
- Suivre les exigences de santé
et sécurité au travail
- Fournir un équipement
adéquat aux travailleurs
- Former les travailleurs en
santé et sécurité au travail
- Equiper les pylônes d'un
système d'identification
- Proposer des inspections de
ligne via des drones
- Exiger aux sous-traitants les
mêmes normes
- Nombre de travailleurs ayant
reçu une formation en santé
et sécurité
- Détection de travailleurs
sans équipement adéquat
- Nombre d'accidents du
travail déclarés à la sécurité
sociale (ventilé selon la
gravité de l'accident)
- Nombre d’inspections
réalisées via drone
- Liste de participants et compte-
rendu de formation
- Visite de supervision des sites
de construction
- Rapport de suivi des accidents
de l’entreprise contractante et
des sous-traitants
IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
253
7.4.4 Indicateurs de suivi-évaluation des mesures d’atténuation environnementales
Tableau 15 : Système de suivi-évaluation des mesures d’atténuation environnementale
Description de
l'impact
Mesures d'atténuation ou optimisation Indicateurs
de suivi Sources de vérification
Impact 1 –
Dégradation de
la qualité de l'air
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise pour la
phase de construction. La mise en œuvre de bonnes pratiques
de gestion environnementale et sociale standard suffira. Les
émissions de poussière provenant de diverses activités telles
que l'excavation, le transport des matériaux
(chargement/déchargement) et le déplacement de véhicule en
général peuvent être réduites au maximum grâce aux respects
des bonnes pratiques de chantier
Mesures AQI
& PM 2.5 Rapports
Rapports de maintenance
des machines et des
véhicules
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise pour la
phase de construction. La mise en œuvre de bonnes pratiques
de gestion environnementale et sociale standard suffiront :
- les émissions de poussières dues au déplacement des
véhicules de maintenance pourront être réduites au maximum
grâce aux limitations de vitesse sur le site, c'est-à-dire ne pas
dépasser 40 km/h le long des routes non pavées ou 20 km/h
le long des zones non consolidées.
- Les émissions d'échappement des véhicules seront
contrôlées également grâce à un entretien approprié des
véhicules.
Mesures AQI
& PM 2.5
Rapports
Rapports de maintenance
des machines et des
véhicules
Impact 2 –
Emissions
sonores
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques de gestion environnementale
standard suffira.
- Protection auditive recommandée (bouchons d'oreille) pour
les travailleurs sur site
Niveau
d'émission
sonore
Plaintes reçues
Rapports de suivi
Aucune mesure d'atténuation n'est requise.
Impact 15-
Détérioration de
sites d’héritage
culturel
- Eviter d’inclure des biens
culturels dans les zones
d’acquisition temporaire et
permanente
- Compenser et déplacer les
biens ne pouvant être évités
- Informer et consulter les okals
et la population durant tout le
processus
- Nombre de tombes affectées
(par lieu)
- Nombre de tombes réparées
(par lieu)
- Nombre de tombes
déplacées (par lieu)
- Rapport de suivi de l‘entreprise
contractante
- Rapport de suivi du CPR
- Contrats signés avec les
personnes affectées
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
254
Impact 3 –
Impact sur la
géologie et la
géomorphologie
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques de gestion environnementale
standard est recommandée :
- Réaliser une évaluation ou une étude géotechnique pour la
conception détaillée des pylônes et du poste de Nagad ;
- Restreindre les activités de terrassement aux zones de
construction strictement nécessaires
Zone
couverte par
l'activité de
construction
Rapport d'enquête
Impact 4 -
Changements
dans les
processus de
sédimentation
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise.
La mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion
environnementale standard est recommandée :
- Limiter le défrichement de la végétation et l'effeuillage de la
terre aux zones strictement nécessaires ;
- Utiliser au maximum les routes existantes, lorsque cela est
possible, pour minimiser les impacts sur les sols intacts ;
- Minimiser l’exposition du sol pendant les périodes de fortes
pluies lors des excavations et des activités de terrassement ;
- Veiller à ce que toutes les zones de construction de lignes
électriques et de postes fassent l’objet d’un examen adéquat
par des ingénieurs géotechniques et des géologues afin de
détecter les sols expansibles/affaissés et les zones de pentes
potentiellement instables avant la construction.
Modification
des schémas
d’utilisation
des sols et de
la superficie
couverte
Rapport d’état
d’avancement du projet/
visite sur le terrain.
Impact 5 –
Augmentation du
compactage et
de l’érosion des
sols
Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées :
- Privilégier l’utilisation des voies d’accès existantes pour
accéder aux sites de travail ;
- Limiter le défrichement de la végétation aux zones
strictement nécessaires à la construction ;
- Stocker la terre végétale avant les activités de terrassement
pour la réutiliser ultérieurement dans les travaux de
réhabilitation ;
- Protéger les sols stockés temporairement ;
- Éviter la construction de pylônes dans les plaines et les
zones de pente importantes afin de réduire les risques
d’érosion du sol par la pluie et le vent.
Schéma
d’utilisation
des sols
Zone
exposée à
l’érosion
Rapport d’état
d’avancement du projet
/visite sur le terrain.
Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées :
- Privilégier l’utilisation des voies d’accès existantes pour
accéder aux sites de travail ;
- Limiter le défrichement de la végétation aux zones
strictement nécessaires à la construction ;
- Stocker la terre végétale avant les activités de terrassement
pour la réutiliser ultérieurement dans les travaux de
Zone
exposée à
l’érosion
Rapports de suivi réguliers
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
255
réhabilitation ;
- Protéger les sols stockés temporairement ;
- Éviter la construction de pylônes dans les plaines et les
zones de pente importantes afin de réduire les risques
d’érosion du sol par la pluie et le vent.
Impact 6 –
Contamination
potentielle des
sols
Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées :
- Si une fuite se produit, une procédure d’urgence doit être
entamée pour réduire immédiatement la propagation
potentielle du polluant ;
- Interdire le déversement de tout type d’eau résiduelle non
traitée dans le sol et/ou les ressources en eau (plans d’eau
saisonniers, aquifères, etc.) ;
- Gestion des déchets.
Propreté du
site
Présence
d’installations
de collecte,
de tri et de
gestion des
déchets
Rapport d’état
d’avancement du projet
/visite sur le terrain.
Les mesures d’atténuation suivantes sont recommandées :
- Si une fuite se produit, une procédure d’urgence doit être
entamée pour réduire immédiatement la propagation
potentielle du polluant ;
- Interdire le déversement de tout type d'eau résiduelle non
traitée dans le sol et/ou les ressources en eau (plans d'eau
saisonniers, aquifères, nappes phréatiques);
- Élaborer un plan de gestion des déchets, en suivant les
lignes directrices fournies dans le PGES.
La propreté
du site
Présence
d'installations
de collecte,
de tri et de
gestion des
déchets
Rapport d’état
d’avancement du projet
/visite sur le terrain.
Impact 7 -
Paysage et
impacts visuels
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de pratiques de gestion environnementale standard
est recommandée. Plusieurs mesures peuvent cependant être
appliquées pour réduire, dans la mesure du possible, les
effets temporaires pendant la phase de construction. Il s'agit
notamment des mesures suivantes
- Limiter le défrichement et l'occupation des sols au minimum
nécessaire pour les travaux ;
- Limiter l'éclairage du chantier en dehors des heures
normales de travail, autant que possible, au minimum
nécessaire pour la sécurité et la sûreté ; et
- Maintien de la propreté et du confinement du site.
Changement
du mode
d'utilisation
des terres
Rapport d’état
d’avancement du projet
/visite sur le terrain.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
256
Tous les impacts visuels sur le paysage ne peuvent être
techniquement atténués pendant la phase de construction et
d'exploitation en raison de la présence de certains éléments
de construction de haute envergure.
En raison de la hauteur de la plupart des éléments du projet,
du paysage dégagé et de l'absence de végétation naturelle, il
ne sera pas possible de réaliser une protection visuelle en
utilisant de la végétation et il est peu probable que l'on puisse
atténuer les impacts visuels sur le paysage pendant
l'exploitation. En outre, il est peu probable qu'une plantation
s'établisse et atteigne les hauteurs nécessaires à camoufler
les infrastructures, en raison des conditions climatiques
difficiles existantes.
-
Impact 8 -
Changements
potentiels du
schéma de
ruissellement
naturel
Aucune mesure d'atténuation n'est requise. -
Impact 9 -
Émissions de
gaz à effet de
serre (GES)
Aucune mesure d'atténuation n'est requise. -
Impact 10 - Perte
directe d'unités
de végétation et
d'habitats
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées :
- Limiter strictement le défrichement de la végétation aux
zones requises, en particulier dans les zones d'habitats
naturels ;
- Dans la mesure du possible, mettre les arbres coupés à la
disposition des communautés locales pour qu'elles les
ramassent et les utilisent comme matériaux de construction ou
à d'autres fins ;
- Éviter de situer les camps de construction dans les habitats
naturels ;
- Éviter d'installer des pylônes et des routes d'accès dans les
oueds,
- Réhabiliter et revégétaliser les routes d'accès temporaires et
les zones de travail dès que possible dans le cadre des
travaux ou de micro-projets suivis par l’ingénieur conseil et la
maitrise d’œuvre environnementale
- Le tracé de la ligne de transmission chevauche la zone du
Changement
du mode
d'utilisation
des terres
Rapport d’état
d’avancement du projet
/visite sur le terrain.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
257
projet de la Grande Muraille Verte. La perte de couverture
végétale peut être compensée par la plantation d'arbres
locaux dans le cadre d'initiatives d'agroforesterie et de
reboisement en partenariat avec le projet de la Grande
Muraille Verte
Impact 11 -
Suppression de
la faune en
raison des
perturbations
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de pratiques environnementales standard suffira,
telles que :
- Limiter le défrichement de la végétation aux zones requises,
en particulier dans les zones d'habitats naturels et les oueds ;
- Dans la mesure du possible, des nouveaux accès
temporaires seront créés sur la base des accès existants ;
- Les activités de défrichement de la végétation seront
accompagnées par un spécialiste en écologie/biologie ; pour
détecter tout site important de reproduction à proximité des
zones de défrichement et mettre en œuvre des mesures de
précaution ;
- Éviter autant que possible les travaux de construction
pendant la nuit, lorsque cela est possible ;
- Minimiser l'éclairage dans les camps de construction ;
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets.
Repérage de
la faune
locale
Rapports de suivi réguliers
Impact 12 –
Augmentation de
la mortalité des
espèces de
faune due aux
mouvements de
véhicules et aux
activités de
construction
Aucune mesure d'atténuation spécifique n'est requise. La mise
en œuvre de bonnes pratiques environnementales standard
suffira. Les mesures d'atténuation inhérentes et les pratiques
suivantes doivent être incorporées dans la construction du
projet, telles que
- Les restrictions de vitesse sur le site seront mises en place
et tous les conducteurs de véhicules devront les respecter.
- Entreprendre une formation de sensibilisation des
conducteurs sur les espèces présentes dans la zone qui
peuvent être percutées par des véhicules.
- Mettre en place un système d'exploitation forestière exigeant
aux travailleurs et aux chauffeurs de signaler toute
observation ou collision d'espèces animales et ainsi permettre
l'identification et la mise en œuvre de mesures d'atténuation
supplémentaires si nécessaire (par exemple, utilisation de
coupe-vitesse près des zones identifiées comme à haut
risque, clôtures, réflecteurs de lumière).
- Vérifier les relevés des zones de construction chaque matin
afin de détecter les reptiles, en particulier les serpents, qui
auraient pu pénétrer dans les zones de construction, les
Évolution de
la mortalité
faunique
Rapports des visites de
terrain
(Rapports d'incidents)
Rapports sur les études
écologiques post
construction
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
258
tranchées, etc. pendant la nuit.
Impact 13 -
Fuites et
déversements
accidentels
entraînant une
dégradation de
l'habitat naturel
Aucune mesure d'atténuation ou de gestion environnementale
ou sociale n'est requise. Les lignes directrices générales en
matière d'ESS doivent être suivies.
- -
Impact 14 - I
Augmentation de
la mortalité des
oiseaux
migrateurs par
électrocution et
collision en
raison de la
présence d'une
ligne de
transmission
aérienne
Les mesures d'atténuation suivantes devraient être mises en
œuvre pour réduire les risques de collision et d'électrocution
principalement dans les sections des projets situées à
proximité des zones à haute densité d'oiseaux (Assamo,
Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul Kabah
Kabah) :
Réduire les risques de collision :
- Utiliser des déflecteurs d'oiseaux dans les zones à fort
impact, en particulier le long des voies de migration. Ces
déflecteurs devraient augmenter la visibilité de la ligne en
épaississant l'apparence de la ligne d'au moins 20 cm sur une
longueur de 10 à 20cm;
- Des marqueurs doivent être mobiles, de couleurs
contrastées (par exemple noir et blanc), doivent contraster
avec le paysage, dépasser au-dessus et en dessous de la
ligne et être placés à 5-10 m l'un de l'autre ;
- Enlever le mince fil neutre ou de terre (blindage) au-dessus
des lignes de transmission à haute tension lorsque cela est
possible, et lorsque cela n'est pas possible, marquer la ligne
pour la rendre plus visible ;
- Regrouper les fils à haute tension et utiliser des entretoises
pour accroître la visibilité ;
Réduire les risques d’électrocution :
- Concevoir des lignes électriques et des pylônes adaptés
pour réduire le risque d'électrocution ;
- Suspendre des isolateurs sous les poteaux, à condition que
la distance entre un perchoir probable (principalement le bras)
et les parties sous tension (conducteurs) soit d'au moins 70
cm ;
Évolution de
la mortalité
des oiseaux
migrateurs
par
électrocution
ou collision
Rapports des visites de
terrain
(Rapports d'incidents)
Rapports sur les études
écologiques post
construction
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
259
- le recouvrement des isolateurs avec un matériau non
conducteur et l'utilisation d'un matériau non conducteur pour
fixer les isolateurs aux poteaux ;
- Isoler les câbles à proximité des poteaux, sur au moins 70
cm des deux côtés et autour des zones de perchage, et
jusqu'à au moins 140 cm dans les zones où se trouvent
d'importantes volées d'oiseaux ;
- Lorsque le poteau est en acier, isoler toutes les lignes
conductrices ;
- Sur les structures de traction où des câbles sont utilisés, au
moins deux fils de connexion doivent être suspendus sous la
traverse et le troisième doit être isolé, ou tous les câbles
doivent être isolés ;
- Prévoir des plates-formes de nidification et de perchage
sûres au-dessus des poteaux, à une hauteur minimale de 70
cm au-dessus des éléments sous tension, ou plus haut selon
les espèces présentes ;
- L'espacement entre les conducteurs ne doit pas être inférieur
à 140 cm, et 70 cm entre les sites de perchage et les
composants sous tension ;
- Dans les zones où se trouvent des grandes volées d'oiseau,
l'espacement entre les composants sous tension ou l'isolation
devrait être supérieur à 2,7 m horizontalement et à 1,8 m
verticalement ;
- prévoir des zones de perchage sûres et utiliser des
techniques de gestion des perchoirs ;
Mener des enquêtes post-construction (recherches de
carcasses et enquêtes de mortalité et évaluation des
perturbations et des déplacements) sur les points chauds
prévus et connus (tels que les zones sensibles aux oiseaux
d'Assamo, Djalelo, Dikhil, Yoboki, Hanle Gamarre et Ougul
Kabah Kabah) à intervalles réguliers pendant au moins trois
ans.
Impact 15 -
Défrichement de
la végétation
entraînant la
perte d'habitats
et d'espèces
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en
œuvre pendant la phase de construction du projet :
- Des études de contrôle des oiseaux nicheurs devraient être
entreprises avant le déblaiement de toute végétation. Si des
nids actifs sont enregistrés, le nettoyage de la végétation doit
être retardé jusqu'à ce que la nidification soit terminée et que
la zone de nidification soit protégée des perturbations dans un
Évolution de
l'abondance
des oiseaux
migrateurs et
locaux
Rapports sur les études
écologiques post
construction
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
260
rayon défini par un ornithologue dûment qualifié.
- Les pylônes et les voies d'accès ont été situés en dehors des
canaux des oueds dans la mesure du possible.
- La perte d'habitat sera limitée au minimum nécessaire pour
une mise en œuvre sûre des travaux.
Impact 16 -
Activité et
nuisance sonore
entraînant une
perturbation des
espèces
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en
œuvre pendant la phase de construction du projet :
- Éviter, dans la mesure du possible, le dynamitage et le
martèlement des roches pendant la saison de reproduction.
- Le PGES détaillera les meilleures pratiques, y compris celles
ci-dessus ainsi que d'autres mesures à mettre en œuvre pour
réduire le risque d'impacts secondaires sur les oiseaux,
notamment pour contrôler la poussière, le bruit et l'activité
générale.
Évolution de
l'abondance
des oiseaux
migrateurs et
locaux
Rapports sur les études
écologiques post
construction
Impact 17 –
Menace sur
l'intégrité de
zones protégées
terrestres
traversées par la
ligne électrique
Les mesures d'atténuation suivantes doivent être mises en
œuvre :
- Modifier légèrement la localisation de la ligne électrique pour
éviter de traverser la zone protégée de Djalelo en déplaçant
un pylône dans la direction sud-est afin de s'assurer que la
ligne électrique ne traversera pas cette zone et respectera une
zone tampon de 1 km de distance
-
-
7.4.5 Mécanisme de gestion des plaintes
Plusieurs types de mécontentements peuvent apparaître liés aux différents impacts décrits dans cette étude mais aussi
au sein des travailleurs, c’est pourquoi il est nécessaire de proposer un mécanisme de gestion des plaintes.
Un mécanisme de gestion des plaintes a été proposé dans le Plan de mobilisation des parties prenantes du
présent projet et est présenté dans le PGES. Il a servi de cadre à la proposition de mécanisme de gestion de
plainte qui devra être suivi durant le processus de compensation et réinstallation. L’EDD a la charge du traitement
des plaintes et devra pour ce faire désigner un agent expert en sauvegardes sociales et participation
communautaire. L’EDD s’appuiera aussi sur la maitrise d’œuvre sociale pour l’assister dans la gestion et
documentation des plaintes.
Le mécanisme de gestion des plaintes s’applique aux personnes affectées par le projet et constitue un moyen
structuré de recevoir et de régler une préoccupation soulevée par un individu ou une communauté qui estiment
avoir été lésés par le projet ou par les conditions de travail. Les plaintes et griefs sont traités promptement selon
un processus compréhensible et transparent, approprié sur le plan culturel, gratuit et sans représailles.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
261
Le projet accordera la priorité à la négociation et à la conciliation à l’amiable. En l’absence d’une entente à
l’amiable entre les plaignants et le projet, les plaignants seront informés par l’EDD, l’entreprise contractante et
ses sous-traitants de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs plaintes.
L’EDD mettra en place des Comités de médiation pour le traitement des plaintes au niveau de chaque région.
Ces comités traiteront en particulier les plaintes en relation avec l’acquisition de terres et les restrictions d’usages.
Ils seront composés des huits personnes suivantes :
Un agent de l’EDD expert en sauvegardes sociales et participation communautaire
Un expert de l’entreprise chargée des travaux HSE et/ou spécialisé en Sauvegardes Sociales et
environnementale
Un expert ingénieur conseil de l’entreprise chargée de la supervision HSE et/ou spécialisé en
Sauvegardes Sociales et environnementale
Le préfet de la région concerné (Arta, Ali Sabieh ou Dikhil)
Un représentant des autorités coutumières et traditionnelles (okals) de la région
Une représentante des associations des femmes de la région
Un représentant des individus ou groupes vulnérables de la région
Le Président du Conseil Régional
Le Comité de médiation entreprendra un suivi en temps opportun avec les parties prenantes pour s'assurer que la
plainte consignée a été traitée de manière appropriée et que le plaignant juge la résolution satisfaisante.
7.4.6 Consultations
L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations et des instances
publiques au processus de planification des actions du projet. Les comptes rendus de ces consultations sont
présentés en annexe de cette étude.
Courant août 2020, les équipes d’Insuco et de l’EDD ont rencontré des chefs coutumiers de la région de Dhikil,
des okals de la région d’Ali Sabieh, un groupe de femmes de la région de Dhikil et l’association des femmes de
Holl holl afin de collecter leurs craintes et leurs attentes concernant le projet.
Les attentes principales vis-à-vis du projet sont les suivantes :
Une communication sur le tracé de la future ligne aussi tôt que possible ;
Des opportunités de travail pour les jeunes des villages à proximité de la ligne ;
Opportunités de travail pour les femmes ;
Une augmentation du volume de production d’électricité ;
Une diminution des couts de l’électricité ;
L’alimenter des petites villes non raccordées et la constitution d’un plan d’urgence pour des solutions à
court terme des coupures récurrentes ;
L’implication des okals à chaque étape de la construction de la ligne et dans la résolution des conflits.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
262
De même les équipes d’Insuco et de l’EDD ont échangé avec les notables et élus des différentes régions
concernées. Les attentes sont sensiblement les mêmes que celle des populations locales :
La population, le cheptel et les pâturages ne devront pas être affectés ou restreints par ce projet ;
Un meilleur raccordement au réseau pour les populations qui vont supporter les lignes HT sur leur
territoire et la pollution visuelle du territoire ;
Les emplois doivent être fournis en priorité à la population locale, notamment pendant la phase de
construction.
Une diminution du tarif actuel de l’électricité : le tarif de l’électricité est trop élevé pour la population locale
qui est en situation précaire. Les intervenants demandent un tarif adapté à la population. Ce tarif doit
concerner les couches sociales les plus défavorisées mais aussi les commerces. Il semble incohérent de
faire payer un ménage ou un commerce d’Alli Sabieh de la même manière qu’un ménage ou un
commerce de Djibouti, alors que les conditions de vie et de commerce des uns et des autres ne sont pas
comparables.
Une diminution des chutes de tension et des coupures de réseau surtout pendant l’été ;
Des informations précises concernant le déroulement des travaux
Enfin, dans une démarche d’information, l’EDD et l’équipe d’Insuco sont aussi allés rencontrer les ministères
suivants afin de leur présenter le projet :
- Le Ministère de l’environnement ;
- Le Ministère du transport ;
- Le Ministère de l’énergie
- Le Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'élevage et des Ressources Halieutiques.
7.5 Budget et chronogramme
7.5.1 Calendrier de mise en œuvre
Le tableau ci-dessous indique le calendrier de mise en œuvre du PGES jusqu’à 2030, sachant que toute la phase
d’opération de 40 ans requière la mise en œuvre des mêmes plans de gestion qui sont le Plan de Mobilisation
des Parties prenantes, le manuel de gestion de la main-d’œuvre et le plan d’action contre les VBG.
Tableau 16- Calendrier de mise en œuvre
Étude Construction Opération
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Finalisation du design
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
263
du projet
Plan de Mobilisation
des Parties Prenantes
Cadre de Politique de
Réinstallation
Plan d'Action de
Réinstallation
Manuel de gestion de
la main d'œuvre
Plan d'action contre
les VBG
Développement Mise en œuvre
Avant de mettre en œuvre le PGES, il sera nécessaire de le partager avec les parties prenantes pour recueillir les
commentaires de la population et des autorités locales qui ont déjà été consultées lors du processus de
formulation de l’EIES, comme détaillé dans le PMPP.
Le design du projet doit également être finalisé au plus vite avec la maitrise d’œuvre technique pour que le PAR
puisse être formulé prochainement et être opérationnel immédiatement au début de la phase de construction. Les
autres plans seront utilisés durant toute la vie du projet.
7.5.2 Budget estimatif
Le budget ci-dessous est estimatif. Les chiffres sont donnés sur la base d’expérience de projets similaires dans le
pays.
En termes de personnel, il est prévu de destiner des superviseurs HSE de l’EDD (ou un expert environnemental
et un expert social) à la mise en œuvre du PGES. Lors de la phase de construction, ils travailleront à temps plein
sur le projet en se partageant à 25% sur le PMPP, à 25% sur la supervision du PAR, à 25% sur le suivi du MGM
et à 25% sur le PA-VBG. Lors de la phase d’opération, il passera à mi-temps sur le projet en se partageant à 25%
sur le PMPP, à 12,5% sur le MGM et à 12,5% sur le PA-VBG.
Tableau 17- Budget estimatif de mise en œuvre du PGES
Plans d’action Objet Description Quantité PU (€) Total (€)
Plan de Mobilisation
des Parties
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE + 4 agents
1 forfait 75.000
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
264
Prenantes communautaires
Opération : 0,25 superviseurs
HSE
Consultations publiques Construction : 8/an
Opération : 4/an
176 200 35.200
Impression support
d'information
Montant forfaitaire 1 forfait 15.000
Mise en œuvre du
mécanisme de gestion
des plaintes
Montant forfaitaire 1 forfait 20.000
Plan d'Action de
Réinstallation
Elaboration du PAR Montant forfaitaire 1 forfait 70.000
Mise en œuvre Montant forfaitaire + 0,25
superviseurs HSE
Non connu
Procédure de
gestion de la main
d'œuvre
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE
Opération : 0,125 superviseurs
HSE
1 forfait 33.000
Formations Construction : 26/an (dont 2
santé) Opération : 1/an
52
40
400
400
38.400
16.000
Mécanisme de gestion
des plaintes
Suivi des plaintes 1 forfait 5.000
Procédure de
gestion de la main
d’œuvre (entreprise
contractante, forfait
à inclure dans le
DAO)
Personnel / formation /
suivi-évaluation / gestion
sous-contractants
Montant forfaitaire 1 forfait 30.000
Plan d'action contre
les VBG (EDD)
Personnel Construction : 0,25 superviseurs
HSE
Opération : 0,125 superviseurs
HSE
1 forfait 33.000
Personnel Expert genre (temps partiel) 1 forfait 16.500
Formations Construction : 24/an
Opération : 1/an
88 400 35.200
Sensibilisation des
travailleurs
Montant forfaitaire : 2/an 2 400 800
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
265
Impression support
d'information
Montant forfaitaire 1 forfait 15.000
Facultatif - Personnel Construction : 1 agent de
vérification indépendant pour
des missions courte (30 jours
par an)
1 forfait 15.000
Plan d'action contre
les VBG (entreprise
contractante, forfait
à inclure dans le
DAO)
Personnel/formation/suivi-
évaluation
Montant forfaitaire 1 forfait 30.000
Service d’appui aux
victimes (transport, soin,
etc)
Montant forfaitaire 1 forfait 10.000
Disposition contre la
propagation de la
COVID-19
Equipement
Formations
Equipement de protection
individuel (masque, gel
hydroalcoolique), mise aux
normes sanitaires
Tests de dépistage
Information et communication
sur le virus et les dispositions
anti-COVID 19
1 forfait 20.000
Activités de suivi interne du PGES 7% du total 31.017
Activités de suivi externe du PGES 5% du total 22.155
Total EDD (sans forfait inclus dans DAO)
496.272
Total PGES (sans mise en œuvre du PAR) 566.272
A ce stade du projet, il n’est pas possible de présenter un budget réaliste de mise en œuvre du PAR : cela
demandera tout d’abord d’avoir le design final du projet et l’emplacement des pylônes pour inventorier les biens
affectés et identifier les besoins de compensations de biens et déplacements de tombes.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
266
8 Annexes
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
267
8.1 Cartes de l’occupation actuelle des sols
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
268
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
269
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
270
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
271
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
272
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
273
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
274
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
275
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
276
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
277
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
278
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
279
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
280
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
281
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
282
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
283
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
284
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
285
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
286
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
287
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
288
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
289
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
290
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
291
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
292
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
293
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
294
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
295
8.2 Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO et les marchés
de travaux du projet
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels
d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent
intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du
milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de
nuisances environnementales et sociales. Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels
d’offres ou de marchés d’exécution des travaux.
Paramètres Environnementaux et Sociaux à considérer dans les contrats d’exécution des travaux
d’infrastructures
• S’assurer de planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la végétation pour
compenser d’éventuels abattages
• Eviter le plus que possible de détruire les habitats d’animaux ;
• Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ;
• Ne pas obstruer le passage aux riverains ;
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ;
• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ;
• Eviter d’endommager la végétation existante ;
• Eviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable et inapte à
l’infiltration ;
• Eviter de nuire la population locale en utilisant des matériels qui font beaucoup de bruit ;
• Ne pas brûler des déchets sur le chantier ;
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux ;
• Intégrer le plus que possible les gens de la communauté pour éviter les conflits entre le personnel de
chantier et la population locale.
• Eviter le dégagement des mauvaises odeurs lié à la réparation des latrines ;
• Procéder à la gestion rationnelle des carrières selon les réglementations en vigueur ;
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
296
• Sensibiliser le personnel de chantier sur les maladies transmissibles, les IST/VIH/SIDA et les moyens de
prévention face au Covid 19
• Respecter les sites culturels ;
• Tenir compte des nuisances (bruit, poussière) et de la sécurité de la population en organisant le chantier ;
• Eviter tout rejet des eaux usées dans les rigoles de fondation, les carrières sources de contamination
potentielle de la nappe phréatique et de développement des insectes vecteurs de maladie ;
• Eloigner les centres d’entreposage le plus que possible des maisons, des églises, etc. ;
• Arroser pour réduire la propagation de la poussière ;
• Eviter tout rejet d’eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de
polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fosses de drainage, etc. ;
• Installer des structures permettant d’éviter l’obstruction des réseaux d’assainissement pour ne pas
exposer le bâtiment à l’inondation ;
• Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ;
• Prendre et veiller à l’application de mesures de sécurité pour le personnel de chantier ;
• Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier.
a. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
1. Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entreprise contractante et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de
rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les
atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de
l’environnement.
2. Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entreprise contractante doit se procurer tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les
collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas
d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
297
publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux,
l’Entreprise contractante doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements
facilitant le déroulement des chantiers.
3. Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entreprise contractante et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la
zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser
et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés.
Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
4. Préparation et libération du site
L’Entreprise contractante devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de
champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un
calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début
des travaux, l’Entreprise contractante doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement
payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.
5. Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, l’Entreprise contractante doit instruire une procédure de repérage des réseaux
des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-
verbal signé par toutes les parties (Entreprise contractante, Maître d’œuvre, concessionnaires).
6. Libération des domaines public et privé
L’Entreprise contractante doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises
privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.
7. Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entreprise contractante doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
298
l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les
implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier
indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;
(iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode
de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques
d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures
de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.
Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: l'organigramme du personnel
affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ; le
plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de
l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites
privés.
b. Installations de chantier et préparation
8. Normes de localisation
L’Entreprise contractante doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins
possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites
existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entreprise
contractante doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.
9. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
L’Entreprise contractante doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entreprise contractante doit sensibiliser son
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.
10. Emploi de la main d’œuvre locale
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
299
L’Entreprise contractante est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il
est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.
11. Respect des horaires de travail
L’Entreprise contractante doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en
vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en
cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entreprise contractante doit éviter d’exécuter les travaux
pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
12. Protection du personnel de chantier
L’Entreprise contractante doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités
(casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entreprise contractante doit veiller au port
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et,
en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au
personnel concerné.
13. Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entreprise contractante doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous
les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le
chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son
personnel. L’Entreprise contractante doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des
panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres à éviter les accidents.
14. Désignation du personnel d’astreinte
L’Entreprise contractante doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y
compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entreprise
contractante est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans
exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident
susceptible de se produire en relation avec les travaux.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
300
15. Mesures contre les entraves à la circulation
L’Entreprise contractante doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entreprise contractante veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entreprise contractante doit
veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger et proposer des panneaux de
signalisation, pour les sorties de camions au niveau des travaux de chantier.
c. Repli de chantier et réaménagement
16. Règles générales
A toute libération de site, l'Entreprise contractante laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut
être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait
constater ce bon état. L'Entreprise contractante réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état
des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les
environs.
Une fois les travaux achevés, l’Entreprise contractante doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les
déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et
régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées,
en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées
ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres
ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être
décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une
utilisation future, l'Entreprise contractante doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations
permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entreprise contractante et remis dans un état
équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état
initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entreprise contractante doit
scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements
de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet
autorisés.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
301
En cas de défaillance de l'Entreprise contractante pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont
effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du
défaillant.
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au
procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des
travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera
retenu pour servir à assurer le repli de chantier.
17. Protection des zones instables
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entreprise contractante doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la
zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des
espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
18. Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires
L’Entreprise contractante doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en
rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert
végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert
végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv)
zone de loisir ; écotourisme, entre autres.
19. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants
L’Entreprise contractante doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.
20. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par
l’Entreprise contractante est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.
21. Notification
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
302
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entreprise contractante tous les cas de défaut ou non-exécution des
mesures environnementales et sociales. L’Entreprise contractante doit redresser tout manquement aux
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires
découlant du non-xrespect des clauses sont à la charge de l’Entreprise contractante.
22. Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment
constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entreprise contractante ayant fait
l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des
sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître
d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.
23. Réception des travaux
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entreprise contractante au refus de réception provisoire ou
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et
sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.
24. Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entreprise contractante courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.
d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
25. Signalisation des travaux
L’Entreprise contractante doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit
utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.
26. Mesures pour les travaux de terrassement
L’Entreprise contractante doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le
décapage de la couche de sol arable, l’Entreprise contractante doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
303
réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entreprise contractante doit déposer les déblais non
réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des
zones de remblais préalablement autorisées.
27. Mesures de transport et de stockage des matériaux
Lors de l’exécution des travaux, l’Entreprise contractante doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier
par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de
circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et
routes existantes dans la mesure du possible.
Dans les zones d'habitation, l’Entreprise contractante doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui
doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la
circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins
doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en
cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée
solidement. L’Entreprise contractante doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de
projections, émanations et chutes d’objets.
L’Entreprise contractante peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont
pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces
zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit
usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors
des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.
28. Mesures pour la circulation des engins de chantier
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de
passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
304
L’Entreprise contractante doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la
traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée.
Les véhicules de l’Entreprise contractante doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code
de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.
L’Entreprise contractante devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement
les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des
zones habitées.
29. Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants
L’Entreprise contractante doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses
de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La
livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les
conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident.
Les opérations de dépotage vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les
citernes doivent être déposées sur des plates formes étanches avec un muret d’au moins 15 cm de hauteur pour
éviter d’éventuels écoulements en cas de fuite.
L’Entreprise contractante doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une
distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à l’extérieur
de toute zone inondable et d’habitation..
L’Entreprise contractante doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par
une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être
fermés quand ils ne sont pas utilisés.
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre
afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers
et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement
accidentel.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
305
30. Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers
L’Entreprise contractante doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et
le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les
déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs
doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. L’Entreprise contractante doit mettre en
place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles,
pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur,
téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.).
31. Protection des zones et ouvrages agricoles
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales
périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être connues afin d'adapter
l'échéancier à ces périodes. L’Entreprise contractante doit identifier les endroits où des passages pour les
animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est primordiale.
32. Protection des milieux humides, de la faune et de la flore
Il est interdit à l’Entreprise contractante d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le
comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entreprise contractante doit s'adapter à la
végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour
toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entreprise contractante pour les
besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.
33. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
L’Entreprise contractante doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela,
elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entreprise
contractante doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute
destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
306
dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à
l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et
archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.
34. Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le
Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir
disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni
enfuis sous les matériaux de terrassement. Les arbres avant d’être abattus requièrent d’abord une autorisation,
puis sont cédés à la population.
35. Prévention des feux de brousse
L’Entreprise contractante est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux,
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés
par les autorités compétentes.
36. Approvisionnement en eau du chantier
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entreprise contractante. L’Entreprise
contractante doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau
utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entreprise contractante d’utiliser les services publics
d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux
souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entreprise contractante doit adresser une demande d’autorisation au
service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur.
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par
chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est
pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entreprise contractante doit prendre des
mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et
en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser
l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entreprise contractante doit
aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».
37. Gestion des déchets liquides
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
307
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses
septiques, lavabos et douches). L’Entreprise contractante doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les
installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entreprise contractante de
rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des
pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entreprise contractante doit mettre en place un système
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entreprise contractante devra éviter
tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de
toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les
points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entreprise contractante par le Maître d’œuvre.
38. Gestion des déchets solides
L’Entreprise contractante doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être bâchées de façon à ne
pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte
quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entreprise contractante doit éliminer ou
recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entreprise contractante doit acheminer les
déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.
39. Protection contre la pollution sonore
L’Entreprise contractante est tenu de se conformer à la réglementation en la matière, notamment en limitant les
bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit
par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60
décibels le jour; 40 décibels la nuit.
40. Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA et les masques, gants et gel face à
la propagation du Covid 19..
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit
veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées
contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies
respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme,
gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de
climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
308
L’Entreprise contractante doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i)
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des
infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins
d’urgence.
41. Voies de contournement et chemins d'accès temporaires
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. Pour éviter leur
dégradation prématurée, l’Entreprise contractante doit maintenir les routes locales en bon état durant la
construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.
42. Passerelles piétons et accès riverains
L’Entreprise contractante doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de
garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
43. Services publics et secours
L’Entreprise contractante doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, l’Entreprise contractante doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
44. Journal de chantier
L’Entreprise contractante doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations,
les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre.
L’Entreprise contractante doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de
l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.
45. Entretien des engins et équipements de chantiers
L'Entreprise contractante doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et
effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de
matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) ainsi que des récipients
étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
309
L'Entreprise contractante doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou
d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entreprise
contractante doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits
lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans
l'environnement ou sur le site du chantier.
L'Entreprise contractante doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées pour
les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de rechange
usagées doivent être envoyées à la décharge publique.
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des
huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols
non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés
dans des aires prévues à cet effet.
46. Carrières et sites d'emprunt
L’Entreprise contractante est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des
carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la
matière. L’Entreprise contractante doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous
les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en
vigueur.
47. Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entreprise contractante doit (i) rétablir les écoulements naturels
antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en
répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est
dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.
48. Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire
Avant le début d'exploitation, l'Entreprise contractante doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la carrière
temporaires vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact
environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux organismes
nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant l’exploitation, l’Entreprise contractante doit : (i)
stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
310
carrière ou site d'emprunt ; (ii) régaler les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la
percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels
antérieurs ; (iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v)
aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des fossés de
récupération des eaux de ruissellement.
A la fin de l’exploitation, l'Entreprise contractante doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle
végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt temporaire. À cet
effet, l'Entreprise contractante doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii)
reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail
ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état
l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état, un procès-
verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre.
Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient utilisées comme point
d’eau, l’Entreprise contractante peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager l’ancienne aire
exploitée selon les besoins.
49. Lutte contre les poussières
L'Entreprise contractante doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction
du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. Il
devra aussi sensibiliser les populations riveraines.
50. Sécurité des digues/barrages
La politique sur le barrage n’est pas déclenchée ; néanmoins dès qu’une digue dépasse 2 m, alors il faudra
prévoir des mesures de sécurité (intégration dans la conception ; inspection régulières ; etc.)
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers d’appels
d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin qu’elles puissent
intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du
milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de
nuisances environnementales et sociales. Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels
d’offres ou de marchés d’exécution des travaux.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
311
Paramètres Environnementaux et Sociaux à considérer dans les contrats d’exécution des travaux
d’infrastructures
• S’assurer de planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la végétation pour
compenser d’éventuels abattages
• Eviter le plus que possible de détruire les habitats d’animaux ;
• Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ;
• Ne pas obstruer le passage aux riverains ;
• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ;
• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier ;
• Eviter d’endommager la végétation existante ;
• Eviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable et inapte à
l’infiltration ;
• Eviter de nuire la population locale en utilisant des matériels qui font beaucoup de bruit ;
• Ne pas brûler des déchets sur le chantier ;
• Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux ;
• Intégrer le plus que possible les gens de la communauté pour éviter les conflits entre le personnel de
chantier et la population locale.
• Eviter le dégagement des mauvaises odeurs lié à la réparation des latrines ;
• Procéder à la gestion rationnelle des carrières selon les réglementations en vigueur ;
• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ;
• Respecter les sites culturels ;
• Tenir compte des nuisances (bruit, poussière) et de la sécurité de la population en organisant le chantier ;
• Eviter tout rejet des eaux usées dans les rigoles de fondation, les carrières sources de contamination
potentielle de la nappe phréatique et de développement des insectes vecteurs de maladie ;
• Eloigner les centres d’entreposage le plus que possible des maisons, des églises, etc. ;
• Arroser pour réduire la propagation de la poussière ;
• Eviter tout rejet d’eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de
polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fosses de drainage, etc. ;
• Installer des structures permettant d’éviter l’obstruction des réseaux d’assainissement pour ne pas
exposer le bâtiment à l’inondation ;
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
312
• Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ;
• Prendre et veiller à l’application de mesures de sécurité pour le personnel de chantier ;
• Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier.
e. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux
1. Respect des lois et réglementations nationales :
L’Entreprise contractante et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de
rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les
atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au nonrespect de
l’environnement.
2. Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations
administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entreprise contractante doit se procurer tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés par les
collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas
d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau
publiques), de l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux,
l’Entreprise contractante doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements
facilitant le déroulement des chantiers.
3. Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'Entreprise contractante et le Maître d’œuvre, sous la supervision du Maître
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées dans la
zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser
et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés.
Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les
sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
4. Préparation et libération du site
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
313
L’Entreprise contractante devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de
champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un
calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le début
des travaux, l’Entreprise contractante doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement
payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.
5. Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, l’Entreprise contractante doit instruire une procédure de repérage des réseaux
des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un Procès-
verbal signé par toutes les parties (Entreprise contractante, Maître d’œuvre, concessionnaires).
6. Libération des domaines public et privé
L’Entreprise contractante doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les emprises
privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.
7. Programme de gestion environnementale et sociale
L’Entreprise contractante doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de
gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend : (i) un plan d’occupation du sol indiquant
l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les
implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier
indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ;
(iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, les thèmes et le mode
de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques
d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures
de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence.
Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: l'organigramme du personnel
affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des impacts négatifs ; le
plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan d’approvisionnent et de gestion de
l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites
privés.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
314
f. Installations de chantier et préparation
8. Normes de localisation
L’Entreprise contractante doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le moins
possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque de tels sites
existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres fins. L’Entreprise
contractante doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire protégée.
9. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
L’Entreprise contractante doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entreprise contractante doit sensibiliser son
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.
10. Emploi de la main d’œuvre locale
L’Entreprise contractante est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il
est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.
11. Respect des horaires de travail
L’Entreprise contractante doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux en
vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du possible, (sauf en
cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entreprise contractante doit éviter d’exécuter les travaux
pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
12. Protection du personnel de chantier
L’Entreprise contractante doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs activités
(casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entreprise contractante doit veiller au port
scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et,
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
315
en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au
personnel concerné.
13. Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
L’Entreprise contractante doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à tous
les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le
chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son
personnel. L’Entreprise contractante doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des
panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres à éviter les accidents.
14. Désignation du personnel d’astreinte
L’Entreprise contractante doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y
compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, l’Entreprise
contractante est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les jours sans
exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout incident et/ou accident
susceptible de se produire en relation avec les travaux.
15. Mesures contre les entraves à la circulation
L’Entreprise contractante doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entreprise contractante veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. L’Entreprise contractante doit
veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger et proposer des panneaux de
signalisation, pour les sorties de camions au niveau des travaux de chantier.
g. Repli de chantier et réaménagement
16. Règles générales
A toute libération de site, l'Entreprise contractante laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne peut
être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait
constater ce bon état. L'Entreprise contractante réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
316
des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les
environs.
Une fois les travaux achevés, l’Entreprise contractante doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les
déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts de drainage et
régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec des espèces appropriées,
en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées
ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres
ouvrages rendus au service public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être
décaissées et remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations fixes pour une
utilisation future, l'Entreprise contractante doit les céder sans dédommagements lors du repli. Les installations
permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entreprise contractante et remis dans un état
équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état
initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entreprise contractante doit
scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements
de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet
autorisés.
En cas de défaillance de l'Entreprise contractante pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont
effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés et aux frais du
défaillant.
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au
procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit entraîner le refus de réception des
travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du montant du poste « installation de chantier » sera
retenu pour servir à assurer le repli de chantier.
17. Protection des zones instables
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entreprise contractante doit prendre les précautions
suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la
zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des
espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
317
18. Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires
L’Entreprise contractante doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en
rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du couvert
végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et restauration du couvert
végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les communautés locales ou les animaux : (iv)
zone de loisir ; écotourisme, entre autres.
19. Gestion des produits pétroliers et autres contaminants
L’Entreprise contractante doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.
20. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par
l’Entreprise contractante est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert
environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.
21. Notification
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entreprise contractante tous les cas de défaut ou non-exécution des
mesures environnementales et sociales. L’Entreprise contractante doit redresser tout manquement aux
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires
découlant du non-xrespect des clauses sont à la charge de l’Entreprise contractante.
22. Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment
constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entreprise contractante ayant fait
l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales s’expose à des
sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée par le Maître
d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie.
23. Réception des travaux
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
318
Le non-respect des présentes clauses expose l’Entreprise contractante au refus de réception provisoire ou
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et
sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.
24. Obligations au titre de la garantie
Les obligations de l’Entreprise contractante courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise
qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au contrat.
h. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques
25. Signalisation des travaux
L’Entreprise contractante doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie, circuit
utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.
26. Mesures pour les travaux de terrassement
L’Entreprise contractante doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. Après le
décapage de la couche de sol arable, l’Entreprise contractante doit conserver la terre végétale et l’utiliser pour le
réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entreprise contractante doit déposer les déblais non
réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; sinon il doit les transporter dans des
zones de remblais préalablement autorisées.
27. Mesures de transport et de stockage des matériaux
Lors de l’exécution des travaux, l’Entreprise contractante doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le chantier
par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser régulièrement les voies de
circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) prévoir des déviations par des pistes et
routes existantes dans la mesure du possible.
Dans les zones d'habitation, l’Entreprise contractante doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds qui
doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et congestion de la
circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
319
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres matériaux fins
doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de poussière et le déversement en
cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines doivent être recouverts d'une bâche fixée
solidement. L’Entreprise contractante doit prendre des protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de
projections, émanations et chutes d’objets.
L’Entreprise contractante peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont
pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des chantiers. Ces
zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, d’assemblage, de petit
usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des hydrocarbures.
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement immédiat, en dehors
des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.
28. Mesures pour la circulation des engins de chantier
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des lieux de
passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de chantier.
L’Entreprise contractante doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des agglomérations et à la
traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire l’objet de mesures disciplinaires
pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux entrées des agglomérations sera préconisée.
Les véhicules de l’Entreprise contractante doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du code
de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.
L’Entreprise contractante devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement
les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus particulièrement au niveau des
zones habitées.
29. Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
320
L’Entreprise contractante doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières dangereuses
de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est clairement identifié. La
livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la réglementation en vigueur et les
conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas d’accident.
Les opérations de dépotage vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un personnel averti. Les
citernes doivent être déposées sur des plates formes étanches avec un muret d’au moins 15 cm de hauteur pour
éviter d’éventuels écoulements en cas de fuite.
L’Entreprise contractante doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à une
distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être localisés à l’extérieur
de toute zone inondable et d’habitation..
L’Entreprise contractante doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage par
une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs doivent être
fermés quand ils ne sont pas utilisés.
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à suivre
afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation des produits pétroliers
et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin d’éviter tout déversement
accidentel.
30. Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers
L’Entreprise contractante doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants et
le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle contre les
déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées et les travailleurs
doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident. L’Entreprise contractante doit mettre en
place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles,
pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur,
téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité (signalisation, etc.).
31. Protection des zones et ouvrages agricoles
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
321
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les principales
périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être connues afin d'adapter
l'échéancier à ces périodes. L’Entreprise contractante doit identifier les endroits où des passages pour les
animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la population est primordiale.
32. Protection des milieux humides, de la faune et de la flore
Il est interdit à l’Entreprise contractante d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, notamment en évitant le
comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, l’Entreprise contractante doit s'adapter à la
végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles espèces sans l’avis des services forestiers. Pour
toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de l’emprise et requises par l’Entreprise contractante pour les
besoins de ses travaux, la terre végétale extraite doit être mise en réserve.
33. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
L’Entreprise contractante doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela,
elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux.
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, l’Entreprise
contractante doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter toute
destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y
dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à
l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et
archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.
34. Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le
Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir
disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés ni
enfuis sous les matériaux de terrassement. Les arbres avant d’être abattus requièrent d’abord une autorisation,
puis sont cédés à la population.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
322
35. Prévention des feux de brousse
L’Entreprise contractante est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux,
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés
par les autorités compétentes.
36. Approvisionnement en eau du chantier
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entreprise contractante. L’Entreprise
contractante doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau
utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entreprise contractante d’utiliser les services publics
d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en eau à partir des eaux
souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entreprise contractante doit adresser une demande d’autorisation au
service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur.
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée par
chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires concernés. Si l’eau n’est
pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, l’Entreprise contractante doit prendre des
mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et
en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser
l’eau non potable pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entreprise contractante doit
aviser les employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ».
37. Gestion des déchets liquides
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant (latrines, fosses
septiques, lavabos et douches). L’Entreprise contractante doit respecter les règlements sanitaires en vigueur. Les
installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il est interdit à l’Entreprise contractante de
rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et incommodités pour le voisinage, ou des
pollutions des eaux de surface ou souterraines. L’Entreprise contractante doit mettre en place un système
d’assainissement autonome approprié (fosse étanche ou septique, etc.). L’Entreprise contractante devra éviter
tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de
toute natures, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les
points de rejet et de vidange seront indiqués à l’Entreprise contractante par le Maître d’œuvre.
38. Gestion des déchets solides
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
323
L’Entreprise contractante doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être bâchées de façon à ne
pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas attirer les vecteurs, une collecte
quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de chaleur. L’Entreprise contractante doit éliminer ou
recycler les déchets de manière écologiquement rationnelle. L’Entreprise contractante doit acheminer les
déchets, si possible, vers les lieux d’élimination existants.
39. Protection contre la pollution sonore
L’Entreprise contractante est tenu de se conformer à la réglementation en la matière, notamment en limitant les
bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit
par leur prolongation en dehors des heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60
décibels le jour; 40 décibels la nuit.
40. Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il doit
mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA.
L’Entreprise contractante doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il doit
veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des mesures appropriées
contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils se déroulent : maladies
respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz émis lors des travaux ; paludisme,
gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte prolifération de moustiques, aux changements de
climat et à la qualité de l’eau et des aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone.
L’Entreprise contractante doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i)
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des
infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins
d’urgence.
41. Voies de contournement et chemins d'accès temporaires
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales. Pour éviter leur
dégradation prématurée, l’Entreprise contractante doit maintenir les routes locales en bon état durant la
construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.
42. Passerelles piétons et accès riverains
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
324
L’Entreprise contractante doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou passerelles munis de
garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
43. Services publics et secours
L’Entreprise contractante doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, l’Entreprise contractante doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
44. Journal de chantier
L’Entreprise contractante doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations,
les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre.
L’Entreprise contractante doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de
l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.
45. Entretien des engins et équipements de chantiers
L'Entreprise contractante doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et
effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une provision de
matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) ainsi que des récipients
étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets, doivent être présents.
L'Entreprise contractante doit exécuter, sous surveillance constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou
d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entreprise
contractante doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits
lors des activités d'entretien ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans
l'environnement ou sur le site du chantier.
L'Entreprise contractante doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées pour
les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les pièces de rechange
usagées doivent être envoyées à la décharge publique.
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de récupération des
huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
325
non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport et à la pose du béton doivent être lavés
dans des aires prévues à cet effet.
46. Carrières et sites d'emprunt
L’Entreprise contractante est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des
carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la
matière. L’Entreprise contractante doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site existant. Tous
les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux normes environnementales en
vigueur.
47. Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entreprise contractante doit (i) rétablir les écoulements naturels
antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect délabré du site en
répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est
dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services compétents.
48. Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire
Avant le début d'exploitation, l'Entreprise contractante doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la carrière
temporaires vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude d’impact
environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître d’œuvre et aux organismes
nationaux chargés des mines et de l’environnement.
A la fin de l’exploitation, l'Entreprise contractante doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une nouvelle
végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt temporaire. À cet
effet, l'Entreprise contractante doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii)
reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail
ou les riverains, ou si la carrière peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état
l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état, un procès-
verbal est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre.
49. Lutte contre les poussières
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
326
L'Entreprise contractante doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en fonction
du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-poussières est obligatoire. Il
devra aussi sensibiliser les populations riveraines.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
327
8.3 Plan d’engagement environnemental et social
La République de Djibouti
[TITRE DU PROJET]
1. La République de Djibouti (l'Emprunteur) envisage de mettre en œuvre le [titre du Projet] (le Projet), avec la
participation des ministères / agences / unités suivantes : [indiquer l’agence d’exécution]. La Banque
internationale pour la reconstruction et le développement ci-après, la Banque, a accepté de fournir un
financement pour le projet.
2. L'Emprunteur mettra en œuvre des mesures et actions matérielles afin que le Projet soit mis en œuvre
conformément aux Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale. Ce plan d'engagement
environnemental et social (PEES) présente un résumé des mesures et actions matérielles.
3. Lorsque le PEES fait référence à des plans spécifiques ou à d'autres documents, qu'ils aient déjà été préparés
ou doivent être élaborés, le PEES exige le respect de toutes les dispositions de ces plans ou autres documents.
En particulier, l'PEES exige le respect des dispositions énoncées dans le Plan de Mobilisation des Parties
Prenantes (PMPP) du projet, l’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES), les procédures de gestion du
travail (PGT) élaborés par l’Emprunteur, et les plans de réinstallation (PR) à préparer par l’Emprunteur une fois
que l’Avant-Projet Detaille soit finalise et les Plans de Gestions Environnemental et Social et les procédures de
gestion des travailleurs a préparer par les Entreprise contractantes avant tout début des travaux.
4. Le tableau ci-dessous résume les mesures et actions importantes qui sont nécessaires ainsi que le calendrier
des mesures et actions importantes. L'Emprunteur est responsable du respect de toutes les exigences du PEES
même lorsque la mise en œuvre de mesures et actions spécifiques est menée par l'Emprunteur référencé au 1.
ci-dessus.
5. La mise en œuvre des mesures et actions matérielles énoncées dans le présent PEES fera l'objet d'un suivi et
d'un rapport à la Banque par l'Emprunteur, comme l'exigent le PEES et les conditions de l'accord juridique, et la
Banque suivra et évaluera les progrès et l'achèvement du mesures et actions matérielles tout au long de la mise
en œuvre du projet.
6. Comme convenu par la Banque et l'emprunteur, le présent PEES peut être révisé de temps à autre pendant la
mise en œuvre du projet, afin de refléter la gestion adaptative des changements du projet et des circonstances
imprévues ou en réponse à l'évaluation des performances du projet effectuée dans le cadre du PEES lui-même.
Dans de telles circonstances, l'Emprunteur proposera des modifications à approuver par la Banque et mettra à
jour le PEES pour refléter ces modifications. L'accord sur les modifications du PEES sera documenté par
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET
DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
328
l'échange de lettres signées entre la Banque et l'Emprunteur. L’Emprunteur divulguera rapidement le PEES mis à
jour.
7. Lorsque des changements, des circonstances imprévues ou la performance du projet entraînent des
modifications des risques et des impacts pendant la mise en œuvre du projet, l'emprunteur fournira des fonds
supplémentaires, si nécessaire, pour mettre en œuvre des actions et des mesures pour faire face à ces risques et
impacts.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
329
Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet
Délais
RESPONSIBILE ENTITY/AUTHORITY
RAPPORTS RÉGULIERS: Préparer et soumettre à la Banque des rapports de suivi réguliers sur les performances environnementales, sociales, de santé et de sécurité (ESHS) du projet, y compris, mais sans s'y limiter, la mise en œuvre du PEES, l'état de préparation et de mise en œuvre des documents E&S requis par le PEES, les activités d'engagement des parties prenantes et le fonctionnement du ou des mécanismes de réclamation.
Premier rapport après trois mois de mise en oeuvre du Projet. Les autres rapports seront semestriels tout au long de la période de mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
NOTIFICATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS:
Informer sans délai la Banque de tout incident ou accident lié au projet qui a, ou est susceptible d'avoir, un effet néfaste significatif sur l'environnement, les communautés affectées, le public ou les travailleurs. Fournir suffisamment de détails concernant l'incident ou l'accident, en indiquant les mesures immédiates prises ou envisagées pour y remédier, ainsi que toute information fournie par tout contractant et entité de supervision, le cas échéant. Par la suite, conformément à la demande de la Banque, préparer un rapport sur l’incident ou l’accident et proposer des mesures pour éviter qu’il ne se reproduise.
48 heures après l’occurrence de l'accident/l'incident. Un rapport détaillé ultérieur sera fourni dans un délai considéré acceptable par l’Association, tel que demandé. Tout au long de la mise en œuvre du Projet.
Electricité de Djibouti(EDD)
NES 1: ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
1.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE: Le Récipiendaire mettra en place et maintiendra une Unité de gestion du Projet (UGP) dotée d’un personnel qualifié et des ressources nécessaires à la gestion des risques environnementaux et sociaux et des impacts du Projet, y compris des spécialistes de la gestion des risques environnementaux et sociaux.
Les Spécialistes environnemental et social actuellement recrutés ou nommés sont maintenus en poste tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
1.2 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE: a. Évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux des
activités proposées du Projet, mettre à jour, redivulguer, adopter et mettre en œuvre le CGES du Projet parent, notamment afin de s’assurer que les individus ou les groupes qui pourraient être défavorisés ou vulnérables en raison de leur situation ont accès aux retombées sur le développement du Projet.
b. Mettre à jour, divulguer, adopter et mettre en œuvre tout plan de gestion environnementale et sociale ou tout autre instrument préparé par le Projet parent, y compris les activités requises pour la conduite des processus d’examen, ceci conformément aux NES ; au CGES ; aux Procédures de gestion du travail (PGT) ; aux Directives
a. Le CGES, mis à jour aux fins du Projet parent et du FA, a été divulgué les 21 et 23 octobre 2020, respectivement sur les sites internet du MS et de l’Association.
b. Plans ou instruments préparés adoptés et divulgués avant la réalisation des activités pertinentes
Electricité de Djibouti(EDD)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
330
Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet
Délais
RESPONSIBILE ENTITY/AUTHORITY
environnementales, sanitaires et sécuritaires (DESS) ; et, aux autres Bonnes Pratiques internationales de l’Industrie pertinentes, y compris les directives applicables de l’OMS sur la COVID-19 ainsi que les mesures appropriées aux autres activités, notamment aux fins de la CERC et des petits travaux de génie civil, le tout d’une manière considérée acceptable par l’Association.
du Projet.
1.3 OUTILS ET INSTRUMENTS DE GESTION: Exclure les types d’activités suivants et les considérer non éligibles à un financement dans le cadre du Projet, tel que déjà consignés au CGES du Projet parent, et appliquer également ces exclusions au FA :
Activités pouvant avoir des effets négatifs à long terme
permanents et/ou irréversibles (par ex. perte majeure d’habitat
naturel)
Nouvelles constructions ou agrandissements demandant une
réinstallation
Activités présentant une forte probabilité d’effets néfastes graves
sur la santé humaine et/ou l’environnement non liés au traitement
des cas de COVID-19
Activités risquant d’avoir des impacts sociaux négatifs majeurs et
pouvant donner lieu à des conflits sociaux importants
Activités pouvant affecter les terres ou les droits des peuples
autochtones ou d’autres minorités vulnérables
Activités susceptibles d’impliquer une réinstallation permanente ou l’acquisition de terres ou encore d’avoir des impacts négatifs sur le patrimoine culturel.
Au cours du processus d’évaluation mené dans le cadre de l’action 1.2.a. ci — dessus
Electricité de Djibouti(EDD)
1.4 GESTION DES ENTREPRISE CONTRACTANTES:
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
331
Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet
Délais
RESPONSIBILE ENTITY/AUTHORITY
1.5 PERMIS, CONSENTEMENTS ET AUTORISATIONS: Tous les documents relatifs aux permis, consentements et autorisations devront être disponible au niveau de l’EDD pour le projet.
Avant la mise en œuvre du Projet Electricité de Djibouti(EDD)
1.6 PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS: Différents thèmes de formation du personnel impliqué dans la mise en œuvre du Projet concerneront notamment les aspects suivants :
Recommandations sur la prévention et le contrôle de l’infection
par la COVID-19
Lignes directrices en matière de sécurité sur les postes de travail
du guide de sécurité d’EDD.
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
NES 2: EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
2.1 PROCÉDURES DE GESTION DU TRAVAIL: Le Projet sera mis en œuvre conformément aux exigences applicables de la NES2, ceci de façon considérée acceptable par l’Association, y compris à travers, inter alia, la mise en œuvre de mesures adéquates de santé et de sécurité au travail (incluant des mesures de préparation et de riposte en cas d’urgence) ; l’identification de modalités d’expression de plaintes destinées aux travailleurs du Projet ; et, l’intégration des exigences en matière de SSES de la main-d’œuvre aux spécifications figurant aux documents de passation de marchés et contrats avec les entreprise contractantes et les firmes de supervision. Le Récipiendaire appliquera les mesures ci-dessus conformément aux Procédures de gestion du travail du Projet ESCP, ceci d’une manière considérée acceptable par l’Association et en conformité avec la NES2. Les PGT du Projet parent seront mises à jour afin de prendre en compte les activités prévues au Financement additionnel.
Avant le recrutement direct ou par contractualisation de travailleurs du Projet. Les PGT applicables au Projet et au FA, ont été divulguées XXXXXXXX2020, respectivement sur les sites internet de l’EDD et de l’Association Les PGT seront appliquées tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
2.2 MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DES TRAVAILLEURS DU PROJET Des modalités de plaintes et recours accessibles seront maintenues et publiquement disponibles afin de recevoir et de faciliter le règlement des préoccupations et des griefs liés au Projet, ceci conformément à la NES 10 et de façon considérée acceptable par l’Association.
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
332
Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet
Délais
RESPONSIBILE ENTITY/AUTHORITY
2.3 MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST)
Electricité de Djibouti(EDD)
NES3: UTILISATION RATIONNELLE DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION
3.1 Utilisation rationnelle DES RESSOURCES ET PRÉVENTION ET GESTION DE LA POLLUTION: Toutes les structures de santé qui bénéficieront de matériels et d’équipements financés par le Projet devront préparer, adopter, divulguer et mettre en œuvre des Plans de contrôle des infections et de gestion des déchets biomédicaux (PCIGDB) spécifiques au site et conformes aux exigences du CGES, ceci conformément à la NES 3 et d’une manière considérée satisfaisante par l’Association.
Avant le démarrage du projet Electricité de Djibouti(EDD)
3.2 GESTION DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES DANGEREUSES: Une évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) sera préparée, adoptée, divulguée et mise en œuvre pour tous les aspects pertinents de cette norme seront pris en compte, le cas échéant, au titre de l’action 1.2 ci-dessus, y compris, inter alia les mesures visant à : gérer les types de déchets dangereux et non dangereux ainsi que l’utilisation des ressources (eau, air, etc.), ceci conformément à la NES3, aux DESS et aux autres Bonnes Pratiques internationales de l’Industrie pertinentes, y compris les directives pertinentes de l’OMS, ceci d’une manière jugée satisfaisante par l’Association.
Tout au long de la mise en œuvre du Projet.
Electricité de Djibouti(EDD)
ESS 4: SANTE SECURITE DES POPULATIONS
4.1 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS: Les aspects pertinents de cette norme seront pris en compte, le cas échéant, au titre de l’action 1.2 ci-dessus, y compris, inter alia les mesures visant à : minimiser le potentiel d’exposition communautaire aux maladies transmissibles ; s’assurer que les individus ou les groupes qui pourraient être défavorisés ou vulnérables en raison de leur situation particulière ont accès aux retombées sur le développement du Projet ; et, répondre à l’exploitation et aux abus sexuels et au harcèlement sexuel. Le Projet atténuera les risques d’EAS/HS par des campagnes de communication pour la sensibilisation — comme indiqué à la NES et au plan d’action contre la VBG du Projet parent — et établira des modalités de traitement des plaintes spécifiques qui permettront une réponse rapide et confidentielle aux incidents d’EAS/HS. Tous les travailleurs du Projet, y compris le personnel de l’UGP et les travailleurs
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
333
Résumé des mesures et actions importantes pour atténuer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet
Délais
RESPONSIBILE ENTITY/AUTHORITY
communautaires, seront tenus de se conformer à un Code de conduite.
NES 5: ACQUISITION DES TERRES, RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES TERRE ET REINSTALLATION FORCEE
NES 6: PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES BIOLOGIQUES
6.1 RISQUES ET IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ: Les aspects pertinents de cette norme seront pris en compte, le cas échéant, au titre de l’action 1.2 ci-dessus, y compris, inter alia les mesures visant à : minimiser le potentiel d’exposition pour la biodiversité.
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
ESS 7: INDIGENOUS PEOPLES/SUB-SAHARAN AFRICAN HISTORICALLY UNDERSERVED TRADITIONAL LOCAL COMMUNITIES
7.1 Non pertinent S.O S.O
ESS 8: HERITAGE CULTUREL
8.1 Non pertinent actuellement S.O S.O
ESS 9: INTERMEDIARES FINANCIERS
9.1 Non pertinent S.O S.O
ESS 10: MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES ET INFORMATION
10.1 MISE EN ŒUVRE DU PMPP: Le Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du Projet parent a été préparé, divulgué, adopté et mis en œuvre conformément au Plan Opérationnel pour le Projet ESCP à Djibouti (XXXXX 2020) ; aux « Directives techniques sur la communication des risques posés par la Covid-19 (2019-nCoV) et l’engagement communautaire » de l’OMS (26 janvier 2020) ; et, à la NES 10, ceci de façon considérée acceptable par l’Association.
Le PMPP applicable au Projet ESCP a été divulgué le XXXXXX 2020, respectivement sur les sites internet de l’EDD et de l’Association. Le PMPP s’appliquera pendant toute la période de mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
10.2 MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS DU PROJET: Des modalités de plaintes et recours accessibles seront maintenues et publiquement disponibles afin de recevoir et de faciliter le règlement des préoccupations et des griefs liés au Projet, ceci conformément à la NES 10 et de façon considérée acceptable par l’Association.
Tout au long de la mise en œuvre du Projet
Electricité de Djibouti(EDD)
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
334 334
Titre de propriété de Nagad : concession provisoire
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
335 335
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
336 336
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
337 337
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
338 338
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
339 339
8.4 Questionnaire de l’enquête-ménage
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
340 340
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
341 341
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
342 342
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
343 343
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
344 344
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
345 345
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
346 346
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
347 347
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
348 348
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
349 349
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
350 350
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
351 351
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
352 352
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
353 353
8.5 Guide d’entretien des focus-groups
Guides d’entretiens Focus Group
Introduction pour tous les groupes : Nous réalisons des études dans le cadre d’un projet de l’EDD
pour identifier les impacts de ce projet et voir comment les minimiser en prenant en compte votre
point de vue. L’information collectée est confidentielle et nous permettra de proposer des solutions
adaptées aux besoins des différentes villes impactées par le projet. Nous allons donc vous
demander de répondre à chaque fois aux questions posées en fonction de votre expérience et vos
connaissances. Il n’y a pas de mauvaises réponses. Vous aurez également un temps en fin de
réunion pour nous faire part de vos attentes et préoccupations.
Questions hommes
Nous allons d’abord vous poser des questions sur votre ville/zone.
Pouvez-vous nous raconter qui a fondé votre ville à quel moment et quelles sont les principales tribus dans
la ville ?
Quelles sont les principales activités économiques des hommes et des femmes de votre ville ?
Maintenant on va parler du projet et des terres où le projet devrait passer : il n’est pas encore sur que le
projet se fasse et il est aussi possible que le tracé puisse bouger en fonction d’aspects techniques mais pour
le moment le tracé prévu est celui-ci.
Expliquer le projet : construction d’une ligne électrique entre Djibouti et l’Ethiopie avec l’installation de
campements temporaires de travailleurs lors de la construction (MONTRER UNE CARTE AVEC LE TRACÉ
ET LES PRINCIPALES VILLES ET LA RN 1 COMME POINTS DE REPERES + AVEC LES ZONES AVEC
LES ENCLOS ET LES TOMBES)
A qui sont ces terres se trouvant dans le corridor de la ligne ? Quelles tribus ont quels territoires
approximativement ? Y a-t-il des conflits fonciers entre tribus dans cette zone du projet ?
Est-ce que quelqu’un a déjà vendu des terres non habitées et non cultivées comme celles qui sont dans le
corridor du projet ? Si oui, préciser. Qui pourrait avoir le droit de le faire ? Comment fonctionne la passation
des terres d’une génération à la suivante (héritage ou transmission verticale des terres) ?
Pour chaque usage, demander qui peut utiliser ces terres et à qui doit-il demander la permission ?
(Les usages possibles sont : construire une maison, construire un enclos, construire une tombe, monter un
campement temporaire, faire brouter les animaux, traverser la zone pour se rendre à un autre endroit)
Si quelqu’un construit un enclos : est-ce que d’autres personnes peuvent l’utiliser sans lui demander la
permission ? Y a-t-il des règles à respecter pour utiliser l’enclos ? Est-ce que cet enclos peut être vendu ou
hérité ?
On pose cette question car il y a quelques enclos dans le corridor du projet (montrer sur la carte) : il
est possible qu’il soit nécessaire d’en déplacer certains de quelques centaines de mètres car ils pourraient
être à l’endroit où l’EDD devra construire un pylône. L’EDD se chargerait du déplacement. Qu’est-ce que
vous en pensez ? Quels impacts cela pourrait avoir de déplacer quelques centaines de mètres un enclos ?
Il y a également des tombes dans le corridor du projet (montrer sur la carte) : quel âge ont ces
tombes (les plus jeunes et les plus anciennes) ? Vous rendez-vous à certains moments sur les tombes ? Si
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
354 354
oui, quand, qui (hommes/femmes/jeunes) et pourquoi ? Il est également possible qu’il soit nécessaire d’en
déplacer certaines de quelques centaines de mètres car elles pourraient être à l’endroit où l’EDD devra
construire un pylône. L’EDD se chargerait du déplacement. Qu’est-ce que vous en pensez ? Quels impacts
cela pourrait avoir de déplacer quelques centaines de mètres une tombe ? Y a-t-il des tombes qui ne sont
pas déplaçables et pour quelles raisons ?
De manière générale, voyez-vous des sites vraiment importants pour vous dans la zone du projet que vous
souhaiteriez qu’on évite au maximum ?
Maintenant nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur votre communauté :
Y a-t-il des groupes de personnes qui ne sont pas forcément bienvenus dans votre communauté ou que
vous préférez qu’ils ne s’installent pas ? Quels types de personnes et pour quelles raisons ? (NB : Ici il s’agit
d’identifier si certains groupes sont exclus que ce soit pour des raisons ethniques ou parce que ce sont des
migrants perçus comme dangereux)
S’il y a un conflit dans la communauté ou un problème important à résoudre, qui allez-vous voir ?
Finalement, notre dernière question serait que vous puissiez partager avec nous vos préoccupations et vos
attentes par rapport au projet : nous allons demander à chacun de répondre à son tour.
Avez-vous d’autres points que vous souhaitez partager ? Merci pour votre participation
Questions femmes
Introduction : 2-3 min
Complément d’intro : On espère que vous n’avez pas eu trop de difficultés pour trouver quelqu’un pour
s’occuper de vos enfants.
Question services : 35-40 min
On va tout d’abord vous poser des questions sur votre ville. On va vous demander de lever la main si vous
êtes d’accord. Vous ne devez pas forcément toujours être d’accord entre vous. Levez donc la main si :
- Il y a au moins une mosquée dans votre ville ? Et il y a au moins un imam dans votre ville ?
- Il y a une école primaire dans votre ville ? Et elle a des professeurs qui viennent ?
- Il y a un collège dans votre ville ? Et il a des professeurs qui viennent ?
- Il y a un centre de santé communautaire dans votre ville ? Et on peut y trouver des médecins ou
infirmiers ? Et les gens de votre ville s’y rendent ?
- Il y a un hôpital dans votre ville ? Et on peut y trouver des médecins ou infirmiers ? Et les gens de
votre ville s’y rendent ?
- Il y a l’électricité de l’EDD dans votre ville ? Et elle fonctionne assez régulièrement ?
- Il y a un forage d’eau dans votre ville ou pas très loin ? et il fonctionne ?
Si elles ont levé la main pour tout, leur dire, pour relancer le débat : alors vous n’avez pas de problème dans
votre ville ni avec les écoles, ni avec les centres de santé ni avec l’électricité ni avec l’eau ?
En ce qui concerne la santé, le Gouvernement de Djibouti mène parfois des campagnes d’information et de
prévention sur le SIDA : savez-vous s’il y a déjà eu ce type de campagne dans votre ville ? ou peut-être y-a-
t-il eu des émissions à la radio ?
Question responsabilités hommes/femmes : 25-30 min
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
355 355
Maintenant on va vous poser des questions sur qui fait quoi à la maison car il y a certaines activités que font
plutôt les hommes d’autres plutôt les femmes, d’autres plutôt les enfants.
Qui est responsable de gagner de l’argent ? d’apporter de la nourriture à la maison ? de s’occuper des
animaux (moutons, chèvres et chameaux) ?
Qui est propriétaire de la maison, des terres ou des troupeaux ? Dans quelles circonstances les femmes
peuvent être propriétaires ?
Qui s’occupe d’aller chercher de l’eau ? Y a-t-il des risques à aller chercher de l’eau ? Lesquels ?
Certaines parmi vous ont-elles une activité où elles gagnent de l’argent ? Quelle activité ? Vos enfants vous
aident-ils ? Si oui, Comment ? Donnez-vous une partie ou tout l’argent que vous gagnez à votre mari ?
Quels sont vos clients : des gens de votre ville ou des gens qui passent ?
Question projet : 50 min
Maintenant on va parler du projet pour voir ce que vous en pensez : il n’est pas encore sur que le projet se
fasse et il est aussi possible que le tracé puisse bouger en fonction d’aspects techniques mais pour le
moment le tracé prévu est celui-ci.
Expliquer le projet : construction d’une ligne électrique entre Djibouti et l’Ethiopie avec l’installation de
campements temporaires de travailleurs lors de la construction (MONTRER UNE CARTE AVEC LE TRACÉ
ET LES PRINCIPALES VILLES ET LA RN 1 COMME POINTS DE REPERES + AVEC LES ZONES AVEC
LES ENCLOS ET LES TOMBES)
On vient de vous expliquer le projet dans ces grandes lignes : il peut y avoir de bonnes choses mais aussi
des choses qui vous préoccupent. Pouvez-vous partager votre point de vue sur ces deux
aspects (préoccupations et attentes) ?
Voyez-vous des sites vraiment importants pour vous dans la zone du projet que vous souhaiteriez qu’on
évite au maximum ?
Vous pensez qu’une femme pourrait travailler dans ce projet ? Si non pourquoi et si oui de quoi elle aurait
besoin pour y arriver ?
Que penseriez-vous s’il y avait un camp de travailleurs proche de votre ville ? Est-ce que ça serait
bénéfique ou pas pour votre ville et pourquoi ?
Si on reprend avec celles qui font de la restauration ou du commerce : Pensez-vous que vous pourriez
augmenter vos recettes s’il devait y avoir un campement de travailleurs du projet proche de votre ville ?
Expliquer pourquoi.
Maintenant nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur votre communauté :
Y a-t-il des groupes de personnes qui ne sont pas forcément bienvenus dans votre communauté ou que
vous préférez qu’ils ne s’installent pas ? Quels types de personnes et pour quelles raisons ? (NB : Ici il s’agit
d’identifier si certains groupes sont exclus que ce soit pour des raisons ethniques ou parce que ce sont des
migrants perçus comme dangereux)
S’il y a un conflit dans la communauté ou un problème important à résoudre, qui allez-vous voir ?
Avez-vous d’autres points que vous souhaitez partager ? Merci pour votre participation
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
356 356
Questions jeunes
Introduction : 2-3 min
Question éducation/emploi : 30 min
Jusqu’à quelle classe pouvez-vous aller à l’école dans votre ville ? Et ensuite où allez-vous si vous voulez
continuer à étudier ?
A quel âge les jeunes commencent à travailler et sur quelle activité (élevage/restauration/...) ?
Dans quels activités les jeunes arrivent à gagner de l’argent ? Est-ce que certains arrivent à gagner de
l’argent avec le tourisme dans votre ville ? Avec quelle activité et sur quels sites touristiques ?
Qui parmi vous arrivent avoir des activités rémunérées même périodiques ? Donnez-vous une partie ou tout
l’argent que vous gagnez à votre père/mère ? Quels sont vos clients : des gens de votre ville ou des gens
qui passent ?
Ceux qui doivent s’occuper des animaux, où allez-vous avec les bêtes ? Vous utilisez des enclos dans le
désert ? Ils sont à vous ou c’est un peu à tout le monde ? Vous devez demander la permission à quelqu’un
pour les utiliser ? Vous devez les réparer parfois ? certaines personnes n’ont pas le droit de les utiliser ?
Question projet : 40 min
Maintenant on va parler du projet pour voir ce que vous en pensez : il n’est pas encore sur que le projet se
fasse et il est aussi possible que le tracé puisse bouger en fonction d’aspects techniques mais pour le
moment le tracé prévu est celui-ci.
Expliquer le projet : construction d’une ligne électrique entre Djibouti et l’Ethiopie avec l’installation de
campements temporaires de travailleurs lors de la construction (MONTRER UNE CARTE AVEC LE TRACÉ
ET LES PRINCIPALES VILLES ET LA RN 1 COMME POINTS DE REPERES + AVEC LES ZONES AVEC
LES ENCLOS ET LES TOMBES)
On vient de vous expliquer le projet dans ces grandes lignes : il peut y avoir de bonnes choses mais aussi
des choses qui vous préoccupent. Pouvez-vous partager votre point de vue sur ces deux
aspects (préoccupations et attentes) ?
Que penseriez-vous s’il y avait un camp de travailleurs proche de votre ville ? Est-ce que ça serait
bénéfique ou pas pour votre ville et pourquoi ?
Si on reprend avec ceux qui gagnent de l’argent : Pensez-vous que vous pourriez augmenter vos recettes
s’il devait y avoir un campement de travailleurs du projet proche de votre ville ? Expliquer pourquoi.
Question communauté : 30 min
Maintenant nous aimerions vous poser quelques questions supplémentaires sur votre communauté :
Y a-t-il des groupes de personnes qui ne sont pas forcément bienvenus dans votre communauté ou que
vous préférez qu’ils ne s’installent pas ? Quels types de personnes et pour quelles raisons ? (NB : Ici il s’agit
d’identifier si certains groupes sont exclus que ce soit pour des raisons ethniques ou parce que ce sont des
migrants perçus comme dangereux)
Est-ce que vous avez des relations avec les migrants qui vont d’Ethiopie vers le Yémen et passent proche
de chez vous ? Ce sont également des hommes jeunes et vous pourriez les connaitre. Si oui, quels types
d’interactions avez-vous avec eux ?
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
357 357
S’il y a un conflit dans la communauté ou un problème important à résoudre, qui allez-vous voir ? (NB : ils
peuvent dire la Police mais normalement ils doivent aussi dire l’imam et surement citer une autorité
coutumière/ tribale)
Finalement, le Gouvernement de Djibouti mène parfois des campagnes d’information et de prévention sur le
SIDA : savez-vous s’il y a déjà eu ce type de campagne dans votre ville ? ou peut-être y-a-t-il eu des
émissions à la radio ?
Avez-vous d’autres points que vous souhaitez partager ? Merci pour votre participation
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
358 358
8.6 Comptes-rendus et listes de présence
Procès Verbal de réunion
Date: 26/08/2020 Lieu: Dikhil
Personnes présentes l’équipe de l’EDD, l’équipe de Insuco et 17 chefs coutumiers de la région de
Dikhil
Objet: Réaliser un focus group avec les chefs coutumiers de la région de Dikhil
Conclusion du focus group :
Principales activités économiques des hommes et des femmes de leur village : Les hommes gardent
les troupeaux de chameaux et les caravanes lorsqu’ils sont encore nomades. Les femmes s’occupent du
foyer et s’occupent des troupeaux de chèvres. Il y a également beaucoup de chômeurs qui n’ont aucune
activité.
Terres se trouvant dans le corridor : une route de transhumance et de déplacement des nomades
parcoure Djibouti du Nord au Sud, croisant la future ligne à haute tension. Cette route est encore utilisée
aujourd’hui. Il se peut qu’il y ait des campements mais cela dépend des saisons/aléas climatiques. Les
terrains appartiennent tous à l’Etat et c’est le Préfet qui a autorité pour autoriser l’utilisation des sols (Permis
d’Occupation Provisoire) et les construction (permis de construire). Si quelqu’un veut s’établir sur une terre, il
fait la demande au chef du village, qui fait la demande au sous-préfet ou au préfet. Les terres sont
cependant gérées de manière traditionnelle et selon un système clanique. Chaque chef de village
représente son clan dans son village. Le Préfet s’assurera avec lui que la transaction d’une terre du village
est acceptée par le chef de village et négociée avec lui. S’il y a un conflit, il est réglé selon la tradition afar. Il
n’y a pas de jardin individuel ou collectif dans la zone de projet qui parcoure la région de Dikhil.
Propriété des terres : L’Etat est propriétaire des terres et semble compenser les communautés lorsqu’il
utilise des terres qui leur appartiennent traditionnellement. La terre se passe généralement d’une génération
à une autre (de père à fils), et reste au sein du clan.
Demande d’utilisation des terres : Se fait en premier lieu avec le chef de village qui transfère la demande
à la Préfecture. Traditionnellement, seuls les afars sont autorisés à traverser le territoire des afars, faire
brouter les animaux, camper, etc.
Construction d’un enclos : seuls les afars peuvent utiliser les enclos en territoires afars. Les enclos
appartiennent généralement à une famille et sera transmis par héritage à la descendance. Chaque enclos
qui est détruit et déplacé doit être compensé. Il n’y a pas de problème pour déplacer les enclos, tant que la
communauté est compensée et incluse dans le projet. Beaucoup d’enclos sont aujourd’hui abandonnés et
ne sont plus utilisés, notamment dans la zone du projet.
Déplacement de tombes : certaines tombes sont là d’aussi loin que les intervenants s’en souviennent. Les
familles s’y rendent généralement une fois par an pour faire des invocations et c’est l’occasion de réunion
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
359 359
familiale et de sacrifice d’animaux. Les tombes sont sacrées et ne doivent pas être déplacées. Il est interdit
de déplacer les os de ses ancêtres selon la religion et la tradition et ce n’est pas quelque chose que la
communauté peut facilement accepter.
Il n’y a pas de site particulièrement important dans la zone et qui doivent être évités. Cependant, tout
patrimoine déplacé ou endommagé doit faire l’objet d’une compensation et d’une discussion avec le préfet,
le sous-préfet et les chefs coutumiers.
Personne qui ne sont pas les bienvenues : tous le monde est le bienvenu, mais il est essentiel que les
emplois soient donnés à la population locale.
Conflit : Pour tout ce qui concerne l’administration, c’est la préfecture qui gère. Il est nécessaire de valider
l’ensemble des phases de l’installation de la ligne avec les sous-préfets, à un niveau local.
Attente :
Communiquer le tracé de la future ligne à la population locale aussi tôt que possible
que les jeunes des villages à proximité de la ligne soient embauchés et qu’ils participent à la mise en
place des pylônes
que des villages tels que Yoboki, Galafi, Garabaiss soient alimentés en électricité
que le volume de production d’électricité augmente
une centrale à Haouli du côté éthiopien (environ à 5 km de Galafi) pourrait alimenter les petites villes
à proximité du côté djiboutien et constituer un plan d’urgence pour avoir une solution de court terme
et fournir de l’électricité aux petits villages qui n’en ont pas.
Crainte :
que leurs villages restent sans électricité
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
360 360
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
361 361
Procès Verbal de réunion
Date: 27/08/2020 Lieu: Ali Sabieh
Personnes présentes l’équipe de l’EDD, l’équipe de Insuco et 10 okals de la région d’Ali Sabieh
Objet: Réaliser un focus group avec les chefs coutumiers -les okals – de la région d’Ali Sabieh
Conclusion du focus group :
Principales activités économiques des hommes et des femmes de leur village : traditionnellement, les
hommes gardent les troupeaux. Pour ceux qui sont dans les villages, ils sont chômeurs ou vivent de petites
travaux salariés (maçons, petits commerçants), la plupart du temps de manière journalière.
Terres se trouvant dans le corridor : Les terrains appartiennent tous à l’Etat et c’est le Préfet qui a autorité
pour autoriser l’utilisation des sols (Permis d’Occupation Provisoire) et les construction (permis de
construire). Les terres sont cependant gérées de manière traditionnelle et selon un système clanique.
Chaque okal représente son clan dans son village. Le Préfet s’assurera avec lui que la transaction d’une
terre du village est acceptée par l’okal et négociée avec lui. Tous les sous-clans rencontrés appartiennent au
clan issa. Il n’y a pas de conflits entre les villages/clans, qui communiquent. S’il y a un conflit, il est réglé
selon la tradition et le xeer issa. Il n’y a pas de jardin individuel ou collectif dans la zone de projet qui
parcoure la région d’Ali Sabieh, sauf une plantation de palmier à Doudoubalaleh (la ligne passe à proximité).
Propriété des terres : L’Etat est propriétaire des terres et semble compenser les communautés lorsqu’il
utilise des terres qui leur appartiennent traditionnellement. La terre se passe généralement d’une génération
à une autre (de père à fils), et reste au sein du clan.
Demande d’utilisation des terres : Se fait en premier lieu avec la Préfecture puis avec le chef de village et
l’okal. Seuls les membres du clan Issa (c’est-à-dire tous les sous-clans issa) sont autorisés
traditionnellement à traverser le territoire des issas, faire brouter les animaux, camper, etc.
Construction d’un enclos : seuls les sous-clans issas peuvent utiliser les enclos en territoires issas. Les
enclos appartiennent généralement à une famille et sera transmis par héritage à la descendance. Chaque
enclos qui est détruit et déplacé doit être compensé. Il n’y a pas de problème pour déplacer les enclos, tant
que la communauté est compensée et incluse dans le projet. Les okals ont plusieurs fois fait mention de
l’importance de les inclure en amont de la phase de construction.
Déplacement de tombes : certaines tombes ont plus de 100 ans. Les familles s’y rendent généralement
une fois par an pour faire des invocations et c’est l’occasion de réunion familiale et de sacrifice d’animaux. Il
n’y a pas de problème pour déplacer les tombes, tant que la famille de la personne enterrée sont
compensées et que les okals participent au processus. Lors de la construction du chemin de fer (par une
entreprise chinoise), des tombes ont été déplacées et les familles ont été compensées. Il est primordial de
se référer à l’okal avant d’entreprendre toute action de déplacement.
Il n’y a pas de site particulièrement important dans la zone et qui doivent être évités. Ce qui est primordial
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
362 362
est de faire appel aux okals avant d’entreprendre un quelconque déplacement.
Personne qui ne sont pas les bienvenues : tous le monde est le bienvenu, il n’y a pas de problème avec
l’accueil des étrangers. Les migrants éthiopiens et somaliens bénéficient de l’hospitalité des sous-clans de la
région depuis des années (camps de réfugiés de Ali Addé) et sont intégrés au tissu économique local. Les
okals demandent cependant que les travailleurs locaux qui travailleront sur le projet soient de nationalité
djiboutienne (carte d’identité djiboutienne).
Conflit : Pour tout ce qui concerne l’administration, c’est la préfecture qui gère. Pour tout ce qui concerne les
conflits de la vie courante, c’est l’okal qui gère selon les règles traditionnelles.
Attente :
que les jeunes des villages à proximité de la ligne soient embauchés
que le volume de production d’électricité augmente
que les okals soient impliqués dans chaque étape de la construction de la ligne et qu’ils soient
impliqués dans la résolution des conflits
que la sécurité soit assurée, notamment à la phase d’exploitation de la ligne (exemple d’un berger
qui était monté sur un pylône pour surveiller son troupeau de haut et qui est mort électrocuté)
Crainte :
que les jeunes n’aient pas d’emplois
que les okals ne soient pas impliqués
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
363 363
Procès Verbal de réunion
Date: 26/08/2020 Lieu: Dikhil
Personnes présentes l’équipe de Insuco et 7 femmes de la région de Dikhil
Objet: Réaliser un focus group avec les femmes de la région de Dikhil
Conclusion du focus group :
Infrastructure dans leur village :
Dikhil : a toutes les infrastructures
Yoboki : a une mosquée, un imam, une école primaire, des professeurs, un collège, des
professeurs, un centre de soin avec des infirmiers, des forages d’eau mais l’eau est insuffisante et
les habitants dépendant de camion-citerne. Surtout, Yoboki n’est pas reliée à l’électricité.
Galafi : mosquée + imam, école primaire + professeurs, pas de collège ; caravane irrégulière pour
les soins (si complication, vont à Yoboki puis à Dikhil, puis à Ali Sabieh). Pas d’eau suffisante et
dépendance de camion-citerne, pas d’électricité.
Sensibilisation sur le VIH : la dernière campagne date de 2017 à Dikhil (des spécialistes sont venus sur
place).
Responsabilités entre hommes et femmes : traditionnellement, les hommes sont responsables de
ramener de l’argent au foyer et les femmes s’occupaient du foyer. Aujourd’hui, les deux ramènent un revenu
comme ils peuvent. Les femmes travaillent et s’occupent en plus des tâches domestiques traditionnelles, ce
qui complique leur condition de vie. Certain ménage dont le chef est chômeur bénéficient de projet de filet
social fourni par l’ADDS, soit 30 000 fdj (150€) tous les 3 mois mais tous les pauvres ne sont pas cibler par
le projet (exemple d’une femme veuve avec 5 enfants qui n’est pas bénéficiaire).
Les hommes s’occupent des chameaux, les femmes et les enfants des chèvres et des moutons.
Les hommes sont propriétaires, il est très rare que les femmes puissent le devenir (sauf en cas de veuvage
par exemple, et encore).
Les femmes et les enfants s’occupent d’aller chercher de l’eau. Il n’y a apriori pas de risque sur le trajet pour
aller cherche de l’eau.
Certaines femmes qui ont un revenu sont artisanes (fabrication de paniers), vendeuses de khat, vendeuses
de glace à la sortie des écoles, commerçantes, coiffeuse (chez elle). Leurs clients sont des gens de leur
localité. La totalité de leur revenu va à la famille et une partie est épargnée pour pallier les aléas.
Attentes :
- Opportunités de travail pour les femmes
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
364 364
- Electricité à Yoboki et dans tous les villages non connectés,
- Remise sur le tarif de l’électricité
Craintes :
- Pour leur santé avec la présence des lignes à HT
- Voir le courant passer au-dessus de leur tête sans être relié à l’électricité
Il n’y a pas de site particulièrement important dans la zone et qui doivent être évités. Cependant, tout
patrimoine déplacé ou endommagé doit faire l’objet d’une compensation et d’une discussion avec le préfet,
le sous-préfet et les chefs coutumiers.
Travail des femmes sur le projet : les femmes sont très motivées pour travailler sur le projet, en tant que
restauratrices, femmes de ménage, laveuses, agent de sécurité, électricienne, etc. La distance et les
transports ne sont pas un problème : « tout ce que fait un homme, on peut le faire aussi ».
Un camp de travailleur à proximité de leur village est plus vu comme un avantage que comme une crainte et
serait source d’opportunités de business, ce qui augmenterait leurs revenus.
Violence : Dans leurs villages, tout le monde se connait et elles se sentent en sécurité, ce sont même elles
qui font peur aux étrangers. Lorsqu’elles sont victimes de violence, elles peuvent aller voir la police ou le
cadi. Le plus souvent ça se règle selon les coutumes des clans et les problèmes se règlent toujours à
l’amiable. Il y a une celle d’écoute de l’UNFD à Dikhil mais pas plus loin.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
365 365
Focus group femmes
Compte-rendu
Date : 7 mai 2020
Lieu : Holl-holl, maison de la directrice de l’association des femmes de Holl-holl
Participants :
EDD Insuco
Abdourahman, Chef de la subdivision Sud Louise Pierre, experte social
Hamza Abdillahi, traducteur
Kamil Daoud Banoiyta, chauffeur
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un focus group avec les femmes de l’association des femmes de
Holl-holl s’est tenu.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population
Collecter les craintes énoncées par les femmes
Collecter les attentes énoncées par les femmes
Collecter une première série d’informations spécifiques aux femmes (accès aux services de
base, suivi pré et post accouchement)
Conclusions :
Pour la totalité des femmes, l’impact de ce projet sera positif. La venue de travailleurs sur
ce projet sera source d’opportunité économique.
Holl-holl est connecté au réseau d’électricité depuis mai 2019. Les ménages n’ont pas été
facturés tous les deux mois comme il est d’usage à Djibouti mais au bout d’un an. Le
montant de la facture était trop élevé pour les ménages, qui n’ont pas pu payer. L’EDD a dit
qu’un processus de négociation allait se mettre en place. Les femmes font la demande que
cette facture soit annulée et que l’électricité soit gratuite ou à demi-tarif pour les ménages
de Holl-holl.
L’association des femmes est composée de 6 groupes de 15 femmes de Holl-holl. Leur
cheffe est Fatima Ahmed Ibrahim. Le seul critère pour adhérer à l’association est d’être une
femme. L’association est uniquement financée par ses membres et par une aide de
l’Agence Djiboutienne de Développement Social. L’association réalise principalement des
tontines, des prêts monétaires et des activités de nettoyage de leur localité. Les
bénéficiaires des activités sont des femmes.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
366 366
Lors de grossesse, les femmes sont suivies par une sage-femme. Elles accouchent à
l’hôpital de Holl-holl. Lorsqu’un accouchement est compliqué, elles sont transférées à Ali
Sabieh ou à Djibouti.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
367 367
Liste de présences
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
368 368
Focus group avec les notables et élus d’Ali Sabieh
Compte-rendu
Date : 11 mai 2020
Lieu : Quartier général de l’EDD à Ali Sabieh
Participants :
EDD Insuco Notables et élus
Abdourahman, Chef de la
subdivision Sud
Louise Pierre, experte social D’Ali Sabieh
Equipe technique de l’EDD Mohamed Omar Moussa,
facilitateur
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un focus group avec notables de la région d’Ali Sabieh s’est
tenu.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population
Collecter les craintes énoncées par les notables
Collecter les attentes énoncées par les notables
Conclusions :
Plusieurs craintes ont été énoncées lors de ce focus group :
La population, le cheptel et les pâturages ne devront pas être affectés ou restreints par ce projet.
La population va voir des lignes HT passer sur leur territoire, sans pour autant être raccordée au
réseau. Les élus et notables anticipent devoir expliquer cet état de fait à la population.
Ce projet renforce la dépendance énergétique de Djibouti envers l’Ethiopie.
Les nouveaux pylônes vont polluer visuellement les paysages traversés.
Cette 2éme ligne pourrait ne pas changer le tarif actuel de l’électricité.
Plusieurs attentes ont été énoncées lors de ce focus group :
Goubeito, a proximité de la ligne, n’est pas raccordé à l’électricité. Les élus et notables demandent
que la localité soit électrifiée.
Des emplois doivent être fournis en priorité à la population locale, notamment pendant la phase de
construction.
Ce projet va augmenter le volume de production d’électricité et stabiliser le flux d’électricité. Les
intervenants espèrent que les chutes de tension du réseau vont diminuer.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
369 369
Le tarif de l’électricité est trop élevé pour la population locale qui est en situation précaire. Les
intervenants demandent un tarif adapté à la population. Ce tarif doit concerner les couches sociales
les plus défavorisées mais aussi les commerces. Il semble incohérent de faire payer un ménage ou
un commerce d’Alli Sabieh de la même manière qu’un ménage ou un commerce de Djibouti, alors
que les conditions de vie et de commerce des uns et des autres ne sont pas comparables.
Des coupures d’électricité sont observées en été, alors qu’il fait très chaud et que la population a
besoin de ventilateur et de climatiseur. Les intervenants attendent de ce projet que les coupures
cessent, surtout pendant l’été.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
370 370
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
371 371
Focus group notables de Holl-holl
Compte-rendu
Date : 30 avril 2020
Lieu : Holl-holl, maison de la directrice de l’association des femmes de Holl-holl
Participants :
EDD Insuco Notables
Abdourahman, Chef de
la subdivision Sud
Louise Pierre, experte social 14 notables et élus de Holl-holl
Hamza Abdillahi, traducteur
Kamil Daoud Banoiyta, chauffeur
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un focus group avec notables de Holl-holl s’est tenu.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population
Collecter les craintes énoncées par les notables
Collecter les attentes énoncées par les notables
Conclusions :
Plusieurs craintes ont été énoncées lors de ce focus group :
La ligne aura un impact visuel dans le paysage. Il y aurait 2 lignes Haute Tension sur le
territoire djiboutien, ce qui détériorera d’autant plus le paysage des régions traversées.
La source d’énergie pour cette nouvelle ligne est la même que celle de la 1ère ligne, ce qui
renforce la dépendance énergétique de Djibouti vis-à-vis de l’Ethiopie.
Une ligne à haute tension peut être dangereuse pour la population, notamment par les
ondes qu’elle produit mais aussi si un câble se rompt et tombe au sol (risque
d’électrification).
Il est nécessaire de mettre en place un moyen de stockage d’électricité si une coupure se
produit sur la ligne.
Plusieurs attentes ont été énoncées lors de ce focus group :
Holl-holl pourrait être raccordée à terme à cette ligne.
La population de Holl-holl et de ses alentours est en situation de grande précarité. Holl-
holl pourrait bénéficier de l’électricité gratuitement ou avoir un prix unitaire de
l’électricité spécifique et adapté à sa population.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
372 372
Les écoles, les puits à forages, les centres de santé, des lampadaires se trouvant à
proximité de la zone du projet pourraient être alimentés gratuitement par l’EDD comme
mesures d’accompagnement sociale.
Les fontaines qui approvisionnent la ville en eau ont un trop faible débit et trop de
personnes viennent s’y approvisionner, ce qui provoque une longue attente. Augmenter
le volume d’au ou la capacité de débit serait une mesure d’accompagnement
intéressante.
Liste de présences
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
373 373
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 18 mai 2020
Lieu : Hôtel d'Arta
Participants :
EDD Insuco Notable d'Arta
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Awaleh
Abdoulkader
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Fiche de présence attachée
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux du Ministère du
Transport.
Dans ce cadre, une réunion a été organisée dans la ville d'Arta, chef lieu de la région d'Arta, rassemblant
ainsi l'équipe EDD (le client) ainsi que l'ensemble des élus locaux.
La réunion a été présidée par le préfet de la région ainsi que le Président du Conseil.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
L'ensemble des élus a applaudi l'arrivée d'un tel projet pour Djibouti
Néanmoins ces derniers ont demandé que certaines conditions soient remplies
Plusieurs attentes ont été énoncées :
Espérance d'une électrification généralisée du pays
Nombreuses opportunités de travail pour la jeunesse pendant la phase de construction
Eviter de croiser les infrastructures telles que la route ou encore le barrage de l'amitié
Souhait d'être informé au commencement des travaux
Problème d'acquisition de terre lors de l'installation de la 1ère ligne : à ne pas réitérer
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
374 374
Souhait d'alimenter la zone de PK51 en électricité
Souhait d'une diminution drastique du prix du Kw/H
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
375 375
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 12 mai 2020
Lieu : Ministère de l'Environnement
Participants :
EDD Insuco Direction Environnement
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Houssein Rirah (Directeur
de l'environnement)
Idriss Ismael Nour (DGA
Environnement)
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux de la Direction de
l'Environnement.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
Le Directeur déplore le manque d'information et de documents à leur égard de la part de
l'EDD.
Les TDR environnementaux ont été réalisés par EDD (Djibouti) et EEP (Ethiopie) sans
consulter la direction de l'environnement.
L'EDD se défend en mettant en avant le manque de temps pour envoi au bailleur.
Plusieurs attentes ont été énoncées:
La direction espère une électrification totale du pays afin de s'implanter dans les différentes
régions et ainsi protéger l'environnement terrestre et marin.
Espérance d'un coût du KW/H moins élevé afin d'aider les ménages
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
376 376
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 12 mai 2020
Lieu : Ministère du Transport
Participants :
EDD Insuco Ministère du Transport
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Said Hassan (Secrétaire
Général du Ministère du
Transport)
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux du Ministère du
Transport.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
Le SG pointe le risque d'un croisement entre la nouvelle ligne d'interconnexion ainsi que la
nouvelle route RN14.
Plusieurs attentes ont été énoncées:
Cette nouvelle ligne doit combler le manque de puissance électrique du train.
Espérance d'un coût du KW/H moins élevé afin d'aider les ménages
Retombées économiques et créations d'emplois dans ces régions reculées
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
377 377
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 13 mai 2020
Lieu : Direction du Financement Extérieur
Participants :
EDD Insuco Ministère du Transport
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Ali Mohamed Ali Gadileh
(Directeur)
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux de la direction du
financement extérieur.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
Projet faisant l'objet d'un prêt mixte entre la BAD et la BM.
Satisfait de la mise en œuvre de ce projet.
Projet dans la logique de la stratégie de développement énergétique du pays auprès des
grands bailleurs
Plusieurs attentes ont été énoncées :
Espérance d'un coût du KW/H moins élevé afin d'aider les ménages
Retombées économiques et créations d'emplois dans ces régions reculées
Ce projet doit permettre de donner les moyens au Tourisme de se développer
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
378 378
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 13 mai 2020
Lieu : Ministère de l'Energie
Participants :
EDD Insuco Direction Environnement
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Mohamed Kilch Wais (SG)
Gouled Mohamed
(Directeur de l'Energie)
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux du Ministère de
l'Energie.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
Le Secrétaire Général est convaincu de l'importance et l'utilité de ce projet.
Plusieurs attentes ont été énoncées:
L'apport de cette nouvelle ligne doit permettre de faciliter le transport (Train, route…) et
limiter les baisses et hausses de tensions auprès des ménages.
Espérance d'un coût du KW/H moins élevé afin d'aider les ménages
Ce projet viendra compléter et assister les projets d'électricité verte (Biomass, solaire,
géothermie…) de Djibouti
Possibilité à l'avenir de revendre cette électricité aux pays voisins.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
379 379
Rencontre Parties Prenantes
Compte-rendu
Date : 18 mai 2020
Lieu : Ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'élevage et des Ressources Halieutiques
(MAEPE-RH)
Participants :
EDD Insuco Ministère du Transport
Mahamoud (Chef de service de la
station de dispatching national)
Maxime GERMAIN, Directeur
Insuco
Ibrahim Elmi (Secrétaire
Général du Ministère
MAEPE-RH
Introduction
L’engagement des parties prenantes est une condition au bon déroulement des projets de développement
(Norme Environnementale et Sociale 10 de la Banque Mondiale). Dans le cadre du projet de la 2ème ligne
d’interconnexion entre l’Ethiopie et Djibouti, un rendez-vous a été tenu dans les bureaux du Ministère du
Transport.
Objectifs :
Présenter le projet et ses principaux impacts sur la population et l'environnement.
Collecter les craintes.
Collecter les attentes.
Collecter des idées ou informations supplémentaires.
Conclusions :
Le SG a tenu à préciser qu'il n'a pas été consulté lors de l'élaboration des études
précédentes et le manque de transparence de l'EDD au regard du projet
Satisfait de l'élaboration d'un tel projet pour le pays
Plusieurs attentes ont été énoncées:
Espérance d'une électrification généralisée du pays
Possibilité d'alimenter les différentes zones d'agriculture (même si le solaire suffit)
Possibilité de créer des points de stockage du poisson dans les zones reculées (Nord du
pays) et ainsi aider les pêcheurs locauxDémocratiser le coût du KW/H et ainsi augmenter le
nombre d'abonné
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
380 380
8.7 Bibliographie de la partie sociale
Annuaires statistiques de Djibouti, 2012, DISED.
Annuaires statistiques de Djibouti, 2017, DISED.
Annuaires statistiques de Djibouti, 2019, DISED.
Annuaires statistiques 2007-2008, Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur de
Djibouti.
Annuaires statistiques 2019-2020, Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur de
Djibouti.
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), 2006, UNICEF.
Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM), 2012. DISED
Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages (EDAM), 2019. DISED
Enquête Djiboutienne Auprès des Ménages- Energie (EDAM- Energie), 2004. DISED
Enquête Djiboutienne sur l’Emploi, le Secteur Informel et la Consommation (EDESIC) 2015, DISED
Profil de la pauvreté, 2012, DISED.
Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM), 2004, Ligue des Etats Arabes
Migration Snap shot 2019, OIM
Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition (AGVSAN)- 2014,
PAM.
Haral Mahis et les Afar, importance d'un mythe dans les positionnements sociaux et les stratégies
de pouvoir, Rahem Karim, 2001.
Décentralisation, foncier et acteurs locaux- Fiche Pays Djibouti, Comité technique foncier et
développement, 2009.
Djibouti Contemporain, Amina Saïd Chiré, KARTHALA Editions, 2013
AQUASTAT Profil de Pays – Djibouti, FAO, 2005.
« Étude relative aux emplois directs et indirects du BTP, des transports et de la filière environnement
». Étude réalisée par le BIPE pour le MEDAD (SG/ DAEI/BASP), décembre 2007
"EMF, Electric and Magnetic Fields Associated with the Use of Electric Power", National Institute of
Environmental Health Sciences des États-Unis, Juin 2002.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
381 381
8.8 Bibliographie pour la partie environnementale
Ahmed AH, Rayaleh WE, Zghibi A and Ouaddane B. 2017. Assessment of chemical quality of
groundwater in coastal volcano-sedimentary aquifer of Djibouti, Horn of Africa. Journal of African
Earth Sciences 131, 284-300. doi 10.1016/j.jafrearsci.2017.04.010
Ahmed IM, Le Coz M, Jalludin M, Sardini P and Razack M. 2018. Assessment of Groundwater
Resources in a Complex Volcanic Reservoir with Limited Data Sets in a Semi-Arid Context Using a
Novel Stochastic Approach. The Goda Volcanic Massif, Republic of Djibouti. Journal of Water
Resource and Protection 10, 106-120. doi 10.4236/jwarp.2018.101007
CERD, Geographic distribution of wind velocities of Djibouti at 60m height. cited in in Omar Assowe
Dabar, Abdou Idris, Abdoulkader Ibrahim Idriss, D. Mohamed Said.2016. Integration of Wind Flow
into the Bioclimatic Design in Djibouti. International Journal for Computational Civil and Structural
Engineering 5(2):87-92.
Climate Change Knowledge Portal – Djibouti country profile.
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/djibouti
Earthwise, British Geological Survey. Hydrogeology of Djibouti.
http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrogeology_of_Djibouti
FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2015. Report on the African
Soil Partnership Workshop organized during 20 – 22 May 2015 at Elmina, Ghana.
FAO AQUASTAT. 2005. AQUASTAT - FAO's Global Information System on Water and Agriculture-
Djibouti. http://www.fao.org/aquastat/en/countries-and-basins/country-profiles/country/DJI
Heritage Steven, Houssein Rayaleh, Djama G. Awaleh and Galen B. Rathbun. New records of a lost
species and a geographic range expansion for sengis in the Horn of Africa. 2020. New records of a
lost species and a geographic range expansion for sengis in the Horn of Africa. PeerJ 8:e9652 DOI
10.7717/peerj.9652
Holst, B., A. Ahmed, A. A. Aouled, A. A. Mohamed, A. Laurent, A. M. Aman, A. Desbiez, B. Mulot, B.
Lafrance, C. Gibault, D. Mallon, E. Ruivo, H. A. Rayaleh, K. Leus, P. Moehlmann, P. McGowan.
(eds.). 2013: Conserving Djibouti’s Priority Land Animals – a Seminar and Conservation Workshop.
Final Report. IUCN SSC.
Jalludin M and Razack M. 2004. Assessment of hydraulic properties of sedimentary and volcanic
aquifer systems under arid conditions in the Republic of Djibouti (Horn of Africa). Hydrogeology
Journal, 12, 159-170. doi 10.1007/s10040-003-0312-2.
JICA. 2014. The Republic of Djibouti: the Master Plan Study for sustainable irrigation and farming in
southern Djibouti. Final Report. JICA, December 2014.
Kottek Markus, Jürgen Grieser, Christoph Beck, Bruno Rudolf and Franz Rubel. 2006. World Map
of the Köppen-Geiger climate classification updated. Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, No. 3,
259-263 (June 2006).
Magin, Georgina. Important Bird Areas in Africa and associated islands – Djibouti.
http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/IBAs/AfricaCntryPDFs/Djibouti.pdf
Nations Encyclopedia. The Encyclopedia of the Nations- Djibouti.
https://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Djibouti.html
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
382 382
Real time satellite data https://www.iqair.com/ 22 September2020
Schlüter, Thomas. 2006. Geological Atlas of Africa: With Notes on Stratigraphy, Tectonics, Economic
Geology, Geohazards and Geosites of Each Country. Springer Science & Business Media.
WELCH, G. R. AND WELCH, H. J. (1992) Djibouti III—Migrant Raptor Count. Minsmere Reserve,
Suffolk, UK
Wilby R.L., S. Mora, A.O. Abdallah and A. Ortiz. 2010. Confronting climate variability and change in
Djibouti through risk management. Geologically Active – Williams et al. (eds). Taylor & Francis
Group, London.
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
383 383
8.9 Photo de la faune et de la flore
Photo 17 : Senna alexandrina
Photo 18 : Calotropis Procera
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
384 384
Photo 19 : Solanum Somalense
Photo 20 : Commiphora Myrrha
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
385 385
Photo 21 : Citrullus ecirrhosus
Photo 22 : Aizoon Canariense
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
386 386
Photo 23 : Aerva javanica
Photo 24 : Aristolochia bracteolala
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
387 387
Photo 25 : Anticharis Glandulosa
Photo 26 : Hyphaene thebaica
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
388 388
Photo 27: Papio hamadryas
Photo 28 : Gazella dorcas
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
389 389
Photo 29: Dromadaire (Camelus dromedarius)
Photo 30: Anes domestiqués
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
390 390
Photo 31 : Moutons domestiqués
Photo 32: Chèvres domestiqués
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
391 391
Photo 33: Streptopelia roseogrise
Photo 34: Pterocles exustus
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
392 392
Photo 35: Oena capensis
Photo 36: Ploceus galbula
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
393 393
Landscape
Photo 37: Dépôt de sel à Yoboki
Photo 38 : Une mare temporaire à Dikhil
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
394 394
Photo 39 : Une mare temporaire à Ali Sabieh
Photo 40 : Jardin à Ali Sabieh
ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU SECOND PROJET DE LIGNE D’INTERCONNEXION ENTRE L’ETHIOPIE
ET DJIBOUTI - PARTIE DJIBOUTIENNE
395 395
Photo 41: Erosion du remblais