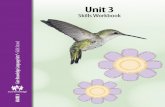LES CINQ FILLES DE Mrs BENNET
-
Upload
aboutmcdonalds -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LES CINQ FILLES DE Mrs BENNET
Jane Austen
LES CINQ FILLES DEMrs BENNET
Pride and prejudice
1813
Traduit de l’anglais par V. Leconte et Ch.Pressoir
INTRODUCTIONLes intrigues sont simples, quoique nourries
d’incidents multiples et variés. Contemporaine des débutsdu romantisme, Jane Austen y est restée à peu prèsétrangère. Elle ne se complaît pas dans la peinture dessituations tragiques ni des passions violentes.Observatrice avant tout, elle cherche seulement dansl’intrigue l’occasion de provoquer le jeu des sentiments, demettre en lumière l’évolution des principaux caractères,et de marquer les traits saillants des autres. C’est par làque ses personnages de premier plan attirent, intéressentet captivent le lecteur. Elle pousse le dédain dupittoresque jusqu’à ne pas nous faire connaître leur aspectphysique, mais elle arrive si bien à nous les représenter« du dedans » qu’ils vivent vraiment sous nos yeux. Seshéroïnes ne se montrent ni très sentimentales, ni trèspassionnées, mais elles ont bien du charme. Leurs naturessont très différentes : Anne Elliot, plus tendre et un peusecrète, Elinor Dashwood, raisonnable et mesurée, EmmaWoodhouse, pleine de confiance en elle-même, désireusede mener à son idée, et pour le plus grand bien de tous, lepetit monde qui l’entoure ; Elizabeth Bennet, spontanée,spirituelle et gaie, portant partout sa franchise et sonindépendance de jugement. Chacune a ses qualités, ses
défauts, ses erreurs d’appréciation, ses préventions. Cequ’elles ont de commun entre elles, c’est une intelligencefine, pénétrante, et une certaine maturité d’esprit quidonne de la valeur à toutes leurs réflexions.
Miss Austen n’a pas moins soigné ses personnagessecondaires, et nombreux parmi eux sont ceux qui ontexcité sa verve et son sens aigu du ridicule : bourgeoisesvulgaires, mères enragées de marier leurs filles, dames depetite noblesse gonflées de leur importance et flattéeslourdement par leurs protégés, « baronets » férus de leurtitre, que la vue de leur arbre généalogique remplitchaque jour d’une satisfaction inlassable, jeunes filleshautaines et prétentieuses, petites écervelées dontl’imagination ne rêve que bals, flirts et enlèvements, semeuvent autour des personnages principaux et formentun ensemble de types comiques dont aucun ne nous laisseindifférents. De même qu’un lecteur de David Copperfieldn’oubliera pas Mr. Micawber et Uriah Heep, celui qui a luPride and Préjudice conserve toujours le souvenir de ladyCatherine et de Mr. Collins. Au milieu de tout ce mondequi s’agite, quelques observateurs, judicieux comme Mr.Knightley, ou ironiques comme M. Bennet, portent desjugements savoureux, incisifs, dont leur entourage ne faitpas toujours son profit.
Ces récits qui se développent à loisir dans une langueclaire, souple et aisée, coupés de dialogues animés, ontprovoqué les éloges de plusieurs grands écrivains anglais.Walter Scott enviait la délicatesse de touche avec laquelleJane Austen donnait de l’intérêt aux incidents les plus
ordinaires. Macaulay l’a comparée à Shakespeare pour safacilité à créer des caractères. Thackeray reconnaissaitque tous ces petits détails vécus, tous ces menus faitsd’observation rendent un son si naturel qu’ils rappellentl’art de Swift. Lewes déclarait qu’il aimerait mieux êtrel’auteur de Pride and Prejudice que d’avoir écrit tous lesromans de Walter Scott. Et les critiques de notre époquecontinuent à témoigner à Jane Austen l’admiration qu’ellemérite et dont elle a si peu joui de son vivant.
IC’est une vérité universellement reconnue qu’un
célibataire pourvu d’une belle fortune doit avoir envie dese marier, et, si peu que l’on sache de son sentiment à cetégard, lorsqu’il arrive dans une nouvelle résidence, cetteidée est si bien fixée dans l’esprit de ses voisins qu’ils leconsidèrent sur-le-champ comme la propriété légitime del’une ou l’autre de leurs filles.
– Savez-vous, mon cher ami, dit un jour Mrs. Bennet àson mari, que Netherfield Park est enfin loué ?
Mr. Bennet répondit qu’il l’ignorait.
– Eh bien, c’est chose faite. Je le tiens de Mrs. Longqui sort d’ici.
Mr. Bennet garda le silence.
– Vous n’avez donc pas envie de savoir qui s’yinstalle ! s’écria sa femme impatientée.
– Vous brûlez de me le dire et je ne vois aucuninconvénient à l’apprendre.
Mrs. Bennet n’en demandait pas davantage.
– Eh bien, mon ami, à ce que dit Mrs. Long, le nouveaulocataire de Netherfield serait un jeune homme très riche
du nord de l’Angleterre. Il est venu lundi dernier enchaise de poste pour visiter la propriété et l’a trouvéetellement à son goût qu’il s’est immédiatement entenduavec Mr. Morris. Il doit s’y installer avant la Saint-Michelet plusieurs domestiques arrivent dès la fin de la semaineprochaine afin de mettre la maison en état.
– Comment s’appelle-t-il ?
– Bingley.
– Marié ou célibataire ?
– Oh ! mon ami, célibataire ! célibataire et très riche !Quatre ou cinq mille livres de rente ! Quelle chance pournos filles !
– Nos filles ? En quoi cela les touche-t-il ?
– Que vous êtes donc agaçant, mon ami ! Je pense,vous le devinez bien, qu’il pourrait être un parti pourl’une d’elles.
– Est-ce dans cette intention qu’il vient s’installer ici ?
– Dans cette intention ! Quelle plaisanterie ! Commentpouvez-vous parler ainsi ?… Tout de même, il n’y auraitrien d’invraisemblable à ce qu’il s’éprenne de l’une d’elles.C’est pourquoi vous ferez bien d’aller lui rendre visite dèsson arrivée.
– Je n’en vois pas l’utilité. Vous pouvez y aller vous-même avec vos filles, ou vous pouvez les envoyer seules,ce qui serait peut-être encore préférable, car vous êtes sibien conservée que Mr. Bingley pourrait se tromper et
égarer sur vous sa préférence.
– Vous me flattez, mon cher. J’ai certainement eu mapart de beauté jadis, mais aujourd’hui j’ai abdiqué touteprétention. Lorsqu’une femme a cinq filles en âge de semarier elle doit cesser de songer à ses propres charmes.
– D’autant que, dans ce cas, il est rare qu’il lui en restebeaucoup.
– Enfin, mon ami, il faut absolument que vous alliezvoir Mr. Bingley dès qu’il sera notre voisin.
– Je ne m’y engage nullement.
– Mais pensez un peu à vos enfants, à ce que seraitpour l’une d’elles un tel établissement ! Sir William et ladyLucas ont résolu d’y aller uniquement pour cette raison,car vous savez que, d’ordinaire, ils ne font jamais visiteaux nouveaux venus. Je vous le répète. Il estindispensable que vous alliez à Netherfield, sans quoi nousne pourrions y aller nous-mêmes.
– Vous avez vraiment trop de scrupules, ma chère. Jesuis persuadé que Mr. Bingley serait enchanté de vousvoir, et je pourrais vous confier quelques lignes pourl’assurer de mon chaleureux consentement à son mariageavec celle de mes filles qu’il voudra bien choisir. Je crois,toutefois, que je mettrai un mot en faveur de ma petiteLizzy.
– Quelle idée ! Lizzy n’a rien de plus que les autres ;elle est beaucoup moins jolie que Jane et n’a pas lavivacité de Lydia.
– Certes, elles n’ont pas grand’chose pour lesrecommander les unes ni les autres, elles sont sottes etignorantes comme toutes les jeunes filles. Lizzy, pourtant,a un peu plus d’esprit que ses sœurs.
– Oh ! Mr. Bennet, parler ainsi de ses propres filles !…Mais vous prenez toujours plaisir à me vexer ; vousn’avez aucune pitié pour mes pauvres nerfs !
– Vous vous trompez, ma chère ! J’ai pour vos nerfs leplus grand respect. Ce sont de vieux amis : voilà plus devingt ans que je vous entends parler d’eux avecconsidération.
– Ah ! vous ne vous rendez pas compte de ce que jesouffre !
– J’espère, cependant, que vous prendrez le dessus etque vous vivrez assez longtemps pour voir de nombreuxjeunes gens pourvus de quatre mille livres de rente venirs’installer dans le voisinage.
– Et quand il en viendrait vingt, à quoi cela servirait-il,puisque vous refusez de faire leur connaissance ?
– Soyez sûre, ma chère, que lorsqu’ils atteindront cenombre, j’irai leur faire visite à tous.
Mr. Bennet était un si curieux mélange de vivacité,d’humeur sarcastique, de fantaisie et de réserve qu’uneexpérience de vingt-trois années n’avait pas suffi à safemme pour lui faire comprendre son caractère. Mrs.Bennet elle-même avait une nature moins compliquée :d’intelligence médiocre, peu cultivée et de caractère
inégal, chaque fois qu’elle était de mauvaise humeur elles’imaginait éprouver des malaises nerveux. Son grandsouci dans l’existence était de marier ses filles et sadistraction la plus chère, les visites et les potins.
IIMr. Bennet fut des premiers à se présenter chez Mr.
Bingley. Il avait toujours eu l’intention d’y aller, tout enaffirmant à sa femme jusqu’au dernier moment qu’il nes’en souciait pas, et ce fut seulement le soir qui suivitcette visite que Mrs. Bennet en eut connaissance. Voicicomment elle l’apprit : Mr. Bennet, qui regardait saseconde fille occupée à garnir un chapeau, lui ditsubitement :
– J’espère, Lizzy, que Mr. Bingley le trouvera de songoût.
– Nous ne prenons pas le chemin de connaître lesgoûts de Mr. Bingley, répliqua la mère avec amertume,puisque nous n’aurons aucune relation avec lui.
– Vous oubliez, maman, dit Elizabeth, que nous lerencontrerons en soirée et que Mrs. Long a promis denous le présenter.
– Mrs. Long n’en fera rien ; elle-même a deux nièces àcaser. C’est une femme égoïste et hypocrite. Je n’attendsrien d’elle.
– Moi non plus, dit Mr. Bennet, et je suis bien aise depenser que vous n’aurez pas besoin de ses services.
Mrs. Bennet ne daigna pas répondre ; mais, incapablede se maîtriser, elle se mit à gourmander une de sesfilles :
– Kitty, pour l’amour de Dieu, ne toussez donc pasainsi. Ayez un peu pitié de mes nerfs.
– Kitty manque d’à-propos, dit le père, elle ne choisitpas le bon moment pour tousser.
– Je ne tousse pas pour mon plaisir, répliqua Kittyavec humeur. Quand doit avoir lieu votre prochain bal,Lizzy ?
– De demain en quinze.
– Justement ! s’écria sa mère. Et Mrs. Long qui estabsente ne rentre que la veille. Il lui sera donc impossiblede nous présenter Mr. Bingley puisqu’elle-même n’aurapas eu le temps de faire sa connaissance.
– Eh bien, chère amie, vous aurez cet avantage surMrs. Long : c’est vous qui le lui présenterez.
– Impossible, Mr. Bennet, impossible, puisque je ne leconnaîtrai pas. Quel plaisir trouvez-vous à me taquinerainsi ?
– J’admire votre réserve ; évidemment, des relationsqui ne datent que de quinze jours sont peu de chose, maissi nous ne prenons pas cette initiative, d’autres laprendront à notre place. Mrs. Long sera certainementtouchée de notre amabilité et si vous ne voulez pas faire laprésentation, c’est moi qui m’en chargerai.
Les jeunes filles regardaient leur père avec surprise.Mrs. Bennet dit seulement :
– Sottises que tout cela.
– Quel est le sens de cette énergique exclamation ?s’écria son mari, vise-t-elle les formes protocolaires de laprésentation ? Si oui, je ne suis pas tout à fait de votreavis. Qu’en dites-vous, Mary ? vous qui êtes une jeunepersonne réfléchie, toujours plongée dans de gros livres ?
Mary aurait aimé faire une réflexion profonde, mais netrouva rien à dire.
– Pendant que Mary rassemble ses idées, continua-t-il, retournons à Mr. Bingley.
– Je ne veux plus entendre parler de Mr. Bingley !déclara Mrs. Bennet.
– J’en suis bien fâché ; pourquoi ne pas me l’avoir ditplus tôt ? Si je l’avais su ce matin je me seraiscertainement dispensé d’aller lui rendre visite. C’est trèsregrettable, mais maintenant que la démarche est faite,nous ne pouvons plus esquiver les relations.
La stupéfaction de ces dames à cette déclaration futaussi complète que Mr. Bennet pouvait le souhaiter, cellede sa femme surtout, bien que, la première explosion dejoie calmée, elle assurât qu’elle n’était nullement étonnée.
– Que vous êtes bon, mon cher ami ! Je savais bienque je finirais par vous persuader. Vous aimez trop vosenfants pour négliger une telle relation. Mon Dieu, que jesuis contente ! Et quelle bonne plaisanterie aussi, d’avoir
fait cette visite ce matin et de ne nous en avoir rien ditjusqu’à présent !
– Maintenant, Kitty, vous pouvez tousser tant quevous voudrez, déclara Mr. Bennet. Et il se retira, un peufatigué des transports de sa femme.
– Quel excellent père vous avez, mes enfants !poursuivit celle-ci, lorsque la porte se fut refermée. – Jene sais comment vous pourrez jamais vous acquitterenvers lui. À notre âge, je peux bien vous l’avouer, on netrouve pas grand plaisir à faire sans cesse de nouvellesconnaissances. Mais pour vous, que ne ferions-nous pas !… Lydia, ma chérie, je suis sûre que Mr. Bingley danseraavec vous au prochain bal, bien que vous soyez la plusjeune.
– Oh ! dit Lydia d’un ton décidé, je ne crains rien ; jesuis la plus jeune, c’est vrai, mais c’est moi qui suis la plusgrande.
Le reste de la soirée se passa en conjectures ; cesdames se demandaient quand Mr. Bingley rendrait lavisite de Mr. Bennet, et quel jour on pourrait l’inviter àdîner.
IIIMalgré toutes les questions dont Mrs. Bennet, aidée de
ses filles, accabla son mari au sujet de Mr. Bingley, elle neput obtenir de lui un portrait qui satisfît sa curiosité. Cesdames livrèrent l’assaut avec une tactique variée :questions directes, suppositions ingénieuses, lointainesconjectures. Mais Mr. Bennet se déroba aux manœuvresles plus habiles, et elles furent réduites finalement à secontenter des renseignements de seconde main fournispar leur voisine, lady Lucas.
Le rapport qu’elle leur fit était hautement favorable :sir William, son mari, avait été enchanté du nouveauvoisin. Celui-ci était très jeune, fort joli garçon, et, ce quiachevait de le rendre sympathique, il se proposaitd’assister au prochain bal et d’y amener tout un grouped’amis. Que pouvait-on rêver de mieux ? Le goût de ladanse mène tout droit à l’amour ; on pouvait espérerbeaucoup du cœur de Mr. Bingley.
– Si je pouvais voir une de mes filles heureusementétablie à Netherfield et toutes les autres aussi bienmariées, répétait Mrs. Bennet à son mari, je n’aurais plusrien à désirer.
Au bout de quelques jours, Mr. Bingley rendit sa visite
à Mr. Bennet, et resta avec lui une dizaine de minutesdans la bibliothèque. Il avait espéré entrevoir les jeunesfilles dont on lui avait beaucoup vanté le charme, mais ilne vit que le père. Ces dames furent plus favorisées car,d’une fenêtre de l’étage supérieur, elles eurent l’avantagede constater qu’il portait un habit bleu et montait uncheval noir.
Une invitation à dîner lui fut envoyée peu après et,déjà, Mrs. Bennet composait un menu qui ferait honneur àses qualités de maîtresse de maison quand la réponse deMr. Bingley vint tout suspendre : « Il était obligé de partirpour Londres le jour suivant, et ne pouvait, parconséquent, avoir l’honneur d’accepter… etc.… »
Mrs. Bennet en fut toute décontenancée. Elle n’arrivaitpas à imaginer quelle affaire pouvait appeler Mr. Bingleyà Londres si tôt après son arrivée en Hertfordshire.Allait-il, par hasard, passer son temps à se promener d’unendroit à un autre au lieu de s’installer convenablement àNetherfield comme c’était son devoir ?… Lady Lucascalma un peu ses craintes en suggérant qu’il était sansdoute allé à Londres pour chercher les amis qu’il devaitamener au prochain bal. Et bientôt se répandit la nouvelleque Mr. Bingley amènerait avec lui douze dames et septmessieurs. Les jeunes filles gémissaient devant unnombre aussi exagéré de danseuses, mais, la veille du bal,elles eurent la consolation d’apprendre que Mr. Bingleyn’avait ramené de Londres que ses cinq sœurs et uncousin. Finalement, lorsque le contingent de Netherfieldfit son entrée dans la salle du bal, il ne comptait en tout
que cinq personnes : Mr. Bingley, ses deux sœurs, le maride l’aînée et un autre jeune homme.
Mr. Bingley plaisait dès l’abord par un extérieuragréable, une allure distinguée, un air avenant et desmanières pleines d’aisance et de naturel. Ses sœursétaient de belles personnes d’une élégance incontestable,et son beau-frère, Mr. Hurst, avait l’air d’un gentleman,sans plus ; mais la haute taille, la belle physionomie, legrand air de son ami, Mr. Darcy, aidés de la rumeur quicinq minutes après son arrivée, circulait dans tous lesgroupes, qu’il possédait dix mille livres de rente,attirèrent bientôt sur celui-ci l’attention de toute la salle.
Le sexe fort le jugea très bel homme, les damesaffirmèrent qu’il était beaucoup mieux que Mr. Bingley,et, pendant toute une partie de la soirée, on le considéraavec la plus vive admiration.
Peu à peu, cependant, le désappointement causé parson attitude vint modifier cette impression favorable. Ons’aperçut bientôt qu’il était fier, qu’il regardait tout lemonde de haut et ne daignait pas exprimer la moindresatisfaction. Du coup, toute son immense propriété duDerbyshire ne put empêcher qu’on le déclarâtantipathique et tout le contraire de son ami.
Mr. Bingley, lui, avait eu vite fait de se mettre enrapport avec les personnes les plus en vue de l’assemblée.Il se montra ouvert, plein d’entrain, prit part à toutes lesdanses, déplora de voir le bal se terminer de si bonneheure, et parla d’en donner un lui-même à Netherfield.
Des manières si parfaites se recommandent d’elles-mêmes. Quel contraste avec son ami !… Mr. Darcy dansaseulement une fois avec Mrs. Hurst et une fois avec missBingley. Il passa le reste du temps à se promener dans lasalle, n’adressant la parole qu’aux personnes de songroupe et refusant de se laisser présenter aux autres.Aussi fut-il vite jugé. C’était l’homme le plus désagréableet le plus hautain que la terre eût jamais porté, et l’onespérait bien qu’il ne reparaîtrait à aucune autre réunion.
Parmi les personnes empressées à le condamner setrouvait Mrs. Bennet. L’antipathie générale tournait chezelle en rancune personnelle, Mr. Darcy ayant fait affront àl’une de ses filles. Par suite du nombre restreint descavaliers, Elizabeth Bennet avait dû rester sur sa chaisel’espace de deux danses, et, pendant un moment, Mr.Darcy s’était tenu debout assez près d’elle pour qu’ellepût entendre les paroles qu’il échangeait avec Mr. Bingleyvenu pour le presser de se joindre aux danseurs.
– Allons, Darcy, venez danser. Je suis agacé de vousvoir vous promener seul. C’est tout à fait ridicule. Faitescomme tout le monde et dansez.
– Non, merci ! La danse est pour moi sans charmes àmoins que je ne connaisse particulièrement une danseuse.Je n’y prendrais aucun plaisir dans une réunion de cegenre. Vos sœurs ne sont pas libres et ce serait pour moiune pénitence que d’inviter quelqu’un d’autre.
– Vous êtes vraiment difficile ! s’écria Bingley. Jedéclare que je n’ai jamais vu dans une soirée tant de
jeunes filles aimables. Quelques-unes même, vous enconviendrez, sont remarquablement jolies.
– Votre danseuse est la seule jolie personne de laréunion, dit Mr. Darcy en désignant du regard l’aînée desdemoiselles Bennet.
– Oh ! c’est la plus charmante créature que j’aie jamaisrencontrée ; mais il y a une de ses sœurs assise derrièrevous qui est aussi fort agréable. Laissez-moi demander àma danseuse de vous présenter.
– De qui voulez-vous parler ? – Mr. Darcy se retournaet considéra un instant Elizabeth. Rencontrant son regard,il détourna le sien et déclara froidement.
– Elle est passable, mais pas assez jolie pour medécider à l’inviter. Du reste je ne me sens pas en humeur,ce soir, de m’occuper des demoiselles qui font tapisserie.Retournez vite à votre souriante partenaire, vous perdezvotre temps avec moi.
Mr. Bingley suivit ce conseil et Mr. Darcy s’éloigna,laissant Elizabeth animée à son égard de sentiments trèspeu cordiaux. Néanmoins elle raconta l’histoire à sesamies avec beaucoup de verve, car elle avait l’esprit fin etun sens très vif de l’humour.
Malgré tout, ce fut, dans l’ensemble, une agréablesoirée pour tout le monde. Le cœur de Mrs. Bennet étaittout réjoui de voir sa fille aînée distinguée par leshabitants de Netherfield. Mr. Bingley avait dansé deuxfois avec elle et ses sœurs lui avaient fait des avances.Jane était aussi satisfaite que sa mère, mais avec plus de
calme. Elizabeth était contente du plaisir de Jane ; Maryétait fière d’avoir été présentée à miss Bingley comme lajeune fille la plus cultivée du pays, et Catherine et Lydian’avaient pas manqué une seule danse, ce qui, à leur âge,suffisait à combler tous leurs vœux.
Elles revinrent donc toutes de très bonne humeur àLongbourn, le petit village dont les Bennet étaient lesprincipaux habitants. Mr. Bennet était encore debout ;avec un livre il ne sentait jamais le temps passer et, pourune fois, il était assez curieux d’entendre le compte rendud’une soirée qui, à l’avance, avait fait naître tant demagnifiques espérances. Il s’attendait un peu à voir safemme revenir désappointée, mais il s’aperçut vite qu’iln’en était rien.
– Oh ! mon cher Mr. Bennet, s’écria-t-elle en entrantdans la pièce, quelle agréable soirée, quel bal réussi !J’aurais voulu que vous fussiez là… Jane a eu tant desuccès ! tout le monde m’en a fait compliment. Mr.Bingley l’a trouvée tout à fait charmante. Il a dansé deuxfois avec elle ; oui, mon ami, deux fois ! Et elle est la seulequ’il ait invitée une seconde fois. Sa première invitation aété pour miss Lucas, – j’en étais assez vexée, – mais il n’apoint paru l’admirer beaucoup, ce qui n’a rien desurprenant. Puis, en voyant danser Jane, il a eu l’aircharmé, a demandé qui elle était et, s’étant fait présenter,l’a invitée pour les deux danses suivantes. Après quoi il ena dansé deux avec miss King, encore deux autres avecJane, la suivante avec Lizzy, la « boulangère » avec…
– Pour l’amour du ciel, arrêtez cette énumération,
s’écria son mari impatienté. S’il avait eu pitié de moi iln’aurait pas dansé moitié autant. Que ne s’est-il tordu lepied à la première danse !
– Oh ! mon ami, continuait Mrs. Bennet, il m’a tout àfait conquise. Physiquement, il est très bien et ses sœurssont des femmes charmantes. Je n’ai rien vu d’aussiélégant que leurs toilettes. La dentelle sur la robe de Mrs.Hurst…
Ici, nouvelle interruption, Mr. Bennet ne voulantécouter aucune description de chiffons. Sa femme fut doncobligée de changer de sujet et raconta avec beaucoupd’amertume et quelque exagération l’incident où Mr.Darcy avait montré une si choquante grossièreté.
– Mais je vous assure, conclut-elle, qu’on ne perd pasgrand’chose à ne pas être appréciée par ce monsieur !C’est un homme horriblement désagréable qui ne méritepas qu’on cherche à lui plaire. Hautain et dédaigneux, il sepromenait de droite et de gauche dans la salle avec l’air dese croire un personnage extraordinaire. J’aurais aimé quevous fussiez là pour lui dire son fait, comme vous savez lefaire ! Non, en vérité, je ne puis pas le sentir.
IVLorsque Jane et Elizabeth se trouvèrent seules, Jane
qui, jusque-là, avait mis beaucoup de réserve dans seslouanges sur Mr. Bingley, laissa voir à sa sœur lasympathie qu’il lui inspirait.
– Il a toutes les qualités qu’on apprécie chez un jeunehomme, dit-elle. Il est plein de sens, de bonne humeur etd’entrain. Je n’ai jamais vu à d’autres jeunes gens desmanières aussi agréables, tant d’aisance unie à une sibonne éducation.
– Et, de plus, ajouta Elizabeth, il est très joli garçon, cequi ne gâte rien. On peut donc le déclarer parfait.
– J’ai été très flattée qu’il m’invite une seconde fois ; jene m’attendais pas à un tel hommage.
– Moi, je n’en ai pas été surprise. C’était très naturel.Pouvait-il ne pas s’apercevoir que vous étiez infinimentplus jolie que toutes les autres danseuses ?… Il n’y a paslieu de lui en être reconnaissante. Ceci dit, il estcertainement très agréable et je vous autorise à luiaccorder votre sympathie. Vous l’avez donnée à biend’autres qui ne le valaient pas.
– Ma chère Lizzy !
– La vérité c’est que vous êtes portée à juger tout lemonde avec trop de bienveillance : vous ne voyez jamaisde défaut à personne. De ma vie, je ne vous ai entenduecritiquer qui que ce soit.
– Je ne veux juger personne trop précipitamment,mais je dis toujours ce que je pense.
– Je le sais, et c’est ce qui m’étonne. Comment, avecvotre bon sens, pouvez-vous être aussi loyalementaveuglée sur la sottise d’autrui ? Il n’y a que vous quiayez assez de candeur pour ne voir jamais chez les gensque leur bon côté… Alors, les sœurs de ce jeune hommevous plaisent aussi ? Elles sont pourtant beaucoup moinssympathiques que lui.
– Oui, au premier abord, mais quand on cause avecelles on s’aperçoit qu’elles sont fort aimables. Miss Bingleyva venir habiter avec son frère, et je serais fort surprise sinous ne trouvions en elle une agréable voisine.
Elizabeth ne répondit pas, mais elle n’était pasconvaincue. L’attitude des sœurs de Mr. Bingley au bal nelui avait pas révélé chez elles le désir de se rendreagréables à tout le monde. D’un esprit plus observateur etd’une nature moins simple que celle de Jane, n’étant pas,de plus, influencée par les attentions de ces dames,Elizabeth était moins disposée à les juger favorablement.Elle voyait en elles d’élégantes personnes, capables de semettre en frais pour qui leur plaisait, mais, somme toute,fières et affectées.
Mrs. Hurst et miss Bingley étaient assez jolies, elles
avaient été élevées dans un des meilleurs pensionnats deLondres et possédaient une fortune de vingt mille livres,mais l’habitude de dépenser sans compter et defréquenter la haute société les portait à avoir d’elles-mêmes une excellente opinion et à juger leur prochainavec quelque dédain. Elles appartenaient à une très bonnefamille du nord de l’Angleterre, chose dont elles sesouvenaient plus volontiers que de l’origine de leurfortune qui avait été faite dans le commerce.
Mr. Bingley avait hérité d’environ cent mille livres deson père. Celui-ci qui souhaitait acheter un domainen’avait pas vécu assez longtemps pour exécuter sonprojet. Mr. Bingley avait la même intention et ses sœursdésiraient vivement la lui voir réaliser. Bien qu’il n’eût faitque louer Netherfield, miss Bingley était toute prête àdiriger sa maison, et Mrs. Hurst, qui avait épousé unhomme plus fashionable que fortuné, n’était pas moinsdisposée à considérer la demeure de son frère comme lasienne. Il y avait à peine deux ans que Mr. Bingley avaitatteint sa majorité, lorsque, par un effet du hasard, il avaitentendu parler du domaine de Netherfield. Il était allé levisiter, l’avait parcouru en une demi-heure, et, le site et lamaison lui plaisant, s’était décidé à louer sur-le-champ.
En dépit d’une grande opposition de caractères,Bingley et Darcy étaient unis par une solide amitié. Darcyaimait Bingley pour sa nature confiante et docile, deuxdispositions pourtant si éloignées de son propre caractère.Bingley, de son côté, avait la plus grande confiance dansl’amitié de Darcy et la plus haute opinion de son jugement.
Il lui était inférieur par l’intelligence, bien que lui-mêmen’en fût point dépourvu, mais Darcy était hautain, distant,d’une courtoisie froide et décourageante, et, à cet égard,son ami reprenait l’avantage. Partout où il paraissait,Bingley était sûr de plaire ; les manières de Darcyn’inspiraient trop souvent que de l’éloignement.
Il n’y avait qu’à les entendre parler du bal de Merytonpour juger de leurs caractères : Bingley n’avait, de sa vie,rencontré des gens plus aimables, des jeunes filles plusjolies ; tout le monde s’était montré plein d’attentionspour lui ; point de raideur ni de cérémonie ; il s’étaitbientôt senti en pays de connaissance : quant à missBennet, c’était véritablement un ange de beauté !… Mr.Darcy, au contraire, n’avait vu là qu’une collection de genschez qui il n’avait trouvé ni élégance, ni charme ;personne ne lui avait inspiré le moindre intérêt ; personnene lui avait marqué de sympathie ni procuré d’agrément.Il reconnaissait que miss Bennet était jolie, mais ellesouriait trop.
Mrs. Hurst et sa sœur étaient de cet avis ; cependant,Jane leur plaisait ; elles déclarèrent que c’était uneaimable personne avec laquelle on pouvait assurément selier. Et leur frère se sentit autorisé par ce jugement àrêver à miss Bennet tout à sa guise.
VÀ peu de distance de Longbourn vivait une famille
avec laquelle les Bennet étaient particulièrement liés.
Sir William Lucas avait commencé par habiterMeryton où il se faisait une petite fortune dans les affaireslorsqu’il s’était vu élever à la dignité de « Knight »{1} à lasuite d’un discours qu’il avait adressé au roi comme mairede la ville. Cette distinction lui avait un peu tourné la têteen lui donnant le dégoût du commerce et de la vie simplede sa petite ville. Quittant l’un et l’autre, il était venu sefixer avec sa famille dans une propriété située à un millede Meryton qui prit dès lors le nom de « Lucas Lodge ».Là, délivré du joug des affaires, il pouvait à loisir méditersur son importance et s’appliquer à devenir l’homme leplus courtois de l’univers. Son nouveau titre l’enchantait,sans lui donner pour cela le moindre soupçond’arrogance ; il se multipliait, au contraire, en attentionspour tout le monde. Inoffensif, bon et serviable parnature, sa présentation à Saint-James avait fait de lui ungentilhomme.
Lady Lucas était une très bonne personne à qui sesfacultés moyennes permettaient de voisineragréablement avec Mrs. Bennet. Elle avait plusieursenfants et l’aînée, jeune fille de vingt-sept ans, intelligente
enfants et l’aînée, jeune fille de vingt-sept ans, intelligenteet pleine de bon sens, était l’amie particulière d’Elizabeth.
Les demoiselles Lucas et les demoiselles Bennetavaient l’habitude de se réunir, après un bal, pouréchanger leurs impressions. Aussi, dès le lendemain de lasoirée de Meryton on vit arriver les demoiselles Lucas àLongbourn.
– Vous avez bien commencé la soirée, Charlotte, ditMrs. Bennet à miss Lucas avec une amabilité un peuforcée. C’est vous que Mr. Bingley a invitée la première.
– Oui, mais il a paru de beaucoup préférer la danseusequ’il a invitée la seconde.
– Oh ! vous voulez parler de Jane parce qu’il l’a faitdanser deux fois. C’est vrai, il avait l’air de l’admirerassez, et je crois même qu’il faisait plus que d’en avoirl’air… On m’a dit là-dessus quelque chose, – je ne saisplus trop quoi, – où il était question de Mr. Robinson…
– Peut-être voulez-vous dire la conversation entreMr. Bingley et Mr. Robinson que j’ai entendue parhasard ; ne vous l’ai-je pas répétée ? Mr. Robinson luidemandait ce qu’il pensait de nos réunions de Meryton,s’il ne trouvait pas qu’il y avait beaucoup de joliespersonnes parmi les danseuses et laquelle était à son gréla plus jolie. À cette question Mr. Bingley a répondu sanshésiter : « Oh ! l’aînée des demoiselles Bennet ; cela nefait pas de doute. »
– Voyez-vous ! Eh bien ! voilà qui est parler net. Ilsemble en effet que… Cependant, il se peut que tout cela
ne mène à rien…
– J’ai entendu cette conversation bien à propos. Jen’en dirai pas autant pour celle que vous avez surprise,Eliza, dit Charlotte. Les réflexions de Mr. Darcy sontmoins gracieuses que celles de son ami. Pauvre Eliza !s’entendre qualifier tout juste de « passable » !
– Je vous en prie, ne poussez pas Lizzy à se formaliserde cette impertinence. Ce serait un grand malheur deplaire à un homme aussi désagréable. Mrs. Long me disaithier soir qu’il était resté une demi-heure à côté d’elle sansdesserrer les lèvres.
– Ne faites-vous pas erreur, maman ? dit Jane. J’aicertainement vu Mr. Darcy lui parler.
– Eh oui, parce qu’à la fin elle lui a demandé s’il seplaisait à Netherfield et force lui a été de répondre, mais ilparaît qu’il avait l’air très mécontent qu’on prît la libertéde lui adresser la parole.
– Miss Bingley dit qu’il n’est jamais loquace avec lesétrangers, mais que dans l’intimité c’est le plus aimablecauseur.
– Je n’en crois pas un traître mot, mon enfant : s’ilétait si aimable, il aurait causé avec Mrs. Long. Non, jesais ce qu’il en est : Mr. Darcy, – tout le monde enconvient, – est bouffi d’orgueil. Il aura su, je pense, queMrs. Long n’a pas d’équipage et que c’est dans unevoiture de louage qu’elle est venue au bal.
– Cela m’est égal qu’il n’ait pas causé avec Mrs. Long,
dit Charlotte, mais j’aurais trouvé bien qu’il dansât avecEliza.
– Une autre fois, Lizzy, dit la mère, à votre place, jerefuserais de danser avec lui.
– Soyez tranquille, ma mère, je crois pouvoir vouspromettre en toute sûreté que je ne danserai jamais aveclui.
– Cet orgueil, dit miss Lucas, me choque moins chez luiparce que j’y trouve des excuses. On ne peut s’étonnerqu’un jeune homme aussi bien physiquement et pourvude toutes sortes d’avantages tels que le rang et la fortuneait de lui-même une haute opinion. Il a, si je puis dire, unpeu le droit d’avoir de l’orgueil.
– Sans doute, fit Elizabeth, et je lui passerais volontiersson orgueil s’il n’avait pas modifié le mien.
– L’orgueil, observa Mary qui se piquait depsychologie, est, je crois, un sentiment très répandu. Lanature nous y porte et bien peu parmi nous échappent àcette complaisance que l’on nourrit pour soi-même àcause de telles ou telles qualités souvent imaginaires. Lavanité et l’orgueil sont choses différentes, bien qu’onemploie souvent ces deux mots l’un pour l’autre ; on peutêtre orgueilleux sans être vaniteux. L’orgueil se rapporteplus à l’opinion que nous avons de nous-mêmes, la vanitéà celle que nous voudrions que les autres aient de nous.
– Si j’étais aussi riche que Mr. Darcy, s’écria un jeuneLucas qui avait accompagné ses sœurs, je me moqueraisbien de tout cela ! Je commencerais par avoir une meute
VILes dames de Longbourn ne tardèrent pas à faire
visite aux dames de Netherfield et celles-ci leur rendirentleur politesse suivant toutes les formes. Le charme deJane accrut les dispositions bienveillantes de Mrs. Hurstet de miss Bingley à son égard, et tout en jugeant la mèreridicule et les plus jeunes sœurs insignifiantes, ellesexprimèrent aux deux aînées le désir de faire avec ellesplus ample connaissance.
Jane reçut cette marque de sympathie avec un plaisirextrême, mais Elizabeth trouva qu’il y avait toujours biende la hauteur dans les manières de ces dames, même àl’égard de sa sœur. Décidément, elle ne les aimait point ;cependant, elle appréciait leurs avances, voulant y voirl’effet de l’admiration que leur frère éprouvait pour Jane.Cette admiration devenait plus évidente à chacune deleurs rencontres et pour Elizabeth il semblait égalementcertain que Jane cédait de plus en plus à la sympathiequ’elle avait ressentie dès le commencement pour Mr.Bingley. Bien heureusement, pensait Elizabeth, personnene devait s’en apercevoir. Car, à beaucoup de sensibilitéJane unissait une égalité d’humeur et une maîtrise d’elle-même qui la préservait des curiosités indiscrètes.
Elizabeth fit part de ces réflexions à miss Lucas.
– Il peut être agréable en pareil cas de tromper desindifférents, répondit Charlotte ; mais une telle réserve nepeut-elle parfois devenir un désavantage ? Si une jeunefille cache avec tant de soin sa préférence à celui qui enest l’objet, elle risque de perdre l’occasion de le fixer, et sedire ensuite que le monde n’y a rien vu est une bien minceconsolation. La gratitude et la vanité jouent un tel rôledans le développement d’une inclination qu’il n’est pasprudent de l’abandonner à elle-même. Votre sœur plaît àBingley sans aucun doute, mais tout peut en rester là, sielle ne l’encourage pas.
– Votre conseil serait excellent, si le désir de faire unbeau mariage était seul en question ; mais ce n’est pas lecas de Jane. Elle n’agit point par calcul ; elle n’est mêmepas encore sûre de la profondeur du sentiment qu’elleéprouve, et elle se demande sans doute si ce sentimentest raisonnable. Voilà seulement quinze jours qu’elle a faitla connaissance de Mr. Bingley : elle a bien dansé quatrefois avec lui à Meryton, l’a vu en visite à Netherfield unmatin, et s’est trouvée à plusieurs dîners où lui-mêmeétait invité ; mais ce n’est pas assez pour le bienconnaître.
– Allons, dit Charlotte, je fais de tout cœur des vœuxpour le bonheur de Jane ; mais je crois qu’elle aurait toutautant de chances d’être heureuse, si elle épousait Mr.Bingley demain que si elle se met à étudier son caractèrependant une année entière ; car le bonheur en ménage estpure affaire de hasard. La félicité de deux époux nem’apparaît pas devoir être plus grande du fait qu’ils se
connaissaient à fond avant leur mariage ; cela n’empêchepas les divergences de naître ensuite et de provoquer lesinévitables déceptions. Mieux vaut, à mon avis, ignorer leplus possible les défauts de celui qui partagera votreexistence !
– Vous m’amusez, Charlotte ; mais ce n’est passérieux, n’est-ce pas ? Non, et vous-même n’agiriez pasainsi.
Tandis qu’elle observait ainsi Mr. Bingley, Elizabethétait bien loin de soupçonner qu’elle commençait elle-même à attirer l’attention de son ami. Mr. Darcy avaitrefusé tout d’abord de la trouver jolie. Il l’avait regardéeavec indifférence au bal de Meryton et ne s’était occupéd’elle ensuite que pour la critiquer. Mais à peine avait-ilconvaincu son entourage du manque de beauté de la jeunefille qu’il s’aperçut que ses grands yeux sombresdonnaient à sa physionomie une expressionsingulièrement intelligente. D’autres découvertessuivirent, aussi mortifiantes : il dut reconnaître àElizabeth une silhouette fine et gracieuse et, lui qui avaitdéclaré que ses manières n’étaient pas celles de la hautesociété, il se sentit séduit par leur charme tout spécial faitde naturel et de gaieté.
De tout ceci Elizabeth était loin de se douter. Pour elle,Mr. Darcy était seulement quelqu’un qui ne cherchaitjamais à se rendre agréable et qui ne l’avait pas jugéeassez jolie pour la faire danser.
Mr. Darcy éprouva bientôt le désir de la mieux
connaître, mais avant de se décider à entrer enconversation avec elle, il commença par l’écouterlorsqu’elle causait avec ses amies. Ce fut chez sir WilliamLucas où une nombreuse société se trouvait réunie quecette manœuvre éveilla pour la première fois l’attentiond’Elizabeth.
– Je voudrais bien savoir, dit-elle à Charlotte,pourquoi Mr. Darcy prenait tout à l’heure un si vif intérêtà ce que je disais au colonel Forster.
– Lui seul pourrait vous le dire.
– S’il recommence, je lui montrerai que je m’enaperçois. Je n’aime pas son air ironique. Si je ne lui serspas bientôt une impertinence de ma façon, vous verrezqu’il finira par m’intimider !
Et comme, peu après, Mr. Darcy s’approchait des deuxjeunes filles sans manifester l’intention de leur adresser laparole, miss Lucas mit son amie au défi d’exécuter samenace. Ainsi provoquée, Elizabeth se tourna vers lenouveau venu et dit :
– N’êtes-vous pas d’avis, Mr. Darcy, que jem’exprimais tout à l’heure avec beaucoup d’éloquencelorsque je tourmentais le colonel Forster pour qu’il donneun bal à Meryton ?
– Avec une grande éloquence. Mais, c’est là un sujetqui en donne toujours aux jeunes filles.
– Vous êtes sévère pour nous.
– Et maintenant, je vais la tourmenter à son tour,
intervint miss Lucas. Eliza, j’ouvre le piano et vous savezce que cela veut dire…
– Quelle singulière amie vous êtes de vouloir me fairejouer et chanter en public ! Je vous en seraisreconnaissante si j’avais des prétentions d’artiste, mais,pour l’instant, je préférerais me taire devant un auditoirehabitué à entendre les plus célèbres virtuoses.
Puis, comme miss Lucas insistait, elle ajouta :
– C’est bien ; puisqu’il le faut, je m’exécute.
Le talent d’Elizabeth était agréable sans plus. Quandelle eut chanté un ou deux morceaux, avant même qu’elleeût pu répondre aux instances de ceux qui lui endemandaient un autre, sa sœur Mary, toujours impatientede se produire, la remplaça au piano.
Mary, la seule des demoiselles Bennet qui ne fût pasjolie, se donnait beaucoup de peine pour perfectionner sonéducation. Malheureusement, la vanité qui animait sonardeur au travail lui donnait en même temps un airpédant et satisfait qui aurait gâté un talent plus grand quele sien. Elizabeth jouait beaucoup moins bien que Mary,mais, simple et naturelle, on l’avait écoutée avec plus deplaisir que sa sœur. À la fin d’un interminable concerto,Mary fut heureuse d’obtenir quelques bravos en jouantdes airs écossais réclamés par ses plus jeunes sœurs quise mirent à danser à l’autre bout du salon avec deux outrois officiers et quelques membres de la famille Lucas.
Non loin de là, Mr. Darcy regardait les danseurs avecdésapprobation, ne comprenant pas qu’on pût ainsi passer
toute une soirée sans réserver un moment pour laconversation ; il fut soudain tiré de ses réflexions par lavoix de sir William Lucas :
– Quel joli divertissement pour la jeunesse que ladanse, Mr. Darcy ! À mon avis, c’est le plaisir le plusraffiné des sociétés civilisées.
– Certainement, monsieur, et il a l’avantage d’êtreégalement en faveur parmi les sociétés les moinscivilisées : tous les sauvages dansent.
Sir William se contenta de sourire.
– Votre ami danse dans la perfection, continua-t-il aubout d’un instant en voyant Bingley se joindre au groupedes danseurs. Je ne doute pas que vous-même, Mr.Darcy, vous n’excelliez dans cet art. Dansez-vous souventà la cour ?
– Jamais, monsieur.
– Ce noble lieu mériterait pourtant cet hommage devotre part.
– C’est un hommage que je me dispense toujours derendre lorsque je puis m’en dispenser.
– Vous avez un hôtel à Londres, m’a-t-on dit ?
Mr. Darcy s’inclina, mais ne répondit rien.
– J’ai eu jadis des velléités de m’y fixer moi-même carj’aurais aimé vivre dans un monde cultivé, mais j’ai craintque l’air de la ville ne fût contraire à la santé de ladyLucas.
Ces confidences restèrent encore sans réponse. Voyantalors Elizabeth qui venait de leur côté, sir William eut uneidée qui lui sembla des plus galantes.
– Comment ! ma chère miss Eliza, vous ne dansezpas ? s’exclama-t-il. Mr. Darcy, laissez-moi vousprésenter cette jeune fille comme une danseuseremarquable. Devant tant de beauté et de charme, je suiscertain que vous ne vous déroberez pas.
Et, saisissant la main d’Elizabeth, il allait la placer danscelle de Mr. Darcy qui, tout étonné, l’aurait cependantprise volontiers, lorsque la jeune fille la retirabrusquement en disant d’un ton vif :
– En vérité, monsieur, je n’ai pas la moindre envie dedanser et je vous prie de croire que je ne venais point dece côté quêter un cavalier.
Avec courtoisie Mr. Darcy insista pour qu’elleconsentît à lui donner la main, mais ce fut en vain. Ladécision d’Elizabeth était irrévocable et sir William lui-même ne put l’en faire revenir.
– Vous dansez si bien, miss Eliza, qu’il est cruel de mepriver du plaisir de vous regarder, et Mr. Darcy, bien qu’ilapprécie peu ce passe-temps, était certainement tout prêtà me donner cette satisfaction pendant une demi-heure.
Elizabeth sourit d’un air moqueur et s’éloigna. Sonrefus ne lui avait point fait tort auprès de Mr. Darcy, et ilpensait à elle avec une certaine complaisance lorsqu’il sevit interpeller par miss Bingley.
– Je devine le sujet de vos méditations, dit-elle.
– En êtes-vous sûre ?
– Vous songez certainement qu’il vous serait biendésagréable de passer beaucoup de soirées dans le genrede celle-ci. C’est aussi mon avis. Dieu ! que ces gens sontinsignifiants, vulgaires et prétentieux ! Je donneraisbeaucoup pour vous entendre dire ce que vous pensezd’eux.
– Vous vous trompez tout à fait ; mes réflexionsétaient d’une nature beaucoup plus agréable : je songeaisseulement au grand plaisir que peuvent donner deuxbeaux yeux dans le visage d’une jolie femme.
Miss Bingley le regarda fixement en lui demandantquelle personne pouvait lui inspirer ce genre de réflexion.
– Miss Elizabeth Bennet, répondit Mr. Darcy sanssourciller.
– Miss Elizabeth Bennet ! répéta miss Bingley. Je n’enreviens pas. Depuis combien de temps occupe-t-elle ainsivos pensées, et quand faudra-t-il que je vous présentemes vœux de bonheur ?
– Voilà bien la question que j’attendais. L’imaginationdes femmes court vite et saute en un clin d’œil del’admiration à l’amour et de l’amour au mariage. J’étaissûr que vous alliez m’offrir vos félicitations.
– Oh ! si vous le prenez ainsi, je considère la chosecomme faite. Vous aurez en vérité une délicieuse belle-mère et qui vous tiendra sans doute souvent compagnie à
Pemberley.
Mr. Darcy écouta ces plaisanteries avec la plus parfaiteindifférence et, rassurée par son air impassible, missBingley donna libre cours à sa verve moqueuse.
VIILa fortune de Mr. Bennet consistait presque tout
entière en un domaine d’un revenu de 2 000 livres maisqui, malheureusement pour ses filles, devait, à défautd’héritier mâle, revenir à un cousin éloigné. L’avoir deleur mère, bien qu’appréciable, ne pouvait compenser unetelle perte. Mrs. Bennet, qui était la fille d’un avoué deMeryton, avait hérité de son père 4 000 livres ; elle avaitune sœur mariée à un Mr. Philips, ancien clerc etsuccesseur de son père, et un frère honorablement établià Londres dans le commerce.
Le village de Longbourn n’était qu’à un mille deMeryton, distance commode pour les jeunes filles qui,trois ou quatre fois par semaine, éprouvaient l’envied’aller présenter leurs devoirs à leur tante ainsi qu’à lamodiste qui lui faisait face de l’autre côté de la rue. Lesdeux benjamines, d’esprit plus frivole que leurs aînées,mettaient à rendre ces visites un empressementparticulier. Quand il n’y avait rien de mieux à faire, unepromenade à Meryton occupait leur matinée etfournissait un sujet de conversation pour la soirée. Si peufertile que fût le pays en événements extraordinaires,elles arrivaient toujours à glaner quelques nouvelles chezleur tante.
Actuellement elles étaient comblées de joie par larécente arrivée dans le voisinage d’un régiment de lamilice. Il devait y cantonner tout l’hiver et Meryton étaitle quartier général. Les visites à Mrs. Philips étaientmaintenant fécondes en informations du plus haut intérêt,chaque jour ajoutait quelque chose à ce que l’on savait surles officiers, leurs noms, leurs familles, et bientôt l’on fitconnaissance avec les officiers eux-mêmes. Mr. Philipsleur fit visite à tous, ouvrant ainsi à ses nièces une sourcede félicité inconnue jusqu’alors. Du coup, elles neparlèrent plus que des officiers, et la grande fortune deMr. Bingley dont l’idée seule faisait vibrer l’imagination deleur mère n’était rien pour elles, comparée à l’uniformerouge d’un sous-lieutenant.
Un matin, après avoir écouté leur conversation sur cetinépuisable sujet, Mr. Bennet observa froidement :
– Tout ce que vous me dites me fait penser que vousêtes deux des filles les plus sottes de la région. Je m’endoutais depuis quelque temps, mais aujourd’hui, j’en suisconvaincu.
Catherine déconcertée ne souffla mot, mais Lydia,avec une parfaite indifférence, continua d’exprimer sonadmiration pour le capitaine Carter et l’espoir de le voir lejour même car il partait le lendemain pour Londres.
– Je suis surprise, mon ami, intervint Mrs. Bennet, devous entendre déprécier vos filles aussi facilement. Sij’étais en humeur de critique, ce n’est pas à mes propresenfants que je m’attaquerais.
– Si mes filles sont sottes, j’espère bien être capable dem’en rendre compte.
– Oui, mais il se trouve au contraire qu’elles sonttoutes fort intelligentes.
– Voilà le seul point, – et je m’en flatte, – sur lequelnous sommes en désaccord. Je voulais croire que vossentiments et les miens coïncidaient en toute chose maisje dois reconnaître qu’ils diffèrent en ce qui concerne nosdeux plus jeunes filles que je trouve remarquablementniaises.
– Mon cher Mr. Bennet, vous ne pouvez vous attendreà trouver chez ces enfants le jugement de leur père et deleur mère. Lorsqu’elles auront notre âge, j’ose direqu’elles ne penseront pas plus aux militaires que nous n’ypensons nous-mêmes. Je me rappelle le temps où j’avaisaussi l’amour de l’uniforme ; – à dire vrai je le gardetoujours au fond du cœur et si un jeune et élégant colonelpourvu de cinq ou six mille livres de rentes désirait lamain d’une de mes filles, ce n’est pas moi qui ledécouragerais. L’autre soir, chez sir William, j’ai trouvéque le colonel Forster avait vraiment belle mine enuniforme.
– Maman, s’écria Lydia, ma tante dit que le colonelForster et le capitaine Carter ne vont plus aussi souventchez miss Watson et qu’elle les voit maintenant faire defréquentes visites à la librairie Clarke.
La conversation fut interrompue par l’entrée du valetde chambre qui apportait une lettre adressée à Jane. Elle
venait de Netherfield et un domestique attendait laréponse.
Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent de plaisir et,pendant que sa fille lisait, elle la pressait de questions :
– Eh bien ! Jane, de qui est-ce ? De quoi s’agit-il ?Voyons, répondez vite, ma chérie.
– C’est de miss Bingley, répondit Jane, et elle lut touthaut : « Chère amie, si vous n’avez pas la charité de venirdîner aujourd’hui avec Louisa et moi, nous courrons lerisque de nous brouiller pour le reste de nos jours, car untête-à-tête de toute une journée entre deux femmes nepeut se terminer sans querelle. Venez aussitôt ce motreçu. Mon frère et ses amis doivent dîner avec lesofficiers. Bien à vous. – Caroline BINGLEY. »
– Avec les officiers ! s’exclama Lydia. Je m’étonne quema tante ne nous en ait rien dit.
– Ils dînent en ville, dit Mrs. Bennet. Pas de chance.
– Puis-je avoir la voiture ? demanda Jane.
– Non, mon enfant, vous ferez mieux d’y aller à chevalcar le temps est à la pluie ; vous ne pourrezvraisemblablement pas revenir ce soir.
– Ce serait fort bien, dit Elizabeth, si vous étiez sûreque les Bingley n’offriront pas de la faire reconduire.
– Oh ! pour aller à Meryton, ces messieurs ont dûprendre le cabriolet de Mr. Bingley et les Hurst n’ont pasd’équipage.
– J’aimerais mieux y aller en voiture.
– Ma chère enfant, votre père ne peut donner leschevaux ; on en a besoin à la ferme, n’est-ce pas, masterBennet ?
– On en a besoin à la ferme plus souvent que je ne puisles donner.
– Alors, si vous les donnez aujourd’hui, dit Elizabeth,vous servirez les projets de ma mère.
Mr. Bennet, finalement reconnut que les chevauxétaient occupés. Jane fut donc obligée de partir à cheval etsa mère la conduisit jusqu’à la porte en formulant toutessortes de joyeux pronostics sur le mauvais temps.
Son espérance se réalisa : Jane était à peine partie quela pluie se mit à tomber avec violence. Ses sœurs n’étaientpas sans inquiétude à son sujet, mais sa mère étaitenchantée. La pluie continua toute la soirée sans arrêt :certainement, Jane ne pourrait pas revenir.
– J’ai eu là vraiment une excellente idée, dit Mrs.Bennet à plusieurs reprises, comme si c’était elle-mêmequi commandait à la pluie.
Ce ne fut cependant que le lendemain matin qu’elleapprit tout le succès de sa combinaison. Le breakfasts’achevait lorsqu’un domestique de Netherfield arrivaporteur d’une lettre pour Elizabeth :
« Ma chère Lizzy, je me sens très souffrante ce matin,du fait, je suppose, d’avoir été trempée jusqu’aux os hier.Mes aimables amies ne veulent pas entendre parler de
mon retour à la maison avant que je sois mieux. Ellesinsistent pour que je voie Mr. Jones. Aussi ne vousalarmez pas si vous entendiez dire qu’il est venu pour moià Netherfield. Je n’ai rien de sérieux, simplement un malde gorge accompagné de migraine. Tout à vous… etc.… »
– Eh bien, ma chère amie, dit Mr. Bennet quandElizabeth eut achevé de lire la lettre à haute voix, sil’indisposition de votre fille s’aggravait et se terminaitmal, vous auriez la consolation de penser qu’elle l’acontractée en courant après Mr. Bingley pour vous obéir.
– Oh ! je suis sans crainte. On ne meurt pas d’unsimple rhume. Elle est certainement bien soignée. Tantqu’elle reste là-bas on peut être tranquille. J’irais la voir sila voiture était libre.
Mais Elizabeth, vraiment anxieuse, décida de serendre elle-même à Netherfield. Comme la voiture n’étaitpas disponible et que la jeune fille ne montait pas à cheval,elle n’avait d’autre alternative que d’y aller à pied.
– Avec une boue pareille ? À quoi pensez-vous ! s’écriasa mère lorsqu’elle annonça son intention. Vous ne serezpas présentable en arrivant.
– Je le serai suffisamment pour voir Jane et c’est toutce que je veux.
– Donnez-vous à entendre, dit le père, que je devraisenvoyer chercher les chevaux ?
– Nullement ; je ne crains pas la marche. La distancen’est rien quand on a un motif pressant et il n’y a que
trois milles ; je serai de retour avant le dîner.
– J’admire l’ardeur de votre dévouement fraternel,déclara Mary. Mais toute impulsion du sentiment devraitêtre réglée par la raison, et l’effort, à mon avis, doittoujours être proportionné au but qu’on se propose.
– Nous vous accompagnons jusqu’à Meryton, direntCatherine et Lydia.
Elizabeth accepta leur compagnie et les trois jeunesfilles partirent ensemble.
– Si nous nous dépêchons, dit Lydia en cours de route,peut-être apercevrons-nous le capitaine Carter avant sondépart.
À Meryton elles se séparèrent. Les deux plus jeunes serendirent chez la femme d’un officier tandis qu’Elizabethpoursuivait seule son chemin. On eût pu la voir, dans sonimpatience d’arriver, aller à travers champs, franchir leséchaliers, sauter les flaques d’eau, pour se trouver enfindevant la maison, les jambes lasses, les bas crottés, et lesjoues enflammées par l’exercice.
Elle fut introduite dans la salle à manger où tout lemonde était réuni sauf Jane. Son apparition causa unevive surprise. Que seule, à cette heure matinale, elle eûtfait trois milles dans une boue pareille, Mrs. Hurst et missBingley n’en revenaient pas et, dans leur étonnement,Elizabeth sentit nettement de la désapprobation. Elles luifirent toutefois un accueil très poli. Dans les manières deleur frère il y avait mieux que de la politesse, il y avait dela cordialité ; Mr. Darcy dit peu de chose et Mr. Hurst rien
du tout. Le premier, tout en admirant le teint d’Elizabethavivé par la marche, se demandait s’il y avait réellementmotif à ce qu’elle eût fait seule une si longue course ; lesecond ne pensait qu’à achever son déjeuner.
Les questions d’Elizabeth au sujet de sa sœur reçurentune réponse peu satisfaisante. Miss Bennet avait maldormi ; elle s’était levée cependant, mais se sentaitfiévreuse et n’avait pas quitté sa chambre. Elizabeth se fitconduire immédiatement auprès d’elle et Jane qui, parcrainte d’alarmer les siens, n’avait pas osé réclamer unevisite, fut ravie de la voir entrer. Son état ne luipermettait pas de parler beaucoup et, quand miss Bingleyles eut laissées ensemble, elle se borna à exprimer sareconnaissance pour l’extrême bonté qu’on lui témoignait.
Leur déjeuner terminé, les deux sœurs vinrent lesrejoindre et Elizabeth elle-même se sentit touchée envoyant l’affection et la sollicitude dont elles entouraientJane. Le médecin, arrivant à ce moment, examina lamalade et déclara comme on s’y attendait qu’elle avaitpris un gros rhume qui demandait à être soignésérieusement. Il lui conseilla de se remettre au lit etpromit de lui envoyer quelques potions. Jane obéitdocilement car les symptômes de fièvre augmentaientainsi que les douleurs de tête.
Elizabeth ne quitta pas un instant la chambre de sasœur et Mrs. Hurst et miss Bingley ne s’en éloignèrentpas beaucoup non plus. Les messieurs étant sortis ellesn’avaient rien de plus intéressant à faire.
Quand l’horloge sonna trois heures, Elizabeth, bien àcontre-cœur, annonça son intention de repartir. MissBingley lui offrit de la faire reconduire en voiture, maisJane témoigna une telle contrariété à la pensée de voir sasœur la quitter que miss Bingley se vit obligée detransformer l’offre du cabriolet en une invitation àdemeurer à Netherfield qu’Elizabeth accepta avecbeaucoup de reconnaissance. Un domestique fut doncenvoyé à Longbourn pour mettre leur famille au courantet rapporter le supplément de linge et de vêtements dontelles avaient besoin.
VIIIÀ cinq heures, Mrs. Hurst et miss Bingley allèrent
s’habiller, et à six heures et demie, on annonçait àElizabeth que le dîner était servi. Quand elle entra dans lasalle à manger, elle fut assaillie de questions parmilesquelles elle eut le plaisir de noter la sollicitude toutespéciale exprimée par Mr. Bingley. Comme elle répondaitque l’état de Jane ne s’améliorait pas, les deux sœursrépétèrent trois ou quatre fois qu’elles en étaientdésolées, qu’un mauvais rhume est une chose biendésagréable et qu’elles-mêmes avaient horreur d’êtremalades ; après quoi elles s’occupèrent d’autre chose,laissant à penser que Jane, hors de leur présence, necomptait plus beaucoup pour elles et cette indifférenceréveilla aussitôt l’antipathie d’Elizabeth.
Leur frère était vraiment la seule personne de lamaison qu’elle jugeât avec faveur. Son anxiété au sujet del’état de Jane était manifeste, et ses attentions pourElizabeth des plus aimables. Grâce à lui elle avait moinsl’impression d’être une intruse dans leur cercle familial.Parmi les autres, personne ne s’occupait beaucoup d’elle :miss Bingley n’avait d’yeux que pour Mr. Darcy, sa sœurégalement ; Mr. Hurst, qui se trouvait à côté d’Elizabeth,était un homme indolent qui ne vivait que pour manger,
boire, et jouer aux cartes, et lorsqu’il eut découvert que savoisine préférait les plats simples aux mets compliqués, ilne trouva plus rien à lui dire.
Le dîner terminé, elle remonta directement auprès deJane. Elle avait à peine quitté sa place que miss Bingley semettait à faire son procès : ses manières, mélange deprésomption et d’impertinence, furent déclarées trèsdéplaisantes ; elle était dépourvue de conversation etn’avait ni élégance, ni goût, ni beauté. Mrs. Hurst pensaitde même et ajouta :
– Il faut lui reconnaître une qualité, celle d’être uneexcellente marcheuse. Je n’oublierai jamais son arrivée,ce matin ; son aspect était inénarrable !
– En effet, Louisa, j’avais peine à garder mon sérieux.Est-ce assez ridicule de courir la campagne pour une sœurenrhumée ! Et ses cheveux tout ébouriffés !
– Et son jupon ! Avez-vous vu son jupon ? Il avait bienun demi-pied de boue que sa robe n’arrivait pas à cacher.
– Votre description peut être très exacte, Louisa, ditBingley, mais rien de tout cela ne m’a frappé. MissElizabeth Bennet m’a paru tout à fait à son avantagequand elle est arrivée ce matin, et je n’ai pas remarquéson jupon boueux.
– Vous, Mr. Darcy, vous l’avez remarqué, j’en suissûre, dit miss Bingley, et j’incline à penser que vousn’aimeriez pas voir votre sœur s’exhiber dans une telletenue.
– Évidemment non.
– Faire ainsi je ne sais combien de milles dans la boue,toute seule ! À mon avis, cela dénote un abominable espritd’indépendance et un mépris des convenances des pluscampagnards.
– À mes yeux, c’est une preuve très touchante detendresse fraternelle, dit Bingley.
– Je crains bien, Mr. Darcy, observaconfidentiellement miss Bingley, que cet incident ne fassetort à votre admiration pour les beaux yeux de missElizabeth.
– En aucune façon, répliqua Darcy : la marche les avaitrendus encore plus brillants.
Un court silence suivit ces paroles après lequel Mrs.Hurst reprit :
– J’ai beaucoup de sympathie pour Jane Bennet quiest vraiment charmante et je souhaite de tout cœur luivoir faire un joli mariage, mais avec une famille comme lasienne, je crains bien qu’elle n’ait point cette chance.
– Il me semble vous avoir entendu dire qu’elle avaitun oncle avoué à Meryton ?
– Oui, et un autre à Londres qui habite quelque partdu côté de Cheapside.
– Quartier des plus élégants, ajouta sa sœur, et toutesdeux se mirent à rire aux éclats.
– Et quand elles auraient des oncles à en remplir
Cheapside, s’écria Bingley, ce n’est pas cela qui lesrendrait moins aimables.
– Oui, mais cela diminuerait singulièrement leurschances de se marier dans la bonne société, répliquaDarcy.
Bingley ne dit rien, mais ses sœurs approuvèrentchaleureusement, et pendant quelque temps encoredonnèrent libre cours à leur gaieté aux dépens de laparenté vulgaire de leur excellente amie.
Cependant, reprises par un accès de sollicitude, ellesmontèrent à sa chambre en quittant la salle à manger etrestèrent auprès d’elle jusqu’à ce qu’on les appelât pour lecafé. Jane souffrait toujours beaucoup et sa sœur nevoulait pas la quitter ; cependant, tard dans la soirée,ayant eu le soulagement de la voir s’endormir, elle se ditqu’il serait plus correct, sinon plus agréable, de descendreun moment.
En entrant dans le salon, elle trouva toute la société entrain de jouer à la mouche et fut immédiatement priée dese joindre à la partie. Comme elle soupçonnait qu’on jouaitgros jeu, elle déclina l’invitation et, donnant commeexcuse son rôle de garde-malade, dit qu’elle prendraitvolontiers un livre pendant les quelques instants où ellepouvait rester en bas. Mr. Hurst la regarda, stupéfait.
– Préféreriez-vous la lecture aux cartes ? demanda-t-il. Quel goût singulier !
– Miss Elizabeth Bennet dédaigne les cartes, réponditmiss Bingley, et la lecture est son unique passion.
– Je ne mérite ni cette louange, ni ce reproche,répliqua Elizabeth. Je ne suis point aussi fervente delecture que vous l’affirmez, et je prends plaisir à beaucoupd’autres choses.
– Vous prenez plaisir, j’en suis sûr, à soigner votresœur, intervint Bingley, et j’espère que ce plaisir serabientôt redoublé par sa guérison.
Elizabeth remercia cordialement, puis se dirigea versune table où elle voyait quelques livres. Bingley aussitôtlui offrit d’aller en chercher d’autres.
– Pour votre agrément, comme pour ma réputation, jesouhaiterais avoir une bibliothèque mieux garnie, maisvoilà, je suis très paresseux, et, bien que je possède peude livres, je ne les ai même pas tous lus.
– Je suis surprise, dit miss Bingley, que mon père aitlaissé si peu de livres. Mais vous, Mr. Darcy, quellemerveilleuse bibliothèque vous avez à Pemberley !
– Rien d’étonnant à cela, répondit-il, car elle estl’œuvre de plusieurs générations.
– Et vous-même travaillez encore à l’enrichir. Vousêtes toujours en train d’acheter des livres.
– Je ne comprends pas qu’on puisse négliger unebibliothèque de famille !
– Je suis sûre que vous ne négligez rien de ce qui peutajouter à la splendeur de votre belle propriété. Charles,lorsque vous vous ferez bâtir une résidence, je vous
conseille sérieusement d’acheter le terrain aux environsde Pemberley et de prendre le manoir de Mr. Darcycomme modèle. Il n’y a pas en Angleterre de plus beaucomté que le Derbyshire.
– Certainement. J’achèterai même Pemberley siDarcy veut me le vendre.
– Charles, je parle de choses réalisables.
– Ma parole, Caroline, je crois qu’il serait plus faciled’acheter Pemberley que de le copier.
Elizabeth intéressée par la conversation se laissadistraire de sa lecture. Elle posa bientôt son livre et,s’approchant de la table, prit place entre Mr. Bingley et sasœur aînée pour suivre la partie.
– Miss Darcy a-t-elle beaucoup changé depuis ceprintemps ? dit miss Bingley. Promet-elle d’être aussigrande que moi ?
– Je crois que oui ; elle est maintenant à peu près de lataille de miss Elizabeth, ou même plus grande.
– Comme je serais heureuse de la revoir ! Je n’aijamais rencontré personne qui me fût plus sympathique.Elle a des manières si gracieuses, elle est si accompliepour son âge ! Son talent de pianiste est vraimentremarquable.
– Je voudrais savoir, dit Bingley, comment font lesjeunes filles pour acquérir tant de talents. Toutes saventpeindre de petites tables, broder des éventails, tricoterdes bourses ; je n’en connais pas une qui ne sache faire
tout cela ; jamais je n’ai entendu parler d’une jeune fillesans être aussitôt informé qu’elle était « parfaitementaccomplie ».
– Ce n’est que trop vrai, dit Darcy. On qualifie ainsinombre de femmes qui ne savent en effet que broder unécran ou tricoter une bourse, mais je ne puis souscrire àvotre jugement général sur les femmes. Pour ma part jen’en connais pas dans mes relations plus d’une demi-douzaine qui méritent réellement cet éloge.
– Alors, observa Elizabeth, c’est que vous faites entrerbeaucoup de choses dans l’idée que vous vous formezd’une femme accomplie.
– Beaucoup en effet.
– Oh ! sans doute, s’écria miss Bingley, sa fidèle alliée,pour qu’une femme soit accomplie, il faut qu’elle ait uneconnaissance approfondie de la musique, du chant, de ladanse et des langues étrangères. Mais il faut encorequ’elle ait dans l’air, la démarche, le son de la voix, lamanière de s’exprimer, un certain quelque chose faute dequoi ce qualificatif ne serait qu’à demi mérité.
– Et à tout ceci, ajouta Mr. Darcy, elle doit ajouter unavantage plus essentiel en cultivant son intelligence parde nombreuses lectures.
– S’il en est ainsi, je ne suis pas surprise que vous neconnaissiez pas plus d’une demi-douzaine de femmesaccomplies. Je m’étonne plutôt que vous en connaissiezautant.
– Êtes-vous donc si sévère pour votre propre sexe ?
– Non, mais je n’ai jamais vu réunis tant de capacités,tant de goût, d’application et d’élégance.
Mrs. Hurst et miss Bingley protestèrent en chœurcontre l’injustice d’Elizabeth, affirmant qu’ellesconnaissaient beaucoup de femmes répondant à ceportrait, lorsque Mr. Hurst les rappela à l’ordre en seplaignant amèrement de ce que personne ne prêtaitattention au jeu. La conversation se trouvant suspendue,Elizabeth quitta peu après le salon.
– Elizabeth Bennet, dit miss Bingley dès que la portefut refermée, est de ces jeunes filles qui cherchent à sefaire valoir auprès de l’autre sexe en dénigrant le leur, etje crois que beaucoup d’hommes s’y laissent prendre ;mais c’est à mon avis un artifice bien méprisable.
– Sans aucun doute, répliqua Darcy à qui ces paroless’adressaient spécialement, il y a quelque chose deméprisable dans tous les artifices que les femmess’abaissent à mettre en œuvre pour nous séduire.
Miss Bingley fut trop peu satisfaite par cette réponsepour insister davantage sur ce sujet.
Lorsque Elizabeth reparut, ce fut seulement pour direque sa sœur était moins bien et qu’il lui était impossiblede la quitter. Bingley insistait pour qu’on allât chercherimmédiatement Mr. Jones, tandis que ses sœurs,dédaignant ce praticien rustique, jugeaient qu’il vaudraitmieux envoyer un exprès à Londres pour ramener un desmeilleurs médecins. Elizabeth écarta formellement cette
meilleurs médecins. Elizabeth écarta formellement cetteidée, mais elle accepta le conseil de Mr. Bingley et il futconvenu qu’on irait dès le matin chercher Mr. Jones si lanuit n’apportait aucune amélioration à l’état de missBennet. Bingley avait l’air très inquiet et ses sœurs sedéclaraient navrées, ce, qui ne les empêcha pas dechanter des duos après le souper tandis que leur frèrecalmait son anxiété en faisant à la femme de charge millerecommandations pour le bien-être de la malade et de sasœur.
IXElizabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès
de Jane ; mais le matin elle eut le plaisir de donner demeilleures nouvelles à la domestique venue de bonneheure de la part de Mr. Bingley, puis, un peu plus tard,aux deux élégantes caméristes attachées au service de sessœurs. En dépit de cette amélioration elle demanda qu’onfît porter à Longbourn un billet où elle priait sa mère devenir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billetfut aussitôt porté et la réponse arriva peu après ledéjeuner sous la forme de Mrs. Bennet escortée de sesdeux plus jeunes filles.
Mrs. Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, auraitété certainement bouleversée ; mais, constatant que sonindisposition n’avait rien d’alarmant, elle ne désiraitnullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devantavoir pour conséquence son départ de Netherfield. Aveccette arrière-pensée elle refusa d’écouter Jane quidemandait à être transportée à Longbourn. Au reste, lemédecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeaitpas non plus la chose raisonnable.
Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane,miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, etBingley vint exprimer à Mrs. Bennet l’espoir qu’elle
n’avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu’elle ne s’yattendait.
– En vérité si, monsieur, répondit-elle. Elle est mêmebeaucoup trop malade pour qu’on puisse la transporter àla maison. Mr. Jones dit qu’il n’y faut pas penser. Nousvoilà donc obligées d’abuser encore de votre hospitalité.
– La transporter chez vous ! s’écria Bingley. Mais laquestion ne se pose même pas ! Ma sœur s’y refuseraitabsolument.
– Vous pouvez être sûre, madame, dit miss Bingleyavec une froide politesse, que miss Bennet, tant qu’ellerestera ici, recevra les soins les plus empressés.
Mrs. Bennet se confondit en remerciements.
– Si vous ne vous étiez pas montrés aussi bons, je nesais ce qu’elle serait devenue, car elle est vraimentmalade et souffre beaucoup, bien qu’avec une patienceangélique comme à l’ordinaire. Cette enfant a le plusdélicieux caractère qu’on puisse imaginer et je dis souventà mes autres filles qu’elles sont loin de valoir leur sœur.Cette pièce est vraiment charmante, master Bingley, etquelle jolie vue sur cette allée sablée. Je ne connais pasdans tout le voisinage une propriété aussi agréable queNetherfield. Vous n’êtes pas pressé de le quitter, je pense,bien que vous n’ayez pas fait un long bail.
– Mes résolutions, madame, sont toujours prisesrapidement, et si je décidais de quitter Netherfield lachose serait probablement faite en un quart d’heure. Pourl’instant, je me considère comme fixé ici définitivement.
l’instant, je me considère comme fixé ici définitivement.
– Voilà qui ne me surprend pas de vous, dit Elizabeth.
– Eh quoi, fit-il en se tournant vers elle, vouscommencez déjà à me connaître.
– Oui, je commence à vous connaître parfaitement.
– Je voudrais voir dans ces mots un compliment, maisje crains qu’il ne soit pas très flatteur d’être pénétré aussifacilement.
– Pourquoi donc ? Une âme profonde et compliquéen’est pas nécessairement plus estimable que la vôtre.
– Lizzy, s’écria sa mère, rappelez-vous où vous êtes etne discourez pas avec la liberté qu’on vous laisse prendreà la maison.
– Je ne savais pas, poursuivait Bingley, que vousaimiez vous livrer à l’étude des caractères.
– La campagne, dit Darcy, ne doit pas vous fournirbeaucoup de sujets d’étude. La société y est généralementrestreinte et ne change guère.
– Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellementqu’il y a toujours du nouveau à observer.
– Assurément, intervint Mrs. Bennet froissée de lafaçon dont Darcy parlait de leur entourage, et je vousassure que sur ce point la province ne le cède en rien à lacapitale. Quels sont après tout les grands avantages deLondres, à part les magasins et les lieux publics ? Lacampagne est beaucoup plus agréable, n’est-ce pas, Mr.Bingley ?
– Quand je suis à la campagne je ne souhaite point laquitter, et quand je me trouve à Londres je suisexactement dans les mêmes dispositions.
– Eh ! c’est que vous avez un heureux caractère. Maisce gentleman, – et Mrs. Bennet lança un regard dans ladirection de Darcy, – semble mépriser la province.
– En vérité, maman, s’écria Elizabeth, vous vousméprenez sur les paroles de Mr. Darcy. Il voulaitseulement dire qu’on ne rencontre pas en province uneaussi grande variété de gens qu’à Londres et vous devezreconnaître qu’il a raison.
– Certainement, ma chère enfant, personne ne leconteste, mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pasgrand monde ici. Pour notre part, nous échangeons desinvitations à dîner avec vingt-quatre familles.
La sympathie de Mr. Bingley pour Elizabeth l’aidaseule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate,regarda Mr. Darcy avec un sourire significatif. Elizabeth,voulant changer de conversation, demanda à sa mère siCharlotte Lucas était venue à Longbourn depuis sondépart.
– Oui, nous l’avons vue hier ainsi que son père. Quelhomme charmant que sir William, n’est-ce pas, Mr.Bingley ? distingué, naturel, ayant toujours un motaimable à dire à chacun. C’est pour moi le type del’homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflésde leur importance qui ne daignent même pas ouvrir labouche.
– Charlotte a-t-elle dîné avec vous ?
– Non. Elle a tenu à retourner chez elle où onl’attendait, je crois, pour la confection des « mincepies ».Quant à moi, Mr. Bingley, je m’arrange pour avoir desdomestiques capables de faire seuls leur besogne, et mesfilles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à samanière et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C’estdommage seulement qu’elles ne soient pas plus jolies ;non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, maisaussi, c’est une amie tellement intime…
– Elle m’a semblé fort aimable, dit Bingley.
– Oh ! certainement, mais il faut bien reconnaîtrequ’elle n’est pas jolie. Mrs. Lucas en convient elle-mêmeet nous envie la beauté de Jane. Certes, je n’aime pas fairel’éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle deJane se voit rarement. À peine âgée de quinze ans, elle arencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, unmonsieur à qui elle plut tellement que ma belle-sœurs’attendait à ce qu’il la demandât en mariage. Il n’en fitrien toutefois – sans doute la trouvait-il trop jeune, –mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis.
– Et ainsi, dit Elizabeth avec un peu d’impatience, setermina cette grande passion. Ce n’est pas la seule donton ait triomphé de cette façon, et je me demande qui, lepremier, a eu l’idée de se servir de la poésie pour seguérir de l’amour.
– J’avais toujours été habitué, dit Darcy, à considérerla poésie comme l’aliment de l’amour.
– Oh ! d’un amour vrai, sain et vigoureux, peut-être !Tout fortifie ce qui est déjà fort. Mais lorsqu’il s’agit d’unepauvre petite inclination, je suis sûre qu’un bon sonnetpeut en avoir facilement raison.
Darcy répondit par un simple sourire. Dans la crainted’un nouveau discours intempestif de sa mère, Elizabethaurait voulu continuer ; mais avant qu’elle eût pu trouverun autre sujet de conversation, Mrs. Bennet avaitrecommencé la litanie de ses remerciements pourl’hospitalité offerte à ses deux filles. Mr. Bingley réponditavec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinonavec autant de bonne grâce, et, satisfaite, Mrs. Bennet netarda pas à redemander sa voiture.
À ce signal, Lydia s’avança : elle avait chuchoté avecKitty tout le temps de la visite et toutes deux avaientdécidé de rappeler à Mr. Bingley la promesse qu’il avaitfaite à son arrivée de donner un bal à Netherfield. Lydiaétait une belle fille fraîche, joyeuse, et pleine d’entrain ;bien qu’elle n’eût que quinze ans, sa mère dont elle était lapréférée la conduisait déjà dans le monde. Les assiduitésdes officiers de la milice qu’attiraient les bons dîners deson oncle, et qu’encourageaient sa liberté d’allures,avaient transformé son assurance naturelle en unvéritable aplomb. Il n’y avait donc rien d’étonnant à cequ’elle rappelât à Mr. Bingley sa promesse, en ajoutantque ce serait « vraiment honteux » s’il ne la tenait pas.
La réponse de Mr. Bingley à cette brusque mise endemeure dut charmer les oreilles de Mrs. Bennet.
– Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mesengagements, et, dès que votre sœur sera remise, vousfixerez vous-même le jour. Vous n’auriez pas le cœur, jepense, de danser pendant qu’elle est malade.
Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce serait mieuxd’attendre la guérison de Jane ; et puis, à ce moment sansdoute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton.
– Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle,j’insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiersen donnent un également.
Mrs. Bennet et ses filles prirent alors congé. Elizabethremonta immédiatement auprès de Jane, laissant à cesdames et à Mr. Darcy la liberté de critiquer à leur aise sonattitude et celle de sa famille.
XLa journée s’écoula, assez semblable à la précédente.
Mrs. Hurst et miss Bingley passèrent quelques heures del’après-midi avec la malade qui continuait, bien quelentement, à se remettre et, dans la soirée, Elizabethdescendit rejoindre ses hôtes au salon.
La table de jeu, cette fois, n’était pas dressée. Mr.Darcy écrivait une lettre et miss Bingley, assise auprès delui, l’interrompait à chaque instant pour le charger demessages pour sa sœur. Mr. Hurst et Mr. Bingleyfaisaient une partie de piquet que suivait Mrs. Hurst.
Elizabeth prit un ouvrage mais fut bientôt distraite parles propos échangés entre Darcy et sa voisine. Lescompliments que lui adressait constamment celle-ci surl’élégance et la régularité de son écriture ou sur lalongueur de sa lettre, et la parfaite indifférence aveclaquelle ces louanges étaient accueillies formaient uneamusante opposition, tout en confirmant l’opinionqu’Elizabeth se faisait de l’un et de l’autre.
– Comme miss Darcy sera contente de recevoir une silongue lettre !
Point de réponse.
– Vous écrivez vraiment avec une rapiditémerveilleuse.
– Erreur. J’écris plutôt lentement.
– Vous direz à votre sœur qu’il me tarde beaucoup dela voir.
– Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière.
– Votre plume grince ! Passez-la-moi. J’ai un talentspécial pour tailler les plumes.
– Je vous remercie, mais c’est une chose que je faistoujours moi-même.
– Comment pouvez-vous écrire si régulièrement ?
– …
– Dites à votre sœur que j’ai été enchantéed’apprendre les progrès qu’elle a faits sur la harpe. Dites-lui aussi que son petit croquis m’a plongée dans leravissement : il est beaucoup plus réussi que celui de missGrantley.
– Me permettez-vous de réserver pour ma prochainelettre l’expression de votre ravissement ? Actuellement, ilne me reste plus de place.
– Oh ! cela n’a pas d’importance. Je verrai du restevotre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque foisd’aussi longues et charmantes missives, Mr. Darcy ?
– Longues, oui ; charmantes, ce n’est pas à moi de lesjuger telles.
– À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilitésont toujours agréables.
– Votre compliment tombe à faux, Caroline, s’écria sonfrère. Darcy n’écrit pas avec facilité ; il recherche trop lesmots savants, les mots de quatre syllabes, n’est-ce pas,Darcy ?
– Mon style épistolaire est évidemment très différentdu vôtre.
– Oh ! s’écria miss Bingley, Charles écrit d’une façontout à fait désordonnée ; il oublie la moitié des mots etbarbouille le reste.
– Les idées se pressent sous ma plume si abondantesque je n’ai même pas le temps de les exprimer. C’est cequi explique pourquoi mes lettres en sont quelquefoistotalement dépourvues.
– Votre humilité devrait désarmer la critique, masterBingley, dit Elizabeth.
– Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut pasêtre dupe. Ce n’est souvent que dédain de l’opiniond’autrui et parfois même prétention dissimulée.
– Lequel de ces deux termes appliquez-vous autémoignage de modestie que je viens de vous donner ?
– Le second. Au fond, vous êtes fier des défauts devotre style que vous attribuez à la rapidité de votrepensée et à une insouciance d’exécution que vous jugezoriginale. On est toujours fier de faire quelque choserapidement et l’on ne prend pas garde aux imperfections
qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à Mrs.Bennet que vous vous décideriez en cinq minutes àquitter Netherfield, vous entendiez provoquer sonadmiration. Pourtant, qu’y a-t-il de si louable dans uneprécipitation qui oblige à laisser inachevées des affairesimportantes et qui ne peut être d’aucun avantage à soi nià personne ?
– Allons ! Allons ! s’écria Bingley, on ne doit pasrappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Etcependant, sur mon honneur, j’étais sincère et ne songeaisnullement à me faire valoir devant ces dames par uneprécipitation aussi vaine.
– J’en suis convaincu, mais j’ai moins de certitudequant à la promptitude de votre départ. Comme tout lemonde, vous êtes à la merci des circonstances, et si aumoment où vous montez à cheval un ami venait vousdire : « Bingley, vous feriez mieux d’attendre jusqu’à lasemaine prochaine, » il est plus que probable que vous nepartiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez un mois.
– Vous nous prouvez par là, s’écria Elizabeth, que Mr.Bingley s’est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bienplus qu’il ne l’a fait lui même.
– Je suis très touché, répondit Bingley, de voirtransformer la critique de mon ami en un éloge de monbon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sapensée ; car il m’estimerait sûrement davantage si en unetelle occasion je refusais tout net, sautais à cheval etm’éloignais à bride abattue !
– Mr. Darcy estime donc que votre entêtement àexécuter votre décision rachèterait la légèreté aveclaquelle vous l’auriez prise ?
– J’avoue qu’il m’est difficile de vous dire au juste cequ’il pense : je lui passe la parole.
– Vous me donnez à défendre une opinion que vousm’attribuez tout à fait gratuitement ! Admettonscependant le cas en question : rappelez-vous, missBennet, que l’ami qui cherche à le retenir ne lui offreaucune raison pour le décider à rester.
– Alors, céder aimablement à la requête d’un ami n’estpas un mérite, à vos yeux ?
– Non. Céder sans raison ne me paraît être honorableni pour l’un, ni pour l’autre.
– Il me semble, Mr. Darcy, que vous comptez pourrien le pouvoir de l’affection. On cède souvent à unedemande par pure amitié sans avoir besoin d’y êtredécidé par des motifs ou des raisonnements. Laissonspour l’instant jusqu’à ce qu’il se présente le cas que vousavez imaginé pour Mr. Bingley. D’une façon générale, siquelqu’un sollicite un ami de modifier une résolution,d’ailleurs peu importante, blâmerez-vous ce dernier d’yconsentir sans attendre qu’on lui donne des argumentscapables de le persuader ?
– Avant de pousser plus loin ce débat, neconviendrait-il pas de préciser l’importance de laquestion, aussi bien que le degré d’intimité des deuxamis ?
– Alors, interrompit Bingley, n’oublions aucune desdonnées du problème, y compris la taille et le poids despersonnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, missBennet. Je vous assure que si Darcy n’était pas un gaillardsi grand et si vigoureux je ne lui témoignerais pas moitiéautant de déférence. Vous ne pouvez vous imaginer lacrainte qu’il m’inspire parfois ; chez lui, en particulier, ledimanche soir, lorsqu’il n’a rien à faire.
Mr. Darcy sourit, mais Elizabeth crut deviner qu’ilétait un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley,indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises.
– Je vois ce que vous cherchez, Bingley, lui dit son ami.Vous n’aimez pas les discussions et voulez mettre unterme à celle-ci.
– Je ne dis pas non. Les discussions ressemblent trop àdes querelles. Si vous et miss Bennet voulez bien attendreque je sois hors du salon, je vous en serai trèsreconnaissant, et vous pourrez dire de moi tout ce quevous voudrez.
– Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, ditElizabeth, et Mr. Darcy, de son côté, ferait mieux determiner sa lettre.
Mr. Darcy suivit ce conseil et, quand il eut fini d’écrire,il pria miss Bingley et Elizabeth de bien vouloir faire unpeu de musique. Miss Bingley s’élança vers le piano etaprès avoir poliment offert à Elizabeth de jouer lapremière, – ce que celle-ci refusa avec autant de politesseet plus de conviction, – elle s’installa elle-même devant le
et plus de conviction, – elle s’installa elle-même devant leclavier.
Mrs. Hurst chanta accompagnée par sa sœur.Elizabeth qui feuilletait des partitions éparses sur le pianone put s’empêcher de remarquer que le regard de Mr.Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu’elleinspirât un intérêt flatteur à ce hautain personnage !D’autre part, supposer qu’il la regardait parce qu’elle luidéplaisait était encore moins vraisemblable. « Sans doute,finit-elle par se dire, y a-t-il en moi quelque chose derépréhensible qui attire son attention. » Cette suppositionne la troubla point ; il ne lui était pas assez sympathiquepour qu’elle se souciât de son opinion.
Après avoir joué quelques chansons italiennes, missBingley, pour changer, attaqua un air écossais vif etalerte.
– Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie dedanser un reel{2}, miss Bennet ? dit Darcy ens’approchant.
Elizabeth sourit mais ne fit aucune réponse.
Un peu surpris de son silence, il répéta sa question.
– Oh ! dit-elle, je vous avais bien entendu la premièrefois, mais ne savais tout d’abord que vous répondre. Vousespériez, j’en suis sûre, que je dirais oui, pour pouvoirensuite railler mon mauvais goût. Mais j’ai toujours plaisirà déjouer de tels desseins et à priver quelqu’un del’occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai doncque je n’ai aucune envie de danser un reel. Et maintenant,
riez de moi si vous l’osez.
– Je ne me le permettrais certainement pas.
Elizabeth, qui pensait l’avoir vexé, fut fort étonnée decette aimable réponse, mais il y avait chez elle un mélanged’espièglerie et de charme qui empêchaient ses manièresd’être blessantes, et jamais encore une femme n’avaitexercé sur Darcy une pareille séduction. « En vérité,pensait-il, sans la vulgarité de sa famille, je courraisquelque danger. »
Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sajalousie fût en éveil et sa sollicitude pour la santé de sachère Jane se doublait du désir d’être débarrasséed’Elizabeth. Elle essayait souvent de rendre la jeune filleantipathique à Darcy en plaisantant devant lui sur leurprochain mariage et sur le bonheur qui l’attendait dansune telle alliance.
– J’espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu’ils sepromenaient dans la charmille, que, lors de cet heureuxévénement, vous donnerez à votre belle-mère quelquesbons conseils sur la nécessité de tenir sa langue, et quevous essayerez de guérir vos belles-sœurs de leur passionpour les militaires ; et, s’il m’est permis d’aborder unsujet aussi délicat, ne pourriez-vous faire aussi disparaîtrecette pointe d’impertinence et de suffisance quicaractérise la dame de vos pensées ?
– Avez-vous d’autres conseils à me donner en vue demon bonheur domestique ?
– Encore ceci : n’oubliez pas de mettre les portraits de
l’oncle et de la tante Philips dans votre galerie àPemberley et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle le juge. Ils sont un peu de la même profession, n’est-ce pas ? Quant à votre Elizabeth, inutile d’essayer de lafaire peindre. Quel artiste serait capable de rendre desyeux aussi admirables ?
À ce moment, Mrs. Hurst et Elizabeth débouchèrentd’une allée transversale.
– Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, ditmiss Bingley un peu confuse à l’idée qu’on avait pusurprendre sa conversation avec Darcy.
– C’est très mal à vous, répondit Mrs. Hurst, d’avoirdisparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. Et,s’emparant de l’autre bras de Mr. Darcy, elle laissaElizabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans lesentier qu’à trois de front. Mr. Darcy, conscient del’impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt :
– Cette allée n’est pas assez large ; si nous allions dansl’avenue ?
– Non, non, dit Elizabeth en riant, vous faites à voustrois un groupe charmant dont ma présence rompraitl’harmonie. Adieu !
Et elle s’enfuit gaiement, heureuse à l’idée de seretrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bienqu’elle avait l’intention de quitter sa chambre une heureou deux ce soir-là.
XILorsque les dames se levèrent de table à la fin du
dîner, Elizabeth remonta en courant chez sa sœur et,après avoir veillé à ce qu’elle fût bien couverte,redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par sesamies avec de grandes démonstrations de joie. JamaisElizabeth ne les avait vues aussi aimables que pendantl’heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de laconversation, pouvaient faire le récit détaillé d’une partiede plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquerde leurs relations avec beaucoup d’agrément. Mais quandles messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain ausecond plan.
Mr. Darcy, dès son entrée, fut interpellé par missBingley mais il s’adressa d’abord à miss Bennet pour laféliciter poliment de sa guérison. Mr. Hurst lui fit aussi unléger salut en murmurant : « Enchanté ! » mais l’accueilde Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité ;plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu de crainte que Jane nesouffrît du changement de température. Sur sesinstances, elle dut se placer de l’autre côté de la cheminéeafin d’être plus loin de la porte ; il s’assit alors auprèsd’elle et se mit à l’entretenir sans plus s’occuper des
autres. Elizabeth qui travaillait un peu plus loin observaitcette petite scène avec une extrême satisfaction.
Après le thé, Mr. Hurst réclama sans succès la table dejeu. Sa belle-sœur avait découvert que Mr. Darcyn’appréciait pas les cartes. Elle affirma que personnen’avait envie de jouer et le silence général parut luidonner raison. Mr. Hurst n’eut donc d’autre ressourceque de s’allonger sur un sofa et de s’y endormir. Darcyprit un livre, miss Bingley en fit autant ; Mrs. Hurst,occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues,plaçait un mot de temps à autre dans la conversation deson frère et de miss Bennet.
Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture quepar celle de Mr. Darcy et ne cessait de lui poser desquestions ou d’aller voir à quelle page il en était ; mais sestentatives de conversation restaient infructueuses ; il secontentait de lui répondre brièvement sans interrompresa lecture. À la fin, lasse de s’intéresser à un livre qu’elleavait pris uniquement parce que c’était le second volumede l’ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant unbâillement :
– Quelle agréable manière de passer une soirée ! Nulplaisir, vraiment, ne vaut la lecture ; on ne s’en lassejamais tandis qu’on se lasse du reste. Lorsque j’aurai unemaison à moi, je serai bien malheureuse si je n’ai pas unetrès belle bibliothèque.
Personne n’ayant répondu, elle bâilla encore une fois,mit son livre de côté et jeta les yeux autour d’elle en
quête d’une autre distraction. Entendant alors son frèreparler d’un bal à miss Bennet, elle se tourna soudain deson côté en disant :
– À propos, Charles, est-ce sérieusement que voussongez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieuxde nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne metrompe, pour certains d’entre nous ce bal serait plutôtune pénitence qu’un plaisir.
– Si c’est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère,libre à lui d’aller se coucher à huit heures ce soir-là. Quantau bal, c’est une affaire décidée et dès que Nichols aurapréparé assez de « blanc manger » j’enverrai mesinvitations.
– Les bals me plairaient davantage s’ils étaientorganisés d’une façon différente. Ces sortes de réunionssont d’une insupportable monotonie. Ne serait-il pasbeaucoup plus raisonnable d’y donner la première place àla conversation et non à la danse ?
– Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chèreCaroline, mais ce ne serait plus un bal.
Miss Bingley ne répondit point et, se levant, se mit à sepromener à travers le salon. Elle avait une silhouetteélégante et marchait avec grâce, mais Darcy dont ellecherchait à attirer l’attention restait inexorablementplongé dans son livre. En désespoir de cause elle vouluttenter un nouvel effort et, se tournant vers Elizabeth :
– Miss Eliza Bennet, dit-elle, suivez donc mon exempleet venez faire le tour du salon. Cet exercice est un
délassement, je vous assure, quand on est resté silongtemps immobile.
Elizabeth, bien que surprise, consentit, et le but secretde miss Bingley fut atteint : Mr. Darcy leva les yeux.Cette sollicitude nouvelle de miss Bingley à l’égardd’Elizabeth le surprenait autant que celle-ci, et,machinalement, il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de sejoindre à la promenade, mais il déclina l’invitation : il nevoyait, dit-il, que deux motifs pour les avoir décidées àfaire les cent pas ensemble et, dans un cas comme dansl’autre, jugeait inopportun de se joindre à elles. Quesignifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d’envie dele savoir, et demanda à Elizabeth si elle comprenait.
– Pas du tout, répondit-elle. Mais soyez sûre qu’il y alà-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleurmoyen de désappointer Mr. Darcy est donc de ne rien luidemander.
Mais désappointer Mr. Darcy était pour miss Bingleyune chose impossible et elle insista pour avoir uneexplication.
– Rien n’empêche que je vous la donne, dit-il, dèsqu’elle lui permit de placer une parole ; vous avez choisice passe-temps soit parce que vous avez des confidencesà échanger, soit pour nous faire admirer l’élégance devotre démarche. Dans le premier cas je serais de tropentre vous et, dans le second, je suis mieux placé pourvous contempler, assis au coin du feu.
– Quelle abomination ! s’écria miss Bingley. A-t-on,
jamais rien entendu de pareil ? Comment pourrions-nousle punir d’un tel discours ?
– C’est bien facile, si vous en avez réellement le désir.Taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intimespour savoir comment vous y prendre.
– Mais pas le moins du monde, je vous assure. Lemoyen de s’attaquer à un homme d’un calme aussiimperturbable et d’une telle présence d’esprit. Non, non ;c’est être vaincu d’avance. Nous n’aurons pasl’imprudence de rire de lui sans sujet. Mr. Darcy peutdonc triompher.
– Comment ? On ne peut pas rire de Mr. Darcy ? Ilpossède là un avantage bien rare !
– Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d’honneur. Leshommes les meilleurs et les plus sages, ou, si vous voulez,les meilleurs et les plus sages de leurs actes peuventtoujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songentqu’à plaisanter.
– J’espère, dit Elizabeth, que je ne suis pas de cenombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui estrespectable. Les sottises, les absurdités, les capricesd’autrui me divertissent, je l’avoue, et j’en ris chaque foisque j’en ai l’occasion ; mais Mr. Darcy, je le suppose, n’arien à faire avec de telles faiblesses.
– Peut-être est-ce difficile, mais j’ai pris à tâched’éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissentles esprits les mieux équilibrés.
– La vanité et l’orgueil, par exemple ?
– Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, maisl’orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujoursdans de justes limites.
Elizabeth se détourna pour cacher un sourire.
– Avez-vous fini l’examen de Mr. Darcy ? demandamiss Bingley. Pouvons-nous en savoir le résultat ?
– Certainement. Mr. Darcy n’a pas de défaut, il l’avouelui-même sans aucune fausse honte.
– Non, dit Darcy, je suis bien loin d’être aussiprésomptueux. J’ai bon nombre de défauts mais je meflatte qu’ils n’affectent pas mon jugement. Je n’oserépondre de mon caractère ; je crois qu’il manque desouplesse – il n’en a certainement pas assez au gréd’autrui. – J’oublie difficilement les offenses qui me sontfaites et mon humeur mériterait sans doute l’épithète devindicative. On ne me fait pas aisément changer d’opinion.Quand je retire mon estime à quelqu’un, c’est d’une façondéfinitive.
– Être incapable de pardonner ! Eh bien ! voilà qui estun défaut ! Mais vous l’avez bien choisi ; il m’estimpossible d’en rire.
– Il y a, je crois, en chacun de nous, un défaut naturelque la meilleure éducation ne peut arriver à fairedisparaître.
– Le vôtre est une tendance à mépriser vossemblables.
– Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est deprendre un malin plaisir à défigurer leur pensée.
– Faisons un peu de musique, voulez-vous ? proposamiss Bingley, fatiguée d’une conversation où elle n’avaitaucune part. Vous ne m’en voudrez pas, Louisa, deréveiller votre mari ?
Mrs. Hurst n’ayant fait aucune objection, le piano futouvert et Darey, à la réflexion, n’en fut pas fâché. Ilcommençait à sentir qu’il y avait quelque danger à trops’occuper d’Elizabeth.
XIIComme il avait été convenu entre les deux sœurs,
Elizabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour luidemander de leur envoyer la voiture dans le cours de lajournée. Mais Mrs. Bennet qui avait calculé que ses fillesresteraient une semaine entière à Netherfield envisageaitsans plaisir un si prompt retour. Elle répondit doncqu’elles ne pourraient pas avoir la voiture avant le mardi,ajoutant en post-scriptum que si l’on insistait pour lesgarder plus longtemps on pouvait bien se passer d’elles àLongbourn.
Elizabeth repoussait l’idée de rester davantage àNetherfield ; d’ailleurs elle ne s’attendait pas à recevoirune invitation de ce genre et craignait, au contraire, qu’enprolongeant sans nécessité leur séjour elle et sa sœur neparussent indiscrètes. Elle insista donc auprès de Janepour que celle-ci priât Mr. Bingley de leur prêter savoiture et elles décidèrent d’annoncer à leurs hôtes leurintention de quitter Netherfield le jour même.
De nombreuses protestations accueillirent cettecommunication et de telles instances furent faites queJane se laissa fléchir et consentit à rester jusqu’aulendemain. Miss Bingley regretta alors d’avoir proposé cedélai, car la jalousie et l’antipathie que lui inspirait l’une
des deux sœurs l’emportaient de beaucoup sur sonaffection pour l’autre.
Le maître de la maison ne pouvait se résigner à lesvoir partir si vite et, à plusieurs reprises, essaya depersuader à miss Bennet qu’elle n’était pas encore assezrétablie pour voyager sans imprudence. Mais, sûre d’agirraisonnablement, Jane ne céda pas.
Quant à Mr. Darcy il apprit la nouvelle sans déplaisir :Elizabeth était restée assez longtemps à Netherfield et ilse sentait attiré vers elle plus qu’il ne l’aurait voulu. D’unautre côté, miss Bingley la traitait avec peu de politesse etle harcelait lui-même de ses moqueries. Il résolutsagement de ne laisser échapper aucune marqued’admiration, aucun signe qui pût donner à Elizabethl’idée qu’elle possédait la moindre influence sur satranquillité. Si un tel espoir avait pu naître chez elle, ilétait évident que la conduite de Darcy pendant cettedernière journée devait agir de façon définitive, ou pour leconfirmer, ou pour le détruire.
Ferme dans sa résolution, c’est à peine s’il adressa laparole à Elizabeth durant toute la journée du samedi et,dans un tête-à-tête d’une demi-heure avec elle, restaconsciencieusement plongé dans son livre sans même luijeter un regard.
Le dimanche après l’office du matin eut lieu cetteséparation presque unanimement souhaitée. MissBingley, au moment des adieux, sentit s’augmenter sonaffection pour Jane et redevint polie envers Elizabeth ;
elle embrassa l’une tendrement en l’assurant de la joiequ’elle aurait toujours à la revoir et serra la main del’autre presque amicalement. Elizabeth, de son côté, sesentait de très joyeuse humeur en prenant congé.
L’accueil qu’elles reçurent de leur mère en arrivant àLongbourn fut moins cordial. Mrs. Bennet s’étonna deleur retour et les blâma sévèrement d’avoir donné à leurshôtes l’embarras de les faire reconduire. De plus, elle étaitbien sûre que Jane avait repris froid ; mais leur père,malgré l’expression laconique de son contentement, étaittrès heureux de les voir de retour. Ses filles aînées luiavaient beaucoup manqué ; il avait senti la place qu’ellesoccupaient à son foyer, et les veillées familiales, en leurabsence, avaient perdu beaucoup de leur animation etpresque tout leur charme.
Elles trouvèrent Mary plongée dans ses grandesétudes et, comme d’habitude, prête à leur lire les derniersextraits de ses lectures accompagnées de réflexionsphilosophiques peu originales. Catherine et Lydia avaientdes nouvelles d’un tout autre genre ; il s’était passébeaucoup de choses au régiment depuis le précédentmercredi : plusieurs officiers étaient venus dîner chez leuroncle ; un soldat avait été fustigé et le bruit du prochainmariage du colonel Forster commençait à se répandre.
XIII– J’espère, ma chère amie, que vous avez commandé
un bon dîner pour ce soir, dit Mr. Bennet à sa femme endéjeunant le lendemain, car il est probable que nousaurons un convive.
– Et qui donc, mon ami ? Je ne vois personne qui soitdans le cas de venir, sauf peut-être Charlotte Lucas, et jepense que notre ordinaire peut lui suffire.
– Le convive dont je parle est un gentleman et unétranger.
Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent.
– Un gentleman et un étranger ! Alors ce ne peut êtreque Mr. Bingley ! Oh ! Jane ! petite rusée, vous n’en aviezrien dit… Assurément je serai ravie de voir Mr. Bingley.Mais, grand Dieu ! Comme c’est ennuyeux qu’on ne puissepas trouver de poisson aujourd’hui ! Lydia, mon amour,sonnez vite ! Il faut que je parle tout de suite à lacuisinière.
– Ce n’est pas Mr. Bingley, intervint son mari ; c’estquelqu’un que je n’ai jamais vu.
Cette déclaration provoqua un étonnement généralsuivi d’un déluge de questions que Mr. Bennet se fit un
malin plaisir de laisser quelque temps sans réponse.
À la fin, il consentit à s’expliquer.
– J’ai reçu, il y a un mois environ, la lettre que voici età laquelle j’ai répondu il y a quinze jours seulement carl’affaire dont il s’agissait était délicate et demandaitréflexion. Cette lettre est de mon cousin, Mr. Collins, qui,à ma mort, peut vous mettre toutes à la porte de cettemaison aussitôt qu’il lui plaira.
– Ah ! mon ami, s’écria sa femme, je vous en prie, nenous parlez pas de cet homme odieux. C’est certainementune calamité que votre domaine doive être ainsi arraché àvos propres filles, et je sais qu’à votre place je me seraisarrangée d’une façon ou d’une autre pour écarter unetelle perspective.
Jane et Elizabeth s’efforcèrent, mais en vain, de fairecomprendre à leur mère ce qu’était un « entail »{3}. Ellesl’avaient déjà tenté plusieurs fois ; mais c’était un sujetsur lequel Mrs. Bennet se refusait à entendre raison, etelle n’en continua pas moins à protester amèrementcontre la cruauté qu’il y avait à déshériter une famille decinq filles en faveur d’un homme dont personne ne sesouciait.
– C’est évidemment une iniquité, dit Mr. Bennet, etrien ne peut laver Mr. Collins du crime d’être héritier deLongbourn. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, lessentiments qu’il y exprime vous adouciront peut-être unpeu.
– Ah ! pour cela non ! J’en suis certaine. Je pense au
– Ah ! pour cela non ! J’en suis certaine. Je pense aucontraire que c’est de sa part le comble de l’impertinenceet de l’hypocrisie que de vous écrire. Que ne reste-t-ilbrouillé avec vous comme l’était son père ?
– Il paraît justement avoir eu, à cet égard, quelquesscrupules, ainsi que vous allez l’entendre :
« Hunsford, par Westerham, Kent. 15 octobre.
« Cher monsieur,
« Le désaccord subsistant entre vous et mon regrettépère m’a toujours été fort pénible, et depuis que j’ai eul’infortune de le perdre, j’ai souvent souhaité d’yremédier. Pendant quelque temps j’ai été retenu par lacrainte de manquer à sa mémoire en me réconciliant avecune personne pour laquelle, toute sa vie, il avait professédes sentiments hostiles… » – Vous voyez, Mrs. Bennet !…« Néanmoins, j’ai fini par prendre une décision. Ayantreçu à Pâques l’ordination, j’ai eu le privilège d’êtredistingué par la Très Honorable lady Catherine deBourgh, veuve de sir Lewis de Bourgh, à la bonté et à lagénérosité de laquelle je dois l’excellente cure deHunsford où mon souci constant sera de témoigner marespectueuse reconnaissance à Sa Grâce, en même tempsque mon empressement à célébrer les rites et cérémoniesinstituées par l’Église d’Angleterre.
« En ma qualité d’ecclésiastique, je sens qu’il est demon devoir de faire avancer le règne de la paix danstoutes les familles soumises à mon influence. Sur ceterrain j’ose me flatter que mes avances ont un caractèrehautement recommandable, et vous oublierez, j’en suis
sûr, le fait que je suis l’héritier du domaine de Longbournpour accepter le rameau d’olivier que je viens vous offrir.
« Je suis réellement peiné d’être l’involontaireinstrument du préjudice causé à vos charmantes filles.Qu’il me soit permis de vous exprimer mes regrets enmême temps que mon vif désir de leur faire accepter tousles dédommagements qui sont en mon pouvoir ; mais, dececi, nous reparlerons plus tard.
« Si vous n’avez point de raison qui vous empêche deme recevoir je me propose de vous rendre visite le lundi18 novembre à quatre heures, et j’abuserai de votrehospitalité jusqu’au samedi de la semaine suivante – ceque je puis faire sans inconvénients, lady Catherine nevoyant pas d’objection à ce que je m’absente undimanche, pourvu que je me fasse remplacer par un demes confrères.
« Veuillez présenter mes respectueux compliments àces dames et me croire votre tout dévoué serviteur etami.
« William COLLINS. »
– Donc, à quatre heures, nous verrons arriver cepacifique gentleman. C’est, semble-t-il, un jeune hommeextrêmement consciencieux et courtois et nous auronssans doute d’agréables relations avec lui pour peu quelady Catherine daigne lui permettre de revenir nous voir.
– Ce qu’il dit à propos de nos filles est plein de raison,et s’il est disposé à faire quelque chose en leur faveur, cen’est pas moi qui le découragerai.
– Bien que je ne voie pas trop comment il pourrait s’yprendre, dit Jane, le désir qu’il en a lui fait certainementhonneur.
Elizabeth était surtout frappée de l’extraordinairedéférence exprimée par Mr. Collins à l’égard de ladyCatherine et de la solennité avec laquelle il affirmait sonintention de baptiser, marier, ou enterrer ses paroissiens,chaque fois que son ministère serait requis.
– Ce doit être un singulier personnage, dit-elle. Sonstyle est bien emphatique ; et que signifient ces excusesd’être l’héritier de Longbourn ? Y changerait-il quelquechose s’il le pouvait ? Pensez-vous que ce soit un hommede grand sens, père ?
– Non, ma chère enfant ; je suis même assuré dedécouvrir le contraire. Il y a dans sa lettre un mélange deservilité et d’importance qui m’intrigue. J’attends savisite avec une vive impatience.
– Au point de vue du style, dit Mary, sa lettre ne mesemble pas défectueuse. L’idée du rameau d’olivier, pourn’être pas très neuve, est néanmoins bien exprimée.
Pour Catherine et Lydia, la lettre ni son auteurn’étaient le moins du monde intéressants. Il y avait peude chances que leur cousin apparût avec un uniformeécarlate et, depuis quelque temps, la société des gensvêtus d’une autre couleur ne leur procurait plus aucunplaisir. Quant à leur mère, la lettre de Mr. Collins avait engrande partie dissipé sa mauvaise humeur et elle sepréparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnait
préparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnaitsa famille.
Mr. Collins arriva ponctuellement à l’heure dite et futreçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Mr.Bennet parla peu, mais ces dames ne demandaient qu’àparler à sa place. Mr. Collins de son côté ne paraissait nisauvage, ni taciturne. C’était un grand garçon un peulourd, à l’air grave et compassé et aux manièrescérémonieuses. À peine assis, il se mit à complimenterMrs. Bennet sur sa charmante famille. Il avait, dit-il,beaucoup entendu vanter la beauté de ses cousines, maisil constatait qu’en cette circonstance le bruit public étaitau-dessous de la vérité. Il ne doutait pas, ajouta-t-il,qu’en temps voulu leur mère n’eût la joie de les voirtoutes honorablement établies. Ces galants proposn’étaient pas goûtés de même façon par tous sesauditeurs, mais Mrs. Bennet, qui n’était point difficile surles compliments, répondit avec empressement :
– Ce que vous me dites là est fort aimable, monsieur,et je souhaite fort que votre prévision se réalise,autrement mes filles se trouveraient un jour dans unesituation bien fâcheuse avec des affaires aussisingulièrement arrangées.
– Vous faites allusion peut-être à l’« entail » de cedomaine.
– Naturellement, monsieur, et vous devez reconnaîtreque c’est une clause bien regrettable pour mes pauvresenfants. – Non que je vous en rende personnellementresponsable.
– Je suis très sensible, madame, au désavantage subipar mes belles cousines et j’en dirais plus sans la craintede vous paraître un peu trop pressé mais je puis affirmerà ces demoiselles que j’arrive tout prêt à goûter leurcharme. Je n’ajoute rien quant à présent. Peut-être,quand nous aurons fait plus ample connaissance…
Il fut interrompu par l’annonce du dîner et les jeunesfilles échangèrent un sourire. Elles n’étaient pas seules àexciter l’admiration de Mr. Collins : le hall, la salle àmanger et son mobilier furent examinés et hautementappréciés. Tant de louanges auraient touché le cœur deMrs. Bennet si elle n’avait eu la pénible arrière-penséeque Mr. Collins passait la revue de ses futurs biens. Ledîner à son tour fut l’objet de ses éloges et il insista poursavoir à laquelle de ses belles cousines revenait l’honneurde plats aussi parfaitement réussis. Mais ici, Mrs. Bennetl’interrompit un peu vivement pour lui dire qu’elle avait lemoyen de s’offrir une bonne cuisinière, et que ses filles nemettaient pas le pied à la cuisine. Mr. Collins la supplia dene pas lui en vouloir, à quoi elle répondit d’un ton plusdoux qu’il n’y avait point d’offense, mais il n’en continuapas moins à s’excuser jusqu’à la fin du dîner.
XIVPendant le repas Mr. Bennet avait à peine ouvert la
bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, ilpensa qu’il était temps de causer un peu avec son hôte, etmit la conversation sur le sujet qu’il estimait le mieuxchoisi pour le faire parler en félicitant son cousin d’avoirtrouvé une protectrice qui se montrait si pleined’attentions pour ses désirs et de sollicitude pour sonconfort.
Mr. Bennet ne pouvait mieux tomber. Mr. Collins futéloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il,solennellement, il n’avait rencontré chez un membre del’aristocratie l’affabilité et la condescendance que luitémoignait lady Catherine. Elle avait été assez bonne pourapprécier les deux sermons qu’il avait eu l’honneur deprêcher devant elle. Deux fois déjà elle l’avait invité àdîner à Rosings, et le samedi précédent encore l’avaitenvoyé chercher pour faire le quatrième à sa partie de« quadrille ». Beaucoup de gens lui reprochaient d’êtrehautaine, mais il n’avait jamais vu chez elle que de labienveillance. Elle le traitait en gentleman et ne voyaitaucune objection à ce qu’il fréquentât la société duvoisinage ou s’absentât une semaine ou deux pour allervoir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu’à lui
conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu’il fîtun choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dansson presbytère où elle avait pleinement approuvé lesaméliorations qu’il y avait apportées et daigné même ensuggérer d’autres, par exemple des rayons à poser dansles placards du premier étage.
– Voilà une intention charmante, dit Mrs. Bennet, et jene doute pas que lady Catherine ne soit une fort aimablefemme. C’est bien regrettable que les grandes dames, engénéral, lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votrevoisinage, monsieur ?
– Le jardin qui entoure mon humble demeure n’estséparé que par un sentier de Rosings Park, résidence deSa Grâce.
– Je crois vous avoir entendu dire qu’elle était veuve.A-t-elle des enfants ?
– Elle n’a qu’une fille, héritière de Rosings et d’uneimmense fortune.
– Ah ! s’écria Mrs. Bennet en soupirant. Elle est mieuxpartagée que beaucoup d’autres. Et cette jeune fille, est-elle jolie ?
– Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine ditelle-même que miss de Bourgh possède quelque chose demieux que la beauté car, dans ses traits, se reconnaît lamarque d’une haute naissance. Malheureusement elle estd’une constitution délicate et n’a pu se perfectionnercomme elle l’aurait voulu dans différents arts d’agrémentpour lesquels elle témoignait des dispositions
remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé sonéducation et qui continue à vivre auprès d’elle à Rosings,mais miss de Bourgh est parfaitement aimable et daignesouvent passer à côté de mon humble presbytère dans lepetit phaéton attelé de poneys qu’elle conduit elle-même.
– A-t-elle été présentée ? Je ne me rappelle pas avoirvu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour.
– Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pasde vivre à Londres. C’est ainsi, comme je l’ai dit un jour àlady Catherine, que la cour d’Angleterre se trouve privéed’un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine aparu touchée de mes paroles. Vous devinez que je suisheureux de lui adresser de ces compliments toujoursappréciés des dames chaque fois que l’occasion s’enprésente. Ces petits riens plaisent à Sa Grâce et fontpartie des hommages que je considère comme mon devoirde lui rendre.
– Vous avez tout à fait raison, dit Mr. Bennet, et c’estun bonheur pour vous de savoir flatter avec tant dedélicatesse. Puis-je vous demander si ces complimentsvous viennent spontanément ou si vous devez lespréparer d’avance ?
– Oh ! spontanément, en général. Je m’amuse aussiparfois à en préparer quelques-uns d’avance, mais jem’efforce toujours de les placer de façon aussi naturelleque possible.
Les prévisions de Mr. Bennet avaient été justes : soncousin était aussi parfaitement ridicule qu’il s’y attendait.
Il l’écoutait avec un vif amusement sans communiquerses impressions autrement que par un coup d’œil que, detemps à autre, il lançait à Elizabeth. Cependant, à l’heuredu thé, trouvant la mesure suffisante, il fut heureux deramener son hôte au salon.
Après le thé il lui demanda s’il voulait bien faire lalecture à ces dames. Mr. Collins consentit avecempressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue dutitre il eut un léger recul et s’excusa, protestant qu’il nelisait jamais de romans. Kitty le regarda avecahurissement et Lydia s’exclama de surprise. D’autreslivres furent apportés parmi lesquels il choisit, aprèsquelques hésitations, les sermons de Fordyce. Lydia semit à bâiller lorsqu’il ouvrit le volume et il n’avait pas lutrois pages d’une voix emphatique et monotone qu’ellel’interrompit en s’écriant :
– Maman, savez-vous que l’oncle Philips parle derenvoyer Richard et que le colonel Forster serait prêt à leprendre à son service ? J’irai demain à Meryton pour ensavoir davantage et demander quand le lieutenant Dennyreviendra de Londres.
Lydia fut priée par ses deux aînées de se taire, maisMr. Collins, froissé, referma son livre en disant :
– J’ai souvent remarqué que les jeunes filles ne saventpas s’intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond,je l’avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu’unelecture instructive, mais je n’ennuierai pas plus longtempsma jeune cousine. Et, malgré l’insistance de Mrs. Bennet
et de ses filles pour qu’il reprît sa lecture, Mr. Collins, touten protestant qu’il ne gardait nullement rancune à Lydia,se tourna vers Mr. Bennet et lui proposa une partie detrictrac.
XVMr. Collins était dépourvu d’intelligence, et ni
l’éducation, ni l’expérience ne l’avaient aidé à comblercette lacune de la nature. Son père, sous la directionduquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse,était un homme avare et illettré, et lui-même, àl’Université où il n’était demeuré que le temps nécessairepour la préparation de sa carrière, n’avait fait aucunerelation profitable.
Le rude joug de l’autorité paternelle lui avait donnédans les manières une grande humilité que combattaitmaintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre etenivré par une prospérité rapide et inattendue.
Une heureuse chance l’avait mis sur le chemin de ladyCatherine de Bourgh au moment où le bénéficed’Hunsford se trouvait vacant, et la vénération que luiinspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu’ilavait de lui-même et de son autorité pastorale, faisaientde Mr. Collins un mélange singulier de servilité etd’importance, d’orgueil et d’obséquiosité.
À présent qu’il se trouvait en possession d’une maisonagréable et d’un revenu suffisant il songeait à se marier.Ce rêve n’était pas étranger à son désir de se réconcilier
avec sa famille car il avait l’intention de choisir une de sesjeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréablesqu’on le disait communément. C’était là le plan qu’il avaitformé pour les dédommager du tort qu’il leur ferait enhéritant à leur place de la propriété de leur père, et il lejugeait excellent. N’était-il pas convenable et avantageuxpour les Bennet, en même temps que très généreux etdésintéressé de sa part ?
La vue de ses cousines ne changea rien à sesintentions. Le charmant visage de Jane ainsi que saqualité d’aînée fixa son choix le premier soir, mais, lelendemain matin, il lui fallut modifier ses projets. Dans unbref entretien qu’il eut avant le déjeuner avec Mrs.Bennet il lui laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-cirépondit avec force sourires et mines encourageantesqu’elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunesfilles, mais que l’aînée, – c’était son devoir de l’enprévenir, – serait sans doute fiancée d’ici peu.
Mr. Collins n’avait plus qu’à passer de Jane àElizabeth. C’est ce qu’il fit pendant que Mrs. Bennettisonnait le feu. Elizabeth qui par l’âge et la beauté venaitimmédiatement après Jane était toute désignée pour luisuccéder.
Cette confidence remplit de joie Mrs. Bennet quivoyait déjà deux de ses filles établies et, de ce fait,l’homme dont la veille encore le nom seul lui était odieuxse trouva promu très haut dans ses bonnes grâces.
Lydia n’oubliait point son projet de se rendre à
Meryton. Ses sœurs, à l’exception de Mary, acceptèrentde l’accompagner, et Mr. Bennet, désireux de sedébarrasser de son cousin qui depuis le déjeuner s’étaitinstallé dans sa bibliothèque où il l’entretenait sans répitde son presbytère et de son jardin, le pressa vivementd’escorter ses filles, ce qu’il accepta sans se faire prier.
Mr. Collins passa le temps du trajet à émettresolennellement des banalités auxquelles ses cousinesacquiesçaient poliment. Mais, sitôt entrées dans la ville lesdeux plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindreintérêt ; elles fouillaient les rues du regard dans l’espoird’y découvrir un uniforme, et il ne fallait rien moinsqu’une robe nouvelle ou un élégant chapeau à unedevanture pour les distraire de leurs recherches.
Bientôt l’attention des demoiselles Bennet fut attiréepar un inconnu jeune et d’allure distinguée qui sepromenait de long en large avec un officier de l’autre côtéde la rue. L’officier était ce même Mr. Denny dont leretour préoccupait si fort Lydia, et il les salua au passage.
Toutes se demandaient quel pouvait être cet étrangerdont la physionomie les avait frappées. Kitty et Lydia,bien décidées à l’apprendre, traversèrent la rue sousprétexte de faire un achat dans un magasin et ellesarrivèrent sur le trottoir opposé pour se trouver face àface avec les deux gens qui revenaient sur leurs pas. Mr.Denny leur demanda la permission de leur présenter sonami, Mr. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui laveille et venait de prendre un brevet d’officier dans sonrégiment.
Voilà qui était parfait : l’uniforme seul manquait à cejeune homme pour le rendre tout à fait séduisant.Extérieurement tout était en sa faveur : silhouetteélégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôtprésenté il engagea la conversation avec unempressement qui n’excluait ni la correction, ni lasimplicité. La conversation allait son train lorsque Mr.Bingley et Mr. Darcy apparurent à cheval au bout de larue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ilsvinrent jusqu’à elles pour leur présenter leurs hommages.Ce fut Bingley qui parla surtout et, s’adressantparticulièrement à Jane, dit qu’il était en route pourLongbourn où il se proposait d’aller prendre des nouvellesde sa santé. Mr. Darcy, confirmait par un signe de têtelorsque ses yeux tombèrent sur l’étranger et leursregards se croisèrent. Elizabeth qui les regardait à cetinstant fut satisfaite de l’effet produit par cetterencontre : tous deux changèrent de couleur ; l’un pâlit,l’autre rougit. Mr. Wickham, au bout d’un instant, touchason chapeau et Mr. Darcy daigna à peine lui rendre cesalut. Qu’est-ce que tout cela signifiait ? Il était difficile dele deviner, difficile aussi de ne pas désirer l’apprendre.
Une minute plus tard, Mr. Bingley, qui semblait nes’être aperçu de rien, prit congé et poursuivit sa routeavec son ami.
Mr. Denny et Mr. Wickham accompagnèrent lesdemoiselles Bennet jusqu’à la maison de leur oncle ; maislà ils les quittèrent en dépit des efforts de Lydia pour lesdécider à entrer et malgré l’invitation de Mrs. Philips elle-
même qui, surgissant à la fenêtre de son salon, appuyabruyamment les instances de sa nièce.
Mrs. Philips accueillit Mr. Collins avec une grandecordialité. Il y répondit par de longs discours pours’excuser de l’indiscrétion qu’il commettait en osant venirchez elle sans lui avoir été préalablement présenté. Saparenté avec ces demoiselles Bennet justifiait un peu,pensait-il, cette incorrection. Mrs. Philips étaitémerveillée d’un tel excès de politesse, mais elle fut vitedistraite par les questions impétueuses de ses nièces surl’étranger qu’elles venaient de rencontrer. Elle ne put dureste leur apprendre que ce qu’elles savaient déjà : queMr. Denny avait ramené ce jeune homme de Londres etqu’il allait recevoir un brevet de lieutenant. Cependant,quelques officiers devant dîner chez les Philips lelendemain, la tante promit d’envoyer son mari inviter Mr.Wickham à condition que la famille de Longbourn vîntpasser la soirée. Mrs. Philips annonçait une bonne partiede loto, joyeuse et bruyante, suivie d’un petit souperchaud. La perspective de telles délices mit tout le mondeen belle humeur et l’on se sépara gaiement de part etd’autre. Mr. Collins répéta ses excuses en quittant lesPhilips et reçut une fois de plus l’aimable assurancequ’elles étaient parfaitement inutiles.
De retour à Longbourn il fit grand plaisir à Mrs.Bennet en louant la politesse et les bonnes manières deMrs. Philips : à l’exception de lady Catherine et de sa fille,jamais il n’avait rencontré de femme plus distinguée. Noncontente de l’avoir accueilli avec une parfaite bonne grâce,
elle l’avait compris dans son invitation pour le lendemain,lui dont elle venait à peine de faire la connaissance. Sansdoute sa parenté avec les Bennet y était pour quelquechose mais, tout de même, il n’avait jamais rencontré unetelle amabilité dans tout le cours de son existence.
XVIAucune objection n’ayant été faite à la partie projetée,
la voiture emporta le lendemain soir à Meryton Mr.Collins et ses cinq cousines. En entrant au salon, cesdemoiselles eurent le plaisir d’apprendre que Mr.Wickham avait accepté l’invitation de leur oncle et qu’ilétait déjà arrivé. Cette nouvelle donnée, tout le mondes’assit et Mr. Collins put regarder et louer à son aise cequi l’entourait. Frappé par les dimensions et le mobilierde la pièce, il déclara qu’il aurait presque pu se croire dansla petite salle où l’on prenait le déjeuner du matin àRosings. Cette comparaison ne produisit pas d’abord toutl’effet qu’il en attendait, mais quand il expliqua ce quec’était que Rosings, quelle en était la propriétaire, etcomment la cheminée d’un des salons avait coûté 800livres à elle seule, Mrs. Philips comprit l’honneur qui luiétait fait et aurait pu entendre comparer son salon à lachambre de la femme de charge sans en être tropfroissée. Mr. Collins s’étendit sur l’importance de ladyCatherine et de son château en ajoutant quelquesdigressions sur son modeste presbytère et lesaméliorations qu’il tâchait d’y apporter et il ne tarit pasjusqu’à l’arrivée des messieurs. Mrs. Philips l’écoutaitavec une considération croissante ; quant aux jeunes filles,
qui ne s’intéressaient pas aux récits de leur cousin, ellestrouvèrent l’attente un peu longue et ce fut avec plaisirqu’elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans lesalon.
En voyant paraître Mr. Wickham Elizabeth pensa quel’admiration qu’il lui avait inspirée à leur premièrerencontre n’avait rien d’exagéré. Les officiers du régimentde Meryton étaient, pour la plupart, des gens de bonnefamille et les plus distingués d’entre eux étaient présentsce soir-là, mais Mr. Wickham ne leur était pas moinssupérieur par l’élégance de sa personne et de sesmanières qu’ils ne l’étaient eux-mêmes au gros onclePhilips qui entrait à leur suite en répandant une forteodeur de porto.
Vers Mr. Wickham, – heureux mortel, –convergeaient presque tous les regards féminins.Elizabeth fut l’heureuse élue auprès de laquelle il vints’asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama laconversation, bien qu’il ne fût question que de l’humiditéde la soirée et de la prévision d’une saison pluvieuse, lui fitsentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénuéd’intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et lecharme de l’interlocuteur.
Avec des concurrents aussi sérieux que Mr. Wickhamet les officiers, Mr. Collins parut sombrer dansl’insignifiance. Aux yeux des jeunes filles il ne comptaitcertainement plus, mais, par intervalles, il trouvait encoreun auditeur bénévole dans la personne de Mrs. Philips et,grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café
et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesseen prenant place à la table de whist.
– Je suis encore un joueur médiocre, dit-il, mais jeserai heureux de me perfectionner. Un homme dans masituation…
Mais Mrs. Philips, tout en lui sachant gré de sacomplaisance, ne prit pas le temps d’écouter ses raisons.
Mr. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilliavec joie à l’autre table où il prit place entre Elizabeth etLydia. Tout d’abord on put craindre que Lydia nel’accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucouples cartes et son attention fut bientôt absorbée par lesparis et les enjeux. Tout en suivant la partie, Mr.Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Elizabeth.Celle-ci était toute disposée à l’écouter, bien qu’elle ne pûtespérer apprendre ce qui l’intéressait le plus, à savoirquelles étaient ses relations avec Mr. Darcy. Elle n’osaitmême pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouvacependant très inopinément satisfaite car Mr. Wickhamaborda lui-même le sujet. Il s’informa de la distance quiséparait Netherfield de Meryton et, sur la réponsed’Elizabeth, demanda avec une légère hésitation depuisquand y séjournait Mr. Darcy.
– Depuis un mois environ, et, pour ne pas quitter cesujet elle ajouta : – J’ai entendu dire qu’il y avait degrandes propriétés dans le Derbyshire.
– En effet, répondit Wickham, son domaine estsplendide et d’un rapport net de 10 000 livres. Personne
ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre,car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famillede Mr. Darcy.
Elizabeth ne put retenir un mouvement de surprise.
– Je comprends votre étonnement, miss Bennet, si,comme il est probable, vous avez remarqué la froideur denotre rencontre d’hier. Connaissez-vous beaucoup Mr.Darcy ?
– Très suffisamment pour mon goût, dit Elizabethavec vivacité. J’ai passé quatre jours avec lui dans unemaison amie, et je le trouve franchement antipathique.
– Je n’ai pas le droit de vous donner mon opinion surce point, dit Wickham ; je connais Mr. Darcy trop bien etdepuis trop longtemps pour le juger avec impartialité.Cependant, je crois que votre sentiment serait en généralaccueilli avec surprise. Du reste, hors d’ici où vous êtesdans votre famille, vous ne l’exprimeriez peut-être pasaussi énergiquement.
– Je vous assure que je ne parlerais pas autrementdans n’importe quelle maison du voisinage, sauf àNetherfield. Personne ici ne vous dira du bien de Mr.Darcy ; son orgueil a rebuté tout le monde.
– Je ne prétends pas être affligé de voir qu’il n’est pasestimé au delà de ses mérites, dit Wickham après uncourt silence ; mais je crois que pareille chose ne lui arrivepas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par safortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur deses manières, et le voient tel qu’il désire être vu.
– D’après le peu que je connais de lui, il me sembleavoir assez mauvais caractère.
Wickham hocha la tête sans répondre.
– Je me demande, reprit-il au bout d’un instant, s’il varester encore longtemps ici.
– Il m’est impossible de vous renseigner là-dessus,mais il n’était pas question de son départ lorsque j’étais àNetherfield. J’espère que vos projets en faveur de votregarnison ne se trouveront pas modifiés du fait de saprésence dans la région.
– Pour cela non. Ce n’est point à moi à fuir devant Mr.Darcy. S’il ne veut pas me voir, il n’a qu’à s’en aller. Nousne sommes pas en bons termes, c’est vrai, et chaquerencontre avec lui m’est pénible mais, je puis le dire trèshaut, je n’ai pas d’autre raison de l’éviter que le souvenirde mauvais procédés à mon égard et le profond regret devoir ce qu’il est devenu. Son père, miss Bennet, le défuntMr. Darcy, était le meilleur homme de l’univers et l’ami leplus sincère que j’aie jamais eu : je ne puis me trouver enprésence de son fils sans être ému jusqu’à l’âme par millesouvenirs attendrissants. Mr. Darcy s’est conduit enversmoi d’une manière scandaleuse, cependant, je crois que jepourrais tout lui pardonner, tout, sauf d’avoir trompé lesespérances et manqué à la mémoire de son père.
Elizabeth de plus en plus intéressée ne perdait pas uneseule de ces paroles, mais le sujet était trop délicat pourlui permettre de poser la moindre question.
Mr. Wickham revint à des propos d’un intérêt plusgénéral : Meryton, les environs, la société. De celle-ci,surtout, il paraissait enchanté et le disait dans les termesles plus galants.
– C’est la perspective de ce milieu agréable qui m’apoussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà deréputation et mon ami Denny a achevé de me décider enme vantant les charmes de sa nouvelle garnison et desagréables relations qu’on pouvait y faire. J’avoue que lasociété m’est nécessaire : j’ai eu de grands chagrins, je nepuis supporter la solitude. Il me faut de l’occupation et dela compagnie. L’armée n’était pas ma vocation, lescirconstances seules m’y ont poussé. Je devais entrerdans les ordres, c’est dans ce but que j’avais été élevé etje serais actuellement en possession d’une très belle curesi tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlionstout à l’heure.
– Vraiment !
– Oui, le défunt Mr. Darcy m’avait désigné pour laprochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine.J’étais son filleul et il me témoignait une grande affection.Jamais je ne pourrai trop louer sa bonté. Il pensait avoir,de cette façon, assuré mon avenir ; mais, quand lavacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice.
– Grand Dieu ! Est-ce possible ? s’écria Elizabeth.Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de sesdernières volontés ? Pourquoi n’avez-vous pas eu recoursà la justice ?
– Il y avait, par malheur, dans le testament un vice deforme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyaln’aurait jamais mis en doute l’intention du donateur. Il aplu à Mr. Darcy de le faire et de considérer cetterecommandation comme une apostille conditionnelle enaffirmant que j’y avais perdu tout droit par mesimprudences, mes extravagances, tout ce que vousvoudrez. Ce qu’il y a de certain, c’est que le bénéfice estdevenu vacant il y a deux ans exactement, lorsque j’étaisen âge d’y aspirer, et qu’il a été donné à un autre : et iln’est pas moins sûr que je n’avais rien fait pour mériterd’en être dépossédé. Je suis d’une humeur assez vive etj’ai pu dire avec trop de liberté à Mr. Darcy ce que jepensais de lui, mais la vérité c’est que nos caractères sontradicalement opposés et qu’il me déteste.
– C’est honteux ! Il mériterait qu’on lui dise son faitpubliquement.
– Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l’autre, maisce n’est point moi qui le ferai. Il faudrait d’abord que jepuisse oublier tout ce que je dois à son père.
De tels sentiments redoublèrent l’estime d’Elizabeth,et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plusséduisant.
– Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ontdonc pu le pousser, et le déterminer à si mal agir ?
– Une antipathie profonde et tenace à mon égard, –une antipathie que je suis forcé, en quelque mesure,d’attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins
d’affection pour moi, le fils m’aurait sans doute mieuxsupporté. Mais l’amitié vraiment peu commune que sonpère me témoignait l’a, je crois, toujours irrité. Il n’étaitpoint homme à accepter l’espèce de rivalité qui nousdivisait et la préférence qui m’était souvent manifestée.
– Je n’aurais jamais cru Mr. Darcy aussi vindicatif.Tout en n’éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne lejugeais pas aussi mal. Je le supposais bien rempli dedédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pascapable de s’abaisser à une telle vengeance, – de montrertant d’injustice et d’inhumanité.
Elle reprit après quelques minutes de réflexion :
– Je me souviens cependant qu’un jour, à Netherfield,il s’est vanté d’être implacable dans ses ressentiments etde ne jamais pardonner. Quel triste caractère !
– Je n’ose m’aventurer sur ce sujet, répliquaWickham. Il me serait trop difficile d’être juste à sonégard.
De nouveau, Elizabeth resta un moment silencieuse etpensive ; puis elle s’exclama :
– Traiter ainsi le filleul, l’ami, le favori de son père !…Elle aurait pu ajouter « un jeune homme aussisympathique » ! Elle se contenta de dire : – et, de plus, unami d’enfance ! Ne m’avez-vous pas dit que vous aviez étéélevés ensemble ?
– Nous sommes nés dans la même paroisse, dansl’enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la
plus grande partie de notre jeunesse, partageant lesmêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Monpère, à ses débuts, avait exercé la profession où votreoncle Philips semble si bien réussir, mais il l’abandonnapour rendre service au défunt Mr. Darcy et consacrertout son temps à diriger le domaine de Pemberley. Mr.Darcy avait pour lui une haute estime et le traitait enconfident et en ami. Il a souvent reconnu tous lesavantages que lui avait valus l’active gestion de mon père.Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de secharger de mon avenir et je suis convaincu que ce futautant pour acquitter une dette de reconnaissance enversmon père que par affection pour moi.
– Que tout cela est extraordinaire ! s’écria Elizabeth.Je m’étonne que la fierté de Mr. Darcy ne l’ait pas pousséà se montrer plus juste envers vous, que l’orgueil, àdéfaut d’un autre motif, ne l’ait pas empêché de seconduire malhonnêtement – car c’est une véritablemalhonnêteté dont il s’agit là.
– Oui, c’est étrange, répondit Wickham, car l’orgueil,en effet, inspire la plupart de ses actions et c’est cesentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de lavertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avecnous-mêmes, et, dans sa conduite à mon égard, il a cédé àdes impulsions plus fortes encore que son orgueil.
– Pensez-vous qu’un orgueil aussi détestable puissejamais le porter à bien agir ?
– Certainement ; c’est par orgueil qu’il est libéral,
généreux, hospitalier, qu’il assiste ses fermiers et secourtles pauvres. L’orgueil familial et filial – car il a le culte deson père – est la cause de cette conduite. La volonté de nepas laisser se perdre les vertus traditionnelles etl’influence de sa maison à Pemberley est le mobile de tousses actes. L’orgueil fraternel renforcé d’un peu d’affectionfait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sasœur, et vous l’entendrez généralement vanter comme lefrère le meilleur et le plus dévoué.
– Quelle sorte de personne est miss Darcy ?
Wickham hocha la tête.
– Je voudrais vous dire qu’elle est aimable, – il m’estpénible de critiquer une Darcy, – mais vraiment elleressemble trop à son frère : c’est la même excessivefierté. Enfant, elle était gentille et affectueuse, et metémoignait beaucoup d’amitié. J’ai passé des heuresnombreuses à l’amuser, mais, aujourd’hui je ne suis plusrien pour elle. C’est une belle fille de quinze ou seize ans,très instruite, m’a-t-on dit. Depuis la mort de son pèreelle vit à Londres avec une institutrice qui dirige sonéducation.
Elizabeth, à diverses reprises, essaya d’aborderd’autres sujets mais elle ne put s’empêcher de revenir aupremier.
– Je suis étonnée, dit-elle, de l’intimité de Mr. Darcyavec Mr. Bingley. Comment Mr. Bingley, qui semble labonne humeur et l’amabilité personnifiées, a-t-il pu faireson ami d’un tel homme ? Comment peuvent-ils
s’entendre ? Connaissez-vous Mr. Bingley ?
– Nullement.
– C’est un homme charmant. Il ne connaît sûrementpas Mr. Darcy sous son vrai jour.
– C’est probable, mais Mr. Darcy peut plaire quand ille désire. Il ne manque pas de charme ni de talents ; c’estun fort agréable causeur quand il veut s’en donner lapeine. Avec ses égaux il peut se montrer extrêmementdifférent de ce qu’il est avec ses inférieurs. Sa fierté nel’abandonne jamais complètement, mais, dans la hautesociété, il sait se montrer large d’idées, juste, sincère,raisonnable, estimable, et peut-être même séduisant, enfaisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur.
La partie de whist avait pris fin. Les joueurs segroupèrent autour de l’autre table et Mr. Collins s’assitentre Elizabeth et Mrs. Philips. Cette dernière luidemanda si la chance l’avait favorisé. Non, il avaitcontinuellement perdu et, comme elle lui en témoignaitson regret, il l’assura avec gravité que la chose était sansimportance ; il n’attachait à l’argent aucune valeur et il lapriait de ne pas s’en affecter.
– Je sais très bien, madame, que lorsqu’on s’assied àune table de jeu l’on doit s’en remettre au hasard, et mesmoyens, c’est heureux, me permettent de perdre cinqshillings. Beaucoup sans doute ne peuvent en dire autant,mais, grâce à lady Catherine de Bourgh, je puis regarderavec indifférence de pareils détails.
Ces mots attirèrent l’attention de Mr. Wickham et,
après avoir considéré Mr. Collins un instant, il demandatout bas à Elizabeth si son cousin était très intime avec lafamille de Bourgh.
– Lady Catherine lui a fait donner récemment la curede Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du toutcomment Mr. Collins a été présenté à cette dame mais jesuis certaine qu’il ne la connaît pas depuis longtemps.
– Vous savez sans doute que lady Catherine de Bourghet lady Anne Darcy étaient sœurs et que, par conséquent,lady Catherine est la tante de Mr. Darcy.
– Non vraiment ! J’ignore tout de la parenté de ladyCatherine. J’ai entendu parler d’elle avant-hier pour lapremière fois.
– Sa fille, miss de Bourgh, est l’héritière d’une énormefortune et l’on croit généralement qu’elle et son cousinréuniront les deux domaines.
Cette information fit sourire Elizabeth qui pensa à lapauvre miss Bingley. À quoi serviraient tous ses soins,l’amitié qu’elle affichait pour la sœur, l’admiration qu’ellemontrait pour le frère si celui-ci était déjà promis à uneautre ?
– Mr. Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de biende lady Catherine et de sa fille. Mais, d’après certainsdétails qu’il nous a donnés sur Sa Grâce, je le soupçonnede se laisser aveugler par la reconnaissance, et saprotectrice me fait l’effet d’être une personne hautaine etarrogante.
– Je crois, répondit Wickham, qu’elle méritelargement ces deux qualificatifs. Je ne l’ai pas revuedepuis des années mais je me rappelle que ses manièresavaient quelque chose de tyrannique et d’insolent qui nem’a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement maisje crois qu’elle doit cette réputation pour une part à sonrang et à sa fortune, pour une autre à ses manièresautoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu qui adécidé que tous les membres de sa famille étaient desêtres supérieurs.
Elizabeth convint que c’était assez vraisemblable et laconversation continua de la sorte jusqu’à l’annonce dusouper qui, en interrompant la partie de cartes, renditaux autres dames leur part des attentions de Mr.Wickham. Toute conversation était devenue impossibledans le brouhaha du souper de Mrs. Philips, mais Mr.Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu’ildisait était si bien exprimé, et tout ce qu’il faisait était faitavec grâce.
Elizabeth partit l’esprit rempli de Mr. Wickham.Pendant le trajet du retour elle ne pensa qu’à lui et à toutce qu’il lui avait raconté ; mais elle ne put même pasmentionner son nom car ni Lydia, ni Mr. Collins necessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur lapartie de cartes, sur les fiches qu’elle avait gagnées etcelles qu’elle avait perdues et Mr. Collins avait tant à direde l’hospitalité de Mr. et de Mrs. Philips, de sonindifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper,de la crainte qu’il avait d’être de trop dans la voiture, qu’il
XVIILe lendemain Elizabeth redit à Jane la conversation
qu’elle avait eue avec Mr. Wickham. Jane l’écouta,stupéfaite et consternée : elle ne pouvait se décider àcroire que Mr. Darcy fût indigne à ce point de l’estime deMr. Bingley. D’autre part, il n’était pas dans sa nature desoupçonner la véracité d’un jeune homme d’apparenceaussi sympathique que Wickham. La seule pensée qu’ileût pu subir une aussi grande injustice suffisait àémouvoir son âme sensible. Ce qu’il y avait de mieux àfaire était de n’accuser personne et de mettre sur lecompte du hasard ou d’une erreur ce qu’on ne pouvaitexpliquer autrement.
– Tous deux ont sans doute été trompés, des gensintéressés ont pu faire à chacun de faux rapports sur lecompte de l’autre ; bref, il est impossible d’imaginer cequi, sans tort réel d’aucun côté, a pu faire naître unepareille inimitié.
– Certes oui. Et maintenant, ma chère Jane, qu’avez-vous à dire pour excuser les « gens intéressés » qui sontsans doute les vrais coupables ? Justifiez-les aussi, quenous n’en soyons pas réduites à les mal juger !
– Riez tant qu’il vous plaira ; cela ne changera point
mon opinion. Ne voyez-vous point, ma chère Lizzy, sousquel jour détestable ceci place Mr. Darcy ? Traiter ainsi leprotégé dont son père avait promis d’assurer l’avenir !Quel homme ayant le souci de sa réputation serait capabled’agir ainsi ? Et ses amis, pourraient-ils s’abuser à cepoint sur son compte ? Oh ! non !
– Il m’est plus facile de croire que Mr. Bingley s’esttrompé à son sujet que d’imaginer que Mr. Wickham ainventé tout ce qu’il m’a conté hier soir en donnant lesnoms, les faits, tous les détails. Si c’est faux, que Mr.Darcy le dise.
À ce moment on appela les jeunes filles qui durentquitter le bosquet où elles s’entretenaient pour retournerà la maison. Mr. Bingley et ses sœurs venaient apportereux-mêmes leur invitation pour le bal si impatiemmentattendu et qui se trouvait fixé au mardi suivant. Mrs.Hurst et miss Bingley se montrèrent enchantées deretrouver leur chère Jane, déclarant qu’il y avait dessiècles qu’elles ne s’étaient vues. Au reste de la familleelles accordèrent peu d’attention : elles évitèrent autantque possible de causer avec Mrs. Bennet, dirent quelquesmots à Elizabeth et rien du tout aux autres. Au bout detrès peu de temps elles se levèrent avec unempressement qui déconcerta quelque peu leur frère etfirent rapidement leurs adieux comme pour échapper auxdémonstrations de Mrs. Bennet.
La perspective du bal de Netherfield causait un vifplaisir à Longbourn. Mrs. Bennet se flattait qu’il étaitdonné à l’intention de sa fille aînée, et considérait comme
une faveur particulière que Mr. Bingley fût venu faire soninvitation en personne au lieu d’envoyer la carte d’usage.
Jane se promettait une agréable soirée où ellegoûterait la compagnie de ses deux amies et les attentionsde leur frère. Elizabeth jouissait d’avance du plaisir dedanser beaucoup avec Mr. Wickham, et d’observer laconfirmation de ce qu’il lui avait confié dans l’expressionet l’attitude de Mr. Darcy. La joie que se promettaientCatherine et Lydia dépendait moins de telle personne oude telle circonstance en particulier ; bien que, commeElizabeth, chacune d’elles fût décidée à danser la moitié dela soirée avec Mr. Wickham, il n’était pas l’unique danseurqui pût les satisfaire, et un bal, après tout, est toujours unbal. Et Mary elle-même pouvait, sans mentir, assurer quela perspective de cette soirée n’était pas pour lui déplaire.
Elizabeth était pleine d’entrain et de gaieté et bienqu’elle ne recherchât point d’ordinaire la conversation deMr. Collins, elle lui demanda s’il comptait accepterl’invitation de Mr. Bingley et, le cas échéant, s’il jugeraitconvenable de se mêler aux divertissements de la soirée.À son grand étonnement il lui répondit qu’il n’éprouvait àce sujet aucun scrupule et qu’il était sûr de n’encouriraucun blâme de la part de son évêque ou de ladyCatherine s’il s’aventurait à danser.
– Je ne crois nullement, l’assura-t-il, qu’un bal donnépar un jeune homme de qualité à des gens respectablespuisse rien présenter de répréhensible, et je réprouve sipeu la danse que j’espère que toutes mes charmantescousines me feront l’honneur de m’accepter pour cavalier
dans le cours de la soirée. Je saisis donc cette occasion,miss Elizabeth, pour vous inviter pour les deux premièresdanses. J’espère que ma cousine Jane attribuera cettepréférence à sa véritable cause et non pas à un manqued’égards pour elle.
Elizabeth se trouvait prise. Elle avait rêvé se faireinviter pour ces mêmes danses par Wickham ! Il n’y avaitplus qu’à accepter l’invitation de son cousin d’aussi bonnegrâce que possible, mais cette galanterie lui causaitd’autant moins de plaisir qu’elle ouvrait la porte à unesupposition nouvelle. Pour la première fois l’idée vint àElizabeth que, parmi ses sœurs, c’était elle que Mr. Collinsavait élue pour aller régner au presbytère de Hundsfordet faire la quatrième à la table de whist de Rosings enl’absence de plus nobles visiteurs. Cette supposition sechangea en certitude devant les attentions multipliées deson cousin et ses compliments sur sa vivacité et sonesprit. À sa fille, plus étonnée que ravie de sa conquête,Mrs. Bennet donna bientôt à entendre que la perspectivede ce mariage lui était extrêmement agréable. Elizabethjugea préférable d’avoir l’air de ne point comprendre afind’éviter une discussion. Après tout, il se pouvait fort bienque Mr. Collins ne fît jamais la demande de sa main et,jusqu’à ce qu’il la fît, il était bien inutile de se quereller àson sujet.
XVIIIQuand elle fit son entrée dans le salon de Netherfield,
Elizabeth remarqua que Wickham ne figurait point dans legroupe d’habits rouges qui y étaient rassemblés. Jusque-là l’idée de cette absence n’avait même pas effleuré sonesprit ; au contraire, mettant à sa toilette un soin toutparticulier, elle s’était préparée joyeusement à achever saconquête, persuadée que c’était l’affaire d’une soirée.
Alors, brusquement, surgit l’affreux soupçon que lesBingley, par complaisance pour Mr. Darcy, avaient omissciemment Wickham dans l’invitation adressée auxofficiers. Bien que la supposition fût inexacte, son absencefut bientôt confirmée par son ami, Mr. Denny ; à Lydiaqui le pressait de questions il répondit que Wickham avaitdû partir pour Londres la veille et qu’il n’était pointencore de retour, ajoutant d’un air significatif :
– Je ne crois pas que ses affaires l’eussent décidé às’absenter précisément aujourd’hui s’il n’avait eu surtoutle désir d’éviter une rencontre avec un gentleman decette société.
Cette allusion, perdue pour Lydia, fut saisie parElizabeth et lui montra que Darcy n’était pas moinsresponsable de l’absence de Wickham que si sa première
supposition avait été juste. L’antipathie qu’il lui inspiraits’en trouva tellement accrue qu’elle eut grand’peine à luirépondre dans des termes suffisamment polis lorsque,peu après, il vint lui-même lui présenter ses hommages.Ne voulant avoir aucune conversation avec lui, elle sedétourna avec un mouvement de mauvaise humeurqu’elle ne put tout de suite surmonter, même en causantavec Mr. Bingley dont l’aveugle partialité à l’égard de sonami la révoltait.
Mais il n’était pas dans la nature d’Elizabeth des’abandonner longtemps à une telle impression, et quandelle se fut soulagée en exposant son désappointement àCharlotte Lucas, elle fut bientôt capable de faire dévier laconversation sur les originalités de son cousin et de lessignaler à l’attention de son amie.
Les deux premières danses, cependant, furent pourelle un intolérable supplice : Mr. Collins, solennel etmaladroit, se répandant en excuses au lieu de faireattention, dansant à contretemps sans même s’enapercevoir, donnait à sa cousine tout l’ennui, toute lamortification qu’un mauvais cavalier peut infliger à sadanseuse. Elizabeth en retrouvant sa liberté éprouva unsoulagement indicible. Invitée ensuite par un officier, elleeut la satisfaction de parler avec lui de Wickham etd’entendre dire qu’il était universellement apprécié.
Elle venait de reprendre sa conversation avecCharlotte Lucas, lorsque Mr. Darcy s’approcha et,s’inclinant devant elle, sollicita l’honneur d’être soncavalier. Elle se trouva tellement prise au dépourvu
qu’elle accepta sans trop savoir ce qu’elle faisait. Ils’éloigna aussitôt, la laissant toute dépitée d’avoir montrési peu de présence d’esprit. Charlotte Lucas essaya de laréconforter :
– Après tout, vous allez peut-être le trouver trèsaimable.
– Le ciel m’en préserve. Quoi ! Trouver aimable unhomme qu’on est résolu à détester !
Mais quand la musique recommença et que Darcys’avança pour lui rappeler sa promesse, Charlotte Lucasne put s’empêcher de lui souffler à l’oreille que son capricepour Wickham ne devait pas lui faire commettre la sottisede se rendre déplaisante aux yeux d’un homme dont lasituation valait dix fois celle de l’officier.
Elizabeth prit rang parmi les danseurs, confondue del’honneur d’avoir Mr. Darcy pour cavalier et lisant dansles regards de ses voisines un étonnement égal au sien.Pendant un certain temps ils gardèrent le silence.Elizabeth était bien décidée à ne pas le rompre lapremière lorsque l’idée lui vint qu’elle infligerait unepénitence à Mr. Darcy en l’obligeant à parler. Elle fit doncune réflexion sur la danse. Il lui répondit, puis retombadans son mutisme.
Au bout de quelques instants, elle reprit :
– Maintenant, Mr. Darcy, c’est à votre tour. J’ai déjàparlé de la danse. À vous de faire la remarque qu’il vousplaira sur les dimensions du salon ou le nombre desdanseurs.
Il sourit et l’assura qu’il était prêt à dire tout ce qu’elledésirait.
– Très bien. Quant à présent, cette réponse peutsuffire. Un peu plus tard j’observerai que les soiréesprivées présentent plus d’agrément que les bals officiels,mais pour l’instant, nous pouvons en rester là.
– Est-ce donc par devoir que vous causez en dansant ?
– Quelquefois. Il faut bien parler un peu. Il seraitétrange de rester ensemble une demi-heure sans ouvrirla bouche. Cependant, pour la commodité de certainsdanseurs, il vaut mieux que la conversation soit réglée detelle façon qu’ils n’aient à parler que le moins possible.
– Dans le cas présent, suivez-vous vos préférences oucherchez-vous à vous conformer aux miennes ?
– Aux uns et aux autres tout ensemble, car j’airemarqué dans notre tour d’esprit une granderessemblance. Nous sommes tous deux de caractèretaciturne et peu sociable et nous n’aimons guère à penser,à moins que ce ne soit pour dire une chose digned’étonner ceux qui nous écoutent et de passer à lapostérité avec tout l’éclat{4} d’un proverbe.
– Ce portrait ne vous ressemble pas d’une façonfrappante selon moi, dit-il. À quel point il me ressemblec’est ce que je ne puis décider. Vous le trouvez fidèle, sansdoute ?
– Ce n’est pas à moi de juger de mon œuvre.
Mr. Darcy ne reprit la conversation qu’au début de ladeuxième danse pour demander à Elizabeth si elle allaitsouvent à Meryton avec ses sœurs. Elle réponditaffirmativement et, ne pouvant résister à la tentation,ajouta :
– Lorsque vous nous avez rencontrées l’autre jour,nous venions justement de faire une nouvelleconnaissance.
L’effet fut immédiat. Un air de hauteur plus accentuéese répandit sur le visage de Darcy, mais il resta un instantsans répondre. Il dit enfin d’un air contraint :
– Mr. Wickham est doué de manières agréables qui luipermettent de se faire facilement des amis. Qu’il soitégalement capable de les conserver est une chose moinssûre.
– Je sais qu’il a eu le malheur de perdre « votre »amitié, répliqua Elizabeth, et cela d’une façon telle qu’il ensouffrira probablement toute son existence.
Darcy ne répondit pas et parut désireux de changer laconversation. À ce moment apparut près d’eux sir WilliamLucas qui essayait de traverser le salon en se faufilantentre les groupes. À la vue de Mr. Darcy il s’arrêta pourlui faire son salut le plus courtois et lui adresser quelquescompliments sur lui et sa danseuse.
– Vous me voyez ravi, cher monsieur. On a rarementl’avantage de voir danser avec un art aussi consommé.Vous me permettrez d’ajouter que votre aimabledanseuse vous fait honneur. J’espère que ce plaisir se
renouvellera souvent pour moi, surtout, ma chère Eliza, siun événement des plus souhaitables vient à se produire,ajouta-t-il en lançant un coup d’œil dans la direction deJane et de Bingley. Quel sujet de joie et de félicitationspour tout le monde ! J’en appelle à Mr. Darcy. Mais que jene vous retienne pas, monsieur. Vous m’en voudriez devous importuner davantage et les beaux yeux de votrejeune danseuse condamnent mon indiscrétion.
La fin de ce discours fut à peine entendue de Darcy.L’allusion de sir William semblait l’avoir frappé, et ildirigeait vers Bingley et Jane un regard préoccupé. Il seressaisit vite, cependant, et se tournant vers sadanseuse :
– L’interruption de sir William, dit-il, m’a fait oublierde quoi nous nous entretenions.
– Mais nous ne parlions de rien, je crois. Nous avionsessayé sans succès deux ou trois sujets de conversation etje me demande quel pourra être le suivant.
– Si nous parlions lecture ? dit-il en souriant.
– Lecture ? oh non ! Je suis sûre que nous n’avons pasles mêmes goûts.
– Je le regrette. Mais, quand cela serait, nouspourrions discuter nos idées respectives.
– Non, il m’est impossible de causer littérature dansun bal ; mon esprit est trop occupé d’autre chose.
– Est-ce ce qui vous entoure qui vous absorbe à cepoint ? demanda-t-il d’un air de doute.
– Oui, répondit-elle machinalement, car sa penséeétait ailleurs comme elle le montra bientôt par cettesoudaine exclamation :
– Mr. Darcy, je me rappelle vous avoir entendu direque vous ne pardonniez jamais une offense. Je supposeque ce n’est pas à la légère que vous concevez unressentiment aussi implacable.
– Non, certes, affirma-t-il avec force.
– Et vous ne vous laissez jamais aveugler par despréventions ?
– J’espère que non.
– Ceux qui ne changent jamais d’opinion doiventnaturellement veiller à juger du premier coup sans setromper.
– Puis-je vous demander à quoi tendent cesquestions ?
– À expliquer votre caractère, tout simplement, dit-elle en reprenant le ton de la plaisanterie. J’essaye en cemoment de le comprendre.
– Y réussissez-vous ?
– Guère, répondit-elle en hochant la tête ; j’entendssur vous des jugements si contradictoires que je m’yperds.
– Je crois en effet, répondit-il d’un ton grave, que l’onexprime sur moi des opinions très différentes, et ce n’est
pas en ce moment, miss Bennet, que j’aurais plaisir à vousvoir essayer de faire mon portrait, car l’œuvre, je lecrains, ne ferait honneur ni à vous, ni à moi.
Elizabeth n’ajouta rien. La danse terminée, ils seséparèrent en silence, mécontents l’un de l’autre, mais àun degré différent, car Darcy avait dans le cœur unsentiment qui le poussa bientôt à pardonner à Elizabeth età réserver toute sa colère pour un autre.
Presque aussitôt miss Bingley se dirigea versElizabeth, et, d’un air de politesse dédaigneuse, l’accostaainsi.
– Il paraît, miss Elizabeth, que George Wickham a fait,votre conquête ? Votre sœur vient de me poser sur luitoutes sortes de questions et j’ai constaté que ce jeunehomme avait négligé de vous dire, entre autres chosesintéressantes, qu’il était le fils du vieux Wickham,l’intendant de feu Mr. Darcy. Permettez-moi de vousdonner un conseil amical : ne recevez pas comme paroled’Évangile tout ce qu’il vous racontera. Il est faux que Mr.Darcy ait fait tort à Wickham : il l’a toujours traité avecune grande générosité, alors que Wickham, au contraire,s’est conduit fort mal envers lui. J’ignore les détails decette affaire, mais je puis vous affirmer que Mr. Darcy n’arien à se reprocher, qu’il ne veut plus entendre parler deWickham, et que mon frère, n’ayant pu se dispenserd’inviter ce dernier avec les autres officiers, a été ravi devoir que de lui-même il s’était retiré. Je me demandecomment il a eu l’audace de venir dans ce pays-ci. Je vousplains, miss Elizabeth, d’être mise ainsi face à face avec
l’indignité de votre favori : mais connaissant son origine,on ne pouvait guère s’attendre à mieux !
– En somme, répliqua Elizabeth irritée, votreaccusation la plus fondée est celle d’être le fils d’unsubalterne : et je puis vous certifier que Mr. Wickhamm’avait lui-même révélé ce détail !
– Oh ! pardon, répondit miss Bingley en s’éloignantavec un ricanement moqueur. Et excusez-moi en faveurde mon intention, qui était bonne !
– Insolente créature ! se dit Elizabeth. Croit-elle doncm’influencer par d’aussi misérables procédés ?… Je nevois là qu’ignorance voulue de sa part, et méchancetépure du côté de Mr. Darcy.
Puis elle chercha sa sœur aînée qui avait dûentreprendre une enquête sur le même sujet auprès deBingley.
Elle trouva Jane avec un sourire de contentement etune flamme joyeuse dans le regard qui montraient assezcombien elle était satisfaite de sa soirée. Elizabeth s’enaperçut tout de suite et tout autre sentiment s’effaça enelle devant l’espoir de voir Jane sur le chemin dubonheur.
– J’aimerais savoir, dit-elle en souriant, elle aussi, sivous avez appris quelque chose sur Mr. Wickham. Maisvous étiez peut-être engagée dans un entretien tropagréable pour penser aux autres. En ce cas, vous êtes toutexcusée.
– Non, reprit Jane, je ne l’ai point oublié, mais je n’airien de satisfaisant à vous dire. Mr. Bingley ne connaît pastoute son histoire et ignore ce qui a le plus offensé Mr.Darcy. Il répond seulement de la probité et de l’honneurde son ami et il est convaincu que Mr. Wickham ne méritemême pas ce que Mr. Darcy a fait pour lui. Je regrette dedire que d’après sa sœur comme d’après lui, Mr.Wickham ne serait pas un jeune homme respectable.
– Mr. Bingley connaît-il lui-même Mr. Wickham ?
– Non, il l’a vu l’autre matin à Meryton pour lapremière fois.
– Donc les renseignements qu’il vous a donnés luiviennent de Mr. Darcy. Cela me suffit. Je n’éprouve aucundoute quant à la sincérité de Mr. Bingley, maispermettez-moi de ne pas me laisser convaincre par desimples affirmations. Puisque Mr. Bingley ignore unepartie de l’affaire et n’en connaît le reste que par son ami,je préfère m’en tenir à mon sentiment personnel sur lesdeux personnes en question.
Elle prit alors un sujet plus agréable pour toutes deuxet sur lequel elles ne pouvaient manquer de s’entendre.Elizabeth se réjouit d’entendre sa sœur lui exprimerl’espoir joyeux, bien que timide, qu’entretenait en ellel’attitude de Mr. Bingley à son égard, et dit ce qu’elle putpour affermir la confiance de Jane. Puis, comme Mr.Bingley lui-même s’avançait de leur côté, Elizabeth seretira près de miss Lucas. Elle avait à peine eu le tempsde répondre aux questions de son amie sur son dernier
danseur que Mr. Collins les joignit, leur annonçant d’unton joyeux qu’il venait de faire une importantedécouverte.
– Par un hasard singulier j’ai trouvé, dit-il, qu’il y avaitdans ce salon un proche parent de ma bienfaitrice. J’ai, àson insu, entendu ce gentleman prononcer lui-même lenom de sa cousine, miss de Bourgh, et celui de sa mère,lady Catherine, en causant avec la jeune dame qui fait leshonneurs du bal. Que le monde est donc petit ! et quiaurait pu penser que je ferais dans cette réunion larencontre d’un neveu de lady Catherine de Bourgh ! Jesuis bien heureux d’avoir fait cette découverte à tempspour que je puisse aller lui présenter mes respects.J’espère qu’il me pardonnera de ne pas m’être acquittéplus tôt de ce devoir. L’ignorance totale où j’étais de cetteparenté me servira d’excuse.
– Vous n’allez pas aborder Mr. Darcy sans lui avoir étéprésenté ?
– Et pourquoi non ? C’est, si j’ai bien compris, lepropre neveu de lady Catherine. J’aurai le plaisir de luiapprendre que Sa Grâce se portait parfaitement il y a huitjours.
Elizabeth essaya en vain de l’arrêter et de lui fairecomprendre que s’il s’adressait à Mr. Darcy sans lui avoirété présenté, celui-ci considérerait cette démarche plutôtcomme une incorrection que comme un acte de déférenceenvers sa tante. Mr. Collins l’écouta avec l’air d’unhomme décidé à n’en faire qu’à sa tête, et quand elle eut
fini :
– Ma chère miss Elizabeth, dit-il, j’ai la plus hauteopinion de votre excellent jugement pour toutes lesmatières qui sont de votre compétence. Mais permettez-moi de vous faire observer qu’à l’égard de l’étiquette lesgens du monde et le clergé ne sont pas astreints auxmêmes règles. Laissez-moi donc, en la circonstance,suivre les ordres de ma conscience et remplir ce que jeconsidère comme un devoir, et pardonnez-moi de négligervos avis qui, en toute autre occasion, me servironttoujours de guide. – Et, s’inclinant profondément, il laquitta pour aller aborder Mr. Darcy.
Elizabeth le suivit des yeux, curieuse de voir l’accueilqu’il recevrait. L’étonnement de Mr. Darcy fut d’abordmanifeste. Mr. Collins avait préludé par un grand salut et,bien qu’elle fût trop loin pour entendre, Elizabeth croyaittout comprendre et reconnaître, aux mouvements deslèvres, les mots « excuses, Hunsford, lady Catherine deBourgh ». Il lui était pénible de voir son cousin s’exposerainsi à la critique d’un tel homme ; Mr. Darcy regardaitson interlocuteur avec une surprise non dissimulée, et,lorsque celui-ci voulut bien s’arrêter, il répondit avec unair de politesse distante. Ceci ne parut pas décourager Mr.Collins qui se remit à parler de plus belle, mais l’airdédaigneux de Mr. Darcy s’accentuait à mesure que sondiscours s’allongeait. Lorsqu’il eut enfin terminé, Mr.Darcy fit simplement un léger salut et s’éloigna. Mr.Collins revint alors près d’Elizabeth.
– Je suis très satisfait, je vous assure, de la réception
qui m’a été faite. Mr. Darcy a paru beaucoup apprécier ladélicatesse de mon intention et m’a répondu avec la plusgrande courtoisie. Il a même eu l’amabilité de me direqu’il connaissait assez sa tante pour être sûr qu’ellen’accordait pas ses faveurs sans discernement. – Voilàune belle pensée bien exprimée. – En définitive, il meplaît beaucoup.
Elizabeth tourna ensuite toute son attention du côté desa sœur et de Mr. Bingley, et les réflexions agréables quesuscita cet examen la rendirent presque aussi heureuseque sa sœur elle-même. Elle voyait déjà Jane installéedans cette même maison et toute au bonheur que seulepeut donner dans le mariage une véritable affection. Lapensée de Mrs. Bennet suivait visiblement le même cours.Au souper, Elizabeth, qui n’était séparée d’elle que parlady Lucas, eut la mortification d’entendre sa mère parlerouvertement à sa voisine de ses espérances maternelles.Entraînée par son sujet, Mrs. Bennet ne se lassait pasd’énumérer les avantages d’une telle union : un jeunehomme si bien, si riche, n’habitant qu’à trois milles deLongbourn ! dont les sœurs montraient tant d’affectionpour Jane et souhaitaient certainement cette allianceautant qu’elle-même. D’autre part, quel avantage pour lesplus jeunes filles que le beau mariage de leur aînée qui lesaiderait sans doute à trouver elles aussi des partisavantageux. Enfin Mrs. Bennet serait très heureuse depouvoir les confier à la garde de leur sœur et de sedispenser ainsi de les accompagner dans le monde. C’estlà un sentiment qu’il est d’usage d’exprimer en pareillecirconstance, mais il était difficile de se représenter Mrs.
Bennet éprouvant, à n’importe quel âge, une si grandesatisfaction à rester chez elle.
Elizabeth essayait d’arrêter ce flot de paroles ou depersuader à sa mère de mettre une sourdine à sa voix, carelle rougissait à la pensée que Mr. Darcy, qui était assis enface d’elles, ne devait presque rien perdre duchuchotement trop intelligible de Mrs. Bennet, mais celle-ci ne répondit qu’en taxant sa fille d’absurdité.
– Et pour quelle raison dois-je avoir si grand’peur deMr. Darcy, je vous prie ! L’amabilité qu’il nous montrem’oblige-t-elle donc à ne pas prononcer une parole quipuisse avoir le malheur de lui déplaire ?
– Pour l’amour du ciel, ma mère, parlez plus bas. Quelavantage voyez-vous à blesser Mr. Darcy ? Cela ne seracertainement pas une recommandation pour vous auprèsde son ami.
Tout ce que put dire Elizabeth fut absolument inutile ;sa mère continua à parler de ses espoirs d’avenir avecaussi peu de réserve. Rouge de honte et de contrariété,Elizabeth ne pouvait s’empêcher de regarderconstamment dans la direction de Mr. Darcy et chaquecoup d’œil la confirmait dans ses craintes. Il ne regardaitpas Mrs. Bennet, mais son attention certainement étaitfixée sur elle et l’expression de son visage passagraduellement de l’indignation à une froideurdédaigneuse. À la fin, pourtant, Mrs. Bennet n’eut plusrien à dire et lady Lucas, que ces considérations sur unbonheur qu’elle n’était pas appelée à partager faisaient
bâiller depuis longtemps, put enfin savourer en paix sonjambon et son poulet froid.
Elizabeth commençait à respirer, mais cettetranquillité ne fut pas de longue durée. Le souperterminé, on proposa un peu de musique et elle eut l’ennuide voir Mary, qu’on en avait à peine priée, se préparer àcharmer l’auditoire. Du regard, elle tenta de l’endissuader, mais enchantée de cette occasion de seproduire, Mary ne voulut pas comprendre et commençaune romance. Elizabeth l’écouta chanter plusieursstrophes avec une impatience qui ne s’apaisa point à la findu morceau ; car quelqu’un ayant exprimé vaguementl’espoir de l’entendre encore, Mary se remit au piano. Sontalent n’était pas à la hauteur de la circonstance ; sa voixmanquait d’ampleur et son interprétation de naturel.Elizabeth au supplice lança un coup d’œil à Jane poursavoir ce qu’elle en pensait, mais Jane causaittranquillement avec Bingley. Ses yeux se tournèrent alorsvers les deux sœurs qu’elle vit échanger des regardsamusés, vers Mr. Darcy, qui gardait le même sérieuximpénétrable, vers son père, enfin, à qui elle fit signed’intervenir, dans la crainte que Mary ne continuât àchanter toute la nuit. Mr. Bennet comprit et lorsque Maryeut achevé son second morceau, il dit à haute voix :
– C’est parfait, mon enfant. Mais vous nous avezcharmés assez longtemps. Laissez aux autres le temps dese produire à leur tour.
Mary, bien qu’elle fît semblant de n’avoir pas entendu,se montra quelque peu décontenancée et Elizabeth,
contrariée par l’apostrophe de son père, regretta sonintervention.
On invitait maintenant d’autres personnes à se faireentendre.
– Si j’avais le bonheur de savoir chanter, dit Mr.Collins, j’aurais grand plaisir à charmer la compagnie carj’estime que la musique est une distraction innocente etparfaitement compatible avec la profession de clergyman.Je ne veux pas dire, cependant, que nous soyons libresd’y consacrer beaucoup de temps. Le recteur d’uneparoisse est très occupé : quand il a composé ses sermonset rempli les devoirs de sa charge, il lui reste bien peu deloisirs pour les soins à donner à son intérieur qu’il seraitinexcusable de ne pas rendre aussi confortable quepossible. D’autre part, il doit avoir le souci constant de semontrer plein d’égards pour tous, et en particulier pour lafamille de laquelle il tient son bénéfice. C’est uneobligation dont il ne saurait se dispenser et, pour ma part,je ne pourrais juger favorablement celui qui négligeraitune occasion de témoigner son respect à toute personneapparentée à ses bienfaiteurs.
Et par un salut adressé à Mr. Darcy, il conclut cediscours débité assez haut pour être entendu de la moitiédu salon. Plusieurs personnes le regardèrent avecétonnement, d’autres sourirent, mais personne neparaissait plus amusé que Mr. Bennet tandis que safemme, avec un grand sérieux, félicitait Mr. Collins de lasagesse de ses propos et observait à voix basse à ladyLucas que ce jeune homme était fort sympathique et
d’une intelligence remarquable.
Il semblait à Elizabeth que si sa famille avait pristâche, ce soir-là, de se rendre ridicule, elle n’aurait pu lefaire avec plus de succès. Heureusement qu’une partie decette exhibition avait échappé à Mr. Bingley ; mais lapensée que ses deux sœurs et Mr. Darcy n’en avaient pasperdu un détail lui était fort pénible, et elle ne savait sielle souffrait plus du mépris silencieux de l’un ou dessourires moqueurs des deux autres.
Le reste de la soirée offrit peu d’agrément à Elizabeth,agacée par la présence continuelle de Mr. Collins à sescôtés. S’il n’obtint pas d’elle la faveur d’une nouvelledanse, il l’empêcha du moins de danser avec d’autres. Envain lui offrit-elle de le présenter à ses amies ; il l’assuraque la danse le laissait indifférent, que son seul objet étaitde lui être agréable et qu’il se ferait un devoir de lui tenircompagnie toute la soirée. Il n’y avait donc rien à faire.Elizabeth dut son unique soulagement à miss Lucas qui,en se joignant à leur conversation, détourna sur elle-même une partie des discours de Mr. Collins.
Du moins Elizabeth n’eut-elle plus à subir lesattentions de Mr. Darcy. Bien qu’il demeurât longtempsseul à peu de distance de leur groupe, il ne chercha plus àlui adresser la parole. Elizabeth vit dans cette attitude lerésultat de ses allusions à Mr. Wickham et s’en félicita.
Les habitants de Longbourn furent des derniers àprendre congé, et par suite d’une manœuvre de Mrs.Bennet, ils durent attendre leur voiture un quart d’heure
de plus que les autres invités, ce qui leur laissa le tempsde voir combien leur départ était ardemment souhaitépar une partie de leurs hôtes. Mrs. Hurst et sa sœurétaient visiblement impatientes de retrouver leur libertépour aller se coucher, et n’ouvraient la bouche que pourse plaindre de la fatigue, laissant Mrs. Bennet essayersans succès de soutenir la conversation. Mr. Darcy nedisait mot ; Mr. Bingley et Jane, un peu à l’écart,causaient sans s’occuper des autres ; Elizabeth gardait lemême silence que Mrs. Hurst et miss Bingley, et Lydiaelle-même n’avait plus la force que de s’exclamer detemps à autre avec un large bâillement : « Dieu, que jesuis lasse ! »
Quand ils se levèrent enfin pour partir, Mrs. Bennetexprima d’une manière pressante son désir de voirbientôt tous ses hôtes à Longbourn, et s’adressaparticulièrement à Mr. Bingley pour l’assurer du plaisirqu’il leur ferait en venant n’importe quel jour, sansinvitation, partager leur repas de famille. Avec plaisir etreconnaissance, Mr. Bingley promit de saisir la premièreoccasion d’aller lui faire visite après son retour de Londresoù il devait se rendre le lendemain même pour un brefséjour.
Mrs. Bennet était pleinement satisfaite. Elle quitta seshôtes avec l’agréable persuasion que, – en tenant comptedes délais nécessaires pour dresser le contrat etcommander l’équipage et les toilettes de noces, – ellepouvait espérer voir sa fille installée à Netherfield dans undélai de trois ou quatre mois.
XIXLe lendemain amena du nouveau à Longbourn : Mr.
Collins fit sa déclaration. Il n’avait plus de temps à perdre,son congé devant se terminer le samedi suivant ; etcomme sa modestie ne lui inspirait aucune inquiétude quipût l’arrêter au dernier moment, il décida de faire sademande dans les formes qu’il jugeait indispensables danscette circonstance.
Trouvant après le breakfast Mrs. Bennet encompagnie d’Elizabeth et d’une autre de ses filles, il luiparla ainsi :
– Puis-je, madame, solliciter votre bienveillant appuipour obtenir de votre fille, Elizabeth, un entretienparticulier dans le cours de la matinée ?
Avant qu’Elizabeth rougissante eût eu le tempsd’ouvrir la bouche. Mrs. Bennet avait déjà répondu :
– Mais je crois bien ! Je suis sûre qu’Elizabeth nedemande pas mieux. Venez, Kitty, j’ai besoin de vous aupremier. – Et rassemblant son ouvrage, elle se hâtait versla porte, lorsque Elizabeth s’écria :
– Ma mère, ne sortez pas, je vous en prie. Mr. Collinsm’excusera, mais il n’a certainement rien à me dire que
tout le monde ne puisse entendre. Je vais moi-même meretirer.
– Non, non, Lizzy ! Quelle est cette sottise ? Je désireque vous restiez. – Et comme Elizabeth, rouge deconfusion et de colère, continuait à gagner la porte, Mrs.Bennet ajouta : – Lizzy, j’insiste pour que vous restiez etque vous écoutiez ce que Mr. Collins veut vous dire.
La jeune fille ne pouvait résister à une telle injonction :comprenant, après un instant de réflexion, que mieuxvalait en finir au plus vite, elle se rassit et reprit sonouvrage pour se donner une contenance et dissimuler lacontrariété ou l’envie de rire qui la prenaient tour à tour.
La porte était à peine refermée sur Mrs. Bennet etKitty que Mr. Collins commençait :
– Croyez, chère miss Elizabeth, que votre modestie,loin de me déplaire, ne fait à mes yeux qu’ajouter à voscharmes. Vous m’auriez paru moins aimable sans ce petitmouvement de retraite, mais laissez-moi vous assurerque j’ai pour vous parler la permission de votrerespectable mère. Vous vous doutez sûrement du but decet entretien, bien que votre délicatesse vous fassesimuler le contraire. J’ai eu pour vous trop d’attentionspour que vous ne m’ayez pas deviné. À peine avais-jefranchi le seuil de cette maison que je voyais en vous lacompagne de mon existence ; mais avant de me laisseremporter par le flot de mes sentiments, peut-être serait-il plus convenable de vous exposer les raisons qui me fontsonger au mariage et le motif qui m’a conduit en
Hertfordshire pour y chercher une épouse.
L’idée du solennel Mr. Collins « se laissant emporterpar le flot de ses sentiments » parut si comique àElizabeth qu’elle dut faire effort pour ne pas éclater derire et perdit l’occasion d’interrompre cet éloquentdiscours.
– Les raisons qui me déterminent à me marier,continua-t-il, sont les suivantes : premièrement, jeconsidère qu’il est du devoir de tout clergyman de donnerle bon exemple à sa paroisse en fondant un foyer.Deuxièmement, je suis convaincu, ce faisant, de travaillerà mon bonheur. Troisièmement, – j’aurais dû peut-êtrecommencer par là, – je réponds ainsi au désir exprimé parla très noble dame que j’ai l’honneur d’appeler maprotectrice. Par deux fois, et sans que je l’en eusse priée,elle a daigné me faire savoir son opinion à ce sujet. Lesamedi soir qui a précédé mon départ, entre deux partiesde « quadrilles », elle m’a encore dit : « Mr. Collins, il fautvous marier. Un clergyman comme vous doit se marier.Faites un bon choix. Pour ma satisfaction, et pour la vôtre,prenez une fille de bonne famille, active, travailleuse,entendue ; non point élevée dans des idées de grandeurmais capable de tirer un bon parti d’un petit revenu.Trouvez une telle compagne le plus tôt possible, amenez-la à Hunsford, et j’irai lui rendre visite. » Permettez-moi,ma belle cousine, de vous dire en passant que labienveillance de lady Catherine de Bourgh n’est pas undes moindres avantages que je puis vous offrir. Sesqualités dépassent tout ce que je puis vous en dire, et je
crois que votre vivacité et votre esprit lui plairont,surtout s’ils sont tempérés par la discrétion et le respectque son rang ne peut manquer de vous inspirer.
Tels sont les motifs qui me poussent au mariage. Il mereste à vous dire pourquoi je suis venu choisir une femmeà Longbourn plutôt que dans mon voisinage où, je vousassure, il ne manque pas d’aimables jeunes filles ; maisdevant hériter de ce domaine à la mort de votrehonorable père (qui, je l’espère, ne se produira pas d’ici delongues années), je ne pourrais être complètementsatisfait si je ne choisissais une de ses filles afin dediminuer autant que possible le tort que je leur causerailorsque arrivera le douloureux événement. (Dieu veuilleque ce soit le plus tard possible !) Ces raisons, ma chèrecousine, ne me feront pas, je l’espère, baisser dans votreestime. Et maintenant il ne me reste plus qu’à vousexprimer en termes ardents toute la force de messentiments. La question de fortune me laisse indifférent.Je sais que votre père ne peut rien vous donner et quemille livres placées à quatre pour cent sont tout ce quevous pouvez espérer recueillir après la mort de votremère. Je garderai donc le silence le plus absolu sur cechapitre et vous pouvez être sûre que jamais vousn’entendrez sortir de ma bouche un reproche dénué degénérosité lorsque nous serons mariés.
– Vous allez trop vite, monsieur, s’écria Elizabeth.Vous oubliez que je ne vous ai pas encore répondu.Laissez-moi le faire sans plus tarder. Je suis très sensibleà l’honneur que vous me faites par cette proposition et je
vous en remercie, mais il m’est impossible de ne point ladécliner.
– Je sais depuis longtemps, répliqua Mr. Collins avecun geste majestueux, qu’il est d’usage parmi les jeunesfilles de repousser celui qu’elles ont au fond l’intentiond’épouser lorsqu’il se déclare pour la première fois, etqu’il leur arrive de renouveler ce refus une seconde etmême une troisième fois ; c’est pourquoi votre réponse nepeut me décourager, et j’ai confiance que j’aurai avantlongtemps le bonheur de vous conduire à l’autel.
– En vérité, monsieur, cette confiance est plutôtextraordinaire après ce que je viens de vous déclarer ! Jevous affirme que je ne suis point de ces jeunes filles, – sitant est qu’il en existe, – assez imprudentes pour jouerleur bonheur sur la chance de se voir demander uneseconde fois. Mon refus est des plus sincères : vous nepourriez pas me rendre heureuse et je suis la dernièrefemme qui pourrait faire votre bonheur. Bien plus, sivotre amie lady Catherine me connaissait, je suis sûrequ’elle me trouverait fort mal qualifiée pour la situationque vous me proposez.
– Quand bien même, répondit gravement Mr. Collins,l’avis de lady Catherine… Mais je ne puis imaginer SaGrâce vous regardant d’un œil défavorable et soyezcertaine que, lorsque je la reverrai, je lui vanterai avecchaleur votre modestie, votre esprit d’ordre et vos autresaimables qualités.
– Mr. Collins, toutes ces louanges seraient inutiles.
Veuillez m’accorder la liberté de juger pour mon compteet me faire la grâce de croire ce que je vous dis. Jesouhaite vous voir heureux et riche et, en vous refusantma main, je contribue à la réalisation de ce vœu. Lesscrupules respectables que vous exprimiez au sujet de mafamille sont sans objet maintenant que vous m’avezproposé d’être votre femme et vous pourrez, quand letemps viendra, entrer en possession de Longbourn sansvous adresser aucun reproche. Cette question est doncréglée.
Elle s’était levée en prononçant ces derniers mots etallait quitter la pièce quand Mr. Collins l’arrêta par cesmots :
– Lorsque j’aurai l’honneur de reprendre cetteconversation avec vous, j’espère recevoir une réponseplus favorable ; non point que je vous accuse de cruauté etpeut-être même, en faisant la part de la réservehabituelle à votre sexe, en avez-vous dit assez aujourd’huipour m’encourager à poursuivre mon projet.
– En vérité, Mr. Collins, s’écria Elizabeth avec chaleur,vous me confondez ! Si vous considérez tout ce que jeviens de vous dire comme un encouragement, je medemande en quels termes il me faut exprimer mon refuspour vous convaincre que c’en est un !
– Laissez-moi croire, ma chère cousine, que ce refusn’est qu’une simple formalité. Il ne me semble pas que jesois indigne de vous, ni que l’établissement que je vousoffre ne soit pas pour vous des plus enviables. Ma
situation, mes relations avec la famille de Bourgh, maparenté avec votre famille, sont autant de conditionsfavorables à ma cause. En outre, vous devriez considérerqu’en dépit de tous vos attraits vous n’êtes nullementcertaine de recevoir une autre demande en mariage.Votre dot est malheureusement si modeste qu’elle doitinévitablement contre-balancer l’effet de votre charme etde vos qualités. Force m’est donc de conclure que votrerefus n’est pas sérieux, et je préfère l’attribuer au désird’exciter ma tendresse en la tenant en suspens, suivantl’élégante coutume des femmes du monde.
– Soyez sûr, monsieur, que je n’ai aucune prétention àcette sorte d’élégance, qui consiste à faire souffrir unhonnête homme. Je préférerais qu’on me fît lecompliment de croire à ce que je dis. Je vous remerciemille fois de votre proposition, mais il m’est impossible del’accepter ; mes sentiments me l’interdisent absolument.Puis-je parler avec plus de clarté ? Ne me prenez paspour une coquette qui prendrait plaisir à voustourmenter, mais pour une personne raisonnable quiparle en toute sincérité.
– Vous êtes vraiment délicieuse, quoi que vousfassiez ! s’écria-t-il avec une lourde galanterie, et je suispersuadé que ma demande, une fois sanctionnée par lavolonté expresse de vos excellents parents, ne manquerapas de vous paraître acceptable.
Devant cette invincible persistance à vouloir s’abuser,Elizabeth abandonna la partie et se retira en silence.
XXMr. Collins ne resta pas longtemps seul à méditer sur
le succès de sa déclaration. Mrs. Bennet, qui rôdait dans levestibule en attendant la fin de l’entretien, n’eut pas plustôt vu sa fille ouvrir la porte et gagner rapidementl’escalier qu’elle entra dans la salle à manger et félicitaMr. Collins avec chaleur en lui exprimant la joie que luicausait la perspective de leur alliance prochaine. Mr.Collins reçut ces félicitations et y répondit avec autant deplaisir, après quoi il se mit à relater les détails d’uneentrevue dont il avait tout lieu d’être satisfait puisque lerefus que sa cousine lui avait obstinément opposé n’avaitd’autre cause que sa modestie et l’extrême délicatesse deses sentiments.
Ce récit cependant causa quelque trouble à Mrs.Bennet. Elle eût bien voulu partager cette belle assuranceet croire que sa fille, en repoussant Mr. Collins, avait eul’intention de l’encourager. Mais la chose lui paraissait peuvraisemblable et elle ne put s’empêcher de le dire.
– Soyez sûr, Mr. Collins, que Lizzy finira par entendreraison. C’est une fille sotte et entêtée qui ne connaît pointson intérêt ; mais je me charge de le lui faire comprendre.
– Permettez, madame : si votre fille est réellement
sotte et entêtée comme vous le dites, je me demande sielle est la femme qui me convient. Un homme dans masituation désire naturellement trouver le bonheur dansl’état conjugal et si ma cousine persiste à rejeter mademande, peut-être vaudrait-il mieux ne pas essayer dela lui faire agréer de force ; sujette à de tels défauts decaractère, elle ne me paraît pas faite pour assurer mafélicité.
– Monsieur, vous interprétez mal mes paroles, s’écriaMrs. Bennet alarmée. Lizzy ne montre d’entêtement quedans des questions de ce genre. Autrement c’est lameilleure nature qu’on puisse rencontrer. Je vais de cepas trouver Mr. Bennet et nous aurons tôt fait, à nousdeux, de régler cette affaire avec elle.
Et, sans lui donner le temps de répondre, elle seprécipita dans la bibliothèque où se trouvait son mari.
– Ah ! Mr. Bennet, s’exclama-t-elle en entrant, j’aibesoin de vous tout de suite. Venez vite obliger Lizzy àaccepter Mr. Collins. Elle jure ses grands dieux qu’elle neveut pas de lui. Si vous ne vous hâtez pas, il va changerd’avis, et c’est lui qui ne voudra plus d’elle !
Mr. Bennet avait levé les yeux de son livre à l’entréede sa femme et la fixait avec une indifférence tranquilleque l’émotion de celle-ci n’arriva pas à troubler.
– Je n’ai pas l’avantage de vous comprendre, dit-ilquand elle eut fini. De quoi parlez-vous donc ?
– Mais de Lizzy et de Mr. Collins ! Lizzy dit qu’elle neveut pas de Mr. Collins et Mr. Collins commence à dire
qu’il ne veut plus de Lizzy.
– Et que puis-je faire à ce propos ? Le cas me sembleplutôt désespéré.
– Parlez à Lizzy. Dites-lui que vous tenez à ce mariage.
– Faites-la appeler. Je vais lui dire ce que j’en pense.
Mrs. Bennet sonna et donna l’ordre d’avertir missElizabeth qu’on la demandait dans la bibliothèque.
– Arrivez ici, mademoiselle, lui cria son père dèsqu’elle parut. Je vous ai envoyé chercher pour une affaired’importance. Mr. Collins, me dit-on, vous auraitdemandée en mariage. Est-ce exact ?
– Très exact, répondit Elizabeth.
– Vous avez repoussé cette demande ?
– Oui, mon père.
– Fort bien. Votre mère insiste pour que vousl’acceptiez. C’est bien cela, Mrs. Bennet ?
– Parfaitement ; si elle s’obstine dans son refus, je nela reverrai de ma vie.
– Ma pauvre enfant, vous voilà dans une cruellealternative. À partir de ce jour, vous allez devenirétrangère à l’un de nous deux. Votre mère refuse de vousrevoir si vous n’épousez pas Mr. Collins, et je vousdéfends de reparaître devant moi si vous l’épousez.
Elizabeth ne put s’empêcher de sourire à cetteconclusion inattendue ; mais Mrs. Bennet, qui avait
supposé que son mari partageait son sentiment, futexcessivement désappointée.
– Mr. Bennet ! À quoi pensez-vous de parler ainsi ?Vous m’aviez promis d’amener votre fille à la raison !
– Ma chère amie, répliqua son mari, veuillezm’accorder deux faveurs : la première, c’est de mepermettre en cette affaire le libre usage de mon jugement,et la seconde de me laisser celui de ma bibliothèque. Jeserais heureux de m’y retrouver seul le plus tôt possible.
Malgré la défection de son mari, Mrs. Bennet ne serésigna pas tout de suite à s’avouer battue. Elle entrepritElizabeth à plusieurs reprises, la suppliant et la menaçanttour à tour. Elle essaya aussi de se faire une alliée de Jane,mais, avec toute la douceur possible, celle-ci refusad’intervenir. Quant à Elizabeth, tantôt avec énergie,tantôt avec gaieté, elle repoussa tous les assauts,changeant de tactique, mais non de détermination.
Mr. Collins pendant ce temps méditait solitairementsur la situation. La haute opinion qu’il avait de lui-mêmel’empêchait de concevoir les motifs qui avaient poussé sacousine à le refuser et, bien que blessé dans son amour-propre, il n’éprouvait pas un véritable chagrin. Sonattachement pour Elizabeth était un pur effetd’imagination et la pensée qu’elle méritait peut-être lesreproches de sa mère éteignait en lui tout sentiment deregret.
Pendant que toute la famille était ainsi dans ledésarroi, Charlotte Lucas vint pour passer la journée avec
ses amies. Elle fut accueillie dans le hall par Lydia qui seprécipita vers elle en chuchotant :
– Je suis contente que vous soyez venue car il se passeici des choses bien drôles. Devinez ce qui est arrivé cematin : Mr. Collins a offert sa main à Lizzy, et elle l’arefusée !
Charlotte n’avait pas eu le temps de répondre qu’ellesétaient rejointes par Kitty, pressée de lui annoncer lamême nouvelle. Enfin, dans la salle à manger, Mrs.Bennet, qu’elles y trouvèrent seule, reprit le même sujetet réclama l’aide de miss Lucas en la priant d’user de soninfluence pour décider son amie à se plier aux vœux detous les siens.
– Je vous en prie, chère miss Lucas, dit-elle d’une voixplaintive, faites cela pour moi ! Personne n’est de moncôté, personne ne me soutient, personne n’a pitié de mespauvres nerfs.
L’entrée de Jane et d’Elizabeth dispensa Charlotte derépondre.
– Et justement la voici, poursuivit Mrs. Bennet, aussitranquille, aussi indifférente que s’il s’agissait du shah dePerse ! Tout lui est égal, pourvu qu’elle puisse faire sesvolontés. Mais, prenez garde, miss Lizzy, si vous vousentêtez à repousser toutes les demandes qui vous sontadressées, vous finirez par rester vieille fille et je ne saispas qui vous fera vivre lorsque votre père ne sera plus là.Ce n’est pas moi qui le pourrai, je vous en avertis. Je vousai dit tout à l’heure, dans la bibliothèque, que je ne vous
parlerais plus ; vous verrez si je ne tiens point parole. Jen’ai aucun plaisir à causer avec une fille si peu soumise.Non que j’en aie beaucoup à causer avec personne ; lesgens qui souffrent de malaises nerveux comme moi n’ontjamais grand goût pour la conversation. Personne ne saitce que j’endure ! Mais c’est toujours la même chose, on neplaint jamais ceux qui ne se plaignent pas eux-mêmes.
Ses filles écoutaient en silence cette litanie, sachantque tout effort pour raisonner leur mère ou pour lacalmer ne ferait que l’irriter davantage. Enfin leslamentations de Mrs. Bennet furent interrompues parl’arrivée de Mr. Collins qui entrait avec un air plussolennel encore que d’habitude.
Sur un signe, les jeunes filles quittèrent la pièce etMrs. Bennet commença d’une voix douloureuse :
– Mon cher Mr. Collins…
– Ma chère madame, interrompit celui-ci, ne parlonsplus de cette affaire. Je suis bien loin, continua-t-il d’unevoix où perçait le mécontentement, de garder rancune àvotre fille. La résignation à ce qu’on ne peut empêcher estun devoir pour tous, et plus spécialement pour un hommequi a fait choix de l’état ecclésiastique. Ce devoir, je m’ysoumets d’autant plus aisément qu’un doute m’est venusur le bonheur qui m’attendait si ma belle cousine m’avaitfait l’honneur de m’accorder sa main. Et j’ai souventremarqué que la résignation n’est jamais si parfaite quelorsque la faveur refusée commence à perdre à nos yeuxquelque chose de sa valeur. J’espère que vous ne
considérerez pas comme un manque de respect enversvous que je retire mes prétentions aux bonnes grâces devotre fille sans vous avoir sollicités, vous et Mr. Bennet,d’user de votre autorité en ma faveur. Peut-être ai-je eutort d’accepter un refus définitif de la bouche de votre filleplutôt que de la vôtre, mais nous sommes tous sujets ànous tromper. J’avais les meilleures intentions : monunique objet était de m’assurer une compagne aimable,tout en servant les intérêts de votre famille. Cependant, sivous voyez dans ma conduite quelque chose derépréhensible, je suis tout prêt à m’en excuser.
XXILa discussion provoquée par la demande de Mr.
Collins était maintenant close. Elizabeth en gardaitseulement un souvenir pénible et devait encore supporterde temps à autre les aigres allusions de sa mère. Quant ausoupirant malheureux, ses sentiments ne s’exprimaientpoint par de l’embarras ou de la tristesse, mais par uneattitude raide et un silence plein de ressentiment. C’est àpeine s’il s’adressait à Elizabeth, et les attentions dont il lacomblait auparavant se reportèrent sur miss Lucas dontla complaisance à écouter ses discours fut un soulagementpour tout le monde et en particulier pour Elizabeth.
Le lendemain, la santé et l’humeur de Mrs. Bennet neprésentaient aucune amélioration et Mr. Collins, de soncôté, continuait à personnifier l’orgueil blessé. Elizabeths’était flattée de l’espoir que son mécontentement ledéciderait à abréger son séjour, mais ses plans n’enparaissaient nullement affectés ; il s’était toujours proposéde rester jusqu’au samedi et n’entendait pas s’en aller unjour plus tôt.
Après le déjeuner les jeunes filles se rendirent àMeryton pour savoir si Mr. Wickham était de retour.Comme elles entraient dans la ville, elles le rencontrèrentlui-même et il les accompagna jusque chez leur tante où
son regret d’avoir manqué le bal de Netherfield et ladéception que tout le monde en avait éprouvée, furentl’objet de longs commentaires. À Elizabeth pourtant, il nefit aucune difficulté pour avouer que son absence avait étévolontaire.
– À mesure que la date du bal se rapprochait, dit-il,j’avais l’impression de plus en plus nette que je feraismieux d’éviter une rencontre avec Mr. Darcy. Me trouveravec lui dans la même salle, dans la même société pendantplusieurs heures, était peut-être plus que je ne pouvaissupporter ; il aurait pu en résulter des incidents aussidésagréables pour les autres que pour moi-même.
Elizabeth approuva pleinement son abstention. Ilseurent tout le loisir de s’étendre sur ce sujet, carWickham et un de ses camarades reconduisirent lesjeunes filles jusqu’à Longbourn et, pendant le trajet, ils’entretint surtout avec Elizabeth. Touchée d’unempressement aussi flatteur, elle profita de l’occasionpour le présenter à ses parents.
Peu après leur retour, un pli apporté de Netherfieldfut remis à Jane qui l’ouvrit aussitôt. L’enveloppecontenait une feuille d’un charmant papier satinécouverte d’une écriture féminine élégante et déliée.Elizabeth vit que sa sœur changeait de couleur en lisant etqu’elle s’arrêtait spécialement à certains passages de lalettre. Jane, d’ailleurs, reprit vite son sang-froid et sejoignit à la conversation générale avec son entrainhabituel. Mais, dès que Wickham et son compagnonfurent partis, elle fit signe à Elizabeth de la suivre dans
leur chambre. À peine y étaient-elles qu’elle dit en luitendant la lettre :
– C’est de Caroline Bingley, et la nouvelle qu’ellem’apporte n’est pas sans me surprendre. À l’heure qu’ilest ils ont tous quitté Netherfield et sont en route pourLondres, sans idée de retour. Écoutez plutôt.
Elle lut la première phrase qui annonçait la résolutionde ces dames de rejoindre leur frère et de dîner ce mêmesoir à Grosvenor Street, où les Hurst avaient leur maison.La lettre continuait ainsi : « Nous ne regretterons pasgrand’chose du Hertfordshire, à part votre société, chèreamie. Espérons cependant que l’avenir nous réservel’occasion de renouer nos si agréables relations et, qu’enattendant, nous adoucirons l’amertume de l’éloignementpar une correspondance fréquente et pleine d’abandon. »
Cette grande tendresse laissa Elizabeth très froide.Bien que la soudaineté de ce départ la surprît, elle n’yvoyait rien qui valût la peine de s’en affliger. Le fait queces dames n’étaient plus à Netherfield n’empêcheraitvraisemblablement point Mr. Bingley d’y revenir et saprésence, Elizabeth en était persuadée, aurait vite consoléJane de l’absence de ses sœurs.
– C’est dommage, dit-elle après un court silence, quevous n’ayez pu les revoir avant leur départ ; cependant ilnous est peut-être permis d’espérer que l’occasion devous retrouver se présentera plus tôt que miss Bingley nele prévoit. Qui sait si ces rapports d’amitié qu’elle atrouvés si agréables ne se renoueront pas plus intimes
encore ?… Mr. Bingley ne se laissera pas retenirlongtemps à Londres.
– Caroline déclare nettement qu’aucun d’eux nereviendra à Netherfield de tout l’hiver. Voici ce qu’elledit : « Quand mon frère nous a quittés hier, il pensaitpouvoir conclure en trois ou quatre jours l’affaire quil’appelait à Londres, mais c’est certainement impossibleet comme nous sommes convaincus, d’autre part, queCharles, une fois à Londres, ne sera nullement pressé d’enrevenir, nous avons décidé de le rejoindre afin de luiépargner le désagrément de la vie à l’hôtel. Beaucoup denos amis ont déjà regagné la ville pour l’hiver. Comme jeserais heureuse d’apprendre que vous-même, chère amie,vous proposez de faire un tour dans la capitale ! Mais,hélas ! je n’ose y compter. Je souhaite sincèrement que lesfêtes de Noël soient chez vous des plus joyeuses et quevos nombreux succès vous consolent du départ des troisadmirateurs que nous allons vous enlever. »
– Ceci montre bien, conclut Jane, que Mr. Bingley nereviendra pas de cet hiver.
– Ceci montre seulement que miss Bingley ne veut pasqu’il revienne.
– Qu’est-ce qui vous le fait croire ? Mr. Bingley estmaître de ses actes ; c’est de lui que vient sans doutecette décision. Mais attendez le reste. À vous, je ne veuxrien cacher, et je vais vous lire le passage qui me peine leplus. « Mr. Darcy est impatient de retrouver sa sœur et, àvous dire vrai, nous ne le sommes pas moins que lui. Il est
difficile de trouver l’égale de Georgiana Darcy sous lerapport de la beauté, de l’élégance et de l’éducation, et lasympathie que nous avons pour elle, Louisa et moi, estaccrue par l’espérance de la voir un jour devenir notresœur. Je ne sais si je vous ai jamais fait part de nossentiments à cet égard, mais je ne veux pas vous quittersans vous en parler. Mon frère admire beaucoupGeorgiana ; il aura maintenant de fréquentes occasions dela voir dans l’intimité, les deux familles s’accordent pourdésirer cette union et je ne crois pas être aveuglée parl’affection fraternelle en disant que Charles a tout ce qu’ilfaut pour se faire aimer. Avec tant de circonstancesfavorables ai-je tort, ma chère Jane, de souhaiter laréalisation d’un événement qui ferait tant d’heureux ? »
– Que pensez-vous de cette phrase, ma chère Lizzy ?dit Jane en achevant sa lecture, ne dit-elle pas clairementque Caroline n’a aucun désir de me voir devenir sa sœur,qu’elle est tout à fait convaincue de l’indifférence de sonfrère à mon égard et que, si elle soupçonne la nature dessentiments qu’il m’inspire, elle veut très amicalement memettre sur mes gardes ? Peut-on voir autre chose dans ceque je viens de vous lire ?
– Oui, certes, car mon impression est tout à faitdifférente, et la voici en deux mots : miss Bingley s’estaperçue que son frère vous aime alors qu’elle veut luifaire épouser miss Darcy. Elle va le rejoindre afin de leretenir à Londres, et elle essaye de vous persuader qu’ilne pense pas à vous.
Jane secoua la tête.
– Jane, je vous dis la vérité. Tous ceux qui vous ontvue avec Mr. Bingley ne peuvent douter de sessentiments pour vous, – miss Bingley pas plus que lesautres, car elle n’est point sotte. – Si elle pouvait croireque Mr. Darcy éprouve seulement la moitié de cetteaffection pour elle-même, elle aurait déjà commandé sarobe de noce. Mais le fait est que nous ne sommes ni assezriches, ni assez nobles pour eux, et miss Bingley estd’autant plus désireuse de voir son frère épouser missDarcy qu’elle pense qu’une première alliance entre lesdeux familles en facilitera une seconde. Ce n’est pas malcombiné et pourrait après tout réussir si miss de Bourghn’était pas dans la coulisse. Mais voyons, ma chère Jane,si miss Bingley vous raconte que son frère est pleind’admiration pour miss Darcy, ce n’est pas une raisonsuffisante pour croire qu’il soit moins sensible à voscharmes que quand il vous a quittée mardi dernier, niqu’elle puisse lui persuader à son gré que ce n’est pas devous, mais de son amie qu’il est épris.
– Tout ce que vous me dites là pourrait metranquilliser si nous nous faisions la même idée de missBingley, répliqua Jane, mais je suis certaine que vous lajugez injustement. Caroline est incapable de tromperquelqu’un de propos délibéré. Tout ce que je puis espérerde mieux dans le cas présent, c’est qu’elle se trompe elle-même.
– C’est parfait. Du moment que vous ne voulez pas demon explication, vous ne pouviez en trouver unemeilleure. Croyez donc que miss Bingley se trompe, et
que cette supposition charitable vous redonne latranquillité.
– Mais, ma chère Elizabeth, même en mettant tout aumieux, pourrais-je être vraiment heureuse en épousantun homme que ses sœurs et ses amis désirent tant marierà une autre ?
– Cela, c’est votre affaire, et si, à la réflexion, voustrouvez que la douleur de désobliger les deux sœurs estplus grande que la joie d’épouser le frère, je vous conseillevivement de ne plus penser à lui.
– Pouvez-vous parler ainsi, dit Jane avec un faiblesourire. Vous savez bien que malgré la peine que mecauserait leur désapprobation, je n’hésiterais pas. Mais ilest probable que je n’aurai pas à choisir si Mr. Bingley nerevient pas cet hiver. Tant de choses peuvent se produireen six mois !
Les deux sœurs convinrent d’annoncer ce départ àleur mère sans rien ajouter qui pût l’inquiéter sur lesintentions de Mr. Bingley. Cette communicationincomplète ne laissa pas toutefois de contrarier vivementMrs. Bennet, qui déplora ce départ comme une calamité :ne survenait-il pas juste au moment où les deux famillescommençaient à se lier intimement ?
Après s’être répandue quelque temps en doléances,l’idée que Mr. Bingley reviendrait sans doute bientôt etdînerait à Longbourn lui apporta un peu de réconfort. Enl’invitant, elle avait parlé d’un repas de famille, mais elledécida que le menu n’en comporterait pas moins deux
XXIILes Bennet dînaient ce jour-là chez les Lucas et, de
nouveau, miss Lucas eut la patience de servir d’auditriceà Mr. Collins pendant la plus grande partie de la soirée.Elizabeth lui en rendit grâces :
– Vous le mettez ainsi de bonne humeur, dit-elle ; jene sais comment vous en remercier…
Charlotte répondit que le sacrifice de son temps étaitlargement compensé par la satisfaction d’obliger son amie.C’était fort aimable : mais la bonté de Charlotte visaitbeaucoup plus loin que ne le soupçonnait Elizabeth, carson but était de la délivrer d’une admiration importune enprenant tout simplement sa place dans le cœur de Mr.Collins. Quand on se sépara, à la fin de la soirée, l’affaireétait en si bon train que Charlotte se serait crue assuréedu succès si Mr. Collins n’avait pas été à la veille dequitter le Hertfordshire.
Mais elle n’avait pas bien mesuré l’ardeur dessentiments de Mr. Collins et l’indépendance de soncaractère. Car, le lendemain matin, il s’échappait deLongbourn, en dissimulant son dessein avec une habiletéincomparable, et accourait à Lucas Lodge pour se jeter àses pieds. Il désirait surtout éviter d’éveiller l’attention de
ses cousines, persuadé qu’elles ne manqueraient pas desoupçonner ses intentions car il ne voulait pas qu’onapprît sa tentative avant qu’il pût en annoncer l’heureuxrésultat. Bien que se sentant assez tranquille, – carCharlotte avait été passablement encourageante, – il setenait quand même sur ses gardes depuis son aventuredu mercredi précédent.
L’accueil qu’il reçut cependant fut des plus flatteurs.D’une fenêtre du premier étage miss Lucas l’aperçut quise dirigeait vers la maison et elle se hâta de sortir pour lerencontrer accidentellement dans le jardin, mais jamaiselle n’aurait pu imaginer que tant d’amour et d’éloquencel’attendait au bout de l’allée.
En aussi peu de temps que le permirent les longsdiscours de Mr. Collins, tout était réglé entre les deuxjeunes gens à leur mutuelle satisfaction et, comme ilsentraient dans la maison, Mr. Collins suppliait déjàCharlotte de fixer le jour qui mettrait le comble à safélicité. Si une telle demande ne pouvait être exaucée sur-le-champ, l’objet de sa flamme ne manifestait du moinsaucune inclination à différer son bonheur. L’inintelligencedont la nature avait gratifié Mr. Collins n’était pas pourfaire souhaiter des fiançailles prolongées avec un telsoupirant, et miss Lucas, qui l’avait accepté dans le seuldésir de s’établir honorablement, se souciait assez peuque la date du mariage fût plus ou moins proche.
Le consentement de sir William et de lady Lucasdemandé aussitôt, fut accordé avec un empressementjoyeux. La situation de Mr. Collins faisait de lui un parti
avantageux pour leur fille dont la dot était modeste tandisque les espérances de fortune du jeune homme étaientfort belles.
Avec un intérêt qu’elle n’avait encore jamais éprouvé,lady Lucas se mit tout de suite à calculer combiend’années Mr. Bennet pouvait bien avoir encore à vivre, etsir William déclara que lorsque son gendre serait enpossession du domaine de Longbourn, il ferait bien de sefaire présenter à la cour avec sa femme. Bref, toute lafamille était ravie ; les plus jeunes filles voyaient dans cemariage l’occasion de faire un peu plus tôt leur entréedans le monde, et les garçons se sentaient délivrés de lacrainte de voir Charlotte mourir vieille fille.
Charlotte elle-même était assez calme. Parvenue à sesfins, elle examinait maintenant le fruit de sa victoire, etses réflexions étaient, somme toute, satisfaisantes. Mr.Collins n’avait évidemment ni intelligence ni charme, saconversation était ennuyeuse et dans l’ardeur de sessentiments il entrait sans doute moins d’amour qued’imagination, mais, tel qu’il était, c’était un mari ; or,sans se faire une très haute idée des hommes, CharlotteLucas avait toujours eu la vocation et le désir de semarier. Elle voyait dans le mariage la seule situationconvenable pour une femme d’éducation distinguée et defortune modeste, car, s’il ne donnait pas nécessairementle bonheur, il mettait du moins à l’abri des difficultésmatérielles. Arrivée à l’âge de vingt-sept ans et n’ayantjamais été jolie, elle appréciait à sa valeur la chance quis’offrait à elle.
Ce qui la gênait le plus, c’était la surprise qu’elle allaitcauser à Elizabeth Bennet dont l’amitié lui étaitparticulièrement chère. Elizabeth s’étonnerait sûrement,la blâmerait peut-être et, si sa résolution ne devait pas enêtre ébranlée, elle pourrait du moins se sentir blessée parla désapprobation de sa meilleure amie. Elle résolut de luifaire part elle-même de l’événement et quand Mr. Collins,à l’heure du dîner, se mit en devoir de retourner àLongbourn, elle le pria de ne faire aucune allusion à leursfiançailles devant la famille Bennet. La promesse d’êtrediscret fut naturellement donnée avec beaucoup desoumission, mais elle ne fut pas tenue sans difficulté, lacuriosité éveillée par la longue absence de Mr. Collins semanifestant à son retour par des questions tellementdirectes qu’il lui fallut beaucoup d’ingéniosité pour leséluder toutes, ainsi que beaucoup d’abnégation pourdissimuler un triomphe qu’il brûlait de publier.
Comme il devait partir le lendemain matin de trèsbonne heure, la cérémonie des adieux eut lieu le soir, aumoment où les dames allaient se retirer.
Mrs. Bennet, toute politesse et cordialité, dit combienils seraient très heureux de le revoir lorsque lescirconstances le permettraient.
– Chère madame, répondit-il, cette invitation m’estd’autant plus agréable que je la souhaitais vivement etvous pouvez être sûre que j’en profiterai aussitôt qu’il mesera possible.
Un étonnement général accueillit ces paroles, et Mr.
Bennet, à qui la perspective d’un retour aussi rapide nesouriait nullement, se hâta de dire :
– Mais êtes-vous bien sûr, mon cher monsieur,d’obtenir l’approbation de lady Catherine ? Mieuxvaudrait négliger un peu votre famille que courir le risquede mécontenter votre protectrice.
– Cher monsieur, répliqua Mr. Collins, laissez-moivous remercier de ce conseil amical. Soyez certain que jene prendrais pas une décision aussi importante sansl’assentiment de Sa Grâce.
– Certes, vous ne pouvez lui marquer trop dedéférence. Risquez tout plutôt que son mécontentement,et si jamais votre visite ici devait le provoquer, demeurezen paix chez vous et soyez persuadé que nous n’en seronsnullement froissés.
– Mon cher monsieur, tant d’attention excite magratitude et vous pouvez compter recevoir bientôt unelettre de remerciements pour toutes les marques desympathie dont vous m’avez comblé pendant mon séjourici. Quant à mes aimables cousines, bien que mon absencedoive être sans doute de courte durée, je prendsmaintenant la liberté de leur souhaiter santé et bonheur…sans faire d’exception pour ma cousine Elizabeth.
Après quelques paroles aimables, Mrs. Bennet et sesfilles se retirèrent, surprises de voir qu’il méditait unaussi prompt retour à Longbourn. Mrs. Bennet auraitaimé en déduire qu’il songeait à l’une de ses plus jeunesfilles, et Mary se serait laissé persuader de l’accepter :
plus que ses sœurs elle appréciait ses qualités et goûtaitses réflexions judicieuses ; encouragé par un exemplecomme le sien à développer sa culture, elle estimait qu’ilpourrait faire un très agréable compagnon. Le lendemainmatin vit s’évanouir cet espoir. Miss Lucas, arrivée peuaprès le breakfast, prit Elizabeth à part et lui raconta cequi s’était passé la veille.
Que Mr. Collins se crût épris de son amie, l’idée enétait déjà venue à Elizabeth au cours des deux journéesprécédentes, mais que Charlotte eût pu l’encourager, lachose lui paraissait inconcevable. Elle fut tellementabasourdie, qu’oubliant toute politesse elle s’écria :
– Fiancée à Mr. Collins ? Ma chère Charlotte, c’estimpossible !
Le calme avec lequel Charlotte avait pu parler jusque-là fit place à une confusion momentanée devant un blâmeaussi peu déguisé. Mais elle reprit bientôt son sang-froidet répliqua paisiblement :
– Pourquoi cette surprise, ma chère Eliza ? Trouvez-vous si incroyable que Mr. Collins puisse obtenir la faveurd’une femme parce qu’il n’a pas eu la chance de gagner lavôtre ?
Mais Elizabeth s’était déjà reprise et, avec un peud’effort, put assurer son amie que la perspective de leurprochaine parenté lui était très agréable, et qu’elle luisouhaitait toutes les prospérités imaginables.
– Je devine votre sentiment, répondit Charlotte. Mr.Collins ayant manifesté si récemment le désir de vous
épouser il est naturel que vous éprouviez un étonnementtrès vif. Cependant, quand vous aurez eu le temps d’yréfléchir, je crois que vous m’approuverez. Vous savezque je ne suis pas romanesque, – je ne l’ai jamais été, – unfoyer confortable est tout ce que je désire ; or, enconsidérant l’honorabilité de Mr. Collins, ses relations, sasituation sociale, je suis convaincue d’avoir en l’épousantdes chances de bonheur que tout le monde ne trouve pasdans le mariage.
– Sans aucun doute, répondit Elizabeth, et après unepause un peu gênée, toutes deux rejoignirent le reste de lafamille. Charlotte ne resta pas longtemps et, après sondépart, Elizabeth se mit à réfléchir sur ce qu’elle venaitd’apprendre. Que Mr. Collins pût faire deux demandes enmariage en trois jours était à ses yeux moins étrange quede le voir agréé par son amie. Elizabeth avait toujourssenti que les idées de Charlotte sur le mariage différaientdes siennes, mais elle n’imaginait point que, le momentvenu, elle serait capable de sacrifier les sentiments lesplus respectables à une situation mondaine et à desavantages matériels. Charlotte mariée à Mr. Collins !Quelle image humiliante ! Au regret de voir son amie sediminuer ainsi dans son estime s’ajoutait la convictionpénible qu’il lui serait impossible de trouver le bonheurdans le lot qu’elle s’était choisi.
XXIIIElizabeth qui travaillait en compagnie de sa mère et de
ses sœurs se demandait si elle était autorisée à leurcommuniquer ce qu’elle venait d’apprendre, lorsque sirWilliam Lucas lui-même fit son entrée, envoyé par sa fillepour annoncer officiellement ses fiançailles à toute lafamille. Avec force compliments, et en se félicitant pourson compte personnel de la perspective d’une allianceentre les deux maisons, il leur fit part de la nouvelle quiprovoqua autant d’incrédulité que de surprise. Mrs.Bennet, avec une insistance discourtoise, protesta qu’ildevait faire erreur, tandis que Lydia, toujours étourdie,s’exclamait bruyamment :
– Grand Dieu ! sir William, que nous contez-vous là ?Ne savez-vous donc pas que Mr. Collins veut épouserLizzy ?
Il fallait toute la politesse d’un homme de cour poursupporter un pareil assaut. Sir William, néanmoins, touten priant ces dames de croire à sa véracité, sut écouterleurs peu discrètes protestations de la meilleure grâce dumonde.
Elizabeth, sentant qu’elle devait lui venir en aide dansune aussi fâcheuse situation, intervint pour dire qu’elle
connaissait déjà la nouvelle par Charlotte et s’efforça demettre un terme aux exclamations de sa mère et de sessœurs en offrant à sir William de cordiales félicitationsauxquelles se joignirent celles de Jane ; puis elle s’étenditen diverses considérations sur le bonheur futur deCharlotte, l’honorabilité de Mr. Collins, et la courtedistance qui séparait Hunsford de Londres. Mrs. Bennetétait tellement stupéfaite qu’elle ne trouva plus rien à direjusqu’au départ de sir William ; mais, dès qu’il se futretiré, elle donna libre cours au flot tumultueux de sessentiments. Elle commença par s’obstiner dans sonincrédulité, puis elle affirma que Mr. Collins s’était laissé« entortiller » par Charlotte, elle déclara ensuite que ceménage ne serait pas heureux et, pour finir, annonça larupture prochaine des fiançailles. Deux choses, cependant,se dégageaient clairement de ces discours : Elizabeth étaitla cause de tout le mal, et elle, Mrs. Bennet, avait étéindignement traitée. Elle médita tout le jour ces deuxpoints. Rien ne pouvait la consoler et la journée ne suffitpas à calmer son ressentiment. De toute la semaine elle neput voir Elizabeth sans lui renouveler ses reproches ; il luifallut plus d’un mois pour reprendre vis-à-vis de sirWilliam et de lady Lucas une attitude suffisammentcorrecte, et il s’écoula beaucoup plus de temps encoreavant qu’elle parvînt à pardonner à leur fille.
Mr. Bennet accueillit la nouvelle avec plus de sérénité.Il lui plaisait, dit-il, de constater que Charlotte Lucas, qu’ilavait toujours considérée comme une fille raisonnable,n’avait pas plus de bon sens que sa femme et en avaitcertainement moins que sa fille.
Entre Elizabeth et Charlotte, une gêne subsistait quiles empêchait toutes deux d’aborder ce chapitre.Elizabeth sentait bien qu’il ne pouvait plus y avoir entreelles la même confiance. Désappointée par Charlotte, ellese tourna avec plus d’affection vers sa sœur sur ladroiture et la délicatesse de laquelle elle savait pouvoirtoujours compter, mais elle devenait chaque jour plusanxieuse au sujet de son bonheur, car Bingley était partidepuis plus d’une semaine et il n’était pas question de sonretour. Jane avait répondu tout de suite à Caroline etcomptait dans combien de jours elle pouvaitraisonnablement espérer une nouvelle lettre.
Les remerciements annoncés par Mr. Collinsarrivèrent le mardi. Adressée à Mr. Bennet, sa lettreexprimait avec emphase sa gratitude aussi profonde ques’il eût fait un séjour de toute une année dans la familleBennet. Ce devoir accompli, Mr. Collins annonçait entermes dithyrambiques le bonheur qu’il avait eu deconquérir le cœur de leur aimable voisine et révélait quec’était avec le dessein de se rapprocher d’elle qu’il avaitaccepté si volontiers leur aimable invitation : il pensaitdonc faire sa réapparition à Longbourn quinze jours plustard. Lady Catherine, ajoutait-il, approuvait sicomplètement son mariage qu’elle désirait le voir célébrerle plus tôt possible et il comptait sur cet argumentpéremptoire pour décider l’aimable Charlotte à fixerrapidement le jour qui ferait de lui le plus heureux deshommes. Le retour de Mr. Collins ne pouvait plus causeraucun plaisir à Mrs. Bennet. Au contraire, tout autant queson mari, elle le trouvait le plus fâcheux du monde.
son mari, elle le trouvait le plus fâcheux du monde.N’était-il pas étrange que Mr. Collins vînt à Longbourn aulieu de descendre chez les Lucas ? C’était fort gênant ettout à fait ennuyeux. Elle n’avait pas besoin de voir deshôtes chez elle avec sa santé fragile et encore moins desfiancés qui, de tous, sont les gens les plus désagréables àrecevoir. Ainsi murmurait Mrs. Bennet, et ces plaintes necessaient que pour faire place à l’expression plus amèredu chagrin que lui causait l’absence prolongée de Mr.Bingley. Cette absence inquiétait aussi Jane et Elizabeth.Les jours s’écoulaient sans apporter de nouvelles, sinoncelle qui commençait à circuler à Meryton qu’on ne lereverrait plus de tout l’hiver à Netherfield. Elizabeth elle-même commençait à craindre que Mr. Bingley ne se fûtlaissé retenir à Londres par ses sœurs. Malgré sarépugnance à admettre une supposition qui ruinait lebonheur de sa sœur et donnait une idée si médiocre de laconstance de Bingley, elle ne pouvait s’empêcher depenser que les efforts réunis de deux sœurs insensibles etd’un ami autoritaire, joints aux charmes de miss Darcy etaux plaisirs de Londres, pourraient bien avoir raison deson attachement pour Jane.
Quant à cette dernière, l’incertitude lui était, cela vade soi, encore plus pénible qu’à Elizabeth. Mais quels quefussent ses sentiments, elle évitait de les laisser voir etc’était un sujet que les deux sœurs n’abordaient jamaisensemble.
Mr. Collins revint ponctuellement quinze jours plustard comme il l’avait annoncé et s’il ne fut pas reçu àLongbourn aussi chaudement que la première fois, il était
trop heureux pour s’en apercevoir. Du reste, ses devoirsde fiancé le retenaient presque toute la journée chez lesLucas et il ne rentrait souvent que pour s’excuser de salongue absence à l’heure où ses hôtes regagnaient leurschambres.
Mrs. Bennet était vraiment à plaindre. La moindreallusion au mariage de Mr. Collins la mettait hors d’elle et,partout où elle allait, elle était sûre d’en entendre parler.La vue de miss Lucas lui était devenue odieuse, elle nepouvait, sans horreur, penser qu’elle lui succéderait àLongbourn et, le cœur plein d’amertume, elle fatiguait sonmari de ses doléances.
– Oui, Mr. Bennet, il est trop dur de penser queCharlotte Lucas sera un jour maîtresse de cette maison etqu’il me faudra m’en aller pour lui céder la place.
– Chère amie, écartez ces pensées funèbres. Flattons-nous plutôt de l’espoir que je vous survivrai.
Mais cette consolation semblait un peu mince à Mrs.Bennet qui, sans y répondre, continuait :
– Je ne puis supporter l’idée que tout ce domaine luiappartiendra. Ah ! s’il n’y avait pas cet « entail », commecela me serait égal !
– Qu’est-ce qui vous semblerait égal ?
– Tout le reste.
– Rendons grâce au ciel, alors, de vous avoir préservéed’une telle insensibilité.
– Jamais, Mr. Bennet, je ne rendrai grâce pour ce quitouche à ce maudit « entail ». Qu’on puisse prendre desdispositions pareilles pour frustrer ses filles de leur bien,c’est une chose que je ne pourrai jamais comprendre. Ettout cela pour les beaux yeux de Mr. Collins, encore !Pourquoi lui plutôt qu’un autre ?
– Je vous laisse le soin de résoudre le problème, ditMr. Bennet.
XXIVLa lettre de miss Bingley arriva et mit fin à tous les
doutes. Dès la première phrase elle confirmait la nouvellede leur installation à Londres pour tout l’hiver ettransmettait les regrets de Mr. Bingley de n’avoir pu allerprésenter ses respects à ses voisins avant de quitter lacampagne. Il fallait donc renoncer à tout espoir et quandJane eut le courage d’achever sa lettre, à part lesprotestations d’amitié de Caroline, elle n’y trouva rien quipût la réconforter. Les louanges de miss Darcy enoccupaient la plus grande partie : miss Bingley se félicitaitde leur intimité croissante et prévoyait l’accomplissementdes désirs secrets qu’elle avait révélés à son amie dans salettre précédente. Elle racontait avec satisfaction que sonfrère fréquentait beaucoup chez Mr. Darcy et décrivaitavec transports les plans de celui-ci pour lerenouvellement de son mobilier.
Elizabeth à qui Jane communiqua le principal de salettre écouta, silencieuse et pleine d’indignation, le cœurpartagé entre la pitié qu’elle éprouvait pour sa sœur et leressentiment que lui inspiraient les Bingley. Ellen’attachait aucune valeur à ce que disait Caroline surl’admiration de son frère pour miss Darcy ; de latendresse de celui-ci pour Jane elle n’avait jamais douté
et n’en doutait pas encore, mais elle ne pouvait sanscolère, à peine sans mépris, songer à ce manque dedécision qui faisait de lui actuellement le jouet desintrigues des siens et l’amenait à sacrifier son bonheur àleurs préférences. Et s’il ne s’agissait que de son bonheur !… libre à lui d’en disposer. Mais celui de Jane aussi étaiten jeu et il ne pouvait l’ignorer.
Un jour ou deux se passèrent avant que Jane eût lecourage d’aborder ce sujet avec Elizabeth, mais uneaprès-midi où sa mère avait plus encore que d’habitudeépanché son irritation contre le maître de Netherfield, ellene put s’empêcher de dire :
– Comme je souhaiterais que notre mère eût un peuplus d’empire sur elle-même ! Elle ne se doute pas de lapeine qu’elle me cause avec ses allusions continuelles àMr. Bingley. Mais je ne veux pas me plaindre. Tout celapassera et nous nous retrouverons comme auparavant.
Elizabeth, sans répondre, regarda sa sœur avec unetendresse incrédule.
– Vous ne me croyez pas ! s’écria Jane en rougissant ;vous avez tort. Il restera dans ma mémoire commel’homme le plus aimable que j’aie connu. Mais c’est tout.Je n’ai rien à lui reprocher ; – Dieu soit loué de m’avoir,du moins, évité ce chagrin. – Aussi, dans un peu detemps… je serai certainement capable de me ressaisir.
Elle ajouta bientôt d’une voix plus ferme :
– J’ai pour l’instant cette consolation : tout ceci n’a étéqu’une erreur de mon imagination et n’a pu faire de mal
qu’à moi-même.
– Jane, ma chérie, vous êtes trop généreuse, s’exclamaElizabeth. Votre douceur, votre désintéressement sontvraiment angéliques. Je ne sais que vous dire. Il mesemble que je ne vous ai jamais rendu justice ni montrétoute la tendresse que vous méritiez.
Jane repoussa ces éloges avec force et se mit en retourà louer la chaude affection de sa sœur.
– Non, dit Elizabeth, ce n’est pas juste. Vous voulez nevoir partout que du bien ; vous êtes contrariée si je porteun jugement sévère, et quand je vous déclare parfaitevous protestez. Oh ! ne craignez pas que j’exagère ou quej’empiète sur votre privilège de juger favorablement toutl’univers. Plus je vais et moins le monde me satisfait.Chaque jour me montre davantage l’instabilité descaractères et le peu de confiance qu’on peut mettre dansles apparences de l’intelligence et du mérite. Je viens d’enavoir deux exemples. De l’un, je ne parlerai pas ; l’autre,c’est le mariage de Charlotte. N’est-il pas inconcevable àtous les points de vue ?
– Ma chère Lizzy, ne vous laissez pas aller à dessentiments de ce genre. Vous ne tenez pas assez comptedes différences de situation et de caractère. Considérezseulement l’honorabilité de Mr. Collins et l’esprit sensé etprudent de Charlotte. Souvenez-vous qu’elle appartient àune nombreuse famille, que ce mariage, sous le rapport dela fortune, est très avantageux, et, par égard pour tousdeux, efforcez-vous de croire que Charlotte peut
vraiment éprouver quelque chose comme de l’estime etde l’affection pour notre cousin.
– Je croirai n’importe quoi pour vous faire plaisir, maisje me demande qui, hormis vous, en bénéficiera. Si jepouvais me persuader que Charlotte aime notre cousin, ilme faudrait juger son esprit aussi sévèrement que je jugeson cœur. Vous ne pouvez nier, ma chère Jane, que Mr.Collins ne soit un être prétentieux, pompeux et ridicule, etvous sentez forcément comme moi que la femme quiconsent à l’épouser manque de jugement. Vous ne pouvezdonc la défendre, même si elle s’appelle Charlotte Lucas.
– Je trouve seulement que vous exprimez votrepensée en termes trop sévères, et vous en serezconvaincue, je l’espère, en les voyant heureux ensemble.Mais laissons ce sujet. Vous avez parlé de « deux »exemples et je vous ai bien comprise. Je vous en prie, machère Lizzy, n’ajoutez pas à ma peine en jugeant unecertaine personne digne de blâme et en déclarant qu’elle aperdu votre estime. Il ne faut pas se croire si vite victimed’une offense volontaire ; nous ne devons pas attendred’un jeune homme gai et plein d’entrain tant de prudenceet de circonspection. Bien souvent c’est votre proprevanité qui vous égare, et les femmes croient trouver dansl’admiration qu’elles excitent beaucoup de choses qui n’ysont pas.
– Et les hommes font bien ce qu’ils peuvent pour leleur faire croire.
– S’ils le font sciemment, ils sont impardonnables.
Mais je ne puis voir partout d’aussi noirs calculs.
– Je suis loin de charger Mr. Bingley d’une telleaccusation. Mais sans avoir de mauvaise intention on peutmal agir et être une cause de chagrin. Il suffit pour celad’être insouciant, de ne pas tenir assez compte dessentiments des autres, ou de manquer de volonté.
– Laquelle de ces trois choses reprochez-vous à Mr.Bingley ?
– La dernière.
– Vous persistez alors à supposer que ses sœurs ontessayé de l’influencer ?
– Oui, et son ami également.
– C’est une chose que je ne puis croire. Elles nepeuvent souhaiter que son bonheur, et, s’il m’aime,aucune autre femme ne pourra le rendre heureux.
– Elles peuvent souhaiter bien d’autres choses que sonbonheur ! Elles peuvent souhaiter pour lui plus derichesse et de considération ; elles peuvent souhaiter luivoir épouser une jeune fille qui lui apporte à la fois de lafortune et de hautes relations.
– Sans aucun doute elles souhaitent lui voir épousermiss Darcy. Mais cela peut venir d’un meilleur sentimentque vous ne pensez. La connaissant depuis plus longtempsque moi, il est naturel qu’elles me la préfèrent. Cependantsi elles croyaient qu’il m’aime, elles ne chercheraient pas ànous séparer, et, s’il m’aimait, elles ne pourraient yréussir. Pour croire qu’il m’aime, il faut supposer que tout
le monde agit mal et cette idée me rend malheureuse. Aucontraire, je n’éprouve nulle honte à reconnaître que jeme suis trompée. Laissez-moi donc voir l’affaire sous cejour qui me paraît être le véritable.
Elizabeth ne pouvait que se rendre au désir de sa sœuret entre elles, à partir de ce jour, le nom de Mr. Bingley nefut plus que rarement prononcé.
La société de Mr. Wickham fut précieuse pour dissiperle voile de tristesse que ces malencontreux événementsavaient jeté sur Longbourn. On le voyait souvent et à sesautres qualités s’ajoutait maintenant un abandon qui lerendait encore plus aimable. Tout ce qu’Elizabeth avaitappris de ses démêlés avec Mr. Darcy était devenupublic : on en parlait un peu partout et l’on se plaisait àremarquer que Mr. Darcy avait paru antipathique à toutle monde avant même que personne fût au courant decette affaire. Jane était la seule à supposer qu’il pouvaitexister des faits ignorés de la société de Meryton. Dans sacandeur charitable, elle plaidait toujours les circonstancesatténuantes, et alléguait la possibilité d’une erreur, maistous les autres s’accordaient pour condamner Mr. Darcyet le déclarer le plus méprisable des hommes.
XXVAprès une semaine passée à exprimer son amour et à
faire des rêves de bonheur, l’arrivée du samedi arrachaMr. Collins à son aimable Charlotte. Le chagrin de laséparation, toutefois, allait être allégé de son côté par lespréparatifs qu’il avait à faire pour la réception de la jeuneépouse car il avait tout lieu d’espérer que le jour dumariage serait fixé à son prochain retour enHertfordshire. Il prit congé des habitants de Longbournavec autant de solennité que la première fois, renouvelases vœux de santé et de bonheur à ses belles cousines etpromit à leur père une autre lettre de remerciements.
Le lundi suivant, Mrs. Bennet eut le plaisir de recevoirson frère et sa belle-sœur qui venaient comme àl’ordinaire passer la Noël à Longbourn. Mr. Gardiner étaitun homme intelligent et de bonnes manières, infinimentsupérieur à sa sœur tant par les qualités naturelles quepar l’éducation. Les dames de Netherfield auraient eupeine à croire qu’un homme qui était dans le commercepouvait être aussi agréable et aussi distingué. Mrs.Gardiner, plus jeune que Mrs. Bennet, était une femmeaimable, élégante et fine que ses nièces de Longbournaimaient beaucoup. Les deux aînées surtout lui étaientunies par une vive affection, et elles faisaient de fréquents
séjours à Londres chez leur tante.
Le premier soin de Mrs. Gardiner fut de distribuer lescadeaux qu’elle avait apportés et de décrire les dernièresmodes de Londres. Ceci fait, son rôle devint moins actif etce fut alors son tour d’écouter. Mrs. Bennet avaitbeaucoup de griefs à raconter, beaucoup de plaintes àexhaler depuis leur dernière rencontre, sa famille avait eubien de la malchance. Deux de ses filles avaient été sur lepoint de se marier et, finalement, les deux projets avaientéchoué.
– Je ne blâme pas Jane, ajoutait-elle : ce n’est pas safaute si l’affaire a manqué. Mais Lizzy !… Oh ! ma sœur, ilest tout de même dur de penser qu’elle pourrait à l’heurequ’il est s’appeler « Mrs. Collins », n’eût été sondéplorable entêtement. Il l’a demandée en mariage danscette pièce même, et elle l’a refusé ! Le résultat, c’est quelady Lucas aura une fille mariée avant moi et que lapropriété de Longbourn sortira de la famille. Les Lucassont des gens fort habiles, ma sœur, et disposés às’emparer de tout ce qui est à leur portée : je regrette dele dire, mais c’est la pure vérité. Quant à moi, cela merend malade d’être contrecarrée de la sorte par les mienset d’avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmesavant de penser aux autres ; mais votre arrivée est unvéritable réconfort, et je suis charmée de ce que vous medites au sujet des manches longues.
Mrs. Gardiner, qui avait déjà été mise au courant desfaits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth,répondit brièvement à sa belle-sœur et, par amitié pour
ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit lesujet un peu plus tard, quand elle se trouva seule avecElizabeth.
– Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane,dit-elle, et je suis bien fâchée que la chose en soit restéelà, mais il n’est pas rare de voir un jeune homme tel quevous me dépeignez Mr. Bingley s’éprendre soudain d’unejolie fille et, si le hasard vient à les séparer, l’oublier aussivite.
– Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth,mais, dans notre cas, le hasard n’est point responsable, etil est assez rare qu’un jeune homme de fortuneindépendante se laisse persuader par les siens d’oublierune jeune fille dont il était violemment épris quelquesjours auparavant.
– Cette expression de « violemment épris » est à lafois si vague et si rebattue qu’elle ne me représente pasgrand’chose. On l’emploie aussi bien pour un sentimentpassager, né d’une simple rencontre, que pour unattachement réel et profond. S’il vous plaît, comment semanifestait ce violent amour de Mr. Bingley ?
– Je n’ai jamais vu une inclination aussi pleine depromesses. Il ne voyait que Jane et ne faisait plusattention à personne. Au bal qu’il a donné chez lui, il afroissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter àdanser, et moi-même ce jour-là je lui ai adressé deux foisla parole sans qu’il eût l’air de m’entendre. Est-ilsymptôme plus significatif ? Le fait d’être impoli envers
tout le monde n’est-il pas chez un homme la marquemême de l’amour !
– Oui… de cette sorte d’amour qu’éprouvait sansdoute Mr. Bingley. Pauvre Jane ! j’en suis fâchée pourelle ; avec sa nature il lui faudra longtemps pour seremettre. Si vous aviez été à sa place, Lizzy, votre gaietévous aurait aidée à réagir plus vite. Mais pensez-vous quenous pourrions décider Jane à venir à Londres avecnous ? Un changement lui ferait du bien, et quitter un peusa famille serait peut-être pour elle le remède le plussalutaire.
Elizabeth applaudit à cette proposition, sûre que Janel’accepterait volontiers.
– J’espère, ajouta Mrs. Gardiner, qu’aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l’arrêtera. Noushabitons un quartier tout différent, nous n’avons pas lesmêmes relations, et nous sortons peu, comme vous lesavez. Il est donc fort peu probable qu’ils se rencontrent,à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir.
– Oh ! cela, c’est impossible, car il est maintenant sousla garde de son ami, et Mr. Darcy ne lui permettracertainement pas d’aller rendre visite à Jane dans un telquartier. Ma chère tante, y pensez-vous ? Mr. Darcy apeut-être entendu parler d’une certaine rue qu’on appelleGracechurch Street, mais un mois d’ablutions luisemblerait à peine suffisant pour s’en purifier si jamais il ymettait les pieds et, soyez-en sûre, Mr. Bingley ne sortjamais sans lui.
– Tant mieux. J’espère qu’ils ne se rencontreront pasdu tout. Mais Jane n’est-elle pas en correspondance avecla sœur ? Elle ne pourra résister au désir d’aller la voir.
– Elle laissera, je pense, tomber cette relation.
Tout en faisant cette déclaration avec la mêmeassurance qu’elle avait prédit que Mr. Bingley n’auraitpas la permission d’aller voir Jane, Elizabeth ressentait aufond d’elle-même une anxiété qui, à la réflexion, luiprouva qu’elle ne jugeait pas l’affaire absolumentdésespérée. Après tout il était possible, – elle allait mêmejusqu’à se dire probable, – que l’amour de Mr. Bingley seréveillât, et que l’influence des siens se trouvât moinsforte que le pouvoir plus naturel des attraits qui l’avaientcharmé.
Jane accepta l’invitation de sa tante avec plaisir et, sielle pensa aux Bingley, ce fut simplement pour se direque, Caroline n’habitant pas avec son frère, elle pourrait,sans risquer de le rencontrer, passer quelquefois unematinée avec elle.
Les Gardiner restèrent une semaine à Longbourn, etentre les Philips, les Lucas, et les officiers de la milice, iln’y eut pas une journée sans invitation. Mrs. Bennet avaitsi bien pourvu à la distraction de son frère et de sa belle-sœur qu’ils ne dînèrent pas une seule fois en famille. Sil’on passait la soirée à la maison, il ne manquait jamais d’yavoir comme convives quelques officiers et parmi eux Mr.Wickham. Dans ces occasions, Mrs. Gardiner, mise enéveil par la sympathie avec laquelle Elizabeth lui avait
parlé de ce dernier, les observait tous deux avecattention. Sans les croire très sérieusement épris l’un del’autre, le plaisir évident qu’ils éprouvaient à se voir suffità l’inquiéter un peu, et elle résolut de représenter avantson départ à Elizabeth l’imprudence qu’il y aurait àencourager un tel sentiment.
Indépendamment de ses qualités personnelles,Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Mrs.Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité uncertain temps la région dont il était lui-même originaire,dans le Derbyshire. Ils avaient donc beaucoup deconnaissances communes et, bien qu’il eût quitté le paysdepuis cinq ans, il pouvait lui donner de ses relationsd’autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu’ellepossédait elle-même.
Mrs. Gardiner avait vu Pemberley, jadis, et avaitbeaucoup entendu parler du père de Mr. Darcy. C’était làun inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir àcomparer ses souvenirs de Pemberley avec la descriptionminutieuse qu’en faisait Wickham et à dire son estimepour l’ancien propriétaire. Son interlocuteur ne semontrait pas moins charmé qu’elle par cette évocation dupassé. Lorsqu’il lui raconta la façon dont l’avait traité lefils elle essaya de se rappeler ce qu’on disait de celui-ci autemps où il n’était encore qu’un jeune garçon et, enfouillant dans sa mémoire, il lui sembla avoir entendu direque le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfantextrêmement orgueilleux et désagréable.
XXVIMrs. Gardiner saisit la première occasion favorable
pour donner doucement à Elizabeth l’avertissementqu’elle jugeait nécessaire. Après lui avoir dit franchementce qu’elle pensait, elle ajouta :
– Vous êtes, Lizzy, une fille trop raisonnable pour vousattacher à quelqu’un simplement parce que l’on cherche àvous en détourner, c’est pourquoi je ne crains pas de vousparler avec cette franchise. Très sérieusement, jevoudrais que vous vous teniez sur vos gardes : ne vouslaissez pas prendre, – et ne laissez pas Mr. Wickham seprendre, – aux douceurs d’une affection que le manqueabsolu de fortune de part et d’autre rendraitsingulièrement imprudente. Je n’ai rien à dire contre lui ;c’est un garçon fort sympathique, et s’il possédait laposition qu’il mérite, je crois que vous ne pourriez mieuxchoisir, mais, la situation étant ce qu’elle est, il vaut mieuxne pas laisser votre imagination s’égarer. Vous avezbeaucoup de bon sens et nous comptons que vous saurezen user. Votre père a toute confiance dans votre jugementet votre fermeté de caractère ; n’allez pas lui causer unedéception.
– Ma chère tante, voilà des paroles bien sérieuses !
– Oui, et j’espère vous décider à être sérieuse, vousaussi.
– Eh bien ! Rassurez-vous, je vous promets d’être surmes gardes, et Mr. Wickham ne s’éprendra pas de moi sije puis l’en empêcher.
– Elizabeth, vous n’êtes pas sérieuse en ce moment.
– Je vous demande pardon ; je vais faire tous mesefforts pour le devenir. Pour l’instant je ne suis pasamoureuse de Mr. Wickham. Non, très sincèrement, je nele suis pas, mais c’est, sans comparaison, l’homme le plusagréable que j’aie jamais rencontré, et, s’il s’attachait àmoi… Non, décidément, il vaut mieux que cela n’arrivepas ; je vois quel en serait le danger. – Oh ! cet horribleMr. Darcy ! – L’estime de mon père me fait grandhonneur, et je serais très malheureuse de la perdre. Monpère, cependant, a un faible pour Mr. Wickham. Enrésumé, ma chère tante, je serais désolée de vous faire dela peine, mais puisque nous voyons tous les jours que lesjeunes gens qui s’aiment se laissent rarement arrêter parle manque de fortune, comment pourrais-je m’engager àme montrer plus forte que tant d’autres en cas detentation ? Comment, même, pourrais-je être sûre qu’ilest plus sage de résister ? Aussi, tout ce que je puis vouspromettre, c’est de ne rien précipiter, de ne pas me hâterde croire que je suis l’unique objet des pensées de Mr.Wickham. En un mot, je ferai de mon mieux.
– Peut-être serait-il bon de ne pas l’encourager àvenir aussi souvent ; tout au moins pourriez-vous ne pas
suggérer à votre mère de l’inviter.
– Comme je l’ai fait l’autre jour, dit Elizabeth qui sourità l’allusion. C’est vrai, il serait sage de m’en abstenir. Maisne croyez pas que ses visites soient habituellement aussifréquentes ; c’est en votre honneur qu’on l’a invité sisouvent cette semaine. Vous connaissez les idées de mamère sur la nécessité d’avoir continuellement du mondepour distraire ses visiteurs. En toute sincérité, j’essaieraide faire ce qui me semblera le plus raisonnable. Etmaintenant, j’espère que vous voilà satisfaite.
Sur la réponse affirmative de sa tante, Elizabeth laremercia de son affectueux intérêt et ainsi se terminal’entretien, – exemple bien rare d’un avis donné enpareille matière sans blesser le personnage qui le reçoit.
Mr. Collins revint en Hertfordshire après le départ desGardiner et de Jane, mais comme il descendit cette foischez les Lucas, son retour ne gêna pas beaucoup Mrs.Bennet. Le jour du mariage approchant, elle s’était enfinrésignée à considérer l’événement comme inévitable, etallait jusqu’à dire d’un ton désagréable qu’elle « souhaitaitqu’ils fussent heureux ».
Le mariage devant avoir lieu le jeudi, miss Lucas vintle mercredi à Longbourn pour faire sa visite d’adieu.Lorsqu’elle se leva pour prendre congé, Elizabeth, confusede la mauvaise grâce de sa mère et de ses souhaitsdépourvus de cordialité, sortit de la pièce en même tempsque Charlotte pour la reconduire. Comme ellesdescendaient ensemble, celle-ci lui dit :
– Je compte recevoir souvent de vos nouvelles,Elizabeth.
– Je vous le promets.
– Et j’ai une autre faveur à vous demander, celle devenir me voir.
– Nous nous rencontrerons souvent ici, je l’espère.
– Il est peu probable que je quitte le Kent d’ici quelquetemps. Promettez-moi donc de venir à Hunsford.
Elizabeth ne pouvait refuser, bien que la perspectivede cette visite la séduisît peu au premier abord.
– Mon père et Maria doivent venir me faire visite enmars. Vous consentirez, je l’espère, à les accompagner, etvous serez accueillie aussi chaudement qu’eux-mêmes.
Le mariage eut lieu. Les mariés partirent pour le Kentau sortir de l’église, et dans le public on échangea lespropos habituels en de telles circonstances.
Les premières lettres de Charlotte furent accueilliesavec empressement. On se demandait naturellement aveccuriosité comment elle parlerait de sa nouvelle demeure,de lady Catherine, et surtout de son bonheur. Les lettreslues, Elizabeth vit que Charlotte s’exprimait sur chaquepoint exactement comme elle l’avait prévu. Elle écrivaitavec beaucoup de gaieté, semblait jouir d’une existencepleine de confort et louait tout ce dont elle parlait : lamaison, le mobilier, les voisins, les routes ne laissaientrien à désirer et lady Catherine se montrait extrêmementaimable et obligeante. Dans tout cela on reconnaissait les
descriptions de Mr. Collins sous une forme plus tempérée.Elizabeth comprit qu’il lui faudrait attendre d’aller àHunsford pour connaître le reste.
Jane avait déjà écrit quelques lignes pour annoncerqu’elle avait fait bon voyage, et Elizabeth espérait que saseconde lettre parlerait un peu des Bingley. Cet espoir eutle sort de tous les espoirs en général. Au bout d’unesemaine passée à Londres, Jane n’avait ni vu Caroline, nirien reçu d’elle. Ce silence, elle l’expliquait en supposantque sa dernière lettre écrite de Longbourn s’était perdue.« Ma tante, continuait-elle, va demain dans leur quartier,et j’en profiterai pour passer à Grosvenor Street. »
La visite faite, elle écrivit de nouveau : elle avait vumiss Bingley. « Je n’ai pas trouvé à Caroline beaucoupd’entrain, disait-elle, mais elle a paru très contente de mevoir et m’a reproché de ne pas lui avoir annoncé monarrivée à Londres. Je ne m’étais donc pas trompée ; ellen’avait pas reçu ma dernière lettre. J’ai naturellementdemandé des nouvelles de son frère : il va bien, mais esttellement accaparé par Mr. Darcy que ses sœurs le voientà peine. J’ai appris au cours de la conversation qu’ellesattendaient miss Darcy à dîner ; j’aurais bien aimé la voir.Ma visite n’a pas été longue parce que Caroline et Mrs.Hurst allaient sortir. Je suis sûre qu’elles ne tarderont pasà me la rendre. »
Elizabeth hocha la tête en lisant cette lettre. Il étaitévident qu’un hasard seul pouvait révéler à Mr. Bingley laprésence de sa sœur à Londres.
Un mois s’écoula sans que Jane entendît parler de lui.Elle tâchait de se convaincre que ce silence la laissaitindifférente mais il lui était difficile de se faire encoreillusion sur les sentiments de miss Bingley. Après l’avoirattendue de jour en jour pendant une quinzaine, en luitrouvant chaque soir une nouvelle excuse, elle la vit enfinapparaître. Mais la brièveté de sa visite, et surtout lechangement de ses manières, lui ouvrirent cette fois lesyeux. Voici ce qu’elle écrivit à ce propos à sa sœur :
« Vous êtes trop bonne, ma chère Lizzy, j’en suis sûre,pour vous glorifier d’avoir été plus perspicace que moiquand je vous confesserai que je m’étais complètementabusée sur les sentiments de miss Bingley à mon égard.Mais, ma chère sœur, bien que les faits vous donnentraison, ne m’accusez pas d’obstination si j’affirme qu’étantdonnées ses démonstrations passées, ma confiance étaitaussi naturelle que vos soupçons. Je ne comprends pas dutout pourquoi Caroline a désiré se lier avec moi ; et si lesmêmes circonstances se représentaient, il serait possibleque je m’y laisse prendre de nouveau. C’est hierseulement qu’elle m’a rendu ma visite, et jusque-là elle nem’avait pas donné le moindre signe de vie. Il était visiblequ’elle faisait cette démarche sans plaisir : elle s’estvaguement excusée de n’être pas venue plus tôt, n’a pasdit une parole qui témoignât du désir de me revoir et m’aparu en tout point tellement changée que lorsqu’elle estpartie j’étais parfaitement résolue à laisser tomber nosrelations. Je ne puis m’empêcher de la blâmer et de laplaindre à la fois. Elle a eu tort de me témoigner tantd’amitié, – car je puis certifier que toutes les avances sont
venues d’elle. Mais je la plains, cependant, parce qu’elledoit sentir qu’elle a mal agi et que sa sollicitude pour sonfrère en est la cause. Je n’ai pas besoin de m’expliquerdavantage. Je suis étonnée seulement que ses craintessubsistent encore à l’heure qu’il est ; car si son frère avaitpour moi la moindre inclination, il y a longtemps qu’ilaurait tâché de me revoir. Il sait certainement que je suisà Londres ; une phrase de Caroline me l’a laissé àentendre.
« Je n’y comprends rien. J’aurais presque envie dedire qu’il y a dans tout cela quelque chose de louche, si jene craignais de faire un jugement téméraire. Mais je vaisessayer de chasser ces pensées pénibles pour me souvenirseulement de ce qui peut me rendre heureuse : votreaffection, par exemple, et l’inépuisable bonté de mononcle et de ma tante. Écrivez-moi bientôt. Miss Bingleym’a fait comprendre que son frère ne retournerait pas àNetherfield et résilierait son bail, mais sans rien dire deprécis. N’en parlons pas, cela vaut mieux.
« Je suis très heureuse que vous ayez de bonnesnouvelles de vos amis de Hunsford. Il faut que vous alliezles voir avec sir William et Maria. Vous ferez là-bas, j’ensuis sûre, un agréable séjour. À vous affectueusement. »
Cette lettre causa quelque peine à Elizabeth, mais ellese réconforta bientôt par la pensée que Jane avait cesséd’être dupe de miss Bingley. Du frère, il n’y avait plus rienà espérer ; un retour à ses premiers sentiments nesemblait même plus souhaitable à Elizabeth, tant il avaitbaissé dans son estime. Son châtiment serait d’épouser
bientôt miss Darcy qui, sans doute, si Wickham avait dit lavérité, lui ferait regretter amèrement ce qu’il avaitdédaigné.
À peu près vers cette époque, Mrs. Gardiner rappela àsa nièce ce qu’elle lui avait promis au sujet de Wickham etréclama d’être tenue au courant. La réponse que fitElizabeth était de nature à satisfaire sa tante plutôtqu’elle-même. La prédilection que semblait lui témoignerWickham avait disparu ; son empressement avait cessé ;ses soins avaient changé d’objet. Elizabeth s’en rendaitcompte mais pouvait constater ce changement sans enéprouver un vrai chagrin. Son cœur n’avait été quelégèrement touché, et la conviction que seule la questionde fortune l’avait empêchée d’être choisie suffisait àsatisfaire son amour-propre. Un héritage inattendu de dixmille livres était le principal attrait de la jeune fille à qui,maintenant, s’adressaient ses hommages, mais Elizabeth,moins clairvoyante ici, semblait-il, que, dans le cas deCharlotte, n’en voulait point à Wickham de la prudence deses calculs. Au contraire, elle ne trouvait rien de plusnaturel, et, tout en supposant qu’il avait dû lui en coûterun peu de renoncer à son premier rêve, elle était prête àapprouver la sagesse de sa conduite et souhaitaitsincèrement qu’il fût heureux.
Elizabeth disait en terminant sa lettre à Mrs.Gardiner :
« Je suis convaincue maintenant, ma chère tante, quemes sentiments pour lui n’ont jamais été bien profonds,autrement son nom seul me ferait horreur et je lui
souhaiterais toutes sortes de maux ; or, non seulement jeme sens pour lui pleine de bienveillance, mais encore jen’en veux pas le moins du monde à miss King et nedemande qu’à lui reconnaître beaucoup de qualités. Toutceci ne peut vraiment pas être de l’amour ; ma vigilance aproduit son effet. Certes, je serais plus intéressante sij’étais folle de chagrin, mais je préfère, somme toute, lamédiocrité de mes sentiments. Kitty et Lydia prennentplus à cœur que moi la défection de Mr. Wickham. Ellessont jeunes, et l’expérience ne leur a pas encore apprisque les jeunes gens les plus aimables ont besoin d’argentpour vivre, tout aussi bien que les autres. »
XXVIISans autre événement plus notable que des
promenades à Meryton, tantôt par la boue et tantôt par lagelée, janvier et février s’écoulèrent.
Mars devait amener le départ d’Elizabeth pourHunsford. Tout d’abord, elle n’avait pas songésérieusement à s’y rendre, mais bientôt, s’étant renducompte que Charlotte comptait véritablement sur savisite, elle en vint à envisager elle-même ce voyage avecun certain plaisir. L’absence avait excité chez elle le désirde revoir son amie et atténué en même temps sonantipathie pour Mr. Collins. Ce séjour mettrait un peu devariété dans son existence, et, comme avec sa mère et sessœurs d’humeur si différente, la maison n’était pastoujours un paradis, un peu de changement serait, aprèstout, le bienvenu. Elle aurait de plus l’occasion de voirJane au passage. Bref, à mesure que le jour du départapprochait, elle eût été bien fâchée que le voyage fûtremis.
Tout s’arrangea le mieux du monde, et selon lespremiers plans de Charlotte. Elizabeth devait partir avecsir William et sa seconde fille ; son plaisir fut completlorsqu’elle apprit qu’on s’arrêterait une nuit à Londres.
Les adieux qu’elle échangea avec Mr. Wickham furentpleins de cordialité, du côté de Mr. Wickham toutparticulièrement. Ses projets actuels ne pouvaient lui faireoublier qu’Elizabeth avait été la première à attirer sonattention, la première à écouter ses confidences avecsympathie, la première à mériter son admiration. Aussi,dans la façon dont il lui souhaita un heureux séjour, en luirappelant quel genre de personne elle allait trouver enlady Catherine de Bourgh, et en exprimant l’espoir que làcomme ailleurs leurs opinions s’accorderaient toujours, ily avait un intérêt, une sollicitude à laquelle Elizabeth futextrêmement sensible, et, en le quittant, elle garda laconviction que, marié ou célibataire, il resterait toujours àses yeux le modèle de l’homme aimable.
La distance jusqu’à Londres n’était que de vingt-quatre milles et, partis dès le matin, les voyageurs purentêtre chez les Gardiner à Gracechurch street vers midi.Jane qui les guettait à une fenêtre du salon s’élança pourles accueillir dans le vestibule. Le premier regardd’Elizabeth fut pour scruter anxieusement le visage de sasœur et elle fut heureuse de constater qu’elle avait bonnemine et qu’elle était aussi fraîche et jolie qu’à l’ordinaire.Sur l’escalier se pressait toute une bande de petitsgarçons et de petites filles impatientes de voir leurcousine ; l’atmosphère était joyeuse et accueillante, et lajournée se passa très agréablement, l’après-midi dans lesmagasins et la soirée au théâtre.
Elizabeth s’arrangea pour se placer à côté de sa tante.Elles commencèrent naturellement par s’entretenir de
Jane, et Elizabeth apprit avec plus de peine que desurprise que sa sœur, malgré ses efforts pour se dominer,avait encore des moments d’abattement. Mrs. Gardinerdonna aussi quelques détails sur la visite de miss Bingleyet rapporta plusieurs conversations qu’elle avait euesavec Jane, qui prouvaient que la jeune fille avait renoncé àcette relation d’une façon définitive.
Mrs. Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur l’infidélitéde Wickham et la félicita de prendre les choses d’une âmesi tranquille.
– Mais comment est donc cette miss King ? Il meserait pénible de penser que notre ami ait l’âme vénale.
– Pourriez-vous me dire, ma chère tante, quelle est ladifférence entre la vénalité et la prudence ? Où finit l’uneet où commence l’autre ? À Noël, vous aviez peur qu’il nem’épousât ; vous regardiez ce mariage comme uneimprudence, et maintenant qu’il cherche à épouser unejeune fille pourvue d’une modeste dot de dix mille livres,vous voilà prête à le taxer de vénalité !
– Dites-moi seulement comment est miss King, jesaurai ensuite ce que je dois penser.
– C’est, je crois, une très bonne fille. Je n’ai jamaisentendu rien dire contre elle.
– Mais Mr. Wickham ne s’était jamais occupé d’ellejusqu’au jour où elle a hérité cette fortune de son grand-père ?
– Non ; pourquoi l’aurait-il fait ? S’il ne lui était point
permis de penser à moi parce que je n’avais pas d’argent,comment aurait-il pu être tenté de faire la cour à unejeune fille qui n’en avait pas davantage et qui par surcroîtlui était indifférente ?
– Il semble peu délicat de s’empresser auprès d’ellesitôt après son changement de fortune.
– Un homme pressé par le besoin d’argent n’a pas letemps de s’arrêter à des convenances que d’autres ont leloisir d’observer. Si miss King n’y trouve rien à redire,pourquoi serions-nous choquées ?
– L’indulgence de miss King ne le justifie point. Celaprouve seulement que quelque chose lui manque aussi,bon sens ou délicatesse.
– Eh bien ! s’écria Elizabeth, qu’il en soit comme vousle voulez, et admettons une fois pour toutes qu’elle estsotte, et qu’il est, lui, un coureur de dot.
– Non, Lizzy, ce n’est pas du tout ce que je veux. Ilm’est pénible de porter ce jugement sévère sur un jeunehomme originaire du Derbyshire.
– Oh ! quant à cela, j’ai une assez pauvre opinion desjeunes gens du Derbyshire ; et leurs intimes amis duHertfordshire ne valent pas beaucoup mieux. Je suisexcédée des uns et des autres, Dieu merci ! Je vais voirdemain un homme totalement dépourvu de sens,d’intelligence et d’éducation, et je finis par croire que cesgens-là seuls sont agréables à fréquenter !
– Prenez garde, Lizzy, voilà un discours qui sent fort le
désappointement.
Avant la fin de la représentation, Elizabeth eut leplaisir très inattendu de se voir inviter par son oncle et satante à les accompagner dans le voyage d’agrément qu’ilsprojetaient pour l’été suivant.
– Nous n’avons pas encore décidé où nous irons. Peut-être dans la région des Lacs.
Nul projet ne pouvait être plus attrayant pourElizabeth et l’invitation fut acceptée avec empressementet reconnaissance.
– Ô ma chère tante, s’écria-t-elle ravie, vous metransportez de joie ! Quelles heures exquises nouspasserons ensemble ! Adieu, tristesses et déceptions !Nous oublierons les hommes en contemplant lesmontagnes !
XXVIIIDans le voyage du lendemain, tout parut nouveau et
intéressant à Elizabeth. Rassurée sur la santé de Jane parsa belle mine et ravie par la perspective de son voyagedans le Nord, elle se sentait pleine d’entrain et de gaieté.
Quand on quitta la grand’route pour prendre lechemin de Hunsford, tous cherchèrent des yeux lepresbytère, s’attendant à le voir surgir à chaque tournant.Leur route longeait d’un côté la grille de Rosings Park.Elizabeth sourit en se souvenant de tout ce qu’elle avaitentendu au sujet de sa propriétaire.
Enfin, le presbytère apparut. Le jardin descendantjusqu’à la route, les palissades vertes, la haie de lauriers,tout annonçait qu’on était au terme du voyage. Mr. Collinset Charlotte se montrèrent à la porte, et la voitures’arrêta devant la barrière, séparée de la maison par unecourte avenue de lauriers.
Mrs. Collins reçut son amie avec une joie si vivequ’Elizabeth, devant cet accueil affectueux, se félicitaencore davantage d’être venue. Elle vit tout de suite quele mariage n’avait pas changé son cousin et que sapolitesse était toujours aussi cérémonieuse. Il la retintplusieurs minutes à la porte pour s’informer de toute sa
famille, puis après avoir, en passant, fait remarquer le belaspect de l’entrée, il introduisit ses hôtes sans plus dedélai dans la maison.
Au salon, il leur souhaita une seconde fois la bienvenuedans son modeste presbytère et répéta ponctuellementles offres de rafraîchissements que sa femme faisait auxvoyageurs.
Elizabeth s’attendait à le voir briller de tout son éclat,et, pendant qu’il faisait admirer les belles proportions dusalon, l’idée lui vint qu’il s’adressait particulièrement àelle comme s’il souhaitait de lui faire sentir tout ce qu’elleavait perdu en refusant de l’épouser. Il lui eût été difficilepourtant d’éprouver le moindre regret, et elle s’étonnaitplutôt que son amie, vivant avec un tel compagnon, pûtavoir l’air aussi joyeux. Toutes les fois que Mr. Collinsproférait quelque sottise, – et la chose n’était pas rare, –les yeux d’Elizabeth se tournaient involontairement verssa femme. Une ou deux fois, elle crut surprendre sur sonvisage une faible rougeur, mais la plupart du temps,Charlotte, très sagement, avait l’air de ne pas entendre.
Après avoir tenu ses visiteurs assez longtemps pourleur faire admirer en détail le mobilier, depuis le bahutjusqu’au garde-feu, et entendre le récit de leur voyage,Mr. Collins les emmena faire le tour du jardin qui étaitvaste, bien dessiné, et qu’il cultivait lui-même. Travaillerdans son jardin était un de ses plus grands plaisirs.Elizabeth admira le sérieux avec lequel Charlotte vantaitla salubrité de cet exercice et reconnaissait qu’elleencourageait son mari à s’y livrer le plus possible. Mr.
Collins les conduisit dans toutes les allées et leur montratous les points de vue avec une minutie qui en faisaitoublier le pittoresque. Mais de toutes les vues que sonjardin, la contrée et même le royaume pouvaient offrir,aucune n’était comparable à celle du manoir de Rosingsqu’une trouée dans les arbres du parc permettaitd’apercevoir presque en face du presbytère. C’était un belédifice de construction moderne, fort bien situé sur uneéminence.
Après le jardin, Mr. Collins voulut leur faire faire letour de ses deux prairies, mais les dames, qui n’étaientpoint chaussées pour affronter les restes d’une geléeblanche, se récusèrent, et tandis qu’il continuait sapromenade avec sir William, Charlotte ramena sa sœur etson amie à la maison, heureuse sans doute de pouvoir laleur faire visiter sans l’aide de son mari. Petite, mais bienconstruite, elle était commodément agencée et tout y étaitorganisé avec un ordre et une intelligence dont Elizabethattribua tout l’honneur à Charlotte. Cette demeure,évidemment, était fort plaisante à condition d’en oublierle maître, et en voyant à quel point Charlotte se montraitsatisfaite, Elizabeth conclut qu’elle l’oubliait souvent.
On avait tout de suite prévenu les arrivants que ladyCatherine était encore à la campagne. On reparla d’elle audîner et Mr. Collins observa :
– Oui, miss Elizabeth, vous aurez l’honneur de voirlady Catherine de Bourgh dimanche prochain, etcertainement elle vous charmera. C’est l’aménité et labienveillance en personne, et je ne doute pas qu’elle n’ait
la bonté de vous adresser la parole à l’issue de l’office. Jene crois pas m’avancer en vous annonçant qu’elle vouscomprendra ainsi que ma sœur Maria dans les invitationsqu’elle nous fera pendant votre séjour ici. Sa manièred’être à l’égard de ma chère Charlotte est des plusaimables : nous dînons à Rosings deux fois par semaine, etjamais Sa Grâce ne nous laisse revenir à pied : sa voitureest toujours prête pour nous ramener ; – je devrais direune de ses voitures, car Sa Grâce en a plusieurs.
– Lady Catherine est une femme intelligente etrespectable, appuya Charlotte, et c’est pour nous unevoisine remplie d’attentions.
– Très juste, ma chère amie ; je le disais à l’instant.C’est une personne pour laquelle on ne peut avoir trop dedéférence.
La soirée se passa tout entière à parler duHertfordshire. Une fois retirée dans la solitude de sachambre, Elizabeth put méditer à loisir sur le bonheurdont semblait jouir son amie. À voir avec quel calmeCharlotte supportait son mari, avec quelle adresse elle legouvernait, Elizabeth fut obligée de reconnaître qu’elles’en tirait à merveille.
Dans l’après-midi du jour suivant, pendant qu’elles’habillait pour une promenade, un bruit soudain parutmettre toute la maison en rumeur ; elle entenditquelqu’un monter précipitamment l’escalier en l’appelantà grands cris. Elle ouvrit la porte et vit sur le palier Mariahors d’haleine.
– Elizabeth, venez vite voir quelque chosed’intéressant ! Je ne veux pas vous dire ce que c’est.Dépêchez-vous et descendez tout de suite à la salle àmanger !
Sans pouvoir obtenir un mot de plus de Maria, elledescendit rapidement avec elle dans la salle à manger, quidonnait sur la route, et, de là, vit deux dames dans unpetit phaéton arrêté à la barrière du jardin.
– C’est tout cela ! s’exclama Elizabeth. Je pensais pourle moins que toute la basse-cour avait envahi le jardin, etvous n’avez à me montrer que lady Catherine et sa fille !
– Oh ! ma chère, dit Maria scandalisée de sa méprise,ce n’est pas lady Catherine, c’est miss Jenkins, la dame decompagnie, et miss de Bourgh. Regardez-la. Quelle petitepersonne ! Qui aurait pu la croire si mince et si chétive ?
– Quelle impolitesse de retenir Charlotte dehors parun vent pareil ! Pourquoi n’entre-t-elle pas ?
– Charlotte dit que cela ne lui arrive presque jamais.C’est une véritable faveur quand miss de Bourgh consentà entrer.
– Son extérieur me plaît, murmura Elizabeth dont lapensée était ailleurs. Elle a l’air maussade et maladive.Elle lui conviendra très bien ; c’est juste la femme qu’il luifaut.
Mr. Collins et Charlotte étaient tous les deux à laporte, en conversation avec ces dames, sir William deboutsur le perron ouvrait de grands yeux en contemplant ce
noble spectacle, et, au grand amusement d’Elizabeth,saluait chaque fois que miss de Bourgh regardait de soncôté.
Enfin, ces dames repartirent, et tout le monde rentradans la maison. Mr. Collins, en apercevant les jeunes filles,les félicita de leur bonne fortune et Charlotte expliquaqu’ils étaient tous invités à dîner à Rosings pour lelendemain.
XXIXMr. Collins exultait.
– J’avoue, dit-il, que je m’attendais un peu à ce que SaGrâce nous demandât d’aller dimanche prendre le thé etpasser la soirée avec elle. J’en étais presque sûr, tant jeconnais sa grande amabilité. Mais qui aurait pu imaginerque nous recevrions une invitation à dîner, – uneinvitation pour tous les cinq, – si tôt après votre arrivée ?
– C’est une chose qui me surprend moins, répliqua sirWilliam, ma situation m’ayant permis de me familiariseravec les usages de la haute société. À la cour, les exemplesd’une telle courtoisie ne sont pas rares.
On ne parla guère d’autre chose ce jour-là et pendantla matinée qui suivit. Mr. Collins s’appliqua à préparer seshôtes aux grandeurs qui les attendaient afin qu’ils nefussent pas trop éblouis par la vue des salons, le nombredes domestiques et la magnificence du dîner. Quand lesdames montèrent pour s’apprêter, il dit à Elizabeth :
– Ne vous faites pas de souci, ma chère cousine, ausujet de votre toilette. Lady Catherine ne réclamenullement de vous l’élégance qui sied à son rang et à celuide sa fille. Je vous conseille simplement de mettre ce quevous avez de mieux. Faire plus serait inutile. Ce n’est pas
votre simplicité qui donnera de vous une moins bonneopinion à lady Catherine ; elle aime que les différencessociales soient respectées.
Pendant qu’on s’habillait, il vint plusieurs fois auxportes des différentes chambres pour recommander defaire diligence, car lady Catherine n’aimait pas qu’onretardât l’heure de son dîner.
Tous ces détails sur lady Catherine et ses habitudesfinissaient par effrayer Maria, et sir William n’avait pasressenti plus d’émotion lorsqu’il avait été présenté à lacour que sa fille n’en éprouvait à l’idée de passer le seuildu château de Rosings.
Comme le temps était doux, la traversée du parc futune agréable promenade. Chaque parc a sa beautépropre ; ce qu’Elizabeth vit de celui de Rosings l’enchanta,bien qu’elle ne pût manifester un enthousiasme égal àcelui qu’attendait Mr. Collins et qu’elle accueillît avec unelégère indifférence les renseignements qu’il lui donnait surle nombre des fenêtres du château et la somme que sirLewis de Bourgh avait dépensée jadis pour les faire vitrer.
La timidité de Maria augmentait à chaque marche duperron et sir William lui-même paraissait un peu troublé.
Après avoir passé le grand hall d’entrée, dont Mr.Collins en termes lyriques fit remarquer les bellesproportions et la décoration élégante, ils traversèrent uneantichambre et le domestique les introduisit dans la pièceoù se trouvait lady Catherine en compagnie de sa fille etde Mrs. Jenkinson. Avec une grande condescendance, Sa
Grâce se leva pour les accueillir et comme Mrs. Collinsavait signifié à son mari qu’elle se chargeait desprésentations, tout se passa le mieux du monde. Malgréson passage à la cour, sir William était tellementimpressionné par la splendeur qui l’entourait qu’il eutjuste assez de présence d’esprit pour faire un profondsalut et s’asseoir sans mot dire. Sa fille, à moitié morte depeur, s’assit sur le bord d’une chaise, ne sachant de quelcôté partager ses regards. Elizabeth, au contraire, avaittout son sang-froid et put examiner avec calme les troispersonnes qu’elle avait devant elle.
Lady Catherine était grande, et ses traits fortementaccentués avaient dû être beaux. Son expression n’avaitrien d’aimable, pas plus que sa manière d’accueillir sesvisiteurs n’était de nature à leur faire oublier l’inférioritéde leur rang. Elle ne gardait pas un silence hautain, maiselle disait tout d’une voix impérieuse qui marquait bien lesentiment qu’elle avait de son importance. Elizabeth serappela ce que lui avait dit Wickham et, de ce moment, futpersuadée que lady Catherine répondait exactement auportrait qu’il lui en avait fait.
Miss de Bourgh n’offrait aucune ressemblance avec samère et Elizabeth fut presque aussi étonnée que Maria desa petite taille et de sa maigreur. Elle parlait peu, si cen’est à voix basse en s’adressant à Mrs. Jenkinson. Celle-ci, personne d’apparence insignifiante, était uniquementoccupée à écouter miss de Bourgh et à lui rendre demenus services.
Au bout de quelques minutes lady Catherine invita ses
visiteurs à se rendre tous à la fenêtre pour admirer lavue. Mr. Collins s’empressa de leur détailler les beautésdu paysage tandis que lady Catherine les informait avecbienveillance que c’était beaucoup plus joli en été.
Le repas fut magnifique. On y vit tous lesdomestiques, toutes les pièces d’argenterie que Mr.Collins avait annoncés. Comme il l’avait également prédit,sur le désir exprimé par lady Catherine, il prit place enface d’elle, marquant par l’expression de son visage qu’ence monde, aucun honneur plus grand ne pouvait lui échoir.Il découpait, mangeait, et faisait des compliments avec lamême allégresse joyeuse. Chaque nouveau plat étaitd’abord célébré par lui, puis par sir William qui,maintenant remis de sa première émotion, faisait écho àtout ce que disait son gendre. À la grande surprised’Elizabeth, une admiration aussi excessive paraissaitenchanter lady Catherine qui souriait gracieusement. Laconversation n’était pas très animée. Elizabeth auraitparlé volontiers si elle en avait eu l’occasion, mais elleétait placée entre Charlotte et miss de Bourgh : lapremière était absorbée par l’attention qu’elle prêtait àlady Catherine et la seconde n’ouvrait pas la bouche. Mrs.Jenkinson ne parlait que pour remarquer que miss deBourgh ne mangeait pas, et pour exprimer la craintequ’elle ne fût indisposée. Maria n’aurait jamais osé dire unmot, et les deux messieurs ne faisaient que manger ets’extasier.
De retour au salon, les dames n’eurent qu’à écouterlady Catherine qui parla sans interruption jusqu’au
moment où le café fut servi, donnant son avis sur touteschoses d’un ton qui montrait qu’elle ignorait lacontradiction. Elle interrogea familièrement Charlotte surson intérieur et lui donna mille conseils pour la conduitede son ménage et de sa basse-cour. Elizabeth vit qu’aucunsujet n’était au-dessus de cette grande dame, pourvuqu’elle y trouvât une occasion de diriger et de régenterses semblables. Entre temps, elle posa toutes sortes dequestions aux deux jeunes filles et plus particulièrement àElizabeth sur le compte de laquelle elle se trouvait moinsrenseignée et qui, observa-t-elle à Mrs. Collins,« paraissait une petite jeune fille gentille et bien élevée ».
Elle lui demanda combien de sœurs elle avait, siaucune n’était sur le point de se marier, si elles étaientjolies, où elles avaient été élevées, quel genre d’équipageavait son père et quel était le nom de jeune fille de samère. Elizabeth trouvait toutes ces questions assezindiscrètes mais y répondit avec beaucoup de calme. Enfinlady Catherine observa :
– Le domaine de votre père doit revenir à Mr. Collins,n’est-ce pas ? – J’en suis heureuse pour vous, dit-elle ense tournant vers Charlotte, – autrement je n’approuvepas une disposition qui dépossède les femmes héritièresen ligne directe. On n’a rien fait de pareil dans la famillede Bourgh. Jouez-vous du piano et chantez-vous, missBennet ?
– Un peu.
– Alors, un jour ou l’autre nous serons heureuses de
vous entendre. Notre piano est excellent, probablementsupérieur à… Enfin, vous l’essaierez. Vos sœurs, sont-ellesaussi musiciennes ?
– L’une d’elles, oui, madame.
– Pourquoi pas toutes ? Vous auriez dû prendre toutesdes leçons. Les demoiselles Webb sont toutes musicienneset leur père n’a pas la situation du vôtre. Faites-vous dudessin ?
– Pas du tout.
– Quoi, aucune d’entre vous ?
– Aucune.
– Comme c’est étrange ! Sans doute l’occasion vousaura manqué. Votre mère aurait dû vous mener àLondres, chaque printemps, pour vous faire prendre desleçons.
– Je crois que ma mère l’eût fait volontiers, mais monpère a Londres en horreur.
– Avez-vous encore votre institutrice ?
– Nous n’en avons jamais eu.
– Bonté du ciel ! cinq filles élevées à la maison sansinstitutrice ! Je n’ai jamais entendu chose pareille ! Quelesclavage pour votre mère !
Elizabeth ne put s’empêcher de sourire et affirma qu’iln’en avait rien été.
– Alors, qui vous faisait travailler ? Qui vous
surveillait ? Sans institutrice ? Vous deviez être biennégligées.
– Mon Dieu, madame, toutes celles d’entre nous quiavaient le désir de s’instruire en ont eu les moyens. Onnous encourageait beaucoup à lire et nous avons eu tousles maîtres nécessaires. Assurément, celles qui lepréféraient étaient libres de ne rien faire.
– Bien entendu, et c’est ce que la présence d’uneinstitutrice aurait empêché. Si j’avais connu votre mère,j’aurais vivement insisté pour qu’elle en prît une. On nesaurait croire le nombre de familles auxquelles j’en aiprocuré. Je suis toujours heureuse, quand je le puis, deplacer une jeune personne dans de bonnes conditions.Grâce à moi quatre nièces de Mrs. Jenkinson ont étépourvues de situations fort agréables. Vous ai-je dit,mistress Collins, que lady Metcalfe est venue me voir hierpour me remercier ? Il paraît que miss Pape est unevéritable perle. Parmi vos jeunes sœurs, y en a-t-il quisortent déjà, miss Bennet ?
– Oui, madame, toutes.
– Toutes ? Quoi ? Alors toutes les cinq à la fois ! Etvous n’êtes que la seconde, et les plus jeunes sortentavant que les aînées soient mariées ? Quel âge ont-ellesdonc ?
– La dernière n’a pas encore seize ans. C’est peut-êtreun peu tôt pour aller dans le monde, mais, madame, neserait-il pas un peu dur pour des jeunes filles d’êtreprivées de leur part légitime de plaisirs parce que les
aînées n’ont pas l’occasion ou le désir de se marier debonne heure ?
– En vérité, dit lady Catherine, vous donnez votre avisavec bien de l’assurance pour une si jeune personne. Quelâge avez-vous donc ?
– Votre Grâce doit comprendre, répliqua Elizabeth ensouriant, qu’avec trois jeunes sœurs qui vont dans lemonde, je ne me soucie plus d’avouer mon âge.
Cette réponse parut interloquer lady Catherine.Elizabeth était sans doute la première créature asseztéméraire pour s’amuser de sa majestueuse impertinence.
– Vous ne devez pas avoir plus de vingt ans. Vousn’avez donc aucune raison de cacher votre âge.
– Je n’ai pas encore vingt et un ans.
Quand les messieurs revinrent et qu’on eut pris le thé,les tables de jeu furent apportées. Lady Catherine, sirWilliam, Mr. et Mrs. Collins s’installèrent pour une partiede « quadrille ». Miss de Bourgh préférait le « casino » ;les deux jeunes filles et Mrs. Jenkinson eurent doncl’honneur de jouer avec elle une partie remarquablementennuyeuse. On n’ouvrait la bouche, à leur table, que pourparler du jeu, sauf lorsque Mrs. Jenkinson exprimait lacrainte que miss de Bourgh eût trop chaud, trop froid, ouqu’elle fût mal éclairée.
L’autre table était beaucoup plus animée. C’était ladyCatherine qui parlait surtout pour noter les fautes de sespartenaires ou raconter des souvenirs personnels. Mr.
Collins approuvait tout ce que disait Sa Grâce, laremerciant chaque fois qu’il gagnait une fiche ets’excusant lorsqu’il avait l’impression d’en gagner trop.Sir William parlait peu : il tâchait de meubler sa mémoired’anecdotes et de noms aristocratiques.
Lorsque lady Catherine et sa fille en eurent assez dujeu, on laissa les cartes, et la voiture fut proposée à Mrs.Collins qui l’accepta avec gratitude. La société se réunitalors autour du feu pour écouter lady Catherine déciderquel temps il ferait le lendemain, puis, la voiture étantannoncée, Mr. Collins réitéra ses remerciements, sirWilliam multiplia les saluts, et l’on se sépara.
À peine la voiture s’était-elle ébranlée qu’Elizabeth futinvitée par son cousin à dire son opinion sur ce qu’elleavait vu à Rosings. Par égard pour Charlotte, elles’appliqua à la donner aussi élogieuse que possible ; maisses louanges, malgré la peine qu’elle prenait pour lesformuler, ne pouvaient satisfaire Mr. Collins qui ne tardapas à se charger lui-même du panégyrique de Sa Grâce.
XXXSir William ne demeura qu’une semaine à Hunsford,
mais ce fut assez pour le convaincre que sa fille était trèsconfortablement installée et qu’elle avait un mari et unevoisine comme on en rencontre peu souvent.
Tant que dura le séjour de sir William, Mr. Collinsconsacra toutes ses matinées à le promener en cabrioletpour lui montrer les environs. Après son départ, chacunretourna à ses occupations habituelles et Elizabeth futheureuse de constater que ce changement ne leurimposait pas davantage la compagnie de son cousin. Ilemployait la plus grande partie de ses journées à lire, àécrire, ou à regarder par la fenêtre de son bureau quidonnait sur la route. La pièce où se réunissaient les damesétait située à l’arrière de la maison. Elizabeth s’étaitsouvent demandé pourquoi Charlotte ne préférait pas setenir dans la salle à manger, pièce plus grande et plusagréable, mais elle devina bientôt la raison de cetarrangement : Mr. Collins aurait certainement passémoins de temps dans son bureau si l’appartement de safemme avait présenté les mêmes agréments que le sien.Du salon, on n’apercevait pas la route. C’est donc par Mr.Collins que ces dames apprenaient combien de voituresétaient passées et surtout s’il avait aperçu miss de Bourgh
dans son phaéton, chose dont il ne manquait jamais devenir les avertir, bien que cela arrivât presquejournellement.
Miss de Bourgh s’arrêtait assez souvent devant lepresbytère et causait quelques minutes avec Charlotte,mais d’ordinaire sans descendre de voiture. De temps entemps, lady Catherine elle-même venait honorer lepresbytère de sa visite. Alors son regard observateur nelaissait rien échapper de ce qui se passait autour d’elle.Elle s’intéressait aux occupations de chacun, examinait letravail des jeunes filles, leur conseillait de s’y prendred’une façon différente, critiquait l’arrangement dumobilier, relevait les négligences de la domestique et nesemblait accepter la collation qui lui était offerte que pourpouvoir déclarer à Mrs. Collins que sa table était tropabondamment servie pour le nombre de ses convives.
Elizabeth s’aperçut vite que, sans faire partie de lajustice de paix du comté, cette grande dame jouait le rôled’un véritable magistrat dans la paroisse, dont lesmoindres incidents lui étaient rapportés par Mr. Collins.Chaque fois que des villageois se montraient querelleurs,mécontents ou disposés à se plaindre de leur pauvreté,vite elle accourait dans le pays, réglait les différends,faisait taire les plaintes et ses admonestations avaientbientôt rétabli l’harmonie, le contentement et laprospérité.
Le plaisir de dîner à Rosings se renouvelait environdeux fois par semaine. À part l’absence de sir William et lefait qu’on n’installait plus qu’une table de jeu, ces
réceptions ressemblaient assez exactement à la première.Les autres invitations étaient rares, la société duvoisinage, en général, menant un train qui n’était pas à laportée des Collins. Elizabeth ne le regrettait pas et,somme toute, ses journées coulaient agréablement. Elleavait avec Charlotte de bonnes heures de causerie et, latempérature étant très belle pour la saison, elle prenaitgrand plaisir à se promener. Son but favori était un petitbois qui longeait un des côtés du parc et elle s’y rendaitsouvent pendant que ses cousins allaient faire visite àRosings. Elle y avait découvert un délicieux sentierombragé que personne ne paraissait rechercher, et où ellese sentait à l’abri des curiosités indiscrètes de ladyCatherine.
Ainsi s’écoula paisiblement la première quinzaine deson séjour à Hunsford. Pâques approchait, et la semainesainte devait ajouter un appoint important à la société deRosings. Peu après son arrivée, Elizabeth avait entendudire que Mr. Darcy était attendu dans quelques semaineset, bien que peu de personnes dans ses relations luifussent moins sympathiques, elle pensait néanmoins quesa présence donnerait un peu d’intérêt aux réceptions deRosings. Sans doute aussi aurait-elle l’amusement deconstater l’inanité des espérances de miss Bingley enobservant la conduite de Mr. Darcy à l’égard de sa cousineà qui lady Catherine le destinait certainement. Elle avaitannoncé son arrivée avec une grande satisfaction, parlaitde lui en termes de la plus haute estime, et avait parupresque désappointée de découvrir que son neveu n’étaitpas un inconnu pour miss Lucas et pour Elizabeth.
Son arrivée fut tout de suite connue au presbytère, carMr. Collins passa toute la matinée à se promener en vuede l’entrée du château afin d’en être le premier témoin ;après avoir fait un profond salut du côté de la voiture quifranchissait la grille, il se précipita chez lui avec la grandenouvelle.
Le lendemain matin, il se hâta d’aller à Rosings offrirses hommages et trouva deux neveux de lady Catherinepour les recevoir, car Darcy avait amené avec lui lecolonel Fitzwilliam, son cousin, fils cadet de lord ***, et lasurprise fut grande au presbytère quand on vit revenirMr. Collins en compagnie des deux jeunes gens.
Du bureau de son mari Charlotte les vit traverser laroute et courut annoncer aux jeunes filles l’honneur quileur était fait :
– Eliza, c’est à vous que nous devons cet excès decourtoisie. Si j’avais été seule, jamais Mr. Darcy n’auraitété aussi pressé de venir me présenter ses hommages.
Elizabeth avait à peine eu le temps de protesterlorsque la sonnette de la porte d’entrée retentit et, uninstant après, ces messieurs faisaient leur entrée dans lesalon.
Le colonel Fitzwilliam, qui paraissait une trentained’années, n’était pas un bel homme mais il avait unegrande distinction dans l’extérieur et dans les manières.Mr. Darcy était tel qu’on l’avait vu en Hertfordshire. Ilprésenta ses compliments à Mrs. Collins avec sa réservehabituelle et, quels que fussent ses sentiments à l’égard
de son amie, s’inclina devant elle d’un air parfaitementimpassible. Elizabeth, sans mot dire, répondit par unerévérence.
Le colonel Fitzwilliam avait engagé la conversationavec toute la facilité et l’aisance d’un homme du mondemais son cousin, après une brève remarque adressée àMrs. Collins sur l’agrément de sa maison, resta quelquetemps sans parler. À la fin il sortit de son mutisme ets’enquit auprès d’Elizabeth de la santé des siens. Ellerépondit que tous allaient bien, puis, après une courtepause, ajouta :
– Ma sœur aînée vient de passer trois mois à Londres ;vous ne l’avez pas rencontrée ?
Elle était parfaitement sûre du contraire mais voulaitvoir s’il laisserait deviner qu’il était au courant de ce quis’était passé entre les Bingley et Jane. Elle crutsurprendre un peu d’embarras dans la manière dont ilrépondit qu’il n’avait pas eu le plaisir de rencontrer missBennet.
Le sujet fut abandonné aussitôt et, au bout dequelques instants, les deux jeunes gens prirent congé.
XXXILes habitants du presbytère goûtèrent beaucoup les
manières du colonel Fitzwilliam et les dames, enparticulier, eurent l’impression que sa présence ajouteraitbeaucoup à l’intérêt des réceptions de lady Catherine.Plusieurs jours s’écoulèrent cependant sans amener denouvelle invitation, – la présence des visiteurs au châteaurendait les Collins moins nécessaires, – et ce futseulement le jour de Pâques, à la sortie de l’office, qu’ilsfurent priés d’aller passer la soirée à Rosings. De toute lasemaine précédente, ils avaient très peu vu ladyCatherine et sa fille ; le colonel Fitzwilliam était entréplusieurs fois au presbytère, mais on n’avait aperçu Mr.Darcy qu’à l’église.
L’invitation fut acceptée comme de juste et, à uneheure convenable, les Collins et leurs hôtes se joignaient àla société réunie dans le salon de lady Catherine. Sa Grâceles accueillit aimablement, mais il était visible que leurcompagnie comptait beaucoup moins pour elle qu’entemps ordinaire. Ses neveux absorbaient la plus grandepart de son attention et c’est aux deux jeunes gens, àDarcy surtout, qu’elle s’adressait de préférence.
Le colonel Fitzwilliam marqua beaucoup de satisfactionen voyant arriver les Collins. Tout, à Rosings, lui semblait
une heureuse diversion et la jolie amie de Mrs. Collins luiavait beaucoup plu. Il s’assit auprès d’elle et se mit àl’entretenir si agréablement du Kent et du Hertfordshire,du plaisir de voyager et de celui de rester chez soi, demusique et de lecture, qu’Elizabeth fut divertie commejamais encore elle ne l’avait été dans ce salon. Ilscausaient avec un tel entrain qu’ils attirèrent l’attentionde lady Catherine ; les yeux de Mr. Darcy se tournèrentaussi de leur côté avec une expression de curiosité ; quantà Sa Grâce, elle manifesta bientôt le même sentiment eninterpellant son neveu : »
– Eh ! Fitzwilliam ? de quoi parlez-vous ? Queracontez-vous donc à miss Bennet ?
– Nous parlions musique, madame, dit-il enfin, nepouvant plus se dispenser de répondre.
– Musique ! Alors, parlez plus haut ; ce sujetm’intéresse. Je crois vraiment qu’il y a peu de personnesen Angleterre qui aiment la musique autant que moi, oul’apprécient avec plus de goût naturel. J’aurais eu sansdoute beaucoup de talent, si je l’avais apprise ; Anne aussiaurait joué délicieusement, si sa santé lui avait permisd’étudier le piano. Et Georgiana, fait-elle beaucoup deprogrès ?
Mr. Darcy répondit par un fraternel éloge du talent desa sœur.
– Ce que vous m’apprenez là me fait grand plaisir ;mais dites-lui bien qu’il lui faut travailler sérieusement sielle veut arriver à quelque chose.
– Je vous assure, madame, qu’elle n’a pas besoin de ceconseil, car elle étudie avec beaucoup d’ardeur.
– Tant mieux, elle ne peut en faire trop et je le luiredirai moi-même quand je lui écrirai. C’est un conseil queje donne toujours aux jeunes filles et j’ai dit bien des fois àmiss Bennet qu’elle devrait faire plus d’exercices.Puisqu’il n’y a pas de piano chez Mrs. Collins, elle peutvenir tous les jours ici pour étudier sur celui qui est dansla chambre de Mrs. Jenkinson. Dans cette partie de lamaison, elle serait sûre de ne déranger personne.
Mr. Darcy, un peu honteux d’entendre sa tante parleravec si peu de tact, ne souffla mot.
Quant on eut pris le café, le colonel Fitzwilliam rappelaqu’Elizabeth lui avait promis un peu de musique. Sans sefaire prier elle s’installa devant le piano et il transportason siège auprès d’elle. Lady Catherine écouta la moitiédu morceau et se remit à parler à son autre neveu, maiscelui-ci au bout d’un moment la quitta et s’approchantdélibérément du piano se plaça de façon à bien voir la jolieexécutante. Elizabeth s’en aperçut et, le morceau terminé,lui dit en plaisantant :
– Vous voudriez m’intimider, Mr. Darcy, en venantm’écouter avec cet air sérieux, mais bien que vous ayezune sœur qui joue avec tant de talent, je ne me laisseraipas troubler. Il y a chez moi une obstination dont on nepeut facilement avoir raison. Chaque essai d’intimidationne fait qu’affermir mon courage.
– Je ne vous dirai pas que vous vous méprenez, dit-il,
car vous ne croyez certainement pas que j’aie l’intentionde vous intimider. Mais j’ai le plaisir de vous connaîtredepuis assez longtemps pour savoir que vous vousamusez à professer des sentiments qui ne sont pas lesvôtres.
Elizabeth rit de bon cœur devant ce portrait d’elle-même, et dit au colonel Fitzwilliam :
– Votre cousin vous donne une jolie opinion de moi, envous enseignant à ne pas croire un mot de ce que je dis !Je n’ai vraiment pas de chance de me retrouver avecquelqu’un si à même de dévoiler mon véritable caractèredans un pays reculé où je pouvais espérer me faire passerpour une personne digne de foi. Réellement, Mr. Darcy, ilest peu généreux de révéler ici les défauts que vous avezremarqués chez moi en Hertfordshire, et n’est-ce pasaussi un peu imprudent ? car vous me provoquez à lavengeance, et il peut en résulter des révélations quirisqueraient fort de choquer votre entourage.
– Oh ! je n’ai pas peur de vous, dit-il en souriant.
– Dites-moi ce que vous avez à reprendre chez lui, jevous en prie, s’écria le colonel Fitzwilliam. J’aimeraissavoir comment il se comporte parmi les étrangers.
– En bien, voilà, mais attendez-vous à quelque chosed’affreux… La première fois que j’ai vu Mr. Darcy, c’étaità un bal. Or, que pensez-vous qu’il fit à ce bal ? Il dansatout juste quatre fois. Je suis désolée de vous faire de lapeine, mais c’est l’exacte vérité. Il n’a dansé que quatrefois, bien que les danseurs fussent peu nombreux et que
plus d’une jeune fille, – je le sais pertinemment, – dutrester sur sa chaise, faute de cavalier. Pouvez-vous nierce fait, Mr. Darcy ?
– Je n’avais pas l’honneur de connaître d’autres damesque celles avec qui j’étais venu à cette soirée.
– C’est exact ; et on ne fait pas de présentations dansune soirée… Alors, colonel, que vais-je vous jouer ? Mesdoigts attendent vos ordres.
– Peut-être, dit Darcy, aurait-il été mieux de chercherà me faire présenter. Mais je n’ai pas les qualitésnécessaires pour me rendre agréable auprès despersonnes étrangères.
– En demanderons-nous la raison à votre cousine ? ditElizabeth en s’adressant au colonel Fitzwilliam. Luidemanderons-nous pourquoi un homme intelligent et quia l’habitude du monde n’a pas les qualités nécessairespour plaire aux étrangers ?
– Inutile de l’interroger, je puis vous répondre moi-même, dit le colonel ; c’est parce qu’il ne veut pas s’endonner la peine.
– Certes, dit Darcy, je n’ai pas, comme d’autres, letalent de converser avec des personnes que je n’ai jamaisvues. Je ne sais pas me mettre à leur diapason nim’intéresser à ce qui les concerne.
– Mes doigts, répliqua Elizabeth, ne se meuvent passur cet instrument avec la maîtrise que l’on remarquechez d’autres pianistes. Ils n’ont pas la même force ni la
même vélocité et ne traduisent pas les mêmes nuances :mais j’ai toujours pensé que la faute en était moins à euxqu’à moi qui n’ai pas pris la peine d’étudier suffisammentpour les assouplir.
Darcy sourit :
– Vous avez parfaitement raison, dit-il ; vous avezmieux employé votre temps. Vous faites plaisir à tousceux qui ont le privilège de vous entendre. Mais, commemoi, vous n’aimez pas à vous produire devant lesétrangers.
Ici, ils furent interrompus par lady Catherine quivoulait être mise au courant de leur conversation.Aussitôt, Elizabeth se remit à jouer. Lady Catherines’approcha, écouta un instant, et dit à Darcy :
– Miss Bennet ne jouerait pas mal si elle étudiaitdavantage et si elle prenait des leçons avec un professeurde Londres. Elle a un très bon doigté, bien que pour legoût, Anne lui soit supérieure. Anne aurait eu un très jolitalent si sa santé lui avait permis d’étudier.
Elizabeth jeta un coup d’œil vers Darcy pour voir dequelle façon il s’associait à l’éloge de sa cousine, mais ni àce moment, ni à un autre, elle ne put discerner le moindresymptôme d’amour. De son attitude à l’égard de miss deBourg, elle recueillit cette consolation pour miss Bingley :c’est que Mr. Darcy aurait aussi bien pu l’épouser si elleavait été sa cousine.
Lady Catherine continua ses remarques entremêléesde conseils ; Elizabeth les écouta avec déférence, et, sur la
prière des deux jeunes gens, demeura au piano jusqu’aumoment où la voiture de Sa Grâce fut prête à les ramenerau presbytère.
XXXIILe lendemain matin, tandis que Mrs. Collins et Maria
faisaient des courses dans le village, Elizabeth, restéeseule au salon, écrivait à Jane lorsqu’un coup de sonnettela fit tressaillir. Dans la crainte que ce ne fût ladyCatherine, elle mettait de côté sa lettre inachevée afind’éviter des questions importunes, lorsque la portes’ouvrit, et, à sa grande surprise, livra passage à Mr.Darcy.
Il parut étonné de la trouver seule et s’excusa de sonindiscrétion en alléguant qu’il avait compris que Mrs.Collins était chez elle. Puis ils s’assirent et quand Elizabetheut demandé des nouvelles de Rosings, il y eut un silencequi menaçait de se prolonger. Il fallait à tout prix trouverun sujet de conversation. Elizabeth se rappelant leurdernière rencontre en Hertfordshire, et curieuse de voirce qu’il dirait sur le départ précipité de ses hôtes, fit cetteremarque :
– Vous avez tous quitté Netherfield bien rapidementen novembre dernier, Mr. Darcy. Mr. Bingley a dû êtreagréablement surpris de vous revoir si tôt, car, si je m’ensouviens bien, il n’était parti que de la veille. Lui et sessœurs allaient bien, je pense, quand vous avez quittéLondres ?
– Fort bien, je vous remercie.
Voyant qu’elle n’obtiendrait pas d’autre réponse, ellereprit au bout d’un moment :
– Il me semble avoir compris que Mr. Bingley n’avaitguère l’intention de revenir à Netherfield.
– Je ne le lui ai jamais entendu dire. Je ne serais pasétonné, cependant, qu’il y passe peu de temps à l’avenir.Il a beaucoup d’amis et se trouve à une époque del’existence où les obligations mondaines se multiplient.
– S’il a l’intention de venir si rarement à Netherfield, ilvaudrait mieux pour ses voisins qu’il l’abandonne tout àfait. Nous aurions peut-être des chances de voir unefamille s’y fixer d’une façon plus stable. Mais peut-êtreMr. Bingley, en prenant cette maison, a-t-il pensé plus àson plaisir qu’à celui des autres et il règle sans doute sesallées et venues d’après le même principe.
– Je ne serais pas surpris, dit Darcy, de le voir céderNetherfield si une offre sérieuse se présentait.
Elizabeth ne répondit pas ; elle craignait de trops’étendre sur ce chapitre, et ne trouvant rien autre à dire,elle résolut de laisser à son interlocuteur la peine dechercher un autre sujet. Celui-ci le sentit et repritbientôt :
– Cette maison paraît fort agréable. Lady Catherine, jecrois, y a fait faire beaucoup d’aménagements lorsque Mr.Collins est venu s’installer à Hunsford.
– Je le crois aussi, et ses faveurs ne pouvaientcertainement exciter plus de reconnaissance.
– Mr. Collins, en se mariant, paraît avoir fait unheureux choix.
– Certes oui ; ses amis peuvent se réjouir qu’il soittombé sur une femme de valeur, capable à la fois del’épouser et de le rendre heureux. Mon amie a beaucoupde jugement, bien qu’à mon sens son mariage ne soitpeut-être pas ce qu’elle a fait de plus sage, mais elle paraîtheureuse, et vue à la lumière de la froide raison, cetteunion présente beaucoup d’avantages.
– Elle doit être satisfaite d’être installée à si peu dedistance de sa famille et de ses amis.
– À si peu de distance, dites-vous ? Mais il y a près decinquante milles entre Meryton et Hunsford.
– Qu’est-ce que cinquante milles, avec de bonnesroutes ? Guère plus d’une demi-journée de voyage.J’appelle cela une courte distance.
– Pour moi, s’écria Elizabeth, jamais je n’aurais comptécette « courte distance » parmi les avantages présentéspar le mariage de mon amie. Je ne trouve pas qu’elle soitétablie à proximité de sa famille.
– Ceci prouve votre attachement pour leHertfordshire. En dehors des environs immédiats deLongbourn, tout pays vous semblerait éloigné, sansdoute ?
En parlant ainsi, il eut un léger sourire qu’Elizabeth
crut comprendre. Il supposait sans doute qu’elle pensait àJane et à Netherfield ; aussi est-ce en rougissant qu’ellerépondit :
– Je ne veux pas dire qu’une jeune femme ne puisseêtre trop près de sa famille. Les distances sont relatives,et quand un jeune ménage a les moyens de voyager,l’éloignement n’est pas un grand mal. Mr. et Mrs. Collins,bien qu’à leur aise, ne le sont pas au point de se permettrede fréquents déplacements, et je suis sûre qu’il faudraitque la distance fût réduite de moitié pour que mon amies’estimât à proximité de sa famille.
Mr. Darcy rapprocha un peu son siège d’Elizabeth :
– Quant à vous, dit-il, il n’est pas possible que voussoyez aussi attachée à votre pays. Sûrement, vous n’avezpas toujours vécu à Longbourn.
Elizabeth eut un air surpris. Mr. Darcy parut seraviser. Reculant sa chaise, il prit un journal sur la table, yjeta les yeux, et poursuivit d’un ton détaché :
– Le Kent vous plaît-il ?
Suivit alors un court dialogue sur le pays, auquel mitfin l’entrée de Charlotte et de sa sœur qui revenaient deleurs courses. Ce tête-à-tête ne fut pas sans les étonner.Darcy raconta comment il avait, par erreur, dérangé missBennet, et après être resté quelques minutes sans diregrand’chose, prit congé et quitta le presbytère.
– Qu’est-ce que cela signifie ? demanda Charlotteaussitôt après son départ. Il doit être amoureux de vous,
Eliza, sans quoi jamais il ne viendrait vous rendre visite sifamilièrement.
Mais lorsque Elizabeth eut raconté combien Darcys’était montré taciturne, cette supposition ne parut pastrès vraisemblable, et on en vint à cette conclusion :Darcy était venu parce qu’il n’avait rien de mieux à faire.
À cette époque, la chasse était fermée. Dans lechâteau, il y avait bien lady Catherine, une bibliothèque etun billard ; mais des jeunes gens ne peuvent resterenfermés du matin au soir. Que ce fût la proximité dupresbytère, l’agrément du chemin qui y conduisait ou despersonnes qui l’habitaient, toujours est-il que le colonelFitzwilliam et Mr. Darcy en firent dès lors le but presquequotidien de leurs promenades. Ils arrivaient à touteheure, tantôt ensemble et tantôt séparément, parfoismême accompagnés de leur tante. Il était visible que lecolonel Fitzwilliam était attiré par la société des troisjeunes femmes. La satisfaction qu’Elizabeth éprouvait à levoir, aussi bien que l’admiration qu’il laissait paraître pourelle, lui rappelaient son ancien favori, George Wickham, etsi en les comparant elle trouvait moins de séduction auxmanières du colonel Fitzwilliam, elle avait l’impressionque, des deux, c’était lui sans doute qui possédait l’espritle plus cultivé.
Mais Mr. Darcy ! Comment expliquer ses fréquentesapparitions au presbytère ? Ce ne pouvait être par amourde la société ? Il lui arrivait souvent de rester dix minutessans ouvrir la bouche, et, quand il parlait, il semblait quece fût par nécessité plutôt que par plaisir. Rarement lui
voyait-on de l’animation. La façon dont Fitzwilliam leplaisantait sur son mutisme prouvait que, d’habitude, iln’était point aussi taciturne. Mrs. Collins ne savait qu’enpenser. Elle eût aimé se persuader que cette attitude étaitl’effet de l’amour, et l’objet de cet amour son amieElizabeth. Pour résoudre ce problème, elle se mit àobserver Darcy, à Rosings et à Hunsford, mais sans grandsuccès. Il regardait certainement beaucoup Elizabeth,mais d’une manière difficile à interpréter. Charlotte sedemandait souvent si le regard attentif qu’il attachait surelle contenait beaucoup d’admiration, et par moments illui semblait simplement le regard d’un homme dontl’esprit est ailleurs. Une ou deux fois, Charlotte avaitinsinué devant son amie que Mr. Darcy nourrissait peut-être une préférence pour elle, mais Elizabeth s’étaitcontentée de rire, et Mrs. Collins avait jugé sage de ne pasinsister de peur de faire naître des espérances stériles.Pour elle il ne faisait pas de doute que l’antipathied’Elizabeth aurait vite fait de s’évanouir si elle avait pucroire qu’elle eût quelque pouvoir sur le cœur de Mr.Darcy. Parfois, dans les projets d’avenir qu’elle faisaitpour son amie, Charlotte la voyait épousant le colonelFitzwilliam. Des deux cousins, c’était sans contredit le plusagréable ; il admirait Elizabeth, et sa situation faisait de luiun beau parti. Seulement, pour contre-balancer tous cesavantages, Mr. Darcy avait une influence considérabledans le monde clérical, tandis que son cousin n’enpossédait aucune.
XXXIIIPlus d’une fois Elizabeth, en se promenant dans le
parc, rencontra Mr. Darcy à l’improviste. Elle trouvaitassez étrange la malchance qui l’amenait dans un endroitordinairement si solitaire, et elle eut soin de l’informerque ce coin du parc était sa retraite favorite. Une seconderencontre après cet avertissement était plutôt singulière ;elle eut lieu cependant, et une autre encore. Était-ce pourl’ennuyer ou pour s’imposer à lui-même une pénitence ?Car il ne se contentait point dans ces occasions de lui direquelques mots de politesse et de poursuivre son chemin,mais paraissait croire nécessaire de l’accompagner danssa promenade. Il ne se montrait jamais très bavard, et, deson côté, Elizabeth ne faisait guère de frais. Au cours de latroisième rencontre, cependant, elle fut frappée desquestions bizarres et sans lien qu’il lui posait surl’agrément de son séjour à Hunsford ; sur son goût pourles promenades solitaires ; sur ce qu’elle pensait de lafélicité du ménage Collins ; enfin, comme il était questionde Rosings et de la disposition intérieure desappartements qu’elle disait ne pas bien connaître, Darcyavait eu l’air de penser que lorsqu’elle reviendrait dans leKent, elle séjournerait cette fois au château. Voilà dumoins ce qu’Elizabeth crut comprendre. Était-ce possible
qu’en parlant ainsi il pensât au colonel Fitzwilliam ? Si cesparoles avaient un sens, il voulait sans doute faire allusionà ce qui pourrait se produire de ce côté. Cette penséetroubla quelque peu Elizabeth qui fut heureuse de seretrouver seule à l’entrée du presbytère.
Un jour qu’en promenade elle relisait une lettre deJane et méditait certains passages qui laissaient devinerla mélancolie de sa sœur, Elizabeth, en levant les yeux, setrouva face à face, non point cette fois avec Mr. Darcy,mais avec le colonel Fitzwilliam.
– Je ne savais pas que vous vous promeniez jamais dece côté, dit-elle avec un sourire en repliant sa lettre.
– Je viens de faire le tour complet du parc comme je lefais généralement à chacun de mes séjours, et je pensaisterminer par une visite à Mrs. Collins. Continuez-vousvotre promenade ?
– Non, j’étais sur le point de rentrer.
Ils reprirent ensemble le chemin du presbytère.
– Avez-vous toujours le projet de partir samediprochain ?
– Oui, si Darcy ne remet pas encore notre départ. Jesuis ici à sa disposition et il arrange tout à sa guise.
– Et si l’arrangement ne le satisfait point, il a toujourseu le plaisir de la décision. Je ne connais personne quisemble goûter plus que Mr. Darcy le pouvoir d’agir à saguise.
– Certes, il aime faire ce qui lui plaît ; mais nous ensommes tous là. Il a seulement pour suivre son inclinationplus de facilité que bien d’autres, parce qu’il est riche etque tout le monde ne l’est pas. J’en parle en connaissancede cause. Les cadets de famille, vous le savez, sonthabitués à plus de dépendance et de renoncements.
– Je ne me serais pas imaginé que le fils cadet d’uncomte avait de tels maux à supporter. Sérieusement, queconnaissez-vous de la dépendance et des renoncements ?Quand le manque d’argent vous a-t-il empêché d’aller oùvous vouliez ou de vous accorder une fantaisie ?
– Voilà des questions bien directes. Non, il faut que jel’avoue, je n’ai pas eu à souffrir beaucoup d’ennuis de cegenre. Mais le manque de fortune peut m’exposer à desépreuves plus graves. Les cadets de famille, vous le savez,ne peuvent guère se marier selon leur choix.
– À moins que leur choix ne se porte sur deshéritières, ce qui arrive, je crois, assez fréquemment.
– Nos habitudes de vie nous rendent trop dépendants,et peu d’hommes de mon rang peuvent se marier sanstenir compte de la fortune.
« Ceci serait-il pour moi ? » se demanda Elizabeth quecette idée fit rougir. Mais se reprenant, elle dit avecenjouement :
– Et quel est, s’il vous plaît, le prix ordinaire du filscadet d’un comte ? À moins que le frère aîné ne soit d’unesanté spécialement délicate, vous ne demandez pas, jepense, plus de cinquante mille livres ?
Il lui répondit sur le même ton, puis, pour rompre unsilence qui aurait pu laisser croire qu’elle était affectée dece qu’il avait dit, Elizabeth reprit bientôt :
– J’imagine que votre cousin vous a amené pour leplaisir de sentir près de lui quelqu’un qui soit à sonentière disposition. Je m’étonne qu’il ne se marie pas, carle mariage lui assurerait cette commodité d’une façonpermanente. Mais peut-être sa sœur lui suffit-elle pourl’instant ; il doit faire d’elle ce que bon lui semblepuisqu’elle est sous sa seule direction.
– Non, répliqua le colonel Fitzwilliam, c’est unavantage qu’il partage avec moi, car nous sommes tousdeux co-tuteurs de miss Darcy.
– Vraiment ? Et dites-moi donc quelle sorte de tuteurvous faites ? Votre pupille vous donne-t-elle beaucoup depeine ? Les jeunes filles de cet âge sont parfois difficiles àmener, et si c’est une vraie Darcy elle est sans doute assezindépendante.
Comme elle prononçait ces paroles, elle remarqua queFitzwilliam la regardait attentivement, et la façon dont illui demanda pourquoi elle supposait que la tutelle de missDarcy pût lui donner quelque peine convainquit Elizabethqu’elle avait, d’une manière ou d’une autre, touché lavérité.
– N’ayez aucune crainte, répliqua-t-elle aussitôt. Jen’ai jamais entendu médire, si peu que ce soit, de votrepupille, et je suis persuadée de sa docilité. Deux dames dema connaissance ne jurent que par elle, Mrs. Hurst et
ma connaissance ne jurent que par elle, Mrs. Hurst etmiss Bingley ; – il me semble vous avoir entendu dire quevous les connaissiez aussi.
– Je les connais un peu. Leur frère est un hommeaimable et bien élevé, et c’est le grand ami de Darcy.
– Oh ! je sais, dit Elizabeth un peu sèchement. Mr.Darcy montre beaucoup de bonté pour Mr. Bingley etveille sur lui avec une extraordinaire sollicitude.
– Oui, je crois en effet que Darcy veille sur son ami qui,sous certains rapports, a besoin d’être guidé. Une chosequ’il m’a dite en venant ici m’a même fait supposer queBingley lui doit à ce titre quelque reconnaissance. Mais jeparle peut-être un peu vite, car rien ne m’assure queBingley soit la personne dont il était question. C’est pureconjecture de ma part.
– De quoi s’agissait-il ?
– D’une circonstance dont Darcy désire certainementgarder le secret, car, s’il devait en revenir quelque chose àla famille intéressée, ce serait fort désobligeant.
– Vous pouvez compter sur ma discrétion.
– Et notez bien que je ne suis pas certain qu’il s’agissede Bingley. Darcy m’a simplement dit qu’il se félicitaitd’avoir sauvé dernièrement un ami du danger d’unmariage imprudent. J’ai supposé que c’était Bingley dontil s’agissait parce qu’il me semble appartenir à la catégoriedes jeunes gens capables d’une étourderie de ce genre, etaussi parce que je savais que Darcy et lui avaient passél’été ensemble.
– Mr. Darcy vous a-t-il donné les raisons de sonintervention ?
– J’ai compris qu’il y avait contre la jeune fille desobjections très sérieuses.
– Et quels moyens habiles a-t-il employés pour lesséparer ?
– Il ne m’a pas conté ce qu’il avait fait, dit Fitzwilliamen souriant ; il m’a dit seulement ce que je viens de vousrépéter.
Elizabeth ne répondit pas et continua d’avancer, lecœur gonflé d’indignation. Après l’avoir observée unmoment, Fitzwilliam lui demanda pourquoi elle était sisongeuse.
– Je pense à ce que vous venez de me dire. Laconduite de votre cousin m’étonne. Pourquoi s’est-il faitjuge en cette affaire ?
– Vous trouvez son intervention indiscrète ?
– Je ne vois pas quel droit avait Mr. Darcy dedésapprouver l’inclination de son ami, ni de décidercomment celui-ci pouvait trouver le bonheur. Mais, dit-elle en se ressaisissant, comme nous ignorons tous lesdétails il n’est pas juste de le condamner. On peutsupposer aussi que le sentiment de son ami n’était pastrès profond.
– Cette supposition n’est pas invraisemblable, ditFitzwilliam, mais elle enlève singulièrement de sa valeur àla victoire de mon cousin.
Ce n’était qu’une réflexion plaisante, mais qui parut àElizabeth peindre très justement Mr. Darcy. Craignant, sielle poursuivait ce sujet, n’être plus maîtresse d’elle-même, la jeune fille changea brusquement laconversation, et il ne fut plus question que de chosesindifférentes jusqu’à l’arrivée au presbytère.
Dès que le visiteur fut parti, elle eut le loisir deréfléchir longuement à ce qu’elle venait d’entendre. Surl’identité des personnages elle ne pouvait avoir de doute :il n’y avait pas deux hommes sur qui Mr. Darcy pût avoirune influence aussi considérable. Elizabeth avait toujourssupposé qu’il avait dû coopérer au plan suivi pour séparerBingley de Jane, mais elle en attribuait l’idée principale etla réalisation à miss Bingley. Cependant, si Mr. Darcy nese vantait pas, c’était lui, c’étaient son orgueil et soncaprice qui étaient la cause de tout ce que Jane avaitsouffert et souffrait encore. Il avait brisé pour un tempstout espoir de bonheur dans le cœur le plus tendre, le plusgénéreux qui fût ; et le mal qu’il avait causé, nul n’enpouvait prévoir la durée.
« Il y avait des objections sérieuses contre la jeunefille, » avait dit le colonel Fitzwilliam. Ces objectionsétaient sans nul doute qu’elle avait un oncle avoué dansune petite ville, et un autre dans le commerce à Londres.« À Jane, que pourrait-on reprocher ? se disait Elizabeth.Jane, le charme et la bonté personnifiés, dont l’esprit estsi raisonnable et les manières si séduisantes ! Contre monpère non plus on ne peut rien dire ; malgré son originalité,il a une intelligence que Mr. Darcy peut ne point
dédaigner, et une respectabilité à laquelle lui-même neparviendra peut-être jamais. » À la pensée de sa mère,elle sentit sa confiance s’ébranler. Mais non, ce genred’objection ne pouvait avoir de poids aux yeux de Mr.Darcy dont l’orgueil, elle en était sûre, était plus sensible àl’infériorité du rang qu’au manque de jugement de lafamille où voulait entrer son ami. Elizabeth finit parconclure qu’il avait été poussé par une détestable fierté,et sans doute aussi par le désir de conserver Bingley poursa sœur.
L’agitation et les larmes qui furent l’effet de cesréflexions provoquèrent une migraine dont Elizabethsouffrait tellement vers le soir que, sa répugnance àrevoir Mr. Darcy aidant, elle décida de ne pasaccompagner ses cousins à Rosings où ils étaient invités àaller prendre le thé. Mrs. Collins, voyant qu’elle étaitréellement souffrante, n’insista pas pour la faire changerd’avis mais Mr. Collins ne lui cacha point qu’il craignaitfort que lady Catherine ne fût mécontente en voyantqu’elle était restée au logis.
XXXIVComme si elle avait pris à tâche de s’exaspérer encore
davantage contre Mr. Darcy, Elizabeth, une fois seule, semit à relire les lettres que Jane lui avait écrites depuis sonarrivée à Hunsford. Aucune ne contenait de plaintespositives mais toutes trahissaient l’absence de cetenjouement qui était le caractère habituel de son style etqui, procédant de la sérénité d’un esprit toujours en paixavec les autres et avec lui-même, n’avait été querarement troublé.
Elizabeth notait toutes les phrases empreintes detristesse avec une attention qu’elle n’avait pas mise à lapremière lecture. La façon dont Mr. Darcy se glorifiait dela souffrance par lui infligée augmentait sa compassionpour le chagrin de sa sœur. C’était une consolation depenser que le séjour de Mr. Darcy à Rosings se terminaitle surlendemain ; c’en était une autre, et plus grande, dese dire que dans moins de quinze jours elle serait auprèsde Jane et pourrait contribuer à la guérison de son cœurde tout le pouvoir de son affection fraternelle.
En songeant au départ de Darcy elle se rappela queson cousin partait avec lui, mais le colonel Fitzwilliamavait montré clairement que ses amabilités ne tiraient pasà conséquence et, tout charmant qu’il était, elle n’avait
nulle envie de se rendre malheureuse à cause de lui.
Elle en était là de ses réflexions lorsque le son de lacloche d’entrée la fit tressaillir. Était-ce, par hasard, lecolonel Fitzwilliam, dont les visites étaient quelquefoisassez tardives, qui venait prendre de ses nouvelles ? Unpeu troublée par cette idée, elle la repoussa aussitôt etreprenait son calme quand elle vit, avec une extrêmesurprise, Mr. Darcy entrer dans la pièce.
Il se hâta tout d’abord de s’enquérir de sa santé,expliquant sa visite par le désir qu’il avait d’apprendrequ’elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec unepolitesse pleine de froideur. Il s’assit quelques instants,puis, se relevant, se mit à arpenter la pièce. Elizabethsaisie d’étonnement ne disait mot. Après un silence deplusieurs minutes, il s’avança vers elle et, d’un air agité,débuta ainsi :
– En vain ai-je lutté. Rien n’y fait. Je ne puis réprimermes sentiments. Laissez-moi vous dire l’ardeur aveclaquelle je vous admire et je vous aime.
Elizabeth stupéfaite le regarda, rougit, se demanda sielle avait bien entendu et garda le silence. Mr. Darcy cruty voir un encouragement et il s’engagea aussitôt dansl’aveu de l’inclination passionnée que depuis longtemps ilressentait pour elle.
Il parlait bien, mais il avait en dehors de son amourd’autres sentiments à exprimer et, sur ce chapitre, il ne semontra pas moins éloquent que sur celui de sa passion. Laconviction de commettre une mésalliance, les obstacles de
famille que son jugement avait toujours opposés à soninclination, tout cela fut détaillé avec une chaleur biennaturelle, si l’on songeait au sacrifice que faisait sa fierté,mais certainement peu propre à plaider sa cause.
En dépit de sa profonde antipathie, Elizabeth nepouvait rester insensible à l’hommage que représentaitl’amour d’un homme tel que Mr. Darcy. Sans que sarésolution en fût ébranlée un instant, elle commença parse sentir peinée du chagrin qu’elle allait lui causer, mais,irritée par la suite de son discours, sa colère supprimatoute compassion, et elle essaya seulement de se dominerpour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu’il auraitterminé. Il conclut en lui représentant la force d’unsentiment que tous ses efforts n’avaient pas réussi àvaincre et en exprimant l’espoir qu’elle voudrait bien yrépondre en lui accordant sa main. Tandis qu’il prononçaitces paroles, il était facile de voir qu’il ne doutait pas derecevoir une réponse favorable. Il parlait bien de crainte,d’anxiété, mais sa contenance exprimait la sécurité. Rienn’était plus fait pour exaspérer Elizabeth, et, dès qu’il eutterminé, elle lui répondit, les joues en feu :
– En des circonstances comme celle-ci, je crois qu’il estd’usage d’exprimer de la reconnaissance pour lessentiments dont on vient d’entendre l’aveu. C’est chosenaturelle, et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vousremercierais. Mais je ne le puis pas. Je n’ai jamaisrecherché votre affection, et c’est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d’avoir pucauser de la peine à quelqu’un, mais je l’ai fait sans le
vouloir, et cette peine, je l’espère, sera de courte durée.Les sentiments qui, me dites-vous, ont retardé jusqu’icil’aveu de votre inclination, n’auront pas de peine à entriompher après cette explication.
Mr. Darcy qui s’appuyait à la cheminée, les yeux fixéssur le visage d’Elizabeth, accueillit ces paroles avec autantd’irritation que de surprise. Il pâlit de colère, et son visagerefléta le trouble de son esprit. Visiblement, il luttait pourreconquérir son sang-froid et il n’ouvrit la bouche quelorsqu’il pensa y être parvenu. Cette pause semblaterrible à Elizabeth. Enfin, d’une voix qu’il réussit àmaintenir calme, il reprit :
– Ainsi, c’est là toute la réponse que j’aurai l’honneurde recevoir ! Puis-je savoir, du moins, pourquoi vous merepoussez avec des formes que n’atténue aucun effort depolitesse ? Mais, au reste, peu importe !
– Je pourrais aussi bien vous demander, répliquaElizabeth, pourquoi, avec l’intention évidente de meblesser, vous venez me dire que vous m’aimez contrevotre volonté, votre raison, et même le souci de votreréputation. N’est-ce pas là une excuse pour monimpolitesse – si impolitesse il y a ? – Mais j’ai d’autressujets d’offense et vous ne les ignorez pas. Quand vous nem’auriez pas été indifférent, quand même j’aurais eu de lasympathie pour vous, rien au monde n’aurait pu me faireaccepter l’homme responsable d’avoir ruiné, peut-êtrepour toujours, le bonheur d’une sœur très aimée.
À ces mots, Mr. Darcy changea de couleur mais son
émotion fut de courte durée, et il ne chercha même pas àinterrompre Elizabeth qui continuait :
– J’ai toutes les raisons du monde de vous mal juger :aucun motif ne peut excuser le rôle injuste et peugénéreux que vous avez joué en cette circonstance. Vousn’oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez étéle principal, sinon le seul artisan de cette séparation, quevous avez exposé l’un à la censure du monde pour salégèreté et l’autre à sa dérision pour ses espérancesdéçues, en infligeant à tous deux la peine la plus vive.
Elle s’arrêta et vit non sans indignation que Darcyl’écoutait avec un air parfaitement insensible. Il avaitmême en la regardant un sourire d’incrédulité affectée.
– Nierez-vous l’avoir fait ? répéta-t-elle.
Avec un calme forcé, il répondit :
– Je ne cherche nullement à nier que j’ai fait tout ceque j’ai pu pour séparer mon ami de votre sœur, ni que jeme suis réjoui d’y avoir réussi. J’ai été pour Bingley plusraisonnable que pour moi-même.
Elizabeth parut dédaigner cette réflexion aimable maisle sens ne lui en échappa point et, de plus en plus animée,elle reprit :
– Ceci n’est pas la seule raison de mon antipathie.Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J’aiappris à vous connaître par les révélations que m’a faitesMr. Wickham, voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet,qu’avez-vous à dire ? Quel acte d’amitié imaginaire
pouvez-vous invoquer pour vous défendre ou de quellefaçon pouvez-vous dénaturer les faits pour en donner uneversion qui vous soit avantageuse ?
– Vous prenez un intérêt bien vif aux affaires de cegentleman, dit Darcy d’un ton moins froid, tandis que sonvisage s’enflammait.
– Qui pourrait n’en point éprouver, quand on connaîtson infortune ?
– Son infortune ? répéta Darcy d’un ton méprisant.Son infortune est grande, en vérité !
– Et vous en êtes l’auteur. C’est vous qui l’avez réduità la pauvreté, – pauvreté relative, je le veux bien. C’estvous qui l’avez frustré d’avantages que vous lui saviezdestinés ; vous avez privé toute sa jeunesse del’indépendance à laquelle il avait droit. Vous avez fait toutcela, et la mention de son infortune n’excite que votreironie ?
– Alors, s’écria Darcy arpentant la pièce avec agitation,voilà l’opinion que vous avez de moi ! Je vous remercie deme l’avoir dite aussi clairement. Les charges énuméréesdans ce réquisitoire, certes, sont accablantes ; mais peut-être, dit-il en suspendant sa marche et en se tournantvers elle, auriez-vous fermé les yeux sur ces offenses sivotre amour-propre n’avait pas été froissé par laconfession honnête des scrupules qui m’ont longtempsempêché de prendre une décision. Ces accusations amèresn’auraient peut-être pas été formulées si, avec plus dediplomatie, j’avais dissimulé mes luttes et vous avais
affirmé que j’étais poussé par une inclination pure et sansmélange, par la raison, par le bon sens, par tout enfin.Mais la dissimulation sous n’importe quelle forme m’atoujours fait horreur. Je ne rougis pas d’ailleurs dessentiments que je vous ai exposés ; ils sont justes etnaturels. Pouviez-vous vous attendre à ce que je meréjouisse de l’infériorité de votre entourage ou que je mefélicite de nouer des liens de parenté avec des personnesdont la condition sociale est si manifestement au-dessousde la mienne ?
La colère d’Elizabeth grandissait de minute en minute.Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elleparvint à se contenir et répondit :
– Vous vous trompez, Mr. Darcy, si vous supposez quele mode de votre déclaration a pu me causer un autreeffet que celui-ci : il m’a épargné l’ennui que j’auraiséprouvé à vous refuser si vous vous étiez exprimé d’unemanière plus digne d’un gentleman.
Il tressaillit, mais la laissa continuer :
– Sous quelque forme que se fût produite votredemande, jamais je n’aurais eu la tentation de l’agréer.
De plus en plus étonné, Darcy la considérait avec uneexpression mêlée d’incrédulité et de mortificationpendant qu’elle poursuivait :
– Depuis le commencement, je pourrais dire dès lepremier instant où je vous ai vu, j’ai été frappée par votrefierté, votre orgueil et votre mépris égoïste dessentiments d’autrui. Il n’y avait pas un mois que je vous
connaissais et déjà je sentais que vous étiez le dernierhomme du monde que je consentirais à épouser.
– Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprendsparfaitement vos sentiments et il ne me reste plus qu’àregretter d’avoir éprouvé les miens. Pardonnez-moid’avoir abusé de votre temps et acceptez mes meilleursvœux pour votre santé et votre bonheur.
Il sortit rapidement sur ces mots et, un instant après,Elizabeth entendait la porte de la maison se refermer surlui. Le tumulte de son esprit était extrême. Tremblanted’émotion, elle se laissa tomber sur un siège et pleurapendant un long moment. Toute cette scène lui semblaitincroyable. Était-il possible que Mr. Darcy eût pu êtreépris d’elle depuis des mois, épris au point de vouloirl’épouser en dépit de toutes les objections qu’il avaitopposées au mariage de son ami avec Jane ? C’était assezflatteur pour elle d’avoir inspiré inconsciemment unsentiment aussi profond, mais l’abominable fierté de Mr.Darcy, la façon dont il avait parlé de Mr. Wickham sansessayer de nier la cruauté de sa propre conduite, eurentvite fait d’éteindre la pitié dans le cœur d’Elizabeth uninstant ému par la pensée d’un tel amour. Ces réflexionscontinuèrent à l’agiter jusqu’au moment où le roulementde la voiture de lady Catherine se fit entendre. Se sentantincapable d’affronter le regard observateur de Charlotte,elle s’enfuit dans sa chambre.
XXXVÀ son réveil, Elizabeth retrouva les pensées et les
réflexions sur lesquelles elle s’était endormie. Elle nepouvait revenir de la surprise qu’elle avait éprouvée laveille ; il lui était impossible de penser à autre chose.Incapable de se livrer à une occupation suivie, elle résolutde prendre un peu d’exercice après le déjeuner. Elle sedirigeait vers son endroit favori lorsque l’idée que Mr.Darcy venait parfois de ce côté l’arrêta. Au lieu d’entrerdans le parc, elle suivit le sentier qui l’éloignait de lagrand’route, tout en longeant la grille. Saisie par lecharme de cette matinée printanière, elle s’arrêta à l’unedes portes et jeta un coup d’œil dans le parc. L’aspect dela campagne avait beaucoup changé pendant les cinqsemaines qu’elle avait passées à Hunsford et les arbres lesplus précoces verdissaient à vue d’œil.
Elizabeth allait reprendre sa promenade lorsqu’elleaperçut une silhouette masculine dans le bosquet quiformait la lisière du parc. Craignant que ce ne fût Mr.Darcy, elle se hâta de battre en retraite ; mais celui qu’ellevoulait éviter était déjà assez près pour la voir et il fitrapidement quelques pas vers elle en l’appelant par sonnom. Elizabeth fit volte-face et revint vers la porte. Mr.Darcy y arrivait en même temps qu’elle, et, lui tendant
une lettre qu’elle prit instinctivement, il lui dit avec uncalme hautain :
– Je me promenais par ici depuis quelque temps dansl’espoir de vous rencontrer. Voulez-vous me fairel’honneur de lire cette lettre ? – Sur quoi, après un légersalut, il rentra dans le parc et fut bientôt hors de vue.
Sans en attendre aucune satisfaction, mais avec unevive curiosité, Elizabeth ouvrit l’enveloppe et fut surprised’y trouver deux grandes feuilles entièrement couvertesd’une écriture fine et serrée. Elle se mit à lire aussitôt touten marchant. La lettre contenait ce qui suit :
» Rosings, huit heures du matin.
« Ne craignez pas, Mademoiselle, en ouvrant cettelettre, que j’aie voulu y renouveler l’aveu de messentiments et la demande qui vous ont si fort offusquéehier soir. Je n’éprouve pas le moindre désir de vousimportuner, non plus que celui de m’abaisser en revenantsur une démarche que nous ne saurions oublier trop tôtl’un et l’autre. Je n’aurais pas eu la peine d’écrire cettelettre ni de vous la lire, si le soin de ma réputation nel’avait exigé. Vous excuserez donc la liberté que je prendsde demander toute votre attention. Ce que je ne sauraisattendre de votre sympathie, je crois pouvoir le réclamerde votre justice.
« Vous m’avez chargé hier de deux accusationsdifférentes de nature aussi bien que de gravité. Lapremière de ces accusations c’est que, sans égard pour lessentiments de l’un et de l’autre, j’avais détaché Mr.
Bingley de votre sœur. La seconde c’est qu’au mépris derevendications légitimes, au mépris des sentimentsd’honneur et d’humanité j’avais brisé la carrière et ruinéles espérances d’avenir de Mr. Wickham. Avoir ainsivolontairement et d’un cœur léger rejeté le compagnon dema jeunesse, le favori de mon père, le jeune homme quine pouvait guère compter que sur notre protection etavait été élevé dans l’assurance qu’elle ne lui manqueraitpas, témoignerait d’une perversion à laquelle le tort deséparer deux jeunes gens dont l’affection remontait àpeine à quelques semaines ne peut se comparer. Dublâme sévère que vous m’avez si généreusement infligéhier soir, j’espère cependant me faire absoudre lorsque lasuite de cette lettre vous aura mise au courant de ce quej’ai fait et des motifs qui m’ont fait agir. Si, au cours decette explication que j’ai le droit de vous donner, je metrouve obligé d’exprimer des sentiments qui vousoffensent, croyez bien que je le regrette, mais je ne puisfaire autrement, et m’en excuser de nouveau seraitsuperflu.
« Je n’étais pas depuis longtemps en Hertfordshirelorsque je m’aperçus avec d’autres que Bingley avaitdistingué votre sœur entre toutes les jeunes filles duvoisinage, mais c’est seulement le soir du bal deNetherfield que je commençai à craindre que cetteinclination ne fût vraiment sérieuse. Ce n’était pas lapremière fois que je le voyais amoureux. Au bal, pendantque je dansais avec vous, une réflexion de sir WilliamLucas me fit comprendre pour la première fois quel’empressement de Bingley auprès de votre sœur avait
convaincu tout le monde de leur prochain mariage. SirWilliam en parlait comme d’un événement dont la dateseule était indéterminée. À partir de ce moment,j’observai Bingley de plus près et je m’aperçus que soninclination pour miss Bennet dépassait ce que j’avaisremarqué jusque-là. J’observai aussi votre sœur : sesmanières étaient ouvertes, joyeuses et engageantescomme toujours mais sans rien qui dénotât unepréférence spéciale et je demeurai convaincu, après unexamen attentif, que si elle accueillait les attentions demon ami avec plaisir elle ne les provoquait pas en luilaissant voir qu’elle partageait ses sentiments. Si vous nevous êtes pas trompée vous-même sur ce point, c’est moiqui dois être dans l’erreur. La connaissance plus intimeque vous avez de votre sœur rend cette suppositionprobable. Dans ce cas, je me suis trouvé lui infliger unesouffrance qui légitime votre ressentiment ; mais jen’hésite pas à dire que la sérénité de votre sœur auraitdonné à l’observateur le plus vigilant l’impression que, siaimable que fût son caractère, son cœur ne devait pasêtre facile à toucher. J’étais, je ne le nie pas, désireux deconstater son indifférence, mais je puis dire avec sincéritéque je n’ai pas l’habitude de laisser influencer monjugement par mes désirs ou par mes craintes. J’ai cru àl’indifférence de votre sœur pour mon ami, non parce queje souhaitais y croire, mais parce que j’en étais réellementpersuadé.
« Les objections que je faisais à ce mariage n’étaientpas seulement celles dont je vous ai dit hier soir qu’ilm’avait fallu pour les repousser toute la force d’une
passion profonde. Le rang social de la famille dans laquelleil désirait entrer ne pouvait avoir pour mon ami la mêmeimportance que pour moi, mais il y avait d’autres motifsde répugnance, motifs qui se rencontrent à un égal degrédans les deux cas, mais que j’ai pour ma part essayéd’oublier parce que les inconvénients que je redoutaisn’étaient plus immédiatement sous mes yeux. Ces motifsdoivent être exposés brièvement.
« La parenté du côté de votre mère bien qu’elle fûtpour moi un obstacle n’était rien en comparaison du faiblesentiment des convenances trop souvent trahi par elle-même, par vos plus jeunes sœurs, parfois aussi par votrepère. Pardonnez-moi ; il m’est pénible de vous blesser,mais, dans la contrariété que vous éprouvez à entendreblâmer votre entourage, que ce soit pour vous uneconsolation de penser que ni vous, ni votre sœur, n’avezjamais donné lieu à la moindre critique de ce genre, etcette louange que tous se plaisent à vous décerner faitsingulièrement honneur au caractère et au bon sens dechacune. Je dois dire que ce qui se passa le soir du balconfirma mon jugement et augmenta mon désir depréserver mon ami de ce que je considérais comme unealliance regrettable.
« Comme vous vous en souvenez, il quitta Netherfieldle lendemain avec l’intention de revenir peu de joursaprès. Le moment est venu maintenant d’expliquer monrôle en cette affaire. L’inquiétude de miss Bingley avaitété également éveillée ; la similitude de nos impressionsfut bientôt découverte, et, convaincus tous deux qu’il n’y
avait pas de temps à perdre si nous voulions détacher sonfrère, nous résolûmes de le rejoindre à Londres où, àpeine arrivé, j’entrepris de faire comprendre à mon amiles inconvénients certains d’un tel choix. Je ne sais à quelpoint mes représentations auraient ébranlé ou retardé sadétermination, mais je ne crois pas qu’en fin de compteelles eussent empêché le mariage sans l’assurance que jen’hésitai pas à lui donner de l’indifférence de votre sœur.Il avait cru jusque-là qu’elle lui rendait son affectionsincèrement sinon avec une ardeur comparable à lasienne, mais Bingley a beaucoup de modestie naturelle etse fie volontiers à mon jugement plus qu’au sien. Leconvaincre qu’il s’était trompé ne fut pas chose difficile ; lepersuader ensuite de ne pas retourner à Netherfield futl’affaire d’un instant.
« Je ne puis me reprocher d’avoir agi de la sorte ; maisil y a autre chose dans ma conduite en cette affaire, quime cause moins de satisfaction. C’est d’avoir consenti àdes mesures ayant pour objet de laisser ignorer à monami la présence de votre sœur à Londres. J’en étaisinstruit moi-même aussi bien que miss Bingley, mais sonfrère n’en a jamais rien su. Ses sentiments ne mesemblaient pas encore assez calmés pour qu’il pût risquersans danger de la revoir. Peut-être cette dissimulationn’était-elle pas digne de moi. En tout cas, la chose est faiteet j’ai agi avec les meilleures intentions. Je n’ai rien deplus à ajouter sur ce sujet, pas d’autres explications àoffrir. Si j’ai causé de la peine à votre sœur, je l’ai fait sansm’en douter, et les motifs de ma conduite, qui doiventnaturellement vous sembler insuffisants, n’ont pas perdu
à mes yeux leur valeur.
« Quant à l’accusation plus grave d’avoir fait tort à Mr.Wickham, je ne puis la réfuter qu’en mettant sous vosyeux le récit de ses relations avec ma famille. J’ignore cedont il m’a particulièrement accusé ; mais de la vérité dece qui va suivre, je puis citer plusieurs témoins dont labonne foi est incontestable.
« Mr. Wickham est le fils d’un homme extrêmementrespectable qui, pendant de longues années, eut à régirtout le domaine de Pemberley. En reconnaissance dudévouement qu’il apporta dans l’accomplissement decette tâche, mon père s’occupa avec une bienveillancesans bornes de George Wickham qui était son filleul. Il sechargea des frais de son éducation au collège et àCambridge ; – aide inappréciable pour Mr. Wickham qui,toujours dans la gêne par suite de l’extravagance de safemme, se trouvait dans l’impossibilité de faire donner àson fils l’éducation d’un gentleman.
« Mon père, non seulement aimait la société de cejeune homme dont les manières ont toujours étéséduisantes, mais l’avait en haute estime ; il souhaitait luivoir embrasser la carrière ecclésiastique et se promettaitd’aider à son avancement. Pour moi, il y avait fortlongtemps que j’avais commencé à le juger d’une façondifférente. Les dispositions vicieuses et le manque deprincipes qu’il prenait soin de dissimuler à son bienfaiteurne pouvaient échapper à un jeune homme du même âgeayant l’occasion, qui manquait à mon père, de le voir dansdes moments où il s’abandonnait à sa nature.
« Me voilà de nouveau dans l’obligation de vous fairede la peine, – en quelle mesure, je ne sais. – Le soupçonqui m’est venu sur la nature des sentiments que vous ainspirés George Wickham ne doit pas m’empêcher devous dévoiler son véritable caractère et me donne mêmeune raison de plus de vous en instruire.
« Mon excellent père mourut il y a cinq ans, et, jusqu’àla fin, son affection pour George Wickham ne se démentitpoint. Dans son testament il me recommandait toutparticulièrement de favoriser l’avancement de sonprotégé dans la carrière de son choix et, au cas où celui-cientrerait dans les ordres, de le faire bénéficier d’une cureimportante qui est un bien de famille aussitôt que lescirconstances la rendraient vacante. Il lui laissait de plusun legs de mille livres.
« Le père de Mr. Wickham ne survécut pas longtempsau mien et, dans les six mois qui suivirent cesévénements, George Wickham m’écrivit pour me direqu’il avait finalement décidé de ne pas entrer dans lesordres. En conséquence, il espérait que je trouveraisnaturel son désir de voir transformer en un avantagepécuniaire la promesse du bénéfice ecclésiastique faite parmon père : « Je me propose, ajoutait-il, de faire mesétudes de droit, et vous devez vous rendre compte que larente de mille livres sterling est insuffisante pour me fairevivre. » J’aurais aimé à le croire sincère ; en tout cas,j’étais prêt à accueillir sa demande car je savaispertinemment qu’il n’était pas fait pour être clergyman.L’affaire fut donc rapidement conclue : en échange d’une
somme de trois mille livres, Mr. Wickham abandonnaittoute prétention à se faire assister dans la carrièreecclésiastique, dût-il jamais y entrer. Il semblaitmaintenant que toutes relations dussent être rompuesentre nous. Je ne l’estimais pas assez pour l’inviter àPemberley, non plus que pour le fréquenter à Londres.C’est là, je crois, qu’il vivait surtout, mais ses études dedroit n’étaient qu’un simple prétexte ; libre maintenantde toute contrainte, il menait une existence de paresse etde dissipation. Pendant trois ans c’est à peine si j’entendisparler de lui. Mais au bout de ce temps, la cure qui, jadis,lui avait été destinée, se trouvant vacante par suite de lamort de son titulaire, il m’écrivit de nouveau pour medemander de la lui réserver. Sa situation, me disait-il, – etje n’avais nulle peine à le croire, – était des plus gênées ; ilavait reconnu que le droit était une carrière sans aveniret, si je consentais à lui accorder le bénéfice en question, ilétait maintenant fermement résolu à se faire ordonner.Mon assentiment lui semblait indubitable car il savait queje n’avais pas d’autre candidat qui m’intéressâtspécialement, et je ne pouvais, certainement, avoir oubliéle vœu de mon père à ce sujet.
« J’opposai à cette demande un refus formel. Vous nem’en blâmerez pas, je pense, non plus que d’avoir résistéà toutes les tentations du même genre qui suivirent. Sonressentiment fut égal à la détresse de sa situation, et jesuis persuadé qu’il s’est montré aussi violent dans lespropos qu’il vous a tenus sur moi que dans les reprochesque je reçus de lui à cette époque. Après quoi, tousrapports cessèrent entre nous. Comment vécut-il, je
l’ignore ; mais, l’été dernier, je le retrouvai sur monchemin dans une circonstance extrêmement pénible, queje voudrais oublier, et que, seule, cette explication medécide à vous dévoiler. Ainsi prévenue, je ne doute pas devotre discrétion.
« Ma sœur, dont je suis l’aîné de plus de dix ans, a étéplacée sous une double tutelle, la mienne et celle du neveude ma mère, le colonel Fitzwilliam. Il y a un an environ, jela retirai de pension et l’installai à Londres. Quand vintl’été elle partit pour Ramsgate avec sa dame decompagnie. À Ramsgate se rendit aussi Mr. Wickham, etcertainement à dessein, car on découvrit ensuite qu’ilavait des relations antérieures avec Mrs. Younge, la damede compagnie, sur l’honorabilité de laquelle nous avionsété indignement trompés. Grâce à sa connivence et à sonaide, il arriva si bien à toucher Georgiana, dont l’âmeaffectueuse avait gardé un bon souvenir de son grandcamarade d’enfance, qu’elle finit par se croire éprise aupoint d’accepter de s’enfuir avec lui. Son âge, quinze ans àpeine, est sa meilleure excuse et, maintenant que je vousai fait connaître son projet insensé, je me hâte d’ajouterque c’est à elle-même que je dus d’en être averti. J’arrivaià l’improviste un jour ou deux avant l’enlèvement projeté,et Georgiana, incapable de supporter l’idée d’offenser unfrère qu’elle respecte presque à l’égal d’un père, meconfessa tout. Vous pouvez imaginer ce que je ressentisalors et quelle conduite j’adoptai. Le souci de la réputationde ma sœur et la crainte de heurter sa sensibilitéinterdisaient tout éclat, mais j’écrivis à Mr. Wickham quiquitta les lieux immédiatement, et Mrs. Younge, bien
entendu, fut renvoyée sur-le-champ. Le but principal deMr. Wickham était sans doute de capter la fortune de masœur, qui est de trente mille livres, mais je ne puism’empêcher de croire que le désir de se venger de moiétait aussi pour lui un puissant mobile. En vérité, savengeance eût été complète !
« Voilà, Mademoiselle, le fidèle récit des événementsauxquels nous nous sommes trouvés mêlés l’un et l’autre.Si vous voulez bien le croire exactement conforme à lavérité, je pense que vous m’absoudrez du reproche decruauté à l’égard de Mr. Wickham. J’ignore de quellemanière, par quels mensonges il a pu vous tromper.Ignorante comme vous l’étiez de tout ce qui nousconcernait, ce n’est pas très surprenant qu’il y ait réussi.Vous n’aviez pas les éléments nécessaires pour vouséclairer sur son compte, et rien ne vous disposait à ladéfiance.
« Vous vous demanderez, sans doute, pourquoi je nevous ai pas dit tout cela hier soir. Je ne me sentais pasassez maître de moi pour juger ce que je pouvais oudevais vous révéler. Quant à l’exactitude des faits quiprécèdent, je puis en appeler plus spécialement autémoignage du colonel Fitzwilliam qui, du fait de notreparenté, de nos rapports intimes et, plus encore, de saqualité d’exécuteur du testament de mon père, a étéforcément mis au courant des moindres détails. Sil’horreur que je vous inspire devait enlever à vos yeuxtoute valeur à mes assertions, rien ne peut vousempêcher de vous renseigner auprès de mon cousin. C’est
pour vous en donner la possibilité que j’essaierai demettre cette lettre entre vos mains dans le courant de lamatinée.
« Je n’ajoute qu’un mot : Dieu vous garde !
« Fitzwilliam DARCY. »
XXXVISi Elizabeth, lorsqu’elle avait pris la lettre de Mr.
Darcy, ne s’attendait pas à trouver le renouvellement desa demande, elle n’avait pas la moindre idée de ce qu’ellepouvait contenir. On se figure l’empressement qu’elle mità en prendre connaissance et les sentimentscontradictoires qui l’agitèrent pendant cette lecture. Toutd’abord, elle trouva stupéfiant qu’il crût possible de sejustifier à ses yeux. Elle était convaincue qu’il ne pouvaitdonner aucune explication dont il n’eût à rougir, et ce futdonc prévenue contre tout ce qu’il pourrait dire qu’ellecommença le récit de ce qui s’était passé à Netherfield.
Elle lisait si avidement que, dans sa hâte de passerd’une phrase à l’autre, elle était incapable de saisirpleinement le sens de ce qu’elle avait sous les yeux. Laconviction affirmée par Darcy au sujet de l’indifférence deJane fut accueillie avec la plus grande incrédulité, etl’énumération des justes objections qu’il faisait au mariagede Bingley avec sa sœur l’irritèrent trop pour qu’elleconsentît à en reconnaître le bien-fondé. Il n’exprimaitaucun regret qui pût atténuer cette impression ; le ton dela lettre n’était pas contrit mais hautain ; c’était toujoursle même orgueil et la même insolence.
Mais quand elle parvint au passage relatif à Wickham,
quand, avec une attention plus libre, elle lut un récit qui,s’il était vrai, devait ruiner l’opinion qu’avec tant decomplaisance elle s’était formée du jeune officier, elleressentit une impression plus pénible en même temps queplus difficile à définir. La stupéfaction, la crainte, l’horreurmême l’oppressèrent. Elle aurait voulu tout nier et necessait de s’exclamer en lisant : « C’est faux ! c’estimpossible ! Tout cela n’est qu’un tissu de mensonges ! »et lorsqu’elle eut achevé la lettre, elle se hâta de la mettrede côté en protestant qu’elle n’en tiendrait aucun compteet n’y jetterait plus les yeux.
Dans cet état d’extrême agitation, elle poursuivit samarche quelques minutes sans parvenir à mettre ducalme dans ses pensées. Mais bientôt, par l’effet d’uneforce irrésistible, la lettre se trouva de nouveau dépliée, etelle recommença la lecture mortifiante de tout ce qui avaittrait à Wickham, en concentrant son attention sur le sensde chaque phrase.
Ce qui concernait les rapports de Wickham avec lafamille de Pemberley et la bienveillance de Mr. Darcypère à son égard correspondait exactement à ce queWickham en avait dit lui-même. Sur ces points les deuxrécits se confirmaient l’un l’autre ; mais ils cessaientd’être d’accord sur le chapitre du testament. Elizabethavait encore présentes à la mémoire les paroles dontWickham s’était servi en parlant du bénéfice. Il étaitindéniable que d’un côté ou de l’autre, elle se trouvait enprésence d’une grande duplicité. Un instant, elle crutpouvoir se flatter que ses sympathies ne l’abusaient point,
mais après avoir lu et relu avec attention les détails quisuivaient sur la renonciation de Wickham au bénéficemoyennant une somme aussi considérable que trois millelivres sterling, elle sentit sa conviction s’ébranler.
Quittant sa lecture, elle se mit à réfléchir sur chaquecirconstance et à peser chaque témoignage en s’efforçantd’être impartiale, mais elle ne s’en trouva pas beaucoupplus avancée : d’un côté comme de l’autre, elle était enprésence de simples assertions. Elle reprit encore la lettreet, cette fois, chaque ligne lui prouva clairement que cetteaffaire, qu’elle croyait impossible de présenter de manièreà justifier Mr. Darcy, était susceptible de prendre unaspect sous lequel sa conduite apparaissait absolumentirréprochable.
L’accusation de prodigalité et de dévergondage portéecontre Wickham excitait cependant son indignation, –l’excitait d’autant plus, peut-être, qu’elle ne pouvait riendécouvrir qui en prouvât l’injustice. De la vie de Wickhamavant son arrivée en Hertfordshire, on ne connaissait quece qu’il en avait raconté lui-même. D’ailleurs, en eût-elleles moyens, Elizabeth n’aurait jamais cherché à savoir cequ’il était véritablement : son aspect, sa voix, sesmanières, l’avaient établi d’emblée à ses yeux dans lapossession de toutes les vertus. Elle essaya de retrouverdans son esprit quelque trait de délicatesse ou degénérosité qui pût le défendre contre les accusations deMr. Darcy, ou, tout au moins, en dénotant une réellevaleur morale, racheter ce qu’elle voulait considérercomme des erreurs passagères ; mais aucun souvenir de
ce genre ne lui revint à la mémoire. Elle revoyaitWickham avec toute la séduction de sa personne et de sesmanières, mais, à son actif, elle ne pouvait se rappelerrien de plus sérieux que la sympathie générale dont iljouissait à Meryton, et la faveur que son aisance et sonentrain lui avaient conquise parmi ses camarades.
Après avoir longuement réfléchi, elle reprit encore unefois sa lecture. Mais hélas ! le passage relatant les desseinsde Wickham sur miss Darcy se trouvait confirmé par laconversation qu’elle avait eue la veille avec le colonelFitzwilliam, et, finalement, Darcy la renvoyait autémoignage de Fitzwilliam lui-même, qu’elle savait être,plus que personne, au courant des affaires de son cousinet dont elle n’avait aucune raison de suspecter la bonnefoi. Un instant l’idée lui vint d’aller le trouver ; mais ladifficulté de cette démarche l’arrêta et aussi la convictionque Mr. Darcy n’aurait pas hasardé une telle propositions’il n’avait été certain que son cousin dût corroborertoutes ses affirmations.
Elle se rappelait parfaitement sa premièreconversation avec Wickham à la soirée de Mrs. Philips. Cequ’il y avait de malséant dans des confidences de ce genrefaites à une étrangère la frappait maintenant, et elles’étonna de ne l’avoir pas remarqué plus tôt. Elle voyaitl’indélicatesse qu’il y avait à se mettre ainsi en avant. Laconduite de Wickham ne concordait pas non plus avec sesdéclarations : ne s’était-il pas vanté d’envisager sanscrainte l’idée de rencontrer Mr. Darcy. Cependant, pasplus tard que la semaine suivante, il s’était abstenu de
paraître au bal de Netherfield. Et puis, tant que lesBingley étaient restés dans le pays, Wickham ne s’étaitconfié qu’à elle, mais, aussitôt leur départ, son histoireavait défrayé partout les conversations et il ne s’était pasfait scrupule de s’attaquer à la réputation de Mr. Darcy,bien qu’il lui eût assuré que son respect pour le pèrel’empêcherait toujours de porter atteinte à l’honneur dufils.
Comme il lui apparaissait maintenant sous un jourdifférent ! Ses assiduités auprès de miss King ne venaientplus que de vils calculs, et la médiocre fortune de la jeunefille, au lieu de prouver la modération de ses ambitions, lemontrait simplement poussé par le besoin d’argent àmettre la main sur tout ce qui était à sa portée. Sonattitude envers elle-même ne pouvait avoir de mobileslouables : ou bien il avait été trompé sur sa fortune, oubien il avait satisfait sa vanité en encourageant unesympathie qu’elle avait eu l’imprudence de lui laisser voir.
Dans ses derniers efforts pour le défendre, Elizabethmettait de moins en moins de conviction. D’autre part,pour la justification de Mr. Darcy, elle était obligée dereconnaître que Mr. Bingley, longtemps auparavant, avaitaffirmé à Jane la correction de son ami dans cette affaire.En outre, si peu agréables que fussent ses manières,jamais au cours de leurs rapports qui, plus fréquents endernier lieu, lui avaient permis de le mieux connaître, ellen’avait rien vu chez lui qui accusât un manque deprincipes ou qui trahît des habitudes répréhensibles aupoint de vue moral ou religieux. Parmi ses relations, il
était estimé et apprécié. S’il avait agi comme l’affirmaitWickham, une conduite si contraire à l’honneur et au bondroit n’aurait pu être tenue cachée, et l’amitié que luitémoignait un homme comme Bingley devenaitinexplicable.
Elizabeth se sentit envahir par la honte. Elle nepouvait penser à Darcy pas plus qu’à Wickham sansreconnaître qu’elle avait été aveugle, absurde, pleine departialité et de préventions.
– Comment, s’exclamait-elle, ai-je pu agir de la sorte ?Moi qui étais si fière de ma clairvoyance et qui ai sisouvent dédaigné la généreuse candeur de Jane ! Quelledécouverte humiliante ! Humiliation trop méritée !L’amour n’aurait pu m’aveugler davantage ; mais c’est lavanité, non l’amour, qui m’a égarée. Flattée de lapréférence de l’un, froissée du manque d’égards del’autre, je me suis abandonnée dès le début à mespréventions et j’ai jugé l’un et l’autre en dépit du bonsens.
D’elle à Bingley, de Bingley à Jane, ses penséesl’amenèrent bientôt au point sur lequel l’explication deDarcy lui avait paru insuffisante, et elle reprit la lettre.Très différent fut l’effet produit par cette seconde lecture.Comment pouvait-elle refuser à ses assertions, dans uncas, le crédit qu’elle s’était trouvée obligée de leur donnerdans l’autre ? Mr. Darcy déclarait qu’il n’avait pas cru àl’attachement de Jane pour son ami. Elizabeth se rappelal’opinion que Charlotte lui avait exprimée à ce sujet : elle-même se rendait compte que Jane manifestait peu ses
sentiments, même les plus vifs, et qu’il y avait dans sonair et dans ses manières une sérénité qui ne donnait pasl’idée d’une grande sensibilité.
Arrivée à la partie de la lettre où Mr. Darcy parlait desa famille en termes mortifiants, et pourtant mérités, elleéprouva un cruel sentiment de honte. La justesse de cettecritique était trop frappante pour qu’elle pût la contesteret les circonstances du bal de Netherfield, qu’il rappelaitcomme ayant confirmé son premier jugement, avaientproduit une impression non moins forte sur l’espritd’Elizabeth.
L’hommage que Darcy lui rendait ainsi qu’à sa sœur lacalma un peu, mais sans la consoler de la censure que lereste de sa famille s’était attirée. À la pensée que ladéception de Jane avait été en fait l’œuvre des siens etque chacune des deux sœurs pouvait être atteinte dans saréputation par de pareilles maladresses, elle ressentit undécouragement tel qu’elle n’en avait encore jamais connude semblable jusque-là.
Il y avait deux heures qu’elle arpentait le sentier,lorsque la fatigue et la pensée de son absence prolongée laramenèrent enfin vers le presbytère. Elle rentra avec lavolonté de montrer autant d’entrain que d’habitude etd’écarter toutes les pensées qui pourraient détourner sonesprit de la conversation.
Elle apprit en arrivant que les gentlemen de Rosingsavaient fait visite tous les deux en son absence ; Mr.Darcy était entré simplement quelques minutes pour
prendre congé, mais le colonel Fitzwilliam était resté aupresbytère plus d’une heure, dans l’attente de son retour,et parlait de partir à sa recherche jusqu’à ce qu’il l’eûtdécouverte. Elizabeth put à grand’peine feindre le regretde l’avoir manqué. Au fond, elle s’en réjouissait. Le colonelFitzwilliam ne l’intéressait plus à cette heure. La lettre,seule, occupait toutes ses pensées.
XXXVIILes deux cousins quittèrent Rosings le lendemain et
Mr. Collins qui avait été les attendre à la sortie du parcpour leur adresser un dernier et respectueux salut eut leplaisir de témoigner que ces messieurs paraissaient enexcellente santé et d’aussi bonne humeur qu’il se pouvaitaprès les adieux attristés qu’ils venaient d’échanger àRosings. Sur ce, il se hâta de se rendre à Rosings pourconsoler lady Catherine et sa fille. À son retour aupresbytère, il transmit avec grande satisfaction unmessage de Sa Grâce impliquant qu’elle s’ennuyait assezpour désirer les avoir tous à dîner le soir même.
Elizabeth ne put revoir lady Catherine sans serappeler que, si elle l’avait voulu, elle lui seraitmaintenant présentée comme sa future nièce, et ellesourit en se représentant l’indignation de Sa Grâce.
La conversation s’engagea d’abord sur le vide produitpar le départ de ses neveux.
– Je vous assure que j’en suis très affectée, dit ladyCatherine. Certes, personne ne sent plus que moi lechagrin d’être privé de ses amis, mais j’ai de plus pour cesdeux jeunes gens un attachement que je sais êtreréciproque. Ils étaient tous deux désolés de s’en aller.
Notre cher colonel a réussi cependant à garder del’entrain jusqu’à la fin, mais Darcy paraissait très ému,plus encore peut-être que l’an dernier. Il sembles’attacher de plus en plus à Rosings.
Ici, Mr. Collins plaça un compliment et une allusionque la mère et la fille accueillirent avec un sourirebienveillant.
Après le dîner, lady Catherine observa que missBennet paraissait songeuse et s’imaginant que laperspective de rentrer bientôt chez elle en était la cause,elle ajouta :
– Si c’est ainsi, écrivez à votre mère pour luidemander de vous laisser un peu plus longtemps. Mrs.Collins, j’en suis sûre, sera enchantée de vous garderencore.
– Je remercie Votre Grâce de cette aimable invitation,répondit Elizabeth, mais il m’est impossible de l’accepter ;je dois être à Londres samedi prochain.
– Quoi ! vous n’aurez fait ici qu’un séjour de sixsemaines ? Je m’attendais à vous voir rester deux mois.Mrs. Bennet peut certainement se passer de vous uneautre quinzaine.
– Oui, mais mon père ne le peut pas. Il m’a écritdernièrement pour me demander de hâter mon retour.
– Oh ! votre père peut aussi bien se passer de vousque votre mère. Si vous restiez un mois encore, jepourrais ramener l’une de vous jusqu’à Londres où j’irai
passer quelques jours au début de juin. Ma femme dechambre ne faisant pas de difficulté pour voyager sur lesiège, j’aurai largement de la place pour l’une de vous, etmême, comme vous êtes très minces l’une et l’autre, jeconsentirais volontiers à vous prendre toutes les deux, sile temps n’était pas trop chaud.
– Je suis touchée de votre bonté, madame, mais jecrois que nous devons nous en tenir à nos premiersprojets.
Lady Catherine parut se résigner.
– Mrs. Collins, vous aurez soin de faire escorter cesdemoiselles par un domestique. Vous savez que je distoujours ce que je pense, or je ne puis supporter l’idée quedeux jeunes filles voyagent seules en poste, ce n’est pasconvenable. Les jeunes filles doivent toujours êtreaccompagnées et protégées, selon leur rang. Quand manièce Georgiana est allée à Ramsgate l’été dernier, j’aitenu à ce qu’elle fût accompagnée de deux domestiques.Miss Darcy, fille de Mr. Darcy de Pemberley et de ladyAnne ne pouvait avec bienséance voyager d’une autrefaçon. Mrs. Collins, il faudra envoyer John avec cesdemoiselles. Je suis heureuse que cette idée me soitvenue à l’esprit. Vous vous feriez mal juger si vous leslaissiez partir seules.
– Mon oncle doit nous envoyer son domestique.
– Votre oncle ! Ah ! votre oncle a un domestique ? Jesuis heureuse que quelqu’un des vôtres ait pensé à cedétail. Où changez-vous de chevaux ? à Bromley,
naturellement. Recommandez-vous de moi à l’hôtel de« la Cloche » et l’on sera pour vous pleins d’égards.
Lady Catherine posa encore nombre de questions auxdeux jeunes filles sur leur voyage et, comme elle ne faisaitpas toutes les réponses elle-même, Elizabeth dut resterattentive à la conversation, ce qui était fort heureux caravec un esprit aussi absorbé que le sien, elle aurait risquéd’oublier où elle se trouvait. Mieux valait réserver sesréflexions pour les moments où elle s’appartiendrait.
Elle s’y replongeait dès qu’elle se retrouvait seule etfaisait chaque jour une promenade solitaire au cours delaquelle elle pouvait se livrer en paix aux délices deremuer des souvenirs désagréables. Elle connaissaitmaintenant presque par cœur la lettre de Mr. Darcy ; elleen avait étudié chaque phrase, et les sentiments qu’elleéprouvait pour son auteur variaient d’un moment àl’autre. Le souvenir de sa déclaration éveillait encore chezelle une vive indignation, mais quand elle considérait avecquelle injustice elle l’avait jugé et condamné, sa colère seretournait contre elle-même, et la déception de Darcy luiinspirait quelque compassion. Toutefois, il continuait à nepoint lui plaire ; elle ne se repentait pas de l’avoir refuséet n’éprouvait aucun désir de le revoir.
Elle trouvait une source constante de déplaisir dans lesouvenir de sa propre conduite et les fâcheux travers desa famille étaient un sujet de réflexion plus pénibleencore. De ce côté, il n’y avait malheureusement rien àespérer. Son père s’était toujours contenté de railler sesplus jeunes filles sans prendre la peine d’essayer de
réprimer leur folle étourderie ; et sa mère – dont lesmanières étaient si loin d’être parfaites – ne trouvait rienà redire à celles de ses benjamines. Elizabeth, ainsi queJane, s’était bien efforcée de modérer l’exubérance deCatherine et de Lydia, mais, aussi longtemps que celles-cise sentaient soutenues par l’indulgence de leur mère, àquoi pouvait-on aboutir ? D’un caractère faible, irritable,et subissant complètement l’influence de Lydia, Catherineavait toujours pris de travers les conseils de ses aînées ;Lydia insouciante, volontaire et entêtée, ne se donnaitmême pas la peine de les écouter. Toutes deux étaientparesseuses, ignorantes et coquettes. Tant qu’il resteraitun officier à Meryton, elles réussiraient à flirter avec lui ettant que Meryton serait à proximité de Longbourn, ellescontinueraient à y passer tout leur temps.
Mais c’était à sa sœur aînée que pensait le plusElizabeth. En disculpant Bingley, les explications de Darcyavaient fait mieux sentir tout ce que Jane avait perdu.Maintenant qu’elle avait la preuve de la sincérité de sonamour et de la loyauté de sa conduite, quelle tristessepour Elizabeth de penser que le manque de bon sens et decorrection des siens avait privé Jane d’un parti quiprésentait de telles garanties de bonheur !
Toutes ces réflexions auxquelles venait s’ajouter ledésappointement causé par la révélation du véritablecaractère de Mr. Wickham ne laissaient pas d’assombrirson esprit ordinairement si enjoué, et il lui fallait faireeffort pour conserver en public son air de gaieté.
Les invitations de lady Catherine furent pendant la
dernière semaine de leur séjour aussi fréquentes qu’audébut. C’est au château que se passa la dernière soirée. SaGrâce s’enquit minutieusement des moindres détails duvoyage, donna des conseils sur la meilleure méthode pourfaire les bagages et insista tellement sur la manière donton devait plier les robes que Maria, au retour, se crutobligée de défaire sa malle et de la recommencer de fonden comble. Quand on prit congé, lady Catherine, pleine debienveillance, souhaita bon voyage aux jeunes filles et lesinvita à revenir l’année suivante à Hunsford, pendant quemiss de Bourgh condescendait à faire une révérence et àleur tendre la main à toutes deux.
XXXVIIILe samedi matin, Elizabeth et Mr. Collins arrivèrent à
la salle à manger quelques minutes avant les autres. Mr.Collins en profita pour faire à sa cousine les complimentsd’adieu qu’il jugeait indispensables.
– Je ne sais, miss Elizabeth, si Mrs. Collins vous a déjàdit combien votre visite l’avait touchée, mais je suiscertain que vous ne quitterez pas cette maison sansrecevoir ses remerciements. Nous savons que notrehumble demeure n’a rien de très attirant. Nos habitudessimples, notre domesticité restreinte, la vie calme quenous menons, font de Hunsford une résidence un peumorne pour une jeune fille. Aussi, croyez bien que nousavons su apprécier la faveur de votre présence et quenous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour quele temps ne vous semble pas trop long.
Elizabeth s’empressa d’exprimer sa gratitude etd’assurer qu’elle était enchantée de son séjour àHunsford. Le plaisir de se retrouver avec Charlotte, lesaimables attentions dont elle avait été l’objet avaientrendu ces six semaines fort agréables pour elle.
Mr. Collins, satisfait, reprit avec une solennité plussouriante :
– Je suis heureux que vous ne vous soyez pasennuyée. Nous avons certainement fait de notre mieux, etcomme nous avions la bonne fortune de vous présenterdans la société la plus choisie, j’ose dire que votre séjour àHunsford n’a pas été entièrement dénué d’intérêt. Nosrapports avec la famille de lady Catherine sontvéritablement un avantage dont peu de personnespeuvent se prévaloir. À dire vrai, si modeste que soitcette demeure, je dois reconnaître que tous ceux qui yséjournent ne sont pas à plaindre, aussi longtemps qu’ilspartagent l’intimité de nos relations avec Rosings.
Ici, les mots manquèrent à Mr. Collins pour exprimerla chaleur de ses sentiments, et il dut faire le tour de lasalle à manger pendant qu’Elizabeth essayait en quelquesphrases brèves de concilier la franchise avec la politesse.
– Vous pourrez en somme faire autour de vous unrapport favorable de ce que vous avez vu ici, ma chèrecousine. Vous avez été le témoin journalier des attentionsde lady Catherine pour Mrs. Collins. Il ne semble pas, jepense, que votre amie ait à regretter… mais autant vautsur ce point garder le silence. Laissez-moi seulement, machère cousine, vous souhaiter du fond du cœur autant defélicité dans le mariage. Ma chère Charlotte et moin’avons qu’un même esprit, qu’une même pensée : il y aentre nous une similitude de caractère et de goûtsvraiment extraordinaire. Il semble que nous ayons étécréés l’un pour l’autre.
Elizabeth put affirmer avec sincérité que c’était làcertes une précieuse garantie de bonheur, et ajouter avec
une égale sincérité qu’elle se réjouissait des agréments desa vie domestique ; mais elle ne fut pas fâchée de voirinterrompre le tableau de cette félicité par l’entrée decelle qui en était l’auteur. Pauvre Charlotte ! C’étaitvraiment triste de l’abandonner à une telle société.Cependant, elle avait fait son choix en connaissance decause, et, tout en regrettant le départ de ses visiteuses,elle ne semblait pas réclamer qu’on la plaignît. Sa maison,son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tous les intérêtsqui en dépendaient n’avaient point encore perdu leurscharmes à ses yeux.
Enfin, la chaise de poste arriva. On hissa les malles, oncasa les paquets, et l’on vint annoncer que tout était prêtpour le départ ; des adieux affectueux furent échangésavec Charlotte, après quoi Mr. Collins accompagnaElizabeth jusqu’à la voiture, en la chargeant de sesrespects pour tous les siens, à quoi il ajouta desremerciements pour la bonté qu’on lui avait témoignée àLongbourn l’hiver précédent et des compliments pour Mr.et Mrs. Gardiner qu’il n’avait jamais vus. Il avait prêtéson aide à Elizabeth, puis à Maria pour monter en voitureet la portière allait se refermer lorsqu’il leur rappelasoudain d’un air consterné qu’elles avaient oublié delaisser un message pour les châtelaines de Rosings.
– Mais, bien entendu, ajouta-t-il, vous souhaitez que jeleur présente vos humbles respects avec l’expression devotre gratitude pour la bienveillance qu’elles vous onttémoignée pendant votre séjour ici.
Elizabeth ne fit aucune objection ; on put enfin fermer
la portière et la voiture s’ébranla.
– Seigneur ! s’écria Maria après quelques minutes desilence, il semble que nous ne soyons arrivées que d’hier !Pourtant, que de choses se sont passées depuis…
– Oui, que de choses ! dit sa compagne avec un soupir.
– Nous avons dîné neuf fois à Rosings, sans compterles deux fois où nous sommes allés y prendre le thé. Quen’aurai-je pas à raconter à la maison !
« Et moi, que n’aurai-je pas à taire ! » songeaElizabeth.
Le voyage s’effectua sans encombre, et quatre heuresaprès avoir quitté Hunsford, elles débarquèrent chez lesGardiner où elles devaient rester quelques jours.
Jane semblait être en bonne santé ; quant à son étatd’esprit, Elizabeth n’eut guère le temps de s’en rendrecompte au milieu des distractions de tout genre quel’amabilité de leur tante leur avait ménagées. Maispuisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, ellepourrait l’y observer à loisir.
XXXIXCe fut dans la seconde semaine de mai que les trois
jeunes filles partirent de Gracechurch street à destinationde la ville de ***, en Hertfordshire. Comme ellesapprochaient de l’auberge, où la voiture de Mr. Bennetdevait les attendre, elles eurent la preuve de l’exactitudedu cocher en voyant paraître Kitty et Lydia à la fenêtred’une salle à manger du premier étage. Ces demoiselles,qui étaient arrivées depuis une heure, avaientagréablement employé leur temps à visiter le magasind’une modiste, à contempler la sentinelle du poste d’enface et à préparer une salade de concombres.
Après les premières effusions, elles désignèrent unetable garnie de viande froide telle que peut en fournir ungarde-manger d’auberge.
– Qu’en dites-vous ? s’exclamèrent-elles d’un airtriomphant. N’est-ce pas une bonne surprise ?
– Et c’est nous qui vous offrons ce lunch, ajouta Lydia.Seulement, vous nous prêterez de quoi le payer car nousavons vidé notre bourse dans le magasin d’en face. – Etmontrant ses achats : – Tenez, j’ai acheté ce chapeau. Iln’a rien de très remarquable, mais je le démolirai enrentrant pour voir si je puis en tirer quelque chose.
Ses sœurs l’ayant déclaré affreux, Lydia poursuivitsans se troubler :
– Oh ! les autres étaient encore bien plus laids, danscette boutique. Quand j’aurai acheté du satin d’une plusjolie nuance pour le regarnir, je crois qu’il ne fera pas mal.Du reste, qu’importe ce que nous mettrons cet été, unefois que le régiment sera parti ? car il s’en va dans unequinzaine.
– Vraiment, il s’en va ? s’écria Elizabeth avecsatisfaction.
– Oui, il quitte Meryton pour aller camper près deBrighton. Oh ! je voudrais tant que papa nous emmènetoutes là-bas pour y passer l’été ! Ce serait délicieux, etne coûterait pas très cher. Maman, aussi, ne demandequ’à y aller avec nous. Autrement, imaginez ce que nousallons nous ennuyer tout l’été à Longbourn !
– En effet, pensa Elizabeth, voilà bien ce qu’il nousfaut. Bonté divine ! Brighton et tout un camp de militairesalors qu’un malheureux régiment de la milice et quelquessoirées à Meryton ont suffi pour nous tourner la tête !
– Maintenant, j’ai une nouvelle à vous annoncer, ditLydia, comme elles se mettaient à table. Devinez un peu !Une nouvelle excellente, sensationnelle, et concernantquelqu’un que nous aimons toutes.
Jane et Elizabeth se regardèrent et l’une d’elles avertitle domestique qu’on n’avait plus besoin de ses services.Lydia se mit à rire.
– Je reconnais bien là votre discrétion et votre amourdes convenances. Comme si le serveur se souciait de ceque nous racontons ! Il en entend bien d’autres ! Mais peuimporte ; il est si laid, je suis contente qu’il soit parti, etmaintenant voici ma nouvelle ; c’est au sujet de ce cherWickham ; il n’y a plus à craindre qu’il épouse Mary King :elle est partie habiter chez son oncle à Liverpool, partiepour de bon ; Wickham est sauvé !
– Mary King aussi, ajouta Elizabeth, elle évite unmariage imprudent quant à la fortune.
– Elle est bien sotte d’être partie, si elle l’aimait.
– Mais j’espère, dit Jane, que le cœur n’étaitsérieusement pris ni d’un côté ni de l’autre.
– Pas du côté de Wickham, en tout cas, je m’en portegarante. Qui pourrait aimer un laideron pareil, avectoutes ses taches de rousseur ?
Elizabeth fut confuse de penser que, la vulgaritéd’expression mise à part, ce jugement différait peu decelui qu’elle avait porté elle-même en le qualifiant dedésintéressé.
Le lunch terminé, la note réglée par les aînées, ondemanda la voiture et, grâce à d’ingénieux arrangements,les cinq jeunes filles parvinrent à s’y caser avec leursmalles, leurs valises, leurs paquets, et le supplément peudésiré que formaient les emplettes de Lydia.
– Eh bien, nous voilà gentiment entassées ! s’exclamacelle-ci. Je ne regrette pas d’avoir acheté cette capote,
quand ce ne serait que pour le plaisir d’avoir un carton deplus. Et maintenant que nous sommes confortablementinstallées, nous pouvons causer et rire jusqu’à la maison.Racontez-nous pour commencer ce que vous avez faitdepuis votre départ. Avez-vous rencontré de beauxjeunes gens ? Avez-vous beaucoup flirté ? J’avais un peul’espoir que l’une de vous ramènerait un mari. Ma parole,Jane sera bientôt une vieille fille, elle qui a presque vingt-trois ans ! Dieu du ciel ! que je serais mortifiée si je n’étaispas mariée à cet âge-là ! Vous n’avez pas idée du désirqu’a ma tante Philips de vous voir mariées toutes lesdeux. Elle trouve que Lizzy aurait mieux fait d’accepterMr. Collins ; mais je ne vois pas, pour ma part, ce que celaaurait eu de particulièrement divertissant. Mon Dieu !que je voudrais donc me marier avant vous toutes ! Jepourrais ensuite vous chaperonner dans les bals. Oh !dites, ce que nous nous sommes amusées l’autre jour chezle colonel Forster où nous étions allées, Kitty et moi,passer la journée… Mrs. Forster avait promis que l’ondanserait le soir (à propos, nous sommes au mieux, Mrs.Forster et moi). Elle avait invité aussi les deuxHarrington, mais Harriet était malade et Pen a dû venirseule. Alors, devinez ce que nous avons fait ? Pour avoirune danseuse de plus, nous avons habillé Chamberlayneen femme. Vous pensez si c’était drôle ! Personne n’étaitau courant, sauf les Forster, Kitty et moi, et aussi matante, à qui nous avions dû emprunter une robe. Vous nepouvez vous figurer comme Chamberlayne était réussi !Quand Denny, Wickham, Pratt et deux ou trois autressont entrés, ils ne l’ont pas reconnu. Dieu ! ce que j’ai ri, et
Mrs. Forster aussi ! J’ai cru que j’en mourrais ! C’est cequi a donné l’éveil aux autres et ils ont eu vite faitd’éventer la plaisanterie.
Avec des histoires de ce genre, Lydia, secondée àl’occasion par Kitty, s’efforça tout le long de la route dedistraire ses compagnes. Elizabeth écoutait le moinspossible, mais force lui était d’entendre le nom deWickham qui revenait fréquemment.
La réception qu’on leur fit à Longbourn fut trèschaude. Mrs. Bennet se réjouissait de voir que Janen’avait rien perdu de sa beauté, et, pendant le repas, Mr.Bennet redit plusieurs fois à Elizabeth :
– Je suis heureux de vous voir de retour, Lizzy.
La salle à manger était pleine, presque tous les Lucasétant venus chercher Maria, et les sujets de conversationétaient nombreux et variés. Lady Lucas demandait à safille à travers la table des nouvelles de l’installation deCharlotte et de son poulailler. Mrs. Bennet était occupéed’un côté à se faire donner par Jane des renseignementssur la mode actuelle et de l’autre à les transmettre auxplus jeunes misses Lucas, et Lydia, d’une voix sonore quicouvrait toutes les autres, énumérait à qui voulaitl’entendre les distractions de leur matinée.
– Oh ! Mary, vous auriez dû venir avec nous. Nousavons tant ri ! Au départ, nous avions baissé les storespour faire croire que la voiture était vide et nous lesaurions gardés ainsi jusqu’au bout si Kitty n’avait pas eumal au cœur. Au « George », nous avons vraiment bien
fait les choses, car nous avons offert aux voyageuses undélicieux lunch froid. Vous en auriez profité. En repartant,nous avons cru que nous ne pourrions jamais nous caserdans la voiture ; c’était drôle comme tout ! J’ai failli enmourir de rire ; et, tout le retour, nous avons été d’unegaieté !… Nous faisions tant de bruit qu’on devait nousentendre à trois lieues à la ronde !
– Je ne voudrais pas, ma chère sœur, répliquagravement Mary, décrier de tels plaisirs. Ils conviennent,je le sais, à la généralité des femmes ; mais ils n’ont pourmoi aucune espèce de charme et une heure de lecture mesemble infiniment préférable.
Mais Lydia n’entendit pas un mot de cette réponse.Elle écoutait rarement plus d’une demi-minute et neprêtait jamais la moindre attention à ce que disait Mary.
L’après-midi, elle pressa vivement ses sœurs ainsi queles autres jeunes filles de venir faire un tour à Meryton,mais Elizabeth s’y opposa avec fermeté. Il ne serait pasdit que les demoiselles Bennet ne pouvaient passer unedemi-journée chez elles sans partir à la poursuite desofficiers. Pour refuser, elle avait encore un autre motif :c’était d’éviter le plus longtemps possible le risque d’unerencontre avec Wickham. Le prochain départ du régimentlui causait un soulagement inexprimable. Dans unequinzaine, il serait loin, et elle pourrait l’oubliercomplètement.
Elle n’était pas depuis longtemps à Longbourn quandelle s’aperçut que le projet de séjour à Brighton, auquel
Lydia avait fait allusion, était un sujet de fréquentesdiscussions entre ses parents. Elle vit tout de suite queMr. Bennet n’avait pas la moindre intention de céder auxinstances de sa femme ; mais en même temps, lesréponses qu’il lui faisait étaient si vagues et si équivoquesque Mrs. Bennet, bien que souvent découragée, neperdait pas l’espoir d’arriver à ses fins.
XLElizabeth ne pouvait contenir plus longtemps
l’impatience qu’elle éprouvait de mettre Jane au courantde ce qui s’était passé à Hunsford, en supprimantnaturellement tous les détails qui se rapportaient à sasœur. Elle lui annonça donc le lendemain qu’elle allait luicauser une grande surprise et commença le récit de lascène qui avait eu lieu entre elle et Mr. Darcy.
L’affection fraternelle de Jane lui faisait trouver toutnaturel qu’on éprouvât de l’admiration pour Elizabeth,aussi sa surprise fut-elle modérée et fit bientôt place àd’autres sentiments. Elle était fâchée que Mr. Darcy eûtplaidé sa cause en termes si peu faits pour le servir, maiselle était encore plus désolée de la peine que le refus de sasœur lui avait causé.
– Il n’aurait certainement pas dû se montrer si sûr deréussir, mais songez combien cette confiance a augmentésa déception.
– Je le regrette infiniment, dit Elizabeth ; mais il ad’autres sentiments qui l’aideront, j’en suis sûre, à seconsoler vite. Vous ne me désapprouvez pas de l’avoirrefusé ?
– Vous désapprouver ? oh non !
– Mais vous me blâmez d’avoir pris le parti deWickham avec autant de chaleur ?
– Non plus. Je ne vois pas que vous ayez eu tort dedire ce que vous m’avez répété.
– Vous ne penserez plus de même lorsque vous saurezla suite.
Elizabeth alors parla de la lettre et dit tout ce qu’ellecontenait concernant Wickham. Quel coup pour la pauvreJane qui aurait parcouru le monde entier sans s’imaginerqu’il existât dans toute l’humanité autant de noirceurqu’elle en découvrait en ce moment dans un seul homme !
Même la justification de Darcy, qui lui causait unevraie joie, ne put suffire à la consoler de cette tristedécouverte. Et elle s’opiniâtrait à croire que tout cecin’était qu’une erreur, et à vouloir innocenter l’un sansaccuser l’autre.
– C’est inutile ! dit Elizabeth ; vous ne parviendrezjamais à les transformer en saints tous les deux ! Il fautchoisir. Leurs vertus et leurs mérites ne sont pas assezabondants pour pouvoir en faire deux parts convenables.Quant à moi, je suis disposée à donner la palme à Mr.Darcy : mais libre à vous de ne pas m’imiter !
Il fallut encore un peu de temps pour que le sourirereparût sur les lèvres de Jane.
– Jamais je n’ai été aussi bouleversée, dit-elle.Wickham perverti à ce point ! C’est à n’y pas croire ! Et cepauvre Mr. Darcy ! Pensez à ce qu’il a dû souffrir : en
même temps qu’il éprouvait une si grande déception,apprendre la mauvaise opinion que vous aviez de lui, et sevoir obligé de vous raconter l’aventure de sa sœur ! C’estvraiment trop pénible. Je suis sûre que vous le sentezcomme moi.
– Oh non ! mes regrets et ma compassions’évanouissent quand je vois l’ardeur des vôtres. Lasympathie que vous prodiguez à Mr. Darcy me dispensede le plaindre et, si vous continuez à vous apitoyer sur lui,je me sentirai le cœur aussi léger qu’une plume.
– Pauvre Wickham ! Il y a dans sa personne un tel airde droiture, et dans ses manières, tant de franchise et dedistinction !
– Il est certain que, de ces deux hommes, l’un possèdeles qualités et l’autre en a l’apparence.
– Je n’ai jamais trouvé que Mr. Darcy n’en eût pasaussi l’apparence.
– Il y a un point sur lequel je voudrais votre avis.Faut-il ouvrir les yeux de nos amis sur la véritablepersonnalité de Wickham ?
Après avoir réfléchi un instant :
– Je ne vois pas, répondit Jane, la nécessité de le livrerainsi au mépris général. Vous-même, qu’en pensez-vous ?
– Je crois qu’il vaut mieux se taire. Mr. Darcy ne m’apas autorisée à publier ses confidences. D’ailleurs, tout cequi a trait à sa sœur doit être gardé secret. Sij’entreprends d’éclairer l’opinion sur les autres points, on
ne me croira pas. Les préventions contre Mr. Darcy sonttelles que si j’essayais de le faire voir sous un meilleurjour, la moitié des bonnes gens de Meryton en feraientune maladie. Cette idée me paralyse… Du reste, Wickhamva s’en aller. Une fois parti, peu importe que l’on sache ounon ce qu’il est en réalité.
– Vous avez tout à fait raison : en publiant ses fautes,on pourrait le perdre sans retour. Peut-être se repent-ilmaintenant de sa conduite et s’efforce-t-il de s’amender.Il ne faut pas l’en décourager.
Cette conversation calma l’agitation d’Elizabeth.Déchargée enfin de deux des secrets dont elle avait portéle poids durant cette quinzaine, elle avait le réconfort desentir maintenant près d’elle une sœur toujours prête àaccueillir ses confidences. Toutefois, il y avait encore unechose que la prudence lui interdisait de découvrir : ellen’osait faire connaître à Jane le reste de la lettre de Mr.Darcy, ni lui révéler la sincérité du sentiment que Mr.Bingley avait eu pour elle.
Maintenant qu’elle était au calme, Elizabeth pouvait serendre compte du véritable état d’esprit de sa sœur. Jane,elle s’en aperçut vite, n’était pas consolée. Elle conservaitpour Bingley une tendre affection et comme son cœurauparavant n’avait jamais été touché, cette inclinationavait la force d’un premier amour auquel son âge et soncaractère donnaient une constance qu’on ne voit pasd’ordinaire dans les attachements de première jeunesse ;et telle était la ferveur de ses souvenirs et de sa fidélité àl’objet de son choix, qu’il lui fallait toute sa raison et un vif
désir de ne chagriner personne pour ne pas s’abandonnerà des regrets capables d’altérer sa santé et de troubler latranquillité des siens.
– Eh bien, Lizzy, dit un jour Mrs. Bennet, que pensez-vous de cette malheureuse histoire de Jane ? Quant àmoi, je suis bien décidée à n’en plus parler à personne ; jele disais encore à votre tante Philips l’autre jour. À ce quej’ai compris, Jane n’a pas vu Mr. Bingley à Londres. Cejeune homme est vraiment un triste personnage et jecrois qu’il n’y a plus de ce côté aucun espoir pour votresœur. Il n’est pas question de son retour à Netherfield, cetété, m’ont dit les gens qualifiés pour le savoir à qui je l’aidemandé.
– Je ne crois pas qu’il revienne jamais.
– Oh ! qu’il fasse ce qu’il voudra. Personne ne luidemande de revenir. Mais je n’en affirme pas moins qu’ils’est fort mal conduit envers ma fille et qu’à la place deJane, je ne l’aurais pas supporté. Lorsqu’elle sera mortede chagrin, je suis sûre qu’il regrettera ce qu’il a fait.
Mais Elizabeth, à qui cette perspective ne donnaitaucun réconfort, garda le silence.
– Alors, Lizzy, reprit bientôt sa mère, les Collinsmènent une existence confortable. C’est bien, c’est trèsbien ; j’espère seulement que cela durera… Et commentmange-t-on chez eux ? Je suis sûre que Charlotte est uneexcellente ménagère ; si elle est seulement moitié aussiserrée que sa mère, elle fera d’assez sérieuses économies.Il n’y a rien d’extravagant, je présume, dans leur manière
de vivre.
– Non, rien du tout.
– On doit regarder de près à la dépense, croyez-moi.Certes, en voilà qui auront soin de ne pas dépasser leurrevenu ! Ils ne connaîtront jamais les embarras d’argent.Tant mieux pour eux ! Je pense qu’ils parlent souvent dujour où, votre père disparu, ils seront maîtres de cettepropriété. Ils considèrent sans doute Longbourn commeleur appartenant déjà.
– Ce sujet, ma mère, ne pouvait être abordé devantmoi.
– Non, c’eût été plutôt étrange de leur part ; mais je nedoute pas qu’ils n’en causent souvent entre eux. Tantmieux, si leur conscience leur permet de prendre undomaine qui ne devrait pas leur revenir. Pour ma part,j’aurais honte d’un héritage qui m’arriverait dans de tellesconditions !
XLILa semaine du retour fut vite écoulée. Celle qui suivit
devait être la dernière que le régiment passait à Meryton.Toute la jeunesse féminine du voisinage donnait les signesd’un profond abattement. La tristesse semblaituniverselle. Seules, les aînées des demoiselles Bennetétaient encore en état de manger, dormir, et vaquer àleurs occupations ordinaires. Cette insensibilité leur étaitdu reste souvent reprochée par Kitty et Lydia dont ladétresse était infinie et qui ne pouvaient comprendre unetelle dureté de cœur chez des membres de leur famille.
– Mon Dieu, qu’allons-nous faire ? qu’allons-nousdevenir ? s’exclamaient-elles sans cesse dans l’amertumede leur désespoir. Comment avez-vous le cœur de sourireainsi, Lizzy ?
Leur mère compatissait à leur chagrin, en se rappelantce qu’elle avait souffert elle-même vingt-cinq ansauparavant, dans de semblables circonstances.
– Moi aussi, j’ai pleuré deux jours entiers, lorsque lerégiment du colonel Millar est parti. Je croyais bien quemon cœur allait se briser.
– Le mien n’y résistera pas, j’en suis sûre, déclaraLydia.
– Si seulement on pouvait aller à Brighton ! fit Mrs.Bennet.
– Oui, si on le pouvait ! mais papa ne fait rien pournous être agréable.
– Quelques bains de mer me rendraient la santé pourlongtemps.
– Et ma tante Philips est convaincue que cela me feraitaussi le plus grand bien, ajoutait Kitty.
Telles étaient les lamentations qui ne cessaient derésonner à Longbourn. Elizabeth aurait voulu en rire,mais cette idée céda bientôt à un sentiment de honte. Ellesentit de nouveau la justesse des appréciations de Darcyet comprit comme elle ne l’avait point fait encore sonintervention dans les projets de son ami.
Mais toutes les sombres idées de Lydia s’envolèrentcomme par enchantement lorsqu’elle reçut de Mrs.Forster, la femme du colonel du régiment, une invitation àl’accompagner à Brighton. Cette amie incomparable étaitune femme toute jeune et tout récemment mariée ; labonne humeur et l’entrain qui les caractérisaient toutesdeux l’avaient vite rapprochée de Lydia. Leurs relationsne dataient que de trois mois et, depuis deux mois déjà,elles étaient sur un pied de grande intimité.
Les transports de Lydia, à cette nouvelle, la joie de samère, la jalousie de Kitty ne peuvent se décrire. Lydia,ravie, parcourait la maison en réclamant bruyamment lesfélicitations de tout le monde, tandis qu’au salon, Kitty
exhalait son dépit en termes aussi aigres qu’excessifs.
– Je ne vois pas pourquoi Mrs. Forster ne m’a pasinvitée aussi bien que Lydia. J’ai autant de droits qu’elle àêtre invitée, plus même, puisque je suis son aînée de deuxans.
En vain Elizabeth essayait-elle de la raisonner, et Janede lui prêcher la résignation.
Elizabeth était si loin de partager la satisfaction deMrs. Bennet qu’elle considérait cette invitation comme leplus sûr moyen de faire perdre à Lydia tout ce qui luirestait de bon sens ; aussi, malgré sa répugnance pourcette démarche, elle ne put s’empêcher d’aller trouverson père pour lui demander de ne point la laisser partir.Elle lui représenta le manque de tenue de sa sœur, le peude profit qu’elle tirerait de la société d’une personnecomme Mrs. Forster, et les dangers qu’elle courrait àBrighton où les tentations étaient certainement plusnombreuses que dans leur petit cercle de Meryton.
Mr. Bennet, après l’avoir écoutée attentivement, luirépondit :
– Lydia ne se calmera pas tant qu’elle ne sera pasexhibée dans un endroit à la mode. Or, nous ne pouvonsespérer qu’elle trouvera une meilleure occasion de le faireavec aussi peu de dépense et d’inconvénient pour le restede sa famille.
– Si vous saviez le tort que Lydia peut nous causer, –ou plutôt nous a causé déjà, – par la liberté et la hardiessede ses manières, je suis sûre que vous en jugeriez
autrement.
– Le tort que Lydia nous a causé ! répéta Mr. Bennet.Quoi ? aurait-elle mis en fuite un de vos soupirants ?Pauvre petite Lizzy ! Mais remettez-vous ; les espritsassez délicats pour s’affecter d’aussi peu de chose neméritent pas d’être regrettés. Allons, faites-moi la liste deces pitoyables candidats que cette écervelée de Lydia aeffarouchés.
– Vous vous méprenez. Je n’ai point de tels griefs etc’est à un point de vue général et non particulier que jeparle en ce moment. C’est notre réputation, notrerespectabilité qui peut être atteinte par la folle légèreté,l’assurance et le mépris de toute contrainte qui forment lefond du caractère de Lydia. Excusez-moi, mon père, devous parler avec cette franchise, mais si vous ne prenezpas la peine de réprimer vous-même son exubérance etde lui apprendre que la vie est faite de choses plussérieuses que celles qui l’occupent en ce moment, il serabientôt impossible de la corriger et Lydia se trouvera êtreà seize ans la plus enragée coquette qui se puisseimaginer ; coquette aussi dans le sens le plus vulgaire dumot, sans autre attrait que sa jeunesse et un physiqueagréable, et que son ignorance et son manque dejugement rendront incapable de se préserver du ridiculeque lui attirera sa fureur à se faire admirer. Kitty courtles mêmes dangers, puisqu’elle suit en tout l’exemple deLydia. Vaniteuses, ignorantes, frivoles, pouvez-vouscroire, mon cher père, qu’elles ne seront pas critiquées etméprisées partout où elles iront, et que, souvent, leurs
sœurs ne se trouveront pas comprises dans le mêmejugement ?
Mr. Bennet, voyant la chaleur avec laquelle parlait safille lui prit affectueusement la main et répondit :
– Ne vous tourmentez pas, ma chérie, partout où l’onvous verra ainsi que Jane, vous serez appréciées etrespectées. Nous n’aurons pas la paix à Longbourn siLydia ne va pas à Brighton. Laissons-la y aller. Le colonelForster est un homme sérieux qui ne la laissera couriraucun danger, et le manque de fortune de Lydial’empêche heureusement d’être un objet de convoitise. ÀBrighton, d’ailleurs, elle perdra de son importance, mêmeau point de vue du flirt. Les officiers y trouveront desfemmes plus dignes de leurs hommages. Espérons plutôtque ce séjour la persuadera de son insignifiance.
Elizabeth dut se contenter de cette réponse et ellequitta son père déçue et peinée. Cependant, il n’était pasdans sa nature de s’appesantir sur les contrariétés. Elleavait fait son devoir ; se mettre en peine maintenant pourdes maux qu’elle ne pouvait empêcher, ou les augmenterpar son inquiétude, ne servirait à rien.
L’indignation de Lydia et de sa mère eût été sansbornes si elles avaient pu entendre cette conversation.Pour Lydia, ce séjour à Brighton représentait toutes lespossibilités de bonheur terrestre. Avec les yeux del’imagination, elle voyait la ville aux rues encombrées demilitaires, elle voyait les splendeurs du camp, avec lestentes alignées dans une imposante uniformité, tout
rutilant d’uniformes, frémissant de jeunesse et de gaieté,elle se voyait enfin l’objet des hommages d’un nombreimpressionnant d’officiers. Qu’eût-elle pensé, si elle avaitsu que sa sœur tentait de l’arracher à d’aussimerveilleuses perspectives ? Elizabeth allait revoirWickham pour la dernière fois. Comme elle l’avaitrencontré à plusieurs reprises depuis son retour, cettepensée ne lui causait plus d’agitation. Aucun reste de sonancienne sympathie ne venait non plus la troubler. Elleavait même découvert dans ces manières aimables quil’avaient tant charmée naguère, une affectation, unemonotonie qu’elle jugeait maintenant fastidieuses. Ledésir qu’il témoigna bientôt de lui renouveler les marquesde sympathie particulière qu’il lui avait données au débutde leurs relations, après ce qu’elle savait ne pouvait quel’irriter. Tout en se dérobant aux manifestations d’unegalanterie frivole et vaine, la pensée qu’il pût la croireflattée de ses nouvelles avances et disposée à y répondrelui causait une profonde mortification.
Le jour qui précéda le départ du régiment, Wickham etd’autres officiers dînèrent à Longbourn. Elizabeth était sipeu disposée à se séparer de lui en termes aimablesqu’elle profita d’une question qu’il lui posait sur sonvoyage à Hunsford pour mentionner le séjour de troissemaines que Mr. Darcy et le colonel Fitzwilliam avaientfait à Rosings et demanda à Wickham s’il connaissait cedernier. Un regard surpris, ennuyé, inquiet même,accueillit cette question. Toutefois, après un instant deréflexion il reprit son air souriant pour dire qu’il avait vule colonel Fitzwilliam jadis et après avoir observé que
c’était un gentleman, demanda à Elizabeth s’il lui avaitplu. Elle lui répondit par l’affirmative. D’un air indifférentil ajouta :
– Combien de temps, dites-vous, qu’il a passé àRosings ?
– Trois semaines environ.
– Et vous l’avez vu souvent ?
– Presque journellement.
– Il ressemble assez peu à son cousin.
– En effet, mais je trouve que Mr. Darcy gagne à êtreconnu.
– Vraiment ? s’écria Wickham avec un regard quin’échappa point à Elizabeth ; et pourrais-je vousdemander… – mais se ressaisissant, il ajouta d’un ton plusenjoué : – Est-ce dans ses manières qu’il a gagné ? A-t-ildaigné ajouter un peu de civilité à ses façons ordinaires ?Car je n’ose espérer, dit-il d’un ton plus grave, que lefonds de sa nature ait changé.
– Oh ! non, répliqua Elizabeth ; sur ce point, je croisqu’il est exactement le même qu’autrefois.
Wickham parut se demander ce qu’il fallait penser dece langage énigmatique et il prêta une attention anxieuseà Elizabeth pendant qu’elle continuait :
– Quand je dis qu’il gagne à être connu, je ne veux pasdire que ses manières ou sa tournure d’esprits’améliorent, mais qu’en le connaissant plus intimement,
on est à même de mieux l’apprécier.
La rougeur qui se répandit sur le visage de Wickhamet l’inquiétude de son regard dénoncèrent le trouble deson esprit. Pendant quelques minutes, il garda le silence,puis, dominant son embarras, il se tourna de nouveauvers Elizabeth et, de sa voix la plus persuasive, lui dit :
– Vous qui connaissez mes sentiments à l’égard de Mr.Darcy, vous pouvez comprendre facilement ce quej’éprouve. Je me réjouis de ce qu’il ait la sagesse deprendre ne serait-ce que les apparences de la droiture.Son orgueil, dirigé dans ce sens, peut avoir d’heureuxeffets, sinon pour lui, du moins pour les autres, en ledétournant d’agir avec la déloyauté dont j’ai tant souffertpour ma part. J’ai peur seulement qu’il n’adopte cettenouvelle attitude que lorsqu’il se trouve devant sa tantedont l’opinion et le jugement lui inspirent une crainterespectueuse. Cette crainte a toujours opéré sur lui. Sansdoute faut-il en voir la cause dans le désir qu’il ad’épouser miss de Bourgh, car je suis certain que ce désirlui tient fort au cœur. Elizabeth, à ces derniers mots, neput réprimer un sourire ; mais elle répondit seulementpar un léger signe de tête. Pendant le reste de la soiréeWickham montra le même entrain que d’habitude, maissans plus rechercher sa compagnie, et lorsqu’ils seséparèrent à la fin, ce fut avec la même civilité de part etd’autre, et peut-être bien aussi le même désir de nejamais se revoir.
Lydia accompagnait les Forster à Meryton d’où ledépart devait avoir lieu le lendemain matin de fort bonne
heure. La séparation fut plus tapageuse qu’émouvante.Kitty fut la seule à verser des larmes, mais des larmesd’envie. Mrs. Bennet, prolixe en vœux de joyeux séjour,enjoignit avec force à sa fille de ne pas perdre uneoccasion de s’amuser, – conseil qui, selon toute apparence,ne manquerait pas d’être suivi ; et, dans les transports dejoie de Lydia, se perdirent les adieux plus discrets de sessœurs.
XLIISi Elizabeth n’avait eu sous les yeux que le spectacle
de sa propre famille, elle n’aurait pu se former une idéetrès avantageuse de la félicité conjugale. Son père, séduitpar la jeunesse, la beauté et les apparences d’uneheureuse nature, avait épousé une femme dont l’espritétroit et le manque de jugement avaient eu vite faitd’éteindre en lui toute véritable affection. Avec le respect,l’estime et la confiance, tous ses rêves de bonheurdomestique s’étaient trouvés détruits.
Mr. Bennet n’était pas homme à chercher un réconfortdans ces plaisirs auxquels tant d’autres ont recours pourse consoler de déceptions causées par leur imprudence. Ilaimait la campagne, les livres, et ces goûts furent lasource de ses principales jouissances. La seule chose dontil fût redevable à sa femme était l’amusement que luiprocuraient son ignorance et sa sottise. Ce n’estévidemment pas le genre de bonheur qu’un hommesouhaite devoir à sa femme, mais, à défaut du reste, unphilosophe se contente des distractions qui sont à saportée.
Ce qu’il y avait d’incorrect à cet égard dans lesmanières de Mr. Bennet n’échappait point à Elizabeth etl’avait toujours peinée. Cependant, appréciant les qualités
de son père et touchée de l’affectueuse prédilection qu’illui témoignait, elle essayait de fermer les yeux sur cequ’elle ne pouvait approuver et tâchait d’oublier cesatteintes continuelles au respect conjugal qui, en exposantune mère à la critique de ses propres enfants, étaient siprofondément regrettables. Mais elle n’avait jamaiscompris comme elle le faisait maintenant les désavantagesréservés aux enfants nés d’une union si mal assortie, ni lebonheur qu’auraient pu ajouter à leur existence lesqualités très réelles de leur père, s’il avait seulement prisla peine de les cultiver davantage. Hors la joie qu’elle eutde voir s’éloigner Wickham, Elizabeth n’eut guère à seféliciter du départ du régiment. Les réunions au dehorsavaient perdu de leur animation tandis qu’à la maison lesgémissements de sa mère et de ses sœurs sur le manquede distractions ôtaient tout agrément au cercle familial.Somme toute, il lui fallait reconnaître – après tantd’autres, – qu’un événement auquel elle avait aspiré avectant d’ardeur ne lui apportait pas toute la satisfactionqu’elle en attendait.
Lydia en partant avait fait la promesse d’écriresouvent et avec grands détails à sa mère et à Kitty. Maisses lettres étaient toujours très courtes et se faisaientattendre longtemps. Celles qu’elle adressait à sa mèrecontenaient peu de chose : elle revenait avec son amie dela bibliothèque où elle avait rencontré tel ou tel officier ;elle avait vu des toilettes qui l’avaient transportéed’admiration ; elle-même avait acheté une robe et uneombrelle dont elle aurait voulu envoyer la descriptionmais elle devait terminer sa lettre en toute hâte parce
qu’elle entendait Mrs. Forster qui l’appelait pour serendre avec elle au camp. Les lettres à Kitty, pluscopieuses, n’en apprenaient guère plus, car elles étaienttrop remplies de passages soulignés pour pouvoir êtrecommuniquées au reste de la famille.
Au bout de deux ou trois semaines après le départ deLydia, la bonne humeur et l’entrain reparurent àLongbourn. Tout reprenait aux environs un aspect plusjoyeux ; les familles qui avaient passé l’hiver à la villerevenaient et, avec elles, les élégances et les distractionsde la belle saison. Mrs. Bennet retrouvait sa sérénitéagressive, et Kitty, vers le milieu de juin, se trouva assezremise pour pouvoir entrer dans Meryton sans verser delarmes.
Le temps fixé pour l’excursion dans le Nord approchaitquand, à peine une quinzaine de jours auparavant, arrivaune lettre de Mrs. Gardiner qui, tout ensemble, enretardait la date et en abrégeait la durée : Mr. Gardinerétait retenu par ses affaires jusqu’en juillet et devait êtrede retour à Londres à la fin du même mois. Ceci laissaittrop peu de temps pour aller si loin et visiter tout ce qu’ilsse proposaient de voir. Mieux valait renoncer aux Lacs etse contenter d’un programme plus modeste. Le nouveauplan de Mr. et Mrs. Gardiner était de ne pas dépasser leDerbyshire : il y avait assez à voir dans cette région pouroccuper la plus grande partie de leurs trois semaines devoyage et Mrs. Gardiner trouvait à ce projet un attraitparticulier : la petite ville où elle avait vécu plusieursannées et où ils pensaient s’arrêter quelques jours,
l’attirait autant que les beautés fameuses de Matlock,Chatsworth et Dovedale.
Elizabeth éprouva un vif désappointement : c’était sonrêve de visiter la région des Lacs, mais, disposée parnature à s’accommoder de toutes les circonstances, elle nefut pas longue à se consoler.
Le Derbyshire lui rappelait bien des choses. Il lui étaitimpossible de voir ce nom sans penser à Pemberley et àson propriétaire. « Tout de même, pensa-t-elle, je puisbien pénétrer dans le comté qu’il habite, et y déroberquelques cristaux de spath sans qu’il m’aperçoive. » Lesquatre semaines d’attente finirent par s’écouler, et Mr. etMrs. Gardiner arrivèrent à Longbourn avec leurs quatreenfants. Ceux-ci, – deux petites filles de six et huit ans etdeux garçons plus jeunes, – devaient être confiés auxsoins de leur cousine Jane qui jouissait auprès d’eux d’ungrand prestige et que son bon sens et sa douceuradaptaient exactement à la tâche de veiller sur eux, de lesinstruire, de les distraire et de les gâter.
Les Gardiner ne restèrent qu’une nuit à Longbourn ;dès le lendemain matin, ils repartaient avec Elizabeth enquête d’impressions et de distractions nouvelles.
Il y avait au moins un plaisir dont ils se sentaientassurés : celui de vivre ensemble dans une ententeparfaite. Tous trois étaient également capables desupporter gaiement les ennuis inévitables du voyage, d’enaugmenter les agréments par leur belle humeur, et de sedistraire mutuellement en cas de désappointement.
Ce n’est point notre intention de donner ici unedescription du Derbyshire ni des endroits renommés quetraversait la route : Oxford, Warwick, Kenilworth. Le lieuqui nous intéresse se limite à une petite portion duDerbyshire. Après avoir vu les principales beautés de larégion, nos voyageurs se dirigèrent vers la petite ville deLambton, ancienne résidence de Mrs. Gardiner, où elleavait appris qu’elle retrouverait quelques connaissances.À moins de cinq milles avant Lambton, dit Mrs. Gardinerà Elizabeth, se trouvait situé Pemberley, non pasdirectement sur leur route, mais à une distance d’un oudeux milles seulement. En arrêtant leur itinéraire, laveille de leur arrivée, Mrs. Gardiner exprima le désir derevoir le château, et son mari ayant déclaré qu’il nedemandait pas mieux, elle dit à Elizabeth :
– N’aimeriez-vous pas, ma chérie, à faire laconnaissance d’un endroit dont vous avez entendu parlersi souvent ? C’est là que Wickham a passé toute sajeunesse.
Elizabeth était horriblement embarrassée. Sa place,elle le sentait bien, n’était pas à Pemberley, et elle laissavoir qu’elle était peu tentée par cette visite. « En vérité,elle était fatiguée de voir des châteaux. Après en avoirtant parcouru, elle n’éprouvait plus aucun plaisir àcontempler des rideaux de satin et des tapis somptueux.
Mrs. Gardiner se moqua d’elle.
– S’il n’était question que de voir une maisonrichement meublée, dit-elle, je ne serais pas tentée non
plus ; mais le parc est magnifique, et renferme quelques-uns des plus beaux arbres de la contrée.
Elizabeth ne dit plus rien, mais le projet ne pouvait luiconvenir. L’éventualité d’une rencontre avec Mr. Darcys’était présentée immédiatement à son esprit, et cetteseule pensée la faisait rougir. Mieux vaudrait, pensa-t-elle, parler ouvertement à sa tante que de courir un telrisque. Ce parti, cependant, présentait lui aussi desinconvénients, et en fin de compte elle résolut de n’y avoirrecours que si l’enquête qu’elle allait faire elle-même luirévélait la présence de Darcy à Pemberley.
Le soir, en se retirant, elle demanda à la femme dechambre des renseignements sur Pemberley. N’était-cepas un endroit intéressant ? Comment se nommaient lespropriétaires ? enfin, – cette question fut posée avec unpeu d’angoisse, – y résidaient-ils en ce moment ? À sagrande satisfaction, la réponse à sa dernière demande futnégative et le lendemain matin, lorsque le sujet fut remisen question, Elizabeth put répondre d’un air naturel etindifférent que le projet de sa tante ne lui causait aucundéplaisir.
Il fut donc décidé qu’on passerait par Pemberley.
XLIIIDans la voiture qui l’emportait avec son oncle et sa
tante, Elizabeth guettait l’apparition des bois dePemberley avec une certaine émotion, et lorsqu’ilsfranchirent la grille du parc, elle se sentit un peu troublée.
Le parc était très vaste et d’aspect extrêmementvarié. Ils y avaient pénétré par la partie la plus basse ;après une montée d’un demi-mille environ à travers unebelle étendue boisée, ils se trouvèrent au sommet d’unecolline d’où le regard était tout de suite frappé par la vuede Pemberley House situé de l’autre côté de la vallée verslaquelle la route descendait en lacets assez brusques. Lechâteau, grande et belle construction en pierre, sedressait avantageusement sur une petite éminencederrière laquelle s’étendait une chaîne de hautes collinesboisées. Devant le château coulait une rivière assezimportante que d’habiles travaux avaient encore élargie,mais sans donner à ses rives une apparence artificielle.Elizabeth était émerveillée ; jamais encore elle n’avait vuun domaine dont le pittoresque naturel eût été aussi bienrespecté.
La voiture descendit la colline, traversa le pont et vints’arrêter devant la porte. Tandis qu’elle examinait deprès l’aspect de la maison, la crainte de rencontrer son
propriétaire vint de nouveau saisir Elizabeth. Si jamais lafemme de chambre de l’hôtel s’était trompée ! Son oncleayant demandé si l’on pouvait visiter le château, on les fitentrer dans le hall, et, pendant qu’ils attendaient l’arrivéede la femme de charge, Elizabeth put à loisir s’étonner dese voir en cet endroit.
La femme de charge était une personne âgée, d’allurerespectable, moins importante et beaucoup plusempressée qu’Elizabeth ne s’y attendait. Tous trois lasuivirent dans la salle à manger. Après avoir jeté un coupd’œil à cette vaste pièce de proportions harmonieuses etsomptueusement meublée, Elizabeth se dirigea vers lafenêtre pour jouir de la vue. La colline boisée qu’ilsvenaient de descendre et qui, à distance, paraissait encoreplus abrupte, formait un admirable vis-à-vis. Le parc,sous tous ses aspects, était charmant, et c’était avecravissement qu’elle contemplait la rivière bordée debouquets d’arbres et la vallée sinueuse aussi loin que l’œilpouvait en suivre les détours. Dans chaque salle où l’onpassait, le point de vue changeait, et de chaque fenêtre il yavait de nouvelles beautés à voir. Les pièces étaient devastes proportions et le mobilier en rapport avec lafortune du propriétaire. Elizabeth nota avec une certaineadmiration qu’il n’y avait rien de voyant ou d’inutilementsomptueux comme à Rosings.
« Et dire que de cette demeure je pourrais être lachâtelaine ! songeait-elle. Ces pièces seraient pour moi undécor familier ; au lieu de les visiter comme uneétrangère, je pourrais y recevoir mon oncle et ma tante…
Mais non, pensa-t-elle en se ressaisissant, ceci n’auraitpas été possible ! mon oncle et ma tante auraient étéperdus pour moi ; jamais je n’aurais été autorisée à lesrecevoir ici ! »
Cette réflexion arrivait à point pour la délivrer dequelque chose qui ressemblait à un regret.
Il lui tardait de demander à la femme de charge si sonmaître était réellement absent, mais elle ne pouvait serésoudre à le faire. Enfin, la question fut posée par sononcle, auquel Mrs. Reynolds répondit affirmativement, enajoutant : – Mais nous l’attendons demain, avec plusieursamis.
« Quelle chance, songea Elizabeth, que notre excursionn’ait point été retardée d’une journée ! »
Sa tante l’appelait à cet instant pour lui montrer,parmi d’autres miniatures suspendues au-dessus d’unecheminée, le portrait de Wickham, et, comme elle luidemandait en souriant ce qu’elle en pensait, la femme decharge s’avança : ce portrait, leur dit-elle, était celui d’unjeune gentleman, fils d’un régisseur de son défunt maîtreque celui-ci avait fait élever à ses frais. Il est maintenantdans l’armée, ajouta-t-elle, mais je crains qu’il n’ait pasfort bien tourné.
Mrs. Gardiner regarda sa nièce avec un sourirequ’Elizabeth ne put lui retourner.
– Voici maintenant le portrait de mon maître, dit Mrs.Reynolds, en désignant une autre miniature ; il est fortressemblant. Les deux portraits ont été faits à la même
époque, il y a environ huit ans.
– J’ai entendu dire que votre maître était très bien desa personne, dit Mrs. Gardiner en examinant laminiature. Voilà certainement une belle physionomie.Mais vous, Lizzy, vous pouvez nous dire si ce portrait estressemblant.
– Cette jeune demoiselle connaîtrait-elle Mr. Darcy ?demanda la femme de charge en regardant Elizabeth avecune nuance de respect plus marquée.
– Un peu, répondit la jeune fille en rougissant.
– N’est-ce pas, mademoiselle, qu’il est très belhomme ?
– Certainement.
– Pour ma part, je n’en connais point d’aussi bien.Dans la galerie, au premier, vous verrez de lui un portraitplus grand et plus beau. Cette chambre était la piècefavorite de mon défunt maître. Il tenait beaucoup à cesminiatures et on les a laissées disposées exactementcomme elles l’étaient de son temps.
Elizabeth comprit alors pourquoi la miniature deWickham se trouvait là parmi les autres.
Mrs. Reynold appela leur attention sur un portrait demiss Darcy à l’âge de huit ans.
– Miss Darcy est-elle aussi bien que son frère ?demanda Mrs. Gardiner.
– Oui, madame, c’est une fort belle jeune fille, et si
bien douée ! Elle fait de la musique et chante toute lajournée. Dans la pièce voisine il y a un nouvel instrumentqui vient d’être apporté pour elle, un cadeau de monmaître. Elle arrive demain avec lui.
Mr. Gardiner toujours aimable et plein d’aisanceencourageait ce bavardage par ses questions et sesremarques. Soit fierté, soit attachement, Mrs. Reynoldsavait évidemment grand plaisir à parler de ses maîtres.
– Mr. Darcy réside-t-il souvent à Pemberley ?
– Pas autant que nous le souhaiterions, monsieur ;mais il est bien ici la moitié de l’année et miss Darcy ypasse toujours les mois d’été.
« Excepté quand elle va à Ramsgate, » pensaElizabeth.
– Si votre maître se mariait, il passerait sans douteplus de temps à Pemberley.
– Probablement, monsieur. Mais quand cela arrivera-t-il ? Je ne connais pas de demoiselle qui soit assez bienpour lui.
Mr. et Mrs. Gardiner sourirent. Elizabeth ne puts’empêcher de dire :
– Assurément, ce que vous dites est tout à sonhonneur.
– Je ne dis que la vérité, et ce que peuvent vousrépéter tous ceux qui le connaissent, insista Mrs.Reynolds.
Elizabeth trouva qu’elle allait un peu loin, et sasurprise redoubla quand elle l’entendit ajouter :
– Je n’ai jamais eu de lui une parole désagréable et,quand je suis entrée au service de son père, il n’avait pasplus de quatre ans.
Cette louange, plus encore que la précédente, déroutaElizabeth : que Darcy eût un caractère difficile, c’est dequoi, jusque-là, elle avait eu la ferme conviction. Ellesouhaitait vivement en entendre davantage, et fut trèsreconnaissante à son oncle de faire cette réflexion :
– Il y a peu de gens dont on puisse en dire autant.Vous avez de la chance d’avoir un tel maître !
– Oui, monsieur, je sais bien que je pourrais faire letour du monde sans en rencontrer un meilleur. Mais il n’afait que tenir ce qu’il promettait dès son enfance. C’était lecaractère le plus aimable et le cœur le plus généreuxqu’on pût imaginer.
– Son père était un homme excellent, dit Mrs.Gardiner.
– Oui, madame, c’est la vérité, et son fils lui ressemble.Il est aussi bon pour les malheureux.
Elizabeth s’étonnait, doutait, et désirait toujours enentendre plus. Ce que Mrs. Reynolds pouvait raconter ausujet des tableaux, des dimensions des pièces ou de lavaleur du mobilier n’avait plus pour elle aucun intérêt.Mr. Gardiner, extrêmement amusé par l’espèce d’orgueil
familial auquel il attribuait l’éloge démesuré que la femmede charge faisait de son maître, ramena bientôt laconversation sur le même sujet, et tout en montant legrand escalier, Mrs. Reynolds énuméra chaleureusementles nombreuses qualités de Mr. Darcy.
– C’est le meilleur propriétaire et le meilleur maîtrequ’on puisse voir, non pas un de ces jeunes écervelésd’aujourd’hui qui ne songent qu’à s’amuser. Vous netrouverez pas un de ses tenanciers ou de ses domestiquespour dire de lui autre chose que du bien. Certaines gens,je le sais, le trouvent fier ; pour moi, je ne m’en suis jamaisaperçue. C’est, j’imagine, parce qu’il est plus réservé queles autres jeunes gens de son âge.
« Sous quel jour avantageux tout ceci le fait voir ! »pensa Elizabeth.
– La façon dont il s’est conduit avec notre pauvre amine correspond guère à ce beau portrait, chuchota Mrs.Gardiner à l’oreille de sa nièce.
– Peut-être avons-nous été trompées.
– C’est peu probable. Nos renseignements viennent detrop bonne source.
Lorsqu’ils eurent atteint le vaste palier de l’étagesupérieur, Mrs. Reynolds les fit entrer dans un très joliboudoir, clair et élégant, et leur expliqua qu’il venaitd’être installé pour faire plaisir à miss Darcy, qui s’étaitenthousiasmée de cette pièce durant son dernier séjour.
– Mr. Darcy est véritablement très bon frère, dit
Elizabeth en s’avançant vers l’une des fenêtres.
Mrs. Reynolds riait d’avance à l’idée du ravissementde sa jeune maîtresse, quand elle pénétrerait dans ceboudoir.
– Et c’est toujours ainsi qu’il agit, ajouta-t-elle. Il suffitque sa sœur exprime un désir pour le voir aussitôt réalisé.Il n’y a pas de chose au monde qu’il ne ferait pour elle !
Il ne restait plus à voir que deux ou trois deschambres principales et la galerie de tableaux. Dans celle-ci, il y avait beaucoup d’œuvres de valeur, mais Elizabethqui ne s’y connaissait point préféra se diriger versquelques fusains de miss Darcy, dont les sujets étaientplus à sa portée. Puis elle se mit à passer rapidement enrevue les portraits de famille, cherchant la seule figurequ’elle pût y reconnaître. À la fin, elle s’arrêta devant unetoile dont la ressemblance était frappante. Elizabeth yretrouvait le sourire même qu’elle avait vu quelquefois àDarcy lorsqu’il la regardait. Elle resta quelques instantsen contemplation et ne quitta point la galerie sans êtrerevenue donner un dernier coup d’œil au tableau. En cetinstant il y avait certainement dans ses sentiments àl’égard de l’original plus de mansuétude qu’elle n’en avaitjamais ressenti. Les éloges prodigués par Mrs. Reynoldsn’étaient pas de qualité ordinaire et quelle louange a plusde valeur que celle d’un serviteur intelligent ? Commefrère, maître, propriétaire, songeait Elizabeth, de combiende personnes Mr. Darcy ne tenait-il pas le bonheur entreses mains ! Que de bien, ou que de mal il était en état defaire ! Tout ce que la femme de charge avait raconté était
entièrement en son honneur.
Arrêtée devant ce portrait dont le regard semblait lafixer, Elizabeth pensait au sentiment que Darcy avait eupour elle avec une gratitude qu’elle n’avait jamais encoreéprouvée ; elle se rappelait la chaleur avec laquelle cesentiment lui avait été déclaré, et oubliait un peu ce quil’avait blessée dans son expression.
Quand la visite fut terminée, ils redescendirent au rez-de-chaussée et, prenant congé de la femme de charge,trouvèrent le jardinier qui les attendait à la ported’entrée. En traversant la pelouse pour descendre vers larivière Elizabeth se retourna pour jeter encore un coupd’œil à la maison ; ses compagnons l’imitèrent, et, pendantque son oncle faisait des conjectures sur la date de laconstruction, le propriétaire en personne apparut soudainsur la route qui venait des communs situés en arrière duchâteau.
Vingt mètres à peine les séparaient et son apparitionavait été si subite qu’il était impossible à Elizabethd’échapper à sa vue. Leurs yeux se rencontrèrent, et tousdeux rougirent violemment. Mr. Darcy tressaillit et restacomme figé par la surprise, mais, se ressaisissant aussitôt,il s’avança vers le petit groupe et adressa la parole àElizabeth, sinon avec un parfait sang-froid, du moins avecla plus grande politesse. Celle-ci, en l’apercevant, avaitesquissé instinctivement un mouvement de retraite, maiss’arrêta en le voyant approcher et reçut ses hommagesavec un indicible embarras.
Mr. et Mrs. Gardiner devinèrent fatalement qu’ilsavaient sous les yeux Mr. Darcy lui-même, grâce à saressemblance avec le portrait, grâce aussi à l’expressionde surprise qui se peignit sur le visage du jardinier à lavue de son maître. Ils restèrent tous deux un peu à l’écartpendant qu’il s’entretenait avec leur nièce Celle-ci,étonnée et confondue, osait à peine lever les yeux sur luiet répondait au hasard aux questions courtoises qu’il luiposait sur sa famille. Tout étonnée du changementsurvenu dans ses manières depuis qu’elle ne l’avait vu,elle sentait à mesure qu’il parlait croître son embarras.L’idée qu’il devait juger déplacée sa présence en ces lieuxlui faisait de cet entretien un véritable supplice. Mr. Darcylui-même ne semblait guère plus à l’aise. Sa voix n’avaitpas sa fermeté habituelle et la façon dont, à plusieursreprises, il la questionna sur l’époque où elle avait quittéLongbourn et sur son séjour en Derbyshire, marquaitclairement le trouble de son esprit. À la fin, toute idéesembla lui manquer et il resta quelques instants sans direun mot. Enfin, il retrouva son sang-froid et prit congé.
Mr. et Mrs, Gardiner, rejoignant leur nièce, se mirentà louer la belle prestance de Mr. Darcy, mais Elizabeth neles entendait pas, et, tout absorbée par ses pensées, elleles suivait en silence. Elle était accablée de honte et dedépit. Cette visite à Pemberley était un acte des plusinconsidérés et des plus regrettables. Comme elle avait dûparaître étrange à Mr. Darcy ! Il allait croire qu’elle s’étaitmise tout exprès sur son chemin. Quelle fâcheuseinterprétation pouvait en concevoir un homme aussiorgueilleux ! Pourquoi, oh ! pourquoi était-elle venue ?…
Et lui-même, comment se trouvait-il là un jour plus tôtqu’on ne l’attendait ?… Elizabeth ne cessait de rougir endéplorant la mauvaise chance de cette rencontre. Quantau changement si frappant des manières de Mr. Darcy,que pouvait-il signifier ? Cette grande politesse,l’amabilité qu’il avait mise à s’enquérir de sa famille !…Jamais elle ne l’avait vu aussi simple, jamais elle ne l’avaitentendu s’exprimer avec autant de douceur. Quelcontraste avec leur dernière rencontre dans le parc deRosings, lorsqu’il lui avait remis sa lettre !… Elle ne savaitqu’en penser.
Ils suivaient maintenant une belle allée longeant larivière et à chaque pas surgissaient de nouveaux etpittoresques points de vue. Mais tout ce charme étaitperdu pour Elizabeth. Elle répondait sans entendre, etregardait sans voir ; sa pensée était à Pemberley Houseavec Mr. Darcy. Elle brûlait de savoir ce qui s’agitait dansson esprit en ce moment ; avec quels sentiments il pensaità elle et si, contre toute vraisemblance, son amour duraitencore. Peut-être n’avait-il montré tant de courtoisie queparce qu’il se sentait indifférent. Pourtant le ton de savoix n’était pas celui de l’indifférence. Elle ne pouvait diresi c’était avec plaisir ou avec peine qu’il l’avait revue,mais, certainement, ce n’était pas sans émotion.
À la longue les remarques de ses compagnons sur sonair distrait la tirèrent de ses pensées et elle sentit lanécessité de retrouver sa présence d’esprit.
Bientôt, les promeneurs s’enfoncèrent dans les bois et,disant adieu pour un moment au bord de l’eau, gravirent
quelques-uns des points les plus élevés d’où des éclairciesleur donnaient des échappées ravissantes sur la vallée,sur les collines d’en face recouvertes en partie par desbois et, par endroits, sur la rivière. Mr. Gardiner ayantexprimé le désir de faire tout le tour du parc, il lui futrépondu avec un sourire triomphant que c’était uneaffaire de dix milles. Un tel chiffre tranchait la question, etl’on poursuivit le circuit ordinaire qui, après une descenteà travers bois, les ramena sur le bord de l’eau. La vallée, àcet endroit, se resserrait en une gorge qui ne laissait deplace que pour la rivière et l’étroit sentier qui la longeait àtravers le taillis. Elizabeth aurait bien désiré en suivre lesdétours mais quand ils eurent traversé le pont et sefurent rendu compte de la distance qui les séparait encoredu château, Mrs. Gardiner, qui était médiocre marcheuse,ne se soucia pas d’aller plus loin et sa nièce dut se résignerà reprendre sur l’autre rive le chemin le plus direct.
Le retour s’accomplit lentement. Mr. Gardiner, grandamateur de pêche, s’attardait à interroger le jardinier surles truites et à guetter leur apparition dans la rivière.Pendant qu’ils avançaient ainsi à petits pas, ils eurent unenouvelle surprise et, non moins étonnée qu’à laprécédente rencontre, Elizabeth vit paraître à peu dedistance Mr. Darcy qui se dirigeait de leur côté. L’alléequ’ils suivaient, moins ombragée que celle de l’autre rive,leur permettait de le voir s’approcher. Elizabeth, mieuxpréparée cette fois à une entrevue, se promit de montrerplus de sang-froid s’il avait vraiment l’intention de lesaborder. Peut-être, après tout, allait-il prendre un autrechemin ? Un tournant qui le déroba à leur vue le lui fit
croire un instant ; mais le tournant dépassé, elle le trouvaimmédiatement devant elle.
Un coup d’œil lui suffit pour voir qu’il n’avait rienperdu de son extrême courtoisie. Ne voulant pas être enreste de politesse, elle se mit, dès qu’il l’eut abordée, àvanter les beautés du parc, mais, à peine eut-elleprononcé les mots « délicieux, charmant », que dessouvenirs fâcheux lui revinrent ; elle s’imagina que, danssa bouche, l’éloge de Pemberley pouvait être malinterprété, rougit et s’arrêta.
Mrs. Gardiner était restée en arrière. LorsqueElizabeth se tut, Mr. Darcy lui demanda si elle voulait bienlui faire l’honneur de le présenter à ses amis. Nullementpréparée à une telle requête, elle put à peine réprimer unsourire, car il demandait à être présenté aux personnesmêmes dont il considérait la parenté humiliante pour sonorgueil quand il lui avait fait la déclaration de sessentiments.
« Quelle va être sa surprise ? pensait-elle. Il les prendsans doute pour des gens de qualité. » La présentation futfaite aussitôt, et en mentionnant le lien de parenté quil’unissait à ses compagnons, elle regarda furtivement Mr.Darcy pour voir comment il supporterait le choc… Il lesupporta vaillamment, bien que sa surprise fût évidenteet, loin de fuir, il rebroussa chemin pour les accompagneret se mit à causer avec Mr. Gardiner. Elizabeth exultait :à sa grande satisfaction, Mr. Darcy pouvait voir qu’elleavait des parents dont elle n’avait pas à rougir !…Attentive à leur conversation, elle notait avec joie toutes
les phrases, toutes les expressions qui attestaientl’intelligence, le goût et la bonne éducation de son oncle.
La conversation tomba bientôt sur la pêche, et elleentendit Mr. Darcy, avec la plus parfaite amabilité, inviterMr. Gardiner à venir pêcher aussi souvent qu’il levoudrait durant son séjour dans le voisinage, offrantmême de lui prêter des lignes, et lui indiquant les endroitsles plus poissonneux. Mrs. Gardiner, qui donnait le bras àsa nièce, lui jeta un coup d’œil surpris ; Elizabeth ne ditmot, mais ressentit une vive satisfaction : c’était à elle ques’adressaient toutes ces marques de courtoisie. Sonétonnement cependant était extrême, et elle se répétaitsans cesse : « Quel changement extraordinaire ! commentl’expliquer ? ce n’est pourtant pas moi qui en suis cause !ce ne sont pas les reproches que je lui ai faits à Hunsfordqui ont opéré une telle transformation !… C’est impossiblequ’il m’aime encore. »
Ils marchèrent ainsi pendant quelque temps, Mrs.Gardiner et sa nièce en avant, et les deux messieurs àl’arrière-garde. Mais après être descendus sur la rivepour voir de plus près une curieuse plante aquatique, il seproduisit un petit changement ; Mrs. Gardiner, fatiguéepar l’exercice de la matinée et trouvant le brasd’Elizabeth insuffisant pour la soutenir, préféra s’appuyersur celui de son mari ; Mr. Darcy prit place auprès de sanièce et ils continuèrent à marcher côte à côte. Après unecourte pause, ce fut la jeune fille qui rompit le silence ; elletenait à ce qu’il apprît qu’en venant à Pemberley elle secroyait sûre de son absence ; aussi commença-t-elle par
une remarque sur la soudaineté de son arrivée.
– Car votre femme de charge, ajouta-t-elle, nous avaitinformés que vous ne seriez pas ici avant demain, et,d’après ce qu’on nous avait dit à Bakervell, nous avionscompris que vous n’étiez pas attendu si tôt.
Mr. Darcy reconnut que c’était exact ; une question àrégler avec son régisseur l’avait obligé à devancer dequelques heures ses compagnons de voyage.
– Ils me rejoindront demain matin de bonne heure,continua-t-il, et vous trouverez parmi eux plusieurspersonnes qui seront heureuses de renouer connaissanceavec vous : Mr. Bingley et ses sœurs.
Elizabeth s’inclina légèrement sans répondre : d’unsaut, sa pensée se reportait brusquement au soir où, pourla dernière fois, le nom de Mr. Bingley avait été prononcépar eux. Si elle en jugeait par la rougeur de soncompagnon, la même idée avait dû lui venir aussi àl’esprit.
– Il y a une autre personne, reprit-il après un courtsilence, qui désire particulièrement vous connaître. Mepermettrez-vous, si ce n’est pas indiscret, de vousprésenter ma sœur pendant votre séjour à Lambton ?
Interdite par cette demande, Elizabeth y répondit sanssavoir au juste dans quels termes. Elle sentait que le désirde la sœur avait dû être inspiré par le frère et sans allerplus loin cette pensée la remplissait de satisfaction. Il luiétait agréable de voir que Mr. Darcy n’avait pas étéamené par la rancune à concevoir d’elle une mauvaise
opinion.
Ils avançaient maintenant en silence, chacun plongédans ses pensées. Bientôt ils distancèrent les Gardiner et,quand ils arrivèrent à la voiture, ils avaient une avanced’au moins cent cinquante mètres.
Mr. Darcy offrit à Elizabeth d’entrer au château, maiselle déclara qu’elle n’était pas fatiguée et ils demeurèrentsur la pelouse.
Le silence à un moment où ils auraient pu se dire tantde choses devenait embarrassant. Elizabeth se rappelaqu’elle venait de voyager et ils parlèrent de Matlock et deDovedale avec beaucoup de persévérance. Mais Elizabethtrouvait que le temps et sa tante avançaient bienlentement et sa patience, ainsi que ses idées, étaientpresque épuisées lorsque ce tête-à-tête prit fin.
Mr. et Mrs. Gardiner les ayant rejoints, Mr. Darcy lespressa d’entrer au château et d’accepter quelquesrafraîchissements ; mais cette proposition fut déclinée etl’on se sépara de part et d’autre avec la plus grandecourtoisie. Mr. Darcy aida les dames à remonter dans leurvoiture et, quand elle fut en marche, Elizabeth le vitretourner à pas lents vers la maison.
Son oncle et sa tante se mirent aussitôt à parler de Mr.Darcy : l’un et l’autre le déclarèrent infiniment mieuxqu’ils ne s’y seraient attendus.
– C’est un parfait gentleman, aimable et simple, ditMr. Gardiner.
– Il y a bien un peu de hauteur dans sa physionomie,reprit sa femme, mais elle n’est que dans l’expression, etne lui sied pas mal. Je puis dire maintenant comme lafemme de charge que la fierté dont certaines gensl’accusent ne m’a nullement frappée.
– J’ai été extrêmement surpris de son accueil c’étaitplus que de la simple politesse, c’était un empressementaimable à quoi rien ne l’obligeait. Ses relations avecElizabeth étaient sans importance, en somme !
– Bien sûr, Lizzy, il n’a pas le charme de Wickhammais comment avez-vous pu nous le représenter commeun homme si désagréable ?
Elizabeth s’excusa comme elle put, dit qu’elle l’avaitmieux apprécié quand ils s’étaient rencontrés dans leKent et qu’elle ne l’avait jamais vu aussi aimable qu’en cejour.
– Tel qu’il s’est montré à nous, continua Mrs.Gardiner, je n’aurais jamais pensé qu’il eût pu se conduireaussi cruellement à l’égard de ce pauvre Wickham. Il n’apas l’air dur, au contraire. Dans toute sa personne il a unedignité qui ne donne pas une idée défavorable de soncœur. La bonne personne qui nous a fait visiter le châteaului fait vraiment une réputation extraordinaire ! J’avaispeine, par moments, à m’empêcher de rire…
Ici, Elizabeth sentit qu’elle devait dire quelque chosepour justifier Mr. Darcy dans ses rapports avec Wickham.En termes aussi réservés que possible elle laissa entendreque, pendant son séjour dans le Kent, elle avait appris que
sa conduite pouvait être interprétée d’une façon toutedifférente, et que son caractère n’était nullement aussiodieux, ni celui de Wickham aussi sympathique qu’onl’avait cru en Hertfordshire. Comme preuve, elle donnales détails de toutes les négociations d’intérêt qui s’étaientpoursuivies entre eux, sans dire qui l’avait renseignée,mais en indiquant qu’elle tenait l’histoire de bonne source.
Sa tante l’écoutait avec une vive curiosité. Mais onapprochait maintenant des lieux qui lui rappelaient sesjeunes années, et toute autre idée s’effaça devant lecharme des souvenirs. Elle fut bientôt trop occupée àdésigner à son mari les endroits intéressants qu’ilstraversaient pour prêter son attention à autre chose. Bienque fatiguée par l’excursion du matin, sitôt qu’elle futsortie de table elle partit à la recherche d’anciens amis, etla soirée fut remplie par le plaisir de renouer des relationsdepuis longtemps interrompues.
Quant à Elizabeth, les événements de la journéeétaient trop passionnants pour qu’elle pût s’intéresserbeaucoup aux amis de sa tante. Elle ne cessait de songer,avec un étonnement dont elle ne pouvait revenir, àl’amabilité de Mr. Darcy et, par-dessus tout, au désir qu’ilavait exprimé de lui présenter sa sœur.
XLIVElizabeth s’attendait à ce que Mr. Darcy lui amenât sa
sœur le lendemain de son arrivée à Pemberley, et déjàelle avait résolu de ne pas s’éloigner de l’hôtel ce matin-là,mais elle s’était trompée dans ses prévisions car sesvisiteurs se présentèrent un jour plus tôt qu’elle ne l’avaitprévu.
Après une promenade dans la ville avec son oncle et satante, tous trois étaient revenus à l’hôtel et se préparaientà aller dîner chez des amis retrouvés par Mrs. Gardiner,lorsque le roulement d’une voiture les attira à la fenêtre.Elizabeth, reconnaissant la livrée du coupé qui s’arrêtaitdevant la porte, devina tout de suite ce dont il s’agissait etannonça à ses compagnons l’honneur qui allait leur êtrefait. Mr. et Mrs. Gardiner étaient stupéfaits, maisl’embarras de leur nièce, qu’ils rapprochaient de cetincident et de celui de la veille, leur ouvrit soudain lesyeux sur des perspectives nouvelles.
Elizabeth se sentait de plus en plus troublée, tout ens’étonnant elle-même de son agitation : entre autressujets d’inquiétude, elle se demandait si Mr. Darcyn’aurait pas trop fait son éloge à sa sœur et, dans le désirde gagner la sympathie de la jeune fille, elle craignait quetous ses moyens ne vinssent à lui manquer à la fois.
Craignant d’être vue, elle s’écarta de la fenêtre et semit à arpenter la pièce pour se remettre, mais les regardsde surprise qu’échangeaient son oncle et sa tanten’étaient pas faits pour lui rendre son sang-froid.
Quelques instants plus tard miss Darcy entrait avecson frère et la redoutable présentation avait lieu. À songrand étonnement, Elizabeth put constater que savisiteuse était au moins aussi embarrassée qu’elle-même.Depuis son arrivée à Lambton elle avait entendu dire quemiss Darcy était extrêmement hautaine ; un coup d’œil luisuffit pour voir qu’elle était surtout prodigieusementtimide. Elle était grande et plus forte qu’Elizabeth ; bienqu’elle eût à peine dépassé seize ans elle avait déjà l’allureet la grâce d’une femme. Ses traits étaient moins beauxque ceux de son frère, mais l’intelligence et la bonnehumeur se lisaient sur son visage. Ses manières étaientaimables et sans aucune recherche. Elizabeth, quis’attendait à retrouver chez elle l’esprit froidementobservateur de son frère, se sentit soulagée.
Au bout de peu d’instants Mr. Darcy l’informa que Mr.Bingley se proposait également de venir lui présenter seshommages, et Elizabeth avait à peine eu le temps derépondre à cette annonce par une phrase de politessequ’on entendait dans l’escalier le pas alerte de Mr. Bingleyqui fit aussitôt son entrée dans la pièce.
Il y avait longtemps que le ressentiment d’Elizabeth àson égard s’était apaisé ; mais s’il n’en avait pas été ainsi,elle n’aurait pu résister à la franche cordialité avec
laquelle Bingley lui exprima son plaisir de la revoir. Ils’enquit de sa famille avec empressement, bien que sansnommer personne, et dans sa manière d’être comme dansson langage il montra l’aisance aimable qui lui étaithabituelle.
Mr. et Mrs. Gardiner le considéraient avec presqueautant d’intérêt qu’Elizabeth ; depuis longtemps ilsdésiraient le connaître. D’ailleurs, toutes les personnesprésentes excitaient leur attention ; les soupçons qui leurétaient nouvellement venus les portaient à observersurtout Mr. Darcy et leur nièce avec une curiosité aussivive que discrète. Le résultat de leurs observations fut lapleine conviction que l’un des deux au moins savait ce quec’était qu’aimer ; des sentiments de leur nièce ilsdoutaient encore un peu, mais il était clair pour eux queMr. Darcy débordait d’admiration.
Elisabeth, de son côté, avait beaucoup à faire. Elleaurait voulu deviner les sentiments de chacun de sesvisiteurs, calmer les siens, et se rendre agréable à tous. Cedernier point sur lequel elle craignait le plus d’échouerétait au contraire celui où elle avait le plus de chances deréussir, ses visiteurs étant tous prévenus en sa faveur.
À la vue de Bingley sa pensée s’était aussitôt élancéevers Jane. Combien elle aurait souhaité savoir si la penséede Bingley avait pris la même direction ! Elle crutremarquer qu’il parlait moins qu’autrefois, et, à une oudeux reprises pendant qu’il la regardait, elle se plut àimaginer qu’il cherchait à découvrir une ressemblanceentre elle et sa sœur. Si tout ceci n’était qu’imagination, il
y avait du moins un fait sur lequel elle ne pouvaits’abuser, c’était l’attitude de Bingley vis-à-vis de missDarcy, la prétendue rivale de Jane. Rien dans leursmanières ne semblait marquer un attrait spécial des deuxjeunes gens l’un pour l’autre ; rien ne se passa entre euxqui fût de nature à justifier les espérances de missBingley. Elizabeth saisit, au contraire, deux ou trois petitsfaits qui lui semblèrent attester chez Mr. Bingley unsentiment persistant de tendresse pour Jane, le désir deparler de choses se rattachant à elle et, s’il l’eût osé, deprononcer son nom. À un moment où les autres causaientensemble, il lui fit observer d’un ton où perçait un réelregret « qu’il était resté bien longtemps sans la voir »,puis ajouta avant qu’elle eût eu le temps de répondre :
– Oui, il y a plus de huit mois. Nous ne nous sommespas rencontrés depuis le 26 novembre, date à laquellenous dansions tous à Netherfield.
Elizabeth fut heureuse de constater que sa mémoireétait si fidèle. Plus tard, pendant qu’on ne les écoutait pas,il saisit l’occasion de lui demander si toutes ses sœursétaient à Longbourn. En elles-mêmes, cette question etl’observation qui l’avait précédée étaient peu de chose,mais l’accent de Bingley leur donnait une signification.
C’était seulement de temps à autre qu’Elizabethpouvait tourner les yeux vers Mr. Darcy ; mais chaquecoup d’œil le lui montrait avec une expression aimable, etquand il parlait, elle ne pouvait découvrir dans sa voix lamoindre nuance de hauteur. En le voyant ainsi plein decivilité non seulement à son égard mais à l’égard de
membres de sa famille qu’il avait ouvertement dédaignés,et en se rappelant leur orageux entretien au presbytèrede Hunsford, le changement lui semblait si grand et sifrappant qu’Elizabeth avait peine à dissimuler sonprofond étonnement. Jamais encore dans la société de sesamis de Netherfield ou dans celle de ses nobles parentesde Rosings elle ne l’avait vu si désireux de plaire et siparfaitement exempt de fierté et de raideur.
La visite se prolongea plus d’une demi-heure et, en selevant pour prendre congé, Mr. Darcy pria sa sœur dejoindre ses instances aux siennes pour demander à leurshôtes de venir dîner à Pemberley avant de quitter larégion. Avec une nervosité qui montrait le peu d’habitudequ’elle avait encore de faire des invitations, miss Darcys’empressa d’obéir. Mrs. Gardiner regarda sa nièce :n’était-ce pas elle que cette invitation concernait surtout ?Mais Elizabeth avait détourné la tête. Interprétant cetteattitude comme un signe d’embarras et non derépugnance pour cette invitation, voyant en outre que sonmari paraissait tout prêt à l’accepter, Mrs. Gardinerrépondit affirmativement et la réunion fut fixée ausurlendemain. Dès que les visiteurs se furent retirés,Elizabeth, désireuse d’échapper aux questions de sononcle et de sa tante, ne resta que le temps de leurentendre exprimer leur bonne impression sur Bingley etelle courut s’habiller pour le dîner.
Elle avait tort de craindre la curiosité de Mr. et Mrs.Gardiner car ils n’avaient aucun désir de forcer sesconfidences. Ils se rendaient compte maintenant
qu’Elizabeth connaissait Mr. Darcy beaucoup plus qu’ilsne se l’étaient imaginé, et ils ne doutaient pas que Mr.Darcy fût sérieusement épris de leur nièce ; tout cela étaità leurs yeux plein d’intérêt, mais ne justifiait pas uneenquête.
En ce qui concernait Wickham les voyageursdécouvrirent bientôt qu’il n’était pas tenu en grandeestime à Lambton : si ses démêlés avec le fils de sonprotecteur étaient imparfaitement connus, c’était un faitnotoire qu’en quittant le Derbyshire il avait laissé derrièrelui un certain nombre de dettes qui avaient été payéesensuite par Mr. Darcy.
Quant à Elizabeth, ses pensées étaient à Pemberley cesoir-là plus encore que la veille. La fin de la journée luiparut longue mais ne le fut pas encore assez pour luipermettre de déterminer la nature exacte des sentimentsqu’elle éprouvait à l’égard d’un des habitants du château,et elle resta éveillée deux bonnes heures, cherchant à voirclair dans son esprit. Elle ne détestait plus Mr. Darcy, noncertes. Il y avait longtemps que son aversion s’étaitdissipée et elle avait honte maintenant de s’être laisséealler à un pareil sentiment. Depuis quelque temps déjàelle avait cessé de lutter contre le respect que luiinspiraient ses indéniables qualités, et sous l’influence dutémoignage qui lui avait été rendu la veille et qui montraitson caractère sous un jour si favorable, ce respect setransformait en quelque chose d’une nature plus amicale.Mais au-dessus de l’estime, au-dessus du respect, il yavait en elle un motif nouveau de sympathie qui ne doit
pas être perdu de vue : c’était la gratitude. Elle étaitreconnaissante à Darcy non seulement de l’avoir aimée,mais de l’aimer encore assez pour lui pardonnerl’impétuosité et l’amertume avec lesquelles elle avaitaccueilli sa demande, ainsi que les accusations injustesqu’elle avait jointes à son refus. Elle eût trouvé naturelqu’il l’évitât comme une ennemie, et voici que dans unerencontre inopinée il montrait au contraire un vif désir devoir se renouer leurs relations. De l’air le plus naturel,sans aucune assiduité indiscrète, il essayait de gagner lasympathie des siens et cherchait à la mettre elle-mêmeen rapport avec sa sœur. L’amour seul – et un amourardent – pouvait chez un homme aussi orgueilleuxexpliquer un tel changement, et l’impression qu’Elizabethen ressentait était très douce, mais difficile à définir. Elleéprouvait du respect, de l’estime et de la reconnaissance :elle souhaitait son bonheur. Elle aurait voulu seulementsavoir dans quelle mesure elle désirait que ce bonheurdépendît d’elle, et si elle aurait raison d’user du pouvoirqu’elle avait conscience de posséder encore pour l’amenerà se déclarer de nouveau.
Il avait été convenu le soir entre la tante et la nièceque l’amabilité vraiment extraordinaire de miss Darcyvenant les voir le jour même de son arrivée réclamaitd’elles une démarche de politesse, et elles avaient décidéd’aller lui faire visite à Pemberley le lendemain.
Mr. Gardiner partit lui-même ce matin-là peu après le« breakfast » ; on avait reparlé la veille des projets depêche, et il devait retrouver vers midi quelques-uns des
XLVConvaincue maintenant que l’antipathie de miss
Bingley était uniquement l’effet de la jalousie, Elizabethsongeait que son arrivée à Pemberley ne causerait à celle-ci aucun plaisir et elle se demandait avec curiosité enquels termes elles allaient renouer connaissance.
À leur arrivée, on leur fit traverser le hall pour gagnerle salon. Cette pièce, exposée au nord, était d’unefraîcheur délicieuse ; par les fenêtres ouvertes on voyaitles hautes collines boisées qui s’élevaient derrière lechâteau et, plus près, des chênes et des châtaigniersmagnifiques se dressant çà et là sur une pelouse. Lesvisiteuses y furent reçues par miss Darcy qui s’y trouvaiten compagnie de Mrs. Hurst, de miss Bingley, et de lapersonne qui lui servait de chaperon à Londres. L’accueilde Georgiana fut plein de politesse, mais empreint decette gêne causée par la timidité qui pouvait donner à sesinférieurs une impression de hautaine réserve. Mrs.Gardiner et sa nièce, cependant, lui rendirent justice touten compatissant à son embarras.
Mrs. Hurst et miss Bingley les honorèrent simplementd’une révérence et, lorsqu’elles se furent assises, il y eutun silence, – embarrassant comme tous les silences, – quidura quelques instants. Ce fut Mrs. Annesley, personne
d’aspect sympathique et distingué, qui le rompit et sesefforts pour trouver quelque chose d’intéressant à diremontrèrent la supériorité de son éducation sur celle deses compagnes. La conversation parvint à s’établir entreelle et Mrs. Gardiner avec un peu d’aide du côtéd’Elizabeth. Miss Darcy paraissait désireuse d’y prendrepart et risquait de temps à autre une courte phrase quandelle avait le moins de chances d’être entendue.
Elizabeth s’aperçut bientôt qu’elle était étroitementobservée par miss Bingley et qu’elle ne pouvait dire unmot à miss Darcy sans attirer immédiatement sonattention. Cette surveillance ne l’aurait pas empêchéed’essayer de causer avec Georgiana sans la distanceincommode qui les séparait l’une de l’autre. MaisElizabeth ne regrettait pas d’être dispensée de parlerbeaucoup ; ses pensées suffisaient à l’occuper. À toutmoment elle s’attendait à voir apparaître le maître de lamaison et ne savait si elle le souhaitait ou si elle leredoutait davantage.
Après être restée un quart d’heure sans ouvrir labouche, miss Bingley surprit Elizabeth en la questionnantd’un ton froid sur la santé de sa famille. Ayant reçu uneréponse aussi brève et aussi froide elle retomba dans sonmutisme.
L’arrivée de domestiques apportant une collationcomposée de viande froide, de gâteaux et des plus beauxfruits de la saison, amena une diversion. Il y avait là dequoi occuper agréablement tout le monde, et de bellespyramides de raisin, de pêches et de brugnons
rassemblèrent toutes les dames autour de la table.
À cet instant, Elizabeth put être fixée sur sessentiments par l’entrée de Mr. Darcy dans le salon. Ilrevenait de la rivière où il avait passé quelque temps avecMr. Gardiner et deux ou trois hôtes du château, et lesavait quittés seulement quand il avait appris que Mrs.Gardiner et sa nièce se proposaient de faire visite àGeorgiana. Dès qu’il apparut, Elizabeth prit la résolutionde se montrer parfaitement calme et naturelle, –résolution d’autant plus sage, sinon plus facile à tenir, –qu’elle sentait éveillés les soupçons de toutes lespersonnes présentes et que tous les yeux étaient tournésvers Mr. Darcy dès son entrée pour observer sonattitude. Aucune physionomie ne reflétait une curiositéplus vive que celle de miss Bingley, en dépit des souriresqu’elle prodiguait à l’un de ceux qui en étaient l’objet carla jalousie ne lui avait pas enlevé tout espoir et sonempressement auprès de Mr. Darcy restait le même.Miss Darcy s’efforça de parler davantage en présence deson frère. Lui-même laissa voir à Elizabeth combien ildésirait qu’elle fît plus ample connaissance avec sa sœur,et tâcha d’animer leurs essais de conversation. MissBingley le remarquait aussi et, dans l’imprudence de sacolère saisit la première occasion pour demander avec unepolitesse moqueuse :
– Eh bien, miss Eliza, est-ce que le régiment de lamilice n’a pas quitté Meryton ? Ce doit être une grandeperte pour votre famille.
En présence de Mr. Darcy, elle n’osa pas prononcer le
nom de Wickham ; mais Elisabeth comprit tout de suiteque c’était à lui que miss Bingley faisait allusion et lessouvenirs que ce nom éveillait la troublèrent un moment.Un effort énergique lui permit de répondre à cetteattaque d’un ton suffisamment détaché. Tout en parlant,d’un coup d’œil involontaire elle vit Darcy, le visage pluscoloré, lui jeter un regard ardent, tandis que sa sœur,saisie de confusion, n’osait même pas lever les yeux. Simiss Bingley avait su la peine qu’elle infligeait à sa trèschère amie, elle se serait sans doute abstenue de cetteinsinuation, mais elle voulait simplement embarrasserElizabeth par cette allusion à un homme pour lequel ellelui croyait une préférence, espérant qu’elle trahirait uneémotion qui pourrait la desservir aux yeux de Darcy ;voulant aussi, peut-être, rappeler à ce dernier les sottiseset les absurdités commises par une partie de la familleBennet à propos du régiment. Du projet d’enlèvement demiss Darcy elle ne savait pas un mot. L’air tranquilled’Elizabeth calma vite l’émotion de Mr. Darcy et, commemiss Bingley, désappointée, n’osa faire une allusion plusprécise à Wickham, Georgiana se remit aussi peu à peu,mais pas assez pour retrouver le courage d’ouvrir labouche avant la fin de la visite. Son frère, dont elle n’osaitrencontrer le regard, avait presque oublié ce qui laconcernait en cette affaire et l’incident calculé pour ledétourner d’Elizabeth semblait au contraire avoir fixé sapensée sur elle avec plus de confiance qu’auparavant.
La visite prit fin peu après. Pendant que Mr. Darcyaccompagnait Mrs. Gardiner et sa nièce jusqu’à leurvoiture, miss Bingley, pour se soulager, se répandit en
critiques sur Elizabeth, sur ses manières et sa toilette,mais Georgiana se garda bien de lui faire écho ; pouraccorder ses bonnes grâces, elle ne consultait que lejugement de son frère qui était infaillible à ses yeux ; or, ilavait parlé d’Elizabeth en des termes tels que Georgianane pouvait que la trouver aimable et charmante.
Quand Darcy rentra au salon, miss Bingley ne puts’empêcher de lui répéter une partie de ce qu’elle venaitde dire à sa sœur :
– Comme Eliza Bennet a changé depuis l’hiverdernier ! Elle a bruni et perdu toute finesse. Nous disionsà l’instant, Louisa et moi, que nous ne l’aurions pasreconnue.
Quel que fût le déplaisir causé à Mr. Darcy par cesparoles, il se contenta de répondre qu’il ne remarquaitchez Elizabeth d’autre changement que le hâle de sonteint, conséquence assez naturelle d’un voyage fait aucœur de l’été.
– Pour ma part, répliqua miss Bingley, j’avoue que jen’ai jamais pu découvrir chez elle le moindre attrait ; elle ale visage trop mince, le teint sans éclat, ses traits n’ontaucune beauté, son nez manque de caractère, et quant àses yeux que j’ai entendu parfois tellement vanter, je neleur trouve rien d’extraordinaire ; ils ont un regardperçant et désagréable que je n’aime pas du tout, et toutesa personne respire une suffisance intolérable.
Convaincue comme elle l’était de l’admiration de Darcypour Elizabeth, miss Bingley s’y prenait vraiment bien
mal pour lui plaire ; mais la colère est souvent mauvaiseconseillère, et tout le succès qu’elle obtint – et qu’elleméritait – fut d’avoir blessé Darcy. Il gardait toutefois unsilence obstiné et, comme si elle avait résolu à toutes finsde le faire parler, elle poursuivit :
– Quand nous l’avons vue pour la première fois enHertfordshire, je me rappelle à quel point nous avions étésurprises d’apprendre qu’elle était considérée là-bascomme une beauté. Je vous entends encore nous dire, unjour où elle était venue à Netherfield : « Jolie, missElizabeth Bennet ? Autant dire que sa mère est unefemme d’esprit ! » Cependant, elle a paru faire ensuitequelque progrès dans votre estime, et il fut même untemps, je crois, où vous la trouviez assez bien.
– En effet, répliqua Darcy incapable de se contenirplus longtemps. Mais c’était au commencement, car voilàbien des mois que je la considère comme une des plusjolies femmes de ma connaissance.
Là-dessus il sortit, laissant miss Bingley savourer lasatisfaction de lui avoir fait dire ce qu’elle désirait le moinsentendre.
Mrs. Gardiner et Elizabeth, pendant leur retour,parlèrent de tout ce qui s’était passé pendant la visite,excepté de ce qui les intéressait davantage l’une etl’autre. Elles échangèrent leurs impressions sur tout lemonde, sauf sur celui qui les occupait le plus. Ellesparlèrent de sa sœur, de ses amis, de sa maison, de sesfruits, de tout, excepté de lui-même. Cependant Elizabeth
brûlait de savoir ce que sa tante pensait de Mr. Darcy, etMrs. Gardiner aurait été infiniment reconnaissante à sanièce si elle avait entamé ce sujet la première.
XLVIElizabeth avait été fort désappointée en arrivant à
Lambton de ne pas y trouver une lettre de Jane, etchaque courrier avait renouvelé cette déception. Le matindu troisième jour cependant, l’arrivée de deux lettres à lafois mit fin à son attente ; l’une des deux lettres, dontl’adresse était fort mal écrite, avait pris une mauvaisedirection, ce qui expliquait le retard.
Son oncle et sa tante, qui s’apprêtaient à l’emmenerfaire une promenade, sortirent seuls pour lui permettrede prendre tranquillement connaissance de son courrier.Elizabeth ouvrit en premier la lettre égarée qui datait déjàde cinq jours. Jane lui racontait d’abord leurs dernièresréunions et les menues nouvelles locales. Mais la secondepartie, qui avait été écrite un jour plus tard et témoignaitchez Jane d’un état de grande agitation, donnait desnouvelles d’une autre importance :
« Depuis hier, très chère Lizzy, s’est produit unévénement des plus inattendus et des plus graves ; –mais j’ai peur de vous alarmer ; ne craignez rien, noussommes tous en bonne santé. – Ce que j’ai à vous direconcerne la pauvre Lydia. Hier soir à minuit, tout lemonde ici étant couché, est arrivé un exprès envoyé parle colonel Forster pour nous informer qu’elle était partie
pour l’Écosse avec un de ses officiers, pour tout dire, avecWickham. Vous pensez quelle fut notre stupéfaction !Kitty cependant paraissait beaucoup moins étonnée quenous. Quant à moi je suis on ne peut plus bouleversée.Quel mariage imprudent pour l’un comme pour l’autre !Mais j’essaye de ne pas voir les choses trop en noir, et jeveux croire que Wickham vaut mieux que sa réputation.Je le crois léger et imprudent, mais ce qu’il a fait ne décèlepas une nature foncièrement mauvaise et son choixprouve au moins son désintéressement, car il n’ignore pasque mon père ne peut rien donner à Lydia. Notre pauvremère est extrêmement affligée ; mon père supportemieux ce choc. Comme je suis heureuse que nous ne leurayons pas communiqué ce que nous savions surWickham ! Il faut maintenant l’oublier nous-mêmes.
« Ils ont dû partir tous deux, samedi soir, vers minuit,mais on ne s’est aperçu de leur fuite que le lendemainmatin vers huit heures. L’exprès nous a été envoyéimmédiatement. Ma chère Lizzy, ils ont dû passer à dixmilles seulement de Longbourn ! Le colonel nous faitprévoir qu’il arrivera lui-même sous peu. Lydia avaitlaissé un mot à sa femme pour lui annoncer sadétermination. Je suis obligée de m’arrêter, car on nepeut laisser notre pauvre mère seule très longtemps. Jesais à peine ce que j’écris ; j’espère que vous pourrez toutde même me comprendre. »
Sans s’arrêter une seconde pour réfléchir et serendant à peine compte de ce qu’elle éprouvait, Elizabethsaisit la seconde lettre et l’ouvrit fébrilement. Elle
contenait ce qui suit :
« En ce moment, ma chère Lizzy, vous avez sans doutedéjà la lettre que je vous ai griffonnée hier à la hâte.J’espère que celle-ci sera plus intelligible ; toutefois mapauvre tête est dans un tel état que je ne puis répondrede mettre beaucoup de suite dans ce que j’écris. Ma chèreLizzy, j’ai de mauvaises nouvelles à vous apprendre ; ilvaut mieux vous les dire tout de suite. Tout imprudentque nous jugions un mariage entre notre pauvre Lydia etMr. Wickham, nous ne demandons maintenant qu’àrecevoir l’assurance qu’il a bien eu lieu, car trop deraisons nous font craindre qu’ils ne soient pas partis pourl’Écosse.
« Le colonel Forster est arrivé hier ici, ayant quittéBrighton peu d’heures après son exprès. Bien que lacourte lettre de Lydia à sa femme leur eût donné à croireque le couple se rendait à Gretna Green{5}, quelques motsqui échappèrent à Denny exprimant la conviction queWickham n’avait jamais eu la moindre intention d’aller enÉcosse, pas plus que celle d’épouser Lydia, avaient étérapportés au colonel Forster qui, prenant alarme, étaitparti sur l’heure de Brighton pour essayer de releverleurs traces. Il avait pu les suivre facilement jusqu’àClapham, mais pas plus loin, car, en arrivant dans cetteville, ils avaient abandonné la chaise de poste qui les avaitamenés d’Epsom, pour prendre une voiture de louage.Tout ce qu’on sait à partir de ce moment, c’est qu’on les avus poursuivre leur voyage vers Londres. Je me perds enconjectures. Après avoir fait toutes les enquêtes possibles
de ce côté, le colonel Forster a pris la route de Longbournen les renouvelant à toutes les barrières et toutes lesauberges de Barnet et de Hatfield : personne répondant àleur signalement n’avait été remarqué. Il est arrivé àLongbourn en nous témoignant la plus grande sympathieet nous a communiqué ses appréhensions en des termesqui font honneur à ses sentiments. Ni lui, ni sa femme,vraiment, ne méritent aucun reproche.
« Notre désolation est grande, ma chère Lizzy. Monpère et ma mère craignent le pire mais je ne puis croire àtant de perversité de la part de Wickham. Bien descirconstances ont pu leur faire préférer se mariersecrètement à Londres plutôt que de suivre leur premierplan ; et même si Wickham avait pu concevoir de telsdesseins sur une jeune fille du milieu de Lydia, pouvons-nous supposer qu’elle aurait perdu à ce point le sentimentde son honneur et de sa dignité ? C’est impossible ! J’ai leregret de dire, néanmoins, que le colonel Forster nesemble pas disposé à partager l’optimisme de messuppositions. Il a secoué la tête lorsque je les ai expriméesdevant lui et m’a répondu qu’il craignait qu’on ne pûtavoir aucune confiance en Wickham.
« Ma pauvre maman est réellement malade et garde lachambre. Si elle pouvait prendre un peu d’empire surelle-même ! Mais il n’y faut pas compter. Quant à notrepère, de ma vie je ne l’ai vu aussi affecté. La pauvre Kittys’en veut d’avoir dissimulé cette intrigue, mais peut-on luireprocher d’avoir gardé pour elle une confidence faitesous le sceau du secret ? Je suis heureuse, ma chère
Lizzy, que vous ayez échappé à ces scènes pénibles maismaintenant que le premier choc est reçu, j’avoue qu’il metarde de vous voir de retour. Je ne suis pas assez égoïstecependant pour vous presser de revenir plus tôt que vousne le souhaitez. Adieu !
« Je reprends la plume pour vous prier de faire ce qu’àl’instant je n’osais vous demander. Les circonstances sonttelles que je ne puis m’empêcher de vous supplier derevenir tous aussitôt que possible. Je connais assez mononcle et ma tante pour ne pas craindre de leur adressercette prière. J’ai encore une autre demande à faire à mononcle. Mon père part à l’instant avec le colonel Forsterpour Londres où il veut essayer de découvrir Lydia. Parquels moyens, je l’ignore ; mais son extrême désarroil’empêchera, je le crains, de prendre les mesures les plusjudicieuses, et le colonel Forster est obligé d’être deretour à Brighton demain soir. Dans une telle conjoncture,les conseils et l’aide de mon oncle lui seraient infinimentutiles. Il comprendra mon sentiment et je m’en remets àsa grande bonté. »
– Mon oncle ! où est mon oncle ! s’écria Elizabethaprès avoir achevé sa lecture, s’élançant pour courir à sarecherche sans perdre une minute. Elle arrivait à la portelorsque celle-ci fut ouverte par un domestique et livrapassage à Mr. Darcy. La pâleur de la jeune fille et son airagité le firent tressaillir mais avant qu’il eût pu seremettre de sa surprise et lui adresser la parole,Elizabeth, qui n’avait plus d’autre pensée que celle deLydia, s’écria :
– Pardonnez-moi, je vous en prie, si je suis obligée devous quitter, mais il faut que je trouve à l’instant Mr.Gardiner pour une affaire extrêmement urgente. Je n’aipas un instant à perdre…
– Grand Dieu ! Qu’avez-vous donc ? s’écria Darcy avecplus de sympathie que de discrétion ; puis, se reprenant :– Je ne vous retiendrai pas un instant, mais permettezque ce soit moi, ou bien votre domestique, qui aillechercher Mr. et Mrs. Gardiner. Vous êtes incapable d’yaller vous-même.
Elizabeth hésita, mais ses jambes se dérobaient souselle et, comprenant qu’il n’y avait aucun avantage à faireelle-même cette recherche, elle rappela le domestique et,d’une voix haletante, à peine intelligible, elle lui donnal’ordre de ramener ses maîtres au plus vite. Dès qu’il futparti, elle se laissa tomber sur un siège, l’air si défait queDarcy ne put se résoudre à la quitter ni s’empêcher de luidire d’un ton plein de douceur et de commisération :
– Laissez-moi appeler votre femme de chambre. N’ya-t-il rien que je puisse faire pour vous procurer quelquesoulagement ? Un peu de vin, peut-être ? Je vais allervous en chercher. Vous êtes toute pâle.
– Non, je vous remercie, répondit Elizabeth en tâchantde se remettre. Je vous assure que je n’ai rien. Je suisseulement bouleversée par des nouvelles désolantes queje viens de recevoir de Longbourn.
En parlant ainsi elle fondit en larmes, et, pendantquelques minutes, se trouva dans l’impossibilité de
continuer. Darcy, anxieux et désolé, ne put quemurmurer quelques mots indistincts sur sa sympathie etla considérer avec une muette compassion.
À la fin, elle put reprendre :
– Je viens de recevoir une lettre de Jane avec desnouvelles lamentables. Ma jeune sœur a quitté ses amis…elle s’est enfuie… avec… elle s’est livrée au pouvoir de…Mr. Wickham… Vous le connaissez assez pour soupçonnerle reste. Elle n’a ni dot, ni situation, ni rien qui puisse letenter. Elle est perdue à jamais !
Darcy restait immobile et muet d’étonnement.
– Quand je pense, ajouta-t-elle d’une voix encore plusagitée, que j’aurais pu empêcher un pareil malheur ! moiqui savais ce qu’il valait ! Si j’avais seulement répété chezmoi une partie de ce que je savais ! Si on l’avait connupour ce qu’il était, cela ne serait pas arrivé. Etmaintenant, il est trop tard !
– Je suis désolé, s’écria Darcy, désolé et indigné. Maistout cela est-il certain, absolument certain ?
– Hélas oui ! Ils ont quitté Brighton dans la nuit dedimanche, et on a pu relever leurs traces presque jusqu’àLondres, mais pas plus loin. Ils ne sont certainement pasallés en Écosse.
– Et qu’a-t-on fait jusqu’ici ? Qu’a-t-on tenté pour laretrouver ?
– Mon père est parti pour Londres, et Jane écrit pourdemander l’aide immédiate de mon oncle. Nous allons
partir, je pense, d’ici une demi-heure. Mais que pourra-t-on faire ? Quel recours y a-t-il contre un tel homme ?Arrivera-t-on même à les découvrir ? Je n’ai pas le plusléger espoir. La situation est horrible sous tous sesaspects !
Darcy acquiesça de la tête, silencieusement.
– Ah ! quand on m’a ouvert les yeux sur la véritablenature de cet homme, si j’avais su alors quel était mondevoir ! Mais je n’ai pas su, j’ai eu peur d’aller trop loin…Quelle funeste erreur !
Darcy ne répondit pas. Il semblait à peine l’entendre ;plongé dans une profonde méditation, il arpentait la pièced’un air sombre et le front contracté. Elizabeth leremarqua et comprit aussitôt : le pouvoir qu’elle avait eusur lui s’évanouissait, sans doute ; tout devait céderdevant la preuve d’une telle faiblesse dans sa famille,devant l’assurance d’une si profonde disgrâce. Elle nepouvait pas plus s’en étonner que condamner Darcy, maisla conviction qu’il faisait effort pour se ressaisirn’apportait aucun adoucissement à sa détresse. D’autrepart, c’était pour elle le moyen de connaître la véritablenature des sentiments qu’elle éprouvait à son égard.Jamais encore elle n’avait senti qu’elle aurait pu l’aimercomme en cet instant où l’aimer devenait désormais chosevaine.
Mais elle ne pouvait songer longtemps à elle-même.Lydia, l’humiliation et le chagrin qu’elle leur infligeait àtous eurent tôt fait d’écarter toute autre préoccupation ;
et, plongeant sa figure dans son mouchoir, Elizabethperdit de vue tout le reste.
Après quelques minutes, elle fut rappelée à la réalitépar la voix de son compagnon. D’un accent qui exprimaitla compassion, mais aussi une certaine gêne, il lui disait :
– J’ai peur, en restant près de vous, de m’être montréindiscret. Je n’ai aucune excuse à invoquer, sinon celled’une très réelle, mais bien vaine sympathie. Plût à Dieuqu’il fût en mon pouvoir de vous apporter quelquesoulagement dans une telle détresse ! mais je ne veux pasvous importuner de souhaits inutiles et qui sembleraientréclamer votre reconnaissance. Ce malheureuxévénement, je le crains, va priver ma sœur du plaisir devous voir à Pemberley aujourd’hui.
– Hélas oui ! Soyez assez bon pour exprimer nosregrets à miss Darcy. Dites que des affaires urgentes nousrappellent immédiatement. Dissimulez la triste vérité tantqu’elle ne se sera pas ébruitée. Je sais que ce ne sera paspour bien longtemps.
Il l’assura de sa discrétion, exprima encore une fois lapart qu’il prenait à son chagrin, souhaita une conclusionplus heureuse que les circonstances présentes ne lefaisaient espérer et, l’enveloppant d’un dernier regard,prit congé d’elle. Au moment où il disparaissait, Elizabethse dit qu’ils avaient bien peu de chances de se rencontrerde nouveau dans cette atmosphère de cordialité qui avaitfait le charme de leurs entrevues en Derbyshire. Ausouvenir de leurs rapports si divers et si pleins de
revirements, elle songea en soupirant à ces étrangesvicissitudes de sentiments qui lui faisaient souhaitermaintenant la continuation de ces rapports après l’avoiramenée jadis à se réjouir de leur rupture. Elle voyaitpartir Darcy avec regret et cet exemple immédiat desconséquences que devait avoir la conduite de Lydia lui fut,au milieu de ses réflexions, une nouvelle cause d’angoisse.
Depuis qu’elle avait lu la seconde lettre, elle n’avaitplus le moindre espoir quant à l’honnêteté des intentionsde Wickham et à son dessein d’épouser Lydia. Il fallaitêtre Jane pour se flatter d’une telle illusion. Tant qu’ellen’avait connu que le contenu de la première lettre elles’était demandé avec une surprise indicible commentWickham pouvait avoir l’idée d’épouser une jeune fillequ’il savait sans fortune. Que Lydia eût pu se l’attacher luisemblait également incompréhensible. Mais touts’expliquait maintenant : pour ce genre d’attachement,Lydia avait suffisamment de charmes. Certes, Elizabethne pensait pas que celle-ci eût pu consentir à unenlèvement où il n’aurait pas été question de mariage,mais elle se rendait compte aisément que ni la vertu, ni lebon sens ne pouvaient empêcher sa sœur de devenir uneproie facile.
Il lui tardait maintenant d’être de retour. Elle brûlaitd’être sur les lieux, de pouvoir se renseigner, et departager avec sa sœur les soucis qui dans une maisonaussi bouleversée, et en l’absence du père, devaientretomber uniquement sur Jane. Malgré sa crainte de voirrester vains les efforts tentés pour sauver Lydia, elle
estimait l’intervention de son oncle de la plus hauteimportance et attendait son retour dans la plusdouloureuse agitation.
Mr. et Mrs. Gardiner arrivèrent tout effrayés, lerapport du domestique leur ayant fait croire que leurnièce se trouvait subitement malade. Elle les rassura surce point, et leur communiqua immédiatement les deuxlettres de Jane. D’une voix tremblante d’émotion, ellesouligna le post-scriptum de la seconde.
L’affliction de Mr. et de Mrs. Gardiner fut profonde,bien que Lydia n’eût jamais été leur favorite, mais il nes’agissait pas d’elle seule ; sa disgrâce atteignait toute safamille. Après les premières exclamations de surprise etd’horreur, Mr. Gardiner promit sans hésiter tout sonconcours ; sa nièce, bien qu’elle n’attendît pas moins delui, le remercia avec des larmes de reconnaissance. Toustrois se trouvant animés du même esprit, leursdispositions en vue du départ furent prises rapidement ; ilfallait se mettre en route aussi vite que possible.
– Et notre invitation à Pemberley ? qu’allons-nousfaire à ce sujet ? s’écria Mrs. Gardiner. John nous a ditque Mr. Darcy était présent quand vous l’avez envoyénous chercher. Est-ce bien exact ?
– Parfaitement, et je lui ai dit que nous ne pourrionstenir notre engagement. Tout est réglé de ce côté.
« Qu’est-ce qui est réglé ? se demandait la tante encourant à sa chambre pour se préparer au départ. Sont-ilsdans des termes tels qu’elle ait pu lui découvrir la vérité ?
Je donnerais beaucoup pour savoir ce qui s’est passéentre eux. »
Si Elizabeth avait eu le loisir de rester inactive, elle seserait sûrement crue incapable de faire quoi que ce fûtdans le désarroi où elle se trouvait, mais elle dut aider satante dans ses préparatifs qui comprenaient l’obligationd’écrire à tous leurs amis de Lambton afin de leur donnerune explication plausible de leur départ subit. En uneheure, cependant, tout fut terminé et Mr. Gardiner ayant,pendant ce temps, réglé ses comptes à l’hôtel, il n’y eutplus qu’à partir. Après cette dure matinée Elizabeth setrouva, en moins de temps qu’elle ne l’aurait supposé,installée en voiture, et sur la route de Longbourn.
XLVII– Plus je réfléchis à cette affaire, Elizabeth, lui dit son
oncle comme ils quittaient la ville, plus j’incline à pensercomme votre sœur aînée : il me semble si étrange qu’unjeune homme ait pu former un tel dessein sur une jeunefille qui n’est pas, certes, sans protecteurs et sans amis etqui, par contre, résidait dans la famille de son colonel, queje suis très enclin à adopter la supposition la plusfavorable. Wickham pouvait-il s’attendre à ce que lafamille de Lydia n’intervînt pas, ou pouvait-il ignorer qu’ilserait mis au ban de son régiment après un tel affront faitau colonel Forster ? Le risque serait hors de proportionavec le but.
– Le croyez-vous vraiment ? s’écria Elizabeth dont levisage s’éclaira un instant.
– Pour ma part, s’écria Mrs. Gardiner, je commence àêtre de l’avis de votre oncle. Il y aurait là un trop grandoubli de la bienséance, de l’honneur et de ses propresintérêts pour que Wickham puisse en être accusé. Vous-même, Lizzy, avez-vous perdu toute estime pour lui aupoint de l’en croire capable ?
– Capable de négliger ses intérêts, non, je ne le croispas, mais de négliger tout le reste, oui, certes ! Si
cependant tout était pour le mieux !… Mais je n’osel’espérer. Pourquoi, dans ce cas, ne seraient-ils pas partispour l’Écosse ?
– En premier lieu, répliqua Mr. Gardiner, il n’y a pasde preuve absolue qu’ils ne soient pas partis pourl’Écosse.
– Le fait qu’ils ont quitté la voiture de poste pourprendre une voiture de louage est une bien forteprésomption. En outre, on n’a pu relever d’eux aucunetrace sur la route de Barnet.
– Eh bien, supposons qu’ils soient à Londres. Ilspeuvent y être pour se cacher, mais sans autre motif plusblâmable. N’ayant sans doute ni l’un ni l’autre beaucoupd’argent, ils ont pu trouver plus économique, sinon aussiexpéditif, de se faire marier à Londres plutôt qu’enÉcosse.
– Mais pourquoi tout ce mystère ? Pourquoi cemariage clandestin ? Non, non, cela n’est pasvraisemblable. Son ami le plus intime, – vous l’avez vudans le récit de Jane, – est persuadé qu’il n’a jamais eul’intention d’épouser Lydia. Jamais Wickham n’épouseraune femme sans fortune ; ses moyens ne le lui permettentpas. Et quels attraits possède donc Lydia, à part sajeunesse et sa gaieté, pour le faire renoncer en sa faveur àun mariage plus avantageux ? Quant à la disgrâce qu’ilencourrait à son régiment, je ne puis en juger, mais j’aibien peur que votre dernière raison ne puisse sesoutenir : Lydia n’a pas de frère pour prendre en main ses
intérêts, et Wickham pouvait imaginer d’après ce qu’ilconnaît de mon père, de son indolence et du peud’attention qu’il semble donner à ce qui se passe chez lui,qu’il ne prendrait pas cette affaire aussi tragiquement quebien des pères de famille.
– Mais croyez-vous Lydia assez fermée à toutsentiment autre que sa folle passion pour consentir devivre avec Wickham sans qu’ils soient mariés ?
– Il est vraiment affreux, répondit Elizabeth, les yeuxpleins de larmes, d’être forcée de douter de sa sœur, etcependant, je ne sais que répondre. Peut-être suis-jeinjuste à son égard, mais Lydia est très jeune, elle n’a pasété habituée à penser aux choses sérieuses et voilà sixmois que le plaisir et la vanité sont toutes sespréoccupations. On l’a laissée libre de disposer de sontemps de la façon la plus frivole et de se gouverner à safantaisie. Depuis que le régiment a pris ses quartiers àMeryton, elle n’avait plus en tête que le flirt et lesmilitaires. Bref elle a fait tout ce qu’elle pouvait –comment dirai-je, – pour donner encore plus de force àdes penchants déjà si accusés. Et vous savez comme moique Wickham, par la séduction de ses manières et de sapersonne, a tout ce qu’il faut pour tourner une tête dejeune fille.
– Mais vous voyez, dit sa tante, que Jane ne juge pasWickham assez mal pour le croire capable d’un telscandale.
– Qui Jane a-t-elle jamais jugé sévèrement ?
Cependant, elle connaît Wickham aussi bien que moi.Nous savons toutes deux qu’il est dépravé au véritablesens du mot, qu’il n’a ni loyauté, ni honneur, et qu’il estaussi trompeur qu’insinuant.
– Vous savez vraiment tout cela ! s’écria Mrs.Gardiner, brûlant de connaître la source de toutes cesrévélations.
– Oui, certes, répliqua Elizabeth en rougissant. Je vousai parlé l’autre jour de l’infamie de sa conduite envers Mr.Darcy ; vous-même, pendant votre séjour à Longbourn,avez pu entendre de quelle manière il parlait de l’hommequi a montré à son égard tant de patience et degénérosité. Il y a d’autres circonstances que je ne suis paslibre de raconter : ses mensonges sur la famille dePemberley ne comptent plus. Par ce qu’il m’avait dit demiss Darcy, je m’attendais à trouver une jeune fille fière,distante et désagréable. Il savait pourtant qu’elle étaitaussi aimable et aussi simple que nous l’avons trouvée.
– Mais Lydia ne sait-elle rien de tout cela ? Peut-elleignorer ce dont vous et Jane paraissez si bien informées ?
– Hélas ! C’est bien là le pire ! Jusqu’à mon séjour dansle Kent pendant lequel j’ai beaucoup vu M. Darcy et soncousin, le colonel Fitzwilliam, j’ignorais moi-même lavérité. Quand je suis revenue à la maison, le régimentallait bientôt quitter Meryton ; ni Jane, ni moi n’avonsjugé nécessaire de dévoiler ce que nous savions. Quand ilfut décidé que Lydia irait avec les Forster à Brighton, lanécessité de lui ouvrir les yeux sur le véritable caractère
de Wickham ne m’est pas venue à l’esprit. Vous devinezcombien j’étais loin de penser que mon silence pût causerune telle catastrophe !
– Ainsi, au moment du départ pour Brighton, vousn’aviez aucune raison de les croire épris l’un de l’autre ?
– Aucune, ni d’un côté, ni de l’autre, je ne puis merappeler le moindre indice d’affection. Pourtant, siquelque chose de ce genre avait été visible, vous pensezque dans une famille comme la nôtre, on n’aurait pasmanqué de s’en apercevoir. Lors de l’arrivée de Wickhamà Meryton, Lydia était certes pleine d’admiration pour lui,mais elle n’était pas la seule, puisqu’il avait fait perdre latête à toutes les jeunes filles de Meryton et des environs.Lui-même, de son côté, n’avait paru distinguer Lydia paraucune attention particulière. Aussi, après une courtepériode d’admiration effrénée, le caprice de Lydia s’étaitéteint et elle avait rendu sa préférence aux officiers qui semontraient plus assidus auprès d’elle.
On s’imagine facilement que tel fut l’unique sujet deconversation durant tout le temps du voyage, bien qu’iln’y eût dans tout ce qu’ils disaient rien qui fût de nature àdonner plus de force à leurs craintes et à leurs espoirs.
Le trajet se fit avec toute la rapidité possible. Envoyageant toute la nuit, ils réussirent à atteindreLongbourn le jour suivant, à l’heure du dîner. C’était unsoulagement pour Elizabeth de penser que l’épreuved’une longue attente serait épargnée à Jane.
Attirés par la vue de la chaise de poste, les petits
Gardiner se pressaient sur les marches du perronlorsqu’elle franchit le portail et, au moment où elles’arrêta, leur joyeuse surprise se traduisit par desgambades et des culbutes. Elizabeth avait déjà sauté de lavoiture et, leur donnant à chacun un baiser hâtif, s’étaitélancée dans le vestibule où elle rencontra Jane quidescendait en courant de l’appartement de sa mère.Elizabeth en la serrant affectueusement dans ses bras,pendant que leurs yeux s’emplissaient de larmes, se hâtade lui demander si l’on avait des nouvelles des fugitifs.
– Pas encore, dit Jane, mais maintenant que mon cheroncle est là, j’ai l’espoir que tout va s’arranger.
– Mon père est-il à Londres ?
– Oui, depuis mardi, comme je vous l’ai écrit.
– Et vous avez reçu de ses nouvelles ?
– Une fois seulement. Il m’a écrit mercredi quelqueslignes pour me donner les instructions que je lui avaisdemandées. Il ajoutait qu’il n’écrirait plus tant qu’iln’aurait rien d’important à nous annoncer.
– Et notre mère, comment va-t-elle ? Comment allez-vous tous ?
– Elle ne va pas mal, je crois, bien que très secouée,mais ne quitte pas sa chambre. Elle sera satisfaite de vousvoir tous les trois. Mary et Kitty, Dieu merci, vont bien.
– Mais vous ? s’écria Elizabeth. Je vous trouve trèspâle. Vous avez dû passer des heures bien cruelles !
Jane assura qu’elle allait parfaitement et leurconversation fut coupée par l’arrivée de Mr. et Mrs.Gardiner que leurs enfants avaient retenus jusque-là.Jane courut à eux et les remercia en souriant à traversses larmes.
Mrs. Bennet les reçut comme ils pouvaient s’yattendre, pleurant, gémissant, accablant d’invectivesl’infâme conduite de Wickham, plaignant ses propressouffrances et accusant l’injustice du sort, blâmant tout lemonde, excepté la personne dont l’indulgence malaviséeétait surtout responsable de l’erreur de sa fille.
– Si j’avais pu aller avec toute ma famille à Brightoncomme je le désirais, cela ne serait pas arrivé. Mais Lydia,la pauvre enfant, n’avait personne pour veiller sur elle.Comment se peut-il que les Forster ne l’aient pas mieuxgardée ? Il y a eu certainement de leur part unenégligence coupable, car Lydia n’était pas fille à agir ainsi,si elle avait été suffisamment surveillée. J’ai toujourspensé qu’on n’aurait pas dû la leur confier. Mais, commec’est la règle, on ne m’a pas écoutée ! Pauvre chèreenfant ! Et maintenant, voilà Mr. Bennet parti. Il vasûrement se battre en duel avec Wickham, s’il leretrouve, et il se fera tuer… Et alors, qu’adviendra-t-il denous toutes ? À peine aura-t-il rendu le dernier soupirque les Collins nous mettront hors d’ici et si vous n’avezpas pitié de nous, mon frère, je ne sais vraiment pas ceque nous deviendrons.
Tous protestèrent en chœur contre ces sombressuppositions, et Mr. Gardiner, après avoir assuré sa sœur
de son dévouement pour elle et sa famille, dit qu’ilretournerait à Londres le lendemain pour aider Mr.Bennet de tout son pouvoir à retrouver Lydia.
– Ne vous laissez pas aller à d’inutiles alarmes, ajouta-t-il. S’il vaut mieux s’attendre au pire, nous n’avons pasde raisons de le considérer comme certain. Il n’y a pastout à fait une semaine qu’ils ont quitté Brighton. Dansquelques jours nous pouvons avoir de leurs nouvelles, et,jusqu’à ce que nous apprenions qu’ils ne sont pas mariés,ni sur le point de l’être, rien ne prouve que tout soitperdu. Dès que je serai à Londres, j’irai trouver votremari ; je l’installerai chez moi et nous pourrons alorsdécider ensemble ce qu’il convient de faire.
– Oh ! mon cher frère, s’exclama Mrs. Bennet. Je nepouvais rien souhaiter de mieux. Et maintenant, je vousen supplie, où qu’ils soient, trouvez-les, et s’ils ne sont pasmariés, mariez-les ! Que la question des habits de noce neles retarde pas. Dites seulement à Lydia qu’aussitôtmariée elle aura tout l’argent nécessaire pour les acheter.Mais, par-dessus tout, empêchez Mr. Bennet de sebattre ! Dites-lui dans quel état affreux vous m’avez vue,à moitié morte de peur, avec de telles crises de frissons,de spasmes dans le côté, de douleurs dans la tête et depalpitations, que je ne puis reposer ni jour, ni nuit. Ditesencore à cette chère Lydia de ne pas prendre de décisionpour ses achats de toilettes avant de m’avoir vue, parcequ’elle ne connaît pas les meilleures maisons. Ô monfrère ! que vous êtes bon ! Je sais qu’on peut compter survous pour tout arranger.
Mr. Gardiner l’assura de nouveau de son vif désir del’aider et lui recommanda la modération dans ses espoirsaussi bien que dans ses craintes. La conversation continuaainsi jusqu’à l’annonce du dîner. Alors ils descendirenttous, laissant Mrs. Bennet s’épancher dans le sein de lafemme de charge qui la soignait en l’absence de ses filles.Bien que la santé de Mrs. Bennet ne parût pas réclamerde telles précautions, son frère et sa belle-sœur necherchèrent pas à la persuader de quitter sa chambre, carils savaient qu’elle était incapable de se taire à tabledevant les domestiques et ils jugeaient préférable qu’uneseule personne, – la servante en qui l’on pouvait avoir leplus de confiance, – reçût la confidence de ses craintes etde ses angoisses.
Dans la salle à manger, ils furent bientôt rejoints parMary et Kitty que leurs occupations avaient empêchéesde paraître plus tôt. L’une avait été retenue par ses livres,l’autre par sa toilette. Toutes deux avaient le visagesuffisamment calme ; néanmoins, l’absence de sa sœurfavorite, ou le mécontentement qu’elle avait encouru elle-même en cette affaire, donnait à la voix de Kitty un accentplus désagréable que d’habitude. Quant à Mary, elle étaitassez maîtresse d’elle-même pour murmurer à Elizabethdès qu’elles furent assises à table :
– C’est une bien regrettable histoire, et qui va fairebeaucoup parler mais, de ce triste événement, il y a uneleçon utile à tirer, c’est que chez la femme, la perte de lavertu est irréparable, que sa réputation est aussi fragilequ’elle est précieuse, et que nous ne saurions être trop en
garde contre les représentants indignes de l’autre sexe.
Elizabeth lui jeta un regard stupéfait et se sentitincapable de lui répondre.
Dans l’après-midi, les deux aînées purent avoir unedemi-heure de tranquillité. Elizabeth en profita pourposer à Jane maintes questions.
– Donnez-moi tous les détails que je ne connais pasencore. Qu’a dit le colonel Forster ? N’avaient-ils, lui et safemme, conçu aucun soupçon avant le jour del’enlèvement ? On devait voir Lydia et Wickham souventensemble.
– Le colonel Forster a avoué qu’il avait à plusieursreprises soupçonné une certaine inclination, du côté deLydia surtout, mais rien dont on eût lieu de s’alarmer… Jesuis si fâchée pour ce pauvre colonel. Il est impossibled’agir avec plus de cœur qu’il ne l’a fait. Il se proposait devenir nous exprimer sa contrariété avant même de savoirqu’ils n’étaient pas partis pour l’Écosse. Dès qu’il a étérenseigné, il a hâté son voyage.
– Et Denny, est-il vraiment convaincu que Wickhamne voulait pas épouser Lydia ? Le colonel Forster a-t-il vuDenny lui-même ?
– Oui, mais questionné par lui, Denny a nié avoir euconnaissance des plans de son camarade et n’a pas vouludire ce qu’il en pensait. Ceci me laisse espérer qu’on a pumal interpréter ce qu’il m’avait dit en premier lieu.
– Jusqu’à l’arrivée du colonel, personne de vous,
naturellement, n’éprouvait le moindre doute sur le but deleur fuite ?
– Comment un tel doute aurait-il pu nous venir àl’esprit ? J’éprouvais bien quelque inquiétude au sujet del’avenir de Lydia, la conduite de Wickham n’ayant pastoujours été sans reproche ; mais mon père et ma mèreignoraient tout cela et sentaient seulement l’imprudenced’une telle union. C’est alors que Kitty, avec un air de seprévaloir de ce qu’elle en savait plus que nous, nous aavoué que Lydia, dans sa dernière lettre, l’avait préparéeà cet événement. Elle savait qu’ils s’aimaient, semble-t-il,depuis plusieurs semaines.
– Mais pas avant le départ pour Brighton ?
– Non, je ne le crois pas.
– Et le colonel Forster, semblait-il juger lui-mêmeWickham défavorablement ? Le connaît-il sous son vraijour ?
– Je dois reconnaître qu’il n’en a pas dit autant de bienqu’autrefois. Il le trouve imprudent et dépensier, et,depuis cette triste affaire, on dit dans Meryton qu’il y alaissé beaucoup de dettes ; mais je veux espérer que c’estfaux.
– Oh ! Jane, si seulement nous avions été moinsdiscrètes ! Si nous avions dit ce que nous savions ! Rien neserait arrivé.
– Peut-être cela eût-il mieux valu, mais nous avons agiavec les meilleures intentions.
– Le colonel Forster a-t-il pu vous répéter ce queLydia avait écrit à sa femme ?
– Il a apporté la lettre elle-même pour nous lamontrer. La voici.
Et Jane la prenant dans son portefeuille la tendit àElizabeth.
La lettre était ainsi conçue :
« Ma chère Harriet,
« Vous allez sûrement bien rire en apprenant où je suispartie. Je ne puis m’empêcher de rire moi-même enpensant à la surprise que vous aurez demain matin,lorsque vous vous apercevrez que je ne suis plus là.
« Je pars pour Gretna Green, et si vous ne devinez pasavec qui, c’est que vous serez bien sotte, car il n’y a quelui qui existe à mes yeux ; c’est un ange, et je l’adore !Aussi ne vois-je aucun mal à partir avec lui. Ne vousdonnez pas la peine d’écrire à Longbourn si cela vousennuie. La surprise n’en sera que plus grande lorsqu’onrecevra là-bas une lettre de moi signée : Lydia Wickham.La bonne plaisanterie ! J’en ris tellement que je puis àpeine écrire !
« Dites à Pratt mon regret de ne pouvoir danser aveclui ce soir. Il ne m’en voudra pas de ne point tenir mapromesse, quand il saura la raison qui m’en empêche.
« J’enverrai chercher mes vêtements dès que je seraià Longbourn, mais je vous serai reconnaissante de dire àSally de réparer un grand accroc à ma robe de mousseline
brodée avant de l’emballer.
« Mes amitiés au colonel Forster ; j’espère que vousboirez tous deux à notre santé et à notre heureux voyage.
« Votre amie affectionnée,
« LYDIA. »
– Écervelée, insouciante Lydia ! s’écria Elizabeth.Écrire une telle lettre dans un moment pareil ! Toutefois,ceci nous montre que de son côté il n’y avait pas dehonteuses intentions. Mon pauvre père ! Quel coup pourlui !
– Il a été positivement atterré. Pendant quelquesminutes, il est resté sans pouvoir articuler une syllabe.Ma mère s’est trouvée mal, et la maison a été dans unétat de confusion indescriptible.
– Oh ! Jane, s’écria Elizabeth, y a-t-il un seul de nosdomestiques qui n’ait tout connu avant la fin de lajournée ?
– Je ne sais. Il est bien difficile d’être sur ses gardes ende tels moments. Notre mère avait des attaques de nerfset je faisais tout mon possible pour la soulager. Mais jecrains de n’avoir pas fait tout ce que j’aurais pu. L’horreuret le chagrin m’ôtaient presque l’usage de mes facultés.
– Toutes ces fatigues ont excédé vos forces. Vous avezl’air épuisée. Oh ! que n’étais-je avec vous ! Tous les soinset toutes les angoisses sont retombés sur vous seule.
– Mary et Kitty ont été très gentilles. Ma tante Philips,
venue à Longbourn mardi, après le départ de notre père,a eu l’obligeance de rester avec nous jusqu’à jeudi. LadyLucas, elle aussi, nous a montré beaucoup de bonté. Elleest venue mercredi nous apporter ses condoléances etnous offrir ses services ou ceux de ses filles au cas où nousen aurions besoin.
– Lady Lucas aurait mieux fait de rester chez elle !s’écria Elizabeth. Peut-être ses intentions étaient bonnes ;mais dans une infortune comme la nôtre, moins on voitses voisins et mieux cela vaut. Leur assistance ne peutêtre d’aucun secours et leurs condoléances sontimportunes. Qu’ils triomphent de loin et nous laissent enpaix !
Elle s’enquit alors des mesures que Mr. Bennet, unefois à Londres, comptait prendre pour retrouver sa fille.
– Il voulait, je crois, aller à Epsom, – car c’est là queWickham et Lydia ont changé de chevaux pour ladernière fois, – et voir s’il pouvait obtenir des postillonsquelques renseignements. Son but principal était dedécouvrir la voiture de louage qu’ils avaient prise àClapham. Cette voiture avait amené de Londres unvoyageur : s’il pouvait connaître la maison où le fiacreavait déposé son voyageur, il aurait à faire là aussi uneenquête qui pouvait, pensait-il, lui faire découvrir lenuméro et la station du fiacre. J’ignore ses autres projets.Il avait si grande hâte de partir et il était tellementtroublé que j’ai déjà eu beaucoup de mal à lui arracher cesquelques renseignements.
XLVIIILe lendemain matin, on s’attendait à Longbourn à
recevoir une lettre de Mr. Bennet, mais le courrier passasans rien apporter de lui. Mr. Bennet était connu pourêtre en temps ordinaire un correspondant plein denégligence. Tout de même, en des circonstances pareilles,les siens attendaient de lui un effort. Ils furent obligés deconclure qu’il n’avait à leur envoyer aucune nouvellerassurante. Mais de cela même ils auraient aimé êtrecertains. Mr. Gardiner se mit en route pour Londresaussitôt après le passage de la poste.
Par lui, du moins, on serait assuré d’être tenu aucourant. Il devait insister auprès de Mr. Bennet pour qu’ilrevînt chez lui le plus tôt possible ; il l’avait promis enpartant, au grand soulagement de sa sœur qui voyait dansce retour la seule chance pour son mari de n’être pas tuéen duel. Mrs. Gardiner s’était décidée à rester quelquesjours de plus en Hertfordshire avec ses enfants, dans lapensée qu’elle pourrait être utile à ses nièces. Elle lesaidait à s’occuper de leur mère et sa présence leur étaitun réconfort dans leurs moments de liberté. Leur tantePhilips aussi les visitait fréquemment, et toujours, commeelle le disait, dans l’unique but de les distraire et de lesremonter ; mais comme elle n’arrivait jamais sans leur
apporter un nouveau témoignage des désordres deWickham, elle laissait généralement ses nièces plusdécouragées qu’elle ne les avait trouvées.
Tout Meryton semblait s’acharner à noircir l’hommequi, trois mois auparavant, avait été son idole. Onracontait qu’il avait laissé des dettes chez tous lescommerçants de la ville, et qu’il avait eu des intriguesqu’on décorait du nom de séductions dans les familles detous ces commerçants. On le proclamait d’une voixunanime l’homme le plus dépravé de l’univers, et chacuncommençait à découvrir que ses dehors vertueux ne luiavaient jamais inspiré confiance. Elizabeth, tout enn’ajoutant pas foi à la moitié de ces racontars, en retenaitassez pour être de plus en plus convaincue de la perteirrémédiable de sa sœur. Jane elle-même abandonnaittout espoir à mesure que le temps s’écoulait, car, si lesfugitifs étaient partis pour l’Écosse, ce qu’elle avaittoujours voulu espérer, on aurait, selon toute probabilité,déjà reçu de leurs nouvelles.
Mr. Gardiner avait quitté Longbourn le dimanche : lemardi, sa femme reçut une lettre où il disait qu’il avait vuson beau-frère à son arrivée, et l’avait décidé à s’installerà Gracechurch street. Mr. Bennet revenait d’Epsom et deClapham où il n’avait pu recueillir la moindreinformation ; il se disposait maintenant à demander desrenseignements dans tous les hôtels de Londres, pensantque Wickham et Lydia avaient pu séjourner dans l’und’eux avant de trouver un logement. Mr. Gardinern’attendait pas grand’chose de ces recherches mais
comme son beau-frère y tenait, il s’apprêtait à leseconder. Il ajoutait que Mr. Bennet n’était pas disposépour l’instant à quitter Londres et qu’il allait écrire à safamille. Un post-scriptum suivait ainsi conçu : « Je viensd’écrire au colonel Forster pour lui demander d’essayerde savoir par les camarades de Wickham si ce dernier ades parents ou des amis en passe de connaître l’endroit oùil se dissimule. Ce serait un point capital pour nous que desavoir où nous adresser avec des chances de trouver un filconducteur. Actuellement, nous n’avons rien pour nousguider. Le colonel Forster, j’en suis sûr, fera tout sonpossible pour nous obtenir ce renseignement ; mais, en yréfléchissant, je me demande si Lizzy ne saurait pas nousdire mieux que personne quels peuvent être les prochesparents de Wickham. »
Elizabeth se demanda pourquoi l’on faisait appel à sonconcours. Il lui était impossible de fournir aucuneindication. Elle n’avait jamais entendu parler à Wickhamde parents autres que son père et sa mère, décédésdepuis longtemps. Il était possible en effet qu’un de sescamarades du régiment fût capable d’apporter plus delumière. Même sans chances sérieuses de réussir, il yavait à faire de ce côté une tentative qui entretiendraitl’espérance dans les esprits.
L’une après l’autre, les journées s’écoulaient àLongbourn dans une anxiété que redoublait l’heure dechaque courrier. Car toute nouvelle, bonne ou mauvaise,ne pouvait venir que par la poste. Mais avant que Mr.Gardiner écrivît de nouveau, une lettre venant d’une tout
autre direction, – une lettre de Mr. Collins, – arriva àl’adresse de Mr. Bennet. Jane, chargée de dépouiller lecourrier de son père, l’ouvrit, et Elizabeth, qui connaissaitle curieux style des lettres de son cousin, lut par-dessusl’épaule de sa sœur :
« Mon cher Monsieur,
« Nos relations de parenté et ma situation de membredu clergé me font un devoir de prendre part à ladouloureuse affliction qui vous frappe, et dont nous avonsété informés hier par une lettre du Hertfordshire. Croyezbien, cher Monsieur, que Mrs. Collins et moisympathisons sincèrement avec vous et toute votrerespectable famille, dans votre présente infortune,d’autant plus amère qu’elle est irréparable. Je ne veuxoublier aucun argument capable de vous réconforter danscette circonstance affligeante entre toutes pour le cœurd’un père. La mort de votre fille eût été en comparaisonune grâce du ciel. L’affaire est d’autant plus triste qu’il y afort à supposer, ainsi que me le dit ma chère Charlotte,que la conduite licencieuse de votre fille provient de lamanière déplorable dont elle a été gâtée. Cependant, pourvotre consolation et celle de Mrs. Bennet, j’incline àpenser que sa nature était foncièrement mauvaise, sansquoi elle n’aurait pas commis une telle énormité à un âgeaussi tendre. Quoi qu’il en soit, vous êtes fort à plaindre,et je partage cette opinion non seulement avec Mrs.Collins, mais encore avec lady Catherine et miss deBourgh. Elles craignent comme moi que l’erreur d’une dessœurs ne porte préjudice à l’avenir de toutes les autres ;
car, ainsi que daignait tout à l’heure me faire remarquerlady Catherine, « qui voudrait maintenant s’allier à votrefamille » ? Et cette considération me porte à réfléchir surle passé avec encore plus de satisfaction, car si lesévénements avaient pris un autre tour, en novembredernier, il me faudrait participer maintenant à votrechagrin et à votre déshonneur.
« Laissez-moi vous conseiller, cher Monsieur, dereprendre courage, de rejeter loin de votre affection unefille indigne et de la laisser recueillir les fruits de soncoupable égarement.
« Croyez, cher Monsieur, » etc.
Mr. Gardiner ne récrivit qu’après avoir reçu laréponse du colonel Forster, mais il n’avait rien desatisfaisant à communiquer. On ne connaissait à Wickhamaucun parent avec qui il entretînt des rapports, et trèscertainement il n’avait plus de famille proche. Il nemanquait pas de relations banales, mais depuis sonarrivée au régiment on ne l’avait vu se lier intimementavec personne. L’état pitoyable de ses finances était pourlui un puissant motif de se cacher, qui s’ajoutait à lacrainte d’être découvert par la famille de Lydia. Le bruitse répandait qu’il avait laissé derrière lui des dettes de jeuconsidérables. Le colonel Forster estimait qu’il faudraitplus de mille livres pour régler ses dépenses à Brighton. Ildevait beaucoup en ville, mais ses dettes d’honneurétaient plus formidables encore.
Mr. Gardiner n’essayait pas de dissimuler ces faits.
Jane les apprit avec horreur :
– Quoi ! Wickham un joueur ! C’est inouï ! s’écriait-elle. Je ne m’en serais jamais doutée !
La lettre de Mr. Gardiner annonçait aux jeunes filles leretour probable de leur père le lendemain même qui étaitun samedi. Découragé par l’insuccès de ses tentatives, ilavait cédé aux instances de son beau-frère qui l’engageaità retourner auprès des siens en lui laissant le soin depoursuivre ses recherches à Londres. Cette déterminationne causa pas à Mrs. Bennet la joie à laquelle ons’attendait, après les craintes qu’elle avait manifestéespour l’existence de son mari.
– Comment, il revient sans cette pauvre Lydia ! Ilquitte Londres avant de les avoir retrouvés ! Qui donc, s’ils’en va, se battra avec Wickham pour l’obliger à épouserLydia ?
Comme Mrs. Gardiner désirait retourner chez elle, ilfut convenu qu’elle partirait avec ses enfants le jour duretour de Mr. Bennet. La voiture les transporta doncjusqu’au premier relais et revint à Longbourn avec sonmaître.
Mrs. Gardiner repartait non moins intriguée au sujetd’Elizabeth et de son ami de Pemberley qu’elle l’avait étéen quittant le Derbyshire. Le nom de Darcy n’était plusjamais venu spontanément aux lèvres de sa nièce, et ledemi-espoir qu’elle-même avait formé de voir arriver unelettre de lui s’était évanoui. Depuis son retour, Elizabethn’avait rien reçu qui parût venir de Pemberley. En vérité,
on ne pouvait faire aucune conjecture d’après l’humeurd’Elizabeth, son abattement s’expliquant assez par lestristesses de la situation présente. Cependant, celle-civoyait assez clair en elle-même pour sentir que si ellen’avait pas connu Darcy, elle aurait supporté la crainte dudéshonneur de Lydia avec un peu moins d’amertume etqu’une nuit d’insomnie sur deux lui aurait été épargnée.
Lorsque Mr. Bennet arriva chez lui, il paraissait avoirrepris son flegme et sa philosophie habituels. Aussi peucommunicatif que de coutume, il ne fit aucune allusion àl’événement qui avait motivé son départ et ses fillesn’eurent pas le courage de lui en parler elles-mêmes.
C’est seulement l’après-midi lorsqu’il les rejoignit pourle thé qu’Elizabeth osa aborder le sujet ; mais lorsqu’ellelui eut exprimé brièvement son regret de tout ce qu’ilavait dû supporter, il répliqua :
– Ne parlez pas de cela. Comme je suis responsable dece qui s’est passé, il est bien juste que j’en souffre.
– Ne soyez pas trop sévère pour vous-même, protestaElizabeth.
– C’est charitable à vous de me prémunir contre un teldanger. Non, Lizzy, laissez-moi sentir au moins une foisdans mon existence combien j’ai été répréhensible. Necraignez point de me voir accablé par ce sentiment quipassera toujours assez tôt.
– Croyez-vous qu’ils soient à Londres ?
– Je le crois. Où pourraient-ils être mieux cachés ?
– Et Lydia souhaitait beaucoup aller à Londres,remarqua Kitty.
– Elle peut être satisfaite alors, dit son pèrefroidement, car elle y demeurera sans doute quelquetemps.
Après un court silence, il reprit :
– Lizzy, je ne vous en veux pas d’avoir eu raisoncontre moi. L’avis que vous m’avez donné au mois de mai,et qui se trouve justifié par les événements, dénote unesprit clairvoyant.
Ils furent interrompus par Jane qui venait chercher lethé de sa mère.
– Quelle aimable mise en scène, et que cela donned’élégance au malheur ! s’écria Mr. Bennet. J’ai bonneenvie, moi aussi, de m’enfermer dans ma bibliothèque enbonnet de nuit et en robe de chambre, et de donner toutl’embarras possible à mon entourage. Mais peut-êtrepuis-je attendre pour cela que Kitty se fasse enlever à sontour.
– Mais je n’ai pas l’intention de me faire enlever,papa ! répliqua Kitty d’un ton vexé. Et si jamais je vais àBrighton, je m’y conduirai beaucoup mieux que Lydia.
– Vous, aller à Brighton ! mais je ne voudrais pas vousvoir aller même à Eastbourn pour un empire ! Non, Kitty.J’ai appris enfin la prudence, et vous en sentirez les effets.Aucun officier désormais ne sera admis à franchir le seuilde ma maison, ni même à passer par le village. Les bals
seront absolument interdits, à moins que vous n’y dansiezqu’avec vos sœurs et vous ne sortirez des limites du parcque lorsque vous aurez prouvé que vous pouvezconsacrer dix minutes par jour à une occupationraisonnable.
Kitty, qui prenait toutes ces menaces à la lettre, fonditen larmes.
– Allons, allons ! ne pleurez pas, lui dit son père. Sivous êtes sage, d’ici une dizaine d’années je vous prometsde vous mener à une revue.
XLIXDeux jours après le retour de Mr. Bennet, Jane et
Elizabeth se promenaient ensemble dans le bosquetderrière la maison, lorsqu’elles virent venir la femme decharge. La croyant envoyée par leur mère pour lesappeler, les deux jeunes filles allèrent à sa rencontre, maisMrs. Hill dit en s’adressant à Jane :
– Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, maisje pensais qu’on avait reçu de bonnes nouvelles deLondres, et je me suis permis de venir m’en enquérirauprès de vous.
– Que voulez-vous dire, Hill ? nous n’avons rien reçude Londres.
– Comment, mademoiselle ! s’écria Mrs. Hillstupéfaite. Vous ne saviez donc pas qu’il est arrivé pourMonsieur un exprès envoyé par Mr. Gardiner ? Il est làdepuis une demi-heure et il a remis une lettre à monmaître.
Les jeunes filles couraient déjà vers la maison ; ellestraversèrent le hall et se précipitèrent dans la salle àmanger, et de là, dans la bibliothèque : leur père ne setrouvait nulle part. Elles allaient monter chez leur mèrequand elles rencontrèrent le valet de chambre.
– Si vous cherchez Monsieur, Mesdemoiselles, il estparti vers le petit bois.
Sur cette indication, elles s’élancèrent hors de lamaison et traversèrent la pelouse en courant pourrejoindre leur père qui d’un pas délibéré se dirigeait versun petit bois qui bordait la prairie.
Jane, moins légère et moins habituée à courirqu’Elizabeth, fut bientôt distancée, tandis que sa sœurtout essoufflée rattrapait son père et lui demandaitavidement :
– Oh ! papa, quelles nouvelles ? quelles nouvelles ?Vous avez bien reçu quelque chose de mon oncle ?
– Oui, un exprès vient de m’apporter une lettre de lui.
– Eh bien ! quelles nouvelles contient-elle ?… bonnesou mauvaises ?
– Que peut-on attendre de bon ? dit-il, tirant la lettrede sa poche. Mais peut-être préférez-vous lire vous-même ce qu’il m’écrit.
Elizabeth lui prit vivement la lettre des mains. À cemoment, Jane les rejoignit.
– Lisez-la tout haut, dit Mr. Bennet, car c’est à peine sije sais moi-même ce qu’elle contient.
« Gracechurch street, mardi 2 août.
« Mon cher frère,
« Enfin il m’est possible de vous envoyer des nouvelles
de ma nièce, et j’espère que, somme toute, elles vousdonneront quelque satisfaction. Samedi, peu après votredépart, j’ai été assez heureux pour découvrir dans quellepartie de Londres ils se cachaient ; – je passe sur lesdétails que je vous donnerai de vive voix ; il suffit quevous sachiez qu’ils sont retrouvés. – Je les ai vus tous lesdeux. »
– Alors, c’est bien comme je l’espérais, s’écria Jane, ilssont mariés !
« … Je les ai vus tous les deux. Ils ne sont pas mariés,et je n’ai pas découvert que le mariage entrât dans leursprojets, mais si vous êtes prêt à remplir les engagementsque je me suis risqué à prendre pour vous, je crois qu’il netardera pas à avoir lieu. Tout ce qu’on vous demande estd’assurer par contrat à votre fille sa part des cinq millelivres qui doivent revenir à vos enfants après vous, etpromettre en outre de lui servir annuellement une rentede cent livres, votre vie durant. Étant donné lescirconstances, j’ai cru pouvoir souscrire sans hésiter à cesconditions dans la mesure où je pouvais m’engager pourvous. Je vous envoie cette lettre par exprès afin que votreréponse m’arrive sans aucun retard. Vous comprenezfacilement par ces détails que la situation pécuniaire deWickham n’est pas aussi mauvaise qu’on le croitgénéralement. Le public a été trompé sur ce point, et jesuis heureux de dire que les dettes une fois réglées, ilrestera un petit capital qui sera porté au nom de manièce. Si, comme je le suppose, vous m’envoyez pleinspouvoirs pour agir en votre nom, je donnerai mes
instructions à Haggerston pour qu’il dresse le contrat. Jene vois pas la moindre utilité à ce que vous reveniez àLondres ; aussi demeurez donc tranquillement àLongbourn et reposez-vous sur moi. Envoyez votreréponse aussitôt que possible en ayant soin de m’écrire entermes très explicites. Nous avons jugé préférable quenotre nièce résidât chez nous jusqu’à son mariage et jepense que vous serez de cet avis. Elle nous arriveaujourd’hui. Je vous récrirai aussitôt que de nouvellesdécisions auront été prises.
« Bien à vous,
« Edward GARDINER. »
– Est-ce possible ! s’écria Elizabeth en terminant salecture. Va-t-il vraiment l’épouser ?
– Wickham n’est donc pas aussi indigne que nousl’avions pensé, dit sa sœur. Mon cher père, je m’en réjouispour vous.
– Avez-vous répondu à cette lettre ? demandaElizabeth.
– Non, mais il faut que je le fasse sans tarder.
– Oh ! père, revenez vite écrire cette lettre ; pensez àl’importance que peut avoir le moindre délai !
– Voulez-vous que j’écrive pour vous, si cela vousennuie de le faire ? proposa Jane.
– Cela m’ennuie énormément, mais il faut que cela soitfait.
Là-dessus il fit volte-face et revint vers la maison avecses filles.
– Puis-je vous poser une question ? dit Elizabeth. Cesconditions, il n’y a sans doute qu’à s’y soumettre ?
– S’y soumettre ! Je suis seulement honteux qu’ildemande si peu…
– Et il faut absolument qu’ils se marient ? Tout demême, épouser un homme pareil !
– Oui, oui ; il faut qu’ils se marient. C’est une nécessitéqui s’impose. Mais il y a deux choses que je désirevivement savoir : d’abord, quelle somme votre oncle a dûdébourser pour obtenir ce résultat ; ensuite, comment jepourrai jamais m’acquitter envers lui.
– Quelle somme ? Mon oncle ? Que voulez-vous dire ?s’écria Jane.
– Je veux dire que pas un homme de sens n’épouseraitLydia pour un appât aussi mince que cent livres par anpendant ma vie, et cinquante après ma mort.
– C’est très juste, dit Elizabeth ; cette idée ne m’étaitpas venue encore. Ses dettes payées, et en outre un petitcapital ! Sûrement, c’est mon oncle qui a tout fait. Quellebonté ! Quelle générosité ! J’ai peur qu’il n’ait fait là unlourd sacrifice. Ce n’est pas avec une petite somme qu’ilaurait pu obtenir ce résultat.
– Non, dit son père, Wickham est fou s’il prend Lydia àmoins de dix mille livres sterling. Je serais fâché d’avoir àle juger si mal dès le début de nos relations de famille.
– Dix mille livres, juste ciel ! Comment pourrait-onrembourser seulement la moitié d’une pareille somme ?
Mr, Bennet ne répondit point et tous trois gardèrent lesilence jusqu’à la maison. Mr. Bennet se rendit dans labibliothèque pour écrire, tandis que ses filles entraientdans la salle à manger.
– Ainsi, ils vont se marier ! s’écria Elizabeth dèsqu’elles furent seules. Et dire qu’il faut en remercier laProvidence… Qu’ils s’épousent avec des chances debonheur si minces et la réputation de Wickham simauvaise, voilà ce dont nous sommes forcées de nousréjouir ! Ô Lydia !…
– Je me console, dit Jane, en pensant qu’il n’épouseraitpas Lydia, s’il n’avait pour elle une réelle affection. Quenotre oncle ait fait quelque chose pour le libérer de sesdettes, c’est probable ; mais je ne puis croire qu’il aitavancé dix mille livres ou une somme qui en approche ! Ilest père de famille : comment pourrait-il disposer de dixmille livres ?
– Si nous arrivons jamais à connaître d’un côté lemontant des dettes, et de l’autre le chiffre du capitalajouté à la dot de Lydia, nous saurons exactement ce qu’afait pour eux Mr. Gardiner, car Wickham n’a pas sixpence lui appartenant en propre. Jamais nous nepourrons assez reconnaître la bonté de mon oncle et dema tante. Avoir pris Lydia chez eux, et lui accorder pourson plus grand bien leur protection et leur appui est unacte de dévouement que des années de reconnaissance ne
suffiront pas à acquitter. Pour le moment, la voilà prèsd’eux, et si un tel bienfait n’excite pas ses remords, elle nemérite pas d’être heureuse. Quel a dû être son embarrasdevant ma tante, à leur première rencontre !
– Efforçons-nous d’oublier ce qui s’est passé de part etd’autre, dit Jane. J’ai espoir et confiance qu’ils serontheureux. Pour moi, du moment qu’il l’épouse, c’est qu’ilveut enfin rentrer dans la bonne voie. Leur affectionmutuelle les soutiendra, et je me dis qu’ils mèneront unevie assez rangée et raisonnable pour que le souvenir deleur imprudence finisse par s’effacer.
– Leur conduite a été telle, répliqua Elizabeth, que nivous, ni moi, ni personne ne pourrons jamais l’oublier. Ilest inutile de se leurrer sur ce point.
Il vint alors à l’esprit des jeunes filles que leur mère,selon toute vraisemblance, ignorait encore les nouvellesreçues. Elles allèrent donc trouver leur père dans labibliothèque, et lui demandèrent si elles devaient mettreelles-mêmes Mrs. Bennet au courant. Il était en traind’écrire et, sans lever la tête, répondit froidement :
– Faites comme il vous plaira.
– Pouvons-nous emporter la lettre de mon oncle pourla lui lire ?
– Emportez tout ce que vous voulez, et laissez-moitranquille.
Elizabeth prit la lettre sur le bureau, et les deux sœursmontèrent chez Mrs. Bennet. Kitty et Mary se trouvaient
auprès d’elle, si bien que la même communication servitpour tout le monde. Après un court préambule pour lespréparer à de bonnes nouvelles, Jane lut la lettre touthaut. Mrs. Bennet avait peine à se contenir. Quand vint lepassage où Mr. Gardiner exprimait l’espoir que Lydiaserait bientôt mariée, sa joie éclata, et la suite ne fitqu’ajouter à son exaltation. Le bonheur la bouleversaitaussi violemment que l’inquiétude et le chagrin l’avaienttourmentée.
– Ma Lydia ! Ma chère petite Lydia ! s’exclama-t-elle.Quelle joie, elle va se marier ! Je la reverrai. Elle va semarier à seize ans. Oh ! mon bon frère ! Je savais bienqu’il arrangerait tout ! Comme il me tarde de la revoir, etde revoir aussi ce cher Wickham… Mais les toilettes ? lestoilettes de noce ? Je vais écrire tout de suite à ma sœurGardiner pour qu’elle s’en occupe. Lizzy, mon enfant,courez demander à votre père combien il lui donnera.Non, restez ! restez ! J’y vais moi-même. Sonnez Hill,Kitty ; je m’habille à l’instant. Lydia, ma chère Lydia !Comme nous serons contentes de nous retrouver !
Jane tenta de calmer ces transports en représentant àsa mère les obligations que leur créait le dévouement deMr. Gardiner.
– Car, dit-elle, nous devons pour une bonne partattribuer cet heureux dénouement à la générosité de mononcle. Nous sommes persuadés qu’il s’est engagé à aiderpécuniairement Mr. Wickham.
– Eh bien ! s’écria sa mère, c’est très juste. Qui pouvait
mieux le faire que l’oncle de Lydia ? S’il n’avait pas defamille, toute sa fortune devrait revenir à moi et à mesenfants. C’est bien la première fois que nous recevronsquelque chose de lui, à part de menus cadeaux de temps àautre. Vraiment, je suis trop heureuse : j’aurai bientôt unefille mariée. Mrs. Wickham… comme cela sonne bien ! Etelle n’a ses seize ans que depuis le mois de juin ! Ma chèreJane, je suis trop émue pour être capable d’écrire moi-même ; aussi je vais dicter et vous écrirez. Plus tard, nousdéciderons avec votre père la somme à envoyer, maisoccupons-nous d’abord de commander le nécessaire.
Elle commençait à entrer dans toutes sortes de détailsde calicot, de mousseline, de batiste, et elle aurait bientôtdicté d’abondantes commandes si Jane ne l’avait, nonsans peine, persuadée d’attendre que Mr. Bennet fût librepour le consulter. Un jour de retard, observa-t-elle, netirait pas à conséquence. L’heureuse mère céda, oubliantson habituelle obstination. D’autres projets, d’ailleurs, luivenaient en tête.
– Dès que je serai prête, déclara-t-elle, j’irai àMeryton pour annoncer la bonne nouvelle à ma sœurPhilips. En revenant, je pourrai m’arrêter chez lady Lucaset chez Mrs. Long. Kitty, descendez vite commander lavoiture. Cela me fera grand bien de prendre l’air. Enfants,puis-je faire quelque chose pour vous à Meryton ? Ah !voilà Hill. Ma brave Hill, avez-vous appris la bonnenouvelle ? Miss Lydia va se marier, et le jour de la nocevous aurez tous un bol de punch pour vous mettre le cœuren fête.
Mrs. Hill aussitôt d’exprimer sa joie. Elizabeth reçutses compliments comme les autres, puis, lasse de tantd’extravagances, elle chercha un refuge dans sa chambrepour s’abandonner librement à ses pensées. La situationde la pauvre Lydia, en mettant les choses au mieux, étaitencore suffisamment triste ; mais il fallait se féliciterqu’elle ne fût pas pire. Tel était le sentiment d’Elizabeth,et bien qu’elle ne pût compter pour sa sœur sur un avenirde bonheur et de prospérité, en pensant à leurs angoissespassées, elle apprécia les avantages du résultat obtenu.
LDurant les années écoulées, Mr. Bennet avait souvent
regretté qu’au lieu de dépenser tout son revenu il n’eûtpas mis de côté chaque année une petite somme pourassurer après lui la possession d’un capital à ses filles et àsa femme, si celle-ci lui survivait. Il le regrettaitaujourd’hui plus que jamais. S’il avait rempli ce devoir,Lydia, à cette heure, ne devrait pas à son oncle l’honneuret la dignité qu’on était en train d’acheter pour elle, etc’est lui-même qui aurait la satisfaction d’avoir décidé undes jeunes hommes les moins estimables de la Grande-Bretagne à devenir le mari de sa fille. Il étaitprofondément contrarié de penser qu’une affaire sidésavantageuse pour tout le monde se réglait aux seulsfrais de son beau-frère, et résolu à découvrir, s’il lepouvait, le montant des sommes qu’il avait débourséespour lui, il se proposait de les lui rendre aussitôt qu’il enaurait les moyens.
Quand Mr. Bennet s’était marié, il n’avait pasconsidéré l’utilité des économies. Naturellement, ilescomptait la naissance d’un fils, par quoi serait annulée laclause de l’« entail », et assuré le sort de Mrs. Bennet etde ses autres enfants. Cinq filles firent l’une après l’autreleur entrée en ce monde, mais le fils ne vint pas. Mrs.
Bennet l’avait espéré encore bien des années après lanaissance de Lydia. Ce rêve avait dû être enfinabandonné, mais il était trop tard pour songer auxéconomies. Mrs. Bennet n’avait aucun goût pourl’épargne, et seule l’aversion de Mr. Bennet pour toutedépendance les avait empêchés de dépasser leur revenu.
D’après le contrat de mariage, cinq mille livresdevaient revenir à Mrs. Bennet et à ses filles ; mais lafaçon dont cette somme serait partagée entre les enfantsétait laissée à la volonté des parents. C’était là un pointque, pour Lydia tout au moins, il fallait décider dès àprésent, et Mr. Bennet ne pouvait avoir aucune hésitationà accepter la proposition qui lui était faite. En des termesqui, bien que concis, exprimaient sa profondereconnaissance, il écrivit à son beau-frère qu’il approuvaitpleinement tout ce qu’il avait fait, et ratifiait tous lesengagements qu’il avait pris en son nom.
C’était pour Mr. Bennet une heureuse surprise de voirque tout s’arrangeait sans plus d’effort de sa part. Sonplus grand désir actuellement était d’avoir à s’occuper lemoins possible de cette affaire. Maintenant que lespremiers transports de colère qui avaient animé sesrecherches étaient passés, il retournait naturellement àson indolence coutumière.
Sa lettre fut bientôt écrite, car s’il était lent à prendreune décision, il la mettait rapidement à exécution. Il priaitson beau-frère de lui donner le compte détaillé de tout cequ’il leur devait. Mais il était encore trop irrité pour lecharger de transmettre à Lydia le moindre message.
Les bonnes nouvelles, bientôt connues dans toute lamaison, se répandirent rapidement aux alentours. Ellesfurent accueillies par les voisins avec une décentephilosophie. Évidemment les conversations auraient putrouver un plus riche aliment si miss Lydia Bennet étaitrevenue brusquement au logis paternel, où mieux encore,si elle avait été mise en pénitence dans une fermeéloignée. Mais son mariage fournissait encore une amplematière à la médisance, et les vœux exprimés par lesvieilles dames acrimonieuses de Meryton ne perdirentpas beaucoup de leur fiel par suite du changement decirconstances car, avec un pareil mari, le malheur deLydia pouvait être considéré comme certain.
Il y avait quinze jours que Mrs. Bennet gardait lachambre. Mais en cet heureux jour, elle reprit sa place àla table de famille dans des dispositions singulièrementjoyeuses. Aucun sentiment de honte ne venait diminuerson triomphe : le mariage d’une de ses filles, – son vœu leplus cher depuis que Jane avait seize ans, – allaits’accomplir ! Elle ne parlait que de tout ce qui figure dansdes noces somptueuses : fines mousselines, équipages etserviteurs. Elle passait en revue toutes les maisons duvoisinage pouvant convenir à sa fille et, sans qu’elle sût niconsidérât quel pourrait être le budget du jeune ménage,rien ne pouvait la satisfaire.
– Haye Park ferait l’affaire si les Gouldinez s’enallaient, ou la grande maison à Stoke, si le salon était unpeu plus vaste. Mais Ashworth est trop loin ; je nepourrais supporter l’idée d’avoir Lydia à dix milles de
chez nous. Quant à Purvis Lodge, le toit de la maison esttrop laid.
Son mari la laissa parler sans l’interrompre tant queles domestiques restèrent pour le service ; mais quand ilsse furent retirés, il lui dit :
– Mrs. Bennet, avant de retenir pour votre fille etvotre gendre une ou plusieurs de ces maisons, tâchonsd’abord de nous entendre. Il y a une maison, en tout cas,où ils ne mettront jamais les pieds. Je ne veux pas avoirl’air d’approuver leur coupable folie en les recevant àLongbourn.
Cette déclaration provoqua une longue querelle, maisMr. Bennet tint bon, et ne tarda pas à en faire une autrequi frappa Mrs. Bennet de stupéfaction et d’horreur : il ditqu’il n’avancerait pas une guinée pour le trousseau de safille et affirma que Lydia ne recevrait pas de lui lamoindre marque d’affection en cette circonstance. Mrs.Bennet n’en revenait pas ; elle ne pouvait concevoir que lacolère de son mari contre sa fille pût être poussée au pointde refuser à celle-ci un privilège sans lequel, lui semblait-il, le mariage serait à peine valide. Elle était plus sensiblepour Lydia au déshonneur qu’il y aurait à se marier sanstoilette neuve qu’à la honte de s’être enfuie et d’avoirvécu quinze jours avec Wickham avant d’être sa femme.
Elizabeth regrettait maintenant d’avoir confié à Mr.Darcy, dans un moment de détresse, les craintes qu’elleéprouvait pour sa sœur. Puisqu’un prompt mariage allaitmettre fin à son aventure, on pouvait espérer en cacher
les malheureux préliminaires à ceux qui n’habitaient pasles environs immédiats. Elle savait que rien ne seraitébruité par lui, – il y avait peu d’hommes dont ladiscrétion lui inspirât autant de confiance, – mais, enmême temps, il y en avait bien peu à qui elle aurait tenudavantage à cacher la fragilité de sa sœur ; non cependantà cause du préjudice qui en pourrait résulter pour elle-même, car entre elle et Darcy, il y avait désormais,semblait-il, un abîme infranchissable. Le mariage deLydia eût-il été conclu le plus honorablement du monde, iln’était guère vraisemblable que Mr. Darcy voulût entrerdans une famille contre laquelle, à tant d’autresobjections, venait s’ajouter celle d’une parenté étroiteavec l’homme qu’il méprisait si justement.
Elizabeth ne pouvait s’étonner qu’il reculât devant unetelle alliance. Il était invraisemblable que le sentimentqu’il lui avait laissé voir en Derbyshire dût survivre à unetelle épreuve. Elle était humiliée, attristée, et ressentaitun vague repentir sans savoir au juste de quoi. Elledésirait jalousement l’estime de Mr. Darcy, maintenantqu’elle n’avait plus rien à en espérer ; elle souhaitaitentendre parler de lui, quand il semblait qu’elle n’eûtaucune chance de recevoir de ses nouvelles, et elle avait laconviction qu’avec lui elle aurait été heureuse alors que,selon toute probabilité, jamais plus ils ne serencontreraient.
« Quel triomphe pour lui, pensait-elle souvent, s’ilsavait que les offres qu’elle avait si fièrement dédaignéesquatre mois auparavant, seraient maintenant accueillies
avec joie et reconnaissance ! Oui, bien qu’à son jugement ildépassât en générosité tous ceux de son sexe, il étaithumain qu’il triomphât. »
Elle se rendait compte à présent que Darcy, par lanature de ses qualités, était exactement l’homme qui luiconvenait. Son intelligence, son caractère quoique sidifférent du sien aurait correspondu à ses vœux. Leurunion eût été à l’avantage de l’un et de l’autre. La vivacitéet le naturel d’Elisabeth auraient adouci l’humeur deDarcy et donné plus de charmes à ses manières ; et lui-même, par son jugement, par la culture de son esprit, parsa connaissance du monde, aurait pu exercer sur elle uneinfluence plus heureuse encore. Mais on ne devait pas voirune telle union offrir au public l’image fidèle de la félicitéconjugale. Une autre d’un caractère tout différent allait seformer dans sa famille qui excluait pour la première toutechance de se réaliser.
Elizabeth se demandait comment pourrait êtreassurée à Wickham et à Lydia une indépendancesuffisante. Mais il lui était aisé de se représenter lebonheur instable dont pourraient jouir deux êtresqu’avait seule rapprochés la violence de leurs passions.
Une nouvelle lettre de Mr. Gardiner arriva bientôt.Aux remerciements de Mr. Bennet il répondaitbrièvement par l’assurance de l’intérêt qu’il portait à tousles membres de sa famille, et demandait pour conclure dene pas revenir sur ce sujet. Le but principal de sa lettreétait d’annoncer que Mr. Wickham était déterminé àquitter la milice.
« … Depuis que le mariage a été décidé, c’était mon vifdésir de lui voir prendre ce parti. Vous penserez sansdoute comme moi que ce changement de milieu est aussiopportun pour ma nièce, que pour lui. Mr. Wickham àl’intention d’entrer dans l’armée régulière, et il ad’anciens amis qui sont prêts à appuyer sa demande. Onlui a promis un brevet d’enseigne dans un régiment duNord. La distance entre ce poste et notre région n’est pasun désavantage. Il paraît bien disposé, et je veux croireque, dans un autre milieu, le souci de sauvegarder leurréputation les rendra tous deux plus circonspects. J’aiécrit au colonel Forster pour l’informer de nos présentsarrangements, et le prier de satisfaire les créanciers deWickham à Brighton et aux environs, par la promessed’un règlement rapide pour lequel je me suis engagé.Voulez-vous prendre la peine de donner la mêmeassurance à ses créanciers de Meryton dont voustrouverez ci-jointe la liste remise par lui-même. Il nous adéclaré toutes ses dettes ; – j’aime à croire du moins qu’ilne nous a pas trompés. – Haggerston à nos ordres, et toutsera prêt d’ici une huitaine de jours. Wickham et safemme partiront alors pour rejoindre le régiment, à moinsqu’ils ne soient d’abord invités à Longbourn, et ma femmeme dit que Lydia désire ardemment vous revoir tousavant son départ pour le Nord. Elle va bien et me chargede ses respects pour vous et pour sa mère.
« Vôtre,
« E. GARDINER. »
Mr. Bennet et ses filles voyaient aussi clairement que
Mr. Gardiner combien il était heureux que Wickhamquittât le régiment de la milice. Mais Mrs. Bennet étaitbeaucoup moins satisfaite. Voir Lydia s’établir dans leNord de l’Angleterre juste au moment où elle était sijoyeuse et si fière à la pensée de l’avoir près d’elle, quellecruelle déception ! Et puis, quel dommage pour Lydia des’éloigner d’un régiment où elle connaissait tout lemonde !
– Elle aimait tant Mrs. Forster, soupirait-elle, qu’il luisera très dur d’en être séparée. Il y avait aussi plusieursjeunes gens qui lui plaisaient beaucoup. Dans ce régimentdu Nord, les officiers seront peut-être moins aimables !
La demande que faisait Lydia d’être admise à revoir safamille avant son départ fut d’abord accueillie de la partde son père par un refus péremptoire, mais Jane etElizabeth désiraient vivement pour le bien, ainsi que pourla réputation de leur sœur, qu’elle fût traitée moinsdurement, et elles pressèrent leur père avec tantd’insistance, de douceur et de raison de recevoir lesjeunes époux à Longbourn qu’il finit par se laisserpersuader. Leur mère eut donc la satisfactiond’apprendre qu’elle pourrait exhiber la jeune mariée àtout le voisinage avant son lointain exil. En répondant àson beau-frère, Mr. Bennet envoya la permissiondemandée et il fut décidé qu’au sortir de l’église, le jeunecouple prendrait la route de Longbourn. Elizabeth futsurprise cependant que Wickham consentît à cetarrangement. En ce qui la concernait, à ne consulter queson inclination, une rencontre avec lui était bien la
LILe jour du mariage de Lydia, Jane et Elizabeth se
sentirent certainement plus émues que la mariée elle-même. La voiture fut envoyée à *** à la rencontre dujeune couple qui devait arriver pour l’heure du dîner. Lessœurs aînées appréhendaient le moment du revoir, Janeen particulier qui prêtait à la coupable les sentimentsqu’elle aurait éprouvés à sa place et souffrait elle-mêmede ce qu’elle devait endurer.
Ils arrivèrent. Toute la famille était réunie dans lepetit salon pour les accueillir. Le visage de Mrs. Bennetn’était que sourires. Celui de son mari restait grave etimpénétrable. Les jeunes filles se sentaient inquiètes,anxieuses et mal à l’aise.
La voix de Lydia se fit entendre dans l’antichambre, laporte s’ouvrit brusquement et elle se précipita dans lesalon. Sa mère s’avança pour la recevoir dans ses bras etl’embrassa avec transports, puis tendit la main avec unaffectueux sourire à Wickham qui suivait sa femme, etleur exprima ses vœux avec un empressement quimontrait bien qu’elle ne doutait nullement de leurbonheur.
L’accueil qu’ils reçurent ensuite de Mr. Bennet ne fut
pas tout à fait aussi cordial. Sa raideur s’accentua et c’està peine s’il ouvrit la bouche. La désinvolture du jeunecouple lui déplaisait extrêmement ; elle indignaitElizabeth et choquait Jane elle-même. Lydia étaittoujours Lydia ; aussi intrépide, aussi exubérante, aussibruyante, aussi indomptable que jamais. Elle allait d’unesœur à l’autre en réclamant leurs félicitations et quand, àla fin, tout le monde fut assis, elle se mit à regarder lesalon, et prenant note de quelques changements qu’on yavait apportés, observa en riant qu’il y avait bienlongtemps qu’elle ne s’était pas trouvée dans cette pièce.
Wickham ne montrait pas plus d’embarras, mais ilavait des manières si charmantes que si sa réputation etson mariage n’avaient donné lieu à aucun blâme, l’aisancesouriante avec laquelle il se réclamait de leur nouvelleparenté aurait ravi tout le monde.
Elizabeth ne revenait pas d’une telle assurance et sedisait qu’il était vain d’imaginer une limite à l’audace d’unhomme impudent. Elle et Jane se sentaient rougir, maissur le visage de ceux qui étaient cause de leur confusion,elles ne voyaient aucun changement de couleur.
La conversation ne languissait pas. La mariée et samère ne pouvaient chacune parler avec assez de volubilitéet Wickham, qui se trouvait assis à côté d’Elizabeth, semit à lui demander des nouvelles de toutes les personnesqu’il connaissait dans le voisinage avec un air naturel etsouriant qu’elle fut incapable de prendre elle-même pourlui répondre. Sa femme et lui ne paraissaient avoir que dejoyeux souvenirs, et Lydia abordait volontairement des
sujets auxquels ses sœurs n’auraient voulu pour rien aumonde faire allusion.
– Songez qu’il y a déjà trois mois que je suis partie !s’écria-t-elle. Il me semble qu’il y a seulement quinzejours, et pourtant les événements n’ont pas manquépendant ces quelques semaines. Dieu du ciel ! me doutais-je, quand je suis partie, que je reviendrais mariée ! bienque je me sois dit quelquefois que ce serait jolimentamusant si cela arrivait…
Ici, son père fronça les sourcils ; Jane paraissait ausupplice, tandis qu’Elizabeth fixait sur Lydia des regardssignificatifs. Mais celle-ci, qui ne voyait ni n’entendait quece qu’elle voulait voir ou entendre, continua gaiement :
– Oh ! maman, sait-on seulement par ici que je me suismariée aujourd’hui ? J’avais peur que non ; aussi quandnous avons dépassé sur la route le cabriolet de WilliamGoulding, j’ai baissé la glace, ôté mon gant et posé la mainsur le rebord de la portière afin qu’il pût voir mon alliance,et j’ai fait des saluts et des sourires à n’en plus finir.
Elizabeth n’en put supporter davantage. Elle s’enfuitdu salon et ne revint que lorsqu’elle entendit tout lemonde traverser le hall pour gagner la salle à manger. Elley arriva à temps pour voir Lydia se placer avecempressement à la droite de sa mère en disant à sa sœuraînée :
– Maintenant, Jane, vous devez me céder votre place,puisque je suis une femme mariée.
Il n’y avait pas lieu de croire que le temps donnerait à
Lydia la réserve dont elle se montrait si dépourvue dès lecommencement. Son assurance et son impétuosité nefaisaient qu’augmenter. Il lui tardait de voir Mrs. Philips,les Lucas, tous les voisins, et de s’entendre appeler « Mrs.Wickham ». En attendant, elle s’en fut après le repasexhiber son alliance et faire parade de sa nouvelle dignitédevant Mrs. Hill et les deux servantes.
– Eh bien, maman, dit-elle quand tous furent revenusdans le petit salon, que dites-vous de mon mari ? N’est-cepas un homme charmant ? Je suis sûre que mes sœursm’envient, et je leur souhaite d’avoir seulement moitiéautant de chance que moi. Il faudra qu’elles aillent toutesà Brighton ; c’est le meilleur endroit pour trouver desmaris. Quel dommage que nous n’y soyons pas alléestoutes les cinq !
– C’est bien vrai ; et si cela n’avait dépendu que demoi… Mais, ma chère Lydia, cela me déplaît beaucoup devous voir partir si loin ! Est-ce absolument nécessaire ?
– Je crois que oui. Mais j’en suis très contente. Vous etpapa viendrez nous voir ainsi que mes sœurs. Nous seronsà Newscastle tout l’hiver. Il y aura sûrement des bals et jem’engage à fournir mes sœurs de danseurs agréables.Quand vous partirez, vous pourrez nous en laisser une oudeux et je me fais forte de leur trouver des maris avant lafin de l’hiver.
– Je vous remercie pour ma part, dit Elizabeth ; maisje n’apprécie pas spécialement votre façon de trouver desmaris.
Le jeune couple ne devait pas rester plus de dix jours ;Mr. Wickham avait reçu son brevet avant son départ deLondres, et devait avoir rejoint son régiment avant la finde la quinzaine. Personne, à part Mrs. Bennet, neregrettait la brièveté de leur séjour. Elle employa tout cetemps à faire des visites avec sa fille, et à organiser chezelle de nombreuses réceptions qui firent plaisir à tout lemonde, certains membres de la famille ne demandantqu’à éviter l’intimité.
Elizabeth eut vite observé que les sentiments deWickham pour Lydia n’avaient pas la chaleur de ceux queLydia éprouvait pour lui ; et elle n’eut pas de peine à sepersuader que c’était la passion de Lydia et non celle deWickham qui avait provoqué l’enlèvement. Elle aurait puse demander pourquoi, n’étant pas plus vivement épris, ilavait accepté de fuir avec Lydia, si elle n’avait tenu pourcertain que cette fuite était commandée par ses embarraspécuniaires, et, dans ce cas, Wickham n’était pas homme àse refuser l’agrément de partir accompagné.
Lydia était follement éprise. Elle n’ouvrait la boucheque pour parler de son cher Wickham : c’était laperfection en tout, et personne ne pouvait lui êtrecomparé.
Un matin qu’elle se trouvait avec ses deux aînées, elledit à Elizabeth :
– Lizzy, je ne vous ai jamais raconté mon mariage, jecrois ; vous n’étiez pas là quand j’en ai parlé à maman etaux autres. N’êtes-vous pas curieuse de savoir comment
les choses se sont passées ?
– Non, en vérité, répliqua Elizabeth ; je suis d’avis quemoins on en parlera, mieux cela vaudra.
– Mon Dieu ! que vous êtes étrange ! Tout de même, ilfaut que je vous mette au courant. Vous savez que nousnous sommes mariés à Saint-Clément parce que Wickhamhabitait sur cette paroisse. Il avait été convenu que nousy serions tous à onze heures ; mon oncle, ma tante et moidevions nous y rendre ensemble, et les autres nousrejoindre à l’église. Le lundi matin, j’étais dans un état !J’avais si peur qu’une difficulté quelconque ne vînt toutremettre ! Je crois que j’en serais devenue folle… Pendantque je m’habillais, ma tante ne cessait de parler et dediscourir, comme si elle débitait un sermon ; mais jen’entendais pas un mot sur dix, car vous supposez bienque je ne pensais qu’à mon cher Wickham. J’avaistellement envie de savoir s’il se marierait avec son habitbleu !
« Nous avons déjeuné à dix heures, comme d’habitude.Il me semblait que l’aiguille de la pendule n’avançait pas ;car il faut vous dire que l’oncle et la tante ont été aussidésagréables que possible, tout le temps que je suis restéeavec eux. Vous me croirez si vous voulez, mais on ne m’apas laissée sortir une seule fois pendant toute cettequinzaine ! Pas une petite réunion, rien, rien !Assurément Londres était à ce moment assez vide ; maisenfin, le Petit Théâtre était encore ouvert !… Pour enrevenir à mon mariage, la voiture arrivait devant la portelorsque mon oncle fut demandé par cet affreux homme,
Mr. Stone, – et vous savez qu’une fois ensemble, ils n’enfinissent plus. – J’avais une peur terrible de les voiroublier l’heure, ce qui aurait fait remettre mon mariageau lendemain ; et nous ne pouvions nous passer de mononcle qui devait me conduire à l’autel. Heureusement, ilest revenu au bout de dix minutes et l’on s’est mis enroute. Depuis, j’ai réfléchi que si mon oncle avait étéretenu, le mariage aurait pu quand même avoir lieu, carMr. Darcy aurait pu très bien le remplacer.
– Mr. Darcy !… répéta Elizabeth abasourdie.
– Mais oui ! Vous savez qu’il devait venir avecWickham… Oh ! mon Dieu ! J’ai oublié que je ne devaispas souffler mot de cela ! Je l’avais si bien promis ! Que vadire Wickham ? C’était un tel secret…
– S’il en est ainsi, dit Jane, ne nous dites pas un mot deplus et soyez assurée que je ne chercherai pas à en savoirdavantage.
– Certainement, appuya Elizabeth qui pourtant étaitdévorée de curiosité, nous ne vous poserons pas dequestions.
– Merci, dit Lydia ; car si vous m’en posiez, je vousdirais tout, et Wickham serait très fâché.
Devant cet encouragement, Elizabeth, pour pouvoirtenir sa promesse, fut obligée de se sauver dans sachambre.
Mais demeurer dans l’ignorance de ce qui s’était passéétait chose impossible, ou du moins il était impossible de
ne pas chercher à se renseigner. Ainsi, Mr. Darcy avaitassisté au mariage de sa sœur !
Les suppositions les plus extravagantes traversèrentl’esprit d’Elizabeth sans qu’aucune pût la satisfaire. Cellesqui lui plaisaient davantage parce qu’elles donnaient unegrande noblesse à la conduite de Mr. Darcy, lui semblaientles plus invraisemblables. Incapable de supporter pluslongtemps cette incertitude, elle saisit une feuille depapier et écrivit à sa tante une courte lettre où elle lapriait de lui expliquer les paroles échappées à Lydia.
« Vous comprendrez facilement combien je suiscurieuse de savoir comment un homme qui ne nous estnullement apparenté, qui n’est même pas un ami de notrefamille, pouvait se trouver parmi vous dans une tellecirconstance. Je vous en prie, écrivez-moi tout de suitepour me donner cette explication, à moins que vous ayezde très sérieuses raisons pour garder le secret, commeLydia semblait le croire nécessaire. Dans ce cas, jetâcherai de m’accommoder de mon ignorance… »
« Pour cela, certainement non, » se dit Elizabeth à elle-même ; et elle termina sa lettre ainsi : « … Mais je doisvous prévenir, ma chère tante, que si vous ne merenseignez pas d’une manière honorable, j’en serai réduiteà employer des ruses et des stratagèmes pour découvrirla vérité… »
Jane avait une délicatesse trop scrupuleuse pourreparler avec Elizabeth de ce que Lydia avait laissééchapper. Elizabeth n’en était pas fâchée. Jusqu’au
LIIElizabeth eut la satisfaction de recevoir une réponse
dans les plus courts délais. Dès qu’elle l’eut en mains, ellese hâta de gagner le petit bois où elle courait le moins derisques d’être dérangée, et s’asseyant sur un banc, seprépara à contenter sa curiosité. Le volume de la lettrel’assurait en effet par avance que sa tante ne répondaitpas à sa demande par un refus.
« Gracechurch Street, 6 septembre.
« Ma chère nièce,
« Je viens de recevoir votre lettre, et vais consacrertoute ma matinée à y répondre, car je prévois quequelques lignes ne suffiraient pas pour tout ce que j’ai àvous dire. Je dois vous avouer que votre question mesurprend. N’allez pas me croire fâchée ; je veuxseulement dire que je n’aurais pas cru que vous eussiezbesoin, « vous », de faire cette enquête. Si vous préférezne pas me comprendre, excusez mon indiscrétion. Votreoncle est aussi surpris que moi-même, et la seuleconviction qu’en cette affaire, vous étiez une des partiesintéressées, l’a décidé à agir comme il l’a fait. Mais siréellement votre innocence et votre ignorance sontcomplètes, je dois me montrer plus explicite.
« Le jour même où je rentrais de Longbourn, votreoncle recevait une visite des plus inattendues ; celle deMr. Darcy qui vint le voir et resta enfermé plusieursheures avec lui. Il venait lui annoncer qu’il avaitdécouvert où se trouvaient votre sœur et Wickham, qu’illes avait vus et s’était entretenu avec eux, – plusieurs foisavec Wickham, et une fois avec Lydia. – D’après ce quej’ai compris, il avait quitté le Derbyshire le lendemainmême de notre départ et était venu à Londres avec larésolution de se mettre à leur recherche. Le motif qu’il ena donné c’est qu’il était convaincu que c’était sa faute sil’indignité de Wickham n’avait pas été suffisammentpubliée pour empêcher toute jeune fille de bonne famillede lui donner son amour et sa confiance. Il accusaitgénéreusement son orgueil, confessant qu’il lui avaitsemblé au-dessus de lui de mettre le monde au courantde ses affaires privées ; sa réputation devait répondrepour lui. Il estimait donc de son devoir d’essayer deréparer le mal qu’il avait involontairement causé. J’ajouteque s’il avait un autre motif, je suis persuadée qu’il esttout à son honneur.
« Quelques jours s’étaient passés avant qu’il pûtdécouvrir les fugitifs, mais il possédait sur nous un grandavantage, celui d’avoir un indice pour le guider dans sesrecherches et le sentiment de cet avantage avait été uneraison de plus pour le déterminer à nous suivre. Ilconnaissait à Londres une dame, une certaine Mrs.Younge, qui avait été quelque temps gouvernante de missDarcy et qui avait été remerciée pour un motif qu’il nenous a pas donné. À la suite de ce renvoi, elle avait pris
une grande maison dans Edward Street et gagnait sa vieen recevant des pensionnaires. Mr. Darcy savait que cetteMrs. Younge connaissait intimement Wickham, et, enarrivant à Londres, il était allé la voir pour lui demanderdes renseignements sur lui, mais il s’était passé deux outrois jours avant qu’il pût obtenir d’elle ce qu’il désirait.Cette femme voulait évidemment se faire payer la petitetrahison qu’on lui demandait, car elle savait où était sonami : Wickham, en effet, était allé la trouver dès sonarrivée à Londres, et, si elle avait eu de la place, elle lesaurait reçus tous deux dans sa maison. À la fin cependant,notre ami si dévoué obtint le renseignement désiré et serendit à l’adresse qu’elle lui avait indiquée. Il vit d’abordWickham, et ensuite insista pour voir Lydia. Sa premièreidée était de la persuader de quitter au plus tôt cettesituation déshonorante et de retourner dans sa famille dèsqu’elle consentirait à la recevoir, lui offrant toute l’aide quipourrait lui être utile. Mais il trouva Lydiairrévocablement décidée à rester où elle était : la penséede sa famille ne la touchait aucunement ; elle ne sesouciait pas de l’aide qui lui était offerte et ne voulait pasentendre parler de quitter Wickham. Elle était sûre qu’ilsse marieraient un jour ou l’autre, et peu importait quand.Ce que voyant, Mr. Darcy pensa qu’il n’y avait plus qu’àdécider et hâter un mariage que Wickham, il l’avait fortbien vu dès sa première conversation avec lui, n’avaitjamais mis dans ses projets. Wickham reconnut qu’il avaitété forcé de quitter le régiment à cause de pressantesdettes d’honneur et ne fit aucun scrupule de rejeter sur laseule folie de Lydia toutes les déplorables conséquences
de sa fuite. Il pensait démissionner immédiatement etn’avait pour l’avenir aucun plan défini. Il devait prendreun parti, il ne savait lequel ; la seule chose certaine, c’estqu’il n’avait aucune ressource. Mr. Darcy lui demandapourquoi il n’épousait pas tout de suite votre sœur ; bienque Mr. Bennet ne dût pas être très riche, il serait capablede faire quelque chose pour lui, et sa situations’améliorerait du fait de ce mariage. En réponse à cettequestion, Wickham laissa entendre qu’il n’avait nullementrenoncé à refaire sa fortune dans des conditions plussatisfaisantes, par un mariage riche dans une autrerégion. Toutefois, étant donnée la situation présente, il yavait des chances qu’il se laissât tenter par l’appât d’unsecours immédiat.
« Plusieurs rencontres eurent lieu, car il y avaitbeaucoup de points à traiter. Les prétentions de Wickhamétaient naturellement exagérées, mais en fin de compte, ilfut obligé de se montrer plus raisonnable.
« Toutes choses étant arrangées entre eux, le premiersoin de Mr. Darcy fut de mettre votre oncle au courant. Ilvint pour le voir à Gracechurch street, la veille de monretour, mais on lui répondit que Mr. Gardiner n’était pasvisible, qu’il était occupé avec votre père, et que celui-ciquittait Londres le lendemain matin. Mr. Darcy, jugeantpréférable de se concerter avec votre oncle plutôt qu’avecvotre père, remit sa visite au lendemain et partit sansavoir donné son nom. Le samedi soir, il revint, et c’estalors qu’il eut avec, votre oncle le long entretien dont jevous ai parlé. Ils se rencontrèrent encore le dimanche, et,
cette fois, je le vis aussi. Mais ce ne fut pas avant le lundique tout se trouva réglé, et aussitôt le message vous futenvoyé à Longbourn. Seulement notre visiteur s’estmontré terriblement têtu. Je crois, Lizzy, quel’obstination est son grand défaut ; on lui en a reprochébien d’autres à différentes reprises, mais celui-là doit êtrele principal. Tout ce qui a été fait, il a voulu le faire lui-même, et Dieu sait (je ne le dis pas pour provoquer vosremerciements) que votre oncle s’en serait chargé degrand cœur. Tous deux ont discuté à ce sujetinterminablement, – ce qui était plus que ne méritait lejeune couple en question. Enfin, votre oncle a dû céder, etau lieu d’aider effectivement sa nièce, il lui a fallu secontenter d’en avoir seulement l’apparence, ce qui n’étaitpas du tout de son goût. Aussi votre lettre de ce matin, enlui permettant de dépouiller son plumage d’emprunt et deretourner les louanges à qui les mérite, lui a-t-elle causégrand plaisir.
« Mais, Lizzy, il faut, il faut absolument que tout cecireste entre vous et moi, et Jane à la grande rigueur. Voussavez sans doute ce qui a été fait pour le jeune ménage.Les dettes de Wickham qui se montent, je crois, àbeaucoup plus de mille livres sterling, doivent être payéesainsi que son brevet d’officier, et mille livres ajoutées à ladot de Lydia et placées en son nom. La raison pourlaquelle Mr. Darcy a voulu faire seul tout ce qui étaitnécessaire est celle que je vous ai dite plus haut. C’est àlui, à sa réserve et à son manque de discernement,affirme-t-il, qu’on doit d’avoir été trompé sur la véritablepersonnalité de Wickham, et que celui-ci a pu être partout
accueilli et fêté. Peut-être y a-t-il là quelque chose devrai. Pourtant je me demande si ce n’est pas la réserved’une autre personne plutôt que la sienne qui doit surtoutêtre mise en cause. Mais, en dépit de tous ces beauxdiscours, vous pouvez être assurée, ma chère Lizzy, quevotre oncle n’aurait jamais cédé, si nous n’avions pas cruque Mr. Darcy avait un autre intérêt dans l’affaire. Quandtout fut entendu, il repartit pour Pemberley, mais aprèsavoir promis de revenir à Londres pour assister aumariage et pour achever de régler les questionspécuniaires.
« Vous savez tout maintenant, et si j’en crois votrelettre, ce récit va vous surprendre extrêmement ;j’espère tout au moins que vous n’en éprouverez aucundéplaisir. Lydia vint aussitôt s’installer ici et Wickham yfut reçu journellement. Il s’est montré tel que je l’avaisconnu en Hertfordshire ; quant à Lydia, je ne vous diraipas combien j’ai été peu satisfaite de son attitude pendantson séjour auprès de nous, si la dernière lettre de Jane nem’avait appris que sa conduite est aussi déraisonnablechez son père que chez moi. Je lui ai parlé trèssérieusement à plusieurs reprises, lui montrant la gravitéde sa faute et le chagrin qu’elle avait causé à sa famille. Sielle m’a entendue, c’est une chance, car je suis certainequ’elle ne m’a jamais écoutée. J’ai failli bien souventperdre patience et c’est seulement par affection pour vouset pour Jane que je me suis contenue.
« Mr. Darcy a tenu sa promesse, et comme vous l’a ditLydia, il assistait au mariage. Il a dîné chez nous le jour
suivant, et devait quitter Londres mercredi ou jeudi. M’envoudrez-vous beaucoup, ma chère Lizzy, si je saisis cetteoccasion de vous dire (ce que je n’ai jamais osé jusqu’ici),quelle sympathie il m’inspire ? Sa conduite à notre égarda été aussi aimable qu’en Derbyshire. Son intelligence, sesgoûts, ses idées, tout en lui me plaît. Pour être parfait, ilne lui manque qu’un peu de gaieté ; mais sa femme, s’ilfait un choix judicieux, pourra lui en donner. Je l’ai trouvéun peu mystérieux : c’est à peine s’il vous a nommée ; lemystère paraît être à la mode… Pardonnez-moi, machérie, si j’ai trop d’audace ; ou tout au moins, ne mepunissez pas au point de me fermer la porte de P… : je neserai tout à fait heureuse que quand j’aurai fait le tour duparc ! Un petit phaéton avec une jolie paire de poneys,voilà ce qu’il faudrait. Mais je m’arrête : depuis une demi-heure, les enfants me réclament.
« À vous de tout cœur,
« M. GARDINER. »
La lecture de cette lettre jeta Elizabeth dans uneagitation où l’on n’aurait su dire si c’était la joie ou la peinequi dominait. Ainsi donc, tous les soupçons vagues etindéterminés qui lui étaient venus au sujet du rôle de Mr.Darcy dans le mariage de sa sœur, et auxquels elle n’avaitpas voulu s’arrêter parce qu’ils supposaient chez lui unebonté trop extraordinaire pour être vraisemblable, etfaisaient d’elle et des siens ses obligés, tous ces soupçonsse trouvaient justifiés et au delà ! Il avait couru à Londres.Il avait accepté tous les ennuis et toutes les mortificationsd’une recherche où il lui avait fallu solliciter les services
d’une femme qu’il devait mépriser et abominer entretoutes, et rencontrer à plusieurs reprises, raisonner,persuader et finalement acheter un homme qu’il auraitvoulu éviter à jamais, et dont il ne prononçait le nomqu’avec répugnance. Et il avait fait tout cela en faveurd’une jeune fille pour qui il ne pouvait avoir ni sympathie,ni estime. Le cœur d’Elizabeth lui murmurait que c’étaitpour elle-même qu’il avait tout fait, mais convenait-il des’abandonner à une si douce pensée ? La vanité mêmen’arrivait point à lui faire croire que l’affection de Darcypour elle, pour celle qui l’avait jadis repoussé, pouvaitavoir raison de l’horreur qu’une alliance avec Wickhamdevait lui inspirer. Beau-frère de Wickham ! Quel orgueil,à l’idée d’un tel lien, ne se serait révolté ? Avait-il doncdonné le vrai motif de sa conduite ? Après tout, il n’étaitpas invraisemblable qu’il se reconnût un tort et qu’ilvoulût réparer les effets de sa hautaine réserve. Il étaitgénéreux, il avait les moyens de l’être ; et puis, sanscroire qu’il eût pensé surtout à elle, Elizabeth pouvaitsupposer que l’affection qu’il lui gardait encore avait puanimer ses efforts dans une entreprise dont le résultatétait pour elle si important. Mais combien il était péniblede penser qu’elle et les siens avaient contracté envers luiune dette qu’ils ne pourraient jamais acquitter ! C’est à luiqu’ils devaient le sauvetage de Lydia et de sa réputation.Comme Elizabeth se reprochait maintenant lessentiments d’antipathie et les paroles blessantes qu’elleavait eues pour lui ! Elle avait honte d’elle-même mais elleétait fière de lui, fière que pour accomplir une tâche depitié et d’honneur, il eût pu se vaincre lui-même. Elle
relut plusieurs fois l’éloge qu’en faisait sa tante : il était àpeine suffisant, mais il la touchait et lui causait un plaisirmêlé de regret en lui montrant à quel point son oncle et satante étaient convaincus qu’il subsistait toujours entre elleet Mr. Darcy un lien d’affection et de confiance.
Un bruit de pas la tira de ses réflexions, et avantqu’elle eût pu prendre une autre allée, Wickham étaitprès d’elle.
– J’ai peur d’interrompre votre promenade solitaire,ma chère sœur, dit-il en l’abordant.
– Assurément, répondit-elle avec un sourire, mais il nes’ensuit pas que cette interruption me soit déplaisante.
– Je serais navré qu’elle le fût. Nous avons toujoursété bons amis, nous le serons encore davantagemaintenant.
– Oui, certes, mais où sont donc les autres ?
– Je n’en sais rien. Mrs. Bennet et Lydia vont envoiture à Meryton. Alors, ma chère sœur, j’ai appris parvotre oncle et votre tante que vous aviez visitéPemberley ?
Elle répondit affirmativement.
– Je vous envie presque ce plaisir ; je crois cependantque ce serait un peu pénible pour moi, sans quoi je m’yarrêterais en allant à Newcastle. Vous avez vu la vieillefemme de charge ? Pauvre Reynolds ! elle m’aimaitbeaucoup. Mais, naturellement, elle ne vous a pas parlé demoi.
– Si, pardon.
– Et que vous a-t-elle dit ?
– Que vous étiez entré dans l’armée, et qu’ellecraignait fort… que vous n’eussiez pas très bien tourné ! Àde telles distances, vous le savez, les nouvelles arriventparfois fâcheusement défigurées.
– C’est certain, fit-il en se mordant les lèvres.
Elizabeth espérait l’avoir réduit au silence, mais ilreprit bientôt :
– J’ai été surpris de voir Darcy à Londres le moisdernier. Nous nous sommes croisés plusieurs fois. Je medemande ce qu’il pouvait bien y faire.
– Peut-être les préparatifs de son mariage avec missde Bourgh, dit Elizabeth. Il lui fallait en effet une raisontoute particulière pour être à Londres en cette saison.
– Assurément. L’avez-vous vu à Lambton ? J’ai cru lecomprendre d’après ce que m’ont dit les Gardiner.
– Oui ; il nous a même présentés à sa sœur.
– Et elle vous a plu ?
– Beaucoup.
– On m’a dit en effet qu’elle avait beaucoup gagnédepuis un an ou deux. La dernière fois que je l’ai vue, ellene promettait guère. Je suis heureux qu’elle vous ait plu.J’espère qu’elle achèvera de se transformer.
– J’en suis persuadée ; elle a dépassé l’âge le plus
– J’en suis persuadée ; elle a dépassé l’âge le plusdifficile.
– Avez-vous traversé le village de Kympton ?
– Je ne puis me rappeler.
– Je vous en parle parce que c’est là que se trouve lacure que j’aurais dû obtenir. Un endroit ravissant, unpresbytère superbe. Cela m’aurait convenu à tous lespoints de vue.
– Même avec l’obligation de faire des sermons ?
– Mais parfaitement. En m’exerçant un peu, j’enaurais eu bientôt pris l’habitude. Les regrets ne servent àrien, mais certainement, c’était la vie qu’il me fallait ;cette retraite, cette tranquillité aurait répondu à tous mesdésirs. Le sort en a décidé autrement. Darcy vous a-t-iljamais parlé de cette affaire, quand vous étiez dans leKent ?
– J’ai appris d’une façon aussi sûre, que ce bénéficevous avait été laissé conditionnellement et à la volonté dupatron actuel.
– Ah ! vraiment ? on vous l’a dit ?… Oui, en effet, il y aquelque chose de cela. Vous vous souvenez que je vousl’avais raconté moi-même, à notre première rencontre.
– J’ai appris aussi qu’à une certaine époque,l’obligation de faire des sermons ne vous tentait pasautant qu’aujourd’hui, que vous aviez affirmé votrevolonté bien arrêtée de ne jamais entrer dans les ordreset que, par suite, la question du bénéfice avait été réglée.
– Ah ! on vous a dit cela aussi ? C’est également assezexact, et je vous en avais de même touché un mot.
Ils étaient maintenant presque à la porte de la maison,car Elizabeth avait marché vite dans sa hâte de sedébarrasser de lui. Ne voulant pas le vexer, par égardpour sa sœur, elle se contenta de lui dire avec un sourirede bonne humeur :
– Allons, Mr. Wickham ! nous voilà frère et sœur.Laissons dormir le passé. J’espère qu’à l’avenir nouspenserons toujours de même…
Et elle lui tendit la main ; il la baisa avec uneaffectueuse galanterie, malgré l’embarras qu’il éprouvaitdans son for intérieur et tous deux rentrèrent dans lamaison.
LIIIMr. Wickham fut si satisfait de cette conversation que
jamais plus il ne prit la peine de revenir sur ce sujet, augrand contentement d’Elizabeth qui se félicita d’en avoirassez dit pour le réduire au silence.
Le jour du départ du jeune ménage arriva bientôt, etMrs. Bennet fut forcée de se résigner à une séparationqui, sans doute, allait être de longue durée, Mr. Bennet nese souciant nullement d’emmener sa famille à Newcastle,comme sa femme le lui proposait.
– Ah ! ma chère Lydia ! gémissait-elle ; quand nousretrouverons-nous ?
– Ma foi, je n’en sais rien ! Pas avant deux ou trois anspeut-être.
– Écrivez-moi souvent, ma chérie.
– Aussi souvent que je le pourrai. Mais vous savezqu’une femme mariée n’a guère de temps pour écrire.Mes sœurs qui n’ont rien à faire m’écriront.
Les adieux de Mr. Wickham furent beaucoup plusaffectueux que ceux de sa femme ; il prodiguait lessourires et les paroles aimables.
– Ce garçon est merveilleux, déclara Mr. Bennet dèsque les voyageurs furent partis. Il sourit, fait des grâces,et conte fleurette à chacun de nous. Je suisprodigieusement fier de lui, et je défie sir Lucas lui-mêmede produire un gendre supérieur à celui-là.
Le départ de Lydia assombrit Mrs. Bennet pendantplusieurs jours.
– Voilà ce que c’est que de marier ses enfants, mamère, lui dit Elizabeth. Réjouissez-vous donc d’avoirencore quatre filles célibataires.
Mais la mélancolie où l’avait plongée cet événement nerésista pas à la nouvelle qui commença bientôt à circulerdans le pays : la femme de charge de Netherfield avait,disait-on, reçu l’ordre de préparer la maison pourl’arrivée prochaine de son maître, qui, à l’occasion de lachasse, venait y passer quelques semaines. Mrs. Bennetne pouvait plus tenir en place.
– Alors, Mr. Bingley est donc sur le point de revenir,ma sœur ? disait-elle à Mrs. Philips qui avait apporté lanouvelle. Eh bien ! tant mieux. Ce n’est pas que les faits etgestes de ce monsieur nous intéressent, ni que j’aie aucundésir de le revoir. Toutefois, il est libre de revenir àNetherfield si cela lui plaît. Et qui sait ce qui peut arriver ?… Mais cela nous importe peu. Vous vous rappelez quenous avons convenu, il y a longtemps, de ne plus aborderce sujet. Alors, c’est bien certain qu’il va venir ?
– Très certain, car Mrs. Nichols est venue à Merytonhier soir, et l’ayant vue passer, je suis sortie moi-même
pour savoir par elle si la nouvelle était exacte. Elle m’a ditque son maître arrivait mercredi ou jeudi, mais plutôtmercredi. Elle allait chez le boucher commander de laviande pour ce jour-là, et elle a heureusement troiscouples de canards bons à tuer.
Jane n’avait pu entendre parler du retour de Bingleysans changer de couleur. Depuis longtemps elle n’avaitpas prononcé son nom devant Elizabeth, mais ce jour-là,dès qu’elles furent seules, elle lui dit :
– J’ai bien vu que votre regard se tournait vers moi,Lizzy, quand ma tante nous a dit la nouvelle, et j’ai sentique je me troublais ; mais n’allez pas attribuer monémotion à une cause puérile. J’ai rougi simplement parceque je savais qu’on allait me regarder. Je vous assure quecette nouvelle ne me cause ni joie, ni peine. Je me réjouisseulement de ce qu’il vienne seul. Nous le verrons ainsifort peu. Ce ne sont pas mes sentiments que je redoute,mais les remarques des indifférents.
Elizabeth ne savait que penser. Si elle n’avait pas vuBingley en Derbyshire, elle aurait pu supposer qu’il venaitsans autre motif que celui qu’on annonçait ; mais elle étaitpersuadée qu’il aimait toujours Jane et se demandait sison ami l’avait autorisé à venir, ou s’il était assezaudacieux pour se passer de sa permission.
En dépit des affirmations formelles de sa sœur, ellen’était pas sans voir que Jane était troublée : son humeurétait moins sereine et moins égale que de coutume.
Le sujet qui avait mis aux prises Mr. et Mrs. Bennet
un an auparavant se trouva remis en question.
– Naturellement, dès que Mr. Bingley arrivera, vousirez le voir, mon ami.
– Certes non. Vous m’avez obligé à lui rendre visitel’an passé, en me promettant que si j’allais le voir ilépouserait une de mes filles. Comme rien de tel n’estarrivé, on ne me fera pas commettre une seconde fois lamême sottise.
Sa femme lui représenta que c’était une politesse quetous les messieurs du voisinage ne pouvaient se dispenserde faire à Mr. Bingley, à l’occasion de son retour.
– C’est un usage que je trouve ridicule, répliqua Mr.Bennet. S’il a besoin de notre société, qu’il vienne lui-même ; il sait où nous habitons et je ne vais pas perdremon temps à visiter mes voisins à chacun de leursdéplacements.
– Tout ce que je puis dire, c’est que votre abstentionsera une véritable impolitesse. En tout cas, cela nem’empêchera pas de l’inviter à dîner. Nous devonsrecevoir bientôt Mrs. Lang et les Goulding. Cela feratreize en nous comptant. Il arrive à point pour faire lequatorzième.
– Je commence décidément à regretter son retour,confia Jane à Elizabeth. Ce ne serait rien, je pourrais lerevoir avec une parfaite indifférence s’il ne fallait pasentendre parler de lui sans cesse. Ma mère est remplie debonnes intentions mais elle ne sait pas – personne ne peutsavoir – combien toutes ses réflexions me font souffrir. Je
serai vraiment soulagée quand il repartira de Netherfield.
Enfin, Mr. Bingley arriva. Mrs. Bennet s’arrangea pouren avoir la première annonce par les domestiques afin quela période d’agitation et d’émoi fût aussi longue quepossible. Elle comptait les jours qui devaient s’écouleravant qu’elle pût envoyer son invitation, n’espérant pas levoir auparavant. Mais le troisième jour au matin, de lafenêtre de son boudoir, elle l’aperçut à cheval quifranchissait le portail et s’avançait vers la maison.
Ses filles furent appelées aussitôt pour partager sonallégresse.
– Quelqu’un l’accompagne, observa Kitty. Qui est-cedonc ? Eh ! mais on dirait que c’est cet ami qui étaittoujours avec lui l’an passé, Mr… ; – comment s’appelle-t-il donc ? – vous savez, cet homme si grand et si hautain ?…
– Grand Dieu ! Mr. Darcy !… Vous ne vous trompezpas. Tous les amis de Mr. Bingley sont les bienvenus ici,naturellement, mais j’avoue que la vue seule de celui-cim’est odieuse.
Jane regarda Elizabeth avec une surprise consternée.Elle n’avait pas su grand’chose de ce qui s’était passé enDerbyshire, et se figurait l’embarras qu’allait éprouver sasœur dans cette première rencontre avec Darcy après salettre d’explication. Elizabeth avait pour être troubléeplus de raisons que ne le pensait Jane à qui elle n’avaitpas encore eu le courage de montrer la lettre de Mrs.Gardiner. Pour Jane, Mr. Darcy n’était qu’un prétendant
qu’Elizabeth avait repoussé et dont elle n’avait pas suapprécier le mérite. Pour Elizabeth, c’était l’homme quivenait de rendre à sa famille un service inestimable etpour qui elle éprouvait un sentiment sinon aussi tendreque celui de Jane pour Bingley, du moins aussi profond etaussi raisonnable. Son étonnement en le voyant venirspontanément à Longbourn égalait celui qu’elle avaitressenti en le retrouvant si changé lors de leur rencontreen Derbyshire. La couleur qui avait quitté son visage yreparut plus ardente, et ses yeux brillèrent de joie à lapensée que les sentiments et les vœux de Darcy n’avaientpeut-être pas changé. Mais elle ne voulut point s’yarrêter.
« Voyons d’abord son attitude, se dit-elle. Après, jepourrai en tirer une conclusion. »
Une affectueuse sollicitude la poussa à regarder sasœur. Jane était un peu pâle, mais beaucoup plus paisiblequ’elle ne s’y attendait ; elle rougit légèrement à l’entréedes deux jeunes gens ; cependant, elle les accueillit d’unair assez naturel et avec une attitude correcte où il n’yavait ni trace de ressentiment, ni excès d’amabilité.
Elizabeth ne prononça que les paroles exigées par lastricte politesse et se remit à son ouvrage avec uneactivité inaccoutumée. Elle n’avait osé jeter qu’un coupd’œil rapide à Mr. Darcy : il avait l’air aussi grave qu’à sonhabitude, plus semblable, pensa-t-elle, à ce qu’il était jadisqu’à ce qu’il s’était montré à Pemberley. Peut-être était-ilmoins ouvert devant sa mère que devant son oncle et satante. Cette supposition, bien que désagréable, n’était pas
sans vraisemblance.
Pour Bingley aussi, elle n’avait eu qu’un regard d’uninstant, et pendant cet instant, il lui avait paru à la foisheureux et gêné. Mrs. Bennet le recevait avec desdémonstrations qui faisaient d’autant plus rougir ses fillesqu’elles s’opposaient à la froideur cérémonieuse qu’ellemontrait à Darcy.
Celui-ci, après avoir demandé à Elizabeth desnouvelles de Mr. et de Mrs. Gardiner, – question àlaquelle elle ne put répondre sans confusion, – n’ouvritpresque plus la bouche. Il n’était pas assis à côté d’elle ;peut-être était-ce la raison de son silence. Quelquesminutes se passèrent sans qu’on entendît le son de savoix. Quand Elizabeth, incapable de résister à la curiositéqui la poussait, levait les yeux sur lui, elle voyait sonregard posé sur Jane aussi souvent que sur elle-même, etfréquemment aussi fixé sur le sol. Il paraissait trèsabsorbé et moins soucieux de plaire qu’à leurs dernièresrencontres. Elle se sentit désappointée et en éprouva del’irritation contre elle-même.
« À quoi d’autre pouvais-je m’attendre ? se dit elle.Mais alors, pourquoi est il venu ? »
– Voilà bien longtemps que vous étiez absent, Mr.Bingley, observa Mrs. Bennet. Je commençais à craindreun départ définitif. On disait que vous alliez donner congépour la Saint-Michel ; j’espère que ce n’est pas vrai. Biendes changements se sont produits depuis votre départ.Miss Lucas s’est mariée ainsi qu’une de mes filles. Peut-
être l’avez-vous appris ? L’annonce en a paru dans leTimes et dans le Courrier, mais rédigée d’une façon biensingulière : « Récemment a eu lieu le mariage de G.Wickham esq. et de miss Lydia Bennet, » un point, c’esttout ! rien sur mon mari ou sur le lieu de notre résidence.C’est mon frère Gardiner qui l’avait fait insérer ; je medemande à quoi il a pensé ! L’avez-vous vue ?
Bingley répondit affirmativement et présenta sesfélicitations. Elizabeth n’osait lever les yeux, et ne put liresur le visage de Mr. Darcy.
– Assurément, avoir une fille bien mariée est unegrande satisfaction, continua Mrs. Bennet, mais en mêmetemps, Mr. Bingley, la séparation est une chose bien dure.Ils sont partis pour Newcastle, tout à fait dans le Nord, etils vont y rester je ne sais combien de temps. C’est là quese trouve le régiment de mon gendre. Vous savez sansdoute qu’il a quitté la milice et réussi à passer dansl’armée régulière ? Dieu merci, il a quelques bons amis,peut-être pas autant qu’il le mérite !
Cette flèche à l’adresse de Mr. Darcy mit Elizabethdans une telle confusion qu’elle eut envie de s’enfuir,mais, se ressaisissant, elle sentit au contraire la nécessitéde dire quelque chose, et demanda à Bingley s’il pensaitfaire à la campagne un séjour de quelque durée. « Deplusieurs semaines, » répondit-il.
– Quand vous aurez tué tout votre gibier, Mr. Bingley,lui dit Mrs. Bennet, il faudra venir ici et chasser autantqu’il vous plaira sur les terres de Mr. Bennet. Mon mari
en sera enchanté et vous réservera ses plus bellescompagnies de perdreaux.
La souffrance d’Elizabeth s’accrut encore devant desavances aussi déplacées. « Alors même, pensait-elle,qu’on pourrait reprendre le rêve de l’année dernière, toutconspirerait à le détruire encore une fois. » Et il lui semblaque des années de bonheur ne suffiraient pas pour lesdédommager, elle et Jane, de ces instants de péniblemortification.
Cette fâcheuse impression se dissipa pourtant quandelle remarqua combien la beauté de Jane semblait raviverles sentiments de son ancien admirateur. Pourcommencer, il ne lui avait pas beaucoup parlé, mais àmesure que l’heure s’avançait, il se tournait davantage deson côté et s’adressait à elle de plus en plus. Il laretrouvait aussi charmante, aussi naturelle, aussi aimableque l’an passé, bien que peut-être un peu plus silencieuse.
Quand les jeunes gens se levèrent pour partir, Mrs.Bennet n’eut garde d’oublier l’invitation projetée, et ilsacceptèrent de venir dîner à Longbourn quelques joursplus tard.
– Vous êtes en dette avec moi, Mr. Bingley, ajouta-t-elle. Avant votre départ pour Londres, vous m’aviezpromis de venir dîner en famille dès votre retour. Cettepromesse, que je n’ai pas oubliée, n’a pas été tenue, ce quim’a causé une grande déception, je vous assure.
Bingley parut un peu interloqué par ce discours et ditquelque chose sur son regret d’en avoir été empêché par
ses affaires, puis ils se retirèrent tous les deux.
Mrs. Bennet avait eu grande envie de les retenir àdîner le soir même ; mais bien que sa table fût toujourssoignée, elle s’était dit que deux services ne seraient pastrop pour recevoir un jeune homme sur qui elle fondait desi grandes espérances, et satisfaire l’appétit d’ungentleman qui avait dix mille livres de rentes.
LIVAussitôt qu’ils furent partis, Elizabeth sortit pour
tâcher de se remettre, ou, plus exactement, pour seplonger dans les réflexions les mieux faites pour lui ôtertout courage.
L’attitude de Mr. Darcy était pour elle un sujetd’étonnement et de mortification. « Puisqu’il a pu semontrer si aimable avec mon oncle et ma tante, quand ilétait à Londres, pensait-elle, pourquoi ne l’est-il pas avecmoi ? S’il me redoute, pourquoi est-il venu ? S’il a cesséde m’aimer, pourquoi ce silence ? Quel hommedéconcertant ! Je ne veux plus penser à lui. »
L’approche de sa sœur vint l’aider à donner à cetterésolution un commencement d’exécution. L’air joyeux deJane témoignait qu’elle était satisfaite de leurs visiteursbeaucoup plus qu’Elizabeth.
– Maintenant qu’a eu lieu cette première rencontre,dit-elle, je me sens tout à fait soulagée. Mes forces ont étémises à l’épreuve et je puis le voir désormais sans aucuntrouble. Je suis contente qu’il vienne dîner ici mardi :ainsi, tout le monde pourra se rendre compte que nousnous rencontrons, lui et moi, sur un pied de parfaiteindifférence.
– De parfaite indifférence, je n’en doute pas ! ditElizabeth en riant. Ô Jane, prenez garde !
– Ma petite Lizzy, vous ne me croyez pas assez faiblepour courir encore le moindre danger.
– Je crois que vous courez surtout le danger de lerendre encore plus amoureux qu’auparavant…
On ne revit pas les jeunes gens jusqu’au mardi. Cesoir-là, il y avait nombreuse compagnie à Longbourn, etles deux invités de marque se montrèrent exacts. Quandon passa dans la salle à manger, Elizabeth regarda siBingley allait reprendre la place qui, dans les réunionsd’autrefois, était la sienne auprès de sa sœur. Mrs.Bennet, en mère avisée, omit de l’inviter à prendre placeà côté d’elle. Il parut hésiter tout d’abord ; mais Jane, parhasard, regardait de son côté en souriant. Le sort en étaitjeté ; il alla s’asseoir auprès d’elle. Elizabeth, avec unsentiment de triomphe, lança un coup d’œil dans ladirection de Mr. Darcy : il paraissait parfaitementindifférent, et, pour un peu, elle aurait cru qu’il avaitdonné à son ami toute licence d’être heureux ; si ellen’avait vu les yeux de Bingley se tourner vers lui avec unsourire un peu confus. Pendant tout le temps du dîner, iltémoigna à sa sœur une admiration qui, pour être plusréservée qu’auparavant, n’en prouva pas moins àElizabeth que s’il avait toute la liberté d’agir, son bonheuret celui de Jane seraient bientôt assurés.
Mr. Darcy, séparé d’elle par toute la longueur de latable, était assis à côté de la maîtresse de maison.
Elizabeth savait que ce voisinage ne pouvait leur causeraucun plaisir, et qu’il n’était pas fait pour les mettre envaleur ni l’un ni l’autre. Trop éloignée pour suivre leurconversation, elle remarquait qu’ils se parlaient rarementet toujours avec une froide politesse. La mauvaise grâcede sa mère lui rendait plus pénible le sentiment de tout ceque sa famille devait à Mr. Darcy, et, à certains moments,elle eût tout donné pour pouvoir lui dire qu’une personneau moins de cette famille savait tout, et lui étaitprofondément reconnaissante. Elle espérait que la soiréeleur fournirait l’occasion de se rapprocher et d’avoir uneconversation moins banale que les quelques proposcérémonieux qu’ils avaient échangés à son entrée. Danscette attente, le moment qu’elle passa au salon avant leretour des messieurs lui parut interminable. Il luisemblait que tout le plaisir de la soirée dépendait del’instant qui allait suivre : « S’il ne vient pas alors merejoindre, pensa-t-elle, j’abandonnerai toute espérance. »
Les messieurs revinrent au salon, et Mr. Darcy eutl’air, un instant, de vouloir répondre aux vœuxd’Elizabeth. Mais, hélas, autour de la table où elle servaitle café avec Jane, les dames s’étaient rassemblées en ungroupe si compact qu’il n’y avait pas moyen de glisser unechaise parmi elles.
Mr. Darcy se dirigea vers une autre partie du salon oùElizabeth le suivit du regard, enviant tous ceux à qui iladressait la parole. Un peu d’espoir lui revint en le voyantrapporter lui-même sa tasse ; elle saisit cette occasionpour lui demander :
– Votre sœur est-elle encore à Pemberley ?
– Oui, elle y restera jusqu’à Noël.
– Tous ses amis l’ont-ils quittée ?
– Mrs. Annesley est toujours avec elle ; les autres sontpartis pour Scarborough il y a trois semaines.
Elizabeth chercha en vain autre chose à dire. Aprèstout, il ne tenait qu’à lui de poursuivre la conversation s’ille désirait. Mais il restait silencieux à ses côtés, et commeune jeune fille s’approchait et chuchotait à l’oreilled’Elizabeth, il s’éloigna.
Les plateaux enlevés, on ouvrit les tables à jeu, ettoutes les dames se levèrent. Mr. Darcy fut aussitôtaccaparé par Mrs. Bennet qui cherchait des joueurs dewhist ; ce que voyant, Elizabeth perdit tout son espoir dele voir la rejoindre et n’attendit plus de cette réunionaucun plaisir. Ils passèrent le reste de la soirée à destables différentes et tout ce qu’Elizabeth put faire fut desouhaiter qu’il tournât ses regards de son côté assezsouvent pour le rendre autant qu’elle-même distrait etmaladroit au jeu.
– Eh bien ! enfants, dit Mrs. Bennet dès qu’elle seretrouva avec ses filles, que pensez-vous de cette soirée ?J’ose dire que tout a marché à souhait. J’ai rarement vuun dîner aussi réussi. Le chevreuil était rôti à point et toutle monde a déclaré n’avoir jamais mangé un cuissot pareil.Le potage était incomparablement supérieur à celui qu’onnous a servi chez les Lucas la semaine dernière. Mr.Darcy lui-même a reconnu que les perdreaux étaient
parfaits ; or, il doit bien avoir chez lui deux ou troiscuisiniers français !… Et puis, ma chère Jane, je ne vous aijamais vue plus en beauté. Mrs. Long, à qui je l’ai faitremarquer, était de mon avis. Et savez-vous ce qu’elle aajouté ? « Ah ! Mrs. Bennet, je crois bien que nous laverrons tout de même à Netherfield !… » Oui, elle a ditcela textuellement. Cette Mrs. Long est la meilleurepersonne qui soit, et ses nièces sont des jeunes filles fortbien élevées, et pas du tout jolies ; elles me plaisenténormément.
– Cette journée a été fort agréable, dit Jane àElizabeth. Les invités étaient bien choisis, tout le mondese convenait. J’espère que de telles réunions serenouvelleront.
Elizabeth sourit.
– Lizzy, ne souriez pas. Vous me mortifiez en prenantcet air sceptique. Je vous assure que je puis jouirmaintenant de la conversation de Mr. Bingley comme decelle d’un homme agréable et bien élevé, sans la pluspetite arrière-pensée. Je suis absolument persuadée,d’après sa façon d’être actuelle, qu’il n’a jamais pensé àmoi. Il a seulement plus de charme dans les manières etplus de désir de plaire que n’en montrent la plupart deshommes.
– Vous êtes vraiment cruelle, repartit Elizabeth. Vousme défendez de sourire, et vous m’y forcez sans cesse…Excusez-moi donc, mais si vous persistez dans votreindifférence, vous ferez bien de chercher une autre
LVPeu de jours après, Mr. Bingley se présenta de
nouveau, et cette fois seul. Son ami l’avait quitté le matinpour retourner à Londres, et il devait revenir une dizainede jours plus tard. Mr. Bingley resta environ une heure etmontra un entrain remarquable. Mrs. Bennet luidemanda de rester à dîner, mais il répondit qu’à songrand regret il était déjà retenu.
– Pouvez-vous venir demain ?
Oui ; il n’avait point d’engagement pour le lendemain,et il accepta l’invitation avec un air de vif contentement.
Le lendemain, il arriva de si bonne heure qu’aucune deces dames n’était encore prête. En peignoir et à demicoiffée, Mrs. Bennet se précipita dans la chambre de safille.
– Vite, ma chère Jane, dépêchez-vous de descendre. Ilest arrivé ! Mr. Bingley est là ! Oui, il est là. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, Sarah ! Laissez la coiffure de missLizzy et venez vite aider miss Jane à passer sa robe.
– Nous descendrons dès que nous le pourrons, ditJane ; mais Kitty doit être déjà prête car il y a une demi-heure qu’elle est montée.
– Que Kitty aille au diable !… Il s’agit bien d’elle ! Vite,votre ceinture, ma chérie.
Mais rien ne put décider Jane à descendre sans une deses sœurs.
La préoccupation de ménager un tête-à-tête aux deuxjeunes gens fut de nouveau visible chez Mrs. Bennet dansla soirée. Après le thé, son mari se retira dans labibliothèque selon son habitude et Mary alla retrouverson piano. Deux obstacles sur cinq ayant ainsi disparu,Mrs. Bennet se mit à faire des signes à Elizabeth et àKitty, mais sans succès ; Elizabeth ne voulait rien voir.Elle finit par attirer l’attention de Kitty qui lui demandainnocemment :
– Qu’y a-t-il, maman ? Que veulent dire tous cesfroncements de sourcils ? Que faut-il que je fasse ?
– Rien du tout, mon enfant. Je ne vous ai même pasregardée.
Mrs. Bennet se tint tranquille cinq minutes ; mais ellene pouvait se résoudre à perdre un temps aussi précieux.À la fin, elle se leva et dit soudain à Kitty :
– Venez, ma chérie ; j’ai à vous parler. Et ellel’emmena hors du salon. Jane jeta vers Elizabeth unregard de détresse où se lisait l’instante prière de ne passe prêter à un tel complot. Quelques instants après,Mrs Bennet entre-bâilla la porte et appela :
– Lizzy, mon enfant, j’ai un mot à vous dire.
Elizabeth fut bien obligée de sortir.
– Nous ferons mieux de les laisser seuls, lui dit samère. Kitty et moi allons nous installer dans ma chambre.
Elizabeth n’essaya pas de discuter avec sa mère ; elleattendit tranquillement dans le hall que Mrs. Bennet etKitty eussent disparu pour retourner dans le salon.
Les savantes combinaisons de Mrs. Bennet neréussirent pas ce soir-là. Mr. Bingley se montra des pluscharmants, mais ne se déclara pas. Il ne se fit pas prierpour rester à souper ; et avant qu’il prît congé, Mrs.Bennet convint avec lui qu’il reviendrait le lendemainmatin pour chasser avec son mari.
À partir de ce moment, Jane n’essaya plus de parlerde son « indifférence ». Pas un mot au sujet de Bingley nefut échangé entre les deux sœurs, mais Elizabeth s’en futcoucher avec l’heureuse certitude que tout serait bientôtdécidé, hors le cas d’un retour inopiné de Mr. Darcy.
Bingley fut exact au rendez-vous et passa toute lamatinée au dehors avec Mr. Bennet comme il avait étéentendu. Ce dernier se montra beaucoup plus agréableque son compagnon ne s’y attendait. Il n’y avait chezBingley ni vanité, ni sottise qui pût provoquer l’ironie oule mutisme de Mr. Bennet, qui se montra moins original etplus communicatif que Bingley ne l’avait encore vu. Ilsrevinrent ensemble pour le dîner.
Après le thé, Elizabeth s’en fut dans le petit salonécrire une lettre ; les autres se préparant à faire unepartie de cartes, sa présence n’était plus nécessaire,pensa-t-elle, pour déjouer les combinaisons de sa mère.
Sa lettre terminée, elle revint au salon et vit alors queMrs. Bennet avait été plus avisée qu’elle. En ouvrant laporte, elle aperçut sa sœur et Bingley debout devant lacheminée qui parlaient avec animation. Si cette vue ne luiavait donné aucun soupçon, l’expression de leurphysionomie et la hâte avec laquelle ils s’éloignèrent l’unde l’autre auraient suffi pour l’éclairer. Trouvant lasituation un peu gênante, Elizabeth allait se retirer, quandBingley qui s’était assis se leva soudain, murmuraquelques mots à Jane, et se précipita hors du salon.
Jane ne pouvait rien cacher à Elizabeth, et, la prenantdans ses bras, reconnut avec émotion qu’elle était la plusheureuse des femmes.
– C’est trop, ajouta-t-elle, beaucoup trop. Je ne leméritais pas. Oh ! que je voudrais voir tout le monde aussiheureux que moi !
Elizabeth félicita sa sœur avec une sincérité, une joie etune chaleur difficiles à rendre. Chaque phrase affectueuseajoutait au bonheur de Jane. Mais elle ne voulut pasprolonger davantage cet entretien.
– Il faut que j’aille tout de suite trouver ma mère, dit-elle. Je ne voudrais sous aucun prétexte avoir l’air deméconnaître son affectueuse sollicitude ou permettrequ’elle apprît la nouvelle par un autre que moi-même. Ilest allé de son côté trouver mon père. Ô Lizzy, quel plaisirde songer que cette nouvelle va causer tant de joie auxmiens ! Comment supporterai-je tant de bonheur !
Et elle courut rejoindre sa mère qui avait interrompu
exprès la partie de cartes et s’était retirée au premierétage avec Kitty.
Elizabeth restée seule sourit devant l’aisance et larapidité avec laquelle se réglait une affaire qui leur avaitdonné tant de mois d’incertitude et d’anxiété. Elle futrejointe au bout de quelques minutes par Bingley dontl’entrevue avec Mr. Bennet avait été courte etsatisfaisante.
– Où est votre sœur ? demanda-t-il en ouvrant laporte.
– Avec ma mère, au premier ; mais je suis sûre qu’elleva redescendre bientôt.
Fermant la porte, il s’approcha d’elle et réclama desfélicitations et une part de son affection fraternelle.Elizabeth exprima avec effusion toute sa joie de voir seformer entre eux un tel lien. Ils se serrèrent la main avecune grande cordialité et, jusqu’au retour de Jane, elle dutécouter tout ce qu’il avait à dire de son bonheur et desperfections de sa fiancée. Tout en faisant la part del’exagération naturelle aux amoureux, Elizabeth se disaitque tout ce bonheur entrevu n’était pas impossible car ilaurait pour base l’excellent jugement et le caractère idéalde Jane, sans compter une parfaite similitude de goûts etde sentiments entre elle et Bingley.
Ce fut pour tous une soirée exceptionnellementheureuse. Le bonheur de Jane donnait à son visage unéclat et une animation qui la rendaient plus charmanteque jamais. Kitty minaudait, souriait, espérait que son
tour viendrait bientôt. Mrs. Bennet ne trouvait pas determes assez chauds, assez éloquents pour donner sonconsentement et exprimer son approbation, bien qu’ellene parlât point d’autre chose à Bingley pendant plus d’unedemi-heure. Quant à Mr. Bennet, lorsqu’il vint lesrejoindre au souper, sa voix et ses manières disaientclairement combien il était heureux. Pas un mot, pas uneallusion, cependant, ne passa ses lèvres jusqu’au momentoù leur visiteur eut pris congé, mais alors il s’avança verssa fille en disant :
– Jane, je vous félicite. Vous serez une femmeheureuse.
Jane aussitôt l’embrassa et le remercia de sa bonté.
– Vous êtes une bonne fille, répondit-il, et j’ai grandplaisir à penser que vous allez être si heureusementétablie. Je ne doute pas que vous ne viviez tous deux dansun parfait accord. Vos caractères ne sont en riendissemblables. Vous êtes l’un et l’autre si accommodantsque vous ne pourrez jamais prendre une décision, sidébonnaires que vous serez trompés par tous vosdomestiques, et si généreux que vous dépenserez plusque votre revenu.
– J’espère qu’il n’en sera rien. Si j’étais imprudente ouinsouciante en matière de dépense, je seraisimpardonnable.
– Plus que leur revenu !… À quoi pensez-vous, moncher Mr. Bennet ! s’écria sa femme. Il a au moins quatreou cinq mille livres de rentes ! Ô ma chère Jane, je suis si
contente ! Je n’en dormirai pas de la nuit…
À partir de ce moment, Bingley fit à Longbourn desvisites quotidiennes. Il arrivait fréquemment avant lebreakfast et restait toujours jusqu’après le souper, àmoins que quelque voisin barbare et qu’on ne pouvaitassez maudire, ne lui eût fait une invitation à dîner qu’ilne crût pas pouvoir refuser.
Elizabeth n’avait plus beaucoup de temps pours’entretenir avec sa sœur, car Jane, en la présence deBingley, n’accordait son attention à personne autre ; maiselle rendait grand service à tous deux dans les inévitablesmoments de séparation : en l’absence de Jane, Bingleyvenait chanter ses louanges à Elizabeth et, Bingley parti,Jane en faisait autant de son côté.
– Il m’a rendue heureuse, dit-elle un soir, enm’apprenant qu’il avait toujours ignoré mon séjour àLondres au printemps dernier. Je ne le croyais paspossible !
– J’en avais bien le soupçon, répondit Elizabeth. Quelleexplication vous a-t-il donnée ?
– Ce devait être la faute de ses sœurs. Assurémentelles ne tenaient pas à encourager les relations entre leurfrère et moi, ce qui n’a rien d’étonnant puisqu’il aurait pufaire un mariage tellement plus avantageux sous bien desrapports. Mais quand elles verront, comme j’en ai laconfiance, que leur frère est heureux avec moi, elles enprendront leur parti. Croyez-vous, Lizzy, que lors de sondépart en novembre, il m’aimait vraiment, et que la seule
conviction de mon indifférence l’a empêché de revenir !
– Il a commis une petite erreur, assurément ; mais elleest tout à l’honneur de sa modestie.
Elizabeth était contente de voir que Bingley n’avait pasdit un mot de l’intervention de son ami ; car bien que Janeeût le cœur le plus généreux et le plus indulgent, cettecirconstance n’aurait pu manquer de la prévenir contreMr. Darcy.
– Je suis certainement la créature la plus heureuse dumonde, s’écria Jane. Ô Lizzy ! pourquoi suis-je laprivilégiée de la famille ? Si je pouvais seulement vousvoir aussi heureuse ! S’il y avait seulement pour vous unhomme comparable à Charles !
– Quand vous me donneriez à choisir parmi vingtautres exemplaires de votre fiancé, je ne pourrais jamaisêtre aussi heureuse que vous. Il me manquerait pour celavotre aimable caractère. Non, non ; laissez-moi medébrouiller comme je pourrai. Peut-être, avec un peu dechance, pourrai-je trouver un jour un second Mr. Collins !
LVIUne semaine environ après les fiançailles de Jane,
comme les dames étaient réunies un matin dans la salle àmanger en compagnie de Bingley, leur attention futéveillée soudain par le bruit d’une voiture, et ellesaperçurent une chaise de poste à quatre chevaux quicontournait la pelouse. L’heure était vraiment matinalepour une visite d’amis, et d’ailleurs ni l’équipage, ni lalivrée du cocher ne leur étaient connus. Cependant,comme il était certain que quelqu’un allait se présenter,Bingley eut tôt fait de décider Jane à l’accompagner dansle petit bois pour fuir l’intrus. Mrs. Bennet et ses autresfilles se perdaient en conjectures lorsque la porte s’ouvritet livra passage à lady Catherine.
Elle entra dans la pièce avec un air encore moinsgracieux que d’habitude, ne répondit à la révérenced’Elizabeth qu’en inclinant légèrement la tête et s’assitsans mot dire. Elizabeth l’avait nommée à sa mère aprèsson entrée, bien que Sa Grâce n’eût pas demandé à êtreprésentée. Mrs. Bennet stupéfaite, mais flattée de voirchez elle une personne de si haute importance, déployapour la recevoir toutes les ressources de sa politesse.Après un moment de silence, lady Catherine dit assezsèchement à Elizabeth :
– J’espère que vous allez bien, miss Bennet. Cettedame est votre mère, je suppose ?
Elizabeth fit une brève réponse affirmative.
– Et voilà sans doute une de vos sœurs ?
– Oui, madame, intervint Mrs. Bennet, ravie de parlerà une aussi grande dame. C’est mon avant-dernière fille.La plus jeune s’est mariée dernièrement, et l’aînée est aujardin avec un jeune homme qui ne tardera pas, je crois, àfaire partie de notre famille.
– Votre parc n’est pas bien grand, reprit ladyCatherine après une courte pause.
– Ce n’est rien en comparaison de Rosings,assurément, my lady ; mais je vous assure qu’il estbeaucoup plus vaste que celui de sir William Lucas.
– Cette pièce doit être bien incommode pour les soirsd’été ; elle est en plein couchant.
Mrs. Bennet assura que l’on ne s’y tenait jamais aprèsdîner ; puis elle ajouta :
– Puis-je prendre la liberté de demander à VotreGrâce si elle a laissé Mr. et Mrs. Collins en bonne santé ?
– Oui, ils vont très bien. Je les ai vus avant-hier ausoir.
Elizabeth s’attendait maintenant à ce qu’elle lui remîtune lettre de Charlotte, seule raison, semblait-il, qui pûtexpliquer cette visite. Mais ne voyant aucune lettre venir,elle se sentit de plus en plus intriguée.
Mrs. Bennet pria Sa Grâce d’accepter quelquesrafraîchissements, mais lady Catherine déclaranettement, et sans beaucoup de formes, qu’elle n’avaitbesoin de rien ; puis, se levant, elle dit à Elizabeth :
– Miss Bennet, il m’a semblé qu’il y avait un assez jolipetit bois, de l’autre côté de votre pelouse. J’y feraisvolontiers un tour, si vous me faites la faveur dem’accompagner.
– Allez-y, ma chérie, s’écria Mrs. Bennet, et montrez àSa Grâce les plus jolies allées. Je suis sûre que l’ermitagelui plaira.
Elizabeth obéit et, courant chercher son ombrelle danssa chambre, elle redescendit se mettre à la disposition dela noble visiteuse. Comme elles traversaient le hall, ladyCatherine ouvrit les portes de la salle à manger et dusalon, y jeta un coup d’œil et après avoir daigné lesdéclarer convenables, sortit dans le jardin.
Toutes deux suivirent en silence l’allée sablée quiconduisait au petit bois. Elizabeth était décidée à ne pointse mettre en frais pour une femme qui se montrait, plusencore que d’habitude, insolente et désagréable.
« Comment ai-je jamais pu trouver que son neveu luiressemblait ? » se demandait-elle en la regardant.
À peine furent-elles entrées dans le bois que ladyCatherine entama ainsi la conversation :
– Vous ne devez point être surprise, miss Bennet, deme voir ici. Votre cœur, votre conscience vous ont déjà dit
la raison de ma visite.
Elizabeth la regarda avec un étonnement sincère.
– En vérité, madame, vous vous trompez ; il m’estabsolument impossible de deviner ce qui nous vautl’honneur de vous voir ici.
– Miss Bennet, répliqua Sa Grâce d’un ton irrité, vousdevez savoir qu’on ne se moque pas de moi. Mais s’il vousplaît de ne pas être franche, je ne vous imiterai pas. J’aitoujours été réputée pour ma sincérité et ma franchise, etdans une circonstance aussi grave, je ne m’en départiraicertainement pas. Une nouvelle inquiétante m’estparvenue il y a deux jours. On m’a dit que, non seulementvotre sœur était sur le point de se marier trèsavantageusement, mais que vous, miss Elizabeth Bennet,vous alliez très probablement, peu après, devenir lafemme de mon neveu, de mon propre neveu, Mr. Darcy.Bien qu’il s’agisse là, j’en suis sûre, d’un scandaleuxmensonge, et que je ne veuille pas faire à mon neveul’injure d’y ajouter foi, j’ai résolu immédiatement de metransporter ici pour vous faire connaître mes sentiments.
– Puisque vous ne pouvez croire que ce soit vrai, ditElizabeth, le visage animé par l’étonnement et le dédain,je me demande pourquoi vous vous êtes imposé la fatigued’un pareil voyage. Quelle peut être l’intention de VotreGrâce ?
– C’est d’exiger qu’un démenti formel soit opposé toutde suite à de tels bruits.
– Votre visite à Longbourn, répliqua froidement
Elizabeth, paraîtra plutôt les confirmer, si en effet ilsexistent réellement.
– S’ils existent ! Prétendriez-vous les ignorer ? N’est-ce pas vous et les vôtres qui les avez adroitement mis encirculation ? Ne savez-vous pas qu’ils se répandentpartout ?
– C’est la première nouvelle que j’en aie.
– Et pouvez-vous m’affirmer de même que ces bruitsn’ont aucun fondement ?
– Je ne prétends pas à la même franchise que VotreGrâce. Il peut lui arriver de poser des questionsauxquelles je n’aie point envie de répondre.
– Ceci ne peut se supporter. J’insiste, miss Bennet,pour avoir une réponse. Mon neveu vous a-t-il demandéeen mariage ?
– Votre Grâce a déclaré tout à l’heure que la choseétait impossible.
– Assurément, tant qu’il gardera l’usage de sa raison.Mais vos charmes et votre habileté peuvent lui avoir faitoublier, dans un instant de vertige, ce qu’il doit à safamille et à lui-même. Vous êtes capable de lui avoir faitperdre la tête.
– Si j’ai fait cela, je serai la dernière personne àl’avouer.
– Miss Bennet, savez-vous bien qui je suis ? Je n’aipoint l’habitude de m’entendre parler sur ce ton. Je suis la
plus proche parente que mon neveu ait au monde, et j’aile droit de connaître ses affaires les plus intimes.
– Mais non pas les miennes. Et ce n’est pas votre façond’agir, madame, qui me décidera à en dire davantage.
– Comprenez-moi bien. Cette union, à laquelle vousavez la présomption d’aspirer, ne peut se réaliser, non,jamais. Mr. Darcy est fiancé à ma fille. Et maintenant,qu’avez-vous à dire ?
– Que s’il en est ainsi, vous n’avez aucune raison decraindre qu’il me demande de l’épouser.
Lady Catherine hésita une seconde, puis reprit :
– L’engagement qui les lie est d’une espèceparticulière. Depuis leur tendre enfance, ils ont étédestinés l’un à l’autre. Ce mariage était notre vœu le pluscher, à sa mère et à moi. Nous projetions de les unir alorsqu’ils étaient encore au berceau. Et maintenant que cerêve pourrait s’accomplir, il y serait mis obstacle par unejeune fille de naissance obscure, sans fortune, etcomplètement étrangère à notre famille ?… N’avez-vousdonc aucun égard pour les désirs des siens, pour sonengagement tacite avec miss de Bourgh ? Avez-vousperdu tout sentiment de délicatesse, tout respect desconvenances ? Ne m’avez-vous jamais entendu dire que,dès ses premières années, il était destiné à sa cousine ?
– Si ; on me l’avait même dit avant vous. Mais en quoicela me regarde-t-il ? Si la seule objection à mon mariageavec votre neveu est le désir qu’avaient sa mère et satante de lui voir épouser miss de Bourgh, elle n’existe pas
tante de lui voir épouser miss de Bourgh, elle n’existe paspour moi. Vous avez fait ce qui était en votre pouvoir enformant ce projet ; son accomplissement ne dépendait pasde vous. Si Mr. Darcy ne se sent lié à sa cousine ni parl’honneur, ni par l’inclination, pourquoi ne pourrait-il faireun autre choix ? Et si c’est moi qui suis l’objet de ce choix,pourquoi refuserais-je ?
– Parce que l’honneur, les convenances, la prudence,et votre intérêt même vous l’interdisent. Oui, missBennet, votre intérêt ! car n’allez pas vous imaginer quevous serez accueillie par sa famille ou ses amis, si vousagissez volontairement contre leur désir à tous. Vousserez blâmée, dédaignée et méprisée par tous les gens desa connaissance ; cette alliance sera considérée comme undéshonneur, et votre nom ne sera même jamais prononcéparmi nous.
– Voilà en effet de terribles perspectives ! répliquaElizabeth ; mais la femme qui épousera Mr. Darcytrouvera dans ce mariage de telles compensations que,tout compte fait, elle n’aura rien à regretter.
– Fille volontaire et obstinée ! Vous me faites honte !Est-ce donc ainsi que vous reconnaissez les bontés que j’aieues pour vous au printemps dernier ? N’avez-vous point,de ce fait, quelque obligation envers moi ? Voyons,asseyons-nous. Il faut que vous compreniez, miss Bennet,que je suis venue ici absolument déterminée à voir mavolonté s’accomplir. Rien ne peut m’en détourner ; je n’aipas coutume de céder aux caprices d’autrui.
– Tout ceci rend la situation de Votre Grâce plus digne
de compassion, mais ne peut avoir aucun effet sur moi.
– Ne m’interrompez pas, je vous prie. Ma fille et monneveu sont faits l’un pour l’autre ; ils descendent du côtématernel de la même noble souche, et du côté paternel defamilles anciennes et honorables quoique non titrées. Leurfortune à tous deux est énorme. Tout le monde dans lesdeux familles est d’accord pour désirer ce mariage. Etqu’est-ce qui les séparerait ? Les prétentionsextravagantes d’une jeune personne sans parenté,relations, ni fortune… Peut-on supporter chose pareille ?Non, cela ne doit pas être, et cela ne sera pas. Si vousaviez le moindre bon sens, vous ne souhaiteriez pasquitter le milieu dans lequel vous avez été élevée.
– Je ne considère pas que je le quitterais en épousantvotre neveu. Mr. Darcy est un gentleman, je suis la filled’un gentleman : sur ce point, nous sommes égaux.
– Parfaitement, vous êtes la fille d’un gentleman. Maisvotre mère, qui est-elle ? Et vos oncles, et vos tantes ?…Ne croyez pas que j’ignore leur situation sociale.
– Quelle que soit ma famille, si votre neveu n’y trouverien à redire, vous n’avez pas à vous occuper d’elle.
– Répondez-moi une fois pour toutes ; lui êtes-vousfiancée ?
Bien qu’Elizabeth n’eût pas voulu, dans le seul desseind’obliger lady Catherine, répondre à cette question, ellene put que répondre après un instant de réflexion :
– Non, je ne le suis pas.
Lady Catherine parut soulagée.
– Alors, faites-moi la promesse de ne jamais l’être ?
– Je me refuse absolument à faire une promesse de cegenre.
– Miss Bennet, je suis stupéfaite et indignée. Jepensais vous trouver plus raisonnable. Mais n’allez pasvous imaginer que je céderai. Je ne partirai pas d’ici avantd’avoir obtenu la promesse que je désire.
– Et moi, je ne la donnerai certainement jamais. Cen’est pas par intimidation que l’on parviendra à me fairefaire une chose aussi déraisonnable. Votre Grâce désiremarier sa fille avec Mr. Darcy : la promesse que vousexigez rendra-t-elle plus probable leur mariage ? Ensupposant que Mr. Darcy m’aime, mon refus le poussera-t-il à reporter sa tendresse sur sa cousine ? Permettez-moi de vous dire, lady Catherine, que les arguments parlesquels vous appuyez une démarche si extraordinairesont aussi vains que la démarche est malavisée. Vous meconnaissez bien mal si vous pensez qu’ils peuventm’influencer le moins du monde. Jusqu’à quel point Mr.Darcy peut approuver votre ingérence dans ses affaires,je ne saurais le dire ; mais vous n’avez certainement pasle droit de vous occuper des miennes. C’est pourquoi jedemande à ne pas être importunée davantage sur cesujet.
– Pas si vite, je vous prie ! Je n’ai pas fini. À toutes lesraisons que j’ai déjà données, j’en ajouterai une autre. Jen’ignore rien de la honteuse aventure de votre plus jeune
sœur. Je sais que son mariage avec le jeune homme n’aété qu’un replâtrage qui s’est fait aux frais de votre pèreet de votre oncle. Et une fille pareille deviendrait la sœurde mon neveu ? Il aurait comme beau-frère le fils durégisseur de feu son père ? À quoi pensez-vous, grandDieu ! Les ombres des anciens maîtres de Pemberleydoivent-elles être à ce point déshonorées ?
– Après cela, vous n’avez certainement rien à ajouter,répliqua Elizabeth amèrement. Il n’est pas une seuleinsulte que vous m’ayez épargnée. Je vous prie de bienvouloir me laisser retourner chez moi.
Tout en parlant, elle se leva. Lady Catherine se levaaussi et elles se dirigèrent vers la maison. Sa Grâce étaiten grand courroux.
– C’est bien. Vous refusez de m’obliger. Vous refusezd’obéir à la voix du devoir, de l’honneur, de lareconnaissance. Vous avez juré de perdre mon neveudans l’estime de tous ses amis, et de faire de lui la risée dumonde. Je sais maintenant ce qu’il me reste à faire. Necroyez pas, miss Bennet, que votre ambition puissetriompher. Je suis venue pour essayer de m’entendreavec vous ; j’espérais vous trouver plus raisonnable. Mais,ne vous trompez pas, ce que je veux, je saurai l’obtenir.
Lady Catherine continua son discours jusqu’à laportière de sa voiture ; alors, se retournant vivement, elleajouta :
– Je ne prends pas congé de vous, miss Bennet ; je nevous charge d’aucun compliment pour votre mère. Vous
ne méritez pas cette faveur. Je suis outrée !
Elizabeth ne répondit pas, et rentra tranquillementdans la maison. Elle entendit la voiture s’éloigner tandisqu’elle montait l’escalier. Sa mère l’attendait, impatiente,à la porte du petit salon, et demanda pourquoi ladyCatherine n’était pas revenue pour se reposer.
– Elle n’a pas voulu, répondit la jeune fille ; elle étaitpressée de repartir.
– Quelle personne distinguée ! et comme c’est aimableà elle de venir nous faire visite ! car je suppose que c’estuniquement pour nous apporter des nouvelles des Collinsqu’elle est venue. Elle est sans doute en voyage, et,passant par Meryton, elle aura eu l’idée de s’arrêter pournous voir. Je suppose qu’elle n’avait rien de particulier àvous dire, Lizzy ?
Elizabeth fut forcée de répondre par un légermensonge, car il était vraiment impossible de faireconnaître le véritable sujet de leur conversation.
LVIICe ne fut pas sans peine qu’Elizabeth parvint à
surmonter le trouble où l’avait plongée cette visiteextraordinaire, et son esprit en demeura obsédé durantde longues heures.
Lady Catherine avait donc pris, selon toute apparence,la peine de venir de Rosings à seule fin de rompre l’accordqu’elle supposait arrêté entre son neveu et Elizabeth. Iln’y avait là rien qui pût étonner de sa part ; mais d’oùcette nouvelle lui était-elle venue, c’est ce qu’Elizabethn’arrivait pas à s’expliquer. Enfin, l’idée lui vint que le faitqu’elle était la sœur de Jane, et Darcy l’ami intime deBingley, avait pu suffire à faire naître cette supposition,un projet de mariage ne manquant jamais d’en suggérerun autre à l’imagination du public. Leurs voisins de LucasLodge (car c’était certainement par eux et les Collins quele bruit avait atteint lady Catherine) avaient seulementprédit comme un fait assuré et prochain ce qu’elle-mêmeentrevoyait comme possible dans un avenir plus ou moinséloigné.
Le souvenir des déclarations de lady Catherine n’étaitpas sans lui causer quelque malaise, car il fallaits’attendre, après ce qu’elle avait dit de sa résolutiond’empêcher le mariage, à ce qu’elle exerçât une pression
sur son neveu. Comment celui-ci prendrait-il le tableauqu’elle lui ferait des fâcheuses conséquences d’une allianceavec la famille Bennet ? Elizabeth n’osait le prévoir. Ellene savait pas au juste le degré d’affection que lui inspiraitsa tante, ni l’influence que ses jugements pouvaient avoirsur lui ; mais il était naturel de supposer qu’il avait pourlady Catherine beaucoup plus de considération que n’enavait Elizabeth. Il était certain qu’en énumérant lesinconvénients d’épouser une jeune fille dont la parentéimmédiate était si inférieure à la sienne, sa tantel’attaquerait sur son point vulnérable. Avec ses idées surles inégalités sociales, il estimerait sans douteraisonnables et judicieux les arguments qu’Elizabeth avaitjugés faibles et ridicules. S’il était encore hésitant, lesconseils et les exhortations d’une proche parentepouvaient avoir raison de ses derniers doutes, et ledécider à chercher le bonheur dans la satisfaction degarder sa dignité intacte. Dans ce cas, il ne reviendraitpoint. Lady Catherine le verrait sans doute en traversantLondres et il n’aurait plus qu’à révoquer la promesse faiteà Bingley de revenir à Netherfield.
« Par conséquent, se dit-elle, si son ami reçoit cesjours-ci une lettre où il s’excuse de ne pouvoir tenir sapromesse, je saurai à quoi m’en tenir, et qu’entre lui etmoi tout est fini. »
Le lendemain matin, comme elle descendait de sachambre, elle rencontra son père qui sortait de labibliothèque, une lettre à la main.
– Je vous cherchais justement, Lizzy, lui dit-il, entrez
ici avec moi.
Elle le suivit, curieuse de ce qu’il allait lui dire,intriguée par cette lettre qui devait avoir une certaineimportance. L’idée la frappa brusquement qu’elle venaitpeut-être de lady Catherine, ce qui lui fit entrevoir nonsans effroi toute une série d’explications où il lui faudraits’engager. Elle suivit son père jusque devant la cheminée,et tous deux s’assirent. Mr. Bennet prit la parole :
– Je viens de recevoir une lettre qui m’a causé unesurprise extrême ; comme elle vous concerne toutparticulièrement, il faut que je vous en dise le contenu.J’ignorais jusqu’alors que j’avais « deux » filles sur lepoint de se lier par les nœuds sacrés du mariage.Permettez-moi de vous adresser mes félicitations pourune conquête aussi brillante.
La couleur monta aux joues d’Elizabeth, subitementconvaincue que la lettre venait, non pas de la tante, maisdu neveu. À la fois satisfaite qu’il en vînt à se déclarer etmécontente que la lettre ne lui fût pas adressée, elleentendit son père poursuivre :
– Vous avez l’air de comprendre de quoi il s’agit, – lesjeunes filles, en ces matières, sont douées d’une grandepénétration, – mais je crois pouvoir défier votre sagacitéelle-même de deviner le nom de votre admirateur. Cettelettre vient de Mr. Collins.
– De Mr. Collins ? Que peut-il bien avoir à raconter ?
– Des choses très à propos, bien entendu. Sa lettrecommence par des félicitations sur le « prochain
hyménée » de ma fille Jane, dont il a été averti, semble-t-il, par le bavardage de ces braves Lucas. Je ne me joueraipas de votre impatience en vous lisant ce qu’il écrit là-dessus. Voici le passage qui vous concerne :
« Après vous avoir offert mes sincères congratulationset celles de Mrs. Collins, laissez-moi faire une discrèteallusion à un événement analogue que nous apprenons demême source. Votre fille Elizabeth, annonce-t-on, negarderait pas longtemps le nom de Bennet après que sasœur aînée l’aura quitté, et celui qu’elle a choisi pourpartager son destin est considéré comme l’un despersonnages les plus importants de ce pays. » – Pouvez-vous vraiment deviner de qui il est question, Lizzy ? « …Ce jeune homme est favorisé d’une façon particulière entout ce que peut souhaiter le cœur d’une mortelle : beaudomaine, noble parenté, relations influentes. Cependant,en dépit de tous ces avantages, laissez-moi vous avertir,ainsi que ma cousine Elizabeth, des maux que vousrisquez de déchaîner en accueillant précipitamment lespropositions de ce gentleman, – propositions que vousêtes probablement tentés d’accepter sans retard. »
– À votre idée, Lizzy, quel peut être ce gentleman ?…Mais ici, tout se dévoile : « … Voici le motif pour lequel jevous conseille la prudence : nous avons toute raison decroire que sa tante, lady Catherine de Bourgh, neconsidère pas cette union d’un œil favorable… » – C’estdonc Mr. Darcy ! J’imagine, Lizzy, que c’est une vraiesurprise pour vous. Pouvait-on, parmi toutes nosconnaissances, tomber sur quelqu’un dont le nom pût
mieux faire, ressortir la fausseté de toute cette histoire ?Mr. Darcy, qui ne regarde jamais une femme que pour luidécouvrir une imperfection, Mr. Darcy qui, probablement,ne vous a même jamais regardée ! C’est ineffable !
Elizabeth tenta de s’associer à la gaieté de son père,mais ne réussit qu’à ébaucher un sourire hésitant.
– Cela ne vous amuse pas ?
– Oh si ! Mais continuez donc à lire.
– « … Hier soir, lorsque j’ai entretenu Sa Grâce de lapossibilité de ce mariage, avec sa bienveillancecoutumière, elle m’a confié ses sentiments. Par suite decertaines raisons de famille qu’elle fait valoir contre macousine, il me paraît évident qu’elle ne donnerait jamaisson consentement à ce qu’elle appelle une mésallianceinacceptable. Je crois de mon devoir d’avertir avec toutela diligence possible ma cousine et son noble admirateur,afin qu’ils sachent à quoi ils s’exposent, et ne précipitentpas une union qui ne serait pas dûment approuvée… » –Mr. Collins ajoute encore : « Je me réjouis véritablementde ce que la triste histoire de ma cousine Lydia ait été sibien étouffée. Une seule chose me peine, c’est que l’onsache dans le public qu’ils ont vécu ensemble quinze joursavant la bénédiction nuptiale. Je ne puis me dérober audevoir de ma charge et m’abstenir d’exprimer monétonnement que vous ayez reçu le jeune couple chez vous,aussitôt après le mariage : c’est un encouragement auvice, et si j’étais le recteur de Longbourn, je m’y seraisopposé de tout mon pouvoir. Assurément vous devez leur
pardonner en chrétien, mais non les admettre en votreprésence, ni supporter que l’on prononce leurs nomsdevant vous… »
– Voilà quelle est sa conception du pardon chrétien !La fin de la lettre roule sur l’intéressante situation de sachère Charlotte, et leur espérance de voir bientôt chezeux « un jeune plant d’olivier ». Mais, Lizzy, cela n’a pasl’air de vous amuser ? Vous n’allez pas faire la délicate, jepense, et vous montrer affectée par un racontar stupide.Pourquoi sommes-nous sur terre, sinon pour fournirquelque distraction à nos voisins, et en retour, nouségayer à leurs dépens ?
– Oh ! s’écria Elizabeth, je trouve cela très drôle, maistellement étrange !
– Et justement ! c’est ce qui en fait le piquant ! Si cesbraves gens avaient choisi un autre personnage, il n’yaurait eu là rien de divertissant ; mais l’extrême froideurde Mr. Darcy et votre aversion pour lui témoignent à quelpoint cette fable est délicieusement absurde. Bien quej’aie horreur d’écrire, je ne voudrais pour rien au mondemettre un terme à ma correspondance avec Mr. Collins.Bien mieux, quand je lis une de ses lettres, je ne puism’empêcher de le placer au-dessus de Wickham, quoiquej’apprécie fort l’impudence et l’hypocrisie de mon gendre.Et dites-moi, Lizzy, qu’a raconté là-dessus ladyCatherine ? Était-elle venue pour refuser sonconsentement ?
Pour toute réponse, Elizabeth se mit à rire ; la
question avait été posée le plus légèrement du monde etMr. Bennet n’insista pas.
Elizabeth était plus malheureuse que jamais d’avoir àdissimuler ses sentiments ; elle se forçait à rire alorsqu’elle aurait eu plutôt envie de pleurer. Son père l’avaitcruellement mortifiée par ce qu’il avait dit del’indifférence de Mr. Darcy. Elle s’étonnait d’un telmanque de clairvoyance et en arrivait à craindre que là oùson père n’avait rien vu, elle-même n’eût vu plus que laréalité.
LVIIIAu lieu de recevoir de son ami une lettre d’excuse,
ainsi qu’Elizabeth s’y attendait à demi, Mr. Bingley putamener Mr. Darcy en personne à Longbourn, peu de joursaprès la visite de lady Catherine.
Tous deux arrivèrent de bonne heure, et avant queMrs. Bennet eût eu le temps de dire à Mr. Darcy qu’elleavait vu sa tante, – ce qu’Elizabeth redouta un instant, –Bingley, qui cherchait l’occasion d’un tête-à-tête avecJane, proposa à tout le monde une promenade. Mrs.Bennet n’aimait pas la marche, et Mary n’avait jamais unmoment à perdre ; mais les autres acceptèrent etensemble se mirent en route. Bingley et Jane, toutefois, selaissèrent bientôt distancer et restèrent à marcherdoucement en arrière. Le groupe formé par les troisautres était plutôt taciturne ; Kitty, intimidée par Mr.Darcy, n’osait ouvrir la bouche, Elizabeth se préparaitsecrètement à brûler ses vaisseaux, et peut-être Darcy enfaisait-il autant de son côté.
Ils s’étaient dirigés vers Lucas Lodge où Kitty avaitl’intention de faire visite à Maria. Elizabeth, ne voyant pasla nécessité de l’accompagner, la laissa entrer seule, etpoursuivit délibérément sa route avec Mr. Darcy.
C’était maintenant le moment, ou jamais, d’exécutersa résolution. Profitant du courage qu’elle se sentait en cetinstant, elle commença sans plus attendre :
– Je suis très égoïste, Mr. Darcy. Pour me soulagerd’un poids, je vais donner libre cours à mes sentiments, aurisque de heurter les vôtres ; mais je ne puis rester pluslongtemps sans vous remercier de la bonté vraimentextraordinaire dont vous avez fait preuve pour mapauvre sœur. Croyez bien que si le reste de ma famille enétait instruit, je n’aurais pas ma seule reconnaissance àvous exprimer.
– Je regrette, je regrette infiniment, répliqua Darcyavec un accent plein de surprise et d’émotion, qu’on vousait informée de choses qui, mal interprétées, ont pu vouscauser quelque malaise. J’aurais cru qu’on pouvait se fierdavantage à la discrétion de Mrs. Gardiner.
– Ne blâmez pas ma tante. L’étourderie de Lydia seulem’a révélé que vous aviez été mêlé à cette affaire, et, bienentendu, je n’ai pas eu de repos tant que je n’en ai pasconnu tous les détails. Laissez-moi vous remercier mille etmille fois au nom de toute ma famille de la généreuse pitiéqui vous a poussé à prendre tant de peine et à supportertant de mortifications pour arriver à découvrir ma sœur.
– Si vous tenez à me remercier, répliqua Darcy,remerciez-moi pour vous seule. Que le désir de vousrendre la tranquillité ait ajouté aux autres motifs quej’avais d’agir ainsi, je n’essaierai pas de le nier, mais votrefamille ne me doit rien. Avec tout le respect que j’ai pour
elle, je crois avoir songé uniquement à vous.
L’embarras d’Elizabeth était tel qu’elle ne putprononcer une parole. Après une courte pause, soncompagnon poursuivit :
– Vous êtes trop généreuse pour vous jouer de messentiments. Si les vôtres sont les mêmes qu’au printempsdernier, dites-le-moi tout de suite. Les miens n’ont pasvarié, non plus que le rêve que j’avais formé alors. Maisun mot de vous suffira pour m’imposer silence à jamais.
Désireuse de mettre un terme à son anxiété, Elizabethretrouva enfin assez d’empire sur elle-même pour luirépondre, et sans tarder, bien qu’en phrasesentrecoupées, elle lui fit entendre que depuis l’époque àlaquelle il faisait allusion, ses sentiments avaient subi unchangement assez profond pour qu’elle pût accueillirmaintenant avec joie le nouvel aveu des siens.
Cette réponse causa à Darcy un bonheur tel que sansdoute il n’en avait point encore éprouvé un semblable, etil l’exprima dans des termes où l’on sentait toute l’ardeuret la tendresse d’un cœur passionnément épris. SiElizabeth avait osé lever les yeux, elle aurait vu combienl’expression de joie profonde qui illuminait sa physionomieembellissait son visage. Mais si son trouble l’empêchait deregarder, elle pouvait l’entendre : et tout ce qu’il disait,montrant à quel point elle lui était chère, lui faisait sentirdavantage, de minute en minute, le prix de son affection.
Ils marchaient au hasard, sans but, absorbés par cequ’ils avaient à se confier, et le reste du monde n’existait
plus pour eux. Elizabeth apprit bientôt que l’heureuseentente qui venait de s’établir entre eux était due auxefforts de lady Catherine pour les séparer. En traversantLondres au retour, elle était allée trouver son neveu et luiavait conté son voyage à Longbourn sans lui en taire lemotif ; elle avait rapporté en substance sa conversationavec Elizabeth, appuyant avec emphase sur toutes lesparoles qui, à son sens, prouvaient la perversité oul’impudence de la jeune fille, persuadée qu’avec un telrécit elle obtiendrait de son neveu la promessequ’Elizabeth avait refusé de lui faire. Mais,malheureusement pour Sa Grâce, l’effet produit avait étéexactement le contraire de celui qu’elle attendait.
– Elle m’a donné, dit-il, des raisons d’espérer que jen’avais pas encore. Je connaissais assez votre caractèrepour être sûr que si vous aviez été décidée à me refuserd’une façon absolue et irrévocable, vous l’auriez dit à ladyCatherine franchement et sans détour.
Elizabeth rougit et répondit en riant :
– Vous ne connaissez que trop, en effet, ma franchise.Si j’ai pu vous faire en face tant de reprochesabominables, je n’aurais eu aucun scrupule à les rediredevant n’importe quel membre de votre famille.
– Et qu’avez-vous donc dit qui ne fût mérité ? Car sivos accusations étaient mal fondées, mon attitude enversvous dans cette circonstance était digne des reproches lesplus sévères ; elle était impardonnable, et je ne puis ysonger sans honte.
– Ne nous disputons pas pour savoir qui de nous fut,ce soir-là, le plus à blâmer. D’aucun des deux la conduite,en toute impartialité, ne peut être jugée irréprochable.Mais depuis lors nous avons fait, je crois, l’un et l’autredes progrès en politesse.
– Je ne puis m’absoudre aussi facilement. Le souvenirde ce que j’ai dit alors, de mes manières, de mesexpressions, m’est encore, après de longs mois, infinimentpénible. Il y a un de vos reproches que je n’oublieraijamais : « Si votre conduite avait été celle d’ungentleman… », m’avez-vous dit. Vous ne pouvez savoir,vous pouvez à peine imaginer combien ces paroles m’onttorturé, bien qu’il m’ait fallu quelque temps, je l’avoue,pour arriver à en reconnaître la justesse.
– J’étais certes bien éloignée de penser qu’ellesproduiraient sur vous une si forte impression.
– Je le crois aisément ; vous me jugiez alors incapablede tout bon sentiment. Oui, ne protestez pas. Je nepourrai jamais oublier l’expression de votre visagelorsque vous m’avez déclaré que, « faite sous n’importequelle forme, ma demande n’aurait jamais pu vous donnerla moindre tentation de l’agréer. »
– Oh ! ne répétez pas tout ce que j’ai dit ! Cessouvenirs n’ont rien d’agréable, et voilà longtemps, jevous assure, qu’ils me remplissent de confusion.
Darcy rappela sa lettre :
– Vous a-t-elle donné meilleure opinion de moi ?Avez-vous, en la lisant, fait crédit à ce qu’elle contenait ?
Elizabeth expliqua les impressions qu’elle avaitressenties et comment, l’une après l’autre, toutes sespréventions étaient tombées.
– En écrivant cette lettre, reprit Darcy, je m’imaginaisêtre calme et froid ; mais je me rends compte maintenantque je l’ai écrite le cœur plein d’une affreuse amertume.
– Peut-être commençait-elle dans l’amertume, maiselle se terminait par un adieu plein de charité. Allons, nepensez plus à cette lettre : les sentiments de celui qui l’aécrite, comme de celle qui l’a reçue, ont si profondémentchangé depuis lors que tous les souvenirs désagréablesqui s’y rapportent doivent être oubliés. Mettez-vous àl’école de ma philosophie, et ne retenez du passé que cequi peut vous donner quelque plaisir.
– Je n’appelle pas cela de la philosophie : les souvenirsque vous évoquez sont si exempts de reproches que lasatisfaction qu’ils font naître ne peut prendre le nom dephilosophie. Mais il n’en va pas de même pour moi, et dessouvenirs pénibles s’imposent à mon esprit qui nepeuvent pas, qui ne doivent pas être repoussés. J’ai vécujusqu’ici en égoïste : enfant, on m’a enseigné à faire lebien, mais on ne m’a pas appris à corriger mon caractère.J’étais malheureusement fils unique, – même, durant delongues années, unique enfant, – et j’ai été gâté par mesparents qui, bien que pleins de bonté (mon père enparticulier était la bienveillance même), ont laissé croîtreet même encouragé la tendance que j’avais à me montrerpersonnel et hautain, à enfermer mes sympathies dans le
cadre familial et à faire fi du reste du monde. Tel ai-je étédepuis mon enfance jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Telserais-je encore si je ne vous avais pas rencontrée,aimable et charmante Elizabeth. Que ne vous dois-je pas ?Vous m’avez donné une leçon, dure sans doute, maisprécieuse. Par vous j’ai été justement humilié. Je venais àvous, n’éprouvant aucun doute au sujet de l’accueil quim’attendait. Vous m’avez montré combien mesprétentions étaient insuffisantes pour plaire à une femmequi avait le droit d’être difficile.
– Comme vous avez dû me détester après ce soir-là !
– Vous détester ! J’ai été en colère, peut-être, pourcommencer, mais ma colère a pris bientôt une meilleuredirection.
– J’ose à peine vous demander ce que vous avez penséde moi lorsque nous nous sommes rencontrés àPemberley. Ma présence en ce lieu ne vous a-t-elle pasparu déplacée ?
– Non, en vérité. Je n’ai ressenti que de la surprise.
– Votre surprise n’a sûrement pas été plus grande quela mienne en me voyant traitée par vous avec tantd’égards. Ma conscience me disait que je ne méritais pasd’être l’objet d’une politesse exagérée, et j’avoue que je necomptais pas recevoir plus qu’il ne m’était dû.
– Mon but, répliqua Darcy, était de vous montrer, partoute la courtoisie dont j’étais capable, que je n’avais pasl’âme assez basse pour vous garder rancune du passé.J’espérais obtenir votre pardon et adoucir la mauvaise
opinion que vous aviez de moi, en vous faisant voir quevos reproches avaient été pris en considération. À quelmoment d’autres souhaits se sont-ils mêlés à cet espoir, jepuis à peine le dire ; mais je crois bien que ce fut moinsd’une heure après vous avoir revue.
Il lui dit alors combien Georgiana avait été charmée defaire sa connaissance, et sa déception en voyant leursrelations si brusquement interrompues. Ici, leur penséese portant naturellement sur la cause de cetteinterruption, Elizabeth apprit bientôt que c’était à l’hôtelmême de Lambton que Darcy avait pris la décision dequitter le Derbyshire à sa suite et de se mettre à larecherche de Lydia. Son air grave et préoccupé venaituniquement du débat intérieur d’où était sortie cettedétermination.
Après avoir fait ainsi plusieurs milles sans y songer, uncoup d’œil jeté à leurs montres leur fit voir qu’il étaitgrand temps de rentrer. Et Bingley, et Jane ? Qu’étaient-ils devenus ? Cette question tourna sur eux laconversation. Darcy était enchanté de leurs fiançailles ;son ami lui en avait donné la première nouvelle.
– Je voudrais savoir si elle vous a surpris, ditElizabeth.
– Du tout. Lorsque j’étais parti, je savais que cedénouement était proche.
– C’est-à-dire que vous aviez donné votreautorisation. Je m’en doutais.
Et, bien qu’il protestât contre le terme, Elizabeth
Et, bien qu’il protestât contre le terme, Elizabethdécouvrit que c’était à peu près ainsi que les chosess’étaient passées.
– Le soir qui a précédé mon départ pour Londres, dit-il, j’ai fait à Bingley une confession à laquelle j’aurais dûme décider depuis longtemps. Je lui ai dit tout ce qui étaitarrivé pour rendre ma première intervention dans sesaffaires absurde et déplacée. Sa surprise a été grande. Iln’avait jamais eu le moindre soupçon. Je lui ai dit de plusque je m’étais trompé en supposant votre sœurindifférente à son égard et que, ne pouvant douter de laconstance de son amour pour elle, j’étais convaincu qu’ilsseraient heureux ensemble.
– Et votre conviction, je le suppose, a entraînéimmédiatement la sienne ?
– Parfaitement. Bingley est très sincèrementmodeste ; sa défiance naturelle l’avait empêché de s’enremettre à son propre jugement, dans une question aussiimportante. Sa confiance dans le mien a tout décidé. Maisje lui devais un autre aveu qui, pendant un moment, etnon sans raison, l’a blessé. Je ne pouvais me permettre delui cacher que votre sœur avait passé trois mois à Londresl’hiver dernier, que je l’avais su, et le lui avais laissévolontairement ignorer. Ceci l’a fâché ; mais sa colère, jecrois bien, s’est évanouie en même temps que son doutesur les sentiments de votre sœur.
Elisabeth avait grande envie d’observer que Mr.Bingley avait été un ami tout à fait charmant et que sadocilité à se laisser guider rendait inappréciable ; mais elle
se contint. Elle se rappela que Mr. Darcy n’était pasencore habitué à ce qu’on le plaisantât, et il était encoreun peu tôt pour commencer.
Tout en continuant à parler du bonheur de Bingley,qui, naturellement, ne pouvait être inférieur qu’au sien, ilpoursuivit la conversation jusqu’à leur arrivée àLongbourn. Dans le hall, ils se séparèrent.
LIX– Ma chère Lizzy, où avez-vous bien pu aller vous
promener ?
Telle fut la question que Jane fit à Elizabeth, à sonretour, et que répétèrent les autres membres de la familleau moment où l’on se mettait à table. Elle répondit qu’ilsavaient marché au hasard des routes jusqu’à ne plussavoir exactement où ils se trouvaient, et elle rougit enfaisant cette réponse ; mais ni par là, ni par autre chose,elle n’excita aucun soupçon.
La soirée se passa paisiblement, sans incident notable.Les fiancés déclarés causaient et riaient ; ceux quil’étaient secrètement restaient silencieux. Darcy n’étaitpas d’un caractère à laisser son bonheur se révéler pardes dehors joyeux, et Elizabeth, émue et perplexe, sedemandait ce que diraient les siens lorsqu’ils sauraienttout, Jane étant la seule qui n’eût pas d’antipathie pourMr. Darcy.
Le soir, elle s’ouvrit à sa sœur. Bien que la défiance nefût pas dans ses habitudes, Jane reçut la nouvelle avecune parfaite incrédulité :
– Vous plaisantez, Lizzy. C’est inimaginable ! Vous,fiancée à Mr. Darcy ?… Non, non, je ne puis vous croire ;
je sais que c’est impossible…
– Je n’ai pas de chance pour commencer ! Moi quimettais toute ma confiance en vous, je suis sûre à présentque personne ne me croira, si vous vous y refusez vous-même. Pourtant, je parle très sérieusement ; je ne dis quela vérité : il m’aime toujours, et nous nous sommes fiancéstout à l’heure.
Jane la regarda d’un air de doute.
– Oh ! Lizzy, ce n’est pas possible… Je sais combien ilvous déplaît.
– Vous n’en savez rien du tout. Oubliez tout ce quevous croyez savoir. Peut-être fut-il un temps où je nel’aimais pas comme aujourd’hui, mais je vous dispensed’avoir une mémoire trop fidèle. Dorénavant, je ne veuxplus m’en souvenir moi-même.
– Mon Dieu, est-ce possible ? s’écria Jane. Pourtant, ilfaut bien que je vous croie. Lizzy chérie, je voudrais… jeveux vous féliciter. Mais êtes-vous certaine, – excusez maquestion, – êtes-vous bien certaine que vous puissiez êtreheureuse avec lui ?
– Il n’y a aucun doute à cet égard. Nous avons déjàdécidé que nous serions le couple le plus heureux dumonde. Mais êtes-vous contente, Jane ? Serez-vousheureuse de l’avoir pour frère ?
– Très heureuse ! Mr. Bingley et moi ne pouvionssouhaiter mieux ! Nous en parlions quelquefois, mais enconsidérant la chose comme impossible. En toute
sincérité, l’aimez-vous assez ? Oh ! Lizzy ! tout plutôtqu’un mariage sans amour !… Êtes-vous bien sûre de vossentiments ?
– Tellement sûre que j’ai peur de vous entendre direqu’ils sont exagérés !
– Pourquoi donc ?
– Parce que je l’aime plus que Mr. Bingley !… N’allezpas vous fâcher ?
– Ma chère petite sœur, ne plaisantez pas. Je parlefort sérieusement. Dites-moi vite tout ce que je doissavoir. Depuis quand l’aimez-vous ?
– Tout cela est venu si insensiblement qu’il me seraitdifficile de vous répondre. Mais, cependant, je pourraispeut-être dire : depuis que j’ai visité son beau domaine dePemberley !
Une nouvelle invitation à parler sérieusementproduisit son effet et Elizabeth eut vite rassuré sa sœursur la réalité de son attachement pour Mr. Darcy. MissBennet déclara alors qu’elle n’avait plus rien à désirer.
– Désormais, je suis pleinement heureuse, affirma-t-elle, car votre part de bonheur sera aussi belle que lamienne. J’ai toujours estimé Mr. Darcy. N’y eût-il eu enlui que son amour pour vous, cela m’aurait suffi.Maintenant qu’il sera l’ami de mon mari et le mari de masœur, il aura le troisième rang dans mes affections. MaisLizzy, comme vous avez été dissimulée avec moi !…J’ignore presque tout ce qui s’est passé à Pemberley et à
Lambton, et le peu que j’en sais m’a été raconté pard’autres que par vous !
Elizabeth lui expliqua les motifs de son silence.L’incertitude où elle était au sujet de ses propressentiments lui avait fait éviter jusqu’alors de nommer Mr.Darcy : mais maintenant il fallait que Jane sût la part qu’ilavait prise au mariage de Lydia. Tout fut éclairci et lamoitié de la nuit se passa en conversation.
– Dieu du ciel ! s’écria Mrs. Bennet, le lendemainmatin, en regardant par la fenêtre, ne voilà-t-il pas cefâcheux Mr. Darcy qui arrive encore avec notre cherBingley ? Quelle raison peut-il avoir pour nous fatiguer deses visites ? Je m’imaginais qu’il venait pour chasser,pêcher, tout ce qu’il voudrait, mais non pour être toujoursfourré ici. Qu’allons-nous en faire ? Lizzy, vous devriezencore l’emmener promener pour éviter que Bingley letrouve sans cesse sur son chemin.
Elizabeth garda difficilement son sérieux à uneproposition si opportune.
Bingley, en entrant, la regarda d’un air expressif et luiserra la main avec une chaleur qui montrait bien qu’ilsavait tout ; puis, presque aussitôt :
– Mistress Bennet, dit-il, n’avez-vous pas d’autreschemins dans lesquels Lizzy pourrait recommencer à seperdre aujourd’hui ?
– Je conseillerai à Mr. Darcy, à Lizzy et à Kitty, ditMrs. Bennet, d’aller à pied ce matin jusqu’à OaklamMount ; c’est une jolie promenade, et Mr. Darcy ne doit
pas connaître ce point de vue.
Kitty avoua qu’elle préférait ne pas sortir. Darcyprofessa une grande curiosité pour la vue de OaklamMount, et Elizabeth donna son assentiment sans rien dire.Comme elle allait se préparer, Mrs. Bennet la suivit pourlui dire :
– Je regrette, Lizzy, de vous imposer cet ennuyeuxpersonnage ; mais vous ferez bien cela pour Jane. Inutile,du reste, de vous fatiguer à tenir conversation tout le longdu chemin ; un mot de temps à autre suffira.
Pendant cette promenade, ils décidèrent qu’il fallait, lesoir même, demander le consentement de Mr. Bennet.Elizabeth se réserva la démarche auprès de sa mère. Ellene pouvait prévoir comment celle-ci accueillerait lanouvelle, si elle manifesterait une opposition violente ouune joie impétueuse : de toute manière, l’expression deses sentiments ne ferait pas honneur à sa pondération, etElizabeth n’aurait pas pu supporter que Mr. Darcy fûttémoin ni des premiers transports de sa joie, ni desmouvements véhéments de sa désapprobation.
Dans la soirée, quand Mr. Bennet se retira, Mr. Darcyse leva et le suivit dans la bibliothèque. Elizabeth fut trèsagitée jusqu’au moment où il reparut. Un sourire larassura tout d’abord : puis, s’étant approché d’elle sousprétexte d’admirer sa broderie, il lui glissa :
– Allez trouver votre père ; il vous attend dans labibliothèque.
Elle s’y rendit aussitôt. Mr. Bennet arpentait la pièce,
Elle s’y rendit aussitôt. Mr. Bennet arpentait la pièce,l’air grave et anxieux.
– Lizzy, dit-il, qu’êtes-vous en train de faire ? Avez-vous perdu le sens, d’accepter cet homme ? Ne l’avez-vous pas toujours détesté ?
Comme Elizabeth eût souhaité alors n’avoir jamaisformulé de ces jugements excessifs ! Il lui fallait à présenten passer par des explications difficiles, et ce fut avecquelque embarras qu’elle affirma son attachement pourDarcy.
– En d’autres termes, vous êtes décidée à l’épouser. Ilest riche, c’est certain, et vous aurez de plus bellestoilettes et de plus beaux équipages que Jane. Mais celavous donnera-t-il le bonheur ?
– N’avez-vous pas d’objection autre que la convictionde mon indifférence ?
– Aucune. Nous savons tous qu’il est orgueilleux, peuavenant, mais ceci ne serait rien s’il vous plaisaitréellement.
– Mais il me plaît ! protesta-t-elle, les larmes auxyeux. Je l’aime ! Il n’y a point chez lui d’excès d’orgueil ; ilest parfaitement digne d’affection. Vous ne le connaissezpas vraiment ; aussi, ne m’affligez pas en me parlant delui en de tels termes.
– Lizzy, lui dit son père, je lui ai donné monconsentement. Il est de ces gens auxquels on n’oserefuser ce qu’ils vous font l’honneur de vous demander.Je vous le donne également, si vous êtes résolue à
l’épouser, mais je vous conseille de réfléchir encore. Jeconnais votre caractère, Lizzy. Je sais que vous ne serezheureuse que si vous estimez sincèrement votre mari et sivous reconnaissez qu’il vous est supérieur. La vivacité devotre esprit rendrait plus périlleux pour vous un mariagemal assorti. Mon enfant, ne me donnez pas le chagrin devous voir dans l’impossibilité de respecter le compagnonde votre existence. Vous ne savez pas ce que c’est.
Elizabeth, encore plus émue, donna dans sa réponseles assurances les plus solennelles : elle répéta que Mr.Darcy était réellement l’objet de son choix, elle expliquacomment l’opinion qu’elle avait eue de lui s’était peu à peutransformée tandis que le sentiment de Darcy, loin d’êtrel’œuvre d’un jour, avait supporté l’épreuve de plusieursmois d’incertitude ; elle fit avec chaleur l’énumération detoutes ses qualités, et finit par triompher de l’incrédulitéde son père.
– Eh bien, ma chérie, dit-il, lorsqu’elle eut fini deparler, je n’ai plus rien à dire. S’il en est ainsi il est dignede vous.
Pour compléter cette impression favorable, Elizabethl’instruisit de ce que Darcy avait fait spontanément pourLydia. Il l’écouta avec stupéfaction.
– Que de surprises dans une seule soirée ! Ainsi donc,c’est Darcy qui a tout fait, – arrangé le mariage, donnél’argent, payé les dettes, obtenu le brevet d’officier deWickham ! – Eh bien, tant mieux ! Cela m’épargne biendu tourment et me dispense d’une foule d’économies. Si
j’étais redevable de tout à votre oncle, je devrais, jevoudrais m’acquitter entièrement envers lui. Mais cesjeunes amoureux n’en font qu’à leur tête. J’offriraidemain à Mr. Darcy de le rembourser : il s’emportera,tempêtera en protestant de son amour pour vous, et cesera le dernier mot de l’histoire.
Il se souvint alors de l’embarras qu’elle avait laissévoir en écoutant la lecture de la lettre de Mr. Collins. Ill’en plaisanta quelques instants ; enfin, il la laissa partir,ajoutant comme elle le quittait :
– S’il venait des prétendants pour Mary ou Kitty, vouspouvez me les envoyer. J’ai tout le temps de leurrépondre.
La soirée se passa paisiblement. Lorsque Mrs. Bennetregagna sa chambre, Elizabeth la suivit pour lui fairel’importante communication. L’effet en fut des plusdéconcertants. Aux premiers mots, Mrs. Bennet se laissatomber sur une chaise, immobile, incapable d’articulerune syllabe. Ce ne fut qu’au bout d’un long momentqu’elle put comprendre le sens de ce qu’elle entendait,bien qu’en général elle eût l’esprit assez prompt dès qu’ilétait question d’un avantage pour sa famille, ou d’unamoureux pour ses filles. Enfin, elle reprit possessiond’elle-même, s’agita sur sa chaise, se leva, se rassit, et pritle ciel à témoin de sa stupéfaction.
– Miséricorde ! Bonté divine ! Peut-on s’imaginerchose pareille ? Mr. Darcy ! qui aurait pu le supposer ?Est-ce bien vrai ? Ô ma petite Lizzy, comme vous allez
être riche et considérée ! Argent de poche, bijoux,équipages, rien ne vous manquera ! Jane n’aura rien decomparable. Je suis tellement contente, tellementheureuse… Un homme si charmant ! si beau ! si grand !Oh ! ma chère Lizzy, je n’ai qu’un regret, c’est d’avoir eupour lui jusqu’à ce jour tant d’antipathie : j’espère qu’il nes’en sera pas aperçu. Lizzy chérie ! Une maison àLondres ! Tout ce qui fait le charme de la vie ! Trois fillesmariées ! dix mille livres de rentes ! Ô mon Dieu, quevais-je devenir ? C’est à en perdre la tête…
Il n’en fallait pas plus pour faire voir que sonapprobation ne faisait pas de doute. Heureuse d’avoir étéle seul témoin de ces effusions, Elizabeth se retira bientôt.Mais elle n’était pas dans sa chambre depuis trois minutesque sa mère l’y rejoignit.
– Mon enfant bien-aimée, s’écria-t-elle, je ne puispenser à autre chose. Dix mille livres de rentes, et plusencore très probablement. Cela vaut un titre. Et la licencespéciale{6} ! Il faut que vous soyez mariés par licencespéciale… Mais dites-moi, mon cher amour, quel est doncle plat préféré de Mr. Darcy, que je puisse le lui servirdemain !
Voilà qui ne présageait rien de bon à Elizabeth pourl’attitude que prendrait sa mère avec le gentleman lui-même. Mais la journée du lendemain se passa beaucoupmieux qu’elle ne s’y attendait, car Mrs. Bennet étaittellement intimidée par son futur gendre qu’elle ne sehasarda guère à lui parler, sauf pour approuver tout cequ’il disait.
Quant à Mr. Bennet, Elizabeth eut la satisfaction de levoir chercher à faire plus intimement connaissance avecDarcy ; il assura même bientôt à sa fille que son estimepour lui croissait d’heure en heure.
– J’admire hautement mes trois gendres, déclara-t-il.Wickham, peut-être, est mon préféré ; mais je crois quej’aimerai votre mari tout autant que celui de Jane.
LXElizabeth, qui avait retrouvé tout son joyeux entrain,
pria Mr. Darcy de lui conter comment il était devenuamoureux d’elle.
– Je m’imagine bien comment, une fois lancé, vousavez continué, mais c’est le point de départ qui m’intrigue.
– Je ne puis vous fixer ni le jour, ni le lieu, pas plus quevous dire le regard ou les paroles qui ont tout déterminé.Il y a vraiment trop longtemps. J’étais déjà loin sur laroute avant de m’apercevoir que je m’étais mis enmarche.
– Vous ne vous faisiez pourtant point d’illusion sur mabeauté. Quant à mes manières, elles frisaient l’impolitesseà votre égard, et je ne vous adressais jamais la parole sansavoir l’intention de vous être désagréable. Dites-moi, est-ce pour mon impertinence que vous m’admiriez ?
– Votre vivacité d’esprit, oui certes.
– Appelez-la tout de suite de l’impertinence, car cen’était guère autre chose. La vérité, c’est que vous étiezdégoûté de cette amabilité, de cette déférence, de cessoins empressés dont vous étiez l’objet. Vous étiez fatiguéde ces femmes qui ne faisaient rien que pour obtenir
votre approbation. C’est parce que je leur ressemblais sipeu que j’ai éveillé votre intérêt. Voilà ; je vous ai épargnéla peine de me le dire. Certainement, vous ne voyez rien àlouer en moi, mais pense-t-on à cela, lorsqu’on tombeamoureux ?
– N’y avait-il rien à louer dans le dévouementaffectueux que vous avez eu pour Jane lorsqu’elle étaitmalade à Netherfield ?
– Cette chère Jane ! Qui donc n’en aurait fait autantpour elle ? Vous voulez de cela me faire un mérite à toutprix ; soit. Mes bonnes qualités sont sous votreprotection ; grossissez-les autant que vous voudrez. Enretour, il m’appartiendra de vous taquiner et de vousquereller le plus souvent possible. Je vais commencer toutde suite en vous demandant pourquoi vous étiez si peudisposé en dernier lieu à aborder la question ? Qu’est-cequi vous rendait si réservé quand vous êtes venu nousfaire visite et le soir où vous avez dîné à Longbourn ?Vous aviez l’air de ne pas faire attention à moi.
– Vous étiez grave et silencieuse, et ne me donniezaucun encouragement.
– C’est que j’étais embarrassée.
– Et moi de même.
– Vous auriez pu causer un peu plus quand vous êtesvenu dîner.
– Un homme moins épris en eût été capable sansdoute.
– Quel malheur que vous ayez toujours une réponseraisonnable à faire, et que je sois moi-même assezraisonnable pour l’accepter ! Mais je me demandecombien de temps vous auriez continué ainsi, et quandvous vous seriez décidé à parler, si je ne vous y avaisprovoqué ? Mon désir de vous remercier de tout ce quevous avez fait pour Lydia y a certainement beaucoupcontribué, trop peut-être : que devient la morale si notrebonheur naît d’une promesse violée ? En conscience, jen’aurais jamais dû aborder ce sujet.
– Ne vous tourmentez pas : la morale n’est pascompromise. Les tentatives injustifiables de ladyCatherine pour nous séparer ont eu pour effet de dissipertous mes doutes. Je ne dois point mon bonheur actuel audésir que vous avez eu de m’exprimer votre gratitude,car le rapport fait par ma tante m’avait donné de l’espoir,et j’étais décidé à tout éclaircir sans plus tarder.
– Lady Catherine nous a été infiniment utile, et c’estde quoi elle devrait être heureuse, elle qui aime tant àrendre service. Aurez-vous jamais le courage de luiannoncer ce qui l’attend ?
– C’est le temps qui me manquerait plutôt que lecourage, Elizabeth ; cependant, c’est une chose qu’il fautfaire, et si vous voulez bien me donner une feuille depapier, je vais écrire immédiatement.
– Si je n’avais moi-même une lettre à écrire, jepourrais m’asseoir près de vous, et admirer la régularitéde votre écriture, comme une autre jeune demoiselle le fit
un soir. Mais, moi aussi, j’ai une tante que je ne dois pasnégliger plus longtemps.
La longue lettre de Mrs. Gardiner n’avait pas encorereçu de réponse, Elizabeth se sentant peu disposée àrectifier les exagérations de sa tante sur son intimité avecDarcy. Mais à présent qu’elle avait à faire part d’unenouvelle qu’elle savait devoir être accueillie avecsatisfaction, elle avait honte d’avoir déjà retardé de troisjours la joie de son oncle et de sa tante, et elle écrivit sur-le-champ :
« J’aurais déjà dû vous remercier, ma chère tante, devotre bonne lettre, pleine de longs et satisfaisants détails.À vous parler franchement, j’étais de trop méchantehumeur pour écrire. Vos suppositions, alors, dépassaientla réalité. Mais maintenant, supposez tout ce que vousvoudrez, lâchez la bride à votre imagination, et, à moinsde vous figurer que je suis déjà mariée, vous ne pouvezvous tromper de beaucoup. Vite, écrivez-moi, et dites delui beaucoup plus de bien que vous n’avez fait dans votredernière lettre. Je vous remercie mille et mille fois de nepas m’avoir emmenée visiter la région des Lacs. Quej’étais donc sotte de le souhaiter ! Votre idée de poneysest charmante ; tous les jours nous ferons le tour du parc.Je suis la créature la plus heureuse du monde. Beaucoup,sans doute, ont dit la même chose avant moi, mais jamaisaussi justement. Je suis plus heureuse que Jane elle-même, car elle sourit, et moi je ris ! Mr. Darcy vousenvoie toute l’affection qu’il peut distraire de la part quime revient. Il faut que vous veniez tous passer Noël à
Pemberley.
« Affectueusement… »
La lettre de Mr. Darcy à lady Catherine était d’unautre style, et bien différente de l’une et de l’autre futcelle que Mr. Bennet adressa à Mr. Collins en réponse à sadernière épître.
« Cher monsieur,
« Je vais vous obliger encore une fois à m’envoyer desfélicitations. Elizabeth sera bientôt la femme de Mr.Darcy. Consolez de votre mieux lady Catherine ; mais, àvotre place, je prendrais le parti du neveu : des deux,c’est le plus riche.
« Tout à vous.
« BENNET. »
Les félicitations adressées par miss Bingley à son frèrefurent aussi chaleureuses que peu sincères. Elle écrivitmême à Jane pour lui exprimer sa joie et lui renouvelerl’assurance de sa très vive affection. Jane ne s’y laissa pastromper, mais cependant elle ne put s’empêcher derépondre à miss Bingley beaucoup plus amicalement quecelle-ci ne le méritait.
Miss Darcy eut autant de plaisir à répondre à son frèrequ’il en avait eu à lui annoncer la grande nouvelle, et c’està peine si quatre pages suffirent à exprimer sonravissement et tout le désir qu’elle avait de plaire à safuture belle-sœur.
Avant qu’on n’eût rien pu recevoir des Collins, leshabitants de Longbourn apprirent l’arrivée de ceux-cichez les Lucas. La raison de ce déplacement fut bientôtconnue : lady Catherine était entrée dans une telle colèreau reçu de la lettre de son neveu que Charlotte, qui seréjouissait sincèrement du mariage d’Elizabeth, avaitpréféré s’éloigner et donner à la tempête le temps de secalmer. La présence de son amie fut une vraie joie pourElizabeth, mais elle trouvait parfois cette joie chèrementachetée lorsqu’elle voyait Mr. Darcy victime del’empressement obséquieux de Mr. Collins. Darcysupporta cette épreuve avec un calme admirable : il putmême écouter avec la plus parfaite sérénité sir WilliamLucas le féliciter « d’avoir conquis le plus beau joyau de lacontrée », et lui exprimer l’espoir « qu’ils seretrouveraient tous fréquemment à la cour ». S’il luiarriva de hausser les épaules, ce ne fut qu’après le départde sir William.
La vulgarité de Mrs. Philips mit sans doute sa patienceà plus rude épreuve ; et quoique Mrs. Philips se sentît ensa présence trop intimidée pour parler avec la familiaritéque la bonhomie de Bingley encourageait, elle ne pouvaitpas ouvrir la bouche sans être commune, et tout lerespect qu’elle éprouvait pour Darcy ne parvenait pas àlui donner même un semblant de distinction. Elizabeth fitce qu’elle put pour épargner à son fiancé de tropfréquentes rencontres avec les uns et les autres ; et sitout cela diminuait parfois un peu la joie de cette périodedes fiançailles, elle n’en avait que plus de bonheur àpenser au temps où ils quitteraient enfin cette société si
peu de leur goût pour aller jouir du confort et del’élégance de Pemberley dans l’intimité de leur viefamiliale.
LXIHeureux entre tous, pour les sentiments maternels de
Mrs. Bennet, fut le jour où elle se sépara de ses deux pluscharmantes filles. Avec quelle satisfaction orgueilleuse elleput dans la suite visiter Mrs. Bingley et parler de Mrs.Darcy s’imagine aisément. Je voudrais pouvoir affirmerpour le bonheur des siens que cette réalisation inespéréede ses vœux les plus chers la transforma en une femmeaimable, discrète et judicieuse pour le reste de sonexistence ; mais il n’est pas sûr que son mari auraitapprécié cette forme si nouvelle pour lui du bonheurconjugal, et peut-être valait-il mieux qu’elle gardât sasottise et ses troubles nerveux.
Mr. Bennet eut beaucoup de peine à s’accoutumer audépart de sa seconde fille et l’ardent désir qu’il avait de larevoir parvint à l’arracher fréquemment à ses habitudes.Il prenait grand plaisir à aller à Pemberley, spécialementlorsqu’on ne l’y attendait pas.
Jane et son mari ne restèrent qu’un an à Netherfield.Le voisinage trop proche de Mrs. Bennet et descommérages de Meryton vinrent à bout même ducaractère conciliant de Bingley et du cœur affectueux de lajeune femme. Le vœu de miss Bingley et de Mrs. Hurstfut alors accompli : leur frère acheta une propriété toute
proche du Derbyshire, et Jane et Elizabeth, outre tantd’autres satisfactions, eurent celle de se trouverseulement à trente milles l’une de l’autre.
Kitty, pour son plus grand avantage, passa désormaisla majeure partie de son temps auprès de ses sœursaînées. En si bonne société, elle fit de rapides progrès, et,soustraite à l’influence de Lydia, devint moinsombrageuse, moins frivole et plus cultivée. Ses sœursveillèrent à ce qu’elle fréquentât Mrs. Wickham le moinspossible ; et bien que celle-ci l’engagea souvent à venir lavoir en lui promettant force bals et prétendants, Mr.Bennet ne permit jamais à Kitty de se rendre à sesinvitations.
Mary fut donc la seule des cinq demoiselles Bennet quidemeura au foyer, mais elle dut négliger ses chèresétudes à cause de l’impossibilité où était sa mère de resteren tête-en-tête avec elle-même. Mary se trouva doncforcée de se mêler un peu plus au monde ; comme cela nel’empêchait pas de philosopher à tort et à travers, et quele voisinage de ses jolies sœurs ne l’obligeait plus à descomparaisons mortifiantes pour elle-même, son père lasoupçonna d’accepter sans regret cette nouvelleexistence.
Le mariage de Jane et d’Elizabeth n’amena aucunchangement chez les Wickham. Le mari de Lydiasupporta avec philosophie la pensée qu’Elizabeth devaitmaintenant connaître toute l’ingratitude de sa conduite etla fausseté de son caractère qu’elle avait ignorées jusque-là, mais il garda malgré tout le secret espoir que Darcy
pourrait être amené à l’aider dans sa carrière. C’était toutau moins ce que laissait entendre la lettre que Lydiaenvoya à sa sœur à l’occasion de ses fiançailles :
« Ma chère Lizzy,
« Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vousaimez Mr. Darcy moitié autant que j’aime mon cherWickham, vous serez très heureuse. C’est une grandesatisfaction que de vous voir devenir si riche ! Et quandvous n’aurez rien de mieux à faire, j’espère que vouspenserez à nous. Je suis sûre que mon mari apprécieraitbeaucoup une charge à la cour ; et vous savez que nosmoyens ne nous permettent guère de vivre sans un petitappoint. N’importe quelle situation de trois ou quatrecents livres serait la bienvenue. Mais, je vous en prie, nevous croyez pas obligée d’en parler à Mr. Darcy si celavous ennuie.
« À vous bien affectueusement… »
Comme il se trouvait justement que cela ennuyaitbeaucoup Elizabeth, elle s’efforça en répondant à Lydia demettre un terme définitif à toute sollicitation de ce genre.Mais par la suite elle ne laissa pas d’envoyer à sa jeunesœur les petites sommes qu’elle pouvait prélever sur sesdépenses personnelles. Elle avait toujours été persuadéeque les modestes ressources du ménage Wickhamseraient insuffisantes entre les mains de deux êtres aussiprodigues et aussi insouciants de l’avenir. À chacun deleurs changements de garnison, elle ou Jane se voyaitmise à contribution pour payer leurs créanciers. Même
lorsque, la paix ayant été conclue, ils purent avoir unerésidence fixe, ils continuèrent leur vie désordonnée,toujours à la recherche d’une situation, et toujoursdépensant plus que leur revenu. L’affection de Wickhampour sa femme se mua bientôt en indifférence. Lydia, elle,lui demeura attachée un peu plus longtemps, et, en dépitde sa jeunesse et de la liberté de ses manières, saréputation ne donna plus sujet à la critique.
Quoique Darcy ne pût consentir à recevoir Wickham àPemberley, à cause d’Elisabeth, il s’occupa de sonavancement. Lydia venait parfois les voir, lorsque sonmari allait se distraire à Londres ou à Bath. Mais, chez lesBingley, tous deux firent de si fréquents et si longs séjoursque Bingley finit par se lasser et alla même jusqu’àenvisager la possibilité de leur suggérer qu’ils feraientbien de s’en aller.
Miss Bingley fut très mortifiée par le mariage deDarcy ; mais pour ne pas se fermer la porte dePemberley, elle dissimula sa déception, se montra plusaffectueuse que jamais pour Georgiana, presque aussiempressée près de Darcy, et liquida tout son arriéré depolitesse vis-à-vis d’Elizabeth.
Georgiana vécut dès lors à Pemberley, et son intimitéavec Elizabeth fut aussi complète que Darcy l’avait rêvée.Georgiana avait la plus grande admiration pour sa belle-sœur, quoique au début elle fût presque choquée de lamanière enjouée et familière dont celle-ci parlait à sonmari. Ce frère aîné qui lui avait toujours inspiré unrespect touchant à la crainte, elle le voyait maintenant
taquiné sans façon ! Elle comprit peu à peu qu’une jeunefemme peut prendre avec son mari des libertés qu’unfrère ne permettrait pas toujours à une sœur de dix ansplus jeune que lui.
Lady Catherine fut indignée du mariage de son neveu ;comme elle donna libre cours à sa franchise dans saréponse à la lettre qui le lui annonçait, elle s’exprima entermes si blessants, spécialement à l’égard d’Elizabeth,que tout rapport cessa pour un temps entre Rosings etPemberley. Mais à la longue, sous l’influence d’Elizabeth,Darcy consentit à oublier son déplaisir et à chercher unrapprochement ; après quelque résistance de la part delady Catherine, le ressentiment de celle-ci finit par céder,et, que ce fût par affection pour son neveu ou par curiositéde voir comment sa femme se comportait, ellecondescendit à venir à Pemberley, bien que ces lieuxeussent été profanés, non seulement par la présenced’une telle châtelaine, mais encore par les visites de sesoncle et tante de la cité.
Les habitants de Pemberley restèrent avec lesGardiner dans les termes les plus intimes. Darcy, aussibien que sa femme, éprouvait pour eux une affectionréelle ; et tous deux conservèrent toujours la plus vivereconnaissance pour ceux qui, en amenant Elizabeth enDerbyshire, avaient joué entre eux le rôle providentiel detrait d’union.
FIN
À propos de cette éditionélectronique
Texte libre de droits.
Corrections, édition, conversion informatique etpublication par le groupe :
Ebooks libres et gratuits
http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits
Adresse du site web du groupe :http://www.ebooksgratuits.com/
—
Novembre 2009
—
– Élaboration de ce livre électronique :
Ce livre électronique est le fruit de la collaboration deWikisource – http://fr.wikisource.org/ et de Ebookslibres et gratuits.
Ont participé à l’élaboration de ce livre :
Pour Wikisource, Sapcal22.
Pour Ebooks libres et gratuits, Jean-Marc, MartineA,Coolmicro et Fred.
– Dispositions :
Les livres que nous mettons à votre disposition, sontdes textes libres de droits, que vous pouvez utiliserlibr e me nt , à une fin non commerciale et nonprofessionnelle. Tout lien vers notre site estbienvenu…
– Qualité :
Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leurintégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelonsque c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nousessayons de promouvoir la culture littéraire avec demaigres moyens.
Votre aide est la bienvenue !
VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRECES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.
{1} Chevalier.{2} Reel : danse écossaise.{3} Disposition par laquelle un domaine, à défaut
d’héritier mâle, passe à une autre branche de la famille.{4} En français dans le texte.{5} Gretna Green : village à la frontière de l’Écosse où
se célébraient les mariages clandestins.{6} Licence spéciale : dispense accordée par
l’archevêque de Cantorbéry, permettant la célébrationd’un mariage, sans publication de bans, à des jours et dansdes lieux autres que ceux généralement autorisés.