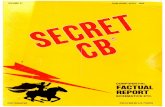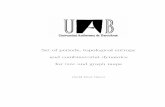Farming in mediterranean France and rural settlement in the late roman and early medieval periods:...
Transcript of Farming in mediterranean France and rural settlement in the late roman and early medieval periods:...
THE MAKlNG OF FEUDJ\L _AGRICULTURES?
EDITED.IlY
:MIQUEL BARCELÔ
1 1 1 t
BRIULEIDEi\i · BbSTON
2004
. .
' '
FRAt"!ÇOIS SIGAUT
f_AR_l\IIING IN lVIEDITERI<.A.NEAN FRAi'{CE A.ND RURAL SETTLEivlENT ·Il~ THE LATE ROMAi\T AND EARLY WlEDIEV AL PERIODS: THE CONTRIBUTION FROJV( ARÇHAEOLOG:( A!."''D El'WIRO:N"MENT,AL SCIE.l~CES
li~ THE LAST T'WENTY YEARS (1980-2000)
Aline Durand and Philippe Leveau*
Introduction
From the .end of the l 9tl1 C, Fr~rich historiography has studied the period spanning the 5th-lOth C essentially along politic~l and insti-
. tutional lines. For Southern Frflllce, the sum of available information allows a brief overview. TI1e Province of Gallia .Narbonensis, created as a single administrative unit during ~e early RoiD;an Empire, was fust split up, as a result of Diocletian's reforms, at t:'le ei)..d of the 3rd C. These reforrns leçl to the creation of three new provinces: the Primary Narbonnaises (Narbonensis Prima comprising NJ:lTbonne,. Béziers, Nîmes, Lodève, Uzès, Agde and lVIaguelonne), the Secondary Narbonn~es (Narbonensis Seconda with Aix-en-Provence, Apt, Riez, Fréjus, Gap, Sisteron, Antibes) in between.which the Provincia Viennensis were inserted (the southcrn part of the latter, ... comprising .Valence, Die, St-Paul-Trois-Châteaux, Vaison, Ora.."lge, Cavaillon, Avignon, Arles, Mar~eille, Carpentras being of in te rest here) (Rivet 1988). But the real divisions stem from the splitting up of the Roman Empire following the military crisis that · ensued from the massive influx -of Germanie peoples, Visigotl1s in the South, Burgundians in the North, into the former Province. New political entities were formed through the settlem~nt of immigrants and through the gradu.al merging of t~e old Gallo-Roman population -vvith the newcomers: Septimania and Provence on either side of the Rhône valley. Even though from the' e;nd of the 5th. C the Francs achieved the unity of Gaul within the Frankish kingdom ând later v,rithin ilie Carolingia~ Empire by removing Provence from the Burgundian kingdom, the two regions-
* Aline Durand, LAl\IIM, M!.YISJI, BP 647, F. 13094 Aix-en-Provence Cede.'<: 2, [email protected]. Philippe Leveau, CC], NlN!SH, BP 647, F. 13094 Aixen-Provence Cedex 2, [email protected]
178
-
.....1
..:(
~
Il.. r--. ...... z (/)
LI.l (/)
()
< ~
ALThlE DURA.~ AND PHILIPPE LEVEAU
Î ~\].
1 ~
~, ......... __ \ \ " . \ \.- ....... ~.,;l.
\ 1
1 1
1 1
(
~
? ~
0 ~
-p
-.:>'
~ " 1 ~-
Â-(..)
.).
.! .. '1 .,
. • J
1.
. '
i .
FARt'VliNG IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 179
Provence and Septimania-nevertheless remain peripheral to these political developments. The dissolution of the Carolingian Empire after 822 AD resulted in the birth of two new feudal principalities: the county of Provence torn between its allegiance to the Carolingians on the one band and the Burgundians who for a century considered Provence as a territory ripe for conquest on the other hand, and the marguisate of Gothia.
By contrast, the history of farming during this 'period of transition' between the Roman Empire and the Middle Ages is rarely studied for itself. Several reasons can explain this situation. Amongst the main reasons figures the dirth of written documents even in a region generally better served than others. A number of written sources of considerable interest exist for the period of the end of the Roman Empire. Sorne, like the Theodosian code refer to the whole of the Empire. The imperial legal texts that it contains are to be used with caution, as illustrated by the debate surrounding the meaning of the expression agri deserti. This expression, coined for taxation purposes (Whittaker 1976), cannot be used to describe a real situation in settlement archaeology. Other texts provide local information, such as that given in the works of Gregory of Tours or Sidonius Apollinaris, or in Visigothic documents or in the Lives of Saints. On the other hand, descriptive or financial accounts, compiled primarily for military or taxation purposes do not appear until the 7th and 8th C with the two polyptychs of Waldade and Ansefred, advocatus of the Bishop of Béziers. At the very end of the 8th C royal and imperial proclamations of gifts or confirmations throw sorne light on rural Languedoc and Provence. It is only in the second half of the 1 Oth C that diplomatie acts begin to form series coherent enough to shed light upon agricultural systems. Even so, the interpretation of these sources encounter problems, .in particular of vocabulary. Thus it is hard to elicit the meaning of such key terms as amtrum (ard or plough) or frumentum (winter or spring cereals). To obtain a more complete picture of agricultural regimes, one must therefore turn to archaeology. But here the medieval period is less easily legible on the ground than the late Roman period: in surveys greater use of lime in masonry and the better quality of pottery favour the Roman period in comparison with the Early Middle Ages whose remains are difficult to trace. Therefore the Roman period is overrepresented in relative terms. This bias is largely illusory but it combines with a miserabilist school of interpretation of often tenuous
180 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
remains to reinforce the image of a period of decline experienced by the second part of the first millennium AD.
Sorne twenty years ago, ]. Chapelot and R. Fossier berated the Mediterranean coast as the one region of Europe where,-with sorne notable exceptions, amongst which Provence-archaeological research in the rural environment was least advanced (Chapelot and Fossier 1980, 70). In fact, from that rime onwards a fundamental change in the attitude of archaeologists was beginning to take shape and is at the origin of much recent progress. P.-A. Février was ah-eady drawing attention, in the 1970s, to the strength of new research on settlement and population patterns, a research area he was particularly keen to encourage (Février 1978) and which he reviewed in the catalogue of the exhibition Premiers temps chrétienS en Gaule méridionale (Février 1986) At the same time, the traditional historical view of the Early Middle Ages as a Dark Age where people, driven to despair by recurrent famines due to very poor if not basic farming pracrices, were resorting to cannibalism was being challenged at the Flar.an colloquium (1992). The way was open to a new more sophisticated reading of the documents and to a better integration of archaeological research, which itself was in the process of reorientatiqn. These developments allow the breaking clown of barriers between fields of research formerly artificially segmented into insritutionalised chronological compartments. They open . new paths which an increasing number of researchers are eager to take and, at present, the Ministry of Culture actively promotes archaeological research on the periods under discussion.
By definition, agriculture aims to model, adapt and transform a natural milieu to produce plant and animal products. The milieu under consideration corresponds to Mediterranean France, that is to say three old French provinces, Provence, Languedoc and Roussillon. Climate and soils, conditioning the development of agricultural regimes, are two key elements in the reading of the evidence and are used to define a sector whose northern limit is given by botanists and plant geographers as the limit of the spread of the olive tree, the mythical tree of Mediterranean civilisation. T emperate Winters, hot and dry summers contribute to unite a regi.on topographically very varied or even divided on either si de of the Rhône: to the \AT est plains and plateaux predominate and to the East basins and mountains of middle altitude prevail. As always in .l\1editerranean countries, the major characteristic is. not so much the amount of annual
..
1
FARiviiNG IN MEDITERRANEAN FRANCE A.ND RURAL SETTLEMENT 181
rainfall-in the Camargue 450 mm, in Nice 7 50 mm-but the arid conditions of the summer, necessitating irrigation and rendering cattle production very difficult.
17ze milieu and LandscajJe 4Jnamics
The question of the milieu has grown in importance during the last few years, particularly in archaeological studies of historical periods. By reinstating archaeological sites into their geomorphological and sedimentological context, soil scientists and geomorphologists have drawn the attention of archaeologists to the role of the climate in the destntction or post-depositional history of archaeological sites. A strictly deterministic approach showed its limitations and led to misinterpretations. Nevertheless, natural elements and processes have an influence upon the f6rrnation of land and their exploitation: stable, even inert or stagnating periods are followed by phases of innovation where technical advances or social and economie stniCtures cross new thresholds. That is why we shall consider in sorne detail the results of an approach that can increase our understanding of agricultural activities and farming practices.
17ze question of general climate change
It is generally accepted that the end of the Roman Empire saw a major deterioration in elima te · which contributed to depress living conditions and may have played a key role in the onset of an economie decline (Provost 1984). This correlation needs to be re-examined in the light of recent advances in our knowledge of climatic history, made possible through new dàting methods such as radiocarbon dating and dendrochronology (Magny and Richard 1992). Historians have in the past tended to use the work of natural scientists to dress up 'scientifically' a tradition strongly anchored in a messianic vision of early Christianity: the notion of a God-inflicted worsening of conditions in retribution for the sins of humanity was in tune with its time. Even though historie thinking has become more secular, historians have continued to see climate change as one of the factors in the decline of the Roman Empire: the consequent deterioration of living conditions would have been one of the causes for the great migrations. It is therefore necessary to review briefly the
182 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
subject, while underlining the relative nature of the term 'worsening' since we are dealing with a particular Mediterranean climatic zone 'IA·here farming regimes are bound by heat and summer droughts, Obviously a drop in the mean temperature or an increase in rainfall do not have the same effect as in more northerly regions.
Collaborative research carried out by archaeo1ogists, historians and environmentalists give a more trustworthy and subtle image of climatic conditions, that is to say the climatic context. Since written documents can only be used from 1396 AD (Alexandre 1987), when continuous and homogeneous series of records begin, a multidisciplinary approach is necessary. The data gathered refer to temperature and rainfall, i.e. two of the three parameters that de:fine 'the climate'; they were collected in the main along the northern margins of our study area. In brief, palaeoclimatologists have identi:fied a cooling phase named 'Goschenen II' which begins in the 3rd C and resulted in an advance of alpine glaciers at its peak in the 5th to 7th C. This cooling period be gan in the Danube regions and the Alps in the first half of _ the 4th C and continued with the advance of glaciers around the middle of the 5th C. The drop in summer temperatuxe is estimated to be in the orcier of l degTee C and heralded the end of better climatic conditions which had enabled the spread of certain plants such as, in particular, the grapevine (Patzelt 1994). This sequence of events seems to be confirmed by observations made on the level of lakes in the Jura and subalpine regions (Magny 1992) and on tree-ring growth of larch trees (Serre 1979). This phase corresponds to a period of coastal erosion resulting in a rise of the sea level along the North Sea coast between 250 and 700 AD (formerly named 'the second Dunkirk transgression'). A general warming period, coincidental with the Middle Ages proper, foll0wed this cooler period. A small 'elimatic optimum', peaking around 1000 AD continued until the l4th C, which saw the onset of the Little l ee Age. These are of course general trends which, depending on the regions, can have greater or lesser effects upon agricultural production, the subject of our investigations. Particular caution is needed since the Mediterranean climate affecting our region is itself a climate of transition. This question has recently been addressed by tl1e pollen specialist G. J alut. His work shows that the Mediterranean climate developed gradually in the western Mediterranean during the Holocene period along a north-south latitude. According to Jal ut, a change in the annual distribution of rainfal1 which resulted in the pattern of summer droughts characteristic
FARMING IN MEDITERRA...l\ŒAN FRANCE AND RURAL SEITLEMENT 183
of the Mediterranean climate took place between 3300 and 1000 B.P in a latitude zone located between 40° and 44° (northern latitude), i.e. in our study area (Jal ut et alii, 1997). The onset of summer droughts in the Golfe du Lion is dated to 2600-1900 B.P. (2850-1630 caL B.P .) (Jal ut et alii, 2000) (contra: Pons and Quezel 1998). In the Languedoc and Roussillon, the climate sequence has been refined thanks to a series of measurements on the variation of o13C carried out on Med.iterranean deciduous oak charcoal from prehistorie and historie contexts (Vernet et alii, 1997). Indeed if the weather is too dry, plant stomata close up, inhibiting the exchange of gas through photosynthesis, i.e the fixing of carbon in lignite, the constituent of living wood. Although further observations are needed, these results already point to a date around 3000 B.P. for the greatest extent of summer droughts. The construction of a Holocene curve of variations in the isotope Of oxygen 018Ü from stalagmiteS in the cave of Clamouse near St-Guilhem-le-Désert in the middle valley of Hérault (MacDermott et al. 1999) also reveals the return to warmer and/ or drier climatic conditions-without it being possible to determine which-from around 3000 B.P.: the correlation between the isotopie variations and the behaviour of stalagmites is particularly well documented in this cave and therefore an interpretation along climatic lines is permissible.
These hypotheses must be compared with observations that suggest that during the Roman period rainfall patterns were more regular. For the northern Alps and the Jura, it is now possible to consult the work carried out on the lakes of the Jura and the lake of Paladru in the department ·of Isère. Archaeological research conducted by M. Collardelle and E. Verdel allow the reconstruction of a climatic sequence dating to the end of the Early Middle Ages. The period preced.ing 1000 AD is characterised by a 'dry' phase which archaeologists suggest ""'as an essential factor in the establishment of a community on the edge of the lake of Paladru (Borel et al. 1996). Work carried out on river levels and on the formation of water basins in the lower Rhône valley has recently extended our understanding of climatic conditions. This research examines rainfall regimes through measuring the river water debit. A combination of morphological, sedimentological and archaeological information has allowed riverine milieux to be better defined in our region. It is only during the transition phase between the late Roman and tl1e Early Medieval period that a major hydraulic crisis, capable of affecting river environments
184 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
in a fundamental way, can be detected. VVhereas during the millennium that comprises the later Iron Age and the Roman period, that is to say the period bracketed between the 5th C BC and the 5th C AD, hydro-sedimentary activity had not caused any major modification of the water courses, the latter underwent, during the three centuries that run from the end of the 5th to the end of the 7th C AD major transformations such as braiding of the water courses or modification to the delta. Noticeable from the end of the Roman period, this development signifies an increase in the liquid and solid volume carried by the water courses and this is undeniably due to a climatic component (Provansal et al. 1999). A wetter climate phase starting around the 2nd C lasted into the beginning of the Middle Ages proper, when conditions became drier again. In a comparative study of the sedimentary stratification from two rock shelters, Fontde-l'Oule near Fontaine-de-Vaucluse in the Rhône valley and Font Juvénal near Carcassonne, J.-L. Brochîer notes a first cold speU around 450-700 AD and a second one corresponding with the Little l ee Age. The lack of sedimentary deposition during a period spanning the 7th to 12th C undoubtedly corresponds, given the palaeoclimatic data, to a temperate period which Brochier ascribes to a 'dry tendency>. Indeed conditions became more humid from the 13th C onwards (Brochier 1983).
Climate) agriculture and the rhythms of erosion
Erosion, which in our time scale refers to superficial erosion, is the physical process where the effects of the climate on the landscape are most readily observable. Rainwash carries sediments towards the bases of slopes which are then built up into river terraces and which are accumulated downstream in river mouths before ending up in marine deposits. These formations depend on petrology and on dimate. In the absence of human intervention, the rhythm of the erosion that affects them (slowing clown or speeding up) depends on two factors that define the climate: rainwater that causes the sediments to move and vegetation that protects soils from the impact of rain and stabilises them on slopes. However, since the beginning of d1e Holocene, one must add anthropogenic causes to climatic causes.
During the last century, f01·esters engaged in d1e fight against torrential rains emphasised the relationship existing between the latter and forest clearances caused by the increase in agricultural exploi-
F:\Rl\!IING IN MEDITE.RR.ANEA!'T FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 185
tation and by the need for fuel. In historie times, but particularly in · the 19th C hillwash had torn from hill ~;lopes and Mediterranean
mountain sides huge arnounts of sediments which built up in lower valleys, coastal plains and deltas. These accounts were corroborated by the work of geomorphologists who had proposed a more subtle analysis of alluvial deposits than those presented in geological maps of the 'recent Quaternari. The late 1960s saw the work of C. VitaFinzi on alluvial valleys around the Mediterranean during the Quaternary. The model that Vita-Finzi put forward gave precedence to natural causes, that is to say the climate (Vita-Finzi 1969). But, following on from the concept of anthropisation, other models have emphasised the social causes of erosion (Ne boit 1991 ). The latter are of great interest to historians enabling them to detect within the rhythms of erosions precious pointers, in regions and periods where documents are rare, to the impact of agricultural systems.
This approach has been followed in Provence since 1985, when research on historie periods by geomorphologists from Aix-en-Provence was conducted in collaboration with archaeologists and historians in the neighbouring hill regions. First, research concentrated on hills to the East of the Etang de Berre, a lagoon formed by the retreating waters of the Holocene: boreholes through sedimentary deposits enabled the rhythms of erosion in the basins of a small number of water courses to be charted. This work has led to the definition of regional rhythms corresponding to developments in agriculture and fluctuations in the climate. A firs t erosion 'crisis' initiated at the beginning of the Subatlantic lasted into the early Iron Age. By contrast, the Roman period is characterised by a very small arnount of sedimentary deposition. Beyond, a second crisis results in the establishment of a second alluvial blanket, noted on the principal river terraces and in the foothills. The Little lee Age and the population explosion of modern times are held jointly responsible for this alluvium (Provansal 1996). In fact the data show a great range of situations giveri by natural factors-petrology and slope-as well as anthropogenic causes. For the massif of the Sainte-Victoire, M. Jorda concludes that 'the sum of erosion during the last two millennia seems modest in spi te of the delicate nature of the milieu and contours seem to have changed little since protohistoric times' (Jorda and Mocci 1997, 227). By contrast, the situation is vastly different in the northern and southern foothills of the Alpilles where detailed research by H. Bruneton (1999) concentrated upon the post-Roman accumulation
186 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
of deposits on archaeological sites. The site of Glanum, located at the base of a talweg and on its northem slope, was fossilised by a sedimentary blanket that could reach a depth of 4 to 5 m. Further, there are colluvial fills which, though not deep, cover most of the piedmont (Bruneton 1999, 150). H . Bruneton reaches the following general conclusion in his study: 'the widespread nature of post-Roman deposits in talwegs and their very frequent association with colluvial pockets represents a new facies which it is possible to attribute to increased pressure of agriculture on slopes, whatever the fluctuations in population or the settlement densities might be' (ibid., 168). However, a detailed picture is a complex one: in the hollows formed on the archaeological site of Saint-Blaise on the western side of the Étang de Berre 'stratigraphy shows rather a series of erosion incidents, separated by episodes of arable land' (Provansal 1996) (Leveau et al. 2001 in press).
One must therefore turn to soil science to extend our understanding in a more refined way. First among such studies were the works of P. Poupet and thenj.-F. Berger who both cooperated with archaeologists. Though following different lines of enquiry the results obtained converge. P. Poupet carried out detailed studies on the nature of the soils of eastern Languedoc, their possible depletion caused by agricultural exploitation, their preservation and the possibility to trace agricultural practices on soils that were subsequently suddenly covered. His research targeted two micro-regions in particular, the Vaunage and the Banks of the Garrigues in the Nîmes area. T he Vaunage consists of a small depression, sorne 10 km from Nîmes and sorne 25 km from the sea. It is drained by a tributary of the Vistre, the Rhôny, which springs to the North-East of the Vaunage and is 12 km long. The region is the subject of a number of investigations into its protohistoric, Roman and medieval past. Whereas it used to be thought, in the 1970s, that the region had been stabilised early on by a system of terrace cultivation dating to protohistoric times (Sapin 1981 ), it became apparent, just as it was becoming apparent elsewhere, that the visible landscape was not an ancient landscape (Ginouvez et al. 1990, 389-393). A section observed near Saint-Dionisy 'shows that before the Roman period the slopes below the oppida of Viou and Nages-les-Castels were stable>. Its cultivation before protohistoric times is discounted. In fact it is after the Roman period that there began a series of soil management cycles and of le\'elling of the slopes (Poupet 1999, 135 and fig. 14b). The effects of erosion vary
-
F ARl'vliNG IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 18 7
tremendously. T hus, whereas shallow Oess than lm thiel<.) deposits smother the foothills of La Liquîère, substantial post-Roman colluvial deposits can be se en at the foot of Roque-de-Vi ou. The se observations have been extended to the eastern fringes of the Garrigues of Nîmes, where P. Poupet has studied the evolution of the slopes and piedmont above the river Vistre. There are of course areas of cover, but on the whole they are not substantial. In certain areas, the level of ancient fields has even been totally stripped.
Further North in the Valdaine, the work carried out by J.-F. Berger has resulted in a series of publications from which we have extracted information concerning the period under study. This billy region is located on the left bank of the Rhône to the East of Montélimar and occupies circa 300 km2
• Drained by two tributaries of the Rhône, the Roubion in the North and the Jabron in the South, it consists of a series of bills and sandstone-marl plateaux with changes in levels ranging from 250 to 450 m. During the H olocene, a very active period of morphogenesis has resulted in a rounded topography. In spite of the continuing erosion of the slopes causing deep alluvium in the talwegs, the sedimentary deposits have become stabilised by a permanent vegetation cover during the second half of the first millennium Ad (Berger 1997, 115-117). For the period spanning the 4th to 1 Oth C the soil, charcoal and mollusc analyses carried out by S. Thiébault and F. Magnin conjure up an open vegetation along forest edges or hedges (Berger 1995, 1 05). By contrast a brown soil formation in the plains and foothills demonstrates that a period of hydrological calm followed a period of greater hydrological activity. But the drainage networks that allow the development of agriculture are abandoned: the data provided by molluscs indicates wet meadows and marshes where fields were once cultivated. A period of several centuries, in which slopes were able to stabilise, allowed the soil cover to become structurally more stable and to reach a high level of organic matter which was to be of benefit to the medieval society that came · to exist after 1 000 AD.
Sedimentary build-up: coastal plains and river terraces
The relatively stable nature of slopes (upland zone) does not preclude substantial sedimentary build-up on major river terraces and on coastal plains Oowland zone). Though of small extent at a regional scale> these deposits are of particular interest to farmers at a local level
188 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
since the grey alluvial soils that make up these surfaces give cultivation sail of good quality, kept fertile by the adjunction of silt from ftooding. Their cultivation presupposes a strong degree of water management. As they are very sensitive to summer droughts, these soils need to be irrigated. It is also necessary to drain them to diminate standing rainwater and to lower the level of the water table. Floocling does no harm provided the ditches that allow floodwaters to recede and stop the water table from rising are kept in good order. During periods of environmental crises, saturation on alluvium quickly results in the abandonment by farmers of low-lying land.
The construction, in 1996, of a new TGV line in the Rhône valley between Valence and Orange allowed new research to be commissioned. These have confirmed the predicted extent of sediments which, since the Roman period, reaches a depth of 1 to 3 rn and even 3.50 rn in the plain of Orange (Brochier 1997, 95). These seclimentary deposits have masked the old 'corrugated iron' land surfaces (id. 94). J.-F. Berger and C. Jung have concentrated on . the hydrological conditions prevailing in these sedimentary deposits and on the relationship between the control of water ftows and agricultural exploitation. They were able to identif)r a stable period dating from the end of the 3rd or early 2nd C BC to the end of the 1 st C AD (Berger et al. 1997, 150), in which a marked slowing clown of alluviation had allowed soils to regenerate. The agricultural conquest of the flood plains took place at the rime of the establishment of the Roman centuriation system of Orange. Later, starting at the end of the l st C, there begins a 'major hydrological crisis' which entails a rise, estimated to be between 50 and 80 cm, in the river beds as weil as an increase in the amount of sedimentation in the southern Tricastin at north of Avignon and in the plain of Orange (3-4 mm per year). From the late 5th and early 6th C to the 7th and 8th C, that is to say during a climatic phase known to have been humid throughout Europe, there are no more controls over water drainage, nor over the disposai of sedimentary deposits, nor over their admixture to arable land: severa! dozen centimetres of floodvvater silt can be seen sealing abandoned ditches. A fallow period begins, a phenomenon whose social nature J.-F. Berger draws attention to. But the hydromorphology of the soüs observed in sections dating to the end of the 2nd C is not irreversible. Between the end of the 3rd and the end of the 5th C the drainage networks connected \·vith the centuriation system are ·restored and enable the control of alluvia-
FARMING IN MEDITERRANEA..~ FRANCE AND RURAL SETILEMENT 189
tion; soil formation is allowed to restart .. H o-vvever, when, from the end of the 5th C, ditches are no longer cleaned out marshes develop. Thus natural factors such as a climatic crisis are compounded by a political crisis. Husbandry would then have grown in importance according to J.-F. Berger.
Information concerning the coastal zone is uneven, in spite of collaborative research between archaeologists and geomorphologists. T o the East of the Rhône, on the lower reaches of the river Argens, research is in its initial stages. T wo borehole sondages, one upstream from the ria, the other 5.2 km to the East, i.e. about half-way from the present coast line, have allowed M. Dubar to propose a provisional reconstruction of the rhythms of growth of the shoreline and of filling up of the ria. He notes the depth of reddish silts eut into by the present river bed. These 4 to 5 rn thick deposits represent reddish clays washed clown from the flanks of the massifs of the Maures and Esterel; erosion has caused an alluvial cone to build up between the 5th C BC and the beginning of our era, which means that 'access to the port of Fréjus has to be provided by an artificial channel' (Fiches et al. 1995, 21 0). But the reconstructions proposed are based on a mathematical mode! which assumes a constant rate of sedimentation taking into account neither fluctuations in climate nor social pressure. Situated between Provence and the Languedoc, the lower Rhône plain and the Camargue have been studied for the light they can shed on the dynamics of the river and the history of the delta. The blanket coverage of al1uvium explains why archaeological distribution maps do not reflect the density of occupation in ancient periods. The effects of fl.ooding and of dynamics specifie to the formation of the delta are compounded. In the plain of Arles, sedimentation is estimated to have grown by c. 2.5 rn since the Roman period outside the areas near river banks where it is obviously deeper. The port of Aigues-Mortes to the west of the Rhône delta was eut off by alluvium from the river during the Middle Ages. T o the West in the Languedoc, the coast is characterised by extensive marshy plains and marshes whose history is linked to the coastal rivers that bring deposits with them. As a result, despite the rise in sea level in the last two millennia (Ambert 1986; Ambert 1995, 432), the sealing off of lagoons is inconsequential when the rivers that flow into them are low but rapid when rivers are high. The difference between two neighbouring stretches of water, the Etang de Thau and the Etang de l'Or (or of Mauguio) illustrates perfectly this state of affairs. At
190 ALll\TE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
present, the Vidourle, a small coastal river of sorne 70 km in length, flows directly into the marshes of the Petite-Camargue. But up to recent times it fl.owed into the Etang-de-l'Or which is now almost completely filled in by the rivers Vidourle, Vistre and Radelle (Ambert 1986). The fragile nature of the marshes and their movements have important implications in terms of salinity and exploitation of natural re sources. Documents from Psalmodi of the 9th and 1 Oth C indicate, through the precision of their descriptions and vocabulary, that there was a clear knowledge of the landscape and of land reclamation at an ancient date. In the ll th C, the Bishop of Maguelonne orders a new salt marsh to be opened to replace the old 'grau sarrasin' whose access had become difficult. Further west the demise of the old port o(Narbonne is linked to the build up of soil by the river Aude: its present volume is estimated to be in the order of 1800 m3 per year (Ambert et al. 1993, 129-130). The present lower course of the river is totally artificial, having been corrected and managed after the ftoods of the 14th C and the great flood of 1 7 55. In ali the cases cited, though the general sequence has been identified, the rhythms of fluctuations have not yet been recognised precisely. The character of the coastal region remains elusive beyond the 17th C, when map evidence becomes available to reconstruct the coastline. The precise impact of the crisis of the 6th and 7th C should become better understood thanks to current research on the· wetland zones and the valley of the Aude, where borehole surveys have been carried out by P. Ambert and by J. Guilaine (1995).
The conditions of farm production
Straddling traditional historical periods, the period spanning the 3rd to the 1 Oth C is split between a dying Roman Empire and a yet unborn Frankish kingdom. This situation bas earned it the definition of an inevitably obscure transition phase, between the high points of two different socio-economic systems. It can therefore neither have its own dynamic nor offer conditions which would favour an expansion in farming. Given the weight that such a historie tradition carries, let us briefty review its main lines. Indeed, gaps in our knowledge have given rise to vast historie narratives, sometimes brilliantly told, which even today still hold sway. They are beginning to be revised in the face of so much contradictory evidence. Two areas are par-
FARMING IN lviEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 191
ticularly significant: on the one hand economie and commercial exchanges which benefit from two interesting data sets, pottery and coin evidence; on the other hand the mastery of energy sources, indicative of the history of technology.
Ex changes
For Henri Pirenne, the great divide in the J\1edieval western world was not the migration of 'barbarian' peoples at the beginning of the 5th C, but the migration of the Saracens: trade and economie relations between East and West would have remained active up to the time of Arab expansion. Muslim piracy would have led to the failure of these relations and the death of the Christian western Mediterranean world. Sometimes taken to extremes, this thesis, which emphasises the break of the 7th C, has been rejected by historians for several decades. In the absence of a great corpus of written documents, recent archaeological research can contribute new information to the economie question. It allows us to qualify over-simplistic schemes by pointing out the complexity of economie phenomena. It also gives the opportunity to approach the question at different levels, in particular local and regional levels.
Pottery, a favoured indicator of change, has been the subject of new studies completely revising the question of the opening of Provence and Languedoc to commercial currents. Paradoxically from the 4th C onwards, ceramic evidence allows us to trace a curve, from a l st C base, which shows increasing exchanges and the number of sites denoted by pottery show that land occupation is at its peak at this time. Cerarnic imports have substantially increased compared to local pottery production. Imports only begin to decline in the 6th C, a century which saw the end of the great Mediterranean market (Février 1986; Raynaud et al. 1990, 289- 299 and 1996). But this decline is not simultaneous everywhere: evidence for solid commercial relationships exists for Marseille up to the 7th C, whereas in Arles or Narbonne they can only be traced up to the 5th C (Villedieu 1986, 182-1 83). Between the 7th and 9th C this trend, identified by A. Parodi and C. Raynaud in their research on the Vaunage (Parodi et al. 1987), is characterised by a change in pottery repertoire where 'grey pottery predominates, pottery forms in the Gallo-Roman tradition disappear and Mediterranean imports cease'. They also note that this trend does not prejudice the intensity of inter-regional relations.
192 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Other recent pottery studies follow sirnilar lines (Lenhardt et alii, 1993). The first truly medieval pottery tradition can only be clearly perceived from the 7th C and 8th C, when regional workshops such as Masmolène start production and prelude the great tradition of regional pottery production that lasted right into modem times. Y et a break in imports and an evolution of indigenous productions does not imply a stable system: mapping of micro-regional distribution zones shows that the Early Medieval economy was not a mere subsistence economy.
The study of coins from excavations has shawn that small and medium coinage continued to be used weil after minting stopped in the Merovingian period: 'numismatists have evidence that the currency which was no longer available to regular administration was nevertheless in use for far longer than could be supposed, at least until the Ostrogothic period' (Brenat 1998, 361 ). Byzantine bronze coinage maked an appearance in Provence and the Languedoc. Ancient coins continue in use · and are copied by overcasting. N evertheless . a break in the monetary economy occured in the 7th C. Copper and bronze were already no longer used at the end of the 6th C. At the end of the following century, around 675-680, the Merovingian mints of Arles and Marseille ceased to mint gold coinage. Silver was left as the only metal used for coinage until the first gold issues of Saint Louis (Brenat 1986, 197~ 199 and 1996, 14 7-160).
The mastery of energy sources
From the oldest (Duby 1962) to the most recent, all the syntheses dedicated to farming in the Early Middle Ages emphasise the poor means at the disposai of the peasantry for cultivating the land: primitive tools, 'hardly any iron', 'poor quality and badly selected stock' (Chapelot and Fossier 1980, 24- 25). Fortunately, archaeology allows a re-evaluation of such notions. The situations that archaeology highlights, in the history of water mills and in the light of more and more frequent finds of metalworking from sites, go against the received notion of a technologically backward period. But this state of a:ffairs does not preclude the upkeep of techniques that go back to the earliest da ys of farming, evidenced by the data on manuring (see below). For the time being, the diversity of real situations is striking.
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 193
The water mill question Recent years have seen much progress in the archaeological identification of water mills> a structure that occupies a key place in the mastery of natural sources of energy. Since the work of M. Bloch (Bloch 1935)> the historiography of mills bas been marked by the notion of a blockage in techniques with a society that relied on slave labour. Mills would only have come into general use during the Middle Ages. Undertaken by F. Benoit during the 1940s, the excavations of the mills of Barbegal near Arles seem to have given
. archaeological credence to such a theory. It appears that the mills were built at the end of the 3rd C and were in use until the end of the 4th C. The dating was based upon observations of building techniques seen on the aqueduct bridges of the valley of the Arcs and on excavated finds, in particular coins. F. Benoit saw the mills in a wider economie and historie context (Benoit 1940). Accordingly, the abandonment of the mills was due to an economie decline following the barbarian invasions. The dating suited social historians and historians of techniques and, quickly, the mills became a symbol: the construction of these mills constituted a response of the Roman economy to the decline of slavery. Unable to force men to carry out work that was considered the hardest of labours, Roman society would have turned to technology and would have tried to substitute human labour with natural energy sources.
New discoveries were to be expected: Palladius recommends the use of the outfiow from bathhouses to drive water mills, a recommendation that would suggest that this sort of arrangement was commonplace in villae (De agricultura I, 41). New excavations at the site of the mills of Barbegal has caused the dating of this structure to be revised: earlier by a century and a half, the construction of the mills goes back to the second quarter of the 2nd C (Leveau 1996). At the same time greater attention given to this type of structure has revealed that mills were more common than once thought. R. Royet had excavated an early Roman mill with vertical wheel outside the baths of the villa of Vernai in Saint-Romain-de-Jalionas to the east of Lyon (Royet 1995 and 1996). In the department of the Var, excavations by M. Borréani and J.-P. Brun have led to the identification of two mills, at the sites of the villae of Mesclans and Laurons at Les Arcs-sur-Argens (Borréani and Brun 1998). In the same region, the site of Saint-Martin at Taradeau provides a good
194 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
example of the transformation of a water basin into a reservoir for a horizontal wheel driven mill (Brun 1999, 770). No doubt the list will grow. Between Arles and Barbegal, at La Calade (Amouric et al. 2000), a rescue archaeology project has led to the discovery of a turbine mill dating to the late Roman period. Similarly at the site of a villa of Vareilles at Paulhan on the Hérault, work on the A75 motorway has unearthed two mills of the lst C AD, superceded by a third, larger mill (Mauné 1999). Similar discoveries have been made elsewhere, in North Africa (Wilson 1995) and in Portugal (Carvalho-Quintela et al. 1999, 214).
In Catalonia and in the Languedoc, where written documents are more frequent than in Provence, the first mentions of mills allow us to put clown sorne pointers to the history of the use of hydraulic energy during the early Middle Ages. In the Roussillon, the distribution of water mills leads S. Caucanas (1987) to conclude that water mills are neither rare nor isolated elements in the Carolingian landscape. Similar results have been obtained in the plains of the Languedoc: there the extremely wide geographie spread of the first mills dated to the 8th-9th C shows that all running water courses, even standing water, were tried and put to use (Durand 200 l ). Current historiography th us asks afresh the question of the appearance of water mills and its spread between the Roman period and the year 1000, by investigating its mechanism and technique in a precise regional context, without generalising by trying to establish a link between the establishment of landlords and farm machinery (Cornet 1999). In this perspective, the question of the chain of elements is of utmost importance; in the end, what use is made of the milled product? The graduai take-over by cereals of the fanners' diet, which took place sorne time between the 5th and 8th C, may provide a partial answer.
Iron metallurgy . Iron is readily found throughout Europe but its frequent association with other metals makes it necessary to purify it in an operation that is technically delicate. Consequently, rural historians traditionally describe the early Middle Ages as a period where iron is scarce and inefficient tools are made mostly of \Yood. This point of view was made popular by G. Duby and has largely contributed to our pessimistic view of rudimentary farming techniques and of a scarcely developed agriculture with a low output of hardly double the seeded input (for each sown grain only one or two grains were harvested) .
FARlVIING IN MEDITERRANEAI'l' FRA.NCE AND RURAL SETTLEMENT 195
This thesis was founded both on historical (Duby 1962, 71- 87) and archaeological sources. Indeed Carolingia·n tax inventories, including the weil known example from Annapes, mention very few iron tools, and up until r ecently, archaeological finds of iron objects or tangible and frequent evidence for ironworking (forges) in the country was rare (Pesez 1991 ). Re-interpretation of polyptychs, in particular southern ones like the Brescia one, shows that iron is indeed present, if not plentiful, and that the traditional view can no longer be held. In the last decade, J.-NL Pesez and other archaeologists have drawn attention to the fact that negative evidence does not necessarily mean a real lack of iron: it could have been collected and reused (Pesez 1991 ). Protohistorians, who tend to propose older dates, go even further: according to them, technical progress goes back well before the N.L.ddle Ages and they suggest the abandonment of the notion that Iron Age tools bad remained at an archaic stage. In a development of an idea put forward by J. Kolendo in respect of Roman agriculture, P. Poupet notes, in the context of the protohistoric site of Ambrussum, that the scarcity of metals is linked to the cycle of re-use and re-shaping of tools (Poupet 1989, 264). Current investigations that follow this avenue of enquiry are leading to a complete reappraisal of traditional opinion. Thanks to rescue archaeology, early medieval settlements are beginning to become better known, when previously knowledge had been confined to just two sites: Larina in the higher Rhône valley in the southern zone and Brébières in the department of Pas-de-Calais in the northern zone. Iron slag, forges, charcoal kilns and other iron scrap are nearly always recovered from rural settlement sites (Bilans archéologiques régionaux).
F. Trément explains in his book on the occupation pattern around Saint-Blaise (on the western side of the Étang de Berre) that, although he took account of iron slag only in the last phases of his survey, his results show that forges and smithies engaged in the manufacture and repair of small agricwtural tools are evident: 34 such sites have been identified. On one of these sites, seven areas of high density of slag coïncide with settlement evidence for a harnlet. In the absence of excavation, this activity cannot be dated precisely, but Trément observes that the greatest part of these sites were occupied in the late Roman period (Trément 1999 a, 195). A few kilometres to the East and · this time in an excavated context, ironworking on the site of la Pousaraque at Gignac has been identified by F. Gateau (1997, 16). These are but a fevv pointers in a re_g1on where remains of
196 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
metalworking are frequent on ancient sites, as is shown by consulting the Archeological Map (Sites and Monuments Records) under the heading 'slag'. Once alerted, it is noticeable that forges or smithies are frequently reported in late Roman settlement or villa excavation reports. Amongst published sites, settlements at Lunel-Viel (Raynaud 1998) or the Camp-de-César at Laudun above the right edge of the Rhône at nord-west of Avignon in the 5th C at least (Goury 1997, 166) or villae sites in their ultimate phases of occupation such as Près-Bas on northern side of the Étang de Thau (Pellecuer 1998}, Sauvian/La Domergue near Beziers (Ginouvez et al. 1998, .182-3), dated to the second half of the 4th C at the earliest, at La Ramière (Maufras et al. 1998, 210-22 1) and Mayran (Buffat and Petitot 1998) in the east of the department of the Gard or at Les Bruns on the south-west side of Mont-Ventoux in Provence. These relatively frequent and recent indications give support to the hypothesis that negative evidence results from a lack of prospection. Thus the small number of slag-producing sites-sorne twenty amongst the 300 surveyed by S. Mauné in the valley of the Hérault-is probably explained as a problem of visibility (Mauné 1998).
Based upon an enormous and painstaking amount of survey that now needs the support of excavated evidence, V. Izard's thesis, dedicated to the Mediterranean Pyrenean mountains, demonstrates masterfully the role of iron prior to the year 1000. By tracing the diffusion of iron and technical advances in the art of tl1e blacksmith, she shows the excellent quality of Catalonian iron and puts forward the idea that iron metallurgy plays a fundamental, hitherto unsuspected but never so clearly illustrated, role in the onset of the medieval process, and this from the Carolingian period onwards. This truly iron based civilisation reveals a new mountain civilisation, an anthropological system based not on pastoralism but on metallurgy (Izard 1999). Such a situation implies that finished metal products are plentiful and exported ail over the South. Similarly, historians and archeologists engaged in the study of castels and 'incastellamento' in the Languedoc, emphasise more and more the control of mines and their chains of production to explain the introduction of certain fortified places and the existence of veritable networks of power. These considerations appear to play a major role in tli.e process of compartmentalisation ('encellulement') of people; underestimated until recentiy (Amado 1977; J ournot 1990, Darnas 1998). This array of indications
- ·~-,.--
'
r
s
1
:l ·' ,,
·) s i ~
~
s t
t
3
f
1
·--
FA.RMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 197
and of com:erging results points to the existence of a very developed and very early mastery of iron craft:Smanship, if not metallurgy. During the 1997 Flaran colloquium dedicated to village craftsmen, the overview by M . Arnoux and the review by C. V erna of the western southern zone endorsed this point of view (Mousnier 2001 ).
Plant environment and agrarian societies
G. Bertrand wrote in 1975 that 'the historie interpretation of the natural world in its relationship with agrarian structures and societies remains the most ill-understood problem, most rarely tackled and above ail most ill-defined in the who le of rural his tory' (Bertrand 197 5, 38). Since, an increasing number of palaeoecological analyses are beginning to restore the ecological dimension within the history of farming societies. Palaeobotanical data allow us to trace in broad lines the anthropisation of the plant landscape, that is to say the opening of the environment to, and the development of species that appear in relation with agriculture and the need for fuel for domestic purposes and for craft or industry. Generally speaking, forest clearance episodes are characterised in pollen assemblages by a fall in the tree pollen curve. But it is yet early days for the construction of a general picture giving the regional fluctuations of such a history of clearance. Indeed, up to now in France, pollen specialists have mainly been interested in older periods and have paid little attention to historie periods, as shown in a survey by Jalut in 1991 (Jalut 1991, 360-1) of sites that have been sampled. Similarly in 1993, M.-C. MarinvalVigne et S. Thiébault (Marinval-Vigne and Thiébault 1996), in their review ·of palaeoecological studies carried out throughout the French territory, note the lack of analytical data, thus prohibiting in-depth syntheses. However, the number of such studies has grown appreciably in the last ten years, though important regions remain on the fringe. The reasons behind such a situation are to be sought partly in the late start of French archaeological research, and partly in the inclination of palaeobotanists to study climate history rather than agritul ture.
The approach adopted here consists of an attempt to sequence written, archaeological and environmental data. Palynologists who have been concerned mainly with environmental change have made
198 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
use of cultural features or agrarian features to date events in pollen sequences, but have rarely used written historical documents. Biologists or scientists have been engaged in research on ancient landscapes, most often within the boundaries of climate research. Inevitably these scholars were led to work with prehistorians, but also with archaeologists and historians studying the more recent past. Amongst leading laboratories, let us mention the 'Laboratoire Paléobotanique, Environnement et Action de l'Homme' at l\fontpellier, the Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie at Marseille and the geomorphologists of the Institut de Géographie and the CEREGE at Aix-en-Provence.
Indicators of cultivation
Palaeoecology no longer contents itself with just providing lists of species for historians or archaeologists: it brings precious information on the character of the vegetation cover which reflects changes in the economie orientation of societies. In principle, these· vegetation dynamics are often regressive in our climates: farmers clear forests or craftsmen exploit them to obtain fuel for heating mines and above all for ovens or furnaces. This evolution is obviously speeded up when the needs of urban markets for farm produce and craftsmen's products greedy in fuel are taken into account. During the Roman period urbanisation increases the need for building materials (timber, lime and fired materials), for heating public baths and for manufacturing pottery vessels.
In the coastal region-an urtstable milieu and therefore sensitive to change--, in Provence, in the lower Rhône valley and in the Languedoc, recent work on charcoal and pollen analyses enable us to follow the sequence of hüman pressure on the vegetation and its effect on the landscape at the end of the Iron Age. At the foot of the massif of the Alpilles, in the Vallée-des-Baux, the Subatlantic phase is characterised by a drop in forest taxa (deciduous oak or pine) and the appearance of cultivated taxa, whose persistence indicates farming activity (Andrieu et al. 2000, 58). This activity, to which V-re shall return la ter, do es not however exclu de the re-growth of forests, though the latter remains difficult to date (Riera i 1.1ora 2000, 369-370). In general, however, palaeoecological data contribute to a more sophisticated image of the region during the early Middle Ages. Of course there is no denying the importance of water nor the impact of the
n )-
l-y h ;t
' ' )
tt e
,f 1.
1
1
s
)
s 1
)
.,
[
T t '
FARMING IN MEDITERRANEA.!~ FRANCE M"'D RURAL SETTLEMENT 199
break in cultivation in the medieval landscape around Arles. The abbey of Montmajour emerges from the· marshes, which its monks manage, like an island (Stouff 1993). Pollen cliagrams do not register any particular vegetational regeneration, probably because of the continuation of an agrarian economy. Bore holes made in the delta of the old Rhône and the current Rhône off the Golfe du Lion by N. Acherki (Acherki 1997) also show, at the same time, an intensification in human activity with almost the same pointers to cultivation as previously. Pinus sp. and Buxus sempervirens, the latter indicative of an open environment, are added to the list of taxa. These sondages add to and mostly support the conclusions reached by N. Planchais in his study of the lagoon site of Marsillargues on the edge of the Etang de Mauguio (or de l'Or) in the Languedoc (Planchais 1982). N. Planchais attributed a first fall in the oak-beech curve, visible in the level of frequency of Fagus in pollen assemblages of the end of the Iron Age, to a first phase of clearance. If the Roman period is unremarkable in the pollen diagram from Marsillargues, the land charcoal spectrum of this period shows an opening up of the environment on the alluvial plains and the immediate surroundings of the sites studied poor in naturally generated forest: forest management, evidenced by coppiced wood, plays an important role (Chabal 1997, 132). A similar situation is shawn further West in the lower valley of the Aude in the sequences of Peyrac and Capestang (Guilaine et alii, 1990) and comparable to the result obtained at Marsillargues and in the Golfe du Lion. They record the same double evolution: a marked decrease in the deciduous oak forest and/ or of the oakbeech woods in favour of Qyercus ilex-coccifera, or Pinus, notably at Peyrac, and in favour of open garrigues or moorland (heathers, cypresses, Buxus) conjoined with an increase in indicators of human activity (Cerealia, Plantago, Artemisia> Juglans, Olea, Vitis).
In the hinterland of the Languedoc, in the coomb of l'Hortus, J.-L. Vernet has followed tl1e establishment of the green-oak caver at the expense of deciduous oak at sorne. rime between the end of the 4th C and the 5th C (Vernet 1973). The palynologist J. RenaultMiskovsky notes that on that site the tree pollen component falls from 22.5% to 7% while Carducaea, Anthemidia and chicory plants are on the increase. An examination of the texture of Q,uercus pubescens reveals that wood from hearths is gathered fi.rst from tightly forested stands and then later from more and more open areas. The activity of smelters requiring wood for their hearths in the vicinity is in this
200 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
case directly responsible for the transformation of the landscape, not for agriculture but for the management of wood resources. This opposition must, however, not be exaggerated.
Since we are dealing with a homogeneous milieu, regional differences can nevertheless be apprehended. In the basin of the Aude, the decrease in mesophilic species is more pronounced and earlier, and, in general, the beginning of woodland clearances takes place more quickly than at Marsillargues, where Cupressacea and Ericacea, indi~ cating open environments, only reach their peak after the early Middle Ages. Thus, to the East of the Hérault, the end of the proto~ historie era and the beginning of the Roman period are marked by a fall in tree pollen, indicating extensive forest clearance. T his state of affairs is to be linked to the proximity of Narbonne, capital of the Roman province, and to a greater degree of regional urbanisation than on the coast of the eastern Languedoc, where the principal Roman centres are located in the interior (Nîmes). The effects of the 6th-7th C crisis are also felt differentially: in the bore holes studied by N. Acherki, the strong presence of weeds betrays an intensification of farming activity from the 7th and 8th C (Acherki 199 7); on the M arsillargues pollen diagram, around the 8th C ( 1300 ± 60 BP), human intervention upon the forest environment is perceived through the rapid decrease in (Luercus pollen of ilex type (including Q ilex and Q coccifera); it denotes an episode of woodland clearance for cultivation. This event is indeed accompanied by the appearance in continuous pollen curves of cultivated taxa: Castanea sp.) ]uglans. sp.) Olea sp., Vztis sp. Coincidentally peaks in Ericacea, Cerealia and a whole series of introduced weeds ali point in the same direction. At Psalmodi (5th-12th C), Mauguio (llth C), and Lunel-Viel (10th-12th C), at east of the Rhône delta, the landscape is cleared of woodland. Mixed oak forest is receding and Aleppo pine plays a major role (Durand 1998, 329- 332). Indeed this species behaves like a veritable stop-gap, re-colonising open areas faster than green oak. At Lunel-Viel, however, there is evidence for the regeneration of oak woodland at the turn betvveen the 4th and 5th C (Raynaud et alii 1990, 318- 326).
All the signais given by the charcoal evidence indicate a strong anthropisation of the milieu from the beginning of the early Middle Ages. On the plain of eastern Languedoc in particular, many intènsive and diversified developments, notably the establishment of archards, have been recognised. Written documents support these findings: the
FAR..\ilNG L"l' MEDITERRA..""'"EAN FRA..'TCE AND RURAL SETTLEMENT 201
flourishing of Benedictine monasteries, of which Psalmodi is a prime example, encouraged by royal and later imperial politics, as well as the establishment of refugee settlers from Spain under a specifie contract, the aprisio, explain that Carolingian forest clearances resulted in bath an agrarian colonisation and an intensification of land ownership. Regional differences exist nevertheless. In the Massif Central, J-L. de Beaulieu, A. Pons and M. Reille have carried out pollen analyses of 88 peat, lake or bog sites, for which 160 C 14 dates were available. This analysis demonstrates that the Gallo-Roman period saw widespread forest clearance which is ascribed to an exploitation of the environment similar to that observable in the l9th C. The re-afforestation that followed began during the 4th C and lasted into the middle of the 9th C (Beaulieu et al. 1988).
The question qf buming
Land clearance is associated with fire, whose place in agriculture is much debated: for a long time this question was tackled by historians as well as botanists and plant geographers only to deplore the erosion, desertification and devastation that ensues. But up to the l9th C, when mechanisation became available, land clearance by fire of moorland, grassland or forests was the only known and used technique to extend the surface of arable land. In the central Pyrenees, detailed studies by J.-P. Métailié on pastoral fire (Métailié 1981) have given back to fire its role as a natural agent in the working of many ecosystems. Yet this role is difficult to characterise in written documents: mentions of the use of fire or ash by ancient agronomists are rare and restricted to stubble or brushwood burning or to the use of ash as fertiliser (Sigaut 1975, 295). Medieval Carolingian sources are completely silent on the subject. Therefore, archaeology is called in to play and develop procedures to apprehend these practices, as has been achieved in N orthern Europe, where pollen analysis of peat bogs makes it possible to date the beginnings of agriculture thanks to burning practices.
Detailed observations on sediments in the V al daine and la ter in the plain of Orange have led J.-F. Berger to question the origin of the fires attested by charcoal which appears on thin section slides prepare cl for rnicromorphological analysis. In the Valdaine, a series of fires is to be linked to burning practi.ces within a pastoral economy. According to Berger, the exploitation of the massifs from the
. .. ··---· ···---···~~.-~--
202 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
4th to the-~ 1 Oth C would have been 'marked by periodic fires and the upkeep of open spaces, where Fruticea plants and dry grassland predominate according to the snail population identified in alluvium at the foot of slopes. The spectra of the burnt vegetation are typified by the absence of oak (Q pubescens) and the frequency of elm, ash, box trees and Rosaceae (Sorbus type), evoking an open forest-edge or hedge environment in the hills and peripheral plateaux' (Berger 1995, 105). Lower clown, in the plain of Orange now bisected by the TGV, further observations could be made on the dual sites of Caderousse-les-Crémades and les-Négades. Sediments recorded 'burning of hedges or forest-edges ', most probably associated with cereal cultivation, whose last phase is dated to the course of the 6th C. In the following two or three centuries, 'traces of human activity are only perceptible in the form of fires of the deciduous oak forest' which is thought to be linked to husbandry (Berger forthcoming).
These observations are made in the framework of a reflexion on 'the role of fire in the techniques used for preparing fields in ancient European agriculture ' pursued by F. Sigaut in his book L)agriculture
. et le feu (Sigaut 1975). He has shown that slash and burn clearance, sail enrichment, manuring, burning of fallow land, moorland and pastures with running fires are specifie agrariap techniques. Those who are seeking their traces in the ground agree on the difficulty in identifying such horizons and in distinguishing them from natural fires or fires started without pastoral or agrarian objectives (Boissinot
. and Brochier 1997, 42-44). Taking into account a elima tic phase typified by a degree of drought at least during the 9th C, J.-F. Berger and S. Thiébault suggest that a natural propensity to fires could have been combined with a period of reorganisation of the agrarian system requiring new land for pastures to be gained (Berger an T hiébault 1997). This suggestion is supported by further palaeoecological data. In the Valdaine (the region of :t\1ontélirnar), the period is characterised by the growth of 'evolved meadow soils', favouring the development of a pastoral economy. Land snail analysis shows that in marl zones marshy ecosystems and water meadows superceded cultivated fields (Berger 1995, 1 03). But confirmation through archaeological data or written sources is needed to validate such a thesis.
Indirect evidence may confirm that land has been cleared by fire. One of the more secure hypotheses is the relationship between burning and certain crops. This is the case of root crops and green crops (Sigaut 1975) 15), and, amongst grasses, buckwheat (Fagopyrum),
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 203
identified for the l\lfiddle Ages at Canet-Saint-Nazaire by N. Planchais (Planchais 1985). It is also the case of sorne ligneous plants. In the Pyrenean part of the department of the Aude, at Pinet, pollen assemblages from a peat bog located at an altitude of 880 rn are marked by a dTop of the oak and beech-fir (Pagus) Abies) count and by a temporary peak in the frequency of Betula. Birch trees, together with aider are pioneer species which recolonise burnt coniferous forests; because germination of the seeds of the former species are stimulated by ashy soils (Sigaut 197 5, 112). At Pinet, pollen-analytical indicators, considered as characterising changes due to the introduction of husbandry (Poaceae) Plantago lanceolata, Chenopodiaceae) support the interpretation that the site is a clearance site: land has been gained from the forest to be tumed into pasture. At the same time, the increase in the frequency of cultivated plants ( Cerealia, Fagopyrum) and weeds (Artemisia and other Compositae) testifies to the establishment of fields (Reille 1991 ). Furthermore burning entails a mineralisation of organic matter which acts as fertiliser and benefits plant growth. F. Sigaut reminds us that 'in experimental clearance trials, Danish archaeologists witnessed the appearance of a characteristic plant population consisting of lanceolate plantain, various composites ( dandelion, daisies, thistles) and sorne species of moss. This situation had also been observed in clearances in the New World, where 'plantain was, to the Indian, the trail of the white man' (Sigaut 1975, 112-113). The results from pollen analysis of the site of Marsillargues also suggest an interpretation along those lines. The pollen sample records the increase of Cupressacea, in particular juniper from the Early l\IIiddle Ages. J unipers are, just like birch, pre-forest bushes establishing themselves on formerly cultivated soils and which lead to the reconstitution of a forest cover and forest soil. In the hinterland and coastal landscapes, a syncopated triennial rotation system of winter cereals and oats has been identified (Durand 1998, 312- 323). By 'syncopated', it is understood that cultivation systems existed within an internai organisation of the landscape without being complete, unlike full rotation systems (R. Fossier). Such a system vvith long fallow periods can only work as an itinerant system on temporarily cleared land. The increase in junipers at Marsillargues in the Early Middle Ages has also been interpreted as direct evidence for an itinerant cereal culture on burnt land.
Such still dispersed results need further evidence. Nevertheless they already show that the slash and burn system that had rendered the
204 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
expansion of societies from the Neolithic onwards possible had not been abandoned during the 5th-12th C. In general histories of agriculture, the Middle Ages are considered to be the period in which heavy ploughing with draught animals is introduced; in lowland zones, this system replaces a system with fallow periods and husbandry, associated with light ploughing with draught animais which existed since at !east the early Roman period (Mazoyer and Roudart 1997, 128). In spatial terms, a general tendency observable at the level of a huge geographical zone does not prejudice the reality of customs that can be apprehended at a micro-regional and even regional level. Indeed, not all landscapes !end themselves to such an evolution and research · emphasises the attachment of peasant communities to trie cl and trusted methods and techniques.
Agricultural production
Comparing archaeological and palaeoecological studies makes it possible to tackle the question of agricultural production in a period where written documents remain rare.
Oil production
Roman oil production was the subject of much attention in the 1980s and was considered to be the major agricultural activity of the province. Cultural reasons dictated such a position: the olive is the plant most closely linked with Mediterranean civilisations. Certainly in modern times it was the case that olives played this major role in Provence. Results from archaeological surveys supported this position, while excavations of production sites allowed the technical characterisation of pressing systems to be undertaken and to evaluate the size of these production sites (Brun 1986). Furthermore, pollen specialists favoured this interpretation. For them, it was expedient to establish a relationship between the increase in the percentage-the 'peak'- of Olea observed in pollen diagrams and the Roman period. As a result, a circular argument developed: pollen analysis was validating a the01-y borrm .. vcd from historians, that is to say the massive increase of oil production in southern Gaul. But, unlike what was happening for wine production, it bas not been possible to pinpoint the existence of an amphora production specificaly for oil: there was
1 ' :
i
FA.RMING IN J.\IIEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 205
no such thing as an oil amphora from the Narbonnaise) whose distribution could be mapped. On the contràry ceramic stuclies emphasised the importance of imports from Spain and Africa. A comparison between production sites in the Narbonnaise and production sites in Africa where large scale buildings are much more frequent was already painting in this direction.
Facts had to be faced: the relative ease with which oil production could be identified in surveys was at the origin. of the overestimated situation. Olive pressing indeed produces characteristic stone equ~pment: large blocks of stone, easily identifiable in surveys, are used as counterweights and for other parts of the presses. The economie importance of oil production in Provence during the Roman period has been re-evaluated since 1990. In pollen diagrams, signs for cultivated Olea are recorded from the end of the Subatlantic without precise dates. This is the case of the pollen sequences of PontsClapets-Fos and Grands-Paluds-de-Fos D20 (Triat-Laval 1978) and of l'Etang-du-Pourra (Laval et al. 1991) on the eastern side of the Rhône delta. The cultivation of olive trees is dated in only one eliagram, that of the Etang-de-Berre (Laval et al. 1991), where its beginning is dated to 1070 ± 70 BP. In the Vallée-de-Baux, evidence for post-Roman periods has been greatly damaged by deep ploughing for rice cultivation. By contrast, on the eastern edge of the plain of Arles at La Calade (Fontvieille)) V. Andrieu has been able to observe in a sequence starting in the 11 th C a very steep rise in the pollen of Olea; reaching a maximum of 6% of the pollen population and testifying to a regional oil production. Olive trees were not absent previously, but the pollen count remains low) although the possibility that olives were cultivated cannot be excluded (Andrieu-Panel et al. a 2000, 353). Ail in all, the zenith of oil production in Southern France is medieval and modern: it is linked to trade with Northern Europe.
In the pollen samples of Marsillargues) of the Golfe du Lion and of the basin of the Aude (Planchais 1982, Acherki 1997, Guilaine et al 1990), olive is recorded as present since the beginning of the pollen sequences, but in a sporadic and fieeting manner. The major cultivation peaks date to the Early lVliddle Ages, around the 8th-9th C) since they post-date the C 14 date of 1300 BP in the eastern lagoons. Charcoal analyses of the sites of Au gery (9th- lOth C), Psalmocli (5th-12th C) and Mauguio ( 1 Oth- 11 th C) endorse these finclings, depicting an alluvial plain where fruit culture, with olives in the first place, occupies an extensive surface. At present, work on fruit
--~ ~----·-· ..
206 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
remains has not yet confirmed these findings, but this is due to the rarity of studies dedicated to the Carolingian period in Mediterranean France (Ruas 1992, 1993). Historical documents of the region do not record an increase in oil production during the 8th-l l th C either, even though olive groves are not unknown. By contrast, the documents show a phase of intensification in farming when fruit trees were planted in the Languedoc landscape from the Il th C onwards: olive graves invade the plateaux, garrigues and sedimentary basins such as the Vatmage. At the beginning of the 12th C, olive production was sufficiently advanced to become a specialist affair: the existence of specialist workers, the olivadors, and a special duty, the olivigarium, suggests an advanced level of technical know-how in olive oil production methods (Durand 1998, 345). In Provence, at least in the region of Arles and in the hinterland of Nice, olive cultivation on a large scale would have to wait until the beginning of the l5th C (Boyer 1991, 14 7, Stouff 1988).
T he increase in surveys has also confirmed that the extent of archaeological remains concerning ancient olive ail production had indeed been overestimated. Oil production is weil attested in the Languedoc (Garcia 1992) and never absent anywhere. But it has left traces mainly on the coast of Provence in the department of the Var and in the Marseille region (Leveau et al. 1991 ). In summary, the data gathered confirm Strabo's report that olive trees were introduced into Southern Gaul via Marseille. The mild winters of coastal Provence explain why remains of olive oil production are more frequent there. Cultivated species of higher yield, introduced by the Greeks of Marseille, probably found better conditions in the department of the Vat than in the lower Rhône area and the Languedoc, areas which can suffer from hard cold spells. The diffusion of olives towards the north and the west would have been constrained by the climate. Indigenous species were adapted to harsher conditions, but their yield would have been less. The historical dimension in this discussion is of fundamental importance. The most likely explanation for the fact that the greatest increase in olive cultivation actually happened during the Little l ee Age must be in the care given to the trees. Economie reasons must have discouraged Roman agronomists from applying to olive production the know-how that they had proven in the care of vineyards. But it cannat be excluded that certain aspects of the l\1editerranean climate which were beneficiai to the growth of cultivated olive trees only appeared in the region during the }.1iddle Ages (Jalut et al. 1997).
....... ~ .-
\
r 1
1
! 1
· 1
l
FARMING LN MEDITERRANEAN FRANCE A.l'ID RURAL SETTLEMENT 207
Wine production
Up to recent years, wine production was known in Gaul through a few written sources that were used by R. Dion to trace the origm of viticulture in a celebrated book (Dion 1959). Archaeological data have com.pletely revolutionised the subject since the 1980s. First, the study of amphorae, in particular that ofF. Laubenheimer, established that wine was exported in specifie amphorae, the so-called 'Gaulish' amphorae. The mapping of amphora kilns has thus made it possible to draw the first maps of the extent of the vineyard in Southern Gaul (Laubenheimer 1992). Its produce was exported northwards towards the borders of Germania and the British Isles. Imports of Gaulish wine are of great importance in Rome up to the 3rd C. And in the East, it is exported as far as India. New ad van ces in archaeological research have been made in the 1990s. On archaeological sites in the Rhône valley, in the Languedoc and in Provence, excavations have revealed production and storage sites. These establishments come in all shapes and sizes. The most important cellars known up to now are th ose of the Mollard at Donzère in the Rhône valley in the department of the Drôme and Rians on the northern side of the Montagne Sainte-Victoire in the department of the Var where the maximum storage capacities are estimated to be in the order of 2,500 hl for 200 dolia (Odiot 1996) and 1,760 hl for 176 dolia (Brun 1999, 599-600) respectively. The discovery of vineyard plantations represents the third and latest phase in research. Taking into account the conqitions that favour the preservation of vineyards in the plain or on lower slopes rather than on hillsides, soil stripping that was occasioned by road or rail (TGV) constntction has brought to light vast surfaces planted with vines (Boissinot 1997) and has caused a new specialism to be born, that of the archaeology of fields (Monteil et al. 1999). Archaeo-botanical studies have sprung from this work, just as for olives and along similar lines; in particular, they allow us to question afresh the botanical basis for the emergence and the growth of viticulture in Gaul. A secure basis would enable us to vindicate or to refine the role of Marseille in relation to the indigenous population (Marinval 1997). On archaeological sites, the study of fruit, charcoal and wood remains mak~s it possible to identify the presence of vines. The pollen of Vitis does not
· get dispersed as widely as that of the olive tree. In the landscape, however, the pollen signature of vines is a constant element of all pollen diagrams: at Embouchac near Lattes, for example, it is one
208 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
of the typical taxa of the Subatlantic (Puertas 1998 and 2000): percentages of up to 16% leave no doubt that this is the cultivated variety and not a wild vine (<2%).
Based on the study of cellars, it used to be thought that wine production saw a slow decline from the 3rd C onwards. But the most recent studies come to refine this view. The association between viticulture and storage space in dolia, a well established feature of Southem Gaul, is not known further North in Northern Gaul, for example in the vineyards of the Mosel. Storage in barrels, whose archaeological identification is extremely difficult, must therefore not be excluded. This is what J-P. Brun proposes for Provence (Brun 1993) and C. Pellecuer for the Languedoc. The latter scholar has established that wine continued to be produced in the Languedoc in the 5th C. It is present already in a villa close to the oppidum of Ensérune, at Nissanlez-Ensérune/Les Fargettes next to Béziers (Pellecuer 1996). But his major work is concerned with the villa of Près Bas at Loupian on the edge of the Etang de Thau (Pellecuer, forthcoming). Presses were installed again on this villa site in the second half of the 4th C, when a storage building was also constructed. Later, at the beginning of the 5th C the residential wing of the villa was rebuilt and extended at the expense of the storage buildings. But wine growing did not disappear. A wine production site has been identified at Bourdou/Port de Loupian, only 2 km from the villa. This new site represents at present the latest known architectural evidence for local wine growing. Palaeoecology and the archaeology of fields con tribu te further findings in the same vein. \!\Tine growing also seems to be documented for the phase 370/425 around the farm site excavated at Les JurièresBasses at Puissalicon 1 0 km from Beziers in the department of Hérault. There, on the other hand, in the phase dated to the second half of the 5th C and early 6th C, Vitis has practically disappeared from the charcoal samp1es (~1auné et al. 1998, 1 08). T he data from the archaeological excavation of fields at Dassargues give similar indica-
. tions. Trenches have been identi:fied as traces of the planting of a vineyard of several hectares dated to the 5th and 6th C.
Archaeological records are silent for the ensuing period. This silence and the lack of texts would suggest a decline in wine growing in Provence as a weil as in the Languedoc. Indeed, testimonies for the existence of vineyards or vine plantations reappear only in the 9thlOth C, with tl1e fust scraps of written documents. First in the urban
r
-:. .. _
FARMING IN !VŒDITERR.ANEA.l'-1' FRANCE Al'.JD RURAL SETTLEMENT 209
zone: in the ancient Roman cities, a hanging vine nearly always gives shade to the domus or the domus cum curte. In the countryside, vineyards are recorded alongside fields in the long lists of goods in villa inventories. However, even though wine culture is well and truly present, it is hard to fa thom its size in the 9th C; but in the 1 Oth C, the growth of viticulture, in particular in the Biterrois, preludes the great growth of the Middle Ages proper, from 930- 960 AD (Bourin-Derruau 1987). Indeed, by means of the plantation con tract, part of the land devoted to growing cereals because vineyards. The extent of vvine growing is also shown by the existence of çmaieuls' and young vines which indicate that the land was freshly put to this use. M. Bourin is convinced by the strength of such a phenomenon, when considering the relationship between the number of occurrences of new vineyards and the total number of vineyards cited in documents. The mobility of land devoted to wine growing, a sign of the vitality of the market, is a further indicator. This increase does not take place on newly cleared land, but on old land in the plain. Vineyards were established in lowland zones, near streams and rivers, on good, humid alluvial land. For a rural farmstead, a manse, two to three vineyards are recorded for 5 to 6 fields (Bourin-Derruau 1987). In the Nîmes chartulary of the 1 Oth C, vineyards form large surfaces of conjoined land. Such popularity, in particular in urban zones, cannot be explained purely by an increase in consurnption. M . Bourin considers the possibility that sorne of the production was ex.ported, but without any supporting evidence. Archaeology is of little help since wine is sold in barrels and no longer in amphorae. Nevertheless, Vitis sp. is recorded in small percentages in charcoal analyses at Psalmodi (8th-12th C), Lunel-Viel (10th-l 2th C) on the western siçle of the Rhône delta and Béziers (13th C), whereas this. taxon is absent from Au gery on the northern Camargue (9th-! Oth C). vVhatever the reason, the growth of the vineyard of the Languedoc around 950 represents a new form of investment, often of a speculative nature since it gives good returns. It resulted in an increase in commercial relations. T his expansion continued through the follm.ving centuries. Th. Sclafert insists on the importance of vineyards in the valley of the Durance (Sclafert 1959). And vines are cultivated in the V al daine · to the east to Montélimar according to charco al analysis.
210 ALINE DURAND AND PHlLIPPE LEVEAU
Cereal production
Identifying cereal cultivation poses a complex problem for archaeologists, similar to that posed by husbandry. Both activities are identified on rural sites by remains linked to the consumption of their endproducts: food refuse, and stone artefacts used for grinding flour. But cereal consumption is at the basis of nutrition; therefore the number of mortars or millstones found on a given site does not permit local production to be estimated. More than for oil and wine, it is necessary to distinguish between two types of production. In the case of a subsistence economy, grain production provides for local consumption. It allows, in second place, to extract surpluses for export. Such a type of production existed in Southern Gaul in the Roman period. At the end of the 2nd C BC, Marius had to import wheat to feed his troops, stationed in the Rhôrie valley. In the years around 7 5 BC~ Fonteius has to resort to confiscations in orcier to supply the armies of Pompey in Spain. The situation changed during the Roman Empire and the province of Narbonnaise became an exporter. A painted inscription on a small amphora records this new situation, telling us th at in the 1 st C AD, the Ca vares were sen ding bar ley from the region of Avignon to Marseille (Liou and Morel 1977). Alongside the open market, there was a state-controlled market whose purpose it was to participate in the supply of Rome: two texts are probably to be put in relation with the concept of the annona (C.I.L., III 14185 and C.I.L., XII 672 = I.L.S . . 1432). Aichaeological sources are not explicit. It is much harder to extract information out of cereal fields than out of archards, whose excavation can }>inpoint the spacing of trees or bushes. As for storage, diffiClllties are just as great. Storage in the Roman period is above ground and therefore granaries are difficult to identify. In the protohistoric period and in the Middle Ages storage takes place underground. But even in this case, problems abound. Though the excavation of storage pits provides information on the volume of stored grain, it is however much more delicate to interpret the food remains that they contain in terms of actual consumption, as it is exceptional to encounter an intact storage pit : these features, having been emptied of their primary content, were often used for rubbish disposai (Raynaud et alii, 1990).
The recent development of environmental approaches for the period under study throws new light on this question. The work undertaken in the lower valley and delta of the Rhône is a good
.. 1
'
FARMING IN MEDITERRANE.AJ.\1 FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 211
illustration. As F. Benoit wrote, the Camargue was probably not a granary, fishing activity and other activities linked -..vith the sea being important (Benoit 1959; 1965, 11 6, n. 33). But whatever their importance, cereal agriculture played a fundamental role during the Iron Age and the Roman period, never really disappearing. In these sectors, the production of cereals would have thus knovvn a widespread extension onto alluvial soil after drainage. It would have been one of the reasons for the prosperity of the Roman colonia of Arles. A few pollen analyses give support to the hypothesis that land was dedicated to wheat a little further north in the region. Cereal cultivarion indeed appears distinctly in the profiles dra-vvn by H. Triat-Laval in his thesis. Though no precise date could be given to the profile from Barbegal, the profile of La Calade, a few kilometres further on and on the edge of the Rhône plain shows a continuous curve for Cerealia in the later IronAge and the Roman period: Ceralia sp. dominates but rye is present and introduced weeds ( Centaurea solstitialis and Po!Jgonum aviculare) are occasionally recorded. For V. Andrieu-Ponel it constitutes proof that cereals were grown in the plain of Arles. Later, in the second phase corresponding to the Merovingian and Carolingian periods, the curve becomes more continuous, readùng 3 to 4% of the total and the presence of Centaurea also becomes continuous. A third phase, whose beginnings are dated around 1200 AD and corresponds to the Middle Ages proper is characterised by a high level of cultivated plants or weeds in a continuous curve, reaching as much as 8%, with Centaurea solstitialis present in very high proportions (AndrieuPanel et al. 2000, 353). At Augery-de-Corrège in Tête-de-Camargue, around the period of the 9th to early Il th C, the analysis of pollen spores reveals a regular increase in cereals (Laval and Malléa, 1993). For the western plain of the lower Rhône, bore holes carried out in lagoori sediments (Marsillargues, Golfe du Lion) (Planchais 1982; Acherki 1997) give a similar general image of an increase of cereal cultivation during the historie period. But there, just as in the Camargue, the major peaks in Cerealia are not recorded during the Roman period, nor do they occur during the period of late-Roman to early Medieval transition, but during the Carolingian period.
ln syntheses on produce at the level of France, the singular position of Southern France in the Carolingian period has been pointed out a number of times (Ruas and Marinval 1991; Ruas 1999). The classical disparity between coastal plains and mountains refiected by a much clearer diversity of cereals in hilly regions belongs to the sum
212 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
of new scientific knowledge acquired in the last few years. It is notably shown by the dominant place occupied in mountains by so-called secondary cereals, in particular the two types of millet, common Millet and Italian Millet, two hulled cereals which medieval documents of the Languedoc do not mention (Ruas 1999) and in the plains by oats and emmer wheat. According to the overview tables, it seems that the diversity in cereals that typifies the South and the hinterland-coast dichotomy was born during the period spanning the 5th- lOth C. But for the time being, the lack of data in sequences does not allow us to be entirely positive about the period of transition between the late Roman and early Middle Ages, whereas for the Iron Age and the beginnings of romanisation we are better informed. Pollen analysis also records the progression of rye, beans and buckwheat. The latter species is only encountered in the pollen analysis of Canet next to Perpignan in the Roussillon (Planchais 1985) and of Pinet in the Pyrenean part of the department of the Aude (Reille 1991) around the l3th C. Originating in central Asia and perhaps cultivated on the Armorican peninsula from the Iron Age onwards, it only spread late in the Mediterranean zone. These puzzling indications seem to give weight to the hypothesis that this plant was cultivated weil before its first mention in written documents (15th C). Often Iinked with autumn-germinating weeds, the Mediterranean cereals were generally sown at the end of the summer and regularly hoed; this suggests that sowing was clone in rows and not broadcast, which goes against the accepted historical tradition (Ruas 1999).
Fruit production
Oil and wine are weil and truly the principal products of fruit-bearing agriculture of the 5th to 11 th C. But vines and olive trees are not the only trees cultivated for their fruits. By demonstrating that Mediterranean farming is not reduced to the intensive cultivation of the classical Mediterranean wine-olive-cereal trilogy, archaeobotanical data has struck a blow to the stereotype of a Mediterranean landscape and enriched its image.
In Southern France, archaeobotanical research tends to confirm what was already hinted at by written sources. An example is the analysis of fruit remain assemblages from the site of Coudouneu, on the northern side of the Étang de Berre, excavated by F. Verdin: the plant remain study by Ph.· Nlarinval has high1ighted the presence of
1 · ··!~
F ARMJNG IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 213
garlic, a plant that is only recorde cl in the 1 st C AD in Italy (Marin val 2000). The beginnings of a fruit tree culture are visible from the Iron Age and are to be linked with the increase of exchanges between indigenous peoples and sea-faring peoples who transmit the knowledge from the East, Italy and Africa. These beginnings are earlier than further north and they reveal a real sophistication in grovving techniques inherited from the classical and hellenistic Greek world, where horticulture and fruit tree culture were common practice (Ruas 1996). This chronology confirms that the economie penetration of these regions by Marseille and later by Rome took place earlier than the conquest and the administrative reorganisation of Southern Gaul. An eloquent example is given by the walnut tree. Since H.-J. Beug published his article (Beug 1975), pollen specialists interpret the presence of ]uglans not only as an inclicator of human activity, but also as a convenient yard-stick for measuring the increasing part played by agriculture. Around 2270 BP, or the 3rd C BC, the ]uglans-line showing the extent of the introduction of walnuts circumscribes the northwestern Mediterranean. In broader terms, the spread of this tree is linked with 'romanisation' and its presence is used as a dating element at Pinet as weil as at Marsillargues. It is thought that walnut trees were still in an exp an ding phase in Italy in the l st C AD and that its spread was far from completed (Benzi and Berliocchi 1999, 90). MeanwhjJe, the latest archaeobotanical analyses appear to date its ·appeanince back to around 3500 BP (Triat-Laval 1979; ArnaudFasetta G. et alii, in preparation). The study of.ancient seeds in particular shows that walnuts spread in Gaul earlier than previously thought. In northern France, ]uglans regia is recorded in the late Neolithic or Copper Age (Ruas and Marinval 1990, 420), and in southern France in the Aveyron (Krauss-Marguet 1981). It is cultivated in the Valdaine, according to charcoal analysis. In fact, there are old records in historical documents, an unsurprising fact since walnuts are linked to religious traditions. The Greeks associated walnuts with the cult of Dionysos and the Romans with that of J upiter, as indicated by its name: ]ovi glans has given ]uglans.
Archaeobotanical work has led to a reconsideration of the influence of the oriental world. Since the famous remark by J. Le Goff, it is accepted that apricot trees are really the only benefit brought back from the Crusades in the north-eastern Mediterranean. By ail accounts, it seems that Prunus armeniaca had already been cultivated weil before the Il th C in the Languedoc. Charcoal analysis undertaken by
214 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
L. Chabal at the Moulin-Villard and at Lunel-Viel in the plain of the Vistre at east of the Rhône delta identifies this tree in the 1 st C AD (Chabal 1997, 113 and 130). A single kernel found on the oppidum of Nages in Vaunage reveals that apricot was consumed in the second half of the 2nd C (Pottrain and Py 1975). Almond trees are thought to have been introduced by the Greeks into protohistorie Gaul; at least this is L. Chabal's hypothesis, to explain the presence of almonds on the island of Porquerolles in the offing of Toulon (Chabal 1991 ). Note th at during the Carolingian period, almond trees were the abject of special care: the size of vessels (wood cells) from charcoal samples of Psalmodi show that irrigation took place. As for peach trees, analysis of fruit remains as weil as charcoal analysis shows that it was present in the region weil before the Middle Ages.
Sites of the 5th to 11 th C in the southern zone reflect a weil established fruit grovving economy. Already in 1982, when interpreting the pollen data from Marsillargues, N. Planchais defined the Early Middle Ages as 'a period of very intensive and very diversified development fundarnentally different from the current agricultural and wine producing organisation', where orchards of Rosaceae occupy a choice place. Further charcoal analyses come to confirm and to broaden this vision. From the end of the 8th C, oak and pine woods left space for fruit tree cultivation which entered a major phase of expansion: cherries, almonds, figs, olives were grown over the whole of the lowland plain of the eastern Languedoc. Charters of the Languedoc hinterland in the Middle Ages proper reveals that fruit cultivation was sufficiently spread to have become a specialist affair: the cellariuinkeeper of the abbey of Aniane (Herault), responsible for its supplies,had to feed the olivadors and the amanliadors every day (cart.An.n°100 p. 240 (l 1 81-1188). Such a terminology implies certainly that there was a technical expertise linked to a differentiation of tasks-depending on species. The existence, if not of a group of specialist workers, but at !east of a workforce attached to a specifie type of fruit culture, speaks for advanced cultural behaviour. Written historical documents show that fruit trees were not planted only as homogeneous orchards. In the 12th C vineyards planted together with, most often, olive and almond trees occupied an increasingly important place and, except in the Biterrois, broke up the uniformity of the cultivated landscape. In this respect, there is everything to expect from an improvement in southern France in the archaeology of fields, which has already proved so useful in northern France> following the strip-
FARMIJ.'l"G IN MEDITERRANE.A.l\1' FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 215
ping of vast surfaces in the context of rescue archaeology. The work of Laurent Vidal has made the first contribution to this subject for the landscape of the Biterrois in the late 9th and early 1 Oth C (Vidal 2000, 238-246).
Hus bandry
The study of the fauna from food refuse contained within archaeological contexts was still in its infancy sorne twenty years ago but is now the object of much attention from archaeologists. As a result, archaeozoology has conquered an important place in historie, ancient and medieval periods. It is now in a position to set a specifie research agenda, appreciably different from that elaborated for earlier periods. In the latter, in so far as the commercialisation of animais, their meat and other products was restricted, the faunal assemblages made it possible to apprehend directly the management of Bocks belonging to the community living on a given site. From the end of the protohistoric period, it may still be possible to consider a simple economie relationship between people and flocks in marginal peasant communities. But in the rural Gallo-Roman and Medieval world, the setting up of complex commercial networks prevents the establishing of a direct link between meat consumption, as apprehended through archaeozoology, and herds or Bocks from the same site. Animais rriay have been consumed by the occupants of a given site; but they could have been marketed, so that animal borre remains constitute simply data in the study of husbandry.
A social indicator The social dimension of meat consumption is essential in faunal research. While studying animal assemblages from Roman sites along the coast of the department of the Var, M. Leguilloux observed that there were no great economie differences between the small peasants living in hamlets and the rich farmers living in medium-sized villae: a break did exist between 'the latter group and that of the great landowners', înhabiting the great villae, whose refuse reveals that high quality meat and venison was consumed. This situation typifies the sites of Saint-Michel at La Garde near Toulon and Les Laurons at Les Arcs-sur-Argens up to the 5th C in the same region.
But the historie, Gallo-Roman and l\!Iedieval periods do not constitute a single bloc and it is important to recognise phases in meat
216 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
consumption. On the site of Saint-Julien.:.les-Martigues at the southern end of the Etang-de-Berre, luxury goods consumption is linked to the early Roman levels, whereas at the end of the Roman period a large proportion of sheep and goats is associated with a lesser consumption of beef. In this case, the analysis of the faunal assemblages joins that of the building structure: the site is first occupied by a residential villa; at the end of the Roman period and up to the 6th C, the social status of its inhabitants changed: they were peasants (Columeau 1996, 132-3). In the hinterland of the Languedoc, on two sites of the early age of casties, Olargues-le-Vieux and Saint-Amans-de-Teulet (Le Pouget in the middle Hérault valley), A. Gardeisen highlights the luxury consumption of suckling pork and lamb: the inhabitants of the first perched barracks of the year l 000 are not peasants, but caballarii, recorded by remains of crossbows and hunting horns found amongst bone artefacts. They are more concerned with raiding and hunting than with husbandry: their social status is a privileged one (Durand et al. 1997). These examples show that a correct interpretation of animal bone assemblages requires an archaeological refie:xlon encompassing the whole of the site and included into a micro-regional context.
Tize question qf the morphology qf cattle Osteological studies allow the identification of an evolution in cattle populations and to define assemblages corresponding to different economie situations. For the beginning of our era, they have been incorporated into the research agenda concerning romanisation. The starting point of this reflexion cornes from northern Gaul, where archaeozoologists note an increase in the size of domestic animais, particularly of cattle, for the period following the Roman conquest (Brunaux and Meniel 1983). At present, the debate is centred on the reality, the size and the interpretation of such a phenomenon. It is summarised thus by two archaeozoologists: 'By extrapolation from osteometrical data, there emerges a breed of 'small cattle' or Gaulish cattle associated with peat bog cattle, Bos taurus bracfl)Jceros Rütimeyer, and a breed of 'large cattle' or Roman cattle, Bos taurus brac/rycephalus Wilckens' (Forest and Rodet-Belarbi 1998). Though in principle of a methodological and zootechnical nature, this debate is compounded by the opposition Gauls/Romans: the growth curve of the size of cattle is seen as a consequence of the Roman conquest and later of
! •
FARMING IN MEDITERRANEAN FRAl'l'CE AND RURAL SETTLEMENT 217
the decline of the Roman Empire. The Roman conquest would have introduced new species of greater size originating in I taly. The crisis and decline of Rome would have entailed a return to a situation prevalent in protohistoric times. This historical scheme was proposed a number of years ago but has not been endorsed by the archaeozoological research that follovved. The latter have shovvn that the situation in Gaul was far from simple. First of ali, occurrences of 'large cattle' are earlier in Northern Gaul than in the South: in the former region it appeared in the last two decades of the 1 st C BC but in the latter region it is known only a century later (Lepetz 1997). 'Large cattle' make a real impact in Southem Gaul from the end of the 1 st C AD, that is to say two centuries after the Roman conquest. Then it remains dominant until the end of the 5th C . But this predominance is not exclusive: 'large cattle ' does not eliminate 'small cattle'; neither does the former characterise herds found in 'Roman' archaeological contexts, nor does the latter typify herds from 'indigenous' contexts. T he data do not allow us to think that 'Romans' imported breeding stock on a massive scale. It is more likely that the cattle population evolved 'through a zootechnical will to obtain larger animais from an original Gaulish cattle population' (Forest and Rodet-Belarbi 1998, 1054). Rather than import herds, a rich breeder from the Narbonnaise would use the Roman slave system and settle in his Jamilia rustica> slave technicians able to master the techniques of breed selection; he would have bought them on the Italian or Oriental market or would have moved them from one of his other regi.onal estates. Furthermore, it is not certain that the 'large cattle' breeds are superior. Because of difficulties in preserving meat, a smaller size was not a disadvantage for meat-bearing animais if the outlets were insufficient (Columeau, pers. comm.). Larger animals were, however, more appropriate as draught animais, giving an advantage if they were destined to be used for traction on a farm or if they were to be used as beasts of burd en. In fact, current osteological research does not permit to stay whether 'large cattle' are remarkable for their power rather than for their weight, that is to say whether they were traction animais or animals bred for their meat. In any case, this phenomenon does not coïncide completely with traditional chronological frameworks: it makes an impact only from the 2nd C for a period that does not extend beyond the 5th C.
218 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
A regional division of space Archaeozoologists are begi.nning to interpret the data obtained in terms of space. At the local (micro-regional) level in Provence during the Roman period, M. Leguilloux has made use of faunal assemblages to refine the character of an estate, that of the villa of Laurons in the valley of the Argens (Berato et al. 1990, 245). Regional specialisms have been identified. L. J om·dan had noted the importance of goat remains in the animal bone assemblages from the port of Marseille (Jourdan 1976, 133). M. Leguilloux has been able to confirm this trend in animal bone assemblages from more recent excavations: at the end of the Roman period, ovicaprids, i.e. sheep and goats together, make up between 63 and 77% of the assemblages. An extensive fleece or fur industry would have provided an outlet for the fiocks of the neighbouring countryside or even from the Crau (Leguilloux 1998, 240). On his side, Ph. Columeau recorded a great proportion of goats on the site of the Pousaraque to the South of the Etang-de-Berre and suggests that these findings confirm L. Jourdan's hypothesis that goat meat was smoked or cured. These data shed light on the relationship between Marseille and its hinterland (Columeau 1996 and 1997, 29-30). In the Languedoc, A. Gardeisen and th en V. Forest have shawn that during the early Middle Ages, the eastern lagoon plain was specially dedicated to meat cattle breeding, a type of husbandry that is weil suited to the geographie conditions of the hinterland, where husbandry is part and parcel of integrated economie and commercial networks (Gardeisen 1993, Forest 1997- 1998). A relationship between the type of husbandry and a humid environment has been established by Ph. Columeau in his work on the faunal remains from the Vallée-des-Baux (Columeau 2000, 353) and from the villa of Près Bas on the edge of the Etang de Thau (Columeau, forthcoming). In a synthesis on meat consumption during the Middle Ages in the Languedoc, V. Forest insists on the diversity of the images obtained through the study of animal remains: sites in the Pyrenees stick out as sites where indigenous species were consumed, including bear and izard (Pyrenean chamois); on lowland and billy sites cattle and sheep dominate . Thus the lowland of the Languedoc appears similar to Southern Provence, whereas sites on middle range mountains form, together with their neighbours of Northern Provence, an intermediary assemblage, between the Mediterranean coast and the region of Rhône-Alpes. Consequently an identity specifie to the Languedoc, as opposed to a ProvenÇal identity cannat be identified.
1
l t
1 1
\
1
1
i i 1
1 '
FARMIJ."'l'G IN MEDITER.RAI'IEAN FRANCE AND RURAL SETILEMENT 219
Knovvledge of husbandry practices in pre- and protohistoric periods has made great progress thanks to the contribution from soil analysis of samples taken by natural historians in cave sites, where indicators contained within the sediments have shown that animais were stabled in these caves (Brochier 1991 ). Su ch methods are starting to be applied to more recent periods. But in the case of open sites, the preservation of these indicators is often poor and few attempts have been made for the historie period. Buildings dedicated to husbandry remain litde-known. Caves continue to be used. The contribution of palaeoecological analyses carried out outside excavation sites is essenrial, in particular those of pollen analysts: the increase in proportion of nitrate-loving taxa, the Chenopodiaceae and plantain (Plantago lanceolata) is to be put in relation with the presence of fl.ocks or herds. Such an observation was made in the sondage of La Calade on the edge of the plain of Arles, where an increase in these taxa is even used to distinguish a particular phase, phase 2: the levels are higher towards the end of the Roman period and for the Middle Ages. This interpretation has received support from a correlation with insect assemblages: the continuous presence of dung-lo\i.ng insects shows that along the eastern edge of the plain, a humid zone has been frequented continually by f:l.ocks (Andrieu-Ponel et alii 2000). It is therefore possible to foresee a spatial analysis that makes it possible to write the long-term history of sheep husbandry in the region of Arles. The site of La Calade is located not far from the plateau of the Crau precisely where a major discovery has recently been made, tl1at of ancient sheep folds. Identi.fied at the beginning of the l990s, th~se buildings are now fairly well known, thanks to archaeological surveys followed by excavations. They are long, large structures pointing towards the mistral (Négreiron-Négrès 6: length: 46.3 rn; width: 9.55 rn; surface: 280 m2). Their presence is surprising; Strabo (Geography IV, 1, 7) and Pliny (Hist. Nat. , 21, 57) note that f:l.ocks roamed the Crau, no doubt since a very long time ago. But that this husbandry should include sheep folds was not expected. Considering the size of these sheep folds, which can shelter 700 to 900 sheep at any one time, and the number of sheep folds, estimated at around 130, a figure of 100,000 sheep has be en put forward. In the present elima te during the dry season, such numbers could not subsist if the flocks had only access to nearby humid zones (the plain of the Rhône, the Camargue, or the edges of the Étang de Berre). This husbandry would therefore have to have resorted to transhumance, far earlier than the
220 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
transhumance knovm in Provence at the end of the Middle Ages (Badan et al. 1995). It would go back to the Roman period. The evidence poses sorne problems which Ph. Columeau points out. The absence · of milk teeth of lambs in the occupation levels of the sheep folds lead him to place the occupation of the sheep folds after the months of December/january. Given a better spread of rainfall, the sheep folds of the Crau would have fulfilled 'as their main function the need to shelter f:l.ocks of sheep from the end of the win ter to the beginning of the summer' (Columeau 2000, 354- 355). As for transhumance, it is safest to stick with the minimalist hypothesis of P. Coste and N_. Coulet: the sheep of the Crau in the Roman period 'spent their summers in the Camargue marshes, or in the neighbouring Alpilles or in the Lubéron, just beyond the Durance' (Coste and Coulet 1994, 65). Further, the discovery of sheep pens has opened a discussion that has become polemical. Indeed, at the same rime, P. Gros, while studying sorne particularities in the architecture of the site of Glanum at the north piedmont of the Alpilles, during the hellenistic and Roman period, suggested that there, there was an assemblage typical of the sanctuaries-cum-markets associated with transhumance. Tax collection at a site of passage is thought to have been one of the reasons for the prosperity of the town (Gros 1996). This article caused a strong reaction from A. Roth-Congès, putting forward a number of objections, from a chronological, geographical and technical point of view and trying to re-instate the religious hypothesis (Roth-Congès 1997). These objections are of unequal weight. The chronological dispute in particular is open to discussion because the research in the Crau has shown precisely that the sheep folds dated to the Roman period, whereas the texts of Pliny and Strabo refer in general terms to Bocks that may have existed far earlier and which applied to breeds of sheep that do not require built shelters. Furthermore, new archaeological research has shown that the site of Glanum extended beyond what was expected and was not confined to the monumental zone that is on display (Gazenbeeck 1998).
It is in fact necessary to improve research on stock animais, in order to characterise them (types of breeds, dura ti on of periods spent in stables, ... ) and to identify the paths they followed to their pastures. Here again geoarchaeological work conducted in the Rhône valley has brought new evidence: according to J.-F. Berger, in certain sectors subject to fiooding and in the hollows of the Tricastin at north of Avignon and the Valdaine at east of Montélimar, drainage
FARMING m MEDITERRANEA.t'l" FRANCE A.~D RURAL SETTLEMENT 221
was abandoned from the end of the 2nd C onwards. T he landscape was then altered by an increase in water meadows, which would correspond to an extensive pastoral exploitation, which of course remains to be proven by archaeologica1 findings (Berger 200 1).
Situations differ from one region to the next. The Crau was pasture land for fl.ocks from the Neolithic onwards, but, as we have seen, the Roman period is characterised by the establishment of stabling, which is only found again in modern times. This difference can of course be explained by the nature of the Roman occupation in Provence and the place that the market economy occupied, that is to say by a change introduced into the region by Rome. In the Pyrenean mountains, historical ecology and the archaeology of pastures (Davasse et al. 1997; Galop 1 998), make it possible to sketch a history of husbandry from the Neolithic to the modern period which does not exhibit any similar breaks in tradition. In French Catalonia, on the mountain of Enveig, archaeological records of levels dating to the Roman period show a pastoral occupation probably to be equated with farrning occupation in the plain: it is likely that the former are summer pasture rather than transhumance sites. Thus archaeology cornes to vindicate the hypotheses put forward by palaeoecologists for the history of the Pyrenean mountains; the opening of the forest picked up in pollen analyses must be related to the pastoral occupation of the mountain. In the long-term frequentation of the mountains, a history that starts in the Neolithic, the Roman period does not occupy a particular position. It exists as a continuation of a system of exploitation and use of space that goes back to the end of the Bronze Age and has very little impact on the mountain (Galop 1998, 257; Riera i Mora 1994). On the French side of the Pyrenees complementary research on the lowland zones has not been undertaken. But an investigation of the plain of Barcelona, carried out by J.-M. Palet i Martinez, can be consulted. During the period that is of interest to us, the development of the pastoral economy is characterised by the complementary nature of the delta wetlands, where pollen diagrams record the presence of flocks (Riera-Mora 1995) and the pastures of the mountain chain of Collserola. New road axes, used as drave ways, replace the roads of the Roman centuriation system and allow the plain to be crossed (Palet 1997). The topography is very different from that of Southern France: the Pyrenean mountains directly dominate the plain, whereas in Provence a long trek is necessary to reach the summer pastures from lower Provence.
222 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
In the hinterland of the Languedoc, further West in the Monts de l'Espinouse, a clear decrease in the level of tree pollen is recorded in the pollen diagrams of Font-Salesse and Baissecure between the 1 st and the 8th-1 Oth C , although this phenomenon is not accompanied by a notable increase in the Mediterranean vegetation (Beaulieu 1969). On the contrary, in a region where the cultivation of cereals and trees (sweet chestnut, walnut) are still only recorded in places, the start of a continuous curve for plantain speaks for a pastoral use of these zones. From the 8th- 1 Oth C middle-range transhumance begins to develop, under the auspices of the Benedictine monasteries established on the high plateaux and in the plain (Durand 1998, 362-370). The same situation exists in Catalonia. In the Po plain il;! Italy, middle-range transhumance also starts at around the same time, associated with indications that trees (mostly sweet chestnut) were also cultivated (Menant 1994, 249-287).
A number of palaeoenvironmental studies highlight the role of husbandry in mixed farming. In the Pyrenean part of the department of the Aude, work on the peat bog of Pinet provides a good example (see above). According to charcoal analysis in the Valdaine, ash trees, which, like elm trees are used in husbandry, increase, probably because they were used to build hedges. But they are not the only ones. On the plateau of the Larzac, box trees are documented as being used in husbandry, particularly for lambs Oitter, food), so much so that one can talk of a box tree culture. During the Carolingian period, the only known sites are located in the uplands, at the northern limit of the green oak forest. Human activity is recorded there. Botanical work by M. Farizier on a macro-flora preserved in limestone deposits (travertine) and radiocarbon-dated to the 11 th C (l 080 ± 50), has revealed the presence of Coryllus avellana, which indicates an opening up of the beech forest during the period that precedes the establishment of the Carthusian monastery in 1205, a clearing that is greater in extent than today's (Farizier 1980).
The rural economy
77ze populating of the countryside
The traditional -vi.ew of the populating of the countryside has been markedly modified by a better grasp of the dynamics of the landscape. It has permitted a review of the notion that the lowland zones
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 223
had been deserted by showing that the absence of visible archaeological sites was due to their burial by later deposits. Research in the Vallée des Baux can be cited as one of the most accomplished examples (Leveau and Saquet 2000). This depression of sorne 1- 2 km in width, separating the Alpilles from the Crau and defined by the 20 rn contour, has been incorporated into the bed of the river Rhône following a process that probably started in the Middle Ages. As a result it constitutes an excellent observatory for the history of regional hydrological phenomena. The bottom of this valley is almost level with the sea-level and it would be a marsh if water was not permanently pumped out from it. Transformed into a polder after a century of drainage works, the valley is at present under cultivation. It bas long been thought that the marsh bad existed 'at ail times', in particular during the Roman period (Benoit 1940, 68). But sediment analysis and the discovery of a settlement (village?) going back to the Copper Age have brought into question the notion of the permanent underwater status of this depression. Deposits corresponding to various hydraulic features of the valley have been correlated with written historical documents and archaeological data. It could be demonstrated that the horizontal nature of the valley was the result of the build-up of sediments masking a varied topography (Leveau 1999). Thus, contrary to what used to be written ·since F. Benoit, human occupation had not retreated towards the North at an early date, abandoning the valley bottom to rising water: the valley remained occupied until the 7th- 8th C (Bellamy and Hitchner 1996).
The situation at the end qf the Roman period Much has been made by Romanists of the end of the Roman world, a crisis whose origins were sought in the crisis of the 3rd C. In the last ten years, a general re-thinking of the problem has led to an abandonment of the idea that there was a profound break in rural settlement between an ill-defined Early Medieval period and a far better studied Roman period in the Mediterranean regions. Then, battles and sieges affected the economy and had a depressing effect on the conditions of production and the econonùc networks. But the latter put up a :fight. Archaeological research would now put less emphasis on the process of decline that was observed and forbids presenting a the end of the Roman period as a time of a sudden break and a general collapse of the Roman infrastructure. One of the major advances in archaeology, and one that has made re-interpretation possible, has been the use of quantitative methods which increase
224 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
our understanding of the real bUl·den that society puts on the landscape. Archaeological surveys, conducted systematically and within a scientific and heritage perspective make it now possible to draw, sector by sector, distribution maps of given sites and to construct curves showing the appearance, the growth, the maintenance or the decline of different forms of settlement, 'peasant settlement' or villa latijùndia (Durand-Dastes et al. 1998, 74- 114). Micro-regional characteristics can appear on these curves. Regions with dense Roman populations are broadly opposed to other regions where a farming economy of protohistoric origin and indigenous tradition is dominant. The density curves that have been drawn up, giving the number of sites per km2
, show roughly parallel evolutions. 'During the 4th C, densities range between 0.11 and 0.92 sites per km2, for an average of 0.25 sites per km2
• During the 5th C, they range from 0.14 to 2.08 sites per km2
, the average being 0.60 sites per krn2. These values can be
compared with those for the lst C AD which range between 0.59 and 2.28 sites per km2
, that is an average of 1.15 sites per km2
(~rément et al. 2001). There is therefore a real decrease in the occupation of the landscape, manifesting itself in the loss of a considerable number of Roman villae, in particular large villae with often ostentatious architecture and meclium-sized or small villae which secure the weft of the landscape. This decrease is often of a qualitative nature. In Provence, where stuclies have been conducted, villae sites are indeed occupied during the 4th- 5th C. But only a very small number of them has the status of villa (Carru et al. 200 1). The others were not necessarily abandoned, but the nature of their occupation changed. What remains of the occupied parts of buildings exhibits a drop in the standard of living. In fact, the situation is close to that described by P. van Ossel and P. Ouzoulias in Northern Gaul, to the extent that his observations merit being applied to the whole of the terri tory of Gaul (Van Ossel and Ouzoulias 2000). In N orthern Gaul, this development is accompanied by the appearance of a type of settlement different in its plan and organisation. In 1980, J. Chapelot and R . Fossier thought that buildings which were partly underground and partly above ground had been brought in by Germanie migrations from the Slavie and Germanie world where such structures are known (Chapelot and Fossier 1980, 131-1 32). Since then, examples have been excavated in Southern France, in the Languedoc (Ginouvez 1993; Garnier et al. 1995; Mauné and Feugère 1999, 391) and in Provence (Bertucchi pers comm; Berato in Bertoncello 1999, 291 ).
n
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 225
Therefore, one might be justified in asking whether the novelty lies in the type of construction or in its discovery! 'The difference is of importance: in one case it would be a real innovation and it could correspond to a Germanie settlement (Mercier and Raynaud 1995, 202), in the other it would merely confirm its use.
One element seems certain: in Narbonnaise Gaul, the phenomenon of the palatial villa did not experience a growth equivalent to that exhibited in Aquitaine, in North-Eastern Gau.l or in Spain in the 4th C. The only known villa which is comparable is a villq- maritima which has been known for sorne rime, the villa of Les Beaumelles at Saint-Cyr-Les-Leques to the West of Toulon (Brun 1999, 639- 652). The presence of urban elites is nevertheless well documented in the countryside. P.A. Février has been able to prove this from geographicallists (Février 1981 ), to which archaeological findings can be added. The best known villa is now that of Près-Bas at Loupian on the edge of the Etang de Thau reported on by Ch. Pellecuer in a monograph that reconstructs its history from its construction in the carly Roman empire up to its definitive abandonment in the 7th C. The site sequencè is meticulously reconstructed over the half millennium preceding the building of the architectural project that include the rich polychrome mosaics that have made the villa famous. Started at the beginning of the 5th C, it entails a transformation of the local topography, however without breaking with earlier phases. The residential part doubled in size. Whereas previously residential wings and courtyards were laid out following the topography of a slope eut into by small valleys, a new and vast platform was built. The buildings were arranged around a huge peristyle ( 40 x 26 rn indu ding the porticos). Archaeological finds (pottery, coins), combined with stylistic arguments suggest a date around 400 AD for this building programme, a date which would roughly agree vvith the suggestion by H. Lavagne ( 1981) th at the building dates to the first quarter of the 5th C. Excavations have not revealed agricultural buildings, whichjust as the baths of this rime-are located outside the confines of the villa, in the near or far neighbourhood. The final period of occupation of the site is little known.
All in all, the situation does not evolve in a way that is different from other villa sites in the Narbonnaise, like that excavated at SaintJulien-Les-Martigues (Rivet 1996, 97-111 ). But what is different is the chronology. At Près Bas, there is indeed evidence for the permanency of the residential occupation of the building for a very long time
226 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
span; the mosaics reveal that the rooms were occupied continuously. As in Northern Gaul, where such a trend has been observed by P. Van Ossel (Van Ossel 1992, 178), utilitarian and agricultural functions re-colonise certain parts of the building, where they replace residential functions. During the course of the 6th C, the courtyard seems to have housed a hut. The gardens of the residence were no longer looked after. New buildings were erected, in particular sunken-floored structures sïmilar to those discovered at Dassargues (Garnier et al. 1995, 36 and fig. 35). Thus Ch. Pellecuer has been able to bring to light evidence of an evolution also observed elsewhere, in particular at Saint-André-de-Codols, where a villa site has been the subject of a large rescue archaeology operation (Fiches and Veyrac 1996, 489-491 ). In the South, the real break in the occupation of the landscape is to be sought in the course of the 7th C.
The Catolingian desti'f0' Medieval historiography of the 1980s and 1990s, dominated by the question of casties, proposed a unequivocal view of human endeavour prior to the year 1000: in that most classical of schemes inherited from the Italian case, peasants, up to then spread in makeshift settlements, were gathering together under the coercion of lords from the year 950 AD onwards, inside purpose-built fortified settlements so that they could benefit from the benevolent but interested protection of the master. The birth of villages coincided with a will to assemble populations in orcier to control them better. In the Languedoc, M. Bourin has pointed out from early on that this scenario needed sorne adjustments: it described the Carolingian settlement pattern as open and dispersed, though not absolutely, with harnlets in the form of clusters or more rarely as tightly-knit communitiès. Within this very loose structure, the nuclei of the old Gallo-Roman vici and those of the cities remained. Similarly, in the growth of the castle network, the part of the ancient, Roman or Carolingian, inheritance is to be taken into account, even if the reorganisation of the setdement pattern was largely under way.
Archaeological research has come to refine, complement, even contradict the general fl·amework, by demonstrating that the growth of villages is a complex phenomenon. At Lunel-Viel-the oldest and most thorough example-the excavations of C. Ra~maud have revealed the hesitations and the fluctuations of the settlement betv..reen the 7th
FARMING IN :tvlEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 227
and 11 th C, highlighting the problem of '\veak discontinuities in the built environment while the site remained ·occupied continuously since the Roman period. The organisation of this village was slow and took place over a long time around the church area (Raynaud et alii 1990). In the Vaunage and the canton of Mauguio, to the west and south of Nîmes, A. Parodi, C. Raynaud and C. Mercier have demonstrated the existence of nuclei of grouped setdements before the year 1000, which, though modest, survived beyond the year 1 000, to die out with the new trend for casdes in society. A more careful rereading of Carolingian written documents endors es this point of view: the term in ipsa villa, following in the same sentence or at the beginning of the next the expression in villa de, shows that the word villa means at the same time a tract of land cultivated by peasants and a specifie place located within this land, where a settlement bas started to nucleate (Bourin and Durand 1994). The use of topographie descriptors such as super or subtus reifies in the landscape this polarisation of space by taking into account one of the elements of the landscape, its contours. Further, a large number of castra of the year 1000 are conceived initially as the inheritors of a mother-villa, refiected in the place-names in -an or -argues. The simLÙtaneous use of two terms, villa and castrum, in the same place-name in the same document reveals the dual nature of the settlement and the bi-polar use of space, in ipsa villa on the one hand, around a castrum on the other hand.
The irriportance of the late Roman inheritance of the 3rd to 6th C in the formation of the Carolingian settlement framework is weil established today, through cross-reference of a number of sources. But this continuity of nucleated or even closed settlements (Raynaud et al. 1990) does not signify an immobile situation: without going as far as mentioning an itinerant pattern, it must be stressed that the anchorage of the built fabric to specifie localities is not yet definitively achieved; the polarisation of the Carolingian rural space is the beginning of a long process of burgeoning settlements reaching a plateau with the birth of villages in the 11 th C. These continuities or weak discontinuities do not exclude foundations like Augery-de-Corrège (9th-Il th C) in the Camargue, which could be a village colonising marshy zones or former salt marshes. At least this is one possible interpretation. These grouped setdements are still very loosely knit: the settlement buildings of Augery are grouped around enclosed spaces interpreted as courtyards or kitchen gardens and they form the centre
228 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
of the nucleus. Grouping is also open, flexible and articulated around fields at Dassargues. It therefore appears that the structural organisation of these early forms of villages is rough and ready, even rustic, corresponding to what J.-M. Pesez caUs 'infraconstruction).
Archaeological evidence has also come to re-evaluate the weight of secular fortifications in the genesis of villages: in Catalonia first, then in the Languedoc in the department of the Aude, and later in the departments of the Hérault and Gard, historians and archaeologists have contrived to describe the 'ensagreramenf, that is to say the spontaneous congregation of people around the circle . of peace of churches, defined as a radius of 30 paces around the ecclesiastic building, in order to protect itself against the violence and increasing demands of milites during the advent of the tying of common men to the lord's fief (Baudreu, Cazes 1994; Catafau 1997). In the higher Herault valley, the Carolingian diplomas of the monasteries of Aniane and Gellone also record closed groupings of people around a cult centre. Th us the role of the church and cemetery in the polarisation of the Carolingian rural space has been largely rehabilitated in the last ten years: research activity in the South is at present focused on this subject.
Motte and bailey casties have long been considered as typical of the northern half of Europe. Supported by a national inventory programme on earthen fortifications, research has demonstrated that this feature was also presents in Provence and Languedoc: C. Castelvi (1984) in Roussillon, M. Dauzat (1983) in Lauragais, M. Fixot (1975) and D. Mouton in Provence, P.-Y. Laffont (1998) in Vivarais have listed a not negligable number of mottes. If sorne re-use or re-eut natural contours, others respond weil and truly to the strictest definition of the phenomenon. In chronological terms, it begins in the 1 Oth C and ends during the course of the 13th. Generally featuring wooden constructions and surrounded by storage structures, notably numerous grain storage silos, these mottes have been recognised as part of a timber and earth tradition. Indeed, if J. Chapelot and R. Fossier remained relatively cautious in 1980, writing that in France and Italy 'due to the paucity of excavations, it is difficult to establish the age of this rural stone building tradition, especially in the Mediterranean zone'; they noted, however, the fact that the analysis of documents dating to a period prior to the 12th C recorded stone houses more frequently than timber houses and concluded that stone houses were closely linked to the southern limestone zones of Europe. Since at
FARMING IN l.VIEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 229
least the last decade, archaeology has come to contraclict such a chronology: during the early Middle Ages as aftervvards, medieval bouses of carth, timber, mud or wattle and daub existed also in the South, and not just in the Camargue.
Major. land organisations
The setting out of land boundaries, roads and drainage, which give to the landscape an enduring framework, were determined by two objectives. The :first is economie and consists of the establishment of newly cultivated land and the opening up of the region. The second is constituted by taxation, based on land boundaries. Neither of these two objectives are, a priori, the prerogative of a specifie period. But there seems no doubt that in the Roman period particular attention was paid to the system of centurîation, whose establishment and destiny has played an essential part in research.
Orthogonal and concentric land boundaries The Roman conquest resulted in a vast agrarian restructuring which a:ffected most parts of the plains of Provence, the Languedoc and the valley of the Rhône. In its outline, the Roman landscape remains profoundly marked by this heritage. The publication by A. Piganiol of the Roman marbles of Orange, which give the plans of three centuriations in the Rhône valley, followed by the research of M. ClavelLévêque on Béziers, together with, in more general terms, the remarkable work of the Besançon geomorphologists have permitted an estimate of the surfaces involved. The R omans were of course not the only ones to have resorted to geometrie divisions into plots of the territory. But in the South of France, they were the only ones to have conceived and put into practice such an organisation over hundreds of km2
• The discovery of fossîl centuriation systems has therefore heen greeted unanimously by historians as a maj or feature. Two rrùllennia later, the traces of this organisation continue to mark the landscape, undoubtedly to a lesser degree than in Africa or in Italy, in Campania or the Po plain, but sufficiently clearly to be visible on vertical air photographs and recorded on topographie maps.
At present, research is able to delve deeper into the evidence. In the Rhône valley, work on the cadastres of Orange continues. The three lmown cadastres are now fairly securely located. Two of them can · be pinpointed with certainty: the <Cadastre B' since the publication
230 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
of A. Piganiol (Piganiol 1962) and the 'Cadastre A' since the research undertaken by G. Chouquer in 1981 (Chouquer 1981 ). The 'Cadastre C' has recently been the subject of convincing arguments that vindicate a suggestion of A. Piganiol (Christol et al. 1998). In the Languedoc, the research carried out on the cadastres of Béziers have resulted in the publication of an Atlas (Clavel-Lévêque 1995). These results have generally enabled us to evaluate the complexity of the evidence for superimposition and enmeshment of the centuriations, related in the texts of the Gromatici. Thus, in the Langu edoc, in the territories of Roman colonies, but also in territories dependant on Latin law such as Nîmes, extensive research has been able to isolate a sequence of successive centuriations on the palimpsest of the landscape. Impressed by the success obtained by antiquarians, G. Duby presented centuriation as a 'vast net, whose fine mesh was thrown by Rome o~er the peasantry of Gaul' (Duby 1975, 30).
But matters did go adrift, as such images justified a simplistic method, which consisted of casting grids onto maps and ending up with a multiplicity of geometrie boundary systems attributed systematically to Roman colonisation, while concentric land boundaries were considered as medieval. This approach is absurd, as it aims to attribute to the shape of land boundaries a chronological value. Generated as convenient plots, orthogonal divisions are indeed the basis of ali space management on a large scale by a strong power. By contrast, rural communities will create a landscape whose circular character is due to the polarisation of fields towards a central point, the village or the farm. Ease of access to fields favours such an arrangement in a period in which power is splitting up. A priori, it should not be impossible for a central power to allocate plots on a circular model: it has been used in the history of European urbanism (Fabre et al. 1996). But concentric forms could just as easily have existed during the Roman period in sectors where the underlying pattern had been respected, while orthogonal layouts had been used in the pre-Roman period in our regions by Phocean colonists and, in the l\1iddle Ages, on newly colonised land. Orthogonal and polarised structures refer first and foremost to social formation~which could coexist-; in second place only, can this phenomenon be interpreted in chronological tenns. It nevertheless remains true that nonorthogonal landscape forms are more characteristic of protohistoric and medieval landscapes, whereas the orthogonal treatment of territories represents an ceveùt', such as the imposition of power from Rome over Southem Gaul.
FARML"JG IN MEDITERRANEAN FRANCE Ai''ID RURAL SETTLEMENT 231
Like aU 'crises', that which affects archaeo-morphological research does not only have negative effects (Leveau ·2000). Growing attention is being paid to the decay of the geometrie framework associated with five centuries of use of land and tracks and to the relationship between land boundaries and the natural environment. The complexity of the situation is becoming increasingly apparent. Sorne researchers have sought a confirmation in the field by excavating fields and revealing traces of ploughing, ditches and field boundaries of centuriation systems. The burial conditions ('taphonomy') of field boundaries or the reasons for their destruction through erosion constitute a precise research target, tackled in collaboration with environmentalists. The latter have been able to incorporate into archaeological operations, physical variables associated with seclimentary deposits likely to bury archaeological features. Research protocols put in place on large excavations, such as those occasioned by the construction of the regional airport of Lorraine have been applied to certain sectors of the excavations on the TGV Méditerranée line in the Rhône valley in the area affecti.ng the Cadastre B, the best documented of the three cadastres of Orange. Through cross-reference between the data obtained by the three disciplines involved in this research-archaeological data referring to soil occupation, archaeomorphology and geomorphology- it is possible to refute objections levelled at the method (Chouquer 2000). Geomorphological studies have been instrumental in establishing the phases of use of drainage networks and for comparison with the results from the various palaeoecological, geomorphological and soil studies. Knowledge of the theoretical frameworks of centuriation has enabled us to understand the diversity of 'their initial materialisation (ditches, buried drains, tracks, hedges) and later to sketch their role and function (drainage, irrigation, communication or protection from the vvind)' (Berger 1999). In the plain of the Rhône, in the Tricastin, in the locality of Malalones in the parish of Pierrelatte, ]. Berger and C. Jung have been able to follow the history of a ditch belonging to the Cadastre B of Orange. Regularly cleaned and recut in the Middle Ages, it was finally obliterated by later deposits. But, remarkably, its line was preserved by a lat er hedge (Berger and Jung 1996, 100 fig. 5). This example vinclicates archaeological research procedures while also demonstrating the determining role played by collective memory in the preservation of land boundaries: in its outline, the modern landscape bas inherited ancient forms. Archaeological investigations allow the threads of complex orientations to be unravelled in areas where written
232 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
sources are not available. Centuriation affected the whole of the plain of the Rhône South of the Roman colony of Orange. The plain of Arles was also subjected to a centuriation system, only known up to now through the orientation it bas imprinted on the land boundaries. The cadastre of Orange stops at the foot of the Alpilles, sorne ten kilometres North of where the town of Arles was established. At present, no network of tracks and ditches comparable to those known in the plain of Orange has been identified through aerial reconnaissance or excavation.
At present, the best example outside that of the plain of Orange is located in the region of Lunel-Dassargues, on the right-hand bank of the Vidourle between the Camargue and the Garrigues of Nîmes, where orientations picked up in excavated areas are probablylinked to three centuriations in the territory of Nîmes, already highlighted in studies of agrarian morphology (Favory 1996). The network of ditches that reveals these territorial divisions was in use up to the end of the 4th C at the latest. Inspite of being backfilled, the orientation of these ditches continue to structure the landscape up to the 7th C: hedges and wooden fences replaced them. A farm and a small cemetery of a few graves were established in this context. There is little archaeological evidence for the Carolingian period, although an 8th C text refers to the existence of a church and bouses (Garnier et al. 1995).
Ail in all, recent research has come to confirm the hypothesis of J. Chapelot and R. Fossier of sorne twenty years ago: 'In the South of France, the maintenance of Roman land boundaries, at least in large areas, can be explained probably by an exploitation of the landscape so much imprinted upon the terrain that an early medieval agricultural exploitation did not alter it' (Chapelot and F ossier, 1980, 70). Advances in archaeological techniques enable current research on the rural world of the Barly Middle Ages to review the image of deserted landscapes that prevailed in the past. The image of a general abandonment is to be rejected. But this does not necessarily mean that sectors whose cultivation required rigorous management and important means continued to be exploited.
Agricultural water management Research by S. Caucanas on mills and irrigation in the Roussillon from the 9th to the 14th C represents the most recent overview on the question of water management in the South of France. Its origins are obscure: historiography hesitates between a Roman, Visigothic
FARMING lN :tviEDITER.RANEAl~ FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 233
or Arabie origin (Caucanas 1995, 20). But, in the absence of precise and explicit archaeological or historical evidence for mills and irrigation systems, it is impossible to decide. The study of the fust texts: dated to a time spanning the 9th to 11 th C, leads Cancanas to highlight the relationship between agricultural water management and the construction of water mills: it appears to be a relatively common practice. Irrigation of gardens on a small scale has been a feature of farming since the origins of agriculture in agrarian societies, whatever their technical leve!; there are no reasons for thinking that this was no longer the case. But a real innovation appears at the beginning of the ll th C in the form of canals 'which are no longer just considered a profitable but ancillary means of increasing the incarne of an estate: on the contrary they are now regarded as essential, even paramount and fundamental for the exploitation of the land' (Caucanas 1995, 27). In the light of documents describing the situation in the decades prior to the year 1000, S. Caucanas concludes that 'everything leads us to believe that constructions of this type were already in existence during the preceding centuries'. There is no cause for surprise: such arrangements are known in the Iberian peninsula since Roman times (Gorges and German Rodrigez Martin 1999).
An identical situation is visible in the neighbouring Languedoc: the existence of veritable hydraulic systems can be linked to the mastery of irrigation from the beginning of the 9th C: before the year 1000, around 30% of mills were equipped with systems for watering the land; this percentage is truly eloquent, considering that these are the beginnings of the mechanisation of the landscape (Durand in press). Furthermore, particularly in the lowlands in the zones of marshland or former salt marshes, a number of fields were passed on vallo in medio, but it is not possible to decide whether this refers to a drainage system or an irrigation system or both together. Field archaeology confirms the vision offered by the history of water management given in written documents. At Augery-de-Corrège there are numerous salt water canals on the Carolingian settlement site. The purpose of land snail analysis, undertaken by J. André, on a number of negative features, was to c:lifferentiate between their origins, functions and time of use, such as drainage stmctures, foundation trenches or tracks. Thus, she has been able to recognise beside dry ditches, which had later been rapidly backfilled, drainage ditches which held st~onant water and which were periodically fiooded. Results from charcoal analysis, which record salt-loving and humidity-loving
234 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
species with monocotyledons, do not contradict these findings (Kotarba et alii, 1987). Research undertaken by C. Raynaud on the territory of Dassargues has also shown the presence of irrigation and drainage ditches associated with traces of ferrees and hedges and to plantation furrows: they allow the reconstruction of the limits of a few hectares of a farm established at the beginning of the 6th C on the banks of the Vidourle (André et al. 199 7, 1 09- 113). Irrigation on a small scale is thus well recorded in the farming economy in Provence as well as in the Languedoc.
In the latter region, contrary to what S. Caucanas records in French Catalonia, there is still no evidence that irrigation on a large scale existe cl in the Middle Ages (Bourrin-Derruau et alii, forthcoming). J. Béthemont had already noted that, just as in the rest of the Rhône valley, large scale irrigation was only developed in Basse Provence in modern times, when the canal of Craponne was built (Béthemont 1972). In the Comtat Venaissin, where the management of water became of particular importance, the historian P. Fournier has recently dated the beginning of the process to the end of the 16th C, a process that ends up with the large scale irrigation of the 1 9th C (Fournier 1999, 24-25). P. Fournier accepts that there was an (acceleration' of the process in the Middle Ages but not a (break'. The documentation which he consulted gives an impression of a constant improvement of procedures needed to control water. Archaeological work is able to contribute new data to this subject. For the Roman period, large scale irrigation, that is to say the construction of structures able to collect, conserve and distribute water to fields on the scale of a whole valley or a plain, was only known in cirier regions of the Empire and perhaps in Italy (Quilici-Gigli 1989; Thomas and Wilson 1994). J.-F. Berger and C. Jung suggest they have identified a Roman irrigation network at Bartras in the parish of Bollène in the Tricastin, based on a study of the typical sandy fills of the ditches (Berger and Jung 1993, 103-105). The appear to have established the presence of large scale irrigation in the Roman period which disappears from most areas during the l\1iddle Ages. However hydraulic know1edge was passed on into sorne historie documents of the Languedoc dating to the 11 th-12th C and mentioning fossatos antiquos, apparently in working orcier. Used in a specifie context, the adjective antiquus refers to a stone-built structure rather than to just a ditch or vallum. The Roman period is the most likely.
The scattered information available for the history of water mi.lls
FARMING IN NlEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 235
points in the same direction. Im tht: Catalan Pyrenees, V. Izard argues convincingly that the use of water wheels in the context of iron metallurgy goes back sorne three centuries earlier than thought, that is to around the year 1000 (Izard 1999). In her eyes, this is a veritable technological revolution. It is therefore unlikely that hydraulic techniques had disappeared completely.
The data concerning systems of sluices or outlets speak in general in favour of a preservation of the knowledge required to operate drainage and irrigation on a large scale. Thanks to such systems, the many enclosed depressions that are scattered throughout the calcareous plateaux of Southern France, in Provence as well as in the Languedoc, were put into cultivation, as has been recorded on air photographs: anomalies in land boundaries continue to indicate the shape of these hollows, now almost ali drained. Following the research that he has conducted on the wetlands of the eastern Languedoc and on the closing of the lagoon of Narbonne, P. Ambert has recently directed research in the valley of the Aude which opens new perspectives for the history of the landscape in the Roman and Medieval periods. Under the aegis of the Centre d'Anthropologie de l'Ecole des Hautes Etudes at Toulouse and the directorship of J. Guilaine, the 10\~ver valley of the Aude between Carcassonne and Narbonne has been the subject of a borehole survey. Meanwhile P. Ambert assembled a palaeoenvironmental team which examined a series of closed depressions isolated from the regional river network and which were naturally marshy, and therefore likely to give a good record of the evolution of the local environments. Sorne hollows had been developed during historie periods, with tunnels or canals dug into the subsoil to drain them (Ambert 1995, 221). The possibilities for observation and analysis offered by these depressions have been known for sorne time. They contain, preserved in them, remains of constructions, in particular trenches or outlet tunnels, which are roughly equated with the Roman period or with medieval land clearance. Considering that these are periods in which tl1e techniques of mining had been mastered, canal construction was of no great technical difficulty.
An interesting example of drainage work identified at Suze-laRousse in the department of the Drôme, in the Tricastin, has been the focus of sorne suggestions from P. Poupet. An underground structure maintains at present the drainage of a depression located in the parish of Suze-la-Rousse, being the successor to drainage works carried out in the 1 7th C: but the marsh kept returning. The first
236 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
interventions are mentioned in texts of the 11 th C. Y et the depression belongs to a zone known to have been cultivated during Roman times and integrated into the area of the cadastre of Orange (Poupet 1994). A similar focus was brought to the are a surrounding the ancient site of Saint-Blaise, on the western side of the Etang de Berre, where F. Trément has studied a number of smaJl depressions. For this zone, there are numerous archaeological and historical records which allow the fluctuations of water levels to be put in relation with the rhythms of occupation of the land and with large scale drainage works which are probably datable to the Roman period (Trément 1999a and b). Further research is being undertaken, in particular on two depressions crossed by the new TGV line at west of Avignon, at Tras-le-Puy (Arthuis and Ambert 1997) and Pujau, where a sluice tunnel is knovvn to have existed.
Traditionally, it used to be thought that these drainage works were the work of powerful individuals or ecclesiastic communities able to command suffi.cient political and financial support, wanting to increase their arable land or hay meadows on soils with high potèntial. No doubt this is the case for the most extensive interventions. During the 13th C, the drainage of the depression of Montady near Ensérune in the country of Béziers is indeed presented as the proof of the renewed dynamism of an association of citizens (Bourin 1987, 2, 16). But it is likely that research has been too influenced by extreme examples, the most famous being the drainage of the Fucine lake which required the outlay of the Emperors of Rome and later in the Middle Ages the investment of their Germanie successors to maintain and refurbish this drainage. Too little attention has been paid to smaller scale works. A brief note on this subject by N. Coulet is dedicated to the drainage of a small depression in eastern Basse Provence by a single carpenter! (Coulet 1993). Finally, the remark made by S. Caucanas in relation to irrigation can equally weil be applied to drainage: the initiative for the construction of these water works is due to 'the owners of estates, as much the rich landlords as the small landholders' (Caucanas 1995, 31). In this perspective, the study of land improvements, large or small, of their opération and maintenance is an avenue to explore in order to evaluate the will and the ability of societies to master their environment.
FAR!v1ING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 237
The management of slopes A similar type of question can be asked of cultivated terraces used to manage slopes. At a time of great demographie pressure, these developments extend agrarian surfaces on sloping terrain and maintain a relative humidity. As a result, they stabilise the slopes and help minimise the effects of erosion. In the majority of cases, these terraces do not last long if they are not maintained, perhaps sorne dozen years, unless they have been buried at the base of slopes. Thus, against the hopes entertained in the 1970s that the presence of this type of development could be established and that one day archaeological excavation would reveal its traces, many archaeologists in the South of France have reacted negatively towards such a proposai. Neither have the methods used by plant geographers proved useful in apprehending the history of ridge and furrow agriculture. In Southern Gaul the technique of terrace construction had already been mastered by Iron Age populations adept at building ramparts. The question has been taken up again by P. Poupet who, in opposition to general opinion, has been able to establish convincingly that slopes have been managed since the protohistoric period on a site occupied by the old Benedictine quarter in Nîmes. ·He conclu des: 'The slope of the Mont Cavalier, on the site of Les Villégiales has been cultivated in fields staged along a terrace system between the 4th C BC and the beginning or middle of the 2nd C BC' (Poupet 2000, 37). No sünilar research has yet been published nor envisaged for the Roman period, although it could be undertaken by archaeological teams. It is a question of seizing opportunities. Most archaeological operations capable of taking into account such a research objective have been carried out in the plains. Where it could have been possible to study terracing, namely in certain sectors touched by the construction of the TGV Méditerranée line, it has not been considered a priority by those responsible for operations. This is what happened in a section located between the valley of the Durance and the basin of Aix-en-Provence, where the line ran through a landscape that archaeologists and geomorphologists from the University of Aix had just studied.
The question of terraces was . becoming a major archaeological challenge. It would permit the apprehension on an archaeological basis, for the protohistoric period, the question of the density of the indigenous farming population on the periphery of the domain of
238 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Marseille and, for the Roman period, the question of a potential reflux of populations towards the higher ground and of an exploitation of slopes in zones integrated into the Roman agricultural system (Leveau 1993, 34). For geomorphologists, the question was to assess the place of human factors in erosion processes during the last tvvo millennia (] orda 1993).
These are the questions tackled by F. Bertoncello and M. Gazenbeek in the Massif des Maures on the rock of Rochebrune which overlooks the valley of the Argens near Fréjus. There, buts and terrace walls of protohistoric date bad encouraged the creation of soil accumulations against or on them ~ynchets), on which new occupants settled in the late Roman period, reusing these structures. 'Since the abandonment of the site in the 6th or 7th C, in spite of their partial collapse, these structures continue to retain soil on the slopes' (Bertoncello and Gazenbeek 1997, 619). A small village has been surveyed by F. Bertoncello and M. Gazenbeek on the rock of Rochebrune. Samples were taken and the pollen analysis undertaken by Bui Thi Mai shows that in the 5th and 6th C human activity had somewhat diminished compared with earlier periods.
The author of a remarkable study of the genesis of landscapes and farming communities in Europe in modern times, Ph. Blanchemanc~e, bad called the attention of archaeologists to the absence of mentions of cultivation terraces in historie documents (Blanchemanche 1990). In fact, a few texts dating to the Roman period mention terraces (Poupet 2000, 38). But it is not easy to track clown terraces in written medieval sources. In the absence of descriptions in acts, only indirect references can be traced. The first and most secure approach consists of following the term 'faïsse' (faissa~ jaxia, fascia) which bears witness to the development of slopes in a series of chartularies. In the Languedoc, the earliest mentions of 'faïsses' date back to the 9th C, but the zenith of the phenomenon takes place towards the end of the 11 th C, follovving an increase in population. The term 'faïsse' itself encompasses a whole range of different structures and different types of cultivation. It describes steps on rocky slopes as weil as terraces on the slopes of garrigues or even, and that is its main meaning, long narrow strips of land established along lagoons or water courses. Indeed, farming on slopes is not just concerned with steep slopes of the hinterland: it develops also and foremost in humid environments, along the edges of rivers, using as its base the contours of quaternary terraces sculpted into steps. The process is well understood: from
FARrviiNG IN MEDITERRANEAN FRANCE Al~D RURAL SETTLEMENT 239
around the year 1000, the colonisation of ri_ver banks following wood-· land clearance incorporate into the ager land dedicated to intensive cereal cultivation which requires drainage, banking or tree planting, using sometimes very specifie procedures such as manuring or revetting vvith grass or turf. But if historical sources shine a fairly strong light on certain aspects of terrace cultivation, they remain silent on other types of development. Y et, from the end of the 1 Oth C, terms (prepositions) meaning a change of level are becoming increasingly frequent in descriptions and naming of goods, and strips of land located on or next to puechs (hilltops) are also more common. The long and laborious work of transporting stones and building with stone and earth is not recorded more precisely in written sources: the absence of exploitation contracts or of collective charters suggests that it must have been mostly inclividual constructions.
ConclusiQn
The image of the landscape in the Mediterranean South during the second half of the fust Millennium that we have been able to present appears to show the sense there is in adopting an approach that integrates palaeo-ecological data. At the level of data useful to historical reflexion, whether they are land units, archaeological sites or agricultural produce, the gain is obv_tously considerable. But this approach bas not just the effect of bringing more data or more precise data to light. An ecological history implies a reinstatement of the 'largue durée', a slightly outdated concept sin ce the rehabilitation of the history of events. Ecological history gives pride of place to the notions of usage and inheritance. The concept of the first known use permits us in particular to avoid falling into the trap of over-interpretation of an archaeological cliscovery or of negative evidence, and similarly to avoid underestimating a given period. The examples concerning the use of water mills, of iron metallurgy or of terrace cultivation constitute good illustrations. Historians and archaeologists alike are led to abandon simple evolutionary models consisting of progress from 'protohistory' to the 'Roman period' to the 'Dark Ages' to the 'Middle Ages'. In breach with a mythical image that portrays Romanitas from which the Middle Ages were breaking off, they insist on the notion of inheritance. Research bas shown that, thanks to internai developments and to influences originating in the
240 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
eastern Mediterranean, the foundations of the farming economy had been laid clown during protohistoric times: plant cultivation, animal husbandry, tools, techniques of cultivation, management of the soils (drainage, irrigation, terrace building) forrn these bases. They continue to exist during the early Middle Ages. The principal novelty introduced by Rome consists of the integration of the region into the commercial economy of the whole Empire. The political and military crisis that accompanies the fall of Rome has had disastrous consequences. But it does not entail a retreat or a regression. Much of what has been acquired remains, broadly paving the way for a takeoff in the early Middle Ages, succeeded by the great expansion of the centuries following the year 1000. The growth in farrning in the 8th- 9th C, resti.ng on a demographie increase combined with intensive land clearance episodes, owes much to the preceding centuries: the change resides more in the intensification than in the introduction of new features.
Archaeological analysis allows us to step back from making obviously simplistic generalisations. At the micro-regional scale, two agricultural economies coexist, a farming economy that h<3:s its roots in a protohistorie tradition, and an organised economy ruled by profit ('capitalistic'). Just as any other region, Southem France is not a homogeneous black. In the Roman period, the notion of heterogeneity in space enables us to integrate the opposition between the Roman and indigenous worlds, an opposition that has preoccupied many archaeologists. In the history of environments, it is not possible to talk in general terms of the impact of humans on the natural environment: the concept of anthropisation must be used at the level of the history of the societies being stuclied (Leveau 1997). Such is also the case in societies. Thus the administrative, social and economie aspects of romanisation can be distinguished. ln Narbonnaise Gaul, as in the other provinces during the Roman period, irreducible economie forms exist side by side. 'Rome' signifies in the first place a chronological period; in the second place it qualifies a social formation that has at its disposai means of intervention wh ose efficiency and . wh ose impact on the environment have no common measure with the preceding protohistoric societies. The term 'Protohistory' contains the same ambiguity: fust of ali it also identifies a chronological period and secondly a type of economy or a social formation that is otherwise qualified as 'indigenous'. The administrative integration of a geographical zone into the Roman province does not necessarily
1
f 1
! 1.
FARMING lJ."'1 1V1EDITERRANEAN FRA.t""'CE AND RURAL SETTLEMENT 241
translate itself into the adoption of methods of space management that are encountered in the more developed sectors- the territories of the Roman colonial foundations for example. This way of reasoning also applies to the Carolingian period. Historians have already underlined on a number of occasions the heterogenous character of Frankish constructions, notably in Septimania and in Provence where Hispanie, Germanie and Gallo-Roman influences are encountered. One of the great merits of the dynasty of Pippin the Brief, Charlemagne and his successors is to have attempted the unification of the Frankish kingdom and later empire, the fust form of the future Europe. On an economie level, Carolingian legislation, by means of capitularies, offers a model of organisation, that of the great estate, which possibly may never have been viable nor even attempted, if one follows its most fervent critics. Therefore, the term 'Carolingian' exhibits the same ambiguity as 'Protohistory' or 'Romanisation'. There is no Carolingian economy in the strict sense of the terrn, but the coexistence of different forms of spatial organisation and exploitation of the land. Bio-archaeological analyses demonstrate that any attempt to construct models on this subject is illusory and reaffirm the processes of human interaction with the landscape in ail its complexity.
Finally the concept of transition applied to our period must be criticised. The archaeology of the landscape and of the land shows clearly how much this primitive notion is inadequate and useless. Indeed the historical vocabulary does not have another specifie term to designate the span of time between the 4th-5th C and the Carolingian period: this hybrid situation is a perfect reflexion of a historical study that leads nowhere.
Translated by Madeleine Hummler, January 2001
Bibliographie
Acherki, N. ( 1997). Ana{yse pa{ynologique de quatre carottes du Golfe du Lion. Application à la restitution de la végétation et du climat du Midi de la France pendant le dernier cycle climatique et à la stratigraphie marine. Thèse, Université de Montpellier II, Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier, 158 p.
Alexandre, P. (1987). Le climat en Europe au Moyen Age. Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 827 p.
Amado, C. (1977). La seigneurie des mines en pays de Béziers et en Razès. Analyse de trois documents àe la seconde moitié du XII• siècle. In: lv/ines et mineurs .. . 1977: 123-144.
242 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Ambert, M. (1986). Le milieu naturel des étangs à l'époque médiévale. ln: Les étangs à fépoque médiévale . .. : 19-28.
Ambert, M., Ambert, P., Lugand, M. (1993). Le littoral des départements de l'Aude et de l'Hérault. Atlas des changements des lignes de rivage en Méditerranée occidentale au cours des 2000 dernières années. Archéologie en Languedoc, 17: 126-1 34.
Ambert, P. (1995). La branche orientale du delta de l'Hérault ou de J'insularité du volcan d'Agde à l'époque gréco-rom'\-ine. Hypothèses archéologiques et données
· géologiques. ln: Arcehn et al. 1995 (Etudes Massaliètes 4): 1 OS~ 112. -- ( 1995). Le couloir de l'Aude entre Carcassonne et la mer. ln: Guilaine 1995:
22 1-224. Amouretti, M.-C., Brunl. J.-P. and Eitam, D. (eds.) (1 993). La production du vin et de
t>huile en M éditmanée. e cole française, Athènes, 339 p. Amouric, H., Thernot, R., Vacca-Goutoulli, M., Bruneton, H. (2000). Un moulin
à turbine de .la fin de l'Antiquité. La Calade du Castellet (Fontvieille; Bouchesdu-Rhône). In: Leveau and Saquet 2000: 261-274.
André, J., Chabal, L., Bui, Thi Maï, Raynaud, C. (1997). Habitat et environnement autour de l'Etang de l'Or au premier mi1lénaire. Revue Archéologique de Narbonnaise, 30, 85-121.
Andrieu, V., Brugiapaglia, E., Cheddadi, R., Reille, M., Beaulieu, J.-1. (de), Barbera, M. (1999). A computerized data base for the palynological recording of human activity in the Mediterranean basin. In: Leveau et al. 1999: l 7-24.
Andrieu-Pond, V., Ponel, P., Bruneton, H ., Leveau, P., Beaulieu, J.-L. (de) (2000 a). Palaeoenvironments and cultural landscape of the last 2000 years reconstructed from pollen and coleopteran record in the Lower Rhône Valley, southern France. The Holocene 10, 3: 341-355.
--, Jull, A.J.-T., Beaulieu, J.-L. (de), Bruneton, H ., Leveau, P. (2000 b). 10,000 years of vegetation history in Lower Provence revealed by the pollen analysis of two new sediment profiles from Marais des Baux. Vegetation History and Archaeobotany, 9: 71-84.
Arcelin, P., Bats, M., Marchand, G., Schwaller, M. (eds) (1995). Sur les pas des Grecs en Occident, Études Massaliètes, 4, 492 p.
Archéologie et espace, Actes des rencontres des 19- 20-21 oct. 1989, APDCA, Juan-les-Pins, (1990), 523 p.
Arnaud-Fasetta, G., Beaulieu, J.-L. de, Suc, J.-P., Provansal, M., Williamson, D., Leveau, P., Aloïsi, J.-C., Gadel, F., Giresse, P., Evin, J., Duzer, D. (2000). Evidence for an early landuse in the Rhône delta (mediterranean France) as recorded by late Holocene fluvial paleoenvironments (1640~ l 00 BC). Geodinamica Acta, 13: 3 77-389.
Arthuis, R. and Ambert, P. (1997). Des étangs, un petit lac, de vastes paluds, une prairie assainie: l'évolution naturelle et artificielle des cuvettes périglaciaires dans la dépression de Tras-le-Puy (Gard), durant l'Holocène. In: Bumouf et al., 1997: 350-364.
Badan, 0., Brun, J.-P., Congès, G., (1995). Les bergeries romaines de la Crau d'Arles. Les origines de la transhumance en Provence. Gallia, 52: ·263- 310.
Bazzana, A. (ed.) (1999). Castrum 5, Archéologie des espaces agraires méditmanéens au Moyen Âge, Casa de Velazquez, École française de Rome, Ayuntamiento de Murcia, Madrid-Rome, 496 p .
Beaulieu, J.-L. de, Pons, A., et Reille, M. (1988). Histoire de la flore et de la végétation du Massif Central (France) depuis la fin de la dernière glaciation. Cahiers de micropaléontologie, N.S., 3, 4: 5- 35.
Beaulieu, J.-L. de, (1969). Analyses polliniques dans les Monts de l'Epinouse (Hérault). Pollen et Spores, I l : 83-95.
- - , ( 1977). Contribution pollenafytiquc à [>histoire tardiglaciaire et holocène de la l'égétation des Alpes Méridionales Françaises, Université d'Aix-Marseille III: 358 p.
Bedon, R. (ed.) (1998). Suburbia. Les faubourgs en Gaule romaine et dans les régionS voisines, Centre de Recherche A. Piganiol, Caesarodunum, 32, 356 p.
i 1·
1 1:
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 243
Bellamy, P. and Hitchner, R.-B. (1996). The \·illas of Vallée des Baux and the Barbegal Mill: Excavations at La Mérindo1e Villa and cemetery. Journal of Roman
· Archaeology, 9: 154-176. · Bender, H ., Wolff, H. (ed.) (1994). Ld.ndliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein
Donau Provinze des Romischen Reiclles, Passau, 2 vol., 5 19 p., 183 pl. Benoit, F. (1940). L'usine de meunerie hydraulique de Barbegal. &vue Archéologiqne,
15' 1 : 7 0-71. - - (1 959). L'Économie du littoral de la Narbonnaise. Revue d'Études Ligures, 25,
Bordigh era, 1959: 87-11 O. -- (1965). Le développement de la colonie d'Arles et la centuriation de la Crau,
Compte rendu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres: 156-169. Benzi, F., Berliocchi, L. ( 1999). L'histoire des plantes en Méditerranée. Art et botanique,
Actes Sud/Motta, Milan, 1 70 p. Bérato, J., Boreanni, M., Leguilloux, M. (1990). La villa gallo-romaine des Laurons
(quartier Saint-Pierre). Les Arcs sur Argens, Var. Documents d'Archéologie Méridionale, 13: 221-247.
Berger, J.-F. (2001). Evolution des agro- et hydrosystèmes dans la région médiarhodanienne. ln: O uzoulias et al. 200 1.
- - and Jung, C. (1996). Fonction, évolution et tap honomie des parcellaires en moyenne vallée du Rhône. Un exemple intégré en archéomorphologie et en géoarchéologie. ln: Chouquer 1996: 95-112.
- - (1999). Developing a methodological approach to the evolution of mid-rhodanian agro-systems during historical periods. ln: Leveau et al. 1999: 155-168.
-- (1995). Facteurs anthropiques et naturels de l'évolution des paysages romains et protomédiévaux du Bassin valdenais (Drôme). In: Van der Leeuw 1995: 79-1 14.
-- ( 1996). Le cadre paléogéographique des occupations du bassin ualdainais (Drôme) à l'Holocène, Thèse de l'Université de Paris I, 325 p.
--, Brochier, J.-L., J ung, C., Odiot, T. (1997). Données paléogéographiques et données archéologiques dans le cadre de l'opération de sauvetage archéologique du T.G.V.- Méditerranée. In: Burnouf ct al., 1997: 155-184.
--, Favory, F., Odiot, T., Zannier, M.-P. (1997). Pédologie et agrologie antique dans le Tricastin central (Drôme Vaucluse), d 'après les textes agronomiques et épigraphiques latins et les données géoarchéologiques. In: Burnouf et al., 1997: 127- 154.
--, Magnin, F., Thiebault, S., Vital,]., 2000. Emprise et déprise culturelle à l'âge du Bronze: l'exemple du bassin valdainais (Drôme) et de la moyenne vallée du Rhône, Bulletin de la société de Préhistoire française, 97- l: 95-11 9.
--, T hiébault, S., Holocene fire history in South East France: Impact of elimatic changes and human activities, colloque Fire and the Palaeoenvironment, Sheffield, 13-15 mars I 997.
Bertoncello, F. and Gazanbeek, M. (1997). Dynamiques du peuplement en moyenne montagne: le massif des Maures (Var) entre le deuxième âge du Fer et la fin de l'antiquité. In: Burnouf et al. 1997: 601-620.
Bertoncello, F. (1999). Le peuplement de la Basse Vallée de l'Argens et de ses marges (Var) de la fin de l'âge du Fer à la fin de l'Antiquité, Thèse de doctorat de l'Université de Provence, Aix-en-Provence, 503 p., 205 fig.
Bertrand, G. (1975). Pour une histoire écologique de la France rurale. ln: DUBY 1975: 34-1 13.
Bethemont,]. (1972). Le tMme de l'eau dans la vallée du Rhône. Essai de genèse d'un espace lfydraulique, Le Feuillet Blanc, Saint-Etienne, 642 p.
Beug, H.-J. (1975). Changes of climate and vegetation belts in the mountains of mediterranean Europe during the Holocene. Bulletin ofGeology (Varsovie), 19: 101-110.
Bilan scientifique, 22, Rhône-Alpes, 1996. Ministère de la culture, DRAC, Lyon, 208 p. Bilan scientifique, 11, Languedoc-Roussillon 1999, Ministère de la culture, DRAC,
Montpellier, 198 p.
!'
244 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Blanchard, R. ( 1952). Les Alpes occidentales. 5 Les grandes Alpes ji-ançaises du Sud, 2 vol., Grenoble.
Blanchemanche, P. (1990). Bâtisseurs de paysages, terrassements, épierrement et petiœ hydraulique agricole en Europe XVII'-XIX' siècle, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 329 p.
Bloch, M. (1935). Avènement et conquête du moulin à eau. Annales d'hiswire économique et sociale, 7: 538-563.
Boissinot, P. and Brochier, J.-E. (1997). Pour une archéOlogie du champ. In: Chouquer 1997: 35- 56.
Boissinot, P. (1997). Archéologie des façons culturales. ln: Burnouf et al. 1997: 85-112. Bonifay, M., Carre, M.-B., Rigoir, Y. (1998). Les fouilles de Marseille. Les mobiliers
(!"-VII' s.), Etudes Jvfassaliétes 5, Errance, Paris, 433 p. Borel, J.-L., Brochier, J.-L., Druard, J.-C. (1996). Séquences climatiques et occupa
tion du sol du VIII• au XI• siècle dans le terroir de Colletière. In: Colardelle 1996: 191- 196.
Bon-éani, M., Brun, J.-P. (1998). Deux moulins hydrauliques du Haut Empire dans le département du Var (Villae des Mesclans à La Crau et des Laurons/SaintPierre aux Arcs-sur-Argens). Gallia, 55: 279-326.
Bourin-Derruau, M. (1987). Villages médiévaux en Bas-Languedoc; t. l, Genèse d'une sociabilité (X'-XIV' siècle), L'Harmattan, Paris, 339 p.; t. 2, La démocratie au village, XIIJ<-XIV' siècles, L'Harmattan, Paris, 4 71 p.
Boyer, J.-P. and Emmanuelli, F.-X. (eds.), De Provence et d'ailleurs. Mélanges offerts à N. Coulet, Provence historique, 546 p.
Boyer, J.-P. ( 1990). Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval. La Vésubie (XII!'-XV' siècle), Centre d'ét.ude médiévale, Nice, 585 p.
Bravard, J.-P. and Presteau, M. (eds.) (1997). Dynamiques du paysage. Entretiens de géoarchéologie. Table ronde tenue à Ly on, les 17 et 18 novembre 1995, DARA, Lyon, 282 p.
Brenat, C. (1986). La circulation monétaire sur les sites de Lyon à la Méditerranée (IV•-vn• siècles). ln: Fevrier 1986: 197-199.
- - (1996). Du monnayage impérial au monnayage mérovingien; l'exemple d'Arles et de Marseille. In: Lepelley 1996: 14 7-160.
-- (1998). Fouilles de Marseille. Les mobiliers. vo- VIII• siècles après J-C. ln: Bonifay et al. 1998: 358-361.
Brochier, J.-E. (1983). Deux mille ans d'histoire du climat dans le Midi de la France. Annales (Économies, Sociétés, Civilisations), 8: 425- 438.
-- {1991). Géoarchéologie du monde agropastoral. ln: Guilaine 1991: 303-322. Brochier, J.-L. (1997). Contexte morphodynamique et habitat humain de la moyenne
vallée du Rhône au cours de la préhistoire récente. In: Bravard and Prestreau: 87-102.
Brun, J.-P. and Congès, G. (1996). Une crise agraire en Provence au troisième siècle? In: Fiches 1996: 233-256.
Brun, J.-P. (1986). L'oléiculture en Provence: les huileries du département du Var, CNRS, Paris, 312 p., 224 fig.
- - (1993). L'oléiculture et la viticulture antique en Gaule, instruments et installations de production. In: Amouretti and Brun 1993: 307-~41.
-- (1996). La grande transhumance à l'époque romaine. A propos des recherches sur la Crau d'Arles. Anthropozoologica, 24: 31-44.
-- (1999). Le Var, 83/1 et 2, Carte archéologique de la Gaule, Paris, 984 p. Brunaux, J.-L., Meniel, P. (1983). L'importation du bœuf à la période romaine:
premières données. Revue Archéologique de Picardie, 4: 15- 20. Bruneton, H. (1999). Evolution Holocène d'un hydrosystème nord-méditerranéen et de son envi
ronnement géommphologique. Les plaines d'Arles à l'interface entre le massif d.•s Alpilles et fe Rhône, Doctorat de l'Université d'Aix-Marseille I.
Buffat, L. and Petitot, H. (1998). Une activité métallurgique tarda-antique sur l'éta-
1 1
_,_,~-
FARMING IN MEDITERRAl\lEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 245
blissement de Mayran (Saint-Victor-Lacoste, Gard). ln: Feugère and Serneels 1998: 175-180.
Burnouf, J., Bravard, J.-P., Chouquer, J-P. (eds.) (1997). La 4Jnamique des paysages protohistoriques, antiques, médikaux et modernes, APDCA, Sophia-Antipolis, 624 p.
Buxo, I Capdevila, R. ( 1992). Cueillette et agriculture à Lattes: les ressources végétales d'après les semences et les fruits. In: Py 1992: 45- 90.
Buxo, R. and Pons, E. (eds.) (2000). Els productes ali.mentaris d'origen vegetal a l'edat del ferro de l'Europa occidental: de la produccio al consum. XXll' colloque intemational pour l'étude de l'Age du Fer, Monografies del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona, 18, Gérone, 413 p.
Caecalho-Quintela, A., Mascarenhas, J.M., Caedoso, J.-L. (1999). Ban-ages romains au sud du Tage (Portugal). ln: Gorges and German R odriguez Martin 1999: 197- 226
Carru, D., Gateau, F., Leveau, P. , Renaud, N., Berato, J, Bertoncello, F., Meffre, J.-C., lvlichel, J.-M., Mocci, F., Trément, F., Valentin, F . (2001). Les vi.llae en Provence aux IV• et V• siècles: apports et limites des inventaires archéologiques. In: Ouzoulias et al. 2001.
Castelvi, G. (1984). Les mottes castrales du Roussillon. Archéologie du Midi médiéval, 2: 15-26.
Caucanas, S. (1987). Les premières mentions de moulins en Roussillon. In: Grau and Poisson 1987: 167-174.
-- (1995). Moulins et irrigation en Roussillon, du IX' au XV' siècle, CNRS, Paris, 421 p.
Chabal, L. ( 1997). L'anthracologie, de l'échantillonnage des cha1·bons de bois à l'interprétation du paysage du Néolithique final à la période romaine en Bas Languedoc, Documents d'Archéologie Française, Paris, 189 p.
Chapelot, J., Fossier, R. (1980). Le village et la maison au Moyen Age, Hachette, Paris, 357 p.
Chouquer, G. (ed.) (1997). Les formes du pqysage, 3, L'ana!Jse des ~stèmes sjJatiaux, Errance, Paris, 198 p. VIII pl.
-- ( ed.), 1996. Les formes du paysage, 2, Archéologie des parcellaires, Paris, Errance, 263 p., XVI pl.
- - (2000). L'étude des paysages. Essais sur leurs formes et leur histoire, Paris, Errance, 208 p., 23 ill.
- - (1983). Localisation et extension géographiqu e des cadastres affichés à Orange. In: Clavel-Lévêque 1983: 275-295.
Christol, M., Layraud, J.-C., Meffre, J.-C. ( 1998). Le cadastre C d'Orange: révisions épigraphiques et nouvelles données d'onomastique, Ga/lia, 55: 337- 343.
Clavel-Lévêque, M. (ed.) (1 983 a). Cadastre et espace rural. Approclus et réalités antiques, CNRS, Paris.
-- and Vignot, A. (eds.) (1998). Cité et territoire II, Les Belles Lettres, Paris, 273 p. - - (1995). Atlas des Cadastres de Gaule -1-. Le réseau centurié de Béziers B, Les Belles
Lettres, Paris, 116 p. -- (1983 b). Pratiques impérialistes et implantations cadastrales: 223- 244 (le cas
de la Transalpine). Ktéma, 8: 240-24 7. Colardelle, M. (ed.) (1996). L'homme. et la nature du Mqyen Age, Actes du V< congrès
international d'archéologie médiévale, Grenoble, 6-9 octo~re 1993, Errance, Paris, 259 p.
Columeau, P. (1996). Pratiques cultuelles et spécialisation pastorale autour de l'Étang de Berre, de l'Âge du Fer à la fin de l'Antiquité. In: Gateau 1996: 128-136.
-- (1997). La Poussaraque. Les ressources de l'élevage. Revue Archéologique de Narbonnaise, 30: 27-30.
-- (1997). Variation de la hauteur du garrot du boeuf de la fin de l'âge du Fer à l'antiquité tardive dans-sud-est de la Gaule. In: Garcia and Meeks 1997: 153- 156.
-- (2000). Consommation de viande et élevage dans la vallée des Baux de l'âge
246 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
du Fer au Moyen Age d'après les vestiges osseux. ln: Leveau and Saquet 2000: 347- 357.
Cornet, G. (1999). Moulins de Provence et d'ailleurs. Historiographie, méthode et idéologie chez les historiens. In: Boyer and Emmanuelli 1999: 159-168.
Congès, G. (I 997). Bergerie et transhumance dans la Crau antique: innovation et adaptation. ln: Garcia and Meeks 1997: 149-152.
Coste, P., Coulet, N. (1994). Que sait-on des origines de la transhumance en Provence? ln: Duclos J.-C. and Pitte A., L'homme et le mouton dans l'espace de la transhumance, Glénat, Grenoble: 65- 70.
Coulet, N. (1993). Une opération de drainage en Basse Provence orientale au xve siècle. Rives nord méditerranéennes, 8, GIS 'Cultures et Civilisations Méridionales (Xl'- XX') (Université de Provence): 58-61 .
Damas, I. (1998). Un castrum artisanal: Calberte en Gévaudan (XII<-XIV< siècle). ln: Feller et al. 1998: 335- 348.
Dauzat, M. (1983). Les mottes castrales du Lauragais: notes préliminaires, Le Lauragais. Histoire et archéologie.
Davasse, B., Galop, D., Rendu, C. (1997). Paysages du Néolithique à nos jours dans les Pyrénées de l'Est d'après l'écologie historique et l'archéologie pastorale. ln: Burnouf et al. 1997: 577-599.
Demians, D'Archimbaud, G. (ed.) (1994). L'oppidum de Saint-Blaise (Bouches-du-Rlzône) du V' au VIII' s., Documents d'Archéologie Française 45, Paris, 264 p., 172 ill.
Dion, R. ( 1 959). Histoire de la vigne et du vin en France. Des origines au XIX' siècle, Paris, Duby, G. (ed.) (1975). Histoire de la France rurale. T. 1 La formation des campagnes .fran
çaises des origines au XIV' siècle, Seuil, Paris, 624 p. -- 1975. Avant-propos. ln: Duby 1975: 19-75. -- ( 1 962). L'économie rurale et la vie des campagnes dans L'Occident médiéval (France,
Angleterre, Empire, lX'-XlV' siècles), t. 1, Aubier, Paris, 285 p. Durand, A. ( 1998). Les paysages médiévaux du Languedoc, Toulouse, Presses universitai
res du Mirail, 491 p. -~ (2002). Les moulins carolingiens du Languedoc de la fin du VIlle siècle au
milieu du XI• siècle. ln: Mousnier, 2002: 31- 52. - -, Forest, V., Gardeisen, A., Ruas, M.-P. (1997). Approches bioarchéo1ogiques
de l'habitat castrai languedocien: huit sites de la bordure méridionale du Massif central. Histoire et Sociétés rurales, 8: 11- 32.
Durand-Dastès, F., Favory, F., Fiches,J.-L., Mathian, H., Pumain, D., Raynaud, C., Sanders, L., van der Leeuw, S. (1998). Des oppida aux métropoles. Archéologues et géographes en vallée du Rhône, Anthropos, Paris, 280 p.
Fabre, G., Bourin, M., Caille, J., Debord, A. (ed.) (1996). M01phogenèse du village médiéval (lX'-Xlft si~cles). In: Actes de La table ronde de Montpellier (22-23 février 1993), Inventaire général, Cahiers du patrimoine, Montpellier, 299 p.
Farizier, M. (1980). Recherches sur Les macroflores des tufs quaternaires du Sud de La France. DESS., Ecole pratique des Hautes études, Université des Sciences et Techniques du Languedoc-Montpellier II, 326 p. et XXVII planches.
Favory, F. and Fiches, J.-L. {eds.). (1994). Les campagnes de la France méditerranéenne dans l'Antiquité et le haut Moyen Age. Études microrégionales, Paris, Documents d'Archéologie Française 42, 339 p., 205 ill.
Favory, F. (1988). Le site de Lattes et son environnement (France Hérault), d'après les images aériennes et les documents planimétriques. Lattara 1: 15-56.
-- (I 996). Morphologie agraire isocline avec une limitation romaine. Acquis et problèmes. ln: Chouquer 1996: 193-200, pl. VI- IX.
Feller, L., Mane, P., Piponnier, F. (eds.) (1 998). Le village médiéval et son environnement. Mélanges qfferts à ]. -M. Pesez, Publications de la Sorbonne, Paris, 683 p.
Feugère, M. and Serneels, V. (eds.) (1998). Recherches sur L'économie dufer en Méditerranée nord occidentale, (Monographie /nstrumentum, 4), Monique Mergoil, Montagnac, 263 p.
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE Al'ID RURAL SETILEMENT 24 7
Février, P.-A. (1978). Problème de l'habitat du Midi méditerranéen à la fin de l'Antiquité et dans le Haut Moyen Age. Jahrbuch des-rb'misch-germanischen .<:,entra/museums lvfainz.: 208-24 7.
-- (ed.), 1986. Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale. Antiquité tardive et haut Moyen Age Ill'-VIII' siècles, Archéologie médiévale en Rhône-Alpes, Association Lyonnaise de Sauvegarde des Sites Archéologiques MédiévalL'<, Lyon, 210 p.
- - (1981). Villes et campagnes des Gaules sous l'Empire. Ktéma, n° 6: 359-372. Fiches, J.-L. (ed.) (1989). L'oppidum d'Ambrussum et son territoire, CNRS, Paris, 286 p. - - ( ed.) ( 1996). Le Ill' siècle en Gaule Narbonnaise. Données régionales sur la crise de
l'Empire, APDCA, Juan-les-Pins, 404 p. -- (ed.), Bérato, J., Brentchalof, D., Chouquer, G., Dubar, M., Gazenbeek, M.,
Latour, J., Rogers, G.B. (1995). Habitats de l'Age du Fer et structures agraires d'époque romaine aux Escaravatiers (Puget-sur-Argens, Var). Gallia, 52: 205-261.
Fiches, J.-L. and Veyrac, A. (eds.) (1996). Nfrnes 3011. Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 634 p., XXXI pl.
Finley, M.I. (ed.) (1976), Studies in Roman Properf:y, Cambridge. Fixot, M. and Zadora, Rio, E. (eds.) (1994). L'environnement des églises et la topographie
religieuse des campagnes médiévales, Documents d'Archéologie Française 46, Paris, 184 p., 90 ill.
Fixot, M. (1975). La motte et l'habitat fortifié en Provence médiévale, ChâteauGaillard. Etudes de castellologie médiévale, Actes du colloque international tenu à Blois 2- 7 septembre 1974, 7, C.N.R.S.-Université de Caen, Caen: 67- 93.
- - (1994). L'église médiévale dans l'espace rural provençal d'après les fouilles récentes. ln: Fixot and Zadora-Rio 1994: 36-47.
Flamn ( 1990): La croissance agricole du haut MC!Jien Age. Chronologie, mod(llités, Géographie, Actes des 1 Oe Journées internationales d'histoire médiévale et moderne tenues au Centre culturel de l'abbaye de Flaran des 9-11 septembre 1988, Comité départemental du Tourisme du Gers, Auch, 1990, 205 p.
-- (1992): Plantes et cultures nouvelles en Europe occidentale, au Moyen Age et à l'époque moderne, Actes des 12e Journées internationales d'histoire médiévale et moderne tenues au Centre culturel de l'abbaye de Flaran les 11-13 septembre 1990, Valence-sur-Baïse, Centre culturel de l'abbaye de Flaran, 155 p.
Forest, V. and Rodet-Belarbi, I. (1997). Augmentation du format des bovins en Gaule romaine: problèmes méthodologiques et inno\!ation technique. In: Garcia and Meeks, 1997: 166-171.
-- (1998). Ostéométrie du métatarse des bovins en Gaule de la Conquête romaine à l'Antiquité tardive. Revue Méd. Vétérinaire, 149, Il: 1033-1056.
Galop, D. ( 1998). La forêt, l'homme et le troupeau dans les Pyrénées. 6000 ans d'histoire de l'environnement entre Garonne et Atféditerranée. Contribution palynologique, Géode, Toulouse, 285 p.
Garcia, D. and Meeks, D. (ecls.) (1997). Techniques et écorwmie antiques et médiivales. Le temps de l'innovation, Errance, Paris, 239 p.
Garcia, D. (1992). Les éléments de pressoirs de Lattes et l'oléiculture antique en Languedoc. ln: PY 1992: 237-258.
Garmy, P. and Monteil, M. (eds.) {2000), Le quartier antique des Bénédictins à Nîmes (Gard), Documents d'Archéologie Française 81, Paris, 282 p, 236 fig.
Garnier, B., Garnotel, A., Mercier, C., Raynaud, C. (1995). De la ferme au village: Dassargues du V• au XII• siècle (Lunel, Hérault). Archéologie du Midi Médiéval, 13: 1-78.
Gascou, J. and Leveau, P. {1996). Un témoignage sur l'économie domaniale près d'Arles au début de l'Empire? Un membre d 'un collège de jabri à Barbegal (Fontvieille, Bouches-du-Rhône). Ktéma, 21: 237- 250.
Gateau, F. and Gazenbeek (eds.) (1999). Les Alpilles, 1312, Carte Archéologique de la Gaule, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 464 p.
248 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Gate_au, F. (1996). Bouches-du-Rhône, 13, Carte Archéologique des communes des 1ives de l'Etang de Berre, Carte Archéologique de la Gaule, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 380 p.
- - (1997). L'établissement rural de la Pousarague, Revue Archéologique de Narbonnaise, 30: 5-31.
Gazenbeeck, M. ( 1998). Prospections systématiques autour de Glanum (Bouches-duRhône): l'extension de l'agglomération. In: Bedon 1998: 83- 103.
Ginouvèz, O. , J anin, T., Vidal, L., Poupet, P. (1990). Paléosols et structures agraires enfuies: quelques exemples d'approche du paysage rural. ln: Archéologie et espace, 1990: 383-418.
Ginouvez, 0., Pomarèdes, H., Feugère, M., 1998. Le travail du fer dans la villa de la Domergue à Sauvian (Hérault). In: Feugère and Sernee1s 1998: 181-185.
Ginouvez, O. (1993). Des maisons excavées à Narbonne autour de l'an Mil. Archéologie du Midi Médiéval, 11: 53-68.
Gorgs, J.-G. and German Rodriguez Martin F" (eds.) (1999). Economie et territoire en Lusitanie romaine, 65, Casa de Velazquez, Madrid, 555 p.
Goury, D. (1997). L'oppidum du Camp de César à Laudun (Gard) : premières acquisitions de la recherche 1990-1994. Revue Archéologique de Narbonnaise, 30: 125-172.
Grau, M . and Poisson, O. (eds.) (1987). Etudes roussillonnaises qffertes à Pierre Ponsùh. Mélanges d'archéologie, d'histoire et d'histoire de l'art du Roussillon et de la Cerdagne = Estudis rossellonesos dedicata a en Pere Ponsich: rniscellània d'arqueologia, historia de l'art del Rosselo i de la Cerdanya, Le Publicateur, Perpignan, 558 p.
Gros, P. (1995). H ercule à Glanum, sanctuaires de transhumance et développement 'urbain'. Gallia, 52: 311-331.
Guilaine, J. (ed.) (1991). Pour une archéologie agraire, Colin, Paris, 576 p. - - (ed.) (1995). Temps et espace dans le bassin de !>Aude du néolithique à l1Âge du Fer,
Centre d'Anthropologie des Sociétés rurales, Toulouse, 442 p. Izard, V. (1999). Les montagnes du fer. Eco-histoire de la métallurgie et des forêts dans les
Iyrénées méditerranéennes (de !>Antiquité à nos jours). Pour une histoire de l'environnement, Thèse de l'université de Toulouse II-le-Mirail, t. I, 560 p. , t. II, 192 p.
Jalut, G. (1991). Le pollen, traducteur du paysage agraire. In: Guilaine 1991: 345-368. Jalut, G., Esteban Amat A., Bonnet L., Fontugne M., Gauque1in T., (2000). Holocene
climatic changes in the Western Mediterranean, from south-east France t6 southwest Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Paleoecology, 160: 255- 290.
Jalut, G., Esteban, Amat, A., Riera, Mora S., Fontugne, M., Mook, R., Bonnet, L., Gauquelin, T. (1997). Holocene climatic changes in the western Mediterranean: installations of the Mediterranean climate. Compte Rendu à l'Académie des Sciences de Paris, Sciences de la terre et des planètes, 325: 327-334.
J orda, M. and Mocci, F. (1997). Sites protohistoriques et gallo-romains du massifde Sainte-Victoire dans leur contexte morphodynamique. ln: Burnouf et al. 1997: 212-229.
J ourdan, L. (1976). La faune du site gallo-romain et paléochrétien de La Bourse à Marseille, CNRS, Paris.
J ournot, F. ( 1990). Archéologie des châteaux médiévaux de la montagne héraultaise (bassin de l'Orb et de la Lergue), xe- XIV' siècle, thèse d'archéologie et d'histoire de l'art de l'Université de Rennes II, t. I, 313 p., t. II, 283, t. III, 302 p.
Kotarba, J., Alessandri, P., Compan, M., Pezin, A., Pomaredes, H. (1 987). Arles-13, Augery de Corrèges- Sauvetage programmé, rapport de fouille, Service régional de l'archéologie du Languedoc-Roussillon.
Krauss-Marguet, I. (1981). :\nalyse anthracologique du gisement postglaciaire de la Poujade (Millau, Aveyron). Paléobiologie Continentale, 12, 1, 9: 93- 11 Q.
Laffont, P.-Y. (1998). Châteaux, pouvoirs et habitats en Vivarais, X'-XII!' siècles, Thèse Université de Lyon II, vol. I, 372 p. and vol. II, 344 p.
i
(
1.
1
F.ARlYIING IN l\ŒDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 249
Laubenheimer, F. (1985). La production des amphores en Gaule narbonnaise, Belles Lettres, Paris, 426 p.
Lavagne, H. (1981). Les nouvelles mosaïques de la villa gallo-romaine de Loupian (Hérault). Revue Archéologique de Jvarbonnaise, 14: 173-203.
Laval, H. and Malléa, M. (1993). Analyse sporopollinique de sédiments médiévaux à Augery, Camargue. ln: Leveau and Provansal 1993: 387-390.
Laval, H. and Medus,]. ( 1994).- Une séquence pollinique subboréal-subatlantique dans la vallée des Baux: changements de végétation, climatiques et anthropogéniques de l'âge du Bronze à celui du Fer en Provence. Archives Sciences de Genève, 47, 2: 83-94.
Laval, H., Medus, J., Roux, M. (1991). Palynological and sedimentological records of Holocene human impact for the Etang de Berre, southeastern France. The Holocene, l-3: 269-272.
Leenhardt, M., Raynaud, C., Schneider, L. (eds.) (1993). Céramiques languedociennes du haut Moyen Age (VII-XI• s.). Etudes micro-régionales et essai de synthèse. Archéologie du Midi Médiéval, 11: 111-228.
Leguilloux, M. (1989). La faune des villae gallo-romaines dans le Var: aspects économiques et sociaux. Revue Archéologique de Narbonnaise, 22: 311-322.
~- (1998). La faune tardive du port de Marseille (V<-VII< s. ap. J.-C.) d'après les fouilles de la Bourse (1980-1981 ). Revue Archéologique de Narbonnaise, 31: 233-253.
~-, L'acquisition des techniques d'élevage en Narbonnaise orientale. ln: Garcia and Meeks 1997: 172-174.
Lepelley, C. (1996). La fin de la cité antique et le dibut de la cité médiévale de la fin du Ill' siècle à !>avènement de Charlemagne. Actes du colloque (Paris, 1-3 avril 1993), Edupuglia, Bari: 147-160.
Lepetz, S. (1997). L'amélioration des espèces animales domestiques à la période romaine en France du Nord. ln: Garcia and Meeks 1997: 157-165;
Leroy, S. (1995). Analyse palynologique du forage Peyriac-Sud. ln: Guilaine 1995: 369-390. Les étangs à !>époque médiévale d'Aigues-Mortes à Maguelone, (1986). Catalogue de l'exposi
tion, Musée archéologique, Lattes, 173 p. Leveau, P. and Provansal, M. (1993). Archéologù et environnement: de la Sainte- Victoire
aux Alpilles, Publications de l'université de Provence, Aix-en-Provence, 551 p. Leveau, P. and Saquet, J.-P. (eds.), 2000. Milieux et société dans la vallée des Baux, Revue
Archéologique de Narbonnaise, supl. 31, Montpellier, 2000, 390 p. Leveau, P. (1993). Sociétés antiques et écologie des milieux montagnards et palustres.
(La construction des paysages méditerq.néens). ln: Leveau and Provansal, 1993. ~- (1996). The Barbegal water mill in its environment: and the economie and
social history of antiquity. Journal of Roman Archaeology, 9: 137~ 153. ~- ( 1997). L'archéologie des paysages et les époques historiques: les grands amé
nagements agraires et leur 'signature' dans le paysage (anthropisation des milieux et complexité des sociétés). ln: Mornet and Morenzoni 1997: 71-84.
~- (1999). The Integration of archeological, historical and environmental data: the examp1e of the 'Vallée-des-Baux' (Bouches-du-Rhône, France). ln: Leveau et al. 1999: 193-206.
-- (2000). L'archéologie des paysages aux époques historiques. Annales, Histoire, Sciences sociales, 3: 555-582.
- - , Heinz, C., Laval, H., Marinval, P., Médus,]. (1991). Les origines de l'oléiculture en Gaule du Sud. Données historiques, archéologiques et botaniques. Revue d'Archéométrie 15: 83~94.
--, Provansal, M ., Bruneton, H. , Palet-Martinez, J.-M., Poupet, P. ·walsh, K., 2002. La crise environnementale de la fin de l'Antiquité et du haut Moyen Âge: définition d'un modèle et retour au milieu réel. ln: Richard and Vignot 2002: 291-304.
250 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
- -, Trément, F., Walsh, K. and Barker, G. (ed.), 1999. Environmental Reconstruction in Mediterranean Landscape ArchaeoloKJ, Oxbow Book, Oxford, 210 p.
Liou, B. and Morel, M. ( 1977). L'orge des Ca vares. Revue Archéologique de Narbonnaise, 10: 189-197.
Lorren, C. and Périn, P. (eds.), 1995. L'habitat rural du haut Moyen Age (France, PaysBas, Danemark, Grande-Bretagne). Actes des XIVe joumées d'archéologie mérovingienne, Paris, 1993, Musée des Antiquités de Seine Maritime, Rouen, 237 p.
MacDermott, F., Frisia, S., Huang, Y., Longinelli, A., Spiro, B., Heaton, T., Hawkesvvorth, C., Borsato, A., Keppens, E., Fairchild, I ., Van der Borg, K., Verheyden, S., Selmo, E. (1999). Holocene climate variability in Europe: evidence from ol80, texturai and extension-rate variation in three spe1eothems. Qy.atemary Science Review, t. 18: 1021-1038.
Magny, M. and Richard, H . (1992). Le climat à la fin de l'Age du Fer et dans l'Antiquité (500 BC-500 AD). Méthodes d'approche et résultats. Les Nouvelles de l'Archéologie, 50 p.
Magny, M. (1992). Les fluctuations des lacs jurassiens et subalpins. In: Magny and Richard 1992: 32-36.
Marinval, M.-C. and Thiebault, S. (1996). Faune et flore témoins de l'exploitation du territoire rural. In: Collardelle 1996: 11-19.
Marinval, P. (1997). Vigne sauvage et vigne cultivée dans le b assin méditerranéen. Émergence de la viticulture. Contribution archée-botanique. ln: L'histoire du uin. Une histoire de rites, Paris, 13 7-1 7 2.
-- (2000). Agriculture et structuration du paysage agricole à Marseille grecque et dans les sociétés indigènes aux premier et second Ages du Fer. Pallas , 52.
Maufras, 0., Fabre, L., Colomer, G., Sedraoui, Z. (1998). Une forge tardive (IV-V' s.) sur le site de La Ramière (Roquemaure, Gard). In: Feugère and Serneels 1998: 210-221.
Mauné, S. and Feugère, M. (1999). La villa gallo-romaine de Lieussac (Montagnac, Hérault, France) au VI• s. de notre ère. Archii.ologisches Korrespondan.;:.blatt, 29: 377-394.
Mauné, S. (1998). Les campagnes de la cité de Béziers dans l'Antiquité (partie nord-orientale) (II1 s. av. ].-C., 117e s. ap. J.-C), Montagnac, Monique Mergoil,_ 532 p.
-- (1999). Paulhan. Vareilles. In: Bilan scient:jfique Languedoc-Roussillon 1999: 142-144. --, Sanchez, C., Forest, V., Chabal, L., Bouchette, A. (1998). L 'établissement
rural des Jurières-Basses à Puissalicon (Hérault) I•' s.-VI• s. ap. J.-G., Contribution à l'histoire des campagnes de la cité de Béziers dans l'Antiquité. In: ClavelLévêque and Vignot 1998: 73-121.
Mazoyer, M. and Roudart, L. ( 1997). Histoire des agricultures du monde du néolithique à la crise contemporaine, Le Seuil, Paris, 564 p.
lVfercier, C. and Raynaud, C. (1995). L'habitat rural en Gaule Méditerranéenne aux VI•-VII• s. Approche régionale et étude de cas. In: Lorren and Perrin, 1995: 194-206.
Metailie, J.-P. (198 1 ). Le feu pastoral dans les Pyrénées centrales (Barousses, Oueil, [.m·bous~, CNRS, Paris, 294 p.
Mines et mineurs en Languedoc-Roussillon et régions voisines de l'Antiquité à nos jours, (1976). Actes du XLIXe congrès de la fedération historique du Languedoc et du Roussillon organisé à Alès les 22 et 23 mai 1976, La Fédération, Montpellier, 334 p.
Monteil, M., Barberan, S., Piscorz, M . and Vidal, Bel V., Sauvage, L. (1999). Culture de la vigne et traces de plantation des II<-Ier s. av. J.-C. dans la proche campagne de Nîmes (Gard, France) . Rroue Archéologique de Narbonnaise, 32: 67- 124.
Mornet, E. and Morenzoni, F. (eds.) (1997). A1ilicux naturels, espaces sociaux. Études o.f!ertr.s à Robert Delort, Paris, Publications de la Sorbonne, 161 p.
Mousnier, M. (ed.) (2002). L'artisan au village dans l'Europe médiévale et moderne, Actes des 19e journées internationales d'histoire médiévale et moderne tenues à Flaran (septembre 1997), Presses universitaire du Mirail, Toulouse.
FARMING IN MEDITERRANEAN FRAl~CE Al'ID RURAL SETTLEIV!ENT 251
-- (ed.) (2002). Moulins et meuniers dans les campagnes européennes (IX'-XH!l' siècle), Actes des journées internationales d'histoire médiévale et moderne tenues à F1aran (3-5 septembre 1999), Presses universitaires du Mirail, T oulouse, 286 p.
Neboit, R. (1991). L'homme et l-'ùosion. L'érosion des sols dans le monde, Publications de la Faculté des Lettres, Clermont-Ferrand, 269 p.
Odiot, Th. (1996). Donzère. Le Mollard (26). ln: Formes de l'habitat tural en Gaule narbonnaise, n. 3, Sophia Antipolis, 25 p.
Ouzoulias, P., Pellecuer, C. R aynaud, C. (200 1 ). Les campagnes de la Gaule à la fin de l'Antiquité. Actes du colloque de Montpellier, APDCA, Antibes,
Palet, J.-M. ( 1997). Estudi territorial del .Pla de Barcelona. Estructuracié i evolucié del terrilori entre l'època iberoromana i l'altmedieval. Segles 11- 1 aC-X- XI dG, Barcelona, 218 p.
Pals, J.-P. (ed.) (1992). Festschrifl for Professor W Van ,Zeist, Review of Paleobotany and Palynology, 73.
Parodi, A., Raynaud, C., Roger, J.M. (1987). La Vaunage du III' siècle au milieu du XII• siècle. Habitat et occupation du sol. Archéologie du lvfidi Médiéval, 4: 3-59.
Patzelt, G. (1994). Die klimatischen Verhaltnisse im südlichen Mitteleuropa zur Réimerzeit. ln: Bender and Wolff 1994: 7- 20.
Pellecuer, C. (1998). Le travail du fer dans la villa des Près-Bas à Loupian (Hérault). ln: Feugère and Serneels 1998: 166-174.
-- (1996). Villa et domaine. ln: Fiches 1996: 277- 291. -- (2000). La villa des Prés-Bas (Loupian, Hérault) dans son environnement. Contkibution
à L'étude des villae et de l'économie domaniale en Narbonnaise, Thèse de Doctorat, Université de Provence, 565 p.
Pesez,J.-M. (1991). Outils et techniques agricoles du monde médiéval. ln: Guilaine 1991: 131-164·.
Piganiol, A. (1962). Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange, Gallia suppl. 16, CNRS, Paris, 4·34 p., 36 fig., 47 pl.
Planchais, N. (1982). Palynologie lagunaire de l'étang de Mauguio. Paléoenvironnement végétal et évolution anthropique. Pollen et Spores, XXIV: 93-118.
-- (1985). Analyses polliniques du remplissage holocène de la lagune de Canet (plaine du Roussillon, département des Pyrénées Orientales). Ecologia mediterranea, li, fasc. 1: 117- 127.
Pons, A. and Quezel, P. (1998). À propos de la mise en place du climat méditerranéen. Compte Rendu à l'Académie des Sciences, Paris, Sciences de la T erre et des planètes, 327, série II a: 7 55-760.
Poupet, P. (1989). La société agricole et son rapport avec l'espace. ln: Fiches 1989: 263-266. .
-- (1994). Quelques éléments pour l'histoire de l'espace rural et de l'agriculture antique en Tricastin: le quartier des Hauts-Palus, Suze-la-Rousse (Drôme). ln: Favory and Fiches 1994: 108-116.
-- (2000). L'anthropisation des pentes du mont Cavalier: archéologie agraire en milieu urbain. ln: Garmy and Monteil 2000: 27-40.
Provansal, M., Berger, J.-F., Bravard, J.-P., Salvador, P.-G., Arnaud-Fassetta, G., Bruneton, H., Vérot-Bourrely, A. (1999). Le régime du Rhône et les mutations des environnements fluviaux du lac de Genève à la mer. Gallia 56: 13-32.
Provansal, M. (1996). The part of climate in morphogenesis from the Bronze Age in Provence, southem France. 17ze Holocene, 5, 3: 348-353.
Provost, M . (1984). L'homme et les fluctuations climatiques en Gaule dans la deuxième moitié du II< siècle après J.-C. Revue Archéologique, 1: 71-78.
Puertas, 0 . (1998). Palynologie dans le delta du Lez. Contribution à l'histoire du po;ysage de Lattes. Lattara Il, Lattes, 181 p.
-- (2000). Spatialisation des activités agricoles dans te delta du Lez à partir de l'analyse pollinique. ln: Buxo and Pons 2000: 43-49.
252 ALINE DURAND AND PHILIPPE LEVEAU
Py, M. (ed.), 1992. Recherches sur l'économie vivrière des Lattarenses. Lattara 5, Lattes, 34-3 p. Quilici Gigli, S. (1989). Paesaggi storici dell'agro falisco. I prata di Corchiano.
Opuscola Romana, 1 7: 12 3-135. Quilici, L. and Quilici-Gigli, S. (ed.) (1995). Inten;enti di bonifica agJ·aria nell'ltalia romana,
Atlante tematico di topogrofia antica, 4-, L'Erma di Bretschneider, Roma, 248 p. Quilici-Gigli, S. (1 995). Bonifica agraria e difesa dei territori montani. Alcuni inter
venti nella bassa Sabina. In: Quilici and Quilici-Gigli 1995: 129-156. Raynaud, C. (ed.), Brien-Poitevin, F., Chabal, L., Columeau, P., Diot, M.-F., Durant, A,
Manniez, Y., Ruas, M.-P. (1990). Le village gallo-romain et médiéval de Lunel Viel (Hérault), La fouille du quartier ouest (1981-1983). Annales littéraires de l'université de Besançon, Besançon, 353 p.
Raynaud, C. and Schneider, L. (2000). L'habitat en marge. Grottes et sites perchés en Languedoc et en Provence. ln: Ouzoulias et al. 2001.
Raynaud, C. (1996). Les Campagnes rhodaniennes: quelle crise? In: Fiches 1996: 189-212.
--, 1998. L'activité métallurgique à Lunel-Vieil (Hérault) du r•r au XI< s. In: Feugère and Serneels 1998: 155-165.
Reille, M. (1991). L'origine de la station de pin à crochets de la tourbière de Pinet (Aude) et de quelques stations isolées de cet arbre dans les Vosges et le Jura. Bulletin de la Société Botanique de France, 138, 2: 123- 4-8.
Richard, H. and Vignot, A. (eds.), 2002. Équilibres et rupture dans les écosystèmes dur(JJlt les 20 demien millénaires: durabilité et mutation. Les Belles lettres, Paris, 4-88 p.
Riera, I. and Mora, S. (1995). Evolucio del paisatge vegetal holocè al Pla de Barcelona a partir de les dades polliniques, Barcelone, Universitat de Barcelona. Colleccio de Tesis Doctorals. 1v1icrofixades.
-- (2000). Anthropisation du paysage végétal dans la vallée des Baux: premiers résultats de prélèvements paJéo-polliniques effectués durant l'opération 'Artère du Mjdi. In: Leveau and Saquet 2000: 359- 372.
Rivet, A.L.F. (1988). Gallia Narbonensis, Batsford, London, 370 p. Rivet, L. (1 996). Saint-Julien-lès-Martigues. ln: Gatea,u 1996: 24-9-254. Roth-Congès, A. (1997). La fortune éphémère de Glanum: du religieux à l'économi-
que (à propos d'un article récent). Gallia, 54-: 15 7- 202. Royet, R. (1996). Saint-Martin de Jalionas. In: Bilan scientifique Rhône-Alpes, 1996: 116. Ruas, M.P. and Marinval, P. (1991). Alimentation végétale et agriculture d'après
les semences archéologiques (de 9,000 avantj.-C. au XIV• siècle). ln: Guilaine 1991: 409-4-39.
Ruas, :tvL-P. (1992). Les plantes exploitées en France d'après les semences archéologiques. ln: Flar(JJl 1992: 9-35.
- - (1992). The archeobotanical record of cultivated and collected plants of economie importance from medieval sites in France. ln: Pals 1992: 301-314.
- - ( 1996). Eléments pour une histoire de la fructiculture en France: données archée-botaniques de l'Antiquité au XVII• siècle. ln: Colardelle 1996: 92-105.
-- (1999). Semences archéologiques, miroir des productions agraires en France méridionale du VI• au XVI• siècle. In: Bazzana 1999: 301-316.
Sapin, J. (1981). Jalons géographiques pour l'histoire d'un milieu de vie antique: 'La Vaunage'. Documents d'archéologie méridionale, 4: 169-178.
Sclafert, T. (1959). Cultures en Haute Provence: déboisement et pâturages au Moyen Age, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 271 p.
Serres, F. (1979). Résultats dendroclimatiques pour les Alpes méridionales françaises. In: Evolution des atmosphères planétaire et climatologiques de la T me, colloque international, CNE S: 381-386.
Sigaut, F. (1975). L'agriculture et lefeu, Editions de la Maison des Science5 de l'Homme Paris, 320 p.
Stouff, L. (1988). L'olivier et .l'huile d'olive en Provence aux derniers siècles du Moyen Age. Provence historique, 38: 181-191.
FARMING IN MEDITERRANEAN FRANCE AND RURAL SETTLEMENT 253
-- (1993). La lutte contre les eaux dans les pays du Bas-Rhône (XJI•-XV< siècles). L'exemple du pays d'Aries. Méditerranée, 3/4: 57-68.
Terral, J.-F. (1997). Le début de la domestication de l'olivier (Olea europea L.) en Méditerranée nord-occidentale, mise en évidence par l'analyse morphométrique appliquée à du matériel anthracologique. Compte Rendu ife l'Académie des Sciences Paris, 324, série Ha: 417-425.
Thomas, A. and Wilson, A. (1994). Water supply for Roman farms in Latium and South Etruria. Papers if the British School at Rome (iVJacmillan London}, 99: 15 7-158.
Trément, F. (ed.), Berato, J., Berger, J.-F., Bertoncello, F., Borréani, M., Gateau, F., Gazenbeek, M., Landurée, C., Mocci, F., Meffre, J.-C., Odiot, T., Pasqualini, M. (200 l ). Le peuplement rural de la Provence, de la basse et moyenne vallée du Rhône aux JVe et ve s. In: Ouzoulias et al. 200 l.
Trément, F. (1999a). Archéologie d'un paysage. Les étangs de Saint-Blaise, Documents d'Archéologie Française, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris, 314 p.
-- ( 1999b). The integration of .historical, archaeological and paleoenvironmental data at the regional scale: the Etang de Berre, southern France. In: Leveau et al. (eds.) 1999: 193-205.
Triat-Laval, H. (1978). Contribution pollenana{ytique à l'histoire tardi- et postglaciaire de la végétation de la basse vallée du Rhône. Thèse, Université Aix-Marseille III, 3, 343 p.
-- (1982). Pollenanalyse de sédiments quaternaires récents du pourtour de l'Étang de Berre. Ecologia Mediterranea, VIII, 4: 97-115.
Van der Leeuw, S. (ed.) (1995). L'!wmme et la dégradation de l'environnement, XV' Rencontres internationales d)Archéologie et d'Histoire d'Antibes, APDCA, Sophia Antipolis, 514 p.
Van Osse!, P. and Ouzoulias, P. (2000). Rural settlement economy in Northern Gaul in the Late Empire: a overview and assessment. Journal if Roman Archaeology, 13: 134-160.
Van Ossel, P. (1992). Etablissements ruraux de l'Antiquité tardive dans le Nord de la Gaule, CNRS, Paris, 470,p.
Vernet,J.-L. (1973). Etude sur l'histoire de la végétation de la France au Quaternaire d'après les charbons de bois principalement. Paléobiologie continentale, 4, 1 Montpellier, 90 p. 13 p.
Vernet, J.-L., Pachiaudi, C. , Bazile, F., Chabal, L., Durand, A, Fabre, L., Heinz, C ., Solari, M.-E., Thiebault, S. (1996). Les variations du 8 C 13 sur une série de charbons de bois préhistoriques et historiques méditerranéens de 35,000 BP à l'actuel. Premiers résultats. Compte Rendu à l'Académie des Sciences de Paris, t. 323, série IIA: 323-324.
Vidal, L. (2000). Aménagement et mise en valeur des campagnes de La Protohistoire au Moyen Âge dans le sud de la France: !>exemple du Languedoc central et oriental, thèse de doctorat de l'Université de Montpellier III-Paul Valéry, 475 p., 282 fig.
Villedieu, F. (1986). Importations africaines, orientales et hispaniques à Marseille, Lyon, Arles et Narbonne. In: Février 1986: 182-183.
Vita Finzi, C. (1969). The lvfediterranean Valley: Geological changes in Historical Times, . Cambridge University Press, Cambridge, 143 p.
Wegmüller, S. (1977). Pollenanalystische Untersuchungen zur spdt- und postglazialen Vegetationsgeschichte der franzosischen Alpen (Dauphiné), Bern, 185 p.
Whittaker, C.R. (1976). Agri deserti. ln: Finley 1976: 137-165. Wilson, A (1995). Water-power in North Africa and the development of the hori
zontal-wheel. Journal if Roman Archaeology, 8: 499-510.
LES AGRICULTURES DANS LA FRANCE MEDITERRANEENNE ET LE PEUPLEMENT DES CAMPAGNES A LA FIN DE L'ANTIQUITE ET DURANT LE
HAUT MOYEN ÂGE : L'APPORT DES TRAVAUX ARCHEOLOGIQUES ET DES SCIENCES DE
L'ENVIRONNEMENT DURANT LES VINGT DERNIERES ANNEES (1980-2000)
Aline DURAND, LAMM, MMSH, BP 647, F. 13094 Aix-en-Provence Cedex 2, [email protected]
Philippe LEVEAU, CCJ, MMSH, BP 647, F. 13094 Aix-en-Provence Cedex 2, [email protected]
Introduction Depuis la fin du XIXe s., l'historiographie française étudie l'arc de temps compris entre lesVe
et Xe s. sous l'angle essentiellement politique et institutionnel. Pour le Midi de la France, les connaissances accumulées permettent d'en rappeler brièvement la trame. Réunie dans une même organisation administrative durant le Haut Empire Romain, la province de Gaule Narbonnaise est une première fois pa11agée à la fin du Ille s. à la suite des réformes de Dioclétien. CeJles-ci aboutissent à la création de trois provinces nouvelles : les Narbonnaises Première (Narbonne, Béziers, Nîmes, Lodève, Uzès, Agde et Maguelone) et Seconde (Aix-en-Provence, Apt, Riez, Fréjus, Gap, Sisteron, Antibes) entre lesquelles s'intercale la Viennoise dont la partie méditerranéenne est seule ici concernée (Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Vaison, Orange, Cavaillon, Avignon, Arles, Marseille et Carpentras). Mais la d ivision véritable résulte de l'éclatement de l'Empire à la suite de la crise militaire consécutive à l'entrée massive, au Ve s., des peuples germaniques, Wisigoths au sud, Burgondes au nord. Se forment alors de nouvelles entités politiques issues de l'installation des migrants et de la fusion progressive des anciennes populations gallo-romaines et des nouveaux venus : la Septimanie d'une pa1i, et la Provence d'autre part, séparées par le sillon rhodanien. Si , à partir de la fin du Ve s. , les Francs réussirent à reconstituer l'unité des Gaules au sein du royaume franc puis de l'empire carolingien en démembrant la Provence du royaume Burgonde, il n'en demeure pas moins que les deux régions furent toujours périphériques en regard de ces constructions politiques. Après 822, la dissolution de l'Empire donne naissance à deux principautés féodales : le comté de Provence déchiré entre sa tendance à la fidélité aux Carolingiens et les Bourguignons qui le considèrent pendant un siècle comme une terre à s'approprier et le marquisat de Gothie.
En revanche, l'histoire des agricultures durant cette " période de transition" entre l'Antiquité et le Moyen Age est rarement appréhendée en tant que telle. Cette situation s'explique par plusieurs raisons. L'une des principales est la faiblesse de la documentation écrite, même dans la France méditerranéenne, région pourtant plus favorisée qu •ailleurs. Pour la fin de l'Antiquité, on dispose de sources écrites dont l'intérêt n'est pas négligeable. Un certain nombre concerne 1•ensemble de l'Empire romain, comme le code théodosien. Les textes législatifs impériaux qu ' il contient sont d 'utilisation délicate comme le montre la discussion autour de l'expression agri deserti. Élaborée dans une perspective fiscale (Lepelley 1967), cette notion ne peut pas être utilisée en archéologie de l 'occupation du sol pour rendre compte d'une situation concrète. D 'autres textes nous renseignent sur des situations loca les comme les œuvres de Grégoire de Tours et de Sidoine Apollinaire, les documents wisigothiques et les récits hagiographiques. En revanche les sources descriptives et comptables issues de préoccupations essentiellement fiscales ou militaires n'apparaissent qu'aux VUe et VIIIe s. avec les deux po lyptyques de Waldade et d'Ansefred, advocatus de l'évêque de Béziers. À l'extrême fin du VIlle s., pancartes de donations ou de confirmations royales et impériales éclairent les campagnes languedociennes et provençales. Ce n'est que dans la seconde moitié du Xe siècle que les actes diplomatiques commencent à former des séries suffisantes et continues pour éclairer l'agrosystème. Mais l'exploitation de ces sources reste malaisée en particulier à cause du vocabulaire. Ainsi on peine à cerner le champ sémantique de mots clés comme aratrum (araire ou chan·ue) ou jrumentum (froment d'hiver o u de printemps). Aussi faut-il se toumer vers l'archéologie pour obtenir
2
une image plus complète. Sur ce plan, la période médiévale est moins lisible sur le terrain que la période antique : une utilisation plus large de la maçonnerie de chaux et la meilleure qualité de la céramique privilégient en prospection la période romaine par rapport au haut Moyen Âge dont les traces apparaissent mal. Il existe donc une suneprésentation, relative, de la période antique. Cette suneprésentation est en grande partie illusoire. Mais elle se combine avec une interprétation misérabiliste de vestiges parfois très ténus pour renforcer l'image de période de déclin attachée à la seconde moitié du premier millénaire de notre ère.
Il y a une vingtaine d'années, J. Chapelet et R. Fossier déploraient que les rives de la Méditerranée soient la partie de l'Europe où, -réserve faite de certaines régions, dont [a Provence-, la recherche archéologique en milieu rural était la moins avancée (Chapelet et Fossier 1980, 70). En fait, dès cette époque, s'annonçait une modification fondamentale de l'attitude des archéologues qui est à l'origine des progrès récents. Dès les années 1970, P.-A-- Février soulignait le dynamisme d'une recherche sur l'habitat et le peuplement que lui-même encourageait particulièrement (Février 1978) et dont il donnait un large aperçu dans Je catalogue de l'exposition Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale. Parallèlement, le colloque de Flaran (Flaran 1990) battait en brèche la vision historique traditionnelle d'un haut Moyen Age sombre, où les hommes, conduits au désespoir par les famines récunentes dues à une agriculture très pauvre -pour ne pas dire rudimentaire-, se livraient au canniba lisme. La voie était ouverte à une relecture nuancée des textes et à une meilleure prise en compte de la recherche archéologique qui elle-même se réorientait. Cette dynamique participe au décloi sonnement de champs de recherche artificiellement scindés par les découpages chronologiques institutionnels. Elle ouvre de nouvelles pistes qu'empruntent un nombre croissant de chercheurs. Actuellement, le Ministère de la Culture encourage les recherches archéologiques sur ces périodes.
Par définition l'agricu lture vise à modeler, à adapter, à transformer un milieu naturel pour produire des végétaux ou des animaux. Celui qui est envisagé ici conespond à la France méditerranéenne, soit à trois anciennes provinces françaises, la Provence, le Languedoc et Je Roussillon. Paramètres conditionnant le développement des agricultures, le climat et les sols sont deux clefs de lecture pertinentes pour défin ir ce secteur dont la limite septentrionale est assimilée par les botanistes et les phytogéographes à celle de l'o livier, arbre mythique de la civilisation méditerranéenne. La douceur hivernale, la sécheresse et la chaleur de l'été contribuent à rattacher à ce domaine des régions au relief par ailleurs varié, voire compartimenté, puisque, de part et d'autre du Rltône, on retrouve des plaines et des plateaux à l'ouest, des bassins et des montagnes moyennes à l'est. Comme toujours en pays méditerranéen, la donnée caractéristique n'est pas tant la quantité d'eau tombée annue llement -en Camargue 450 mm d'eau mais 750 mm à Nice-- que l'aridité de l'été et, avec elle, la nécessité d'irriguer et la difficulté d'élever sur place du gros bétail.
1.- LE MILIEU ET LA DYNAMIQUE DES PAYSAGES
Ces demières années, la question du milieu a pris une importance particulière dans les études archéologiques portant sur les périodes historiques. En replaçant les sites archéologiques dans leurs contextes morpho-sédimentaires, géologues des formations superficielles et géomorphologues attiraient l'attention des archéologues sur I.e rôle du climat dans la destruction ou l'évolution post dépositionnelle des sites archéologiques. Une démarche strictement déterministe a montré ses limites et conduit à des aberrations. Cependant, les éléments naturels et leurs mécanismes propres influent sur la construction des terroirs et leur mise en valeur : à des périodes de stabil ité voire d 'inertie ou de blocage succèdent des phases d ' innovation lorsque les capacités techniques ou les structures sociales et économiques franchissent des seuils agrotechniques. C'est pourquoi nous insisterons ici sur les conséquences de cette démarche pour la connaissance des activités et pratiques agricoles.
1.- La question de l'évolution climatique générale On admet en général que la fin de l'Empire romain s'est accompagnée d'une dégradation
climatique majeure qui serait venue aggraver les conditions de vie des populations et aurait joué un rôle capital dans Je déclin de la vie économique (Provost 1 984). Cette relation mérite d'être discutée à la lumière des progrès dans la connaissance de l'histoire du cl imat que de nouvelles méthodes de
3
datation, dendrochronologie, radio-carbone ont rendu possibles (Magny et Richard 1992). Les historiens ont eu en effet tendance à utiliser les travaux des naturalistes pour donner un habillage " scientifique " à une tradition fortement influencée par l'ambiance messianique qui accompagna la christianisation : l'idée d'une péjoration des cond itions voulue par Dieu en punition de leurs péchés s'imposait aux hommes du temps. La laïcisation de la réflexion n'a pas empêché les historiens de rechercher dans l'évo lution climatique l'un des facteurs de la crise de l'Empire : la détérioration des conditions de subsistance qu'elle aurait entraînée serait l'une des causes des grandes migrations. Il est donc indispensable de donner un rapide état de la question en soulignant au préalable le caractère relatif de la notion de " péjoration " des cond itions naturelles, s'agissant en particu lier de la zone climatique méditerranéenne où l'activité agricole est limitée par la chaleur et la sécheresse estivale. Une baisse de la moyenne des températures et une plus forte pluviosité n'ont évidemment pas la même incidence que dans les régions septentrionales.
Les recherches menées en collaboration entre archéologues, historiens et environnementalistes brossent un tableau plus fiab le et plus nuancé des conditions naturelles, c' est-àdire du contexte climatique. Les textes ne formant de séries homogènes et continues exploitables pour une histoire de ce type qu'à partir de 1396 (Alexandre 1987), une confrontation pluridisciplinaire s'impose. Les données réunies portent sur les températures et les précipitations, deux des trois paramètres qui constituent " le climat " ; elles concernent pour l' essentiel les marges septentrionales de notre secteur d'étude. D'une man ière générale, les paléo-climatologues ont établi l'existence d'une phase de refroidissement dite de " Gôschenen JI ", qui se développe à partir du ille s. et détermine une avancée des glaciers alpins qui culmine dans la période allant du Ve au VIle s .. Dans les régions danubiennes et les Alpes, un refroidissement s'amorce dans la première moitié du IVe s. ; il entraîne une avancée glaciaire vers le milieu du Ve s .. La baisse des températures estivales est évaluée à 1 degré et met un terme à des conditions favorables qui, dans ces régions, avaient favorisé la diffusion de certaines plantes, en particulier la vigne (Patzelt 1994). Cette évolution est confirmée par les observations faites sur les lacs jurassiens et subalpins (Magny 1992) et sur les cernes d'accroissement des mélèzes (Serre 1979). Elle coïncide avec une période de destruction de cordons littoraux entraînant une invasion marine sur les côtes de la mer du Nord entre 250 et 700 (anciennement appelée "seconde transgression dunkerquienne ") . À ce refroidissement succède un réchauffement général correspondant au Moyen Age central. Un petit "optimum climatique " centré autour de l'An Mil se maintient jusqu'au XIVe s .. Débute alors le Petit Age Glaciaire. Il s'agit, bien entendu, là de tendances générales qui, selon les régions, peuvent avoir des conséquences plus ou moins importantes sur les productions agricoles, objet de notre étude, d'autant que le climat méditerranéen qui intéresse l'ensemble de la zone est lui-même un climat de transition. Cette question vient d'être reprise par Je palynologue G. Jalut. li montre qu'en Méditerranée occidentale, durant l'Holocène, l'installation du c limat méditerranéen s'est fait de manière progressive, selon un gradient latitudinal sud-nord. Selon lui, entre 40° et 44° de latitude nord, soit dans la région qui nous intéresse, une modification dans la répartition annuelle des précipitations, conduisant à l'installation de la sécheresse estivale caractéristique du climat méditerranéen, s'est produite entre 3 300 et 1 000 B.P. (Jalut et alii, 1997). Dans Je Golfe du Lion, il détermine la mise en place de la sécheresse estivale entre 2600-1900 B.P. (2850-1630 cal. B.P) (Jalut 2000, 19)/En Languedoc et en Roussillon, la trame climatique est affinée par des mesures de la variation du 813C effectuées sur une série de charbons de bo is d'âges préhistorique et historique rapportés au chêne à feuillage caduc méditerranéen (Vernet et a lii, 1997). En effet, lorsque Je temps est trop sec, les stomates des plantes se fennent, arrêtant les échanges gazeux de la photosynthèse, donc la fixation du carbone dans la lignine, partie constitutive du bois vivant. Bien que ces observations demandent à être complétées, elles mettent d'ores et déjà en évidence que les valeurs maximales de sécheresse sont enregistrées vers B.P.B.P . . La construction d'une courbe holocène des variations isotopiques de l'oxygène (8180) à partir des stalagmites de la grotte de Clamouse près de Saint-Guilhem-le-Désert (MacDermott et al. 1999) révèle également le retour à des conditions cl imatiques plus chaudes et/ou plus sèches, sans qu 'i l soit possib le de trancher entre les deux, à partir de 3000 BP: la relation entre les variations isotopiques et l'activité des stalagmites est particulièrement bien établie et corrélée pour cette cavité et donc interprétable en termes climatiques.
4
Ces hypothèses doivent être mises en relation avec des constatations qui, pour l'époque antique, laissent penser que les précipitations étaient plus régulières. Pour les Alpes du Nord et le Jura, on dispose désormais des études réalisées sur les lacs du Jura et sur le lac de Paladru dans l'Isère. Les opé rations archéologiques conduites par M . Collardelle etE. Verdet ont permis la reconstitution d'une séquence climatiq ue du haut Moyen Age fi nissant. La période qui précède l'An mil est caractérisée par une fluctuation " sèche " o ù les archéologues ont voulu voir un facteur essentie l de l'installation d'une communauté au bord du Lac de Paladru (Bore l et alii 1996). Actuellement, les connaissances sur les conditions climatiques ont été précisées par des travaux sur le régime des fleuves et sur l'évolution de plans d'eau dans la régjon du Bas Rhône. Ces travaux intéressent essentiellement le régime pluvial par le biais des quantités d'eau écoulées par les cours d'eau. Pour cette région, la combinaison d'ind ices morpho-sédimentaires et archéologiques a permis de préciser l'évo lution des mi lieux riverains. Seule la transition Antiquité tardive-haut Moyen Age est caractérisée par une crise hydraulique majeure susceptible de modifier profondément les milieux fl uviaux. A lors que durant le millénaire qui comprend Je second Age du Fer et la période romaine dans son ensemble, soit duYes. av. J.-C. auVe s. ap. J .-C., l'activité hydra-sédimentaire n'avait pas entraîné de transformations majeures des lits fluviaux, durant les trois siècles qui vont de la fin du Ve à la fin du VIle s. ap. J.-C., ces milieux connaissent une évolution q ui aboutit à leur métamorphose (tressage du chenal, modification du delta). Perceptible dés la fin de l'Antiquité, cette évolution traduit un renforcement des flux liquides et solides du fleuve où la composante climatique est certaine (Provansal et alii 1999). La phase d'humidité qui débute vers le Ile siècle dure jusqu'au début du Moyen Age Centra l, période durant laquelle les conditions redeviennent plus sèches. J .-L. Brochier a réalisé des comparaisons sur les stratigraphies séd imentaires de deux abris-sous-roche, Font-de-J'Oule prés de la Fontaine-de-Vaucluse dans la vallée du Rhône et Font Juvénal près de Carcassonne. Elles enregistrent une première pulsation froide pour les années 400-750 et une seconde pour la période qui con-espond au Petit Age Glaciaire. Entre les V Ile et XIIe s., l'arrêt de la sédimentation correspondrait à une période qu i, compte tenu de l'acquis paléoclimatique, devait à coup sûr être tempérée et à laquelle il attribue une "tendance sèche". En fait dès le XIIIe s. les conditions deviennent plus humides (Brochier 1983).
2.- Climat, agriculture et rythmes de l'érosion L'érosion qui, à l'échelle de temps prise en considération ici, s'exerce sur les formations
superficielles, est le processus physique par lequel les effets du climat sur le paysage sont Je plus directement observables. Le ruissellement entraîne vers les bas de pente des sédiments que les cours d'eau accumu lent dans des terrasses fluviales et, à l'aval, dans les embouchures avant d'aboutir dans les fonds marins. Ces formations dépendent de la lithologie et du climat. En l'absence d' intervention des sociétés humaines, Je rythme de l'érosion qui les affecte (ralentissement ou accélération) dépend de deux des facteurs q ui concourent à définir un climat : les eaux de p lu ie qui mobilisent les sédiments et la végétation qui protège des sols de l'impact de la pluie et les retient sur les versants. Mais, depuis Je début de l'Holocène, aux causes climatiques s'ajoutent les causes anthropiques.
Au siècle dernier, leur lutte contre la torrentialité méditerranéenne avait conduit les forestiers à insister sur la relation qu'elle entretenait avec le déboisement qu'avait entraîné le développement de l'agriculture et des besoins en combustibles. Aux époques historiques, en particulier au XIXe siècle, les ruissellements avaient arraché aux versants des collines et montagnes méditerranéennes d'énormes masses de sédiment qui s'étaient accumulés dans les basses vallées, les plaines littorales et les deltas. Ces débats avaient évidemment trouvé leur écho chez les géomorphologues qui avaient proposé une analyse plus fine des dépôts a lluv iaux que les cartes géologiques datent du " quaternaire récent". À la fin des années 1960, ils ont été marqués par les travaux de V ita Finzi sur les vallées alluv iales au quaternaire autour de la Méditerranée. Le modèle qu'il avait é laboré attribuait la priorité aux causalités naturelles soit au cl imat (Vita-Finzi 1969). Mais, à partir du concept d' anthropisation, d'autres modèles o nt insisté sur les causes sociales de l'érosion (Neboit 1991). Ces derniers p résentent un grand intérêt pour les historiens qui peuvent trouver dans les rythmes de l'érosion un marqueur de l'emprise de l'agrosystème, précieux pour les régions et les périodes mal documentées.
Cette voie a été suiv ie à partir de 1985 en Provence o ù des études ont été conduites par les géomorphologues aixois en concertat ion avec des archéologues et des historiens sur les périodes
5
historiques dans des zones collinaires. Les premières recherches ont porté sur les collines à l'est de l'Étang de Berre, une lagune constituée par la remontée des eaux à l'Holocène où des carottes prélevées dans les sédiments permettaient d'évaluer des rythmes de l'érosion sur les bassins versants d'un petit nombre de cours d'eau (Jo rda et al ii 1993). Ces études ont permis de définir des rythmes régionaux en relation avec le développement agricole et l'évolution climatique. Amorcée au début du Subatlantique, une première" crise " érosive a duré jusqu'au début de l'âge du Fer. L'époque romaine est caractérisée en revanche par un taux de sédimentation plus faible. Au-delà, une seconde crise aboutit à la mise en place d'une seconde nappe alluviale observée sur les terrasses des cours d'eau principaux et sur les piémonts. D'âge récent, elle est expliquée par les effets conjugués du Petit Âge Glaciaire et de la poussée démographique des Temps Modernes (Jorda 1992 ; Provansal 1992). En fait, les observations réal isées montrent une grande diversité de situation qui traduit celles des facteurs naturels -la lithologie et la pente - et anthropiques. Pour le massif de Sainte-Victoire, M. Jorda conclut que " le bilan de J'érosion des deux derniers millénaires paraît bien modeste, malgré la fragilité du milieu, et les modelés semblent avoir peu évolué à partir de la Protohistoire " (Jorda et Mo cci 1997, 227). La situation est en revanche très différente sur les piémonts nord et sud des Alpilles qui ont fait J'objet d'études précises (Bruneton 1999) portant sur Je recouvrement de sites archéologiques postérieurement à l'époque romaine. Situé au fond d'un talweg sur le versant nord, Je site de Glanum a été fossilisé par une nappe sédimentaire qui atteint 4 à 5 m". Elle est complétée par des remblaiements colluviaux peu épais mais recouvrant l'essentiel du piémont (Bruneton 1999, 150). Au total, dans son étude, H. Bruneton arrive à la conclusion suivante : "La généralisation des dépôts post-antiques dans les talwegs et leur association avec des poches colluviales très fréquentes constitue un caractère nouveau, qui est possible d'attribuer à la pression agricole accrue sur les versants, quelles que soient les fluctuations dans la démographie et la répartition de l'habitat" (ibid. 168). Mais dans le détail, la situation est complexe : dans les dépressions formes du site archéologique de Saint-Blaise, " la stratigraphie montre plutôt une sér ie d'à-coups érosifs, séparés par des sols de culture" (Provansal et alii, 1994, 2,3-204).
C'est donc vers une approche plus fine liée à la pédologie qu'i l convient de se tourner pour en savoir plus. Les premières études de ce type ont été conduites par P. Poupet d'abord, puis par J.-F. Berger qui, l'un et l'autre, ont collaboré avec les archéologues. Obtenus avec des approches sensiblement différentes, leurs résultats convergent. P. Poupet a conduit sur le Languedoc oriental de très fines études qui ont porté sur la nature des sols, leur dégradation éventuelle à la suite de pratiques culturales, leur conservation et la possibilité de retrouver la trace de façons agricoles sur des sols brutalement enfouis. Deux micro régions ont été pruticulièrement concernées par ses recherches, la Vaunage et Je versant des Garrigues correspondant au secteur de Nîmes. La Vaunage est une petite dépression, située à 10 km environ de Nîmes et à 25 km de la mer. Elle est drainée par un affluent du Vistre, long de 12 km, le Rhony, qui prend sa source au nord-ouest de la dépression. La région a fait l'objet une série d'études portant sur son occupation protohistorique, antique et médiévale. Alors que, dans les années 1970, on pensait que Je paysage avait été précocement stabilisé par un système de terrasses de cultures remontant à la protohistoire (Sapin 1981), on s'est rendu compte qu'à l'image de ce que l'on connaît ailleurs, celui que l'on observe n'était pas le paysage antique (Ginouvez et alii 1990, 389-393). L'observation d'une coupe près de Saint-Dionisy "démontre qu'avant l'époque romaine, Je versant à l'aplomb des oppida de Roque de Viou et de Nages-Les-Castels était stable". Sa mise en culture durant la protohistoire est exclue. En réalité, c'est après l'époque romaine que s'était amorcé une succession de cycles de maîtrise des sols et de déprise des pentes (Poupet 1999, 135 et fig. l4b ). Les effets de l'érosion varient de manière remarquable. Ainsi, alors que de faibles recouvrements (moins de 1 rn) nappent le piémont de La Liquière, d'importants colluvionnements post antiques sont observés au pied de Roque-de-Viau. Ces observations ont été étendues à la frange méridionale des Garrigues Nîmoises, où P. Poupet a étudié l'évolution des versants et piémont dominant le Vistre. Il existe, bien entendu, des recouvrements. Mais, dans l'ensemble, ils ne sont pas importants. Dans certains secteurs, le niveau des champs antiques a même été totalement décapé.
Les travaux conduits plus au nord par J.-F. Berger en Valdaine, ont donné lieu à des publications dont nous retenons ce qui concerne la période qui nous intéresse ici. En rive gauche du Rhône, cette zone de collines couvre environ 300 km2
, à J'est de Montélimar. Drainée par deux affluents du Rhône, le Roubion au nord et le Jabron au sud, elle comporte une succession de collines
6
et de plateaux marne-gréseux avec des dénivelés de 250 à 450 m. Une morphogenèse très active à l'Holocène en a adouci la topographie. Durant la seconde moitié du Ier millénaire, malgré la persistance de l'érosion des versants qui entraîne un fort alluvionnement dans les talwegs, les couvertures sédimentaires sont stabilisées par un couvert végétal permanent (Berger 1997, 115-117). Pour la période allant du IVe s. au Xe s., les analyses pédo-anthracologiques et malocologiques réalisées par S. Thiébault et F. Magnin, évoquent une végétation ouverte de lisières ou de haies (Berger, 1995, 1 05). En revanche, dans la plaine et les piémonts, une pédogenèse brunifiante montre qu'une période de calme hydrologique a succédé à une période de plus forte hydrologie. Mais les réseaux de drainage qui permettaient le développement de la vie agricole sont abandonnés : les associations malacologiques correspondent à des prairies humides et des marais qui ont pris la place des champs cultivés. Une stabi lisation des versants durant plusieurs siècles a pennis aux couvertures pédologiques d'acquérir la stabilité structurale et les taux de matière organique élevés qui ont profité à la société médiévale des siècles qui ont suivi l'an Mil.
3.- Les accumulations sédimentaires :plaines littorales et terrasses fluviales La relative stabilité des versants (zone amont) n'exclut pas d'importantes accumulations
sédimentaires dans les terrasses fluviales d'organismes majeurs et dans les plaines littorales (zone aval). Peu importantes à l'échelle régionale, les surfaces concemées présentent un grand intérêt agricole car les sols gris alluviaux qui les constituent donnent des tenes de bonne qualité dont la fertilité est entretenue par les limons de crue. Leur mise en culture suppose un fort contrôle de l'eau. Très sensibles à la sécheresse estivale, elles ont besoin d 'être irriguées. Il est nécessaire de les drainer pour évacuer les eaux de pluies et abaisser le niveau de la nappe phréatique. L'inondation n'est pas néfaste à condition d'entretenir des fossés qui permettent d'évacuer les eaux de crues et empêchent la remontée des nappes phréatiques. En période de crise environnementale, l'engorgement des écoulements par les alluvions entraîne rapidement l'abandon des basses terres par les agriculteurs.
Les connaissances ont été renouvelées par les recherches occasionnées en 1996 par l'opération de construction du T.G.V. dans la vallée du Rhône entre Valence et Orange. Elles ont confirmé l'importance prévisible d'une sédimentation qui, depuis la période antique, va de 1 à 3 m et atteint même 3,5 m dans la plaine d'Orange (Brochier 1997, 95). Cette sédimentation a effacé des paléoreliefs "en tôle ondulée" (id. 94). J .-F. Berger et C. Jung ont porté leur attention sur les conditions hydrologiques qu'elle traduisait et sur la relation existant entre la maîtrise des écoulements et la mise en valeur agricole. Ils ont pu reconnaître une période de stabil ité allant de la fin IIIe et du début du Ile s. av. J. -C. jusqu'au début du 1er s. ap. J .-C .. (Berger et a/ii 1997, 150), durant laquelle une nette réduction de l'alluvionnement avait permis aux sols de se reconstituer. La conquête agricole de la plaine d'inondation a été réalisée lors de la mise en place de la centuriation romaine d'Orange. Par la suite, s'amorce une" crise hydrologique majeure" qui débute dans ce secteur à la fin du Ier s. et entraîne un exhaussement des lits fluviaux, évalué entre de 50 et 80 cm, ainsi qu ' une augmentation des taux de sédimentation dans le sud du Tricastin et la plaine d'Orange (3 à 4 mm/an). À la fin du Ve et du début du VIe s. aux VUe et VIlle s., soit durant la phase climatique humide observée dans toute l'Europe, n i l'écoulement des eaux, ni l'évacuation des sédiments, ni leur mélange avec la terre arable ne sont plus contrôlés : 0 11 observe l'accumulation de plusieurs décimètres de limons amenés par les crues au-dessus des fossés abandonnés. Une déprise agricole s'instaure. J.-F. Berger insiste sur la composante sociale du phénomène. Cependant, l'hydromorphie des sols observée sur les coupes à la fin du Ile s. n'est pas irréversible. Entre la fin du Hie et la fin du Ve s., la remise en service des réseaux de drainage et de voirie liée à la centuriation permet un contrô le de l'alluvionnement ; la pédogenèse reprend. Mais, lorsqu'à partir de la fin du Ve, les fossés ne sont plus curés, le marais s'installe. Les facteurs naturels -la crise cl imatique-- conjuguent ainsi leurs effets avec la crise politique. Selon J.-F. Berger, l'exploitation pastorale aura it pris alors une importance majeure.
Sur le littoral, malgré la collaboration entre archéo logues et géomorphologues, les connaissances sont inégales. À l'est du Rhône, dans la basse vallée de l'Argens, les études n'en sont qu'à leur début. Deux sondages carottés l'un à l'amont de la ria, l'autre 5,2 km à l'est, soit à mi-distance de la ligne actuelle du rivage, ont pennis à M. Dubar de proposer une première restitution des rythmes de la progradation du littoral et du comblement de la ria. Il relève l'épaisseur des limons rougeâtres dans lesquels la rivière entaille son lit actuel. Les 4 à 5 m de ce dépôt correspondent à des argiles
7
rubéfiées arrachées aux versants des Maures et de l'Esterel ; l'érosion a entraîné la formation un cône détritique responsable du remblaiement qui se développe entre le Ve s. av. J.-C. et le début de l'ère "puisque l'accès au port de Fréjus se fait alors par un canal artificiel " (Fiches et aJii 1995, 21 0). Mais, établies à partir d'un modèle mathématique, les restitutions proposées sont fondées sur un taux de sédimentation constant qui ne prend en compte ni la variabilité du climat ni celle de la pression des sociétés. Entre Provence et Languedoc, la basse plaine du Rhône et la Camargue ont fait l'objet de recherches conduites en relation avec l'étude des dynamiques fluviales et de l'histoire du delta. Les recouvrements alluviaux expliquent que les cartes archéologiques ne reflètent pas l'importance de l'occupation du sol aux périodes anciennes. Inondations et dynamiques propres au delta conjuguent leurs effets. Dans la plaine d'Arles, la sédimentation est évaluée à 2,5 m depuis l'époque antique en dehors des zones proches des levées de berge où elle est évidemment plus importante. Au Moyen Age, les alluvions du Rhône ont isolé le port d'Aigues-Mortes. Vers l'ouest, en Languedoc, le littoral est caractérisé par l'importance des plaines palustres et des étangs dont l'histoire est liée aux apports des fleuves littoraux qui y aboutissent. De ce fait, malgré l'élévation décimétrique du niveau marin durant les deux demiers millénaires (Ambert, 1986 ; Ambert 1995, 432), le colmatage des lagunes est faible lorsque les cours d'eau qui y aboutissent sont peu importants ; il est rapide dans le cas contraire. La différence entre deux plans d'eau voisins, l'étang de Thau et l'étang de L'Or (ou de Maugio), illustre parfaitement cette opposition. Actuellement, le Vidourle, petit fleuve littoral long de 70 km, aboutit directement dans les étangs et marais de la Petite Camargue. Mais jusqu'à l'époque moderne, il se jetait dans l'Étang-de-l'Or que ses apports ajoutés à ceux du Vistre et de la Radelle ont pratiquement comblé (Ambert 1986). La fragilité des graus et leur déplacement ont des conséquences importantes en matière de salinité différentielle et d'exploitation des ressources naturelles. Par la précision des descriptions et du vocabulaire, les documents psalmodiens des JXe et Xe s. attestent d'une conscience nette des changements du paysage et de l'atterrissement des cordons à une date ancienne. Au XIe s., l'évêque de Maguelone fait ouvrir un grau neuf pour remplacer le " grau sarrasin " d'accès malaisé. Plus à l'ouest encore, la ruine du port de Narbonne est liée aux apports terrigènes de l'Aude dont le volume actuel est évalué à 1 800 m3/an (Ambert et alii 1993, 129-130). Totalement artificiel, le cours inférieur actuel de la rivière résulte de travaux de correction et d'aménagement entrepris à la suite des crues du XIVe siècle et de la grande crue de 1755. Dans tous ces cas, si le schéma général d'évolution a bien été dégagé, ses rythmes n'ont pas été précisés. Les caractéristiques du littoral restent mal connues si l'on remonte en deçà du XVIIe s., période à partir de laquelle les représentations cartographiques deviennent uti lisables pour la restitution du trait de côte. L'impact précis de la crise du VIe-VUe s. devrait être précisé par des études en cours sur la zone des étangs et sur la vallée de l'Aude où des forages carottés ont été réalisés par P. Ambert et J. Guilaine 1995).
II. -LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION AGRICOLE
les découpages h istoriques traditionnels, la période comprise entre les lUe et Xe s. est écattelée entre un Empire romain qui se termine et un royaume franc qui n'existe pas encore. Cette situation conduit immédiatement à la définir comme une phase de transition, forcément peu brillante, entre l'apogée de deux systèmes socio-économiques différents. Elle ne peut donc ni avoir une dynamique propre ni offrir des conditions favorables à l'expansion agricole. Compte tenu du poids de cette tradition, il est nécessaire d'en rappeler les grandes lignes. En effet, ces lacunes dans nos connaissances ont donné naissance à de grandes idées historiques, bri llamment exposées, dont certaines font encore aujourd'hui autorité. Démenties par les faits, elles commencent à faire l'objet de révisions. Deux dossiers sont plus particulièrement significatifs : d'une part les échanges économiques et commerciaux sur lesquels nous disposons de deux indicateurs intéressants, la céramique et la numismatique; d'autre part, la maîtrise des sources d'énergie, révélatrice d 'une histoire des techniques.
1.- Les échanges Pour Henri Pirenne, la césure majeure de l'Occident médiéval n'était pas la migration des
peuples " barbares " au début du Ve siècle, mais celle des Sarrasins : jusqu'à 1 'expansion arabe, le
8
commerce et les relations économiques entre l'Orient et l'Occident seraient restés actifs. Ils auraient sombré avec la piraterie musulmane et la mort de la Méditerranée occidentale chrétienne. Parfois suivie jusqu'à l'outrance, cette thèse qui met l'accent sur la rupture du VIle s., a été reniée en bloc depuis plusieurs décennies par les historiens. En l'absence de documentation écrite importante, les études archéologiques récentes apportent des informations neuves sur le domaine économique. Elles nuancent la simplification excessive de tels schémas en révélant la complexité des phénomènes économiques. Elles offrent également la possibilité d'approcher la question selon plusieurs niveaux, notamment sur les plans locaux et régionaux.
Indicateur privilégié des échanges, la céramique a fait l'objet d 'études qui ont complètement renouvelé la question de l'ouverture aux courants commerciaux de la Provence et du Languedoc, régions sur lesquelles elles ont été réalisées. Paradoxalement, à partir du IVe s., l'indicateur céramique permet de tracer une courbe qui montre un accroissement des échanges par rapport au 1er s. le nombre des sites désigne comme la période d'occupation maximale des tenoirs. Comparées à la consommation local.e, les importations de céramique ont connu un développement considérable. Le déclin des importations s'amorce seulement au VIe s. qui voir la fin du grand marché méditerranéen (Février, 1986; Raynaud 1990,289-299 et 1996). Mais il ne s 'amorce pas partout au même moment: à Marseille, des preuves de relations commerciales développées existent jusqu'au VIle s., alors qu'à Arles ou Narbonne, elles ne sont attestées que pour leVe s. (Villedieu 1986, 182-183). Entre le VIle s. et le IXe s., cette évolution mise en évidence par A. Parodi etC. Raynaud dans leurs recherches sur la Vaunage (Parodi et alii, 1987, 3-59), est caractérisée par une modification dans les céramiques dont les caractéristiques sont " la prédominance des poteries grises, la disparition de la vaisselle de tradition gallo-romaine et la fin des importations méditerranéennes " . Ils observent par ailleurs que cette évolution ne préjuge pas de l'intensité des relations inter régionales. Les études récentes sur les céramiques vont dans le même sens (Leenhardt et alii, 1993). Les premiers faciès de céramique véritablement médiévale ne sont perçus avec netteté qu'à pa1tir des VIle et VIlle s. avec le démarrage d ' ateliers régionaux qui, comme Masmolène, préfigurent la grande production régionale dont le dynamisme subsiste jusqu'à l'époque moderne. Mais arrêt des importations et développement des productions autochtones ne signifient pas stabilité du système : la cartographie des aires de diffusion micro-régionale montre que l'économie du haut Moyen Age ne fonctionne pas sur le mode de l'autosu bsistance.
L'étude des monnaies découvertes en fou ille a montré que l'utilisation de la moyenne et petite monnaie de bronze persistait bien après l'arrêt des frappes à l'époque mérovingienne : " le numismate recueille la preuve que le numéraire de nécessité qui échappait à l'organisation administrative régulière, a été en usage plus longtemps qu'il ne pouvait Je supposer, au moins jusqu'à [a période ostrogothique " (Brenot, 1998, 361 ). Le bronze byzantin pénètre en Provence et en Languedoc. Les monnaies anciennes continuent d 'être utilisées et sont reproduites par surmoulage. Cependant une coupure dans l'économie monétaire intervient au VIle s .. Le bronze et Je cuivre n'étaient déjà plus utilisés à la fin du VIe s .. A la fin du siècle suivant, vers 675-680, les ateliers mérovingiens d'Arles et de Marseille cessent de frapper des monnaies d ' or. L'argent reste le seul métal monnayé jusqu'aux premières émissions d'or par saint Louis (Brenot 1986, 197-199 et 1996, J 47-160).
2.- La maîtrise des sources d'énergie
Des plus anciennes (Duby, 1962) aux plus récentes, les synthèses consacrées à l'agriculture du Haut Moyen Age soulignent la médiocrité des moyens dont dispose la paysannerie pour la mise en culture des terres : un outillage primitif, " à peine de fer", " un bétail de médiocre qualité et mal sélectionné " (Chapelot et Fossier 1980, 24-25). Il est réjouissant de constater que l'archéologie permet une réévaluation de cette opinion. Les situations qu'elle décrit en s'appuyant sur l'histoire du moulin à eau et sur les découvertes de plus en plus fréquentes de métallurgie sur les sites vont contre l'idée courante d'un retard technologique durant cette époque. Mais cette situation n' interdit pas non plus le maintien de techniques remontant aux premiers temps de l'agriculture comme l' atteste le
9
dossier de l'écobuage (cf. infra). Pour l'heure, l'accent doit être mis sur la d iversité des situations réelles.
a.- La question du moulin à eau Ces demières années d'importants progrès ont été réalisés dans l'identification archéologique
des moulins, un équipement qui occupe une place essentielle dans la maîtrise des énergies naturelles. Depuis les travaux de M. Bloch (Bloch 1935), l'historiographie des moulins est marquée par le thème du blocage des techniques dans une société caractérisée par l'esclavage. L'usage courant des moulins daterait de la période médiévale. Réalisée par F. Benoit dans les années 1940, la fouille des moulins de Barbegal près de Arles apporta it à cette théorie une validation archéologique. Les moulins auraient été construits à la fin du IIJe s. et auraient été util isés jusqu 'à la fin du Ne s .. Cette datation était fondée sur les techniques de construction observées sur les ponts aqueducs du vallon des Arcs et sur le matériel trouvé au cours des fouilles, en particulier les monnaies. F. Benoit insérait les moulins dans un contexte économique et historique plus large (Benoit 1940). Leur abandon serait dû au déclin économique consécutif aux invasions barbares. Cette datation convenait aux historiens de la société et des techniques et, rapidement, ces moulins sont devenus un symbole : la construction de ce bâtiment aurait traduit une adaptation des économies antiques au déclin de l'esclavage. Ne pouvant plus contraindre les hommes à effectuer un travai l que l'on considérait comme l'un des plus pénibles, la société antique se serait toumée vers le mach inisme et aurait tenté de substituer au travail humain les énergies captées dans la nature.
Il fa llait s'attendre à des découvertes : Palladius recommandait d'utiliser les eaux d'écoulement des bains pour les moulins, prescription qui laissait penser que cet équipement était relativement ordinaire dans les villae (De agricultura, I, 41 ) . La reprise des fouilles des moulins de Barbegal a permis une révision de la date proposée pour cette usine : plus ancienne d'un siècle et demi, leur construction date du second quart du lie s. (Leveau 1995). Au même moment, une plus forte attention prêtée à ces structures a montré que les moulins étaient plus répandus qu'on ne l'a cru. R. Royet avait fouillé un moulin à roue verticale du Haut Empire à la sortie des thermes de la villa du Vernai à SaintRomain-de-Jal ionas à l ' est de Lyon (Royet, 1995 et J 996). Dans Je Var, les fouilles conduites par M. BoJTéani et J.-P. Brun ont permis d'en identifier deux, sur les villae des Mesclans et des Laurons aux Arcs-sur-Argens (Borréan i et Brun, 1998). Dans la même région, le site de Saint-Martin à Taradeau fournit un bel exemple de transformation d 'un bassin d'agrément en réserve d 'eau pour un moulin à roue horizontale (Brun 1999, 770). La liste devrait s'allonger. Entre Arles et Barbegal, à La Calade (Amouric et a lii, 2000), une opération d'archéologie préventive a conduit à la découverte d'un moulin à turbine daté de la fin de l'Antiquité. De même, sur l'Hérault, à Paulhan, sur le site d'une villa, les travaux de l'A 75 ont mis au jour deux moulins du 1er s., recoupés par un troisième, plus grand (S. Mauné, communication orale). Des constatations analogues ont été fa ites ai lleurs, en Afrique (Wilson 1995) et au Portugal (Carvalho-Quintela et alii 1999, 214).
En Catalogue et dans le Languedoc où la documentation écrite est plus abondante qu' en Provence, les premières mentions de moulins permettent de poser quelques jalons de leur histoire de l'utilisation de l'énergie hydraul ique durant le haut Moyen Age. En Roussillon, la distribution géographique des bâtiments hydraul iques amène S. Cancanas à conclure que le mou lin à eau n'est pas un élément rare et isolé dans les campagnes carol ingiennes (Caucanas 1987). Dans la plaine languedocienne, les résultats sont similaires : là, l'éparpi llement géographique extrême des premiers moulins inventoriés aux VIIIe-IXe s. montre que toutes les eaux courantes, voire même stagnantes, sont testées puis util isées (Durand sous presse). L'historiographie actuelle pose de manière nouvelle la question de l'apparition du moulin à eau et de sa d iffus ion entre l'Antiquité et l'an Mi l en s'attachant à comprendre J'outil, la technique dans un contexte régional précis, sans systématiser, en recherchant les liens entre l'établ issement de la seigneurie banale et la machine agrico le (Cornet 1999). Dans cette perspective, la question de la chaîne opératoire est capitale : en fin de course, quel usage fait-on de la mouture ? La céréalisation progressive de l'alimentation paysanne acquise entre les Ve et VIIIe s. pourrait constituer l'un des éléments de réponses.
b.- La métallurgie du fer
10
Dans toute l'Europe, le fer se trouve en qu anti té importante, mais son association fréquente à d'autres métaux (phosphore) nécessite une épuration techniquement délicate. Aussi, traditionnellement, les historiens ruralistes décrivent le Haut Moyen Age comme une période où le fer est rare et l'outillage, peu performant, essentiellement en bois. Cette opinion, vulgarisée par G. Duby, contribuait largement à la vision pessimiste de techniques agricoles rudimentaires et d'une agriculture peu évoluée aux rendements fa ibles d'à peine à un à deux grains récoltés pour un grain semé (Duby 1962 7 1-87). Elle s'appuyait à la fois sur les sources écrites et archéologiques. En effet, les inventa ires des fiscs carolingiens, dont le célèbre fisc d'Annapes, ne mentionnent que très peu d'outils de fer et, j usqu'à une date récente, l'archéologie n'avait pas fourni d'objets de fer ou d'ind ices probants et fréquents d'une méta llurgie artisanale (forge) dans les campagnes (Pesez 1991 ). La relecture des po lyptyques, notamment méridionaux comme celui de Brescia, montre que le fer est bien présent, sinon abondant, et que la thèse classique ne peut plus être soutenue. Durant la dernière décennie, J.M . Pesez et d'autres archéologues ont rappe lé qu'absence de découvertes archéologiques ne signifi ait pas absence réelle de fer : celui-ci était récupéré et réuti lisé (Pesez, 199 1 ). Les protohistoriens les ant iqu isants vont encore plus loin: pour eux, le progrès est bien antérieur à l'époque méd iévale et il faut rompre avec l' idée selon laquelle l'outillage de 1 'âge du Fer serait resté à un stade proche de l'archaïsme. Repre nant une opinion développée par J. Kolendo à propos de l'agriculture de l'époque romaine, P. Poupet rappelle lui aussi à propos du site protohistorique d'Ambrussum, que la rareté des métaux doit être reliée au cycle des métaux transformés et retransformés en outils (Poupet 1989, 264). S'engageant dans cette voie, les enquêtes conduites actuellement condui sent à une révision complète de l'opinion traditionnelle. Grâce aux opérations d'urgence, l'habitat du haut Moyen Age commence à être mieux connu alors qu'il s'est longtemps résumé à deux sites: Larina pour la zone méridionale et Brébières pour la partie septentrionale. Les scories de fer, les forges, charbonnières et autres ferriers sont presque systématiquement retrouvés sur les sites ruraux (Bilans archéologiques régionaux).
Dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'occupatio n des sols autour de Saint-B laise, F. Trément expliq ue q ue, bien qu'il n'ait p ris en compte les scories que dans les derniers temps de sa prospection, les résultats obtenus mettent en évidence une activité de forge pour la fabrication ou la réparation du petit outillage agricole : 34 sites ont été identifiés. Sur l'un d'entre eux, sept points de forte densité de scories sont en relation avec des indices d'habitat correspondant à un hameau. En J'absence de fouilles, cette activité ne peut pas être datée avec précision. Cependant il observe q ue la grande majorité des sites concernés étaient occupés dans l'Antiquité tard ive (T rément 1999, 195). Quelques kilomètres à l'est, cette fo is en fouille, F. Gateau a également identifié une activité de forge sur le site de la Po usaraque à Gignac (Gateau 1997, 16). Ce ne sont encore que quelques points dans une région où les traces de métallurgie sont nombreuses sur les sites antiques, comme il ressort d'une consu ltation des Cartes A rchéologiques où le mot " scories " est indexé. Lorsque l'on y prête attention, on se rend compte que des forges sont régulièrement signalées pour des périodes de la fi n de l'Antiquité dans les rapports de fou illes sur des sites d'agglomération ou de villa. Parmi les s ites ayant fa it l'objet de publications, c'est le cas des agglomérations de Lunel-V iel (Raynaud 1990) ou du Camp-de-César à Laudun pour le Ve s. au moins (Goury 1997, 166), ou celui de sites de villae durant les phases ultimes de leur occu pation comme au Près-Bas (Pellecuer à paraître), à Sauvian/La Domergue (Ginouvez Feugère, dans Feugère 1998, 182-183) jusque dans la seconde moitié du IVe s. au plus tôt, à La Ramière (Maufras-Pomarédes-Colomer 1998, 2 10-22 l ) en Languedoc ou encore aux Bruns en Provence. Ces indices sont assez nombreux et assez récents pour démontrer que l'hypothèse d'une absence résulte d'un défaut de prospection. Ainsi le faible nombre de sites à scories, -une v ingtaine sur plus de 300 prospectés par S. Mauné dans la vallée de l'Hérault-, s'expl ique vraisemblablement par un problème de visibilité (Mauné, 1998).
En effet, appuyée sur un énorme et tenace travail de p rospection qu'il reste cependant à caler plus finement par des fouilles, la thèse de V. Izard consacrée à la montagne pyrénéenne méd iterranéenne confirme magistralement le rôle du fer antérieu rement à l'an Mil. En suivant la diffusion du fe r et les perfectionnements techniques dans l'art du forgeron, elle montre l'excellente qualité des fers catalans et soutient l' idée que la métallurgie du fer joue un rôle fondamental, jusq ue-là soupçonné, mais j amais aussi vivement éclairé, dans le démarrage du processus de croissance médiéval, et cela, dès la pér iode carolingienne. Décrivant une véritable c ivi lisation du fer, e lle révèle un nouvel anthroposystème montagnard fondé non pas sur le pastoralisme, mais sur cette méta llurgie
l 1
(Izard 1999). Une telle situation suppose l'abondance du matériau travaillé et l'exportation du produit fini dans tout Je Midi. Corrélativement, les historiens et archéologues étud iant le phénomène castrai languedocien mettent de plus en plus J'accent, pour expl iquer l'implantation de certains points fortifiés et l'existence de véritable réseaux de pouvoirs, sur le contrôle des mines et de toute la chaîne de production qui s'y rattache. Dans le p rocessus d'encellulement des hommes, ces p réoccupat ions apparaissent jouer un rôle majeur, m inoré jusqu'à une date récente (Amado 1977 : Journot 1990, Damas, 1998). Ce faisceau d'indices et de résultats convergents prouve l'existence très développée et très précoce d'un artisanat, sinon d'une méta li urgie, du fer. Lors du colloque de 1997 de Flaran consacré à l'artisan au v illage, le rapport général de M. Arnoux et la synthèse de C. V erna consacrée à la zone méridionale occidentale entérinaient ce point de vue (Flaran sous presse.
III- MILIEUX VEGETAUX ET SOCIETES AGRICOLES
En 1975, G. Bertrand écrivait que "J' interprétation historique du facteur naturel dans ses relations avec la société et les structures agraires reste le problème le plus mal éluc idé, le plus rarement abordé et surtout Je plus mal posé de toute l'histoire rurale " (Be11rand 1975, 38). Depuis, la multiplication des analyses paléoécologiques commence à restituer la dimension écologique de l'histoire des sociétés agricoles. Les indicateurs paléobotan iques permettent de dégager les lignes générales de l'anthropisation du paysage végétal, c'est-à-dire de l'ouverture du milieu et du développement d'espèces qui paraissent en re lation avec l' agriculture et la recherche de combustibles pour Jes foyers domestiques et pour les activités artisanales et industrielles. D 'une manière générale, dans les assemblages polliniques, les épisodes de déforestation sont caractérisés par un effo ndrement de la courbe du pollen arboréen. Mais un tableau donnant les rythmes régionaux de cette histoire est encore difficile à établir. Jusqu'à p résent en effet, en France, les pa lynologues se sont intéressés surtout aux périodes anciennes et encore peu à la période historique comme il apparaît clairement dans recensement des sites ayant fait l'objet de forages qu'a dressé G. Jalut en 1991 (Jalut 1991, 360-361 ). De même, en 1993, M.-C. Marinval-Vigne et S . Thiébault (Marinvai-Vigne et Th iébault 1996) dressaient Je bilan des études paléoécologiques menées sur le territoire français et soulignaient Je manque de données analytiques interdisant la réalisation de synthèses approfondies. Depu is une dizaine d'année, le nombre a sensiblement augmenté. Mais des régions importantes restent en marge. Les raisons d'une telle situation sont à rechercher d'une part dans Je retard de l'archéologie française, d'autre part dans l'orientation des paléobotanistes vers une histoire du climat plutôt que de l'agricu !ture.
La démarche présentée ici consiste en tentative de mise en série des données écrites, archéologiques et env ironnementales. Les palynologues ayant eu smtout pour o~jectif de mettre en évidence les changements env ironnementaux, ils ont eu recours aux faits de civi lisations et aux faits agricoles pour dater des événements polliniques, mais ont rarement utilisé la documentation écrite. Les naturalistes ont développé des recherches sur les pa léo-paysages, le plus souvent dans la perspective d'une étude climatologique . Ils ont été évidemment conduits à travailler avec les archéologues préhistoriens, mais aussi avec les archéologues et les h istoriens travaillant sur les périodes récentes. Parmi ces laboratoires, il faut compter au premier chef, à Montpellier, le Laboratoire " Paléobotanique, Environnement et Action de l'Homme ", à Marseille, l'Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Pa léoécologie, à A ix-en-Provence, les géomorphologues de l'Inst itut de Géographie et du CEREGE.
1.- Les marqueurs de la mise en culture Les disciplines paléoécologiques ne se contentent plus de fournir aux historiens et
archéologues des listes florist iques : e lles apportent de précieux renseignements sur les caractéristiques d'un couvert végétal qui se modi fi e en fonction des orientations économiques impulsées par les sociétés. En principe, sous nos climats, ces dynamiq ues de végétation sont fréquemment régressives : la forêt est défrichée par les agriculteurs ou exploitée les artisans afin d' obtenir du bois de chauffage pour les mines et surtout pour les fou rs. Cette évolution est évidemment accrue par les besoins des marchés citadins en produits agricoles et en produits
12
artisanaux gourmands en combustibles. Durant l'époque romaine, l'urbanisation mul6plie les besoins pour la construction (charpenterie et fabrication de la chaux et des matériaux cuits), pour le chauffage des thennes et pour la fabrication des conteneurs céramique.
Dans la région littorale, milieu instable donc sensible à toute modification, en Provence, dans le bas Rhône et dans Je Languedoc, des travaux récents en anthracologie et des études palynologiques permettent de suivre l'évolution de la pression anthropique sur Je milieu végétal et son effet sur les paysages à la fin de J'âge du Fer. À pied, du massif des Alpilles, dans la Vallée-des-Baux, le Subatlantique est caractérisé par l'effondrement des fréquences des taxons forestiers (chêne à feuilles caduques ou pin) et l'apparition des taxons cultivés dont la persistance témoigne d'activités agricoles (Andrieu et alii 2000, 58). Ces activités, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, n'excluent pas des reprises forestières qui restent mal datées (Riera Mora 2000, 369-370). Mais d'une manière générale, les données paléoécologiques permettent de nuancer l'image que l'on avait de la région durant Je haut Moyen Age . Il n'est évidemment pas question de nier ni J'importance de l'eau ni celle de la déprise agricole dans le paysage médiéval de la plaine d'Arles. L'abbaye de Montmajour émerge comme une île au milieu de marais, au maintien desquels les moines sont attachés (Stouff 1993). Les diagrammes polliniques n'y enregistrent aucune reconquête végétale particulière, probablement du fait de la persistance de l'économie agricole. Les carottes prélevées dans le delta du vieux Rhône et du Rhône actuel au large du golfe du Lion par N. Acherki (Acherki 1997) enregistrent elles aussi, à la même date, J'intensification de l'action humaine avec quasiment les mêmes marqueurs de culture que précédemment. S'y ajoutent Pinus sp. et Bu:xus sempervirens, ce dernier taxon indiquant des milieux ouverts. Ces sondages précisent et en général confirment les conclusions de l'étude conduite par N. Planchais sur le site lagunaire de Marsillargues au bord de l'étang de Mauguio, en Languedoc (Planchais 1982). N. Planchais attribua it à une première phase de défrichement un effondrement de la chênaie-hêtraie saisissable au niveau des fréquences de Pagus dans les assemblages polliniques de la fi n de l'âge du Fer. Si la période romaine est peu marquée sur le diagramme pollin ique de Marsillargues, les spectres anthracologiques de cette période montrent une ouverture plus grande du milieu dans les plaines alluviales et un environnement immédiat des sites étudiés pauvre en boisements spontanés : l'arboriculture, attestée par le bois de taille, y occupe une place importante (Chabal 1997, 132). Il en est de même à l'ouest, dans la vallée de l'Aude, pour les séquences de Peyriac et de Capestang (Guilaine et al., 1990) sont comparables à ces sondages et à ceux du Golfe du Lion. Elles enregistrent la même double évolution : recul net de la chênaie caducifoliée et/ou chênaiehêtraie au profit de Quercus ilex-coccifera, ou de Pinus à Peyriac notamment, et des formations ouvertes de garrigues ou landes (Ericacées, C upressacées, Bu:xus) et augmentation conjointe des marqueurs d'anthropisation (Cerealia, Plantago, Artemisia, Juglans, 0/ea, Vitis).
Dans l'arrière-pays languedocien, dans la combe de l'Hortus, J.-L. Vernet a pu suivre la mise en place de la chênaie verte au détriment de la chênaie caducifoliée entre la fin du IVe et le Ve s. (Vernet, 1973). La palynologue J. Renault-Miskovsky y observe une diminution de la représentation des arbres qui chute de 22,5% à 7% alors que progressent les Carduacées, Anthémidées et Cichoriées. L'examen de la texture de Quercus pubescens montre que les bois des foyers sont d'abord récoltés dans des peuplements serrés, puis, ensuite, dans des formations de plus en plus ouvertes. L'activité des fondeurs qui alimentent leurs fours dans un proche voisinage, est ici directement responsable de la transformation du paysage, non pour l'agriculture, mais pour une gestion des peuplements ligneux. Le contraste ne doit cependant pas être exagéré.
Cependant, s'agissant d'un milieu homogène, on observe des nuances régionales intéressantes. Dans Je bassin de l'Aude, la dim inution des taux d 'essences mésophiles est plus accentuée et plus précoce et, d'une manière générale, le démanage des déboisements est plus rapide qu'à Marsillargues où les Cupressacées et les Ericacées, marqueurs de milieux ouverts, n'atteignent leurs maxima qu 'après le haut Moyen Age. Ainsi à l'est de l'Hérault, la fin de la Protohistoire et le début de la romanisation sont marqués par une chute des pollens arboréens caractérisant un très fort déboisement. Cette situation est probablement liée à la proximité de Narbonne, capitale de la Province, et à une urbanisation régionale beaucoup plus forte que sur le littoral du Languedoc oriental où les principaux centres romains sont situés à l'intérieur (Nîmes). La crise des VIe-Ylie s. est aussi inégalement ressentie : sur les carottes étudiées par N. Acherki, la forte présence de plantes rudérales traduit une intensification de l'activité agricole à partir des VIle et VIIIe s. (Acherki 1997) ; sur le diagramme de
13
Marsillargues, vers le VIIIe s. (1300 ± 60 B.P.), l'intervention humaine sur le milieu forestier est perçue par la rapide diminution des fréquences du pollen de Quercus type ilex (qui inclut Q. ilex et Q. coccifera) ; elle traduit un épisode de déforestation que l'on explique par la mise en culture. Cet événement est en effet accompagné par l'apparition des courbes polliniques continues de taxons cultivés : Castanea sp., Juglans sp., Olea sp., et Vitis sp.. Corrélativement, les pics de Bruyère arborée, de Cerealia et du cortège des adventices plaident également en ce sens. À Psalmodi (V e-XIle s.), Mauguio (XIe siècle) et Lunel-Viel (Xe-XIIe s.), le paysage est déboisé. La chênaie mixte a régressé et le pin d'Alep occupe une place essentielle (Durand, 1998 329-332). En effet, recolonisant les zones ouvertes plus rapidement que le chêne vert, cette essence se comporte comme un véritable bouche-trou. Cependant à Lunel-Viel, la régénération de la chênaie a été mise en évidence au tournant des IVe et Ve s. (Raynaud et al. 1990, 318-326).
Ainsi, tous les signaux anthracologiques font état d'une très forte anthropisation du mi lieu dès le début du haut Moyen Age. Dans la plaine du Languedoc orienta l, notamment, de nombreux aménagements intensifs et diversifiés, en particulier l'installation de vergers ont été reconnus. Cette constatation est confirmée par la documentation écrite : l'épanouissement des monastères bénédictins, dont Psalmodi est l'un des fleurons, et qui est encouragé par la politique royale puis impériale, et J'installation de colons réfugiés d'Espagne et dotés d'un contrat spécifique, l'aprisio, expliquent que les déforestations carolingiennes se soient soldées à la fois par une colonisation agraire et une intensification de la prise de possession du sol. Cependant il existe des disparités régionales. Dans le Massif Central, J.-L. de Beaulieu, A. Pons et M. Reille ont procédé à l'analyse pollinique de 88 sites tourbeux, marécageux ou lacustres pour lesquels ils disposaient de 160 dates C 14
·. Cette ana lyse montre un déboisement général à l'époque gallo-romaine qu'ils expliquent par une exploitation du milieu comparable à celle que l'on observe au XIXe s .. La reforestation qui suit débute au IVe s. et dure j usqu'au mil ieu du IXe s. (Beaulieu et alii 1988).
2~ La question des brûlis Au défrichement est associé l'usage du feu dont la place dans l' agriculture suscite des débats:
longtemps, les historiens comme les botanistes et les phytogéographes ne l'ont abordé que pour déplorer l'érosion, la désertification et la dévastation consécutives. Pourtant, jusqu'à la mécanisation du XIXe s., les techniques de défrichement par le feu des landes, des prairies ou des forêts ont été les seules connues et employées pour étendre de grandes surfaces agricoles. Dans les Pyrénées centrales, les travaux de J.-P. Métaj Jié sur le feu pastoral (Méta ilié 1981) ont réhabilité le rôle du feu en tant que facteur naturel du fonctionnement de nombreux écosystèmes. Mais ce rôle est difficile à caractériser dans la documentation écrite : les allusions à l'usage du feu ou des cendres chez les agronomes antiques sont rares et ne concernent que le bnîlis des chaumes ou des broussailles et l'usage des cendres comme engrais (Sigaut 1975, 295). Les sources médiévales carolingiennes sont totalement muettes sur Je sujet. De ce fait, l'archéologie est appelée à se développer pour établir la réalité de ces pratiques, à l'image de ce qui a été réalisé en Europe du Nord où l'analyse palynologique en tourbière date la première agriculture européenne grâce à la pratique du brûlis.
Les fines observations sédimentologiques qu'il a réalisées en Valdaine puis dans la plaine d'Orange ont conduit J .-F. Berger à poser la question de l'origine des feux dont témoignent les charbons apparaissant sur les lames minces soumises à l'étude micro-morphologique. En Valdaine, une succession d'incendies serait liée à la pratique du brûlis dans Je cadre d'une économie pastorale. Selon lui, du IVe s. au Xe s., l'exploitation des massifs aurait été" marquée par la répétition des feux et le maintien d'espaces ouverts, où dominent les fruticées et les pelouses sèches d'après les malacofaunes identifiées dans les alluvions, en pied de versant. Les spectres des végétations incendiées sont marqués par l'absence du chêne pubescent et la fréq uence de l'orme, du frêne, du bu is et des Rosacées (type sorbier). Ce spectre évoque une végétation ouverte de lisière ou de haie pour les coll ines et plateaux périphériques "(Berger 1995, 1 05). À l'aval, dans la plaine d'Orange traversée par le T.G.V., d'autres observations ont pu être effectuées sur les deux s ites de Caderousse-les-Crémades et les-Négades. Les sédiments ont enregistré "des brûlis de haies ou de lisières forestières" en relation probable avec des cultures céréalières. La dernière phase de culture antique se situerait dans le courant du VIe s .. Durant les deux ou trois siècles suivant, " les indices d'anthropisation sont
14
uniquement perceptibles sous forme d'incendies de la chaînée caducifol iée" et seraient liés à l'exploitation pastorale (Berger à paraître).
Ces constatations s' inscrivaient dans la réflexion sur Je " rôle du feu dans les techniques de préparation du champ dans l'ancienne agriculture européenne" développée par F. Sigaut dans son ouvrage sur L'Agriculture et le feu (Sigaut 1975). Celui-ci a montré que défrichement par le feu, amendement par essartage, écobuage, brûlage des friches, des landes et des pâturages par feu courant sont des techniques agraires spécifiques. Les auteurs qui en recherchent la trace sur le terrain s'accordent à reconnaître la difficulté qu'il y a à les identifier et à distinguer leurs traces de celles des incendies naturels ou déclenchés sans objectifs agricoles ou pastoraux (Boissinot et Brochier 1997, 42-44). Compte tenu d'une phase climatique caractérisée par une certaine sécheresse au IXe s. au moins, J.-F. Berger et S. Thiébault considèrent que la sensibilité naturelle aux incendies se serait conjuguée à une période de réorganisation de l'agrosystème nécessitant de gagner des nouveaux espaces pour des pâturages (Berger et Thiébault, 1997). Cette proposition s'appuie sur d'autres indices paléo-écologiques. En Valdaine (région de Montélimar), la période est caractérisée par le développement de "sols de prairie évolués" favorables au développement d'une économie pastorale. La malacologie montre que, dans les zones marneuses, des écosystèmes palustres et de prairies humides succèdent aux champs cultivés (Berger 1995, l 03). Mais pour être validée, elle requiert une confirmation par des données archéologiques ou par les sources écrites.
Des indices indirects peuvent confirmer [e défrichement par le feu. L'un des plus sûrs est la relation bien établie entre le brûlis et certaines cultures. C'est le cas des plantes-racines et des cultures récoltées en vert (Sigaut 1975, 115) et, parmi les graminées, celui du sarrasin (Fagopyrum), identifié pour Je Moyen Age à Canet-Saint-Nazaire par N. Planchais (Planchais 1985). C'est aussi le cas de certains ligneux. Dans les Pyrénées audoises, à Pinet, les assemblages polliniques provenant d'une tourbière située à 880 m d'altitude sont marqués par un effondrement de la chênaie et de la hêtraiesapinière (Pagus, Abies) et par un maximum transitoire des fréquences de Betula. Or le bouleau est, avec l'aulne, une essence pionnière, recolonisatrice de forêts de résineux brûlées, car les capacités germinatives de ses graines sont stimulées par les sols cendreux (Sigaut 1975, 112). Sur ce site, des marqueurs polenanalytiques considérés comme caractéristiques des modifications introduites par l'élevage (Poaceae, Plantage lanceolata, Chenopodiaceae) justifient l'interprétation comme un épisode de défrichement : des terres ont été gagnées sur la forêt afin d'être transformées en pâturage. Au même moment l'accroissement des fréquences de plantes cultivées (Cerealia, Fagopyrum) et de plantes rudérales (Attemisia et autres Compositae) atteste la mise en culture de parcelles (Reille 1991 ). Par ailleurs le brûlage qui entraîne une minéralisation des matières organiques favorable à la pousse des végétaux, agit comme ferti lisant. F. Sigaut rappelle que « lors de leurs essais de défrichement, les archéologues danois ont vu apparaître une population végétale bien caractéristique comprenant le plantain lancéolé, diverses composées (Pissenlit, marguerite, chardon) et certaines espèces de mousses. L'observation avait été faite pour les défrichements du Nouveau Monde où " .le Plantain était pour les Indiens la piste de l'homme blanc " (Sigaut 1975, 112-113). À Marsillargues aussi, les résultats polliniques suggèrent une interprétation de ce type. Le sondage palynologique enregistre à partir du Haut Moyen Age la progression des Cupressacées, plus particulièrement des genévriers. Comme le bouleau, les genévriers sont des arbustes préforestiers s'installant sur des sols postculturaux et qui culminent dans la reconstitution d'un couvert et d'un sol forestiers. Or dans les tetToirs de l'arrière-pays et du littoral, un système de cultures syncopées triennal à céréales d 'hiver et avoine a été reconnu (Durand 1998, 312-323). Par " syncopées", on entend des systèmes de cultures où une organisation inteme du terroir existe sans qu'elle soit totale à la d ifférence des cultures assolées (R. Fossier). Un tel système à longues friches périodiques ne se conçoit qu ' itinérant, sur essartages temporaires. La progression des genévriers à Marsillargues au Haut Moyen Age a ainsi été interprétée comme un témoin indirect d'une céréaliculture itinérante sur brûlis.
Ces résultats encore dispersés demandent à être complétés. Ils montrent néanmoins que Je système abattis-brûlis qui avait permis l'expansion des sociétés depuis Je Néol ithique n'est pas abandonné aux Ve-XIIe s .. Dans une histoire générale des agricultures, le Moyen Age est considéré comme la période où se met en place le système de la culture attelée lourd ; dans les zones de plaine, celui-ci succède au système à jachère avec élevage associé et culture attelée légère existant depuis la haute antiquité (Mazoyer et Roudart 1997, 128). Sur le plan spatial, une tendance générale observable
15
à l'échelle d'un vaste ensemble géographique ne préjuge pas de la réal ité des usages à l'échelle microrégionale et même régionale. En effet tous les tenoirs ne se prêtent pas à une telle évolution et la recherche souligne l'attachement des communautés paysannes aux méthodes et aux techniques qui ont fait leur preuve.
IV- LES PRODUCTIONS AGRICOLES
La confrontation d'études paléoécologiques et archéologiques permet d 'aborder la question des productions agricoles pour une période où les données écrites demeurent encore rares.
1 - Oléiculture Dans les années 1980, l'oléiculture romaine fut l'objet d'une attention particulière et fut
considérée comme l'activité agricole majeure de la province. Cette opinion avait des fondements culturels : l'olivier est la plante associée aux civilisations méditerranéennes. À l'époque moderne, il joua effectivement ce rôle en Provence. Le résultat des prospections archéologiques confortait cette opinion, tandis que la fouille d'installations de production permettait de définir les caractéristiques techniques des systèmes de pressurage et d'évaluer l'importance des installations (Brun 1986). D'autre part, cette théorie rencontrait la faveur des palynologues. Pour eux, il était commode d'établir une relation entre l'augmentation du pourcentage, - le " pic " - , de Olea observée sur les diagrammes polliniques et la période romaine. De ce fait, s'installait un raisonnement circulaire : la palynologie validait une théorie qu'elle avait empruntée aux historiens, celle d'un développement massif de l'oléiculture dans le sud de la Gaule. Mais, à la différence de ce qui se produisit pour la viticulture, on ne put mettre en évidence l'existence d'une production amphorique spécifique : il n'existait pas d'amphores à huile de Narbonnaise dont la ca1tographie permettrait de suivre la diffusion du produit. La céramologie attestait au contraire l'importance des importations d'Espagne et d'Afrique. Une comparaison entre installations de Narbonnaise et installations d'Afrique où les bâtiments de grande taille sont beaucoup plus fréquents, le laissait déjà penser.
Il fallut se rendre à l'évidence : l'identification relativement aisée de 1 'oléiculture en prospection était à l'origine d ' une surévaluation de cette activité. Le pressage des olives donne en effet lieu à la confection d'un appareillage lithique caractéristique ; pour les contrepoids et pour d'autres parties du pressoir, on utilise des blocs de pierre de grande taille commodément identifiables en prospections. Depuis les années 1990, l'importance économique de l'oléiculture provençale à l'époque romaine a été rééval uée. Dans les diagrammes polliniques, des signes de culture d'Olea sont enregistrés à la fin du Subatlantique sans dates précises. C'est le cas dans les séquences polliniques de Ponts-Clapets-Fos et Grands-Paluds-de-Fos D20 (Triat-Laval 1978) et dans celle de l'Etang-du-Pourra (Laval et al. 1991). La mise en culture de cet arbre n'est datée que dans un seul diagramme, celui de l'Etang-de-Berre (Laval et al. 1991) où le début de J'événement est daté de 1070 ± 70 B.P. Dans la Vallée-des-Baux, l'enregistrement des périodes postérieures à la période romaine a été grandement affecté par les labours profonds pratiqués pour la riziculture. En revanche sur les bords de la plaine d'Arles à La Calade, V. Andrieu a observé dans la séquence qui s ' amorce au XIe s. une très forte croissance des taux de Olea qui porte les maxima à 6% de la somme pollinique et témoignent d'une oléiculture régionale. Antérieurement, l'arbre n'est pas absent, mais les taux de pollen restent faibles même s'ils ne permettent pas d'exclure qu'il ait été cultivé (Andrieu-Ponel et alii a 2000, 353). L'apogée de l'oléiculture de la France Méridionale est bien médiéval et moderne ; il est lié aux échanges avec l'Europe du Nord.
Dans les sondages polliniques de Marsillargues, du Golfe du Lion ou du bassin de l'Aude (Planchais 1982, Acherki, 1997, Guilaine et al. 1990), la présence de l'arbre est enregistrée depuis le début des séquences de manière très fugace et sporadique. Les pics majeurs de culture datent du Haut Moyen Age, vers les VIlle et IXe s., puisque, pour les lagunes orientales, ils sont postérieurs à la datation 14C de 1300 B.P .. Les analyses anthracologiques des sites d'Augery (IXe-Xe s.), de Psalmodi (Ve-XIIe s.) et de Mauguio (Xe-XJe s.) entérinent ces données en restituant l'image d'une plaine alluviale où la fructiculture, avec l'olivier au premier chef, occupe une surface importante. Pour l'instant, les études carpologiques n'ont pas pu confirmer ces faits, mais cette lacune est due à la rareté
16
des analyses portant sur la période carolingienne en France méditerranéenne (Ruas, 1992, 1993). La documentation écrite régionale n'enregistre pas non plus un essor de l'oléiculture aux Vliie-IXe s., même si les olivettes ne sont pas inconnues. En revanche, elle atteste d'une phase d'intensification agricole par la plantation de fruitiers dans l'ager languedocien à partir de la fin du XIe s. : les olivettes envahissent alors les plateaux de garrigues et les bassins sédimentaires telle la Vaunage. Au début du XIIe s., elle est suffisamment développée pour devenir une affaire de spécialistes : l'existence de groupes de travailleurs spécialisés, les olivadors et d'une corvée spécifique, l'olivigarium, entérine un savoir-faire techn ique et une méthode de culture oléicole très pointue (Durand 1998, 345). En Provence, au moins dans la région arlésienne et l'arrière-pays niçois, il faut attendre le début du XVe s. pour voir l'essor de l'oléiculture (Boyer 1991, 14 7, Stouff, 1988).
Parallèlement, Je développement des prospections a confirmé que l'extension des vestiges archéologiques de l'oléiculture antique avait bien été surévaluée. Nulle part absente, elle était bien présente en Languedoc (Garcia 1992). Mais elle a laissé des traces importantes surtout sur le littora l provençal, dans le département du Var et dans la région marseillaise (Leveau et alii 1991). En définitive donc, les données dont nous disposons confirment les dires de Strabon qu i explique que l'olivier a été introduit en Gaule du Sud par Marseille. La douceur des hivers du littoral de Provence (Var) explique que les vestiges d'oléiculture y soient plus nombreux. Les espèces cultivées de meilleur rendement introduites par les Grecs de Marseille y ont probablement rencontré des conditions plus favorables que dans Je Bas Rhône et le Languedoc exposés à des coups de froids violents. Vers le nord et vers l'ouest, leur diffusion se serait donc heurtée à une contrainte climatique. Les espèces indigènes étaient adaptées, mais leurs rendements étaient moindres. Dans la discussion, la dimension historique est fondamentale. La solution la plus vraisemblable est que le développement maximal de l'oléiculture au Petit Âge Glaciaire soit dû aux soins apportés à la plante. Des raisons économiques auraient détourné les agronomes romains de lui app liquer le savoir-faire dont ils avaient fait preuve pour la v igne. Mais on ne peut non plus exclure que certaines caractéristiques climatiques méditerranéennes bénéfiques à l'olivier cultivé ne soient apparues dans la région durant le Moyen Âge (Jalut et alii 1 997).
2 - Viticulture Jusqu'à ces dernières années, la vigne était connue en Gaule par quelques sources écrites qui
avaient permis à R. Dion d'en retracer l'origine dans un ouvrage célèbre (Dion 1 959). À partir des années 1980, la question a été complètement renouvelée par les données archéologiques. Les premières ont été fournies par les amphores, en particulier par l'étude qu'en a faite F. Laubenheimer qui, à ce moment, établit que cette production était exportée dans des amphores spécifiques, les amphores dites " Gauloises " . La cartographie des fours à amphores a ainsi permis de dresser les premières cartes du vignoble de Gaule du Sud (Laubenheimer 1992). Vers le nord, la production est exportée vers la frontière de Germanie et vers la Grande-Bretagne. À Rome, jusqu'au flle s., les importations de vin gaulois sont très importantes. En Orient, il est exp01té jusqu'aux Indes. Dans les années 1990, de nouveaux progrès archéologiques ont été réalisés. Sur les sites, les foui lles ont permis d'.identifier des installations de production et de stockage, dans la vallée du Rhône, dans le Languedoc et en Provence. Ces installations étaient de toutes dimensions. Les chais les plus importants connus jusqu'à ces dernières années, celui du Mollard à Donzère dans la Drôme et celui de Rians dans le Var, ont des capacités maximales de stockage évaluées respectivement à 2 500 hl pour 200 dolia (Odiot 1996) et de 1 760 hl pour 176 dolia (Brun et Congès, 1994). La découverte de traces de plantation attribuées à des vignobles constitue la troisième et la plus récente étape de la recherche. Compte tenu des conditions de conservation qui privilégient les vignobles de plaines ou de bas de versants par rapport à ceux de collines, les décapages auxquels ont donné lieu les aménagements routiers et ferrovia ires (T.G.V.), ont permis de mettre au jour de vastes espaces plantés en vigne (Boissinot 1997) et donné naissance à une véritab le spécialisation, une archéologie du champ (Monteil et alii, 1999). Comme pour l'olivier et en termes similaires se sont développées des études archéo-botaniques qui en pa1ticulier permettent de poser en termes nouveaux la question des bases botaniques de l'émergence et du développement de la viticulture en Gaule. La connaissance de celles-ci permettrait de valider ou de relativiser le rôle de Marseille par rapport aux peuples indigènes (Marinval 1997). Sur les sites archéologiques, la carpologie, l' anthracologie et la xy lo logie permettent d' identifier la
17
présence de la plante. Le pollen de vitis disperse moins que celui de l'olivier. Cependant, dans la campagne, la caractérisation palynologique de la vigne est une constante de tous les d iagrammes : à Embouchac près de Lattes, par exemple, elle est l'un des taxons caractéristiques du sub-atlantique (Puertas 1 998) : les pourcentages, jusqu'à 16%, prouvent qu' il s'agit bien de la variété cultivée et non de vigne sauvage ( <2% ).
À partir de l'étude des chais, on admettait qu'au-delà du llle s., la viticulture avait connu un lent déclin. Les travaux les plus récents nuancent cette idée. Bien établie en Gaule du Sud, l'association entre v iticulture et entrepôts à dolia ne se retrouve pas en Gaule du Nord, en particulier dans le vignoble de Moselle. I l ne faut donc pas exclure l'existence de stockage en tonneaux dont l' identification est très difficile. C'est ce qui a été proposé par J.-P. Brun en Provence (Brun 1993) et par C. Pellecuer en Languedoc. Dans cette région, ce dernier a établi que la production de vin se poursuivait au Ve. Il l'observe déjà sur une villa proche de l'oppidum d'Ensérune, N issan-lezEnsérune/Les Fargettes (Pellecuer 1996). Mais sa contribution majeure porte sur la villa des Près Bas à Loupian (Pellecuer à paraître). Sur ce site, dans la seconde moitié du IVe s., des pressoirs sont installés de nouveau dans la villa où un bâtiment de stockage est construit. Par la suite, au début du Ve s., l'aile résidentielle est reconstruite et agrandie aux dépends des bâtiments de stockage. Mais la viticulture ne disparaît pas. Des instaJiations de production ont été reconnues au Bourdou/Port de Loupian, à 2 km de la villa. Cette découverte constitue actuellement le témoignage architectural le plus tardif sur une viticulture locale. La paléoécologie et la fouille de champs apportent des indications qui vont dans le même sens. La culture de la vigne paraît également attestée pour la phase 370/425 autour de l'établissement agricole qui a été fouillé aux Jurières-Basses à Puissalicon dans l'Hérault. En revanche, dans la phase de ce même établissement correspondant à la seconde moitié Ve s.-VIe s., Vitis a pratiquement disparu des charbons de bois (Mauné et alii, 1998, 108). Les données fournies par la fouille de champs à Dassargues vont dans le même sens. Des saignées ont été identifiées comme la trace de plantation d'un vignoble ancien de plusieurs hectares daté des Ve et VIe s ..
La documentation archéologique est muette pour la période qui suit. Ce silence, comme celui des textes, laisse croire à lill déclin de la v iticulture en Provence comme en Languedoc. En effet, les témoignages de vignobles ou de plantations de vigne ne réapparaissent qu'aux IXe-Xe s. avec les balbutiements de la documentation écrite. En zone urbaine d'abord : dans les anciennes cités antiques, une treille ombrage presque systématiquement la domus ou la mansio cum curte ; dans les campagnes ensuite, les vignes voisinent aux côtés des champs dans la longue litanie des biens inventoriés au sein de la villa. Mais, si la culture de la vigne est bien présente, on peine à en mesurer l' importance exacte au IXe s. ; au Xe s. en revanche, l'essor de la viticulture, notamment en Biterrois, prépare la grande croissance du Moyen Age central à partir de 930-960 (Bourin-Derruau 1987). En effet, par le biais du contrat de complant, une partie des terroirs consacrés à la céréaliculture deviennent des vignobles. L'extension de l'encépagement se marque également par l'existence de maieuls et de plantiers qui montrent la jeunesse de tels terroirs. D'après le rapport entre le nombre d'occurrence des jeunes vignes et le nombre total de vignes citées, M. Bourin conclut à la v igueur du phénomène. La mobilité des terrains viticoles, signe de la vitalité du marché, en constitue un autre signe. Cet accroissement ne se fait pas sur de nouvelles terres, mais au sein des v ieux terroirs de la plaine. La vigne est implantée dans les zones basses, proche des ruisseaux et rivières, dans les bonnes terres alluviales humides. Pour une exploitation rurale, Je manse, on recense deux à trois vignes pour 5 à 6 champs (Bourin-Derruau, 1987). Dans le cartulaire de Nîmes, au Xe siècle, les vignes forment de grands quartiers de parcelles jointives. Un tel engouement, en particulier dans les zones urbanisées ne s'explique pas seu lement par l'augmentation de la consommation. M. Bourin évoque la possibilité d'exporter la production, mais sans aucun indice à l'appui. L'archéologie n'est pas d'un grand secours puisque le vin est commercial isé en tonneaux et non plus en amphores. Pourtant Vitis sp. est identifiée par l'analyse anthracologique en faibles pourcentages à Psalmodi (VllJe-Xlle s.), Lunel-Viel (Xe-XIIe s.), Béziers (XIIIe s.) alors que ce taxon est absent à Augery (lXe-Xe s.). Quoi qu'il en soit, l'expansion du vignoble languedocien vers 950 constitue une forme nouvelle d'investissement, souvent à caractère spéculatif car d'exceUent rapp01t. Elle débouche sur une intensification des relations commerc iales. L'expansion se poursuit aux siècles suivants. Th . Sclafert insiste beaucoup sur l' importance de la
18
vigne dans la vallée de la Durance (Sclafert 1959). Selon les analyses anthracologiques, la vigne est cu ltivée en Valdaine.
3 - Céréaliculture La mise en évidence de la céréaliculture pose aux archéologues un problème complexe, qui
présente de grandes analogies avec celle de l'élevage. L'une comme l'autre sont identifiés sur les sites ruraux à partir de vestiges liés à leur consommation : déchets alimentaires, matériel lithique utilisé pour la préparation de la farine. Mais la consommation des céréales est à la base de l'alimentation de sorte que le nombre des mortiers ou des meules trouvées sur un site ne permet pas d'évaluer une production locale. Pl us que pour l'huile et le vin, il faut en effet distinguer deux types de production. Dans le cadre d'une économie vivrière, la production de grains pourvoit à la consommation locale. Elle permet en second lieu de dégager des surplus uti lisés pour l'exportation. En Gaule du Sud, ce type de production a existé à l'époque romaine. À la fin du fie s. avant J.-C., Marius dut importer du blé pour ravitaiJJer ses troupes stationnées dans la vallée du Rhône. Dans les années 75 av. J.-C., Fonteius recourt à des réquisitions pour ravitailler les armées de Pompée en Espagne. À l'époque impériale, la situation a changé et la Narbonnaise est devenue exportatrice. Témoignage de cette situation nouvelle, une inscription peinte sur une amphorette nous assure qu'au Ier s., les Cavares envoyaient de l'orge de la région d'Avignon à Marseille (Liou et Morel l977). À côté du marché libre, existait un marché contrôlé par l'Etat qui lui assignait pour objectif de participer au ravitaillement de Rome : deux textes sont probablement en relation avec le service de l'annone (C.I.L., III, 14185 et C.I.L., XII, 672 = l.L.S ., 1432). Les sources archéologiques sont peu explicites. Les champs de céréales sont beaucoup plus difficiles à faire parler que les vergers dont la fouille renseigne sur l'espacement des arbres ou des arbustes. Pour les stockages, les difficultés ne sont pas moins grandes. À l'époque romaine, le stockage est aérien et, de ce fait, les greniers sont difficiles à identifier. À l'époque protohistorique et au Moyen Âge, le stockage était souten-ain. Mais même dans ce cas, des difficultés existent. Car si la fouille de silos nous renseigne sur les volumes de grains stockés, en revanche il est plus délicat d'interpréter en termes de consommation les vestiges carpologiques qu'elle livre, dans la mesure où il est exceptionnel de fouiller un silo non encore ouvert : après avoir été vidées de leur contenu, ces structures ont fréquemment fonctionné comme dépotoir (Raynaud et a l., 1990).
Le développement récent des approches environnementales pour la période qui nous occupe jette un jour nouveau sur cette question. Les travaux dont ont été l'objet la basse vallée et le delta du Rhône en donnent une bonne illustration. Comme l'écrivait F. Benoit, la Camargue n'était sans doute pas un grenier à blé, les activités de pêche et d'une manière générale les activités liées à la mer y étaient importantes (Benoit, 1959 ; 1965, 116, n. 33). Mais quelle que soit leur importance, l'agriculture céréalière joua un rôle fondamental durant l'Âge du Fer et l'époque romaine et ne disparut jamais vraiment. Dans ces secteurs, la production de céréales aurait donc connu une forte extension sur les terres alluviales après drainage. Elle aurait constitué une des bases de la prospérité de la colonie romaine d'Arles. Quelques analyses polliniques justifient l'hypothèse de terres à blé plus au nord dans la région. En effet, la céréaliculture apparaît nettement sur les profils dressés par H. Triat-Laval dans sa thèse. Si aucune date précise n'a pu être donnée pour le profil de Barbegal, à quelques kilomètres de là, en bordure de la plaine du RJ1ône, le profil de La Calade montre pour le second âge du Fer et l'époque romaine une courbe continue de Cerealia ; Cerealia sp. y domine mais le seigle est présent et les adventices (Centaurea solstitialis et Polygonum aviculare) attestées par des occun·ences irrégulières. Pour V. Andrieu-Ponet, c'est la preuve que les céréales étaient cultivées dans la plaine d'Arles. Par Ja suite durant la seconde phase correspondant aux périodes mérovingienne et carolingienne, la courbe est plus continue et atteint 3 à 4 % tandis que celle de Centaurea solstitialis devient continue. Une troisième phase dont le début est situé dans les années 1200, est caractérisée par des taux élevés de plantes cu ltivées ou adventices correspondant à la période médiévale, la courbe reste continue, s'élevant même à 8% tandis que Centaurea solstitial is présente des fréq uences très élevées (Andrieu-Ponel et alii 2000, 353). À Augery-de-Con·ège en Tête-de-Camargue vers les !Xedébut du XIe siècle, l'analyse sporopollinique révèle une augmentation régulière des céréales (Lava! et Malléa 1993). Pour la plaine occidentale du bas Rhône, les carottages effectués sur des sédiments lagunaires (Marsillargues, Golfe du Lion) (Planchais 1982 ; Acherki, 1997) offrent une même vision
19
globale de l'extension de la céréaliculture durant l'époque historique. Mais là, comme en Camargue, les p ics majeurs de Cerealia ne se situent pas durant la période romaine ni à la transition AntiquitéMoyen Age, mais à la période carolingienne.
Dans les synthèses carpo logiques élaborées à l'échelle de la France, la singul arité de la France méridionale pour la chronologie qui intéresse ici a été plusieurs fois pointée (Ruas et Marinval 1991 ; Ruas 1999). La disparité classique entre plaines littorales et montagnes entérinée par une diversité céréalière plus nette dans les reliefs appartient également aux acquis scientifiques de ces dernières années. Elle se marque notamment par la p lace prépondérante en montagne des céréales dites secondaires, notamment les deux millets, Millet commun et Mill.et italien, deux céréales vêtues, que les textes languedociens du Moyen Age central ne mentionnent pas (Ruas 1999), et, en plaine, par celle de l'avoine et de l 'amidonnier. D'après les tableaux récapitulatifs, il semblerait que la diversité céréalière qui caractérise le Midi et la dichotomie arrière-pays-zone littorale s' installent entre lesVe et Xe s .. Mais, pour l'heure, le manque de données en série ne pem1et pas d'être entièrement affirmatif pour fa transition Antiquité-Moyen Age alors que J'Age du Fer et le début de la Romani sation sont bien mieux connus. Les analyses enregistrent également la progression des cu ltures de seigle, de fève et de sarrasin . Cette dernière espèce n 'est attestée que par l'analyse pollinique de Canet dans le Roussillon (Planchais 1985) et de Pinet (Reille 1991) vers le XIIIe s .. Origina ire d ' Asie centrale et peut-être cultivée en Armorique dès l'âge du Fer, elle ne s'est diffusée dans la zone méd iterranéenne que tardivement. Ces indices, troublants, paraissent accréditer l'hypothèse d'une culture de la plante bien avant les premières mentions textuelles (XVe s.). Souvent associées à des cultures d 'adventices germant à l'automne, les céréales méridionales sont généralement semées au sort ir de l'été et régulièrement sarclées; cela suppose un semis en ligne et non à la volée, ce qui va à l'encontre de la tradition historique établie (Ruas 1999).
4.- L'arboriculture fruitière L'huile et le vin sont bien les deux principales productions de l'agricu lture arbustive des Ve
Xle s .. Mais l' olivier et la vigne ne sont pas les seuls arbres cultivés pour leurs fruits. En démontrant que l'agriculture méditerranéenne ne se réduit pas à la monoculture de la trilogie méditerranéenne classique vigne"olivier"céréales, les données archéobotaniques apportent un démenti au stéréotype du paysage agricole méridional et en enrichissent l'image.
En France méridionale, les recherches archéobotan iques confirment ce que laissaient pressentir les sources écrites. On peut prendre pour exemple l'analyse carpologique des assemblages du site de Coudouneu fou illé par F. Verdin: l'étude carpologique de Ph. Marinval a mis en évidence la présence de l'ail, plante qui n' était attestée qu'au premier siècle de notre ère en Italie (Marinval 2000). Les prémices d'une arboriculture fruit ière se manifestent dès l'âge du Fer en relation avec le développement des échanges entre les populations indigènes et les peuples navigateurs qui transmettent les acquis des peuples d'Orient, d'Italie et d'Afrique. Plus précoces que dans la zone septentrionale, ils révèlent un réel raffinement des techniques de mise en culture issues du monde grec classique et hellénistique où l'horticulture et l'arboriculture fruitière étaient couramment pratiquées (Ruas, 1996). Cette chronologie confirme la pénétration économique de ces régions par Marseille puis par Rome antérieurement à la conquête et à l'organisation administrative de la Gaule du Sud. L'exemple du noyer est à ce suj et éloquent. Depuis l'article de H.-J. Beug (Beug 1975), les palynologues interprètent la présence de Juglans non seulement comme un marqueur anthropique, · mais aussi comme un point de repère commode pour mesurer la part croissante prise par l'agriculture. Aux alentours de• 2270 B.P. , soit au llle s. avant J. -C., la Juglans-line marquant l' introduction du noyer englobe la Méditerranée nord occidentale. De manière plus large, la diffusion de cet arbre est mise en relation avec la "romanisation " et sa présence util isée comme élément de datation à Pinet comme à Marsillargues. On considère qu'en Italie au premier siècle de notre ère, il était encore dans une phase d'expansion et que sa diffusion était loin d'être achevée (Benzi et Berliocchi 1999, 90). Cependant, les dernières analyses archéobotaniques semblent en reculer la date d 'apparition jusque vers 3500 B.P . (Triat-Laval , 1979; Arnaud-Fasetta G . et alii, en préparation). La paléocarpologie en particulier montre une diffusion du noyer en Gaule plus précoce que l'on ne pense. Dans le nord de France, Juglans regia est attesté au néolithique final ou chalcolithique (Ruas et Marinval 1991, 420) et dans Je sud en Aveyron (Krauss-Marguet 1981). Selon les analyses anthracologiques, il est cultivé
20
en Valdaine. En fait, il existe des attestations anciennes dans la documentation écrite, ce qui n'est pas surprenant au vu des traditions religieuses. Les Grecs associaient le noyer au culte de Dionysos et les Romains à celui de Jupiter comme l'indique son nom : Jovis glans a donné Juglans.
Les études archéobotaniques amènent aussi à relativiser l' influence du monde orientaL Depuis la célèbre boutade de J. Le Goff, il est admis gue l'abricotier est vraiment le seu l bénéfice qu'auraient ramené les croisés de la Méditerranée nord orientale. Selon toute vraisemblance, Prunus armeniaca a été cultivé bien avant le XIe s. en Languedoc. L'étude anthracologique menée par L. Chabal au Moulin Villard et à Lunel-Viel dans la plaine du Vistre identi'fie l' arbre au !er s. ap. J.-C (Chabal 1997 113 et 130). Sur l' oppidum de Nages, un unique noyau d'abricot en révélait déjà la consommation dans la seconde moitié du Ile siècle (Pottrain et Py 1975). De même, l'amandier aurait été introduit par les Grecs dans la Gaule protohistorique : c'est du moins l'hypothèse de L. Chabal pour expliquer sa présence sur 1 'île de Porquerolles (Cha bal 1991 ). On constate que durant la période carolingienne, l' arbre bénéficie de soins attentifs: les dimensions des vaisseaux des échantillons anthracologiques de Psalmod i montrent qu ' il est irrigué. Quant au pêcher, la carpologie comme l'anthracologie confinnent sa présence bien avant le Moyen Age central.
Dans la zone méridionale, les sites des Ve-Xle s. renvoient l'image d'une fructicu lture bien en place. Dès 1982, interprétant les données polliniques de Marsillargues, N. Planchais définissait Je Haut Moyen Age comme "une période d 'aménagements très intensifs et très diversifiés fondamentalement différents des organisations agroviticoles actuelles" où les vergers de Rosacées occupent une place de choix. Les analyses anthracologiques ultérieures confi1ment et élargissent cette vision. À partir de la fin du VIIIe s., chênaies et pineraies cèdent la place à l'arboriculture fruitière qui connaît un développement majeur: cerisiers, amandiers, figuiers, oliviers s ' installent dans toute la basse plaine languedocienne orientale. Au Moyen Age central, les chartes de l' arrière-pays languedocien révèlent que l' arboriculture fruitière est suffisamment répandue pour être devenue une affaire de spécialistes : le cellérier de l'abbaye d'Aniane, responsable de son ravitaillement, doit nourrir tous les jours les olivadors et les amanliadors (cart. An. n° lOO p.240 ( 1181-1188). Une telle terminologie entérine certainement un savoir-faire technique lié à une différenciation des tâches en fonction des essences. L'existence, sinon d'un groupe de travailleurs spécialisés, en tout cas de personnel attaché à une forme spécifique de fructiculture, témoigne de conduites culturales élaborées. La documentation écrite montre que les arbres fruitiers ne sont pas seulement plantés en terroirs homogènes. Au XIIe s., le vignoble complanté, le plus souvent d'oliviers ou d'amandiers, occupe une part de plus en plus importante et rompt, sauf en Biterrois, l'uniformité des quartiers cultivés. Sur ce plan, il faut tout attendre du développement en France méridionale d' une archéologie des champs qui a déjà fa it ses preuves en France septentrionale à la suite des décapages pratiqués en archéologie préventive sur de vastes surfaces. Les travaux de Laurent Vidal en ont apporté une première démonstration pour les paysages du Biterrois à la fin du !Xe s. et au début du Xe s. (Vidal 2000, 23 8-246).
5- Elevage Peu développée il a une vingtaine d'années encore, l'étude des faunes à partir des déchets
alimentaires contenus dans les contextes archéologiques fait l'objet d'une attention soutenue de la part des archéologues. De ce fait, l'archéozoologie a conquis une place importante pour les périodes historiques, antique et médiévale. Elle est maintenant en mesure de proposer des problématiques spécifiques sensiblement différentes de celles qui ont été élaborées pour des périodes plus a nciennes. Pour celles-ci, dans la mesure où la commercialisation des animaux, de leur viande et des autres produits étaient réduites, les faunes collectées permettaient une saisie directe de la gestion du troupeau relevant de la communauté vivant sur un site. À partir de la fin de la Protohistoire, une relation économique simple entre l'homme et le troupeau peut être à la rigueur admise pour des communautés paysannes marginales. Mais s'agissant du monde rural gallo-romain et médiéval, l'instauration de circuits commerciaux complexes empêche l'établissement d'un lien direct entre la consommation de viande comme l'archéozoologie peut l'établir et le cheptel du même établissement. Le bétail a pu servir à la consommation des occupants du site; il a pu aussi être commercialisé, de sorte que les restes osseux constituent une simple donnée dans l'étude de l'économie de l'élevage.
21
Un marqueur social
La dimension sociale de la consommation de viande est essentielle dans l'étude de la faune . Étudiant celles des sites antiques du littoral du Var, M. Leguilloux observait qu'elles ne révélaient pas de grandes différences économiques entre petits paysans vivant dans des hameaux et agriculteurs aisés des villae moyennes : la coupure passerait entre " ce groupe et celui des grands propriétaires " possesseurs de grandes villae dont les dépotoirs témoignent de la consommation de v iandes de qualité issues de la production ou provenant de la chasse (Leguilloux 1989, 322). Ainsi, le caractère résidentiel d'une villa est confirmé la consommation de viande. Dans la même région, cette situation caractérise jusqu'au Ve s. les sites de Saint-Michel à La Garde et des Laurons aux Arcs-sur-Argens.
Mais les époques historiques, antique et médiévale, ne constituent pas un bloc unique et il importe de reconnaître les phases de la consommation de viande. Au sud de l'Etang-de-Berre, sur le site de Saint-Julien-les-Martigues, une consommation de luxe est en relation avec les n iveaux du haut Empire, alo rs qu'à la fi n de l'Antiquité une f01te propo11ion de chèvres et de moutons est associée à une plus faible consommation de bœuf. Dans ce cas, l'analyse de faune rejoint l'histoire du bâti : le site est occupé d'abord par une villa résidentielle ; à la fin de l'Antiquité et jusqu'au VIe s., le statut social de ses occupants a changé; il s'agit d ' une population paysanne (Columeau 1996, 132-133). Dans l' arrière-pays languedocien, sur deux sites du premier âge castrai, Olargues-le-Vieux et SaintAmans-de-Teulet, A. Gardeisen met en évidence une consommation privi l.égiée de jeunes porcs et de moutons : les habitants des premières casernes perchés de l'an M il ne sont pas des paysans, mais bien des caballarii, comme J'attestent les caJTeaux d'arbalètes et les cornes d 'appel associées aux artéfacts osseux. Ils sont davantage préoccupés de rapine et de chasse que d 'élevage : leur statut social est privilégié (Durand et al. 1997). Ces exemples montrent qu ' une interprétation correcte des assemblages osseux requiert une réflexion archéologique portant sur l'ensemble du site et 1' insérant dans un cadre micro régiona l.
La question de la morphologie du cheptel bovin Les études ostéologiques permettent d'identifier une évolution des populations bovines et de
défin ir des ensembles correspondant à des situations économiques différentes. Pour le début de notre ère, e lles ont été insérées dans la problématique de la romanisation. Le point de départ de cette réflexion se situe dans le nord de la Gaule où les archéozoologues constatent une augmentation de la taille des animaux d'élevage, des bœufs en particulier, pour la période correspondant aux lendemains de la conquête (Brunaux et Meniel 1983 ). Actuellement un débat porte à la fois sur la réalité et l' importance du phénomène et sur son interprétation. Deux archéozoologues le résument ainsi : " Par extrapolation des données ostéométriques, un "petit bœuf" dit gaulois, rattaché au bœuf des tourbières, Bos taurus brachyceros Rütimeyer, est opposé à un " grand bœuf " dit romain, Bos taurus brachycephalus Wilckens" (Forest et Rodet-Belarbi 1998). D'ordre méthodologique et zootechnique dans son principe, ce débat est compliqué par l'oppos ition Gaulois/Romains : la courbe de croissance de la taille du bœuf est présentée comme un effet de la conquête romaine, puis de la crise et du déclin de l'Empire. La conquête aura it apporté l' introduction de nouvelles espèces de plus grande taille, originaires d'Ital ie. La crise et le déclin de Rome auraient entraîné un retour à la situation qui prévalait durant la période protohistorique. Proposé il y a quelques années, ce schéma historiq ue n'a pas été confirmé par les recherches archéozoologiques qui ont su ivi. Celles-ci ont montré qu'en Gaule, la situation n'était pas simple. Tout d'abord, les occurrences de " grand bœuf " sont plus anciennes dans le nord de la Gaule que dans le sud : apparu dans les deux dernières décennies du Ier s. av. J.-C., il n'est connu dans le sud qu'un siècle plus tard (Lepetz 1997). En Gaule du Sud, le " grand bœuf " s'impose vraiment à partir de la fin du Ier s. soit deux siècles après la conquête. JI domine jusqu'à la fin du Ve s .. Mais cette domination n'est pas exclusive : le " grand bœuf" n'élimine pas le " petit bœuf" : l'w1 ne caractérise pas plus le chepteJ. des contextes archéologiques " romains" que l'autre celui des contextes " indigènes". Les données ne permettent pas de penser que les "Romains" ont importé massivement des reproducteurs. JI faut plutôt imaginer une évol ution du cheptel par" volonté zootechnique d'obtenir de grands animaux à partir d'un cheptel gaulois originel " (Forest, RodetBelarbi 1998, 1054). Plutôt que d'importer des troupeaux, un riche éleveur de Narbonnaise uti lisera le système esclavagiste roma in et fera ven ir dans sajamilia rustica des techniciens servi les maîtrisant les
22
techniques de sélection; il les aura achetés sur un marché d ' Italie ou d'Orient ou le fera venir d' un des domaines qu'il possède dans ces régions. D 'autre part, la supériorité du grand bœuf n'est pas certaine. À cause des difficultés de conservation de la viande, une taille petite n'était pas un handicap pour des animaux de boucherie, si les débouchés étaient insuffisants (Columeau, communication orale). En revanche, des animaux de grande taille étaient plus aptes à la traction et présentaient un avantage si on les destinait à cet usage dans une exploitation agricole ou si on les utilisait pour le transport de lourdes charges. En fait, les études ostéologiques actuelles ne permettent pas de dire si le "grand bœuf" est remarquable plutôt par sa puissance ou par son poids, c'est-à-dire s'il s'agit d'un animal destiné à la traction ou élevé pour la viande. De toute manière, il s'agit d'un phénomène qui ne coïncide pas totalement avec les cadres chronologiques habituels : il s'impose seulement au cours du lie s. pour une période qui ne dépasse pas Je Ve s ..
Une régionalisation de l'espace Les archéozoologues commencent à spatialiser les données obtenues. En Provence . pour la
période romaine, au niveau local (microrégional), M. Leguilloux a util isé la faune pour préciser les caractéristiques d'un domaine, celui de la villa des Laurons dans la vallée de l'Argens (Berato et alii, 1990 245). Des spécialisations régionales ont été identifiées. L. Jourdan avait remarqué l'importance des restes de chèvres dans les faunes du port de Marseil le (Jourdan 1976, 133). M. Leguilloux a confirmé cette observation à partir de faunes provenant des foui ll es plus récentes : à la fin de l'Antiquité les caprinés, chèvres et moutons confondus, représentent 63 à 77 % de la proportion des lots. Une importante activité de pelleterie aurait constitué un débouché pour les t roupeaux des campagnes avoisinantes, voire de la Crau (Leguilloux 1998, 240). De son côté, constatant l'importance de la proportion de chèvres sur le site de la Poussaraque au sud de l'Etang de Berre, Ph. Columeau propose d'y voi.r la confirmation d'une hypothèse proposée par L. Jourdan d'après lequel la viande de chèvre aurait été boucanée. Ces données éclairent la relation entre Marseille et son arrièrepays (Columeau 1996 et 1997, 29-30). En Languedoc, A. Gard eisen, puis V. Forest ont montré que, durant Je haut Moyen Age, la plaine lagunaire orientale était vouée spécifiquement à l'élevage des bovidés en vue de la production de viande, élevage bien adapté aux conditions géographiques en regard de l 'arrière-pays où l 'élevage est intégré dans des circuits économiques et commerciaux (Gardeisen, 1993 Forest 1997-1998). Une relation entre forme d'élevage et milieu humide a été confirmée par Ph. Columeau dans ses études sur les faunes de la vallée des Baux (Columeau 2000, 353) et de la villa des Près Bas au bord de l'étang de Thau (Co lumeau à paraître). Dans une étude synthétique de J'al imentation camée dans le Languedoc médiéval, V. Forest insiste sur la pluralité des images obtenues par l' étude faunique: les sites pyrénéens se singularisent par la consommation d'espèces endémiques, ours et isard; sur les sites de plaines et collines, bœuf et mouton dominent. Ainsi les parties basses languedociennes se rapprochent de celles de la Provence du Sud tandis que les sites de moyenne montagne forment avec leurs voisins du nord de la Provence un ensemble intermédiaire entre les rives de la Méditerranée et la région Rhône-Alpes. De fait, une éventuelle spécifi cité languedocienne ou provençale n'est pas identifiée.
Pour les périodes pré et protohistorique, la connaissance de l'élevage a fait de grands progrès grâce à l'apport des analyses de sédiments prélevés par des naturalistes sur des sites de grottes où les marqueurs contenus dans les sédiments ont permis d'identifier la stabulation (Brochier 1991 ). Ces méthodes commencent à être utilisées pour les périodes plus récentes. Mais, dans le cas des sites de plein air, la conservation de ces marqueurs est souvent médiocre et peu de tentatives ont été faites pour les périodes historiques. Les bâtiments affectés à l'élevage restent très mal connus. Les grottes sont toujours utilisées. La contribution des analyses palée-écologiques hors site est essentielle, en particulier celles qui sont réalisées par palynologues : l'augmentation de la proportion de taxons nitrophiles, les Chenopodiaceae et le plantain (Plantago lanceo/ata) est en relation avec la présence des troupeaux. Une observation de ce type a été faite au sondage de La Calade en bordure de la pla ine d'Arles, où l'augmentation de ces taxons sert même à caractériser une des phases distinguées, le phase 2 : les taux deviennent plus é levés quand on approche la période antique et pour Je Moyen Âge. L'interprétation a été confirmée par la corrélation avec la présence continue d'insectes coprophages qui montre qu 'en bordure orien tale de la plaine, une zone humide a été fréquentée par les troupeaux de manière continue (Andrieu-Panel et al. 2000). On entrevoit ainsi la possibi lité d'une étude spatiale
23
permettant d'écrire dans la longue durée l'histoire de l'élevage du mouton dans la région d'Arles. Le site de La Calade n 'est pas éloigné du p lateau de Crau où a précisément été fa ite une découverte majeure, celle des bergeries antiques. Identifiés au début des années 1990, ces bâtiments sont maintenant assez bien connus grâce à des p rospections archéologiques, puis à des fouilles. De grande taille, ils sont allongés pointe vers le m istral (Négreiron-Négrès 6 : L. : 46, 30 m ; 1. 9, 55 rn, superficie : 280m2). Leur présence est surprenante : Strabon (Géographie, IV, 1, 7) et Pl ine (Hist. Nat., 21, 57) signalaient bien que les troupeaux f réquentaient la Crau depuis sans doute bien longtemps. Mais on ne s'attendait pas à ce que cet élevage s'accompagne de la construction de bergeries. Compte tenu de la taille de ces bergeries qu i pouvaient abriter 700 à 900 moutons et de leur nombre, évalué par extrapolation à 130 bergeries, le chiffre de 100 000 têtes a été proposé. Dans les cond itions climatiques actuelles, pendant la saison sèche, un tel nombre de moutons ne pourrait pas subsister si les troupeaux devaient se contenter des zones humides proches (plaine du Rhône, de Camargue ou des rives de l'Etang de Berre). Cet élevage aurait donc nécessité une pratique de la transhumance bien antérieure à celle que l'on connaît en Provence à la fin du Moyen Age (Badan et alii 1995). Elle remonterait à l'Antiquité. Le dossier pose un certain nombre de pro blèmes qui ont été soulignés par Ph. Colu meau. L'absence de dents de lait dans les niveaux d'occupation l'incite à placer l'occupation des bergeries après les mois de décembre/janvier. Compte tenu d'une me illeure répartition des pluies, les bergeries de Crau auraient eu "pour fonction principale d'héberger ces troupeaux de moutons de la fin de l'hiver au début de l'été" (Columeau 2000, 354-355). S'agissant de la question de la transhumance, il faut sans doute en rester à J'hypothèse minimale de P. Coste et N. Coulet : les moutons de la Crau romaine " estivaient dans les marais camarg uais, dans les Alpilles voisines ou dans Je Lubéron, qui est juste au-delà de la Durance " (Coste et Coulet 1994, 65). Ces découvertes ont par a illeurs nourri une discussion qui a pris des allures polémiques. En effet au même moment, s'interrogeant sur des particularités de l'architecture du site de Glanum à l'époque hellénistique et impériale, P. Gros proposait d'y reconnaître un ensemble caractéristique des sanctuaires-marchés liés à la transhumance. La perception de taxes à un passage obligé aurait été une des sources de la prospérité de la ville (Gros 1996). Cet article a suscité une vive réaction d'A. RothCongès qui a présenté une série d'objections d'ordre chronologique, géographique et technique tendant à réhabiliter l'hypothèse religieuse (Roth-Congès 1997). Ces objections sont de valeur inégale. L'objection chronologique en particulier est discutable car les recherches en Crau ont précisément montré que les bergeries dataient de l'époque romaine alors que les textes de Strabon et de Pline parlent en terme généraux d'une fréquentation des troupeaux bien p lus ancienne q ui intéresse sans doute des espèces qui n'ont pas besoin de bergeries . De plus, de nouvelles recherches archéologiques ont montré depuis que le site de Glanum avait une extension insoupçonnée et ne se réduisait pas à la zone monumentale mise en valeur (Agusta-Boularot et alii 1998).
En fait, il convient de développer des recherches sur les animaux élevés pour en connaître les caractéristiques (espèces élevées, la période de stabulation, ... ) et pour identifier les chemins utilisés par les troupeaux vers leurs zones de pâture. Là encore les travaux géoarchéologiques conduits dans la vallée du Rhône apportent des nouveautés : selon J.-F. Berger, dans certains secteurs soumis aux contraintes de l' inondation et dans les cuvettes du Tricastin et de la Valdaine, le drainage est abandonné dès la fin du Ile s .. Le paysage est alors marqué par une extension des prairies humides qui correspondraient à une exploitation pastorale extensive dont il appartient, bien entendu, aux archéologues d'établir la preuve (Berger à paraître).
Les situations différent d 'une région à l'autre. La Crau était pâturée par les troupeaux depuis le Néolithique, mais la période romaine y est caractérisée -nous l'avons vu- par des installations de stabulat ion dont on retrouve J'équivalent seulement à l'époque moderne. Cette différence s'explique bien évidemment par la nature de l'occupation romaine en Provence et la place qu'y occupe l'économie de marché, c'est-à-dire par un changement introdu it par Rome. Sur la mo ntagne pyrénéenne, l'écologie historique et l'archéologie pastorale (Rendu, Davasse et a li i 1997 ; Galop, 1998) permettent d'ébaucher une histoire de l'élevage du Néolithique à l'époq ue actuelle qui ne montre pas de coupure comparables. En Cata logne française, dans la montagne d'Enveig, des observations archéologiques portant sur des niveaux d'époque romaine prouvent une occupation pastorale en relation probable avec l'occupation agricole de la plaine ; il s'agirait d'estive p lutôt que de transhumance. Ainsi l'archéologie valide les hypothèses faites par les paléo-écologues sur l'h istoire de la forêt pyrénéenne ; l'ouverture
24
de la forêt qu' ils constatent sur les diagrammes polliniques est bien en relation avec l'occupation pastorale de la montagne. Dans la longue durée d'une fréquentation dont l'histoire commence au néolithique, la période romaine n'occupe aucune position particulière. Elle se situe dans Je prolongement de systèmes d'exploitation et d'utilisation de l'espace remontant à la fin de l'âge du Bronze et n'a qu'un faible impact sur la montagne (Galop 1998, 257; Riera i Mora 1994). Du côté français les études complémentaires sur les zones de plaine n'ont pas été conduites. Mais on peut s'appuyer sur l'étude de la plaine de Barcelone qu'a réalisée J.-M. Palet i Martinez. Durant la période qui nous intéresse ici, le développement de l'économie pastorale est caractérisé par la complémentarité entre les prairies humides deltaïques où les diagrammes polliniques attestent la présence des troupeaux (Riera-Mora 1995), et les pâturages de la chaîne de Collserola. Remplacent ceux de la centuriation romaine, de nouveaux axes routiers fonctionnent comme des drailles assurent la traversée de la plaine où ils (Palet 1997). Par ailleurs, la topographie est très différente : la montagne pyrénéenne domine directement les zones de plaine alors qu'un long parcours est nécessaire pour atteindre les zones d'estive depuis la Basse Provence.
Dans l'arrière-pays languedocien, plus à l'ouest, dans les Monts de l'Espinouse, les diagrammes de Font-Salesse et Baissescure enregistrent eux aussi entre les Ier et Vllle-Xe s. une diminution forte du taux de pollens arboréens sans toutefois que ce phénomène se traduise par une extension notable de la végétation méditenanéenne (de Beau! ieu 1969). Au contraire, dans une région où la céréaliculture et l'arboriculture (Castanea, Juglans) sont encore ponctuellement attestées, le démarrage continu de la courbe de plantain plaide pour une utilisation pastorale de ces zones. Or à partir des VJIIe-Xe s., la transhumance à moyen rayon d'action se développe sous l'égide des monastères bénédictins installés entre hauts plateaux et basse plaine (Durand, 1998). Il en est de même en Catalogne. En Italie padane, le développement de la transhumance à moyen rayon d'action démarre à peu près au même moment; il est accompagné d'indices d'arboriculture (Châtaignier essentiellement) (Menant, 1994).
Un certain nombre d 'études paléo-environnementales mettent en évidence la place l'élevage dans une polyculture paysanne. Dans les Pyrénées audoises, l'étude de la tourbière de Pinet en donne un bon exemple (cf supra). Selon les analyses anthracologiques, en Valdaine, le frêne, dont, comme J' orme, on connaît l'utilisation pour l'élevage, se développe probablement pour la constitution de haies. Mais ce ne sont pas les seuls. Sur Je plateau du Larzac, l'anthropologie atteste l'utilisation du buis pour l'élevage du bétail, particulièrement Je jeune bétail ovin (litière, nourriture ... ) à tel point qu'on peut parler de civ ilisation du buis. Durant la période carolingienne, les seuls sites connus sont situés sur les hauteurs, en limite septentrionale de la chênaie sempervirente. lis mettent en évidence des activités anthropiques. Un botaniste, M. Farizier, a étudié une macroflore travertineuse rapportée au XIe siècle par une date 14C ( 1 080± 50), où la présence de Corylus avellana indique une ouverture de la hêtraie durant la période précédant l'installation de la chartreuse en 1205 plus grande que maintenant (Farïzier 1980).
IV - L'ECONOMIE RURALE
1 -Le peuplement des campagnes L'image que l'on avait du peuplement des campagnes a été sensiblement modifiée par une
meilleure prise en compte des dynamiques du paysage. Celle-ci a permis de remettre en question de la notion de dépeuplement des zones basses et d'expliquer l'absence de sites archéologiques apparents par leur enfouissement. Les recherches développées sur la Vallée des Baux en constituent l'exemple le plus achevé (Leveau et Saquet 2000). Délimitée par la courbe de niveau des 20 m, cette dépression de 1 à 2 km de large qui sépare les Alpilles de la Crau a été intégrée au lit majeur du Rhône à la suite d'un processus amorcé sans doute durant le Moyen Age. De ce fait, elle constitue un excellent observatoire de l'histoire des phénomènes hydrologiques régionaux. Son fond se situe à peine audessus du niveau de la mer et el le serait occupée par un marais, si l'eau n'y était pas pompée en permanence. Transformée en polder continental à la suite d ' un siècle de travaux d'assèchement, elle est actuellement cultivée. On a longtemps pensé que le marais y existait " de tout temps ", en particulier à l'époque romaine (Benoit 1940, 68). Mais des études sédimentologiques puis la découverte d'un établissement (vi llage ?) remontant au Chalcolithique ont remis en question l' image
25
d'une inondation permanente de cette dépression (Leveau 1996 et 1997). Des dépôts correspondant aux différents fonctionnements hydraul iques de la Vallée ont été mis en relation avec la documentation écrite et les données archéologiques. On a pu démontrer que son horizontalité résu ltait d'apports sédimentaires colmatant une topographie diversifiée (Bruneton et al ii 1998 a). Ainsi, contrairement à ce que J'on écrivait depuis F. Benoit, l'occupation humaine ne s'était pas précocement repliée vers Je nord abandonnant le fond de la vallée devant la montée de l'eau : la vallée est restée occupée aux VIIe-VIIIe s. (Bellamy et Hitchner 1996).
a.- La situation à /afin de l'Antiquité Une tradition romanisante avait beaucoup insisté sur la fin du monde antique dont e lle
recherchait les origines dans la crise du Ille s .. Depuis une dizaine d'années, une révision générale conduit à renoncer à l'idée d'une rupture profonde dans l'habitat rural entre un haut Moyen Age méconnu et une période romaine bien mieux étudiée dans les régions méditerranéennes. Batailles et sièges affectent alors la vie économique et pèsent sur les conditions de production et les circuits économiques. Mais ceux-ci manifestent leur résistance. Les études archéologiques relativisent les processus de décl in observés et interdisent de présenter la fin de l'Antiquité comme une rupture brutale et un écroulement général des acquis de la romanisation. L'un des progrès majeurs de la recherche archéologique qui ont permis ce renouvellement est l'utilisation des méthodes quantitatives qui améliorent notre appréhension de la charge réelle des sociétés sur le paysage. Des prospections archéologiques menées systématiquement dans une perspective scientifique et patrimoniale permettent maintenant de dresser par secteur des cartes de répartition des sites et de construire des courbes montrant l'apparition, le développement, le maintien ou la décadence des différentes formes de l'habitat, " habitat paysan" ou villa latifundiaire (Durand-Dastès et alii 1998, 74-114). Sur ces courbes, apparaissent des spécificités micro-régionales. Des régions à fort peuplement romain s'opposent globalement à d'autres où prédomine une économie paysanne de tradition protohistorique et indigène. Les courbes de densités brutes des sites au kilomètre can·é qui ont été réalisées montrent des évolutions globalement parallèles." Au IVe siècle, les densités s'étagent de 0, Il à 0,92 sites/k.m2, pour une moyenne de 0,25 sites/km2. AuVe siècle, de 0,14 à 2,08 sites/km2 soit une moyenne de 0,60 sites/km2. Ces valeurs sont à comparer à celles du Ier s. qui se situent entre 0,59 et 2,28 siteslkm2 soit une moyenne de 1,15 sites/km2 (Trément et alii, à paraître). Il y a donc bien une diminution dans l'occupation du sol qui se marq ue en pru1iculier par la dispar ition d'un nombre important de villae romaines, grandes villae à l'architecture souvent ostentatoire ou villae moyennes ou petites qui assuraient le maillage du territoire. La diminution est très souvent qualitative. En Provence, où une recherche a été faite, les sites de villae sont bien occupés aux IVe et Ve s .. Mais seul un petit nombre jouit alors du statut de villae (Carru et a lii, à paraître). Les autres ne sont pas nécessairement abandonnées, mais la nature de leur occupation a changé. Dans la partie occupée des bâtiments, ce qui en demeure traduit une chute dans le n iveau de vie. En fait, la situation est proche de celle qui a été décrite par P. Van Ossel pour la Gaule du Nord et justifie l'extension de ses observations à l'ensemble du territoire de l'ancienne Gaule (Van Osse! 1997). En Gaule du Nord, l'évolution s'accompagne de l'apparition d'un habitat différent dans son organisation et ses plans. En 1980, J. Chapelet et R. Fossier pensaient que des constructions comportant une partie excavée et une partie en é lévation avaient été diffusées par les migrations germaniques à partir du monde slave et germanique où elles étaient connues (Chapelot et Fossier 1980, 131 -132). Depuis, on en a fouillé dans le Midi, en Languedoc (Ginouvez 1993 ; Garnier et al ii l 995) et en Provence (Bertucchi ; Berato in Bertoncello 1999, 291 ). De la sorte, on se demande si la nouveauté porte sur l'utilisation de ce mode de construction ou sur sa découverte ! La différence est importante : dans un cas, il s'agirait bien d'une innovation et elle pourrait correspondre à un peuplement germanique (Mercier et Raynaud 1995, 202) ; dans l'autre, la fouille attesterait seulement un usage.
Un fait semble acquis : en Gaule Narbonnaise, le phénomène de la villa palatia le n'a pas connu un développement équivalent à celui qui fut le sien en Aquitaine et en Gaule du nord-est ou l'Espagne au IVe s .. La seule villa connue qui puisse soutenir la comparaison reste une villa maritima connue depuis longtemps, la villa des Beaumelles à Saint-Cyr-Les-Lecques à l'ouest de Toulon (Brun 1999, 639-652). La présence des élites urbaines est cependant bien attestée dans les campagnes. P. A. Février en avait apporté la preuve à partir des listes épigraphiques (Février 1981) que l' archéologie
26
permet de compléter. La villa la mieux connue est désonnais celle des Près-Bas à Loupian auquel Ch. Pellecuer consacre une monographie qui en restitue l'histoire depuis sa construction au haut Empire jusqu'à son abandon définitif au VIle s .. L'évol ution du site est restituée avec précision sur le demi millénaire précédant la réalisation du projet architectural auquel sont liées les riches mosaïques polychromes qui en ont fait la célébrité. Intervenue au début du Ve s., elle entraîne une modification profonde de la topographie initiale sans toutefois s'inscrire en rupture avec les états antérieurs. La partie résidentielle double de surface. Alors qu'autrefois ailes d'habitation et cours étaient disposées selon la topographie d'un versant entaillé par des vallons, une vaste plate-forme est créée. Les bâtiments s'organisent autour d'un vaste péristyle (40 m sur 26 m en incluant les portiques). Les données de fouille (céramiques, monnaies) combinées aux arguments stylistiques conduisent à placer ce programme autour des années 400, ce qui s'accorde à peu près avec la proposition de H. Lavagne qui pensait au premier quart du Ve s .. La fouille n'a pas permis de reconnaître les bâtiments de productions qui -comme les thermes de cette époque- se situeraient hors de 1 'emprise de la villa, à proche ou lointaine distance. La dernière période d'occupation du site reste mal connue.
En définitive, dans sa nature, la situation n'évolue pas de manière différente de celle qui a été observée sur d'autres sites de villae de Narbonnaise ayant fait l'objet de fouilles comme Saint-Julienles-Martigues (Rivet 1996). Mais ce qui diffère, c'est la chronologie. Aux Près-Bas, on dispose en effet de témoignages de la permanence de l'occupation résidentielle du bâtiment pendant une longue période ; les mosaïques présentent des traces d'une utilisation continue des pièces. Comme en Gaule du Nord, où une évolution de ce type a été reconnue par P. Van Osse! (Van Osse! 1992, 178), les fonctions utilitaires et agricoles reprennent leur place dans certains secteurs du bâtiment où elles remplacent les utilisations résidentielles. Dans le courant du VIe s. la cour semble avoir été colonisée par une cabane. Le jardin de la résidence n'est plus entretenu. De nouvelles constructions s'y installent, en particulier des cabanes excavées évoquant celle qui a été découverte à Dassargues (Garnier et a lii, 1995, 36 et fig. 35). Ainsi Ch. Pellecuer peut-il apporter Je témoignage le plus élaboré d'une évolution observée ailleurs, en particulier à Saint-André-de-Codols sur un site de villae qui a fait l'objet d'une grande opération d'archéologie préventive (Provost et alii 2000). Dans le Midi, la véritable coupure dans l'occupation du sol est à rechercher dans le courant du VIle s ..
b.- Le devenir carolingien Dominée par l'histoire du fait castrai, l'historiographie médiévale des années 1980-1990
proposait une vision univoque du tissu humain antérieur à l 'an Mil: dal1S Je schéma le plus classique hérité du cas italien, les paysans, jusque-là dispersés dans des habitats sommaires, se rassemblaient sous la contrainte seigneuriale à partir de 950, au sein d'habitats fortifiés créées de toutes pièces afin de bénéficier de la protection bienveillante et intéressée du maître. La naissance du village correspondait à une volonté de rassembler les populations pour mieux les contrôler. En Languedoc, M. Bourin a très tôt souligné que ce scénario comportait quelques aménagements : elle décrivait J'habitat carolingien comme ouvert et dispersé mais non de manière absolue, c'est-à-dire comportant des hameaux en forme de nébuleuses et plus rarement en noyaux serrés. Au sein de cette structure très lâche, les noyaux des anciens vici gallo-romains et ceux des cités subsistent. De même, dans la formation de la trame castra le, la part de 1 ' héritage ancien, antique ou carolingien, était à prendre en considération, même si le remodelage de l'habitat était largement enclenché.
Les recherches archéologiques sont venues nuancer, compléter, voire contredire la trame générale en montrant que la maturation villageoise était un phénomène complexe. À Lunel-Viel,l'exemple archéologique le plus ancien et le plus achevé-, les fouilles de C. Raynaud ont montré les hésitations et les fluctuations de l'habitat entre les VIle et XIe s., mettant ainsi l'accent sur le problème des faibles discontinuités du tissu bâti alors que l'occupation du site est ininterrompue depuis l'époque romaine. La structuration de ce village est longue, lente, organisée autour de l' aire ecclésiale (Raynaud et al. 1990). En Vaunage et dans le canton de Mauguio, A. Parodi, C. Raynaud et C. Mercier ont démontré l'existence de noyaux d 'habitats groupés antérieurs à l'an Mi l, certes modestes, mais qui survivent jusqu 'au seuil de l'an Mil pour mourir avec la castralisation de la société. Une relecture plus attentive des actes carolingiens entérine cette vision des choses : la locution in ipsa villa, succédant, dans la même phrase ou au début de la suivante, à in villa de, montre que le mot villa désigne à la fois une étendue de territoire cultivé par un groupe de paysans et un lieu
27
précis, à l'intérieur de cette étendue, dans lequel a commencé à se rassembler l'habitat (Bourin et Durand 1994 ). L'emploi de descripteurs topographiques comme super ou subtus matérialise dans Je paysage cette polarisation de l'espace par la prise en compte de l'une de ses composantes, la dénivellation. Par ailleurs, un nombre important de castra de l'an Mil est conçu initialement comme les héritiers d'une villa matricielle dont ils gardent la toponymie romane en -an ou -argues. L'emploi simultané des deux termes, villa et castrum, sous le même toponyme, dans le même document, révèle la dualité de l'habitat et la bipolarisation de l'espace, in ipsa villa d'une part, autour du castrum d'autre part.
L' importance du legs antique des IHe-Vle s . dans la formation de la maille carolingienne de l ' habitat est donc aujourd' hui bien établie par des sources croisées. Mais cette permanence des sites d 'habitat groupé ouvert ou même fermé (Raynaud) n'est pas synonyme d'immobilisme: sans a ller j usqu'à parler d' itinérance, il faut souligner que l'ancrage médiéval du bâti n'est pas encore définitivement acquis : la polarisation de l'espace rura l carolingien est l'amorce d'un long processus de bourgeonnement de l'habitat dont le point d 'orgue est la naissance du village au XIe s .. Ces continuités ou faibles discontinuités n 'excluent pas les créations comme, en Camargue, Augery-deCorrèges (IX-XIe s.) qui pourrait être un village de colonisation de zones de marais ou de sansouires. Telle est du moins l'une des interprétations avancées, Ces formes groupées sont encore très lâches : les groupes de bâtiments d'habitation d' Augery sont organisés autour d'espaces clos interprétés comme des cours et des jardins potagers et ils fo rment le centre du noyau bâti. À Dassargues aussi, le regroupement est ouvert, souple et articulé autour d'un terroir. Il semble bien que l ' architecture de ces premières formes d'organisation villageo ise soit très fruste, très rustique et corresponde à ce que J.-M. Pesez appelait l"'infraconstruction ".
Les données archéologiques sont également venues pondérer le poids de la fortification laïque dans la genèse du village: en Catalogne d'abord, puis dans le Languedoc audois et plus récemment héraultais et gardois, historiens et archéologues se sont attachés à décrire et périodiser 1 "' ensagrerament ", c'est-à-dire le rassemblement spontané des populations autour du cercle de paix des églises matérialisé par un rayon de 30 pas autour de l'édifice cultuel afin de se protéger des violences et des exactions croissantes des milites lors de la mise en place de l'encellulement des hommes et de la seigneurie banale (Baudreu, Cazes, 1994, Catafau 1997). Les diplômes carolingiens des abbayes d'Aniane et de Gellone font également état de rassemblements fermés des populations autour du lieu de culte. Aussi, le rôle de J'église et du cimetière dans la polarisation de J'espace rural carolingien a-t-il été largement réhabil ité durant ces dix dernières années: l'activité scientifique méridionale est aujourd'hui centrée sur cette thématique.
Le château à motte a longtemps été considéré comme caractéristique de la moitié septentrionale de l'Europe. Soutenue par des programmes nationaux d'inventaires de fortifications de terre, la recherche a montré que Je phénomène était également présent en Provence et en Languedoc : G. Castelv i en Roussillon, M. Dauzat en Lauragais, M. Fixot et O. Mouton en Provence, P.-Y Laffont en Vivarais, ont recensé un nombre non négligeable de mottes. Si certaines fortifications utilisent et retaillent un relief naturel, d 'autres correspondent bien à la définition la plus stricte du phénomène. Chronologiquement, celui-ci démarre dès le Xe s. pour se terminer au tournant du XIIIe s .. P01tant un habitat généralement de bois, entourées d ' installations de stockage, notamment de nombreux silos à grains, ces mottes participent à la reconnaissance de l'architecture de terre et de bois. En effet, si 1. Chapelet et R. Fessier demeuraient re lativement prudents en 1980 en écrivant pour la France et l ' Italie que" faute de fouilles nombreuses, il était d iffici le de connaître l'ancienneté de cette tradition de constnrction rurale de pierre, spécialement dans la zone méditetTanéenne ", ils soulignaient cependant immédiatement que l'analyse des textes antérieurs au XIIe s. entérinaient plus fréquemment la maison de pierre que la maison de bois et terminaient en montrant combien la maison de pierre était liée aux zones calcaires méridionales de l'Europe. Depuis une bonne dizaine d 'année, l'archéologie est venu contredire cette chronologie: durant le haut Moyen Age comme postérieurement, la maison médiévale de terre, de bois, de pisé ou de torchis, existe aussi dans Je Midi, et pas seulement en Camargue.
2 - Les grands aménagements
28
Deux objectifs ont détem1iné la mise en place des limites parcellaires et des réseaux viaires et hydrauliques qui donnent au paysage une ossature dont la permanence a été soulignée. D'ordre économique, le premier est la mise en culture et le désenclavement régional. Le second est la fiscalité dont le cadastre constitue l'assise. A priori, aucun de ces deux objectifs n'est évidemment particul ier à une époque. Mais il est certain que l'époque romaine accorde une importance particulière au système de la centuriation dont la mise en place et le devenir occupent une place essentielle dans les préoccupations des chercheurs.
a.- Les parcellaires orthonormés et radioconcentriques La conquête romaine s'était traduite par une vaste restructuration agraire intéressant la
majeure partie des plaines de Provence et du Languedoc et la vallée du Rhône. Dans ses linéaments, le paysage de la fin de l'Antiquité reste profondément marqué par son héritage. La publication par A. Piganiol des marbres romains d'Orange qui donnent le plan de trois centuriations dans la vallée du Rhône, puis les recherches de M. Clavel-Lévêque sur Béziers et d'une manière plus générale les remarquables travaux des archéomorphologues de Besançon ont permis de prendre la mesure de l'imp01tance des superficies concernées. Les Romains ne sont évidemment pas les seuls à avoir eu recours à la division géométrique du territoire pour lotir. Mais, dans le sud de la France, ils sont les seuls à avoir conçu et mis en pratique de telles entreprises sur des centaines de km2
• La découverte des centuriations fossiles a donc été unanimement saluée par les historiens comme un fait majeur. Deux millénaires plus tard les traces de cette orgrulisation continuent à marquer le paysage, sans doute à un degré moindre qu'en Afrique ou en Italie en Campanie ou dans la plaine du Pô, mais de manière assez nette pour qu'elle soit repérable sur les clichés photographiques verticaux et sur les cartes topographiques.
Actuellement, on assiste à un approfondissement des acquis de la recherche. Dans la vallée du Rhône, les travaux sur les cadastres d'Orange se poursuivent. Les trois cadastres affichés sont maintenant localisés de manière à peu près certaine. Les localisations de deux d'entre eux étaient établies avec certitude : le "Cadastre B" depuis sa publication par A. Piganiol (Piganiol 1962), le cadastre A depuis les travaux G. Chouquer en 1981 (Chouquer 1981); tout récemment le cadastre C vient de faire l'objet de propositions convaincantes qui valident une proposition de A. Piganiol (Christol et al ii, 1 998). En Languedoc, les recherches sur les cadastres de Béziers viennent d'aboutir à la publication d'un Atlas (Clavel-Lévêque 1995). D'une manière générale, les résultats obtenus ont permis de prendre la mesure de la complexité des phénomènes de superposition et d'imbrication des centuriations dont faisaient état les textes des Gromatici. Ainsi dans le Languedoc, sur les territoires des colonies romaines mais aussi ceux de colonies de droit latin comme Nîmes, des recherches poussées ont permis d'isoler des centuriations successives dans la trame paysagère. Impressionné par la réussite spectaculaire des travaux des antiquisants, G. Duby présentait la centuriation comme un " immense filet aux mailles fines que Rome jeta sur la paysannerie des Gaules " (Duby 1975, 30).
Mais des dérives sont apparues et de telles images ont justifié une méthode simpliste consistant à promener des grilles sur les cartes et débouchant sur la multiplication de découvertes de parcellaires géométriques attribués systématiquement à la colonisation romaine, tandis que Jes parcellaires radiocentriques étaient considérés comme médiévaux. Cette démarche résulte d'un contresens consistant à attribuer à la forme du parcellaire une valeur chronologique. Procédé de lotissement commode, l'orthogonalité est en effet à la base de tout aménagement de l'espace sur une grande échelle par un pouvoir fort. Au contraire, des collectivités rurales construiront un terroir dont le caractère circulaire s'explique par la polarisation des champs vers le point central que constitue un village ou un établissement agricole. Dans une période d'émiettement des pouvoirs, la commodité d'accès aux champs favorise une telle organisation parcellaire. A priori, on ne peut pas exclure la possibilité pour un pouvoir de lotir selon le mode circulaire : son utilisation est attestée dans l'histoire de l'urbanisme européen (Fabre et alii 1996). Mais des formes radiocentriques ont pu tout aussi bien exister à l'époque romaine dans des secteurs dont le système foncier a été respecté, tandis que l'orthogonalité a été uti lisée à l'époque préromaine dans ces régions par les colons phocéens et, à l'époque médiévale, dans des teiTitoires de colonisation. Structures orthogonales et structures polarisées renvoient donc d'abord à des formations sociales -qui ont pu coexister- ; en second lieu seulement, ce phénomène être interprété en termes chronologiques. La formation sociale compte tout
29
autant que la période chronologique. Mais il reste que des formes paysagères non orthogonales sont plutôt caractéristiques des périodes protohistorique et médiévale, alors qu'un traitement orthogonal des surfaces est un" événement " caractéristique de la prise du contrôle de la Gaule du Sud par Rome.
Comme toute "crise", celle-ci qui affecte la recherche archéo-morphologique, n'a pas que des effets négatifs. Un intérêt croissant est porté à l'étude de la dégradation de la trame géométrique liée à cinq siècles d'utilisation des chemins et de gestion des sols et à celle des relations que les systèmes parcellaires entretiennent avec le paysage naturel. La complexité des faits apparaît de plus en plus évidente. Des chercheurs ont recherché une validation de terrain par la fouille des champs et la mise au jour des traces de labours, des fossés et des limites de centuriations. Les conditions d'enfouissement ("taphonomie") des limites agraires ou de leur destruction par l'érosion font l'objet de recherches précises en collaboration avec les environnementalistes. Ces derniers ont permis d'intégrer aux opérations archéologiques la variable physique liée aux recouvrements sédimentaires susceptibles de masquer les structures archéo logiques. Des protocoles de recherche mis au point sur de grands chantiers, comme celui de l'aéroport régional de Lorraine, ont été appliqués sur certains secteurs du chantier du T.G.V. Méditerranée, dans la vallée du Rhône, sur l'espace structuré par le cadastre B, le mieux documenté des cadastres d'Orange. L'intégration par croisement des trois composantes de cette recherche, -les données archéologiques re latives à l'occupation du sol, l'archéomorphologie et la géoarchéologie-, apporte des réponses aux objections faites à la méthode (Chouquer et Favory 1999). L'étude géoarchéologique a été d'un apport décisif pour établir les phases de fonctionnement des réseaux de drainage et les comparer aux résultats des différentes études paléoécologiques, géomorphologiques et pédologiques. La connaissance des grilles théoriques de la centuriation a permis d'appréhender la diversité de "leur matérialisation initiale (fossés, drains enterrés, voies, haies.), et par la suite d'entrevoir leur rôle et leur fonction (drainage, irrigation, viabilité ou protection du vent)" (Berger 1999). Dans la plaine du Tricastin, au lieu-dit les Malalones, sur la commune de Pierrelatte, J.-Berger etC. Jung ont suivi l'histoire d'un fossé du cadastre B d'Orange. Régulièrement curé, puis recreusé au Moyen Age il a finalement été oblitéré par des recouvrements. Mais, de manière étonnante, la limite qu'il marquait est perpétuée par une haie (Berger et Jung 1996, 100 fig. 5). Cet exemple valide les procédures archéologiques de recherches mais démontre tout autant le rôle déterminant joué par la mémoire dans la conservation des limites parcellaires : dans ses linéaments, le paysage moderne hérite des formes anciennes. Elles permettent de démêler l'écheveau d'orientations complexes dans des zones pour lesquelles on ne dispose pas de sources écrites. La centuriation avait intéressé J'ensemble de la plaine du Rhône au sud de la colonie romaine d'Orange. La plaine d'Arles a fait aussi l'objet d'une centuriation qui n'est encore connue que par les orientations qu'elle a imprimées au parcellaire. Le cadastre d'Orange s'arrête en effet aux Alpilles, une dizaine de kilomètres au nord du lieu d'implantation de la ville. Pour l'heure, aucun réseau de chemins et de fossés comparable à celui que l'on connaît dans la plaine d'Orange n'a été identifié ni par l'observation aérienne ni par les fouilles.
Actuellement, Je meilleur exemple est situé dans la région de Lunel-Dassargues en rive droite du Vidourle, entre Camargue et Garrigues nîmoises, où les orientations structurant le secteur fouillé sont probablement en rapport avec trois centuriations du territoire de Nîmes mises anciennement en évidence dans des travaux de morphologie agraire (Favory 1996). Le système de fossés qui matérialise ces divisions du territoire a fonctionné au plus tard jusqu'à la fin du IVe s .. Malgré leur comblement, les orientations que matérialisaient les fossés jusqu'au VIle s. continuent à structurer le paysage : des haies et des clôtures de bois ont pris leur suite. Dans ce contexte, se sont installés une ferme et un petit cimetière regroupant quelq ues tombes. L'archéologie livre peu de documents pour la période carolingienne bien qu'un texte du VIlle prouve l'existence d'une église et de maisons (Garnier et ali i, 1995).
En définitive, les travaux récents confirment l'hypothèse formu lée il y a une vingtaine d'années par J. Chapelet et R. Fossier :"Dans le sud de la France, le maintien du parcellaire romain, du moins dans des zones importantes, s'explique sans doute par une mise en valeur du terroir trop matérialisée antérieurement sur le tenain pour que l'exploitation agricole du haut Moyen Age la remette en cause " (Chapelot et Fossier, 1980, 70). Le progrès dans les techniques archéologiques pennet à la recherche actuell.e sur le monde rural durant le Haut Moyen Age de réviser l'image de campagnes dépeuplées qui dominait autrefois. L'image d'une déprise générale est à rejeter. Mais cela
30
ne signifiait pas pour autant le maintien de l'exploitation de secteurs dont la mise en culture nécessitait une gestion rigoureuse et des moyens importants.
b.- L'hydraulique agricole Les travaux de S. Caucanas sur les moulins et l' irrigation en Roussillon du IXe au XIVe s.
constituent la mise au point synthétique la plus récente sur la question des aménagements hydrauliques dans le sud de la France. Les origines en sont obscures : l'historiographie hésite entre une origine romaine, wisigothique ou arabe (Caucanas 1995, 20). Mais en l'absence de documentation archéologique ou historique précise et explicite sur les moulins et systèmes d'irrigation, il est impossible de trancher. L'étude des premiers textes précis échelonnés entre les IXe et XIe s. l'amène à souligner la relation entre aménagements hydrauliques et construction de moulins ; il s'agirait d'une situation relativement courante. La petite irrigation pour des jardins a été pratiquée depuis l'origine de l'agriculture par les sociétés agricoles, quel que soit leur niveau technique; il n'y a pas de raison qu'elle ait cessé de 1 'être. En revanche, une véritable nouveauté intervient au début du XIe s. avec la construction de canaux qui " ne sont plus désormais considérés comme un moyen profitable certes, mais accessoire, d'améliorer les revenus d'un domaine : bien au contraire, ils sont regardés comme l'élément essentiel, voire primordial et fondamental de la mise en valeur d'un terroir " (Caucanas 1995, 27). Devant la situation enregistrée par la documentation des décennies précédant 1 'an Mil, S. Caucanas conclut que " tout porte à croire que les installations de ce type fonctionnaient déjà au cours des siècles précédents ". Il n'y a pas lieu de s'en étonner : de tels aménagements sont connus dans la péninsule Ibérique à partir de l'époque romaine (Gorges et German Rodriguez Mrut in 1999).
Le Languedoc voisin offre une vision identique: dès le début du IXe s., l'existence de véritables complexes hydrauliques est liée à la maîtrise de l'irrigation : avant l'an Mil, environ 30% des moulins sont équipés de systèmes destinés à l'arrosage des terres ; pour les débuts de la mécanisation des campagnes, ce pourcentage est fort et éloquent (Durand sous presse). Par ailleurs, dans la basse plaine, surtout, dans les zones de sansouires ou de marais, un certain nombre de parcelles sont cédées vallo in medio, mais sans qu'il soit possible de discerner s'i l s'agit de système de drainage ou d'irrigation ou des deux réunis. L'archéologie de terrain confirme la vision de l'histoire des aménagements hydrauliques offe1te par les textes. À Augery-de-Corrège, les roubines fourmillent sur tout le site de l ' habitat carolingien. L'analyse malacologique effectuée par J. André sur un certain nombre de structures en creux avait pour but d'en différencier l'origine, la fonction et la durée d'utilisation : structures drainantes, fondations, voies de circulation. Ainsi aux côtés de fossés à sec, dont quelques-uns ont été rapidement comblés, elle a reconnu des fossés drainant sans circulation, en eau stagnante et périodiquement inondés. Les résultats anthracologiques qui font état de formations halophiles ou hygrophyles à Monocotylédones ne contredisent pas ces données (Kotarba et al, 1987). Les recherches dirigées par C. Raynaud sur le territoire de Dassargues ont aussi montré l'existence de fossés d'irrigation et de drainage associés à des traces de clôtures et de haies et à des sa ignées de plantation ; elles permettent de restituer quelques hectares du finage d'une fenne installée au début du VIe s. pow· un siècle au bord du Vidourle (André et alii 1997, 109-113). La petite irrigation existe donc bien dans le cadre de l'économie paysanne en Provence comme en Languedoc.
Dans cette dernière région, à la différence de ce que signale S. Caucanas pour la Catalogne française, il n'existe pas encore de preuve de grande irrigation durant le Moyen Age (Bourrin-Derruau et alii à paraître). J. Béthemont avait déjà noté que, comme dans le reste de la vallée du Rhône, celleci se développait en Basse Provence seulement à l'époque moderne, lorsqu'est construit le canal de Craponne (Béthemont 1972). Dans le Comtat Venaissin où la maîtrise des eaux a pris une importance particulière, un récent historien, P. Fournier, date de la fin du XVIe l'amorce d'un processus qui, au XIXe s., débouche sur la pratique de la grande irrigation (Fournier 1999, 24-25). Pour le Moyen Age en effet, P. Fournier reconnaît une "accélération" et refuse le terme" rupture". La documentation qu'il a maniée donne l'impression d'une amélioration constante des procédures de contrôle des eaux. Les travaux archéologiques app01tent de nouvelles données à ce sujet. Pour l'époque romaine, la grande irrigation, c'est-à-dire la construction d'installations permettant de recueillir, de conserver et de répartir l'eau pour les cultures à l'échelle d'une vallée ou d'une plaine, n'était connue que dans les régions plus sèches de l'Empire et peut-être en Italie (Qu ilici-Gigli 1989; Thomas et Wilson 1994). J.-
31
F. Berger et C . Jung ont proposé d'identifier un réseau d'irrigation d'époque romaine aux Bartras sur la commune de Bollène, en Tricastin, à partir de l'étude du remplissage sableux caractéristique des fossés (Berger et Jung 1996, 103-1 05) . Ils ont en effet établi pour l'époque romaine l'existence d'une grande irrigation. Celle-ci d isparaît de la plupart des secteurs durant le Moyen Age. Cependant, les savoir hydrauliques ont été conservés car certains actes languedociens des XIe-XIIe s iècles mentionnent des fossatos antiquos apparemment en état de fonctionnement. Employé dans un contexte spécifique, l' adjectif antiquus renvoie plutôt à une construction maçonnée qu'à un simple fossé désigné par vallum. De ce fait, on pense à la période antique.
Les données éparses dont on dispose sur l'h isto ire des moulins vont dans le même sens. Dans les Pyrénées catalanes, V. Izard, fait remonter avec un faisceau d 'arguments tout à fait convergents, 1 'emploi de la roue hydraulique pour la métallurgie du fer de près de trois siècles, soit aux environs de l'an Mil (Izard 1999). Pour elle, c'est une véritable révolutio n technologique. Dans ces conditions, on imagine mal une disparition totale des techniques de l'hydraulique.
Le dossier concernant la construction de systèmes de vidanges plaide également en faveur d'une conservation de la maîtrise du drainage et de l'irrigation à grande échelle. Grâce à une opération hydraulique de ce type, les nombreuses dépressions fermées qui parsèment les plateaux calcaires de la France du Sud, en Languedoc comme en Provence, ont été mises en cultures comme 1 ' atteste la photographie aérienne : des anomalies parcellaires perpétuent la forme de ces cuvettes endoréiques maintenant drainées pour la plupart. Inscrits dans la continuité des recherches qu'il a menées sur les étangs du Languedoc oriental et sur le colmatage de la lagune de Narbonne, les travaux récents dirigés par P. Ambert dans vallée de l'Aude ouvrent d'importantes perspectives sur l'histoire des terroirs aux époq ues antiques et médiévales. Entre Carcassonne et Narbonne, la basse vallée a fa it l'objet d'une série de carottages sous l'impulsion du Centre d'Anthropologie de l'Ecole des Hautes Etudes à Toulouse et de J. Gui laine. P. Ambert s'est attaché à réun ir une équipe de paléoenvironnementalistes qui ont porté leur attention sur une série de dépressions fermées, isolées du réseau fluviatile régional, naturellement marécageuses et donc susceptible de constituer de bon observatoire de l'évolution des environnements. Certaines ont fait l'objet d'aménagements durant les périodes historiques pendant lesquelles elles ont été drainées par des tunnels ou des canaux creusés dans le substratum (Ambert 1995, 22l ). Les possibilités d'observations offertes par ces cuvettes ont été relevées depu is lo ngtemps. Elles ont conservé des vestiges d'aménagements, en particul ière des tranchées ou de tunnels de vidange qu i sont attribués de manière approximative aux Roma ins ou à des défricheurs médiévaux. À des époques où les techniques de l'exploitation minière sont maîtrisées, ces travaux ne sont pas d'une grande d ifficulté technique.
P. Poupet a consacré une étude suggestive à un intéressant exemple identifié à Suze-la-Rousse dans le Tricastin. Un ouvrage souterrain qui assure actuellement la vidange d'une dépression située sur le ten-itoire de cette commune de la Drôme prend la su ite de travaux de drainage attestés bien avant le XVIIe s. ; mais chaque fo is le marais revenait. Les premières interventions connues par les textes commencent au XIe. Or la dépression appattient à une zone cultivée dans l'Antiquité et intégrée dans la zone cadastrée autour d'Orange (Poupet 1994). Cette approche constitue un des intérêts de l'étude menée par F. Trément sur la zone des petites dépressions qui s'étend autour du site antique de Saint-Blaise. Sur ce secteur, il dispose d'une documentation h istorique et archéologique importante pennettant de mettre les fl uctuations des p lat1S d'eaux en re latio n avec les rythmes de l'occupation des sols et avec de grands travaux de drainage remontant vraisemblablement à l'époque romaine (Trément 1999). D'autres études sont en cours, en part iculier sur deux dépressions que traverse la ligne nouvelle du T.G.V., cel les de Tras-le-Puy (Arthuis et Ambert 1997) et de Pujau où l'on connaît un tunnel de v idange.
Traditionnellement, on a considéré que ces drainages étaient l'œuvre de personnages puissants o u de collectiv ités ecclésiastiques disposant de moyens fi nanciers et d'appuis politiques importants, désireux de gagner des terres de labour ou des prés de fauche sur des sols aux potentialités fortes. C'est sans doute le cas des plus importants d'entre eux. Au Xlile siècle, le drainage de la dépression de Montady près d'Ensérune est effectivement présenté comme le témoignage du dynamisme retrouvé d ' une association de bourgeois citadins (Bourin 1987, 2, 16). Mais, sans doute, la recherche a-t-e lle été trop influencée par des exemples extrêmes dont le plus célèbre est le drain age du lac Fucin, qui mobilisa les moyens matériel des empereurs de Rome puis, au Moyen Age, ceux de leurs successeurs
32
germaniques, pour son mamt1en et sa rem ise en état. Une attention insuffisante a été prêtée aux travaux de petite hydraulique. Cela fait l' intérêt d'une brève note consacrée par N. Coulet au drainage d'une petite dépression de Basse Provence orientale par un simple menuisier ! (Coulet 1993). En définitive, la remarque faite par S. Caucanas à propos de l'irrigation peut être généralisée aux drainages : l'initiative de la construction de ces équipements hydraul iques revient " aux propriétaires des domaines fonciers, tout aussi bien aux petits alleutiers qu'aux riches maîtres du sol " (Caucanas 1995, 31 ). Dans cette perspective, l'étude de ces aménagements, petits et grands, de leur fonctionnement et de leur entretien est une des voies à explorer pour évaluer la volonté et les capacités des sociétés à ma1tri ser l'environnement.
c. - L'aménagement des pentes Le même type de question se pose pour des terrasses de culture utilisées dans l'aménagement
des pentes. À une époque de grande pression démographique, ces aménagements étendent les surfaces agricoles en zone abrupte et maintiennent une humidité relative. De ce fa it, elles stabilisent les versants et participent à la lutte contre l'érosion. Dans la majorité des cas, sans entretien, les teJTasses ne durent pas très longtemps, quelques dizaines d'années, sauf si elles ont été enfouies en bas de versant. De ce fa it, en réaction contre des espérances nourries dans les années 1970, l'existence de ce type d'aménagement et la possibilité de le mettre au jour par des foui11es archéologiques ont suscité des réactions négatives de la part de nombreux archéologues dans le sud de la Gaule. Les méthodes phytogéographiques ne se sont pas non plus révélées probantes pour appréhender l'histoire des bancels et lunettes. En Gaule du Sud la technique de construction des terrasses était déjà maîtrisée par les populations de l'âge du Fer qui édifiaient des remparts. La question a été reprise par P. Poupet qui, s'élevant contre l'opinion dominante, a pu établir de manière convaincante l'existence de tels aménagements de versant à l'époque protohistorique à l' emplacement du qua1tier antique des Bénédictins à Nîmes. Nous retiendrons sa conclusion : << La pente du mont Cavalier, sur le site des Villégiales, a donc été cultivée selon des champs étagés en un système de terrasses, entre le IVe et le début ou le milieu du Ile s. av. n.è. » (Poupet 2000, 37). Pour l'époque romaine, aucune étude comparable n'a encore été publ iée ni sans doute encore envisagée, bien qu'elle soit à la portée des équipes archéologiques actuelles. Les questions d 'opportunité sont essentiel les. La majorité des opérations archéologiques susceptibles de prendre en considération de tels objectifs, ont porté sur des zones de plaine. Là où elle était poss ible, en pa1ticulier dans certains secteurs intéressés par la construction de la ligne du TGV Méditerranée, elle n'a pas été considérée comme prioritaire par les responsables de l'opération. C'est en particulier ce qui est advenu pour la section comprise entre la vallée de la Durance et le bassin d 'Aix qui traversait une zone où les archéologues et les géomorphologues a ixois venaient de conduire des études d'archéologie du paysage.
La question des terrasses s'imposait comme un enj eu archéologique majeur. Elle permettait d'aborder sur une base archéologique, pour la période protohistorique, la question de la densité d'occupation agricole indigène dans la périphérie du domaine marseillais et, pour la période romaine, celle d' un éventuel refoulement de ces populations vers les zones de hauteur et celle de Ja mise en valeur des versants dans les zones intégrées au système agricole romain (Leveau 1993, 34). Pour les géomorphologues, la question était celle de la place des facteurs anthropiques de l 'érosion durant les deux derniers millénaires (Jorda 1993).
Ces interrogations font l'intérêt des études conduites par F. Bertoncello et M. Gazenbeek dans Je massif des Maures sur le rocher de Rochebrune qui, à proximité de Fréjus, surplombe la vallée de l'Argens. Là, des cabanes et des murs de terrasses d'âge protohistorique avaient favorisé des accumulations de terres sur lesquelles à la fin de l'A ntiquité de nouveaux occupants se sont installés et qu'ils ont réutilisés. "Depuis l'abandon du s ite (à la fin du VIe s. ou au début du V(le s.), malgré leur effondrement partiel, ces structures continuent à retenir le sols sur les versants. " (Bertoncello et Gazenbeek, 1997, 619). Sur ce rocher, les prospections de F. Bertoncello et M. Gazenbeek ont permis d'étudier un petit village. Des prélèvements effectués ont été analysés par Bui Thi Mai dont l'étude palynologique montre qu'aux Ve et VIe s., l'anthropisation a cependant diminué par rapport à la période précédente.
Ph. Blanchemanche, auteur d'une remarquable étude sur la construction des paysages par les paysanneries de l'Europe aux Temps Modernes, avait attiré l'attention des archéologues sur l 'absence
33
des terrasses de culture dans la documentation écrite (Blanchemanche 1990). En fait pour la période antique, quelques textes en font mention (Poupet 2000, 38). Dans les sources écrites médiévales, la perception de ces terrasses n'est pas aisée. En l'absence de description dans les actes de la pratique, el le repose uniquement sur des indices indirects. Le premier et le plus sûr consiste à suivre la diffusion du terme« faïsse >> (faissa.jaxia, jascia) qui concrétise l'aménagement des déclivités dans Je paysage au fil des cartu laires. En Languedoc, les toutes premières mentions de « faïsses » datent du IXe s., mais l'apogée du phénomène se place à la fin du XIe s. consécutivement à la croissance démographique. Le mot même de faïsse englobe des architectures diverses et des systèmes de cultures différents. Il désigne aussi bien les gradins des pentes rocailleuses que les terrasses des versants de garrigues ou encore, et c'est même là son acception principale, les parcelles allongées et aménagées le long des lagunes et des cours d'eau. En effet, l'agriculture de pente ne concerne pas que les déclivités accusées de l' arrière-pays : elle se développe éga lement et surtout en milieu humide au bord des rivières, en prenant assise sur la morphologie des terrasses quaternaires sculptées en marches d'escalier. Le processus est bien cerné: à partir de l'an Mi l, la colonisation des rivages consécutive à la déforestation des formations riveraines, fait entrer dans l' ager des terroirs consacrés à la céréaliculture intensive qui font l'objet de drainage, de talutage, de plantation d'arbres, à l'aide parfois de procédés très pertinents comme l'engazonnement et l' écobuage. Mais si les actes donnent un coup de projecteur assez précis sur cet aspect des cultures en terrasses, ils demeurent muets sur les autres types d 'aménagement. Pourtant, à partir de la fin du Xe s., dans la description et dans la désignation des biens, les prépositions s ignifiant la dénivellation se font plus nombreuses et les parcelles situées sur ou jouxtant des puechs sont elles aussi plus fréquentes. Ce long et pénible travail d'épierrement et de transport de terre n'a pas laissé de trace écrite plus accusée: l'absence de contrats de mise en va leur ou de c hartes collectives suggère qu ' il s'agisse le plus souvent de constructions individuelles.
Conclusion : Le tableau que nous avons pu dresser des campagnes du Midi Méditerranéen durant la
seconde moitié du premier millénaire de notre ère nous semble démontrer le bien fondé d ' une approche intégrant les données paléo-écologiques. Au plan des données sur lesquelles s'appuie la réflexion historique, qu'il s'agisse de terroirs, de sites archéologiques, de produits agricoles, J'apport est évidemment considérable. Mais cette approche n 'a pas pour seul effet d'ajouter des données nouvelles et ponctuelles. Une histoire écologique implique une réintégration du « temps long», un peu passé de mode à la suite de la réhabilitation de l'événement. Celle-ci donne une place capitale aux notions d'usage et d'héritage. La notion de premier usage attesté permet en particulier d'éviter le piège de la sur-interprétation d'une découverte archéologique ou de son absence et de la sousévaluation d'une période chronologique. Les exemples de l' usage du moulin, du fer et des terrasses de culture en constituent de bonnes illustrations. Historiens et archéologues sont conduits à abandonner le schéma évolutionniste simple d'un progrès conduisant de la "protohistoire" à la "période romaine", des "temps barbares" au "Moyen Age classique". Rompant avec une image mythique de la romanité par rapp011 à laquelle la période médiévale s'inscrirait en rupture, ils insistent sur l'importance des héritages. Les recherches ont montré que, grâce au développement interne et aux influences venues de Méditerranée orienta le, les bases de l'économie agricole étaient acquises durant la protohistoire : plantes cultivées, animaux élevés, outils, techniques de culture, maîtrise des sols (drainage, irrigation, construction de terrasses). Elles demeurent durant le haut Moyen Age. La nouveauté principale apportée par Rome réside dans l'intégration de la région à l'économie commercia le de l'Empire. La crise politique et militaire qui en accompagne l'écroulement, a eu des conséquences désastreuses. Mais elle n'entraîne ni retour ni régression. Des acquis demeurent. Ils préparent largement l ' essor du haut Moyen Age, puis la grande expansion des siècles postérieurs à l'an Mil. La croissance agricole des VIlle-IXe siècles reposant sur une cro issance démographique conjuguée à des défrichement intenses doit beaucoup aux siècles précédents : le changement réside plus dans la massification que véritablement dans la diffusion de nouveautés.
L'analyse archéologique permet de se démarquer de généralisation nécessairement réductrices. À l'échelle micro-régiona le, deux économies agricoles coexistent, une économie paysanne poursuivant
34
la tradition protoh istorique, une économie organisée en fonction du profit (" capitalistique "). Pas plus qu'une autre région, la France du Sud ne constitue un ensemble homogène. Pour la période antique, le concept d'hétérogénéité spatiale permet d'intégrer l'opposition entre monde indigène et monde romain qui préoccupe beaucoup d 'archéologues. Dans l'histoire des environnements, on ne peut pas parler en termes généraux de l'impact de l'homme sur le milieu ; le concept d'anthropisation doit être utilisé à l'échelle de l'histoire des sociétés que l'on étudie (Leveau 1997). Il en va de même dans les sociétés. Ainsi, on distinguera les aspects administratifs, sociaux et économiques de la romanisation. En Gaule Narbonnaise, comme dans les autres provinces, durant la période romaine des formes économiques iiTéductibles se juxtaposent." Rome'' désigne en premier lieu une période chronologique; en second lieu, le terme qualifie une formation sociale qui d ispose de moyens d'intervention dont l'efficacité et l'impact sur le milieu sont sans commune mesure avec celui des sociétés protohistoriques. " Protohistoire " présente la même ambiguïté : le terme désigne d'abord une période chronologique et en second lieu un type d'économie ou une formation sociale, que l'on qualifie autrement ct><' indigène". L' intégration admin istrative d'une zone géographique dans la province romaine ne se traduit pas nécessairement par une utilisation des modes de gestion de l'espace que l'on rencontre dans les secteurs les plus développés -les territoires des fondations coloniales romaines par exemple. Le raisonnement s'applique aussi bien à l' époque carolingienne. Les historiens ont déjà souligné à plusieurs reprises le caractère hétérogène de la construction franque, notamment en Septimanie et Provence où se croisent les influences hispaniques, germaniques et gallo-romaines. L'un des grands mérites des Pippinides puis de Charlemagne et de ses successeurs est avoir tenté d ' unifier le royaume puis l'Empire franc, forme première de la future Europe. Sur le plan économique, la législation carolingienne via les capitulaires offre un modèle d'organisation, celui du grand domaine, qui n'a sans doute peut-être jamais été viable n i même appliqué si l 'on suit les auteurs les plus critiques. Ainsi le terme "carolingien" présente-t-il la même ambiguïté que '' Protohistoire" ou "Romanisation " : il n 'y a pas d 'économie carolingienne au sens strict du terme, mais la coexistence de formes différentes d 'organisation des espaces et de mise en valeur du sol. Les analyses bio-archéologiques démontrent que toute tentative de modélisation à ce sujet est illusoire et restitue les processus d'anthropisation des paysages dans toute leur complexité.
Pour finir, il faut critiquer le concept de transition appliqué à cette période. L 'archéologie des paysages et des terroirs montre combien cette notion primitive est inadaptée et non opérationnelle En effet, le vocabulaire historique n 'a pas de terme spécifique autre pour désigner l'arc de temps compris entre les lVe-Ve s. et l' époque carolingienne: cette situation, bâtarde, reflète parfaitement une historiographie qui aboutit à une impasse.