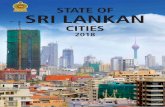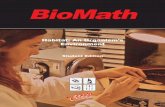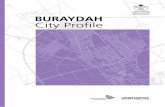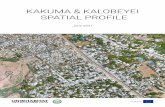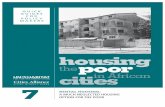H.-P. Francfort, «Habitat rural achéménide, hellénistique et kouchan dans la plaine d’Aï...
Transcript of H.-P. Francfort, «Habitat rural achéménide, hellénistique et kouchan dans la plaine d’Aï...
MÉMOIRES DE LA DÉLÉGATION ARCHÉOLOGIQUE FRANçAISE
EN AFGHANISTAN
TOME XXXIV
FOUILLES D’AÏ KHANOUMIX
L’HABITAT
GUY LECUYOT
Contributions de Paul BERNARD, Henri-Paul FRANCFORT,
Bertille LYONNET et Laurianne MARTINEZ SÈVE
Ouvrage publié avec le soutien de l’UMR 8546 AOROC - Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident (CNRS-ENS)
DIFFUSION DE BOCCARD11, rue de Médicis 75006 Paris
2013
AK IX.indb 3 03/06/13 11:19
© Délégation archéologique française en Afghanistan 2013
ISSN 0768-0473
ISBN ***************
Diff usion De Boccard : www.deboccard.com
Mémoires de la Délégation archéologique française en Afghanistan
Fouilles d’Aï Khanoum
volumes parus
P. Bernard, R. Desparmet, J.-Cl. Gardin, Ph. Gouin, A. de Lapparent, M. Le Berre, G. Le Rider, L. Robert et R. Stucky, Fouilles d’Aï Khanoum I (campagnes 1965, 1966, 1967, 1968), MDAFA XXI, Paris, 1973.
O. Guillaume, Fouilles d’Aï Khanoum II. Les propylées de la rue principale, MDAFA XXVI, Paris, 1983.
H.-P. Francfort, Fouilles d’Aï Khanoum III. Le sanctuaire du temple à niches indentées, 2. Les trouvailles, MDAFA XXVII, Paris, 1984.
P. Bernard, Fouilles d’Aï Khanoum IV. Les monnaies hors trésors. Questions d’histoire gréco-bactrienne, MDAFA XXVIII, Paris, 1985.
P. Leriche, Fouilles d’Aï Khanoum V. Les remparts et les monuments associés, MDAFA XXIX, Paris, 1986.
S. Veuve, Fouilles d’Aï Khanoum VI. Le gymnase, MDAFA XXX, Paris, 1987.
O. Guillaume et A. Rougeulle, Fouilles d’Aï Khanoum VII. Les petits objets, MDAFA XXXI, Paris, 1987.
Cl. Rapin, Fouilles d’Aï Khanoum VIII. La trésorerie du palais hellénistique d’Aï Khanoum. L’apogée et la chute du royaume grec de Bactriane, MDAFA XXXIII, Paris, 1992.
Secrétariat de rédaction et mise en page : Magali Cullin Mingaud (CNRS, UMR 8546-USR 3133)
Illustrations : CNRS, DAFA
Couverture : Plan restitué de la maison hors les murs (dessin Guy Lecuyot) et vue vers le sud-est du porche avec les vestiges des colonnes et des antes retrouvés au cours de la fouille. À l’arrière-plan, on aperçoit la ligne du rempart nord de la ville (photographie DAFA).
Quatrième de couverture : Chapiteau du porche (dessin Guy Lecuyot).
AK IX.indb 4 03/06/13 11:19
sommaire
Préface (P. Bernard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 000
Avant-propos (G. Lecuyot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Introduction (G. Lecuyot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1La ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Données archéologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5matériaux de construction et mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
matériaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9mise en œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Chapitre 1La maison du quartier sud-ouest (G. Lecuyot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Fouille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14État des vestiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14stratigraphie générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
observations techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Portes et fenêtres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Bouchages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Foyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Colonnes et antes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18État ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18occupation tardive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
État I/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37État I/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
État iii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Les rues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45La maison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Constructions mitoyennes à l’ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AK IX.indb 5 03/06/13 11:19
Constructions mitoyennes au nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52État iV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ensemble nord-ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Ensemble sud-ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
État V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59État Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Trouvailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Les moulages en plâtre retrouvésdans la maison du quartier sud-ouest (P. Bernard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Chapitre 2La résidence en bordure de la rue principale (G. Lecuyot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Fouille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76État des vestiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76stratigraphie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Datation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Trouvailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Chapitre 3Le bâtiment du quartier sud-est (G. Lecuyot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
stratigraphie générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94État II/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94État II/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95État I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Trouvailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Chapitre 4La maison hors les murs (G. Lecuyot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Fouille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103État des vestiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103stratigraphie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Description générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Techniques de construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Fondations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105murs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Joints et enduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Portes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107sols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Couverture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
AK IX.indb 6 03/06/13 11:19
Colonnes et supports en pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
État grec ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131occupation tardive i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Trouvailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Chapitre 5Le quartier du temple principal (L. martinez sève) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Les habitations du début du iie siècle av. n. è. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137Les habitations de l’époque d’eucratide ier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
La maison nord-ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Les autres locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Les habitations de la deuxième moitié du iie siècle av. n. è. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140La réoccupation de la maison nord-ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140La réoccupation de la maisons du quartier sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140La réoccupation des espaces périphériques appartenant au sanctuaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141La réoccupation des bâtiments de la cour du sanctuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Chapitre 6Les habitations près de l’hérôon de Kinéas (P. Bernard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
L’Hérôon et sa terrasse : la réoccupation domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Les anciens propylées du palais privatisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Le quartier postpalatial en contrebas de la terrasse sud de l’hérôon,mitoyen de l’aile orientale des propylées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Chapitre 7Habitat rural achéménide, helllénistique et kouchandans la plaine d’Aï Khanoum-Shortughaï (H.-P. Francfort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Butte n° 111 « Zulm » : poterie achéménide et inhumation hellénistique . . . . . . . . . . . . 158Tépé n° 106 : ferme achéménide et kouchane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Tépé n° 97 : ferme hellénistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Tépé n° 209 « shortughaï » : manoir hellénistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
stratigraphie et architecture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Stratigraphie : sols intérieurs et extérieurs du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Conclusion sur la stratigraphie et l’architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Les trouvailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170La céramique du niveau hellénistique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Habitat rural et exploitation agricole de la plaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Chapitre 8La céramique de la maison du quartier sud-ouest d’Aï Khanoum (B. Lyonnet). . . . . . . . . 179
La céramique d’aï Khanoum et la chronologie absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Les états architecturaux de la « maison Kokcha » et l’évolutionde la céramique : problème de corrélation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
AK IX.indb 7 03/06/13 11:19
Le matériel des états V-Vi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Le matériel des états i-ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Le reste du matériel (états i-V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Catalogue de la céramique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Chapitre 9Les différents types d’habitat à Aï Khanoum (G. Lecuyot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Les grandes résidences privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Les résidences du palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Bloc médian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Bloc sud-ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Les autres types d’habitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197origine des grandes résidences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
L’édifice rouge de Nisa-mithradatkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202La résidence de Khurha en iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203abu Qubur en mésopotamie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
ConclusionConsidérations architecturales et historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
architecture (G. Lecuyot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Chronologie (G. Lecuyot). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212Données historiques (L. martinez sève). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Index général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Table des figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Table des planches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Catalogue de la céramique provenant de la maisondu quartier sud-ouest d’Aï Khanoum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Planches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
AK IX.indb 8 03/06/13 11:19
Chapitre 7
HaBiTaT rUraL aCHÉmÉNiDe, HeLLÉNisTiQUe eT KoUCHaN
DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaïpar Henri-Paul Francfort
La plaine d’aï Khanoum en Bactriane orientale est certainement l’un des cantons les mieux connus de l’asie centrale, grâce aux fouilles et prospections qui s’y sont déroulées entre 1964
et 1979 et au nombre considérable de publications qui sont déjà parues et qui continuent de paraître. au cours des années 1976 à 1979, quelques petites buttes recélant des vestiges d’occu-pations rurales ont été sondées ou fouillées, pendant que se déroulaient les prospections et les fouilles d’aï Khanoum (dernière campagne à l’automne 1978) et celles de shortughaï (dernière campagne au printemps 1979) (fig. 66 a).
Ces opérations de sondages et de fouilles étaient avant tout destinées à mettre en évidence les transitions chronologiques de l’histoire de la plaine entre la période hellénistique, brillamment illustrée par la ville d’aï Khanoum, et les époques suivantes (kouchane) ou antérieures (perse, âge du Bronze). Parallèlement, il s’agissait aussi de tester la validité de la représentativité des ramas-sages de surface par rapport aux collectes de poteries faites en fouille. enfin, nous cherchions aussi à comprendre en partie les modes d’occupation du terroir à ces époques, qu’il s’agît de la chora d’aï Khanoum, de son évolution après la chute des royaumes grecs ou de son articulation avec les installations plus anciennes, par les traces des habitats, des vestiges de canaux ou de par-cellaires agricoles 346. malheureusement, les événements politiques n’ont pas permis que fussent développées ces recherches.
au cours des quatre années qui virent se dérouler ces travaux, quatre installations furent fouillées ou sondées. Lors de la campagne de l’automne de 1976, un sondage fut effectué sur la butte perse de Zulm (n° 111) et un autre à shortughaï (n° 209). La grande ferme grecque de shortughaï fut ensuite en grande partie fouillée pendant les campagnes de printemps de 1978 et de 1979. enfin, à l’automne 1977, la butte n° 106 fut sondée et la ferme du « tépé » n° 97 fut fouillée. Les résultats de ces opérations, que nous donnons ici, sont très contrastés.
346 Dans l’étude de Gentelle 1978, l’auteur a tenté une approche détaillée des modes d’occupation de la plaine d’aï Khanoum et donné des indications sur les cadastres à partir d’analyses de cartes au 1/10 000e et de photographies aériennes.
AK IX.indb 157 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT158
Butte n° 111 « Zulm » : poterie achéménide et inhumation hellénistique
La fouille du site de Zulm (fig. 66 a), site n° 111 placé sur la zone du canal aK2 347, a révélé, à environ 2 m de profondeur sous la surface, des vestiges de poteries, restes d’une occupation perse de nature indéterminée mais sans aucun vestige de structures architecturales (pl. xxx-Vii 1). Cette occupation avait pris place sur une élévation naturelle du terrain, configuration qui donnait en surface l’illusion parfaite d’un « tépé » rural. La nature de cette occupation légère n’a pas été élucidée, qu’il s’agisse d’un habitat temporaire, saisonnier ou nomade, ou des restes d’activités d’une autre nature.
Toutefois, une inhumation hellénistique en jarre, apparemment isolée, a été dégagée près de la surface (pl. xxxVii 2) 348. La jarre, haute de 1,30 m, se trouvait couchée dans la seconde couche fouillée sous la surface. Le squelette d’un adulte y gisait en décubitus dorsal, la tête placée au nord vers l’ouverture, les jambes fléchies et les bras le long du corps (pl. xxxVii 3) 349. Les inhumations en jarres sont connues en Bactriane depuis l’âge du Bronze (sites de sapallitépa et Djarkutan en ouzbékistan, vallée du surkhan Darya) 350. À aï Khanoum même, dans la nécro-pole hors les murs, des jarres funéraires ont été mises au jour, mais il s’agit de jarres cinéraires ou de réceptacles d’os décharnés collectés dans un mausolée. Le mode de dépôt usuel des corps en Bactriane hellénistique et kouchane est le décubitus dorsal, jambes allongées et bras le long du corps, mais quelques sépultures en jarre sont connues dans les cimetières de Douchambé et de Tup Khona 351. La jarre funéraire hellénistique de Zulm, éloignée de tout habitat, ne pour-rait-elle pas être un indice montrant que cette butte naturelle avait une destination funéraire et qu’elle avait été auparavant utilisée pour des décharnements de corps exposés à l’air libre selon la coutume perse et bactrienne mazdéenne ? si cela était le cas, il ne serait nullement surprenant de ne pas retrouver d’ossements avec les poteries perses, soit qu’ils aient été dispersés par les ani-maux nécrophages, soit que l’acidité du loess en eût fait disparaître les traces 352. Cependant, si
347 Fouille de P. Bernard, assisté de m.-H. Pottier. Les dates du matériel de ce site (voir Gardin 1998, p. 43 et 235, fig. 3.2) sont P(erse)1, 2-G(rec)-(i(slamique)1). Certaines poteries perses de ce site sont publiées par B. Lyonnet, 1997, p. 29, p. 83, fig. 30, p. 369 (jarres F1-6/2 et F1-6/3), fig. 32, p. 371 (gobelets o3-1 et o3-3) et fig. 34, p. 373 (céramique façonnée à dégraissant fin série G4). Comme le dit l'auteur, ces dernières poteries sont particulièrement intéressantes par leur ancienneté : bec verseur et pieds peuvent en effet remonter à la fin du 2e millénaire.348 Pour une jarre du même type (F1/1) qui provient justement de ce site, voir Lyonnet 1997, p. 379, fig. 40 et p. 127. Le dessin publié là est celui d’un haut de jarre sans fond, mais l’auteur lui associe, d’après les trouvailles faites dans la ville, un fond convexe, plus ou moins bombé, exactement comme l’exemplaire de Zulm. Les publications actuelles de la poterie ne permettent pas de savoir quelle était l’importance quantitative respective du matériel grec et perse à Zulm : "daté essentiellement de la période "bactrienne" (Lyonnet, 1997, p. 29).349 Ce squelette a été étudié par L. Buchet avec ceux d’aï Khanoum, mais son état de conservation n’était pas bon : voir Buchet 1977, p. 4-7. 350 Voir par exemple, parmi bien d’autres publications, askarov et abdullaev 1978.351 sépultures d’aï Khanoum ; voir également, par exemple, Litvinskij et sedov 1984, p. 26-28, 47, 95-96, 137, pour les sépultures en jarre et les comparaisons dans le Caucase et en mésopotamie parthe.352 Les travaux publiés des fouilles d’aï Khanoum sur les squelettes du théâtre (Bernard 1978a, p. 439, fig. 11 et p. 440-441), la publication des monuments funéraires hors les murs (Bernard 1972, p. 613-620), celle des mauso-lées intra muros de Kinéas (Bernard 1967, p. 310 ; Bernard, Le Berre et stucky 1973, p. 87-88) et de celui au caveau de pierre (Francfort et Liger 1976, p. 31-32) permettent de se faire une idée de la diversité et des rapports entre les
AK IX.indb 158 03/06/13 11:19
159HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
l’ethnologie centrasiatique montre bien des lieux naturels plus ou moins aménagés consacrés au décharnement des corps 353, les sources anciennes sont pour leur part beaucoup moins claires sur ce sujet 354 et l’archéologie est quasiment muette 355.
Quoi qu’il en soit de la relation entre les abondantes poteries perses des couches inférieures (niveaux nos 3 et 4) et l’inhumation hellénistique, cette dernière, par ses particularités, indique sans doute la présence de populations centrasiatiques locales, steppiques ou originaires des régions proches du xinjiang. en effet, la position du corps de Zulm se distingue parfaitement de celle de la tradition en vigueur dans la Bactriane de l’âge du Bronze, où prédomine le décubitus latéral et où les bras et les jambes sont repliés. elle est différente aussi de celle qui prédomine au long des époques hellénistique et kouchane, où le corps est tout allongé. en revanche, elle cor-respond exactement à celle d’une sépulture de Hissar (kouchane ?) et à celle des corps momifiés datés des vie-iie siècles av. n. è. retrouvés au xinjiang, dans la partie occidentale du Taklamakan, à Zaghunluk et à Djoumboulaq Koum, où les cercueils sont des troncs de peupliers évidés 356. Ce mode de dépôt du corps se rencontre uniquement dans le monde des steppes de l’asie cen-trale depuis le chalcolithique et la culture d’afanasevo, et parfois aussi dans la « Gandhâra Grave Culture » de la vallée du swat. Les cultures du groupe d’andronovo inhumaient en décubitus latéral fléchi et celles de l’âge du Fer centrasiatique, tant de Yaz-1 que de Yaz-2/3 ou « achémé-nide », avaient adopté le décharnement en surface qui ne laisse pas de tombe 357. Nous ne serions pas surpris, compte tenu de la diffusion géographique et chronologique de ce mode de dépôt du corps, que la tombe de Zulm ait appartenu à un membre d’une des tribus conquérantes de la Bactriane dans la seconde moitié du iie siècle av. n. è.
Tépé n° 106 : ferme achéménide et kouchane
La butte n° 106 (fig. 66 a et pl. xxxViii 1-3) a fait l’objet de trois sondages pratiqués en été, du 27 août au 1er septembre 1977, sur un site « choisi pour la richesse de sa stratigraphie (P(erse) final ?, G(rec) ?, K(ouchan)) d’après les données de la prospection à l’époque, pour sa taille relativement réduite (20 × 40 m sur les points hauts), pour sa proximité d’un important canal P(erse) et K(ouchan) et pour sa proximité du camp d’aï Khanoum (15-20 minutes en
pratiques funéraires grecques et celles des mazdéens-zoroastriens dans cette province de la Bactriane hellénistique et hellénisée.353 au Tibet, en mongolie, en sibérie du sud.354 Grenet 1984, p. 17-30.355 N. Bokovenko considère que certains kereksurs (plateformes aménagées en pierre) de sibérie méridionale et de mongolie ont pu être des plateformes à décharnement : Bokovenko 1996.356 Pour Hissar, voir Litvinskij et sedov 1984, p. 97-98 ; pour le xinjiang, voir Debaine-Francfort et abduressul 2001, p. 137-143, fig. 4, 10, 12, 13. À aï Khanoum, le problème de la présence de populations locales s’est posé du point de vue de l’anthropologie à propos de déformations crâniennes observées notamment sur un crâne du mausolée au caveau de pierre. Du point de vue historique et archéologique, certaines poteries liées aux occupations de dernière période du site ont permis d’évoquer les populations locales, mais aussi les envahisseurs nomades au moment de la fin du royaume gréco-bactrien (Lyonnet 1991). Pour des tombes post-grecques trouvées dans les fouilles du rempart de la citadelle, voir Leriche 1986, p. 109-111, pl. 23 et photos 149-161.357 Voir Francfort 2005.
AK IX.indb 159 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT160
jeep) 358 ». Ce site, installé à environ 50 m à l’est du canal aK1 359, s’est révélé purement perse et kouchan, mais sans matériel grec 360.
Une première tranchée de 6 × 1,50 m, orientée est-ouest, a permis de découvrir une stratigra-phie en dix couches successives (numérotées de 1 à 10 de haut en bas ; fig. 67 a, B et C). Les sept première couches sont d’époque kouchane. elles représentent une épaisseur de 1,50 m et cor-respondent à des constructions architecturales dont les murs observés, au nombre de trois, sont composites, en briques crues reposant sur une assise d’argile ("gel") et enduit de torchis (m1, m2) ou en pisé enduit de torchis (m2, m3 ; fig. 67 B). Les briques (38 × 40 × 10 cm) présentent au lit de pose une raie médiane tracée au doigt (pl. xxxViii 3). Les couches 8 à 10 (ép. totale 20-30 cm) sont d’époque perse et les restes de constructions sont réduits à des massifs de pisé et des rigoles qui sont peut-être les vestiges de constructions sommaires (fig. 67 a). Des restes de foyers et des pierres de meules indiquent qu’il s’agit bien d’un habitat. séparant les deux époques précitées, une couche C7, épaisse de 30 cm environ, a été observée, correspondant à l’abandon du niveau perse et à la construction du niveau kouchan (fig. 67 C).
L’extension de cette première tranchée par l’ouverture d’un carré de 4 × 4 m à l’est a permis la découverte des prolongements des murs m1 et m2, ainsi que de deux nouveaux murs, m4 et m5, dessinant une pièce 1 de 2,60 m × 2,30 m. Une banquette revêtue de torchis, haute de 40 cm (quatre briques empilées) et large de 45 cm (une brique et un joint de torchis), court le long des murs ouest m1, est m4 et sud m5 (pl. xxxViii 2). au niveau même du sommet de cette banquette, la pièce était remplie d’une couche composite (C12) contenant des briques, du torchis tombé, des galets, des tessons ainsi qu’un « petit socle » en argile brûlée mêlée de paille 361, une pierre à aiguiser et de nombreux os de porc (fig. 67 D). il pourrait s’agir du niveau d’effondrement de la toiture ou d’un étage, ou encore d’un niveau d’occupation postérieur à l’époque principale de fonctionnement de cette ferme. sous C12 et les décombres, le sol était plat, dur, légèrement sableux ; deux galets plats y affleuraient, peut-être des supports de piliers de toiture (?). Cette pièce, étrangement, était dépourvue de porte. si ce bâtiment est bien daté de l’époque kouchane et si l’on a bien montré qu’il s’est installé sur les vestiges d’une ancienne occupation perse, en revanche, sa fonction précise n’a pas pu être déterminée par ces sondages. La présence d’un petit socle indique seulement la persistance des cultes locaux en Bactriane de l’époque gréco-bactrienne à l’époque kouchane, mais elle ne suffit nullement à conférer au tépé 106 une fonction religieuse 362.
Un sondage supplémentaire effectué sur la petite butte à l’ouest du tépé principal a été rapi-dement abandonné devant le mauvais état de conservation des vestiges, qui ne donnaient rien de lisible.
358 Journal de fouille 1977.359 ou canal n° 2 dans Gentelle 1978, p. 119, fig. 48.360 Gardin 1998, p. 42 et 235, fig. 3.2, date ainsi : P(1), 2-K(1), 2-H1, c’est-à-dire avec certitude des périodes perse finale, kouchan final et hephtalite.361 Ce petit socle appartient au type F de la série du sanctuaire d’aï Khanoum : voir Francfort 1984, p. 81 et pl. 29.362 Pour des petits socles analogues, d’époque kouchane également et en divers matériaux, voir Pugachenkova 1996. Les petits socles gréco-bactriens connus sont tous en pierre, alors que certains exemplaires kouchans sont en terre cuite.
AK IX.indb 160 03/06/13 11:19
161HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
B. Lyonnet a bien voulu attirer mon attention sur la nouvelle datation, kouchane et kou-chano-sassanide plus précise, qu’elle propose des poteries découvertes au « tépé » 106 363.
Tépé n° 97 : ferme hellénistique
après les sondages précédents, l’effort fut porté sur une autre butte (n° 97), « choisie pour sa proximité avec le site d’aï Khanoum et la présence en surface de céramique grecque et kouchane lais-sant espérer une étude du passage de la période G à la période K 364 » (fig. 66, 68, 71 B ; pl. xxxix 1).
Ce site s’est révélé être purement grec 365, sans le matériel kouchan supposé avant la fouille ou le « bactrien » (perse) imaginé ensuite 366. mais l’apport de cette fouille pour la connaissance de la vie rurale à l’époque hellénistique dans la plaine d’aï Khanoum est loin d’être négligeable, comme le montre la section qui lui est consacrée ci-dessous.
La butte 97 devait donc faire l’objet d’une étude de l’habitat dans la zone rurale 367, mais aussi, parce que des tessons d’époque kouchane recueillis sur sa surface le laissaient espérer, d’une approche stratigraphique du passage de la période hellénistique à la période kouchane. en réalité, les tessons kouchans n’étaient nullement en relation avec un niveau de structures archéologiques, et nous avons finalement fouillé un bâtiment hellénistique dont l’architecture s’apprécie par référence à celle des demeures urbaines.
Le bâtiment est situé sur une dérivation d’un canal secondaire du grand canal du milieu de la plaine aK2 368, à 300 m environ de ce dernier (croquis fig. 66 B). il est voisin des buttes 95 et 96, qui ont une situation analogue dans le réseau d’irrigation sans que leur fonction soit connue ni leur histoire. en surface elles offrent le même aspect que la butte 97, dont l’histoire et la fonction se déduisent de la stratigraphie et de l’architecture.
La stratigraphie observée sur la butte 97 se compose de trois couches qui sont, de haut en bas (voir coupe, fig. 68 B) :
a) une couche de décombres de briques et de lentilles de sable laissées par des eaux stagnantes (C1 et C2) ;
b) une couche d’occupation sur un sol qui s’abaisse en pente douce vers les murs extérieurs, marquée par des vestiges de petites constructions et du matériel de la vie quotidienne (C3 et s3) ;
363 Je remercie B. Lyonnet pour ces références : Lyonnet 1997, p. 174, p. 192, e. (F2-5), p. 215, C. (o3-3), avec les remarques p. 217 (variante o3-3/2 [post-kouchan ou kouchan-sassanide] ; tableaux xxxiV et xxxV(3)), p. 254, décor a. incisé et/ou poinçonné.364 Journal de fouille 1977.365 Gardin 1998, p. 42 et 235, fig. 3.2.366 Lyonnet 1997, p. 29, écrit : « le site 97 de la plaine d’aï Khanum (voir fig. 38), donné pour être “bactrien”, mais surtout grec, dates que la fouille-sondage de H.-P. Francfort a entièrement justifiées, tout en établissant avec plus decertitude une petite occupation "bactrienne" ». Affirmation à corriger, car aucun matériel “bactrien” ou “perse” n’a été recueilli lors de cette fouille ni publié et aucune occupation de cette époque ne peut être assignée à ce tépé : Lyonnet, 1997, fig. 38 "hellénistique"; Gardin, 1998, p. 42 B, tab. 8, p. 24, carte fig. 3.10 aire b donnent tous une date clairement et uniquement "hellénistique".367 La zone rurale se définit comme une région d’habitat dispersé qui s’oppose aux zones urbaine et suburbaine d’aï Khanoum, dont la surface bâtie est majoritaire et où la densité des monuments importants se déduit du grand nombre des éléments de décor architectural repérable en surface (tuiles, antéfixes, éléments de colonnes, éléments de salles d’eau).368 ou canal n° 6 dans Gentelle 1978, p. 124, fig. 51. La légende de la figure 51b, qui reproduit un relevé préliminaire de H.-P. Francfort, indique par erreur qu’il s’agit de la butte n° 95.
AK IX.indb 161 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT162
c) une couche d’occupation horizontale où l’on distingue deux états successifs ayant chacun leur sol (s4). Le premier est l’état originel du bâtiment.
Le plan du bâtiment (fig. 68 et 71B, plan restitué) n’est pas connu avec précision dans son ensemble. il est quadrangulaire et mesure 16,80 m d’est en ouest et 17,45 m du nord au sud (dimensions mesurées à l’intérieur). Ce bâtiment serait donc carré, si nous étions certains que les murs repérés sont bien ses murs extérieurs, ce que ni l’extension de la fouille ni le degré de ruine dû au débordement de la canalisation d’amenée d’eau qui a fait fondre l’argile du côté sud ne permettent d’affirmer.
Les murs les moins mal conservés sont construits en briques crues de 40 cm de côté. Larges de deux briques, soit de 1 à 1,20 m, ils reposent sans fondations à même le sol naturel de la plaine et sont revêtus, du côté intérieur des pièces, d’un enduit de torchis épais de 1 à 2 cm.
au premier état, le bâtiment comportait dix pièces, réparties en trois bandes parallèles de direction est-ouest (voir plan). Dans la bande sud, on trouve les pièces 5, 3, 6, 7. Dans la bande centrale, les pièces 8 et 2 encadrent la pièce 1. Cette situation se répète dans la bande nord où la pièce 10 est flanquée des pièces 4 et 9.
La pièce 2 mesure 4,40 × 7,40 m ; elle recelait deux grandes fosses parallélépipédiques à parois très régulières soigneusement revêtues de torchis bien lissé et profondes de 1 m ; l’une de 1 × 0,80 m et l’autre de 1,80 × 1,20 m (pl. xxxix 2). La destination de ces trous est claire, il s’agit de silos à céréales 369. au second état, après l’obturation des silos et la construction d’un nouveau sol, une sorte d’auge en briques de chant a été construite dans l’angle nord-est (1,7 × 0,5 m env.). on accédait à cette pièce, certainement l’une des principales de la maison, soit depuis la pièce 3 par une porte large de 0,8 m, soit de la pièce 5 par une porte large de 1,20 m, soit depuis le vestibule 1. au dernier état, seul l’accès sud, par la pièce 3, subsistait.
Le vestibule 1 (5,25 × 1,55 m) avait des murs portant encore un enduit de torchis épais parfois de 5 cm. Le passage ouest, donnant sur la pièce 2, large de 0,75 m, a été bouché par un muret de briques au dernier état. il en va de même pour le passage nord, donnant sur le vesti-bule 10, dont le bouchage est en argile, massif épais de 0,85 m et complété par une petite auge en briques de chant, large de 0,6 m, placée du côté intérieur. Une troisième porte de ce vestibule, située dans l’angle sud-est et large de 0,75 m, donnant sur la pièce 8, est restée ouverte jusqu’à la fin du fonctionnement du bâtiment.
La pièce 8 (4,40 × 5,65 m) s’ouvre au nord sur la pièce 9 par une porte large de 1,25 m dont le parement ouest est mal conservé ; au sud, une porte large de 1,40 m s’ouvre sur la pièce 7. on y a découvert une jarre en place dans l’angle nord-ouest et une zone cendreuse le long du mur ouest. au nord des pièces 1, 2 et 8, les pièces 4, 10 et 9 forment un ensemble de dimensions similaires au milieu duquel le vestibule 10 (2,65 × 1,70 m), dans l’alignement du vestibule 1, est flanqué des pièces 4 et 9. ses enduits de torchis sont bien conservés, ainsi que la porte 10-9 (larg. 1,30 m) et la porte symétrique 10-4 (larg. 1,60 m).
369 Leur capacité est respectivement de 0,8 et 2,16 m3, soit 3 m3 environ au total (3000 litres), correspondant à approximativement 1800 kg de blé. Voir plus bas les silos de shortughaï. on connaît les silos comme mode de stockage de céréales dans cette plaine depuis l’âge du Bronze : voir Francfort 1989, p. 244-245, 343, 369, 43, 441.
AK IX.indb 162 03/06/13 11:19
163HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
La pièce 9 (5,15 × 5,80 m) possède un petit foyer adossé au mur ouest, près duquel ont été découverts des pesons de tisserand en argile crue, une fusaïole, un fragment de meule et une pointe de fer 370.
La pièce 4 (5,30 x 7,25 m) conservait encore en partie des enduits sur ses murs nord et sud. Un muret de briques de chant enduit de torchis, construit postérieurement, cloisonne une sur-face rectangulaire de 4,75 × 2 m dans l’angle sud-est. Un foyer rectangulaire (1,10 × 0,70 m) construit en briques crues est l’élément central de cet enclos, dans lequel ont été découverts des restes de jarres (pl. xxxix 3). Ce foyer, enduit de torchis et brûlé sur son sommet, à 35 cm au-dessus du sol, fait nouveauté par rapport à aï Khanoum où les feux s’allumaient au sol ou sur de plates semelles de briques. Des fragments de marmites noires de suie, une fusaïole, une pierre à huile, des tessons de jarres sont les seuls restes du mobilier de cette cuisine, que complètent des fragments de petites meules plates.
Les pièces 5, 3, 6 et 7, situées au sud des précédentes, ne sont pas partout bien conservées. Dans la pièce 5, deux états ont été distingués. au plus ancien, la pièce mesurait plus de 6 m nord-sud et 3,50 m est-ouest ; au plus récent, le mur ouest avait été rasé et elle mesurait plus de 5,60 m d’est en ouest. La porte nord, qui donne dans la pièce 2, est large de 1,20 m. À chacun des états, qui sont séparés en stratigraphie par une couche d’une vingtaine de centimètres de terre, correspondent des petits foyers ainsi qu’une « mosaïque » faite d’un petit pavage rudimen-taire de galets noyés dans le sable gris que charrient les hydragogues. La fonction de cette pièce n’aurait pas changé au cours du temps ; elle semble reproduire, sur un mode rustique, les salles d’eau des maisons d’aï Khanoum.
La pièce 3, située à l’est de la précédente, mesure plus de 6 m (nord-sud, mur partiellement conservé) sur 5,60 m ; elle s’ouvre au nord sur la pièce 2 par une porte large de 0,80 m. on y a découvert un fragment de meule et les restes d’un four en arc de cercle contre le mur nord. À l’est, une porte large de 0,85 m donne sur une petite resserre 7.
Cette pièce 7 (2,50 × 4,50 m) avait une fonction de stockage indiquée par les restes de trois jarres retrouvés en place ; sa communication avec la pièce 6 par une porte est douteuse : porte ou mur détruit ?
La pièce 6 (2,50 × 4,50 m) est traversée en diagonale par une canalisation faite de tuyaux en terre cuite et d’un fragment de jarre (pl. xxxix 4). Cette canalisation, d’après sa pente et la situation du bâtiment par rapport aux canaux, était destinée à amener l’eau dans les pièces 3 et 5.
La fonction de tous les locaux de ce premier état n’est pas certaine, à l’exception de celle des pièces 2 (réserve de stockage de grain), 4 (cuisine, dès cet état ?), 7 (stockage, dès cet état ?) et 5 (bain).
À l’état suivant, l’on assiste à une reprise de certains des éléments et nous décrivons cet état comme un tout achevé, bien que nous ne soyons nullement certains que les transforma-tions décrites furent simultanées ; elles furent plutôt progressives. Les rôles se distribuent un peu mieux dans l’espace carré du bâtiment de ferme de la butte 97. Une nouvelle jonchée de galets tient lieu de salle d’eau rénovée, que la stratigraphie relie à la canalisation qui traverse la pièce 6 et que l’on perd dans la pièce 3. Les silos de terre de la pièce 2 sont condamnés, mais la capacité de stockage a pu être transférée dans les pièces 7 et 8 où se serrent des jarres. La communication directe entre les pièces 1 et 10 est obturée par une murette de briques de chant et la pièce 10
370 Pour les trouvailles, voir plus bas.
AK IX.indb 163 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT164
donne seule accès à la cuisine 4. Là, une cloison faite de briques dressées, revêtues de torchis sur les deux faces, isole un espace dont l’élément central est un foyer. Les pesons de tisserand ne se trouvent que près du petit foyer de briques cuites de chant de la pièce 9, en compagnie d’une fusaïole. ainsi, le tableau de la vie domestique gréco-bactrienne est complet et tout à fait com-parable à celui d’aï Khanoum 371.
après une interruption dans l’occupation, que semble marquer l’accumulation d’une couche de dépôt épaisse de 0,5 m dans la partie centrale du bâtiment, une nouvelle occupation prend place.
Les pièces 5, 6, 7, 8 et 9 sont abandonnées, les passages entre la pièce 1 et les pièces voisines sont murés, ne permettant plus l’accès à cette pièce 372. Une sorte d’auge en briques levées règne dans l’angle nord-est de la pièce 2 373, deux petits foyers sont creusés dans le sol de la pièce 3 374 et des vestiges céramiques de cette dernière phase occupent une partie de la pièce 4.
au cours de ces trois phases, le caractère rural du bâtiment 97 ne se dément pas. La situation dans la plaine, d’abord, indiquait qu’il s’agissait d’un bâtiment campagnard (fig. 66). La capacité de stockage offerte par les silos et les jarres rappelle celle de la grande ferme qui surmonte les ruines de l’établissement protohistorique de shortughaï, à 20 km au nord d’aï Khanoum 375. Les pesons, les meules, les fusaïoles, les petits foyers attestent une activité domestique que l’on retrouve à la ferme de shortughaï 376 et dans les cuisines des monuments de la dernière période de la ville d’aï Khanoum 377. mais ici, à la différence de la ferme de shortughaï, la modestie des occupants est manifestée par l’absence de certaines marques de « luxe » comme des lampes, figurines de terre cuite, couvercles de pyxides de schiste. De même, si l’on excepte la sommaire installation balnéaire, l’architecture de cette fermette rappelle fort peu celle des complexes pala-tiaux ou des grandes demeures urbaines d’aï Khanoum où de vastes vestibules mènent à d’amples salles de réception, parfois hypostyles, et à de grandes cours reliées par de longs corridors à des appartements privés aux salles d’eau rutilantes et aux dallages éclatants 378.
371 Voir aussi d’autres assemblages ruraux contemporains caractéristiques proches des nôtres, comme celui d’Haci Nebi achéménide et hellénistique (pesons, figurines, silos, poterie, lampe) : mcmahon 1996 et 1997. Pour d’autres trouvailles domestiques, voir Gardin 1973, p. 173-174 (céramique de cuisine), p. 176 (pesons de tisserands). Voir ci-dessous le tépé 209 (shortughaï) pour l’ensemble des activités domestiques hellénistiques connues dans la plaine.372 Une pièce sans accès a été trouvée aussi au dernier état du sanctuaire du temple principal. Dans le bâtiment kouchan qui a fait l’objet d’un sondage du 27 août au 1er septembre 1977 (butte n° 106), les quatre murs de la pièce sont couverts d’une couche de torchis continue, appliquée après l’obturation et de l’intérieur, ce qui implique l’existence d’une voie d’accès par le haut. La certitude acquise à la butte 106 ne lève pas les doutes qui planent sur les prétendues casemates d’ajrtam où toutes les pièces sont complètement aveugles : voir Turgunov 1973, p. 54, fig. 2.373 auges semblables dans la dernière couche d’occupation du sanctuaire du temple principal (pièce 2.07 et pièce 2.11, fig. 60).374 Foyers creusés dans le sol dans diverses couches d’occupation du sanctuaire du temple principal.375 Francfort et Pottier 1978, p. 34-35.376 Voir plus bas.377 Y compris les cuisines de l’ensemble palatial.378 Voir par exemple Bernard 1969, p. 325 ; 1970, p. 312 ; 1971, p. 394-402 ; 1974, p. 283-285 ; Bernard, Francfort, Gardin, Liger, Lyonnet et Veuve 1976, p. 9-25. P. Bernard m’indique, et je l’en remercie vivement, que « le plan de cette ferme n’est pas sans évoquer la distribution intérieure de l’état architectural ii du bâtiment sud-est d’aï Khanoum, en bordure de la Kokcha : pièces 1, 2, 5 atteintes par de petits vestibules comme 1 et 10 ici »
AK IX.indb 164 03/06/13 11:19
165HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
Cette indigence est-elle un signe d’autochtonie ou de pauvreté matérielle ? Nul ne le sait, mais nous sommes certainement fort loin de l’opulence des colons grecs de la Bactriane et de leurs successeurs sous les grands Kouchans 379. La dernière phase d’occupation partielle demeure énigmatique, car l’on n’y trouve encore que de la céramique hellénistique 380. elle pourrait cor-respondre à la phase dite de « l’occupation tardive » de la ville, après 145 av. n. è. et le départ des Grecs.
Tépé n° 209 « shortughaï » : manoir hellénistique
L’autre fouille qui apporta les meilleures informations sur la vie rurale à l’époque hellé-nistique est celle de shortughaï (nos 209-210 ; fig. 66 a, 69-71), site surtout connu pour son établissement de l’âge du Bronze, harappéen et bactrien 381. La grande ferme hellénistique qui s’est installée sur le sommet de l’établissement protohistorique ruiné depuis plus d’un millénaire contrôlait une portion de territoire irriguée par le canal aK2 382. Une petite dérivation courait juste au pied de la ferme, installée quelques décimètres au-dessus du vieux canal protohistorique abandonné et comblé, mais montrant ainsi la pérennité de la reprise des tracés 383. Comme nous
(voir Lecuyot, ce vol. fig. 36). Notre plan de la ferme 97 rappelle aussi celui du manoir d’époque achéménide de Dingil’dzhe en Chorasmie, où un corridor central donne des accès aux pièces d’un ensemble placé au nord d’une cour, elle-même dotée d’aménagements : Vorob’eva 1973, p. 18-21, plans fig. 6 et 7.379 Kruglikova 1974, p. 84-97 ; Kruglikova et Pugachenkova 1977, p. 5-47 et 104-112 ; Francfort 1977 ; Pugachenkova 1977, p. 286-287 ; Pugachenkova, rtveladze et Turgunov 1978, donnent les plans des maisons pri-vées. P. Bernard (Bernard 1974, p. 286) pose le problème du régime d’exploitation de la terre par les colons grecs d’aï Khanoum, mais rien dans la maison hors les murs n’évoque l’agriculture (dans la partie fouillée du moins ; voir dans ce volume), de même que rien, dans la butte 97, n’indique l’hellénisme (mais la butte 95 et la butte 96 peuvent faire partie de la même exploi tation, et l’une des deux peut être le manoir hellénistique principal). Quant à la ferme de shortughaï, le caractère « gréco-bactrien » de son matériel n’indique rien sur l’ethnie à laquelle appartenaient ses habitants. Voir plus bas.380 en l’absence de toute trace d’occupation kouchane et sachant que les états 1 et 2 sont datés respectivement par J.-Cl. Gardin et B. Lyonnet (communications orales faites sur place au moment de la fouille, ce dont je les remercie) de « à partir de 250 » et « après 200 ». À titre de comparaison, l’étude céramique globale de 1976 de shortughaï, le tépé 209 (ci-dessous) mentionne que « c’est donc entre 275 et 150 av. n. è., approximativement, qu’il faut placer la période de vie, sous la domination gréco-bactrienne ». Ces dates devraient aujourd’hui être abaissées : autour de200-130 ? (voir les contributions de B. Lyonnet et de L. sève martinez dans le présent volume).381 Francfort 1989. Une brève note sur les niveaux hellénistiques découverts en 1976 a été publiée précédemment : Francfort et Pottier 1978, p. 34-35.382 Plus probablement que aK3 : voir Gardin 1998, p. 43-44, fig. 3.3. Gentelle 1978, p. 103, fig. 41, p. 120-121, fig. 49, publie une coupe préliminaire schématique des canaux d’irrigation localisés à shortughaï. Les observations faites sur l’existence de deux parcellaires de plan régulier mais d’orientation différente dans la portion de plaine proche de shortughaï n’ont pas été reliées à la présence d’occupations ou de mises en valeur successives dans le temps comme P. Gentelle semblait le suggérer. en effet, dans cette partie de la plaine, les poteries « caractéristiques » des buttes ne permettent pas de dater ces réseaux avec suffisamment de précision, et les canaux eux-mêmes sont malaisés à dater car pauvres en tessons et fréquemment réutilisés au cours du temps.383 Voir le plan et la coupe. Pour une coupe sur les canaux montrant la superposition de celui de l’âge du Bronze et de celui de l’époque gréco-bactrienne, voir Francfort 1989, pl. 31. Pour des coupes montrant les niveaux hellénistiques au-dessus de ceux du Bronze, voir Francfort 1989, pl. 19, 21-22, 27. Pour des photographies de coupes du niveau de la ferme grecque, voir Francfort et Pottier 1978, fig. 5-6, mur grec ouest de la pièce 1 en place, son écroulement et les couches extérieures ouest en pente ; fig. 9, coupe montrant le silo gréco-bactrien de la pièce 1 recoupant les
AK IX.indb 165 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT166
le verrons ci-dessous, il s’agit d’une ferme très importante, d’un véritable petit manoir qui a été partiellement fouillé au cours de trois campagnes (1976, 1978 et 1979) dont l’objectif principal était la mise en lumière des vestiges protohistoriques sous-jacents.
stratigraphie et architecture
Stratigraphie : sols intérieurs et extérieurs du bâtimentL’établissement hellénistique du tépé n° 209 occupe le point culminant de la butte. il prend
place sur les derniers niveaux protohistoriques qu’il arase et nivelle, remodelant le relief.La couche archéologique gréco-bactrienne, composée des ruines de l’établissement et de ses
décombres est épaisse d’environ 1,70 m. Le sondage, allongé d’est en ouest, conduit à distinguer d’ouest en est trois ensembles stratigraphiques et architecturaux dans cet établissement, de part et d’autre des murs dégagés (fig. 69) :
a - la pièce 1 et ses alentours nord, ouest et sud ;b - les pièces 2, 3 et leurs alentours nord, sud et est ;c - la pièce 4 et ses alentours nord, sud et est.Les ensembles a et b constituent une partie du corps de bâtiment principal du manoir, tandis
que l’ensemble c, qui en est séparé de 4-5 m, est une annexe de stockage (fig. 70).
a - La pièce 1 et ses alentoursCette partie du bâtiment a été fouillée en 1976 et 1978. La pièce 1 mesure 5,90 × 7 m ;
ses murs, épais de 1,10 à 1,50 m, sont construits en briques crues de 41 cm de côté et 10 cm d’épaisseur environ. Ces murs reposent sans fondation sur une semelle d’argile de 20 cm d’épais-seur. Le mur nord, conservé sur 0,71 m de hauteur, a été consolidé par des briques de chant et revêtu d’un enduit de torchis (kâgel) épais de 10 cm, à badigeon verdâtre (pl. xL 1) 384. Un passage large de 1,10 m s’ouvre dans le mur est, qui donne sur la pièce 2. Comme le mur nord de la pièce 1 s’appuie sans lien au mur ouest de la pièce 2, il est possible, mais non prouvé, que la pièce 1 soit un ajout postérieur à l’ensemble des pièces 2-3. L’unique sol hellénistique, en argile, net et dur, épais de 20 cm, repose sur une couche de terre mêlée de paille (s2) ; il était recouvert d’une couche de décombres de briques crues tombées, épaisse de 1,5 m, dans laquelle furent découvertes et déplacées trois sépultures d’époque islamique sans mobilier. sur ce sol, dans la couche d’occupation, on a mis au jour, outre de la poterie et des pesons de tisserand, des fragments de meules en grès rose. Près de l’angle sud-est de la pièce prenait place un vaste silo de 2,40 × 1,20 m, profond de 1,10 m, dont les parois, très régulières, étaient enduites d’un torchis épais de 1 cm, soigneusement lissé et passé au badigeon verdâtre. La capacité de ce silo dépassait donc les 3000 litres, ce qui dénote un bon volume de stockage (voir ci-dessous). sa position stratigraphique indique qu’il a pu fonctionner antérieurement à la construction de la pièce 1, à un moment où cet espace était extérieur à l’ensemble 2-3, et qu’il a été obturé lors de la construction de la pièce 1.
niveaux du Bronze ; fig. 11, vue vers l’ouest du mur nord de la pièce 1 et la jarre-foyer tandour de l’extérieur nord de cette pièce.384 La technique de consolidation des parties inférieures, principalement des murs, par briques de chant s’observe dans la ville d’aï Khanoum à la dernière période de l’occupation grecque, au sanctuaire principal et à la maison du quartier sud-ouest.
AK IX.indb 166 03/06/13 11:19
167HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
au nord de la pièce 1, l’irrégularité de la surface du sol, fait de décombres d’argile, ainsi que l’absence de toute face nette du mur montrent que nous sommes à l’extérieur des locaux. Le sol, épais d’une vingtaine de centimètres, est percé de deux grands trous. L’un est une jarre-foyer tandour de 0,60 m de diamètre, fichée dans le sol et dont seul le col dépassait. L’autre est un silo profond de 1,10 m, long de 2,06 m et large de plus de 1,06 m ; comme il n’a pas été fouillé en totalité, sa capacité n’est pas connue, mais elle devait être comprise entre 2448 (minimum observé) et 4000 litres (s’il était de forme carrée). Ces installations sont datées de l’époque du fonctionnement du dernier état de la ferme. Un fragment de meule et un lot d’une vingtaine de pesons d’argile rouge (dont deux en tronc de pyramide) complètent le mobilier de cette zone à fonction domestique.
À l’ouest de la pièce 1, nous nous trouvons à l’extérieur du manoir, presque sur la pente de la terrasse naturelle autrefois occupée par les Harappéens, si bien que les quatre sols gréco-bactriens présentent tous un pendage est-ouest et viennent s’accoler à deux murets construits dans un état ancien de la ferme (pl. xL 2). Le premier, d’orientation nord-sud, est épais de 0,80 m à la base ; le second, est-ouest, est aussi en terre et large de 0,60 m à la base ; tous deux sont conservés sur 0,50 m de hauteur. Le premier sol de la succession stratigraphique est épais de 10 cm et l’on y a découvert un tesson de cratère à motif appliqué 385 ainsi qu’un fragment de figurine féminine ; le deuxième, épais de 20 cm, s’appuie sur le mur ancien nord-sud et passe sous la fondation du mur ouest de la pièce 1 ; le troisième sol, plus récent, raccorde en stratigraphie le sommet du muret ancien à la base du mur ouest de la pièce 1 ; le dernier de ces quatre sols rejoint très précisément le niveau du sol intérieur de la pièce 1. au-dessus de ce dernier s’amoncelaient les décombres de l’écroulement des briques du mur ouest de la pièce 1. Cette stratigraphie, comme la succession des deux silos et l’agencement des murs de la pièce 1, indique au moins deux phases de construc-tion et de fonctionnement de cet établissement. on note un autre foyer tandour à l’extérieur sud-ouest de la pièce 1.
au sud de la pièce 1, un mur de direction nord-sud est construit dans l’alignement approxi-matif de son mur ouest. Les épaississements et réparations portent son épaisseur à 1,70 m. il est percé d’une porte large de 1 m dont les montants de bois, des rondins de 10-12 cm de diamètre, étaient calés dans du torchis qui en porte encore l’empreinte. Cet espace était sans doute une cour, comme le montrent la nature des sols, mal construits, la présence d’une grande fosse T 4.
385 Dessiné dans mon journal de fouille de 1976 ; dans le rapport céramique ci-dessous (dans la catégorie D), ce tesson est mentionné comme « dont un avec motif appliqué » (Gardin 1973, pl. 145, fig. 18), mais sans indica-tion de sa couche de provenance ; sur ce type de cratère, voir Lyonnet 1997, type o2-5, p. 134 et fig. 42 n° 12 : il apparaîtrait « à partir de la période iV » de la typo-chronologie d’aï Khanoum (1978, inédite ; voir le tableau dans Lyonnet 1998, p. 144-146). B. Lyonnet mentionne dans son ouvrage (Lyonnet 1997, p. 148, n. 212), à propos de shortughaï hellénistique : « Pour le T. 209 nous ne disposons que de tessons d’un sondage, sans indications de différents niveaux, ce qui ne permet aucune précision autre que post-iV. » Pourtant, toutes les provenances exactes avaient été portées par les fouilleurs (nous) sur les lots de tessons gréco-bactriens remis aux céramologues. C’est de propos délibéré que J.-Cl. Gardin et B. Lyonnet (rapport dactylographié de 1976, voir ci-dessous) précisent que « les indications de couches portées sur les tessons n’ont pas été prises en compte dans la description ni dans le commentaire ci-dessous, en raison de l’homogénéité du matériel (établie par comparaison avec la céramique hellénistique d’aï Khanoum) ». Les couches de l’ouest de la pièce 1, fouillées en 1976, ont fourni la meilleure stratigraphie ; ailleurs, aucun niveau gréco-bactrien ancien (antérieur à l’unique état visible) n’a été observé sous l’occupation principale (voir texte). Toute la poterie hellénistique des campagnes de 1978 et 1979 a été recueil-lie avec soin et rassemblée avec celle d’aï Khanoum, mais elle n’a jamais pu être étudiée. Pour la chronologie de shortughaï, cela ne change rien à la date probable de l’installation de cette ferme dans cette partie de la plaine à partir de la période IV de la chronologie de la cité (voir infra p. 175 les dates de B. Lyonnet dans ce volume).
AK IX.indb 167 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT168
Cette conclusion est renforcée par T 5, une fosse vaste mais peu profonde remplie d’argile, de sable et de traces de coulures (comme une fosse de construction), qui contenait aussi un dépôt de poteries grecques (dont des bols à pieds annulaires en poterie noire entiers et intacts ; pl. xLi 4) et une omoplate de chameau. Contre la face sud (extérieure) du mur sud de la pièce 1, deux foyers successifs, séparés par une couche de 10 cm de terre, viennent corroborer l’hypothèse d’une cour fermée.
b - Les pièces 2, 3 et leurs alentours (pl. xL 3)La pièce 2, située à l’est de la pièce 1, mesure 4,10 × 4,40 m. ses murs, construits en briques
crues, sont épais de 0,90 à 1,30 m et revêtus de torchis. Comme on l’a vu plus haut, elle com-munique avec la pièce 1, mais elle s’ouvre aussi vers le nord par un passage large de 1,20 m. À l’est, la porte de communication avec la pièce 3, dont les parements étaient enduits de torchis, a été à un moment bouchée par une grossière maçonnerie de terre et de fragments d’argile retenus par deux écrans de briques posées sur chant. Un foyer monumental à niche parabolique (F 1) est adossé au mur nord de la pièce, à l’ouest de sa porte nord (pl. xL 4). Ce foyer repose directement sur le sol de la pièce, qui a été maçonné en argile après l’édification des murs contre lesquels il vient buter. il est adossé à une dalle verticale épaisse d’environ 10 cm accolée à l’enduit de torchis du mur et repose sur un socle épais d’une dizaine de centimètres, large de 1,10 m, saillant de 0,70 m du mur ; le foyer proprement dit possède une ouverture de 0,60 m. L’ensemble est enduit de torchis ; une réfection ultérieure des enduits a enveloppé ce foyer. Dans cette pièce, la fouille de la couche d’occupation a mis au jour des meules, des broyeurs et des pesons, témoins d’une activité domestique. Une lampe et une crapaudine, sans doute celle de la porte bouchée, furent découvertes dans le mur est.
La pièce 3, placée à l’est de 2, mesure 4,40 m d’est en ouest. sa limite nord n’est pas connue. ses murs sud et est ne mesurent pas plus de 0,80 m d’épaisseur ; ils sont érodés au point que l’angle sud-est de ce local est ouvert. L’élément le plus remarquable de cette pièce est le foyer à niche parabolique (F 2) qui est accoté au mur ouest (pl. xLi 1). il est posé sur un socle rectan-gulaire (1,40 × 0,90 m ; ép. 10 cm) qui supporte également une petite annexe large de 20 cm. Ce foyer, enduit de torchis, n’est pas directement appuyé contre le mur, dont il est séparé de quelques centimètres, mais il possède trois couches de torchis superposées portant du noir de suie. À gauche du foyer, dans l’angle sud-ouest de la pièce, une dépression (T 3) contenait un silo circulaire de 0,50 m de diamètre enduit de torchis, conservé sur une faible profondeur. Dans tout le quart sud-est de ce local, une grande quantité de vaisselle a été trouvée sur le sol, dont des tessons de jarre (pl. xLi 3). Une jarre en place subsistait au nord-est de la pièce. Des pesons et une lampe complètent les restes du mobilier de la pièce 3.
au nord des pièces 2-3, une zone difficile à comprendre, faite de couches d’argile indistinctes et bosselées, n’a laissé apparaître qu’un foyer dans le front de fouille nord. seule une extension de la fouille dans cette direction permettrait de comprendre cette région.
au sud des pièces 2-3 s’ouvre une zone extérieure caractérisée par l’érosion des parements des murs, mais aussi par les couches de sols qui sont de typiques feuilletés de surfaces exposées aux éléments et au piétinement. on a dénombré jusqu’à dix-sept couches de cette nature, pratique-ment sans matériel, qui peuvent être rattachées à la période gréco-bactrienne et qui surmontent les couches de la période finale de l’âge du Bronze dans cette région. Cette formation s’étend aussi à l’est sur la distance de 4 m qui sépare les pièces principales de l’annexe 4.
AK IX.indb 168 03/06/13 11:19
169HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
c - La pièce 4 et ses alentoursL’ensemble ainsi dénommé est séparé du corps principal des bâtiments et constitue une res-
serre, grenier ou cellier, dont seuls deux murs sont nettement conservés, ainsi que des alignements de trous et de jarres. Deux murs parallèles est-ouest, épais de 0,50 à 1 m, délimitent un espace rectangulaire large de 2,50 m qui paraît se fermer à l’est en partie sous le front d’arrêt de la fouille et moins nettement à l’ouest, à environ 7 m de distance, dans des amoncellements d’argile.
on distingue trois groupes de jarres (J 1 à 5) et de trous (T 1 à 6). au nord, le long du mur, s’alignent une jarre et quatre fosses circulaires de 0,40 à 0,60 m de diamètre. L’une de ces fosses contenait un lot de douze pesons d’argile. À l’est, deux jarres sont calées par une sommaire maçonnerie d’argile. au sud-ouest, au sud du mur, ce sont trois jarres et trois fosses circulaires analogues aux précédentes qui forment un alignement. Dans l’axe du mur, une fosse oblongue de 180 × 100 cm contenait un énigmatique assemblage calé par de la terre, qui se composait d’une grande jarre entière intacte (vide) et de quatre briques crues (41 × 41 × 10 cm) inclinées (pl. xLi 2). Dans cette partie de la fouille, un lot de sept pesons et un fragment de broyeur ont également été retrouvés.
au sud et sud-est, deux petites fosses piriformes profondes de 10 cm restent sans explication. Pour le reste, cette zone est également faite de feuilletés dont le pendage, vers le sud, conduit à la pente naturelle de la terrasse, là où coulait le petit fossé d’irrigation hellénistique.
Conclusion sur la stratigraphie et l’architecture (fig. 71 a)Le manoir de shortughaï, construit pendant la période iV d’aï Khanoum, comprend deux
étapes de développement : un premier état dont nous connaissons quelques murs en pisé et sols en argile, et un second état tel que nous le livre la fouille. Nous ne connaissons pas l’intégralité de son plan, mais, d’après le relief de la butte 209, le corps de bâtiment principal devait mesurer approximativement 20 × 20 m. si l’on ajoute la dépression quadrangulaire qui apparaît sur le plan au nord des constructions, que nous pouvons par hypothèse considérer comme une cour, nous retrouvons le module usuel de l’habitat gréco-bactrien, palatial et analogue au plan de la maison du quartier sud-ouest (voir dans ce volume). Cependant, à shortughaï, l’agencement des pièces est très différent, sans parallèle pour ce que nous en connaissons. on remarque encore que les foyers monumentaux à niches (à l’intérieur des pièces) fonctionnent à la même époque que les jarres-foyers tandour placées dans les murs extérieurs, indiquant peut-être un chauffage hiver-nal et des modes culinaires alternatifs ou des déplacements saisonniers pour la préparation de la nourriture 386. mais le plus frappant est la capacité de stockage de cette ferme, qui est répartie en deux endroits. D’abord, loin du centre, la pièce 4 et ses alentours, avec des jarres, sont un cellier dont le contenu précis est inconnu. Peut-on cependant, malgré le peu de vestiges, suggérer que la grande jarre intacte dans son trou, où elle voisine avec une pile de briques, pourrait faire songer à un rustique pressoir à huile ou à vin 387 ? ensuite, au centre, ce sont les deux silos successifs, creu-sés et enduits, dont la capacité peut être estimée successivement entre 2 500 et 4 000 litres (celui
386 sur la fonction des installations et les rotations saisonnières dans l’habitat traditionnel des ouigours de la vallée de la Keriya au xinjiang (Chine), voir Fournet 2001.387 Pour des pressoirs à vin et des installations vinicoles assurés en asie centrale, à Dal’verzin Tépa à l’époque kouchane, voir Pugachenkova, rtveladze et Turgunov 1978, p. 171-172, fig. 117-118 ; dans la première moitié du ve siècle av. n. è., à Dingil’dzhe en Chorasmie : Vorob’eva 1973, p. 16, p. 208 et fig. 28, p. 82, indique que la pièce 18 pourrait être un pressoir accompagné d’une réserve. Voir aussi abdullaev 2005, p. 229, n. 5, pour des installations moins nettes ou plus récentes.
AK IX.indb 169 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT170
du tépé 97 contenait environ 3 000 l). si l’on estime que 1 m3 correspond approximativement à 600 kg de blé, les silos contenaient entre 1 500 et 2 400 kg. Comme on évalue généralement le rendement traditionnel en culture irriguée entre 1 400 et 2 300 kg par hectare, la capacité de stockage des silos pourrait correspondre à la production d’une superficie d’un hectare 388. Nous reviendrons plus bas sur les problèmes que posent les structures de stockage pour la mise en valeur et l’occupation de la plaine.
Les trouvailles
Nous avons publié dans le rapport de fouille les découvertes protohistoriques provenant des couches gréco-bactriennes suite à des remaniements et remontées de matériel, ordinaires dans les tépés d’orient. seules les trouvailles qui sont nettement grecques sont mentionnées ici (fig. 70).
La céramique forme le gros des découvertes. il s’agit de poterie rouge ou noire, souvent trou-vée en lots là où elle avait été abandonnée : jarres de stockage parfois en place et vaisselle de table (bols, assiettes, cruches ; pl. xLi 3-4). Les habitants des fermes se fournissaient aux mêmes ate-liers que ceux de la cité. La céramique grossière et noire de suie, dite « de cuisine » est également présente en quantité dans toutes les pièces de la ferme 389.
Puis viennent les pesons d’argile, soit en tronc de pyramide, soit ellipsoïdaux, dont la collection s’élève à une cinquantaine de spécimens (pl. xLii 1) 390. Lorsqu’ils sont trouvés en lots, comme au nord de la pièce 1 ou vers la pièce 4, ils peuvent indiquer, comme dans la cité, la présence de métiers à tisser, donc d’un artisanat domestique qui, en zone rurale, bénéficie de la présence de troupeaux d’ovins laineux. L’ubiquité des pesons indique tout de même que les métiers pouvaient être déplacés selon les besoins et les saisons. Cependant, l’on ne note que deux fusaïoles attestant une activité de filage plus diffuse, qui pouvait se pratiquer partout.
Les meules, broyeurs et égrugeoirs, comme dans la cité, se retrouvent un peu partout, très souvent sous forme de fragments, une quarantaine en tout 391. Parmi les plus gros, trouvés sur les sols d’occupation, il faut mentionner ceux de la pièce 1 et des endroits au nord de celle-ci, signalés pour les silos à grains qui s’y trouvent. Pourtant, les pièces 2 et 3 en ont également livré. L’absence des grosses meules à trémie est notable (pl. xLii 2) ; celles-ci sont caractéristiques de la meunerie urbaine d’aï Khanoum, et notamment de celle du temple, qui n’en contenait pas moins de neuf à l’époque de sa réutilisation comme magasin à céréales, à la fin de la période grecque 392. Cette différence nous conduit à distinguer une meunerie domestique dans les fermes
388 Les estimations qui précèdent reposent sur les enquêtes effectuées par P. Gentelle et m. reut sur l’agriculture traditionnelle de la plaine d’aï Khanoum : voir Gentelle 1978, p. 49-51.389 Voir ci-dessous. L’idée que les lots laissés au sol indiqueraient un abandon soudain de ce manoir est recevable mais non démontrable. Les fouilles des niveaux d’abandon de maisons à Takht-i sangin, sans plans publiés à l’heure actuelle, offrent un aspect analogue : Druzhinina 2012.390 Pour ces types de pesons de tisserand en argile fine crue, voir Francfort 1984, p. 45 et pl. 18, nos 6 et 17, pl. xViii iV ; Guillaume et rougeulle 1987, pl. xi 1-2.391 Pour ces objets, voir Francfort 1984, p. 85-86 (type i et ii), pl. 30 et pl. xxxViii ; Guillaume et rougeulle 1987, pl. ix 16-17.392 sur les meules à trémie, voir Bernard 1969, p. 352-353. Ces ustensiles typiquement grecs sont nettement moins maniables que les égrugeoirs que l’on trouve ici. Pour ces meules, voir aussi Francfort 1984, p. 85-87, pl. 30 iV et pl. xxxViii iV, avec les références auxquelles on ajoutera Pulak, Townsend, Koehler et Wallace 1987, p. 41-42, et White 1963, p. 202, pour ces « hopper-rubber ». Une semblable meule, qui n’apparaît pas dans les publications de marshall, a été vue et photographiée par moi-même en 1970 dans la ville indo-parthe et indo-scythe de sirkap, à
AK IX.indb 170 03/06/13 11:19
171HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
(et les maisons ?) et une meunerie « industrielle » dans la cité, cette dernière devant être mise en relation nécessairement avec des moyens et une capacité de stockage « collective » ou « éta-tique » 393. L’absence de silos dans la cité doit donc logiquement correspondre à l’existence de greniers que la fouille n’a pas mis en évidence, mais qui devraient ressembler à ceux qui ont été trouvés à afrasiab hellénistique 394. La seule exception est celle du temple qui donne, avec ses jarres et ses meules, à la dernière période où il est supposé être désacralisé 395, l’image d’un grenier équipé pour une collectivité dont la nature nous échappe.
Deux lampes à tenon en queue d’aronde, type connu en ville, font également partie du mobilier de ce manoir ; toutes deux ont été trouvées dans la maçonnerie de murs (mur nord de la pièce 1 et mur est de la pièce 2 396 ; pl. xLii 3 et xLiii 1). on en conclut qu’elles devaient être rangées dans des niches ou recoins de la maçonnerie et non nécessairement qu’elles appar-tiennent à un état ancien du manoir.
Le couvercle de pyxide de schiste découvert en 1976 est très bombé, ses bords ont disparu, son bouton de préhension est très peu saillant (pl. xLiii 2). son décor se compose d’une cou-ronne incisée autour du bouton et d’une alternance de trois rainures rayonnantes et de trois rosettes à quatre pétales pour incrustations. Ce type d’objet est bien connu dans la ville, où un analogue parfait a été découvert 397.
Un fragment de figurine de bélier évoque très simplement l’élevage ovin ainsi que l’artisanat lainier (pl. xLiii 3).
La figurine féminine de terre cuite fragmentaire, vêtue de chiton et himation et portant une ceinture, ressemble à celles de la ville d’aï Khanoum (pl. xLiii 4) 398.
Le mobilier trouvé au manoir hellénistique de shortughaï concorde parfaitement avec les trouvailles de la cité d’aï Khanoum. on remarque pourtant la faible présence des objets métalliques (quelques fragments, un crochet, une coupelle, deux lames de couteaux en fer), et notamment agricoles comme les faucilles 399, alors que la ville en a donné (pl. xLiii 5). il est donc à supposer que le métal a été en grande partie récupéré.
Taxila, près du « sanctuaire à l’aigle bicéphale », mais aucune n’a jamais été signalée, à ma connaissance, dans l’asie centrale kouchane (pl. xLii 2). sur la différence probable entre la mouture féminine domestique et la meunerie « industrielle », qui pourrait être masculine et même le fait d’esclaves (?), voir Francfort 1984, p. 87, et la note suivante. Une certaine force était nécessaire pour utiliser ces lourdes meules à trémie, malaisées à tailler dans le grès de rustaq.393 en outre, me rappelle P. Bernard, des meules à trémie se rencontrent dans des maisons de Délos ou d’olynthe, où des esclaves devaient les actionner.394 Voir n. 417.395 six meules à trémie dans le temple lui-même et trois dans les locaux du sanctuaire. aucune meule à trémie n’est publiée par o. Guillaume et a. rougeulle ni par Cl. rapin, ce qui renforce le caractère singulier de la meunerie du temple. Cette remarque est à nuancer, car P. Bernard veut bien m’indiquer que dans le bâtiment du quartier sud-est, on compte « plusieurs meules à trémie dont l’une a été trouvée en place sur son dormant », qui n’avaient pas été publiées jusqu’ici (voir G. Lecuyot ce volume, p. 98, fig. 35, pièce 7, pl. XXI, 4.3).396 Voir Gardin 1973, p. 165-166, pl. 124, e-g ; seul le type f se rapproche quelque peu de celles de shortughaï dont le bec est très fin (voir aussi ci-dessous « céramique », catégorie K).397 Francfort 1984, p. 23, pl. xi n° 4 (0.1127), provenant de la zone sud du sanctuaire du temple principal.398 Par exemple Francfort 1984, pl. 16 n° 10.399 Les deux fragments de lames de couteaux trouvés sur le site sont comme les lames des couteaux de la cité : Francfort 1984, p. 67, pl. 25 et pl. xxx 8, p. 65 ; Guillaume et rougeulle 1987, p. 43-44. Ces lames de couteaux ne ressemblent nullement aux faucilles pourtant bien connues à aï Kanoum : voir Guillaume et rougeulle 1987, p. 35-36, pl. ix 8
AK IX.indb 171 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT172
Les restes osseux de faune remarqués dans le matériel hellénistique de shortughaï com-prennent : le chameau (omoplate dans un trou), le cheval (os), les suidés (os), le chien (crottes dans le silo de la pièce 1). ovins, caprins et bovins sont évidents. on note aussi des os d’ani-maux sauvages de datation difficile, qui appartiennent aux couches mêlées de la transition entre la fin du Bronze et le début de l’installation grecque : hémione, mouflon urial, chèvre aegagre, gazelle 400.
Les plantes cultivées du niveau hellénistique, pour leur part, n’ont pas fait l’objet d’une col-lecte spécifique, celle-ci s’étant concentrée sur les précieux niveaux protohistoriques, harappéens en l’occurrence 401.
La céramique du niveau hellénistique 402
Origine : sondage sud seulement [remarque 2009 : selon la dénomination de 1976 ; ici, sur le plan fig . 70 A, il s’agit des carrés A2 et A2W]. Les indications de couches portées sur les tessons n’ont pas été prises en compte dans la description ni dans le commentaire ci-dessous, en raison de l’homogénéité du matériel (établie par comparaison avec la céramique hellénistique d’aï Khanoum).
Description : par référence à la classification publiée par Gardin 1973, p. 121-188 (abrégé ci-dessous AK). Les séries ou types déjà définis dans cette publication ne sont pas décrits une nouvelle fois, mais seulement mentionnés sous le nom et sous le symbole utilisés dans AK ; seuls sont mentionnés les genres ou les traits distinctifs originaux par rapport à cette présentation.
i. Céramique gris-noir (AK p. 127 et suiv.)a. assiettes o1, AK p. 128-129a. lèvre droite o1-d [o1-d1] : 1 tesson, intérieur poli brillantb. lèvre à renflement interne o1-r1, 2 [idem] : 5 tessons
B. Bols o2, AK p. 130-152a. lèvre droite, terminaison arrondie o2-d1 [o2-d2], ou légèrement éversée o2-s1 [également
o2-d2] : 29 tessons, dont 2 avec fond en disque et 1 avec fond annulaire (sur la morphologie des fonds o1 ou o2, voir AK p. 196)
b. lèvre droite, terminaison amincie, pointue o2-d2 [o2-d3] : 1 tesson, intérieur poli brillantc. lèvre éversée, dévers marqué o2-s2 [o2-s1] : 3 tessons
(avec des numéros ne correspondant à aucune pièce précise). six exemplaires ont été trouvés au temple (Francfort 1984, p. 67, pl. 24 nos 15, 20, pl. xxx 16-18), ce qui confirmerait sa vocation agricole à la dernière période.400 Voir J. Desse dans Francfort 1989, p. 187-206, notamment p. 191 (suidés, cheval), et les tableaux nos 68 à 70 (mammifères sauvages). seuls les vestiges fauniques datables du Bronze avaient été apportés en France pour étude ; ceux des niveaux hellénistiques avaient été en majorité entreposés dans la maison de fouille d’aï Khanoum, qui a été pillée.401 G. Willcox avait monté en 1978 une installation de flottation de terrain à l’aide de bidons et de l’eau prise dans le Pandj, à 5 km, et apportée en jeep ; le travail considérable effectué sur les couches protohistoriques ne permettait pas que l’on portât aux niveaux gréco-bactriens la même attention, car ils étaient parfaitement représentés dans la ville : voir G. Willcox dans Francfort 1989, p. 176-185.402 Cette partie reproduit intégralement une brève étude effectuée à aï Khanoum dès l’automne 1976 par J.-Cl. Gardin et B. Lyonnet. [Les notations de types et les remarques en italiques et entre crochets sont les équivalences avec la typologie et la chronologie récentes, mises à jour par B. Lyonnet en février 2006 et pour ce volume.]
AK IX.indb 172 03/06/13 11:19
173HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
d. lèvre rentrante o2-r [idem] : 1 tessonFonds d’assiettes ou de bols (AK p. 196) en disque, avec cercle incisé sur la face interne du
fond : 5 tessonsParticularités : un fragment d’assiette ou de bol épais, grand diamètre (sup. ou égal à 30 cm),
caractéristique de la phase finale d’aï Khanoum (voir plus bas §3).
C. Cruchons f3 [f2 ou f3], AK p. 132 : 2 tessons, dont un avec moulure à la liaison du col et de l’épaule
ii. Céramique blanche ou rouge (AK p. 155 et suiv.)(avec toutes les variations de couleur entre le blanc-gris ou rosé et le rouge-brique ou orangé
dans la plupart des séries, sauf indications contraires données dans AK ou dans la description qui suit.)
a. assiettes à lèvre saillante o1-s, AK p. 136-137a. lèvre pendante o1-s1 [idem] : 1 tessonb. lèvre rabattue o1-s2 [o1-s2/1] : 5 tessonsc. lèvre à bourrelet triangulaire o1-s3 [o1-s3/2] : 2 tessonsd. lèvre épaissie o1-s4 [soit o1-s3/1 soit o1-d3/1] : 3 tessons, dont un avec fond plat, cercle
incisé sur la face interne du fond
B. Bols o2, AK p. 138-141a. lèvre droite ou légèrement éversée o2-d1/s1 [o2-d2] : 25 tessons, dont un avec terminaison
de la lèvre amincieb. lèvre effilée o2-d2 [o2-d4] : 30 tessons, rouges, dont un avec un léger renflement intérieur
le long du bord [o2-d4/2]c. lèvre éversée o2-s2 [o2-s1] : 8 tessons, dont 2 rougesd. lèvre infléchie vasque évasée o2-r1 [idem] (le trait « terminaison plane » est à retirer de la
définition donnée dans AK p. 141) : 4 tessonse. lèvre rentrante o2-r2 [idem] : 4 tessons, dont un avec fond platf. vasque relevée, lèvre droite, terminaison plate (série nouvelle, symbole o2-t2 [idem]) :
16 tessons
Fonds d’assiettes ou de bols, groupes a et B ci-dessus (AK p. 196)
Forme Face intérieure Nombreplat unie 24
cercle incisé 2dépression 1
disque unie 5cercle incisé 5
annulaire unie 4cercle incisé 4
C. Gobelets o3, AK p. 141-143a. paroi sans ressaut o3-1 [o3-2]: 8 tessons
AK IX.indb 173 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT174
b. paroi carénée, avec ressaut o3-2 [o3-4] : 1 tesson, rouge
Tessons pouvant appartenir aux séries a ou b
bords 21 tessonspied en disque 1 tessonpied annulaire 2 tessons
D. Cratères o4, AK p. 145-146 : 4 tessons, rouges, dont un avec motif appliqué (AK p. 145, fig. 18) ; 1 tesson blanc appartenant à un genre de cratère non défini dans AK, paroi convexe, lèvre éversée avec face sup. plate [O4-2](cf. AK p. 146, fig. 19c)
e. Terrines o2, AK p. 152-154a. lèvre à bourrelet peu épais [O2-4/1] (AK p. 154, fig. 24, forme 3) : 2 tessonsb. lèvre rabattue [O2-4/4] (AK, loc . cit., forme 6) : 1 tessonc. lèvre horizontale (AK, loc . cit., forme 8), peu saillante [O2-6/1] : 2 tessons ; saillante [O2-
6/2] : 5 tessons
F. Grandes jarres F1, lèvre épaisse avec flanc mouluré [F1-4/1 ou F1-6/2] (AK p. 155, fig. 25, forme 2) : 6 tessons
G. Jarres F2, AK p. 156-158a. lèvre épaissie, méplat latéral allongé [F2-2] (AK p. 157, fig. 26, forme 1, 2 a) : 1 tessonb. lèvre équarrie [F2-5] (AK, loc . cit., forme 5) : 5 tessonsc. lèvre éversée [F2-7] (AK, loc . cit ., forme 6a), avec face interne de la lèvre concave (nouvelle
série, symbole f1-5) : 3 tessons, rougeâtresParticularité : un tesson appartenant à une jarre façonnée [F2-h] (i .e. non tournée), lèvre
éversée.
H. Cruches F4, lèvre avec bourrelet externe marqué [F4-8] (AK p. 159, fig. 27, forme 4a) : 1 tesson
i. amphores F5, [F3], AK p. 161-162 : 2 tessons
Tessons pouvant appartenir à des cruches ou à des amphores (groupes H et i ci-dessus) :anses plates concaves : 4 tessonsLiaison col/épaule : unie, courbe : 2 tessons
avec ressaut : 2 tessons avec moulure : 1 tesson avec sillon incisé : 7 tessons
Fonds : plats : 15 tessonsdisques : 5 tessonsannulaires : 2 tessons (probablement amphores)
J. Gourdes F6 [F5], avec tenon percé (AK p. 164-165), engobe brun : 1 tesson
K. Lampes à bec latéral rapporté, tenon de préhension (AK p. 145) : 1 tesson
AK IX.indb 174 03/06/13 11:19
175HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
iii. Céramique grossièreChaudrons de cuisine, lèvre droite ou légèrement inversée [G1, G2] (AK, p. 175) : 12 tessons
Commentaire : l’intérêt de l’assemblage ci-dessus est double. il donne une idée du genre de vaisselle courante 403 utilisé dans les établissements de la campagne d’aï Khanoum à l’époque hellénistique, en même temps qu’il fournit des indications sur la date de ces établissements.
sur le premier plan, il suffit de souligner la diversité relative du matériel, qui contraste avec la monotonie de la vaisselle utilisée dans les établissements ruraux de la même région à l’époque achéménide ou à l’époque kouchane 404. sans doute cette observation n’est-elle pas absolument généralisable : tous les établissements gréco-bactriens de la campagne ne manifestent peut-être pas la même diversité. Notons cependant que l’importance relative de l’habitat hellénistique sur le tépé 209, telle qu’on peut se la figurer par le nombre des tessons de surface, est en gros com-parable à celle de la plupart des autres sites ruraux de la même époque repérés dans la plaine d’aï Khanoum, au nombre d’une centaine.
reste l’interprétation chronologique. L’évolution de la céramique recueillie dans les diffé-rents monuments d’aï Khanoum est maintenant connue dans ses grandes lignes 405, et l’on est en mesure de préciser dans certaines limites la date des assemblages de tessons que l’on a recueillis à la surface des sites de la plaine, comme aussi dans ce premier sondage pratiqué sur l’un d’entre eux. D’une manière générale, il ne semble pas que la mise (ou remise) en valeur de la plaine par les maîtres d’aï Khanoum ait commencé avant la période 5 [IV dans le tableau de 1978] définie dans ce schéma évolutif, c’est-à-dire avant 275 av. n. è. [d’après les dernières conclusions de P . Bernard et de moi même, pas avant Antiochos Ier ou II en tout cas], à quelque dix ou vingt [ans] près 406. L’assemblage grec du tépé 209 confirme cette impression : il ne contient aucun des types de céramique particuliers aux périodes 1 ou 2 [I à III] avant cette date. inversement, les types des périodes tardives y sont représentés : ainsi l’assiette ou le bol épais à grand diamètre mentionné plus haut sous le § B, ou encore la jarre façonnée citée sous le § G, auxquels il faut ajouter un pot façonné en pâte grossière caractéristique de l’époque où les envahisseurs de la Bactriane s’établissent sur les fermes et les hameaux grecs de la plaine d’aï Khanoum, après la destruction de la ville 407. C’est donc entre 275 [un peu plus tard probablement, désormais 200]et 150 av. n. è. approximativement [jusqu’à 130 env . ?], qu’il faut placer la période de vie du tépé 209 sous la domination gréco-bactrienne.
403 rappelons en effet que toutes les séries ci-dessus sont abondamment représentées dans la ville d’aï Khanoum, où elles constituaient à n’en pas douter une vaisselle d’usage quotidien pour toutes les fonctions courantes telles que le stockage (ex. séries D, F), le transport (ex. séries G à J), la cuisine (ex. série e, genre iii), la consommation (ex. séries a, B, etc.).404 Cette constatation s’appuie sur la comparaison du matériel recueilli à la surface de quelque 500 sites d’époque achéménide, hellénistique et kouchane dans la plaine d’aï Khanoum, où l’on décèle la même diversité relative de la vaisselle courante pendant l’épisode gréco-bactrien par rapport aux époques qui l’encadrent dans le temps. Publication du matériel en préparation.405 Pour un premier aperçu de cette chronologie, voir Gardin 1971, p. 452 ; Gardin et Lyonnet 1976 ; plus récemment, Lyonnet 1998, avec tableau typo-chronologique de la poterie d’aï Khanoum, p. 144-146. Voir également le chapitre 8 du présent volume : B. Lyonnet date maintenant la période IV du site à partir de 200. 406 Gardin 1971 ; Gardin et Lyonnet 1976 ; Lyonnet 1998.407 Gardin et Gentelle 1976, p. 85.
AK IX.indb 175 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT176
Habitat rural et exploitation agricole de la plaine
Les informations collectées lors des sondages et des fouilles effectués sur les quatre sites décrits offrent un panorama qui touche aux périodes perse (sites 111 et 106) et kouchane (sites 97 et 106), et qui embrasse pour la période hellénistique trois établissements ou occupations de nature et d’importance différentes (sites 97, 111 et 209) : une tombe sur la butte 111, une petite ferme à la butte 97 et un petit manoir à shortughaï (fig. 66). mais ces informations, si détaillées qu’elles puissent paraître, ne sont que peu de chose en regard de la richesse que montrait cette plaine et des multiples excavations précises et détaillées que telle ou telle question eût mérité que l’on effectuât en un point ou l’autre du domaine, pour une période ou une autre.
Pour la période perse, bien représentée dans la plaine par la poterie et les points de collecte de la prospection, datant les périodes d’activité des canaux, les sondages ont été peu productifs. Un peu de poterie et des restes d’installations sommaires sont les seuls vestiges reconnus. il est intéressant, en revanche, d’observer que l’occupation grecque ne prolonge ou ne continue guère celle des perses, mais semble tout reprendre à neuf. Cette conclusion serait osée si nous ne dis-posions que des antiquités de la plaine, mais elle peut s’appuyer aussi sur les fouilles de la cité où la présence grecque laisse mal discerner une occupation perse pourtant indubitable 408. Ce n’est pas l’ampleur de l’emprise sur la plaine par les occupants pré-grecs qui est ici en cause, mais la densité et la monumentalité de leur mode d’installation. Celui-ci semble évoluer d’un mode pré-hellénistique de peuplement large et espacé, fait de constructions légères, à un maillage gréco-bactrien serré et régulier 409, composé de constructions plus monumentales placées dans la périphérie et la chora d’une authentique polis, royale qui plus est 410.
La sépulture en jarre gréco-bactrienne de Zulm est d’un grand intérêt car elle montre une coutume funéraire que l’on ne peut manquer de rapprocher de celles des peuples des steppes,
408 Leriche 1986 pose bien ce problème à partir des niveaux du rempart de la citadelle et des bases de colonnes de type achéménide de la ville. Lyonnet 1997, p. 147-155 ; Gardin 1998, p. 112-114, 125 et suiv., 162 et cartes 3.9 et 3.10, commentent la phase de peuplement hellénistique des plaines de Bactriane orientale dans un contexte géographique et chronologique plus large. Beaucoup plus de poteries de la période allant du Bronze final et début du Fer aux achéménides (P) que de tessons grecs (G) ont été collectés par la prospection (dans son ensemble), mais ils proviennent d’un nombre plus restreint de sites et d’une surface irriguée moins grande. Dans la plaine d’aï Khanoum, aucune ville ne date de cette époque. Kohna Qala est une simple forteresse gardant un passage sur le Pandj et aï Khanoum n’est pas une véritable ville avant l’installation des Grecs.409 Gardin 1998, légende de la fig. 3.10 : « L’aire d’habitat la plus importante, a, entoure le site d’aï Khanoum. Les autres s’échelonnent comme à l’époque P le long des canaux, maintenant au nombre de trois (addition de aK 1) ; mais les fermes isolées se multiplient, donnant l’image d’un peuplement à la fois plus dense et plus également réparti. » Voir aussi fig. 3.4 : « les abords du site hellénistique d'Aï Khanoum.» 410 Le caractère peu impressionnant des monuments perses de la plaine nous renvoie à une observation faite à maintes reprises sur les sites « achéménides » d’asie centrale qui sont aujourd’hui accessibles sur toute leur superficie (ce qui n’est pas le cas des grandes capitales, où les couches de cette époque sont profondément enfouies). on y reconnaît les fortifications et quelques édifices monumentaux (palatiaux ou parfois religieux) qui seuls émergent, laissant de très grandes surfaces des établissements peu et modestement bâties comme des zones qui auraient été vides ou faiblement occupées. Par exemple, observations au Khorezm de s. P. Tolstov, à Kalaly-Gyr et Kjuzeli-Gyr (il pensait que la population habitait les remparts) ; en Bactriane ouzbèque de e. rtveladze et collègues, à Bandykhan-Tépé, à Kyzyl-Tépé, de shajdullaev à Talashkan-Tépé ; en sogdiane de Cl. rapin, à Koktepe ; en Bactriane afghane de r. Besenval, à altyn-Dilyar, et maintenant Cheshme-shafa, etc.
AK IX.indb 176 03/06/13 11:19
177HaBiTaT rUraL DaNs La PLaiNe D’aï KHaNoUm-sHorTUGHaï
de la Bactriane du nord et du xinjiang, et, par conséquent, de ceux qui, venant de l’orient, ont précipité la chute et la fuite des Grecs de Bactriane, la fin d’aï Khanoum vers 145 av. n. è. 411.
La période kouchane, vue par ces quelques sondages, n’apparaît que comme une réoccupa-tion rurale tardive (hephtalite) de la butte 106, qui avait été abandonnée longtemps auparavant par les Perses.
La période grecque de cet habitat rural ne commence apparemment guère avant 250 av. n. è., à partir de la phase iV (200 dans la nouvelle chronologie du site). il s’agit de la grande époque de mise en valeur de la plaine à côté d’un grand centre urbain royal. Cette plaine, véritable chora de la cité d’aï Khanoum, a fait l’objet d’aménagements successifs qui rendent difficile la lecture de leurs traces visibles et datables au sol, mais n’ont pas empêché un « essai de reconstitution du paysage cultivé » 412. Le tépé 106 apparaît ainsi détaché de tout parcellaire 413. en revanche, dans la région de shortughaï (209) on possède des traces complexes d’aménagements hydrauliques malaisés à dater 414. Quant au tépé 97, il se trouve parfaitement inséré dans le parcellaire irrigué, à proximité d’un canal principal et de dérivations 415.
La répartition des établissements hellénistiques, dont la fonction n’est pas connue, pas plus que la durée d’occupation, ne donne pas de vraies clés pour comprendre cette mise en valeur. Cependant, si à titre indicatif les 16 000 hectares environ de terres irriguées sont répartis égale-ment entre les 113 sites hellénistiques repérés dans la plaine, on obtient environ 140 hectares par site. si maintenant on reprend, canal par canal, les chiffres de surface irriguée et de nombre de sites donnés par B. Lyonnet 416, on obtient de 80 à 166 hectares par site. La capacité de produc-tion de la plaine atteint alors son maximum, inégalé même à l’époque islamique pré-mongole ; mais nous ne hasarderons pas de chiffres, tant sont incertaines les données des rendements, celles des apports de la culture sèche, celle de la part des habitants de la ville dans l’exploitation directe, etc. Quoi qu’il en soit, les exploitations sont de grande taille et cette importance notable des établissements ruraux, si elle peut s’expliquer aisément par les incertitudes de la prospection archéologique, peut aussi refléter des réalités historiques comme l’exploitation directe d’un par-tie de la plaine par les habitants de la cité (?), ou encore le commerce ou le prélèvement d’une part de la récolte par le pouvoir en vue de remplir les greniers urbains, royaux ou autres. Dans le dernier état du temple, avec les neuf meules à trémie « industrielles » et la douzaine de jarres de stockage qui s’y rangeaient, on pouvait conserver et traiter au minimum 7 000 kg de blé 417. il est à noter que le temple est le seul endroit de la cité où fut trouvée une telle capacité de stockage, associée de surcroît à un outillage de mouture élaboré. L’hypothèse de la constitution de réserves de grain, ainsi que d’une taxation de la production agricole est évidemment indispensable et l’on
411 Cette tombe vient en complément des nombreuses informations collectées et des études consacrées à ce problème autour d’aï Khanoum par P. Bernard, Cl. rapin, B. Lyonnet, J.-Cl. Gardin, Fr. Grenet.412 Pour le cas d’aï Khanoum, voir Vallino et marinucci 1989, p. 191-193.413 Gentelle 1978, p. 118, fig. 48.414 Gentelle 1978, p. 121.415 Gentelle 1978, p. 124, fig. 51.416 Lyonnet 1997, p. 51, tableau xx.417 Les greniers hellénistiques d’afrasiab, quoique d’un tout autre type, sont importants pour ce problème : voir Grenet 2004, p. 1057-1058, qui attribue 75 tonnes de stockage à chacune des six pièces. Cette capacité donne la possibilité d’engranger 450 tonnes de céréales environ.
AK IX.indb 177 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT178
doit même penser que le prélèvement ne s’appliquait pas seulement à la production céréalière 418. Cependant, il n’est pas dans notre intention, avec des données insuffisantes pour le faire, de tenter de mettre en rapport l’occupation du sol, le parcellaire, le cadastre et la taxation gréco-bactrienne, comme cela a pu être fait pour l’Égypte ptolémaïque ou l’asie mineure. il suffira ici de dire qu’il n’en allait probablement pas autrement en Bactriane qu’ailleurs dans le monde hellénistique 419.
418 Pour les livraisons en nature et l’économie locale à la trésorerie du palais d’aï Khanoum, voir rapin 1992, p. 107-113. sur le stockage des céréales, voir par exemple Foxhall 1990 et Gallant 1989. il ne faudrait pas non plus omettre de mentionner la possibilité d’un commerce de céréales en Bactriane hellénisée.419 Par exemple en syrie, chez les séleucides : sartre 2001, p. 217-222.
AK IX.indb 178 03/06/13 11:19
fig. 66 - A. Carte de la plaine d’Aï Khanoum : potentiel agricole, cité, canaux et « tépés » 111, 106, 97, 209 ; B. situation du « tépé » 97 près des canaux et dérivations antiques.
: céréales
Shortughaï209
97
106
Zulm111
AïKhanoum
Cana
l AK1
Canal AK2
Can
al A
K3
Pand
j
T.97T.96
T.95
dérivation
canal secondaire
canal principal
route
AK2
N
0 10 km
N
A
B
AK IX.indb 305 03/06/13 10:48
Surface
Décombres briques crues + gel
gelgel
gel et terre
gel
gel gel
T1
M2
C1
C3
C5
C6C7C8C9C10
K
Pterre terre
rigole
rigole
argile
S8
rigole
sol sablonneux
banq
uette brèche
M3
S7
M1
M2
EST OUEST
OUESTEST
Niveau S8
Niveau couches 2 et 3 à 7
Meule
M4
PoterieMeuleBrique crue
Torchis
N
0 1 m
A
B
C
D
0 1 m
0 1 m
fig. 67 - site 106. A. Plan du niveau « achéménide » ; B. Plan du niveau kouchan ; C. section montrant les occupations « P » et « K » ; D. Couche de décombres et os de porcs au niveau du sommet de la banquette.
AK IX.indb 306 03/06/13 10:48
extrémité du
tuyau
tuyau
silo
silo
foyer
foyer
tracé de la coupe
4 10 9
812
5
3
6
7
bouchage
jarre
jarre jarres
auge
muret
galetscendres
porte
silo
décombres
foyer
4
M1
2
M8 M7
S4
S3S4
C1
C2
C3
SUD NORD
N
0 10 m
A
B
0 5 m
fig. 68 - site 97. A. Plan ; B. section.
AK IX.indb 307 03/06/13 10:48
T
T
meu
le
fusa
ïole
F2
silo
3 pe
sons
J4
J3 T9
J4J2
14
13
i
h
12
11
10
9
8
A1e
A1
A2
A2
w
A3 A5
A4
A6
12
Silo
meu
les
peso
n
3
4
tand
our
figur
ine
lam
pe
meu
le meu
le
silo meu
le
peso
n
20 p
eson
sm
eule jarr
e-fo
yer
peso
ncend
res
gelm
eule
foye
r
F1
gel
peso
nge
l
F T
T
pilo
n
7 pe
sons
broy
eur
T7T8
T2T4
T5T6
J5
J3
J4
gel
12 p
eson
s1
fusa
ïole
N
0
1
0 m
fig.
69
- site
209
(sho
rtug
haï).
Pla
n.
AK IX.indb 308 03/06/13 10:48
T7 T8
T2T4 T5 T6J5
J3
J4
J4
J3
T9
J4J214
13
12
11
4
52
23
524broyeur
7 pesons
gel
12 pesons1 fusaïole
T
T
F1
F
T
T
fusaïoleF2
silo3 pesons
9
8
A1eA1A2A2 w
A3
A5
A4
A6
1 2
Silomeulespeson
3
35 40
141822
17
5045
153334
16
4729
262728
203637
51
1043
4849
2
39
9
378
21
44
46
1142
1913
314
1
126
3230
25
38
41
silo
meule
meule peson
jarre-foyer
20 pesons meule
peson
cendresmeule
gel
foyer
gel
pesongel
meule meule
tandourpilon
FigurineLampe
N
0 10 m
A
B
fig. 70 - site 209 (shortughaï). Plan de répartition des trouvailles.Liste des trouvailles, campagne 1979 uniquement (pour 1976 et 1978, tout est directement identifié sur le plan ; en 1977 la fouille ne s’est pas portée sur cette partie du site) :1. ? ; 2. Plaque de fer hexagonale (pl. XLiii 5) ; 3. Meule ; 4. ? ; 5. Coupelle de fer ; 6. Étrier de fer ; 7. Peson ; 8 et 9. Pilons de pierre ; 10 et 11. Pesons ; 12. Pointe de fer ; 13. Peson ; 14. Trois pesons ; 15. ? ; 16. Peson ; 17. fusaïole ; 18. Peson ; 19 et 20. ? ; 21. Éclat de silex ; 22. Pilon ; 23. sept pesons ; 24. Broyeur ; 25. Meule ; 26. Crapaudine de pierre ; 27. Tesson ; 28. Lampe ; 29. Peson ; 30. fragment de bronze ; 31 et 32. Pesons ; 33. Meule ; 34. ? ; 35. Peson ; 36 et 37. Pilon ; 38. Astragales ; 39. Débris dans terrier de rongeur moderne ; 40 et 41. Pesons ; 42 et 43. Deux pesons ; 44. Monnaie illisible ; 45. fragment de plomb ; 46. rondelle de céramique percée ; 47. Tige de plomb ; 48. fragment de bronze ; 49. Boulette de plomb ; 50 à 52. ?
AK IX.indb 309 03/06/13 10:48
440,00
442,50
Cour
Habitat
5
2
4
3
1
10 9
8
7
6
N
0 10 m
N
0 20 m
B
A
fig. 71 - A. site 209 (shortughaï). Proposition de restitution partielle avec tracé en pointillé du canal ;B. site 97. restitution.
AK IX.indb 310 03/06/13 10:48
planche XXXVII
3 - site 111 (Zulm) : squelette dans la jarre.
2 - site 111 (Zulm) : jarre funéraire in situ.
1 - site 111 (Zulm) : poterie du niveau achéménide.
AK IX.indb 37 03/06/13 10:51
planche XXXVIII
3 - site 106 : vue vers le nord des murs M1 et M2, banquette.
2 - site 106 : brique marquée.
1- site 106 : vue générale.
AK IX.indb 38 03/06/13 10:51
planche XXXIX
3 - site 97 : pièce 4, plate-forme, muret et foyer.
4 - site 97 : pièce 7, canalisation.
2 - site 97 : pièce 2, silo.
1 - site 97 : vue générale.
AK IX.indb 39 03/06/13 10:51
planche Xl
1 - site 209 (shortughaï) : mur nord de la pièce 1 et jarre-foyer.
4- site 209 (shortughaï) : foyer F1 de la pièce 2.
3 - site 209 (shortughaï) : pièces 2 et 3 et leurs cheminées.
2 - site 209 (shortughaï) : extérieur ouest et niveaux hellénistiques près du canal.
AK IX.indb 40 03/06/13 10:51
planche XlI
1 - site 209 (shortughaï) : foyer F2 de la pièce 3 avec matériel en place.
2 - site 209 (shortughaï) : jarre J4 et briques près de la pièce 4.
3 - site 209 (shortughaï) : poterie en place dans la pièce 3.
4 - site 209 (shortughaï) : poterie en place carré a5 extérieur sud de la pièce 1.
AK IX.indb 41 03/06/13 10:51
planche XlII
3 - site 209 (shortughaï) : lampe dans le mur est de la pièce 2.
2 - sirkap (Taxila) : meule à trémie dans la cour du stupa F (1970).
1 - site 209 (shortughaï) : pesons en argile crue.
AK IX.indb 42 03/06/13 10:51
planche XlIII
1 - lampe (dans le mur nord de la pièce 1).2 - couvercle de schiste gravé (décombres, surface de la pièce 1 ; dessin de G. semoun).3 - Figurine de bélier (décombres, surface de la pièce 1).4 - Figurine féminine (couche moyenne, extérieur ouest de la pièce 1).5 - site 209 (shortughaï) : objets de fer (décombres).
1
23
4
5
AK IX.indb 43 03/06/13 10:51
BiBLioGraPHie
abréviations
AJA : American Journal of Archaeology .BeFar : Bibliothèque des Écoles françaises d’athènes et rome.BEFEO : Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient .BCH : Bulletin de correspondance hellénique .CereDaF : Centre d’études et de recherches documentaires sur l’afghanistan.CRAI : Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres .CUF : Collection des universités de France.IASCCA : International Association for the Study of the Cultures of Central Asia . Information Bulletin, moscou.IMKU : Istorija Material’noj Kul’tury Uzbekistana, Tachkent/samarkand.JA : Journal asiatique .JRS : The Journal of Roman Studies .LIMC : Lexicon iconographicum mythologiae classicae .mDaFa : mémoires de la Délégation archéologique française en afghanistan.MEFRA : Mélanges de l’École française de Rome . Antiquité .mmaFaC : mémoires de la mission archéologique française en asie Centrale.NAPR : Mesopotamian History and Environment, Serie I . Northern Akkad Project Reports .oiP : The University of Chicago. oriental institute Publications.OMRO : Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden .RA : Revue archéologique .RM : Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung .SEG : Supplementum Epigraphicum Graecum .ZPE : Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik .
abdullaev (K.) 1996, « La plastique en terre cuite d’aï Khanoum », RA, 1996, p. 55-67.
abdullaev (K.) 2005, « Les motifs dionysiaques dans l’art de la Bactriane et de la sogdiane », dans Bopearachchi et Boussac 2005, p. 227-257.
abdul massif (J.) et Bessac (J.-Cl.) 2009, Glossaire technique trilingue de la pierre . L’exploitation en carrière, amman-Beyrouth-Damas-alep, 2009 (Guide archéologique de l’institut français du Proche-orient, 7).
adle (Ch.) 2000, « Khorheh, the Dawn of iranian scientific archaeological excavations », Tavoos (Téhéran), 3-4, printemps-été 2000, p. 4-42.
adriani (a.) 1959, Divagazioni intorno ad una coppa paesistica del museo di Alessandria, rome, 1959 (Documenti e ricerche d’arte alessandrina, iii-iV).
AK IX.indb 221 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT222
adriani (a.) 1960, « il vaso argenteo di ingolstadt e il suo modello alessandrino », RM, 67, 1960, p. 111-115.
alexander (m.a.) et ennaifer (m.) 1973, Corpus des mosaïques de Tunisie, i/1, Tunis, 1973.
allara (a.) 2002, Problemi di architettura domestica a Dura-Europs sull’Eufrate . L’isolato dei vasai (B2), Naples, 2002.
amigues (s.) 1988 éd. et trad., Théophraste . Recherches sur les plantes, i. Livres I-II, Paris, 1988 (CUF).
amigues (s.) 1989 éd. et trad., Théophraste . Recherches sur les plantes, ii. Livres III-IV, Paris, 1989 (CUF).
amigues (s.) 2001, « La “science aimable” de Théophraste », CRAI, 2001, p. 1653-1664.
andrae (W.) et Lenzen (H.) 1933, Die Partherstadt Assur, Leipzig, 1933 (Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen orient-Gesellschaft, 57).
askarov (a. a.) et abdullaev (B. N.) 1978, « raskopki mogil’nika Dzharkutan (rezul’taty rabot vesnoj 1975 g.) », IMKU, 14, 1978, p. 19-42.
assar (G. r. F.) 2006, « a revised Parthian Chronology of the Period 165-91 BC », Electrum, 11, 2006, p. 87-158.
assar (G.r.F.) 2009, « some remarks on the Chronology and Coinage of the Parthian “Dark age” », Electrum, 15, 2009, p. 195-234.
auboyer (J.), elisséeff (V.) Kurz (o.) et stern (Ph.) 1954, « Études comparatives », dans Hackin (J.), Nouvelles recherches archéologiques à Bégram (ancienne Kapicî) (1939-1940), Paris, 1954, p. 110-146, 265-275, fig. 274-321 (mDaFa, x).
Bernard (P.) 1965, « Deuxième partie. Les trouvailles. Céramique, vases en pierre, éléments de couverture, autres fragments architecturaux », dans schlumberger (D.) et Bernard (P.), « aï Khanoum », BCH, 89, 1965, p. 604-657.
Bernard (P.) 1966, « Première campagne de fouilles d’aï Khanoum », CRAI, 1966, p. 127-133.
Bernard (P.) 1967, « Deuxième campagne de fouilles d’aï Khanoum en Bactriane », CRAI, 1967, p. 306-324 .
Bernard (P.) 1968a, « Troisième campagne de fouilles à aï Khanoum en Bactriane », CRAI, 1968, p. 263-279.
Bernard (P.) 1968b, « Chapiteaux corinthiens hellénistiques d’asie Centrale découverts à aï Khanoum », Syria, xLV, 1968, p. 111-151 et pl. xiii-xVi.
Bernard (P.) 1969, « Quatrième campagne de fouilles à aï Khanoum (Bactriane) », CRAI, 1969, p. 313-355.
Bernard (P.) 1970, « Campagne de fouilles 1969 à aï Khanoum en afghanistan », CRAI, 1970, p. 301-349.
Bernard (P.) 1971, « La campagne de fouilles de 1970 à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1971, p. 385-452.
Bernard (P.) 1972, « Campagne de fouilles à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1973, p. 605-632.
Bernard (P.) 1973, « Généralités » et « matériaux et techniques de construction », dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 2-5 et 7-15.
Bernard (P.) 1974, « Fouilles de aï Khanoum (afghanistan), campagnes de 1972 et 1973 », CRAI, 1974, p. 280-308.
Bernard (P.) 1975a, « Campagne de fouilles 1974 à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1975, p. 167-197.
Bernard (P.) 1975b, « Note sur la signification historique de la trouvaille », Revue numismatique, 6e série, xVii, 1975, p. 58-69.
AK IX.indb 222 03/06/13 11:19
223BiBLioGraPHie
Bernard (P.) 1976a, « Campagne de fouilles 1975 à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1976, p. 287-322.
Bernard (P.) 1976b, « Les traditions orientales dans l’architecture gréco-bactrienne », JA, CCLxiV, 1976, p. 245-275.
Bernard (P.) 1977, « Les traditions orientales dans l’architecture gréco-bactrienne », dans Deshayes 1977, p. 263-265 (résumé du précédent).
Bernard (P.) 1978a, « Campagne de fouilles 1976-1977 à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1978, p. 421-463.
Bernard (P.) 1978b, « L’origine du nom d’aï Khanoum », dans Bernard et Francfort 1978, p. 25-26.
Bernard (P.) 1978c, « Les mines de lapis lazuli du Badakhshan », dans Bernard et Francfort 1978, p. 49-51.
Bernard (P.) 1980a, « Campagne de fouilles 1978 à aï Khanoum (afghanistan) », CRAI, 1980, p. 435-459.
Bernard (P.) 1980b, « Une nouvelle contribution soviétique à l’histoire des Kushans : la fouille de Dal’verzin-Tepe (Uzbékistan) », BEFEO, LxViii, 1980, p. 313-348 et pl. Liii-LiV.
Bernard (P.) 1981, « Problèmes d’histoire coloniale grecque à travers l’urbanisme d’une cité hellénistique d’asie Centrale », dans 150 Jahre Deutsches Archäologisches Institut, 1829-1979, mayence, 1981, p. 108-120.
Bernard (P.) 1985, Fouilles d’Aï Khanoum IV . Les monnaies hors trésors . Question d’histoire gréco-bactrienne, Paris, 1985 (mDaFa, xxViii).
Bernard (P.) 1987, « Les nomades conquérants de l’empire gréco-bactrien. réflexions sur leur identité ethnique et culturelle », CRAI, 1987, p. 758-768.
Bernard (P.) 2001a, « aï Khanoum en afghanistan hier (1964-1978) et aujourd’hui (2001) : un site en péril. Perspectives d’avenir », CRAI, 2001, p. 971-1029.
Bernard (P.) 2001b, « Découverte, fouille et pillage d’un site archéologique : la cité gréco-bactrienne d’aï Khanoum en afghanistan », dans Afghanistan, patrimoine en péril . Actes d’une journée d’étude UNESCO, 24 février 2001, CEREDAF, Paris, 2001, p. 71-96.
Bernard (P.) 2007, « Les Grecs en Bactriane : de Bactres à aï Khanoum », dans Actes du Colloque international « Le monde hellénistique en Orient à la lumière des fouilles archéologiques », athènes, 2007, p. 59-73.
Bernard (P.) 2009, « La découverte et la fouille du site hellénistique d’aï Khanoum en afghanistan : comment elles se sont faites ? », dans Atti del convegno « Afghanistan . I tresori ritrovati », Torino, Palazzo Chiablese, mercoledi 24 ottobre 2007, Turin, 2009, p. 18-44.
Bernard (P.) 2010, « La découverte et la fouille du site hellénistique d’aï Khanoum en afghanistan : comment elles se sont faites ? », dans Parthica . Incontri di culture nel mondo antico (11 .2009), Pise-rome, 2010, p. 33-56.
Bernard (P.) et Francfort (H.-P.) 1971, « Le temple à redans et son sanctuaire », dans Bernard 1971, p. 414-431.
Bernard (P.) et Francfort (H.-P.) 1978, Études de géographie historique sur la plaine d’Aï Khanoum (Afghanistan), Paris, 1978 (CNrs, Publications de l’Ura 10. mémoire, 1).
Bernard (P.) et Francfort (H.-P.) 1979, « Nouvelles découvertes dans la Bactriane afghane », Annali dell’Istituto Orientale di Napoli, 39 (Ns xxix), 1979, p. 119-148.
Bernard (P.) et Gouin (Ph.) 1971, « maison du quartier sud », dans Bernard 1971, p. 406-414.
AK IX.indb 223 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT224
Bernard (P.) et Grenet (Fr.) dir. 1991, Histoire et cultes de l’Asie Centrale préislamique . Sources écrites et documents archéologiques. Actes du colloque international du CNRS, Paris 22-28 novembre 1988, Paris, 1991.
Bernard (P.) et Le Berre (m.) 1973, « architecture. Le quartier administratif : l’ensemble nord », dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 17-61.
Bernard (P.) et Liger (J.-Cl.) 1976, « Le quartier administratif », dans Bernard, Francfort, Gardin, Liger, Lyonnet et Veuve 1976, p. 6-25 et pl. i-ii et Vii-xi (1).
Bernard (P.) et rapin (Cl.) 1980, « Le palais. La trésorerie », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 10-38 et pl. Vi-x et xxix-xxxi.
Bernard (P.), Besenval (r.) et marquis (Ph.) 2006, « Du “mirage bactrien” aux réalités archéologiques : nouvelles fouilles de la Délégation archéologique française en afghanistan (DaFa) à Bactres (2004-2005) », CRAI, 2006, p. 1175-1240.
Bernard (P.), Gouin (Ph.) et Le Berre (m.) 1973, « architecture. Le quartier administratif : l’ensemble sud », dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 63-83.
Bernard (P.), Jarrige (J.-F.) et Besenval (r.) 2002, « Carnet de route en images d’un voyage sur les sites archéologiques de la Bactriane afghane (mai 2002) », CRAI, 2002, p. 1385-1428.
Bernard (P.), Le Berre (m.) et stucky (r.) 1973, « architecture. Le téménos de Kinéas » dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 85-102 et pl. 12-18 et 85-96.
Bernard (P.), Pinault (G.-J.) et rougemont (G.) 2004, « Deux nouvelles inscriptions grecque de l’asie Centrale », Journal des Savants, juil.-déc. 2004, p. 227-356.
Bernard (P.), Francfort (H.-P.), Gardin (J.-Cl.), Liger (J.-Cl.), Lyonnet (B.) et Veuve (s.) 1976, « Fouillles d’aï Khanoum (afghanistan) : campagne de 1974 », BEFEO, Lxiii, 1976, p. 5-51 et pl. i-xVii.
Bernard (P.), Desparmet (r.), Gardin (J.-Cl.), Gouin (Ph.), Lapparent (a. de), Le Berre (m.), Le rider (G.), robert (L.) et stucky (r.) 1973, Fouilles d’Aï Khanoum I (Campagnes 1965, 1966, 1967, 1968), Paris, 1973 (mDaFa, xxi).
Bernard (P.), Garczinski (P.), Guillaume (o.), Grenet (Fr.), Ghassouli (N.), Leriche (P.), Liger (J.-Cl.), rapin (Cl.), rougeulle (a.), Thoraval (J.), Valence (r. de) et Veuve (s.) 1980, « Campagne de fouille 1978 à aï Khanoum (afghanistan) », BEFEO, LxViii, 1980, p. 1-103 et pl. xxix-xL.
Bessac (J.-Cl.) 1986, L’outillage traditionnel du tailleur de pierre de l’Antiquité à nos jours, Paris, 1986 (Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. 14).
Bielefeld (e.) 1951, Amazonomachia . Beiträge zur Geschichte der Motivwanderung in der antiken Kunst, Halle, 1951 (Hallische monographien, 21).
Bolelov (s. B.) 2006, « Quartier d’habitations d’époque kouchane à Kampirtepa (fouilles 2000-2002) », Materialy Toxaristanskoj Ekspedicii, 6, 2006, p. 15-80 (en russe).
Bokovenko (N. a.) 1996, « Problema rekonstrukcii religioznykh sistem nomadov central’noj azii v skifskuju epokhu », dans alekseev (a. Ju.), Bokovenko (N. a.), Zuev (V. Ju.) et semenov (Vl. a.) dir., Zhrechestvo i shamanizm v skifskuju epokhu, saint-Petersbourg, 1996 (Proekt « skifo-sibirika »), p. 39-42.
Bopearachchi (o.) 1999, « Les monnaies séleucides de l’asie Centrale et l’atelier de Bactres », dans amandry (m.) et Hurter (s.) dir., Travaux de numismatique grecque offerts à Georges Le Rider, Londres, 1999, p. 77-93.
AK IX.indb 224 03/06/13 11:19
225BiBLioGraPHie
Bopearachchi (o.) et Boussac (m.-F.) éd. 2005, Afghanistan, ancien carrefour entre l’Est et l’Ouest . Actes du colloque international de Lattes, 5-7 mai 2003, Turnhout, 2005 (indicopleustoi. archaeologies of the indian ocean, 3).
Bopearachchi (o.), altman Bronberg (G.) et Grenet (Fr.) éd. 1998, Alexander’s Legacy in the East . Studies in Honor of Paul Bernard, Bulletin of the Asian Institute, Ns 12, 1998.
Boucharlat (r.) 1984, « monuments religieux de la Perse achéménide, état des questions », dans roux (G.) dir., Temples et sanctuaires. Séminaire de recherche 1981-1983, Lyon, 1984 (Travaux de la maison de l’orient, 7), p. 119-135.
Buchet (L.) 1977, « squelettes d’aï Khanoum (afghanistan). Étude anthropologique », Bulletin des anthropologistes de Basse Normandie, 1977/1, p. 2-11.
Burkhalter (F.) 1981, c.r. de reinsberg (C.), Studien zur hellenistischen Toreutik, Hildesheim, 1980, Gnomon, 53, 1981, p. 690-693.
Burkhalter (F.) 1984, « moulages en plâtre antiques et toreutique alexandrine », dans Alessandria e il mondo ellenistico romano . Studi in onore di Achille Adriani, rome, 1984 (studi e materiali. istituto di archeologia, Università di Palermo, 6), p. 334-347 et pl. Lx-Lxi.
Burr Thompson (D.) 1964, « Pannychis », Journal of Egyptian Archaeology, 50, 1964, p. 147-163 et pl. xV-xVii.
Cambon (P.) 2002, « Patrimoine hier, patrimoine aujourd’hui », dans Afghanistan, une histoire millénaire, musée national des arts asiatiques-Guimet, Paris, 2002, p. 79-87.
Cambon (P.) et Jarrige (J.-Fr.) dir. 2006, Afghanistan, les trésors retrouvés . Collection du musée de Kaboul, musée national des arts asiatiques-Guimet, Paris, 2006.
Capdetrey (L.) 2007, Le pouvoir séleucide . Territoire, administration, finances d’un royaume hellénistique (312-129 avant J .-C .), rennes, 2007.
Chaniotis (a.), 1993, « ein diplomatischer statthalter nimmt rücksicht auf den verletzten stolz zweier hellenistischer Klein poleis (Nagidos und arsinoe) », Epigrafica Anatolica, 21, 1993, p. 33-42.
Childs (W.) et Demargne (P.) 1989, Le monument des Néréides . Le décor sculpté, Paris, 1989 (Fouilles de xanthos, Viii).
Colledge (m.) 1977, Parthian Art, Londres, 1977.
Cribb (J.) 2005, « The Greek kingdom of Bactria, its coinage and its collapse », dans Bopearachchi et Boussac 2005, p. 207-225.
Darcque (P.) 2005, L’habitat mycénien . Formes et fonctions de l’espace bâti en Grèce continentale à la fin du IIe millénaire avant J .-C ., athènes, 2005 (BeFar, 319).
Davreux (J.) 1942, La légende de la prophétesse Cassandre d’après les textes et les monuments figurés, Liège-Paris, 1942 .
Debaine-Francfort (C.) et abduressul (i.) dir. 2001, Keriya, mémoires d’un fleuve . Archéologie et civilisation des oasis du Taklamakan, Paris, 2001.
Deshayes (J.) dir. 1977, Le plateau Iranien et l’Asie Centrale des origines à la conquête islamique . Leurs relations à la lumière des documents archéologiques, Paris, 22-24 mars 1976, Paris, 1977 (Colloque international du CNrs, 567).
Dieulafoy (m.) 1893, L’Acropole de Suse, Paris, 1893.
Downey (s.) 1986, « The Citadel Palace at Dura-europos », dans Doura-Europos. Études 1986, Syria Lxiii, 1986, p. 27-37.
AK IX.indb 225 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT226
Druzhinina (a. P.) 2012, « rezul’taty issledovanija strucktury gorodishcha Takht-i-sangin i ego okrugi (2002-2009) », Arkheologicheskie Raboty v Tadzhikistane, xxxV, 2012, p. 323-368.
Filipponi (F.) 2009, « materiali e tecniche costruttive », dans antonini (C. s.) et mirzaachmedov (D. K.) éd., Gli Scavi di Uch Kulakh (Oasis di Bukhara) . Rapporto Preliminaire, 1997-2007, Pise-rome, 2009 (Rivista degli studi orientali, n .s . Lxxx, suppl. 1), p. 109-136.
Fitzsimmons (T.) 1996, « Chronological Problems at the Temple of the Dioscuri, Dil’berdzin Tepe (North afghanistan) », East and West, 46, 3/4, 1996, p. 271-298.
Foucher (L.) 1964, « Venationes à Hadrumète », OMRO, xLV, 1964, p. 87-114 et pl. 7-22.
Fournet (T.) 2001, a. Cornet collab., « architecture traditionnelle et activités domestiques », dans Debaine-Francfort et abduressul 2001, p. 34-47.
Foxhall (L.) 1990, « The Dependant Tenant: Land Leasing and Labour in italy and Greece », JRS, 80, 1990, p. 97-114.
Francfort (H.-P.) 1977, « Le plan des maisons gréco-bactriennes et le problème des structures de “type mégaron” en asie Centrale et en iran », dans Deshayes 1977, p. 263-280.
Francfort (H.-P.) 1984, Fouilles d’Aï Khanoum III. Le sanctuaire du temple à niches indentées, 2. Les trouvailles, Paris (mDaFa, xxVii), 1984.
Francfort (H.-P.) 1989, avec des contributions de Boisset (Ch.), Buchet (L.), Desse (J.), echallier (J.-Cl.), Kermorvant (a.) et Willcox (G.), Fouilles de Shortughaï : recherches sur l’Asie Centrale protohistorique, Paris, 1989 (mmaFaC, ii).
Francfort (H.-P.) 2005, « asie Centrale », dans Briant (P.) et Boucharlat (r.) dir., Archéologie de l’empire achéménide : nouvelles recherches, Paris, 2005 (Persika, 9), p. 313-352.
Francfort (H.-P.) et Liger (J.-Cl.) 1976, « L’hérôon au caveau de pierre », dans Bernard, Francfort, Gardin, Liger, Lyonnet et Veuve 1976, p. 25-39, pl. iii-V et xi (2)-xiV.
Francfort (H.-P.) et Pottier (m.-H.) 1978, « sondage préliminaire sur l’établissement protohistorique harappéen et post-harappéen de shortughaï (afghanistan du N.-e.) », Arts asiatiques, xxxiV, 1978, p. 29-87.
Gajbov (V.), Koshelenko (G.) et Novikov (s.) 1991, « Nouveaux documents pour une histoire des religions dans le Turkménistan méridional à l’époque parthe et sassanide », dans Bernard et Grenet 1991, p. 85-94 et pl. xxx-xxxix.
Gallant (Th. W.) 1989, « Crisis and response: risk-Buffering Behavior in Hellenistic Greek Communities », Journal of Interdisciplinary History, 19, 3, 1989, p. 393-413.
Garczinski (P.) 1980, « Le palais. La cour dorique », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 39-45, pl. xi-xVi et xxii-xxiii.
Gardin (J.-Cl.) 1970, « La céramique », dans Bernard 1970, p. 347-349.
Gardin (J.-Cl.) 1971, « Céramique », dans Bernard 1971, p. 447-452.
Gardin (J.-C.) 1973, « Les céramiques », dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 121-188 et pl. 113-143.
Gardin (J.-Cl.) 1975, « Céramique », dans Bernard 1975, p. 193-197.
Gardin (J.-Cl.) 1985, « Les relations entre la méditerranée et la Bactriane dans l’antiquité d’après des données céramologiques inédites », dans Huot (J.-L.), Yon (m.) et Calvet (Y.) éd., De l’Indus aux Balkans . Recueil à la mémoire de J . Deshayes, Paris, 1985, p. 447-460.
AK IX.indb 226 03/06/13 11:19
227BiBLioGraPHie
Gardin (J.-Cl.) dir. 1989, Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978), 1, Paris, 1989 (mmaFaC, iii).
Gardin (J.-Cl.) 1990, « La céramique hellénistique en asie Centrale. Problèmes d’interprétation », dans Zabern (P. von) éd., Akten des XIII Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie, Berlin 1988, mayence, 1990, p. 187-193.
Gardin (J.-Cl.) 1998, « Description des sites et notes de synthèse », dans Gardin (J.-Cl.) dir., Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978), 3, Paris, 1998 (mmaFaC, ix).
Gardin (J.-Cl.) et Gentellle (P.) 1976, « irrigation et peuplement dans la plaine d’aï Khanoum de l’époque achéménide à l’époque musulmane », BEFEO, Lxiii, 1976, p. 59-110.
Gardin (J.-Cl.) et Lyonnet (B.) 1976, « La céramique », dans Bernard, Francfort, Gardin, Liger, Lyonnet et Veuve 1976, p. 45-51.
Gasche (H.) 1999, « abou Qoubour, une résidence parthe près de Baghdad », Dossier d’archéologie, 243, 1999, p. 47-49.
Gasche (H.) et Pons (N.) 1991, « abu Qubur 1990, ii. Chantier F, le “bâtiment parthe” », NAPR, 7, 1991, p. 11-34.
Gentelle (P.) 1978, Étude géographique de la plaine d’Aï Khanoum et de son irrigation depuis les temps antiques, Paris, 1978 (CNrs, Publications de l’Ura 10. mémoires, 2).
Gentelle (P.) 1989, Données paléogéograhiques et fondements de l’irrigation, dans Gardin 1989, p. 17-39.
Ginouvès (r.) 1952, « Une salle de bain hellénistique à Delphes », BCH, 76, 1952, p. 544-561.
Ginouvès (r.) 1962, Balaneutikè . Recherches sur le bain dans l’Antiquité grecque, athènes, 1962 (BeFar, 200).
Gouin (Ph.) 1973, « Les petits objets », dans Bernard, Desparmet, Gardin, Gouin, Lapparent, Le Berre, Le rider, robert et stucky 1973, p. 195-201.
Graham (J. W.) 1954, « olynthiaka, 5-6 », Hesperia, 23, 1954, p. 320-346.
Grenet (Fr.) 1983, « L’onomastique iranienne à aï Khanoum », BCH, CVii, 1983, p. 373-381.
Grenet (Fr.) 1984, Les pratiques funéraires dans l’Asie Centrale sédentaire de la conquête grecque à l’islamisation, Paris, 1984.
Grenet (Fr.) 1991, « mithra au temple principal d’aï Khanoum ? », dans Bernard et Grenet 1991, p. 147-151 et pl. LViii-Lx.
Grenet (Fr.) 2004, « maracanda/samarkand, une métropole pré-mongole. sources écrites et archéologie », Annales Histoire, Sciences Sociales, 5-6, 2004, p. 1043-1067.
Grenet (Fr.), Liger (J.-Cl.) et Valence (r. de) 1980, « L’arsenal », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 51-63 et pl. xix-xxiii et xxxVi-xxxViii.
Grenet (Fr.) et rapin (Cl.) 1998, « alexander, aï Khanum, Termez: remarks on the spring Campaign of 328 », dans Bopearachchi, altman Bronberg et Grenet 1998, p. 79-89.
Guillaume (o.) 1983, Fouilles d’Aï Khanoum II. Les propylées de la rue principale, Paris, 1983 (mDaFa, xxVi).
Guillaume (o.) et rougeulle (a.) 1987, Fouilles d’Aï Khanoum VII. Les petits objets, Paris, 1987 (mDaFa, xxxi).
Gullini (G.) 1964, Architettura iranica dagli Achemenidi ai Sasanidi, Turin, 1964.
Hakemi (a.) 1990, « The excavation of Khura », East and West, 40, 1990, p. 11-41.
AK IX.indb 227 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT228
Hashimoto (N.), Lecuyot (G.) et Ueki (F.) à paraître, « Une grande cité grecque d’asie Centrale restituée en 3D : aï Khanoum », dans De la confrontation des civilisations à l’unité multipolaire de l’Orient hellénistique . Colloque internationnal UNESCO : Rencontres interculturelles dans l’Orient hellénisé, 28-30 septembre 2009, à paraître.
Herzfeld (e.) 1941, Iran in the Ancient East, Londres, 1941.
Holt (F. L.) 1981, « The euthydemid Coinage of Bactria: Further Hoard evidence from aï Khanoum », Revue numismatique, 1981, p. 7-44.
Holt (F. L.) 1999, Thundering Zeus . The Making of Hellenistic Bactria, Berkeley-Los angeles-Londres, 1999.
Humlum (J.) 1959, La géographie de l’Afghanistan . Étude d’un pays aride, Copenhague, 1959.
invernizzi (a.) et Lippolis (C.) 2008, Nisa Partica . Ricerche nel complesso monumentale arsacide, 1990-2006, Florence, 2008 (Centro ricerche archeologiche e scavi di Torino per il medio oriente e l’asia. missione in Turkmenistan, i ; monografie di mesopotamia, ix).
ippel (a.) 1937, Guss- und Treibarbeit in Silber 97, Berlin, 1937.
Jones (C. P.) et Habicht (C.), « a Hellenistic inscription from arsinoe in Cilicia », Phoenix, 43, 1989, p. 317-346.
Kabanov (s. K.) 1981, « osvoenie zapadnykh rajonov goroda na rannikh etapakh ego zhizni », dans Burjakov (Ju. F.) éd., K istoricheskoj topografii drevnego i srednevekovogo Samarkanda, Tashkent, 1981, p. 23-59.
Kirsten (e.) et opelt (i.) 1989, « eine Urkunde der Gründung von arsinoe in Kilikien », ZPE, 77, 1989, p. 55-66.
Kleiss (W.) 1985, « Der säulenbau von Khurha », Archäologische Mitteilungen aus Iran, 18, 1985, p. 173-180.
Knudstad (J.) 1968, « a Preliminary report on the 1966-67 excavations at Nippur », Sumer, xxiV, 1968, p. 95-106.
Koshelenko (G.), Lapshin (a.) et Novikov (s. V.) 1989, « mansur-depe excavations », Bulletin of Asia Institute, Ns 3, 1989, p. 45-52.
Koshelenko (G. a.), Lapshin (a. G.) et Novikov (s. V.) 2000, « The mansur-depe excavation of 1986-1987 », Parthica . Incontri di culture nel mondo antico, 2, 2000, p. 87-123 et pl. V-Vi.
Kritt (B.) 1996, Seleucid Coins of Bactria, Lancaster, 1996 (Classical Numismatic studies, 1).
Kritt (B.) B. 2001, Dynastic Transitions in the Coinage of Bactria, Lancaster, 2001 (Classical Numismatic studies, 4).
Kruglikova (i. T.) 1974, Dilberdzhin, 1, moscou, 1974.
Kruglikova (i. T.) éd. 1976, Drevnjaja Baktrija . Materialy Sovetsko-afganskoj ekspedici 1969-1973 gg, moscou, 1976 (rés. fr. p. 183-190).
Kruglikova (i. T.) et Pugachenkova (G. a.) 1977, dans Dil’berzin. Raskopki 1970-73 gg, 2, moscou, 1977 (rés. fr. « La grande maison », p. 104-112).
Kurz (o.) 1954, « Études comparatives », dans Hackin (J.), Nouvelles recherches archéologiques à Bégram (ancienne Kapicî) (1939-1940), Paris, 1954 (mDaFa, x) .
Laloux (V.) 1888, L’architecture grecque, Paris, 1888.
Lecuyot (G.) 1987, « aï Khanoum : l’habitat », dans Gorodskaja Kul’tura Baktrii-Toxaristana i Sogda. La culture de la Bactriane-Tokharistan et de la Sogdiane (Antiquité et Moyen Âge). Colloque soviéto-français, Samarkand 1986, Tachkent, 1987, p. 59-67 (en russe).
AK IX.indb 228 03/06/13 11:19
229BiBLioGraPHie
Lecuyot (G.) 1993, « résidences hellénistiques en Bactriane, résidences parthes en iran et en mésopotamie. Diffusion ou communauté d’origine ? », NAPR, 8, 1993, p. 31-45 et pl. 1-2.
Lecuyot (G.) 2005a, « essai de restitution 3D de la Ville d’aï Khanoum », dans Bopearachchi et Boussac 2005, p. 187-196.
Lecuyot (G.) 2005b, « La 3D appliquée à la citée gréco-bactrienne d’aï Khanoum en afghanistan », dans L’art d’Afghanistan de la préhistoire à nos jours : nouvelles données. Actes d’une journée d’étude, 11 mars 2005, CEREDAF, Paris, 2005, p. 31-48.
Lecuyot (G.) 2007, « ai Khanum reconstructed », dans Cribb (J.) et Hermann (G.) éd., After Alexander : Central Asia Before Islam, oxford, 2007 (Proceedings of the British academy, 133), p. 155-162 et pl. 1-4.
Lecuyot (G.) et ishizawa (o.) 2005, « aï Khanoum, ville grecque d’afghanistan en 3D », Archéologia, 420, mars 2005, p. 60-71.
Lecuyot (G.) et ishizawa (o.) 2006, « NHK, Taisei, CNrs : une collaboration franco-japonaise à la restitution 3D de la ville d’aï Khanoum en afghanistan », dans Vergnieux (r.) et Delevoie (C.) éd., Actes du Colloque « Virtual Retrospect 2005 », Bordeaux, 2007 (archéovision, 2), p. 121-124.
Leriche (P.) 1986, Fouilles d’Aï Khanoum V . Les remparts et les monuments associés, Paris, 1986 (mDaFa, xxix).
Leriche (P.), 2007, « Bactria, Land of a Thousand Cities », dans Cribb (J.) et Hermann (G.) éd., After Alexander : Central Asia Before Islam, oxford, 2007 (Proceedings of the British academy, 133), p. 122-153.
Leriche (P.), rougeulle (a.) et Ghassouli (N.) 1980, « recherches sur les fortifications de la ville haute et de la citadelle », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 73-74.
Lerner (J. D.) 2003-2004, « Correcting the early History of ay Kanom », Archäologishe Mitteilungen aus Iran und Turan, 35-36, 2003-2004, p. 373-410.
Lerner (J. D.) 2005, « Greek Ceramic Period iV of aï Khanoum », dans antonova (e. a.), mkrtychev (T. K.) éd, Central’naja Azija : istočniki, istorija, kul’tura, moscou, 2005, p. 464-476.
Lerner (J. D.) 2010, « revising the Chronologies of the Hellenistic Colonies of samarkand-marakanda (afrasiab ii-iii) and aï Khanoum (Northeastern afghanistan) », Anabasis, 1, 2010, p. 58-79.
Lerner (J. D.) 2011, « a reappraisal of the economic inscription and Coin Finds from aï Khanoum », Anabasis, 2, 2011, p. 103-147.
Liger (J.-Cl.) s.d., La physionomie urbaine d’une cité hellénistique en Asie Centrale, mémoire de maîtrise, Université de Paris Viii. Département d’urbanisme, s.d.
Lippolis (C.) 2002, « Nisa-mithradatkert : l’edificio a nord della sala rotonda. rapporto preliminare delle campagne di scavo 2000-2001 », Parthica, 4, 2002, p. 47-62.
Lippolis (C.) 2006, « Les recherches italiennes sur l’ancienne Nisa », Dossiers d’archéologie, 317, 2006, p. 58-65.
Lippolis (C.) 2007, « Nisa-mitridatkert. alle origini dell’arte dei Part », dans Sulla via di Alessandro da Seleucia al Gandhara, museo Civico d’arte antica, Turin, 2007, p. 147-153.
Litvinskij (B. a.) et sedov (a. V.) 1984, Kul’ty i ritualy kushanskoj Baktrii . Pogrebal’nyj obrjad, moscou, 1984.
Lyonnet (B.) 1991, « Les nomades et la chute du royaume gréco-bactrien : quelques nouveaux indices en provenance de l’asie Centrale orientale. Vers l’identification des Tokhares - Yueh-Chi ? » dans Bernard et Grenet 1991, p. 153-163 et pl. Lxi-Lxiii.
AK IX.indb 229 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT230
Lyonnet (B.) 1997, « Céramique et peuplement du Chalcolithique à la conquête arabe », dans Gardin (J.-Cl.) dir., Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974-1978), 2, Paris, 1997 (mmaFaC, Viii).
Lyonnet (B.) 1998, « Les Grecs, les Nomades et l’indépendance de la sogdiane, d’après l’occupation comparée d’aï Khanoum et de marakanda au cours des derniers siècles avant notre ère », dans Bopearachchi, altman Bronberg et Grenet 1998, p. 141-159.
Lyonnet (B.) 2010, « D’aï Khanoum à Koktepe. Questions sur la datation absolue de la céramique hellénistique d’asie centrale », dans abdullaev (K.) éd., Traditsii Vostoka i Zapada v antichnoj kul’ture Srednej Azii . Sbornik statej v chest’ Polja Bernara/The Traditions of East and West in the Antique Cultures of Central Asia . Papers in Honor of Paul Bernard, samarkand, 2010, p. 141-153.
Lyonnet (B.) 2012, « Questions on the Date of the Hellenistic Pottery from Central asia (ai Khanoum, marakanda and Koktepe) », Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 18, 2012, p. 143-173.
Lyonnet (B.) sous presse 1, « ellinisticheskaja keramika iz Geroona Kineja v aj Khanum (afganistan) », dans Drevnie tsivilizatsii na Srednem Vostoke . Arkheologija, istorija, kul’tura. Konferentsija posvjashchennoj 80-letiju G .V . Shishkinoj, 23-25 Avgusta 2010, moscou, sous presse.
Lyonnet (B.) sous presse 2, « La céramique hellénistique en asie centrale », dans Fenn (N.) et römer-strehl (C.) éd., Networks in the Hellenistic World according to the Pottery in the Eastern Mediterranean and Beyond. Proceedings of the international conference at Cologne/Bonn, 23-26 February 2011, sous presse (Bar international series).
mangold (m.) 2000, Kassandra in Athen . Die Eroberung Trojas auf attischer Vasen, Berlin, 2000.
martin (r.) 1951, Recherches sur l’Agora grecque . Étude d’histoire et d’architecture urbaine, Paris, 1951 (BeFar, 174).
martinez sève (L.) 2010a, « À propos du temple aux niches indentées d’aï Khanoum : quelques observations », dans Carlier (P.) et Lerouge (Ch.) éd., Paysage et religion en Grèce antique . Mélanges en l’honneur de Madeleine Jost, Paris, 2010 (maison renè-Ginouvès. Travaux, 10), p. 195-207.
martinez sève (L.) 2010b, « suse et les séleucides au iie siècle avant J.-C. », dans Dabrowa (e.) éd., New Studies on the Seleucids, Cracovie, 2010 (electrum, 18), p. 41-66.
martinez sève (L.) sous presse, « La colonisation grecque en asie Centrale : les évolutions récentes de la recherche », dans oetjen (r.) et ryan (F. x.) dir., Seleukeia . Studies in Seleucid History, Archaeology and Numismatics in Honor of Getzel M . Cohen, Berlin, sous presse (Beiträge zur altertumskunde).
mazzoldi (s.) 2001, Cassandra, la vergine et l’indovina, Pise-rome, 2001.
mcmahon (a.) 1996, « The achaemenid-Hellenistic occupation at Hacinebi », dans stein (G. J.), Bernbeck (r.), Coursey (Ch.), mcmahon (a.), miller (N.), misir (a.), Nicola (J.), Pittman (H.), Pollock (s.) et Wright (H.), Uruk Colonies and Mesopotamian Communities . An Interim Report on the 1992-3 Excavations at Hacinebi, Turkey, American Journal of Archaeology, 100, 1996, p. 222-229.
mcmahon (a.) 1997 « achaemenid-Hellenistic remains at Hacinebi, 1996 interim report », dans stein (G.), Boden (K.), edens (C.), edens (J. P.), Keith (K.), mcmahon (a.) et Özbal (H.), Excavations at Hacinebi Turkey, 1996 . Preliminary Report, Anatolica, 23, 1997, p. 121-124.
meiggs (r.) 1982, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, oxford, 1982.
menniger (m.) 1996, Untersuchungen zu den Gläsern und Gipsabgüssen aus dem Fund von Begram (Afghanistan), Würzburg, 1996 (Würzburger Forschungen zur altertumskunde, 1).
moret (J.-m.) 1975, L’Ilioupersis dans la céramique italiote . Les mythes et leur expression figurée au ive siècle, rome, 1975.
olivier-Utard (F.) 1997, Politique et archéologie . Histoire de la Délégation archéologique française en Afghanistan, 1922-1982, Paris, 1997.
AK IX.indb 230 03/06/13 11:19
231BiBLioGraPHie
Perrot (J.) dir. 2010, Le palais de Darius à Suse . Une résidence royale sur la route de Persépolis à Babylone, Paris, 2010.
Petitot-Bieller (Cl.) 1975, « Trésor de monnaies grecques et gréco-bactriennes trouvé à aï Khanoum (afghanistan) », Revue numismatique, 6e s., xVii, 1975, p. 23-57 et pl. i-Vi.
Pilipko (V.) 2006, « Nisa-mihrdarkirt, un site exceptionnel de la culture parthe », Dossiers d’archéologie, 317, 2006, p. 52-57.
Pugachenkova (G. a.) 1977, « La culture de la Bactriane du nord à la lumière des découvertes archéologiques dans la vallée du sourkhan-Darya », dans Deshayes 1977, p. 281-295.
Pugachenkova (G. a.) 1985a, « sur la typologie de l’architecture monumentale des anciens pays de l’asie Centrale », Iranica antiqua, xVii, 1985, p. 21-42 (rés. fr. p. 40-42).
Pugachenkova (G. a.) 1985b, « Le problème de l’héritage dans la culture artistique de la Bactriane antique », dans L’archéologie de la Bactriane ancienne . Actes du colloque franco-soviétique, Dushanbe (URSS)-Paris, 27 octobre-3 novembre 1982, Paris, 1985, p. 253-256.
Pugachenkova (G. a.) 1996, « small stone Basis of Bactria », IASCCA Information Bulletin, 20, 1996, p. 135-140.
Pugachenkova (G. a.), rtveladze (e. V.) et Turgunov (B. a) 1978, Dal’verzintepe kushanskij gorod na juge Uzbekistana, Tashkent, 1978.
Pulak (C.), Townsend (r. F.), Koehler (C. G.) et Wallace (m. B.) 1987, « The Hellenistic shipwreck at serce Limani, Turkey. Preliminary report », AJA, 91, 1, 1987, p. 31-57.
rahbar (m.) 1999, « Khorheh, une résidence parthe sur le Plateau iranien », Dossiers d’archéologie, 243, 1999, p. 44-46.
rahbar (m.) 2003, Archaeological Excavations at Khorhe, Téhéran, 2003 (en perse, rés. angl. p. 181-188).
rapin (Cl.) 1983a, « Les inscriptions économiques de la trésorerie hellénistique d’aï Khanoum (afghanistan) », BCH, CVii, 1983, p. 315-372.
rapin (Cl.) 1983b, notice 1238, dans SEG, 33, 1983.
rapin (Cl.) 1992, Fouilles d’Aï Khanoum VIII. La trésorerie du palais hellénistique d’Aï Khanoum . L’apogée et la chute du royaume grec de Bactriane, Paris, 1992 (mDaFa, xxxiii).
rapin (Cl.) 1998, « L’incompréhensible asie centrale de la carte de Ptolémée. Proposition pour un décodage », dans Bopearachchi, altman Bronberg et Grenet 1998, p. 201-225.
rapin (Cl.) 2005, « L’afghanistan et l’asie centrale dans la géographie mythique des historiens d’alexandre et dans la toponymie des géographes gréco-romains. Notes sur la route d’Herat à Bégram », dans Bopearachchi et Boussac 2005, p. 143-172.
rapin (Cl.) 2010, « L’ère Yavana d’après les parchemins gréco-bactriens d’asangorna et d’amphipolis », dans abdullaev (K.) éd., The Traditions of East and West in the antique cultures of Central Asia . Papers in honor of Paul Bernard (Tradicii Vostoka i Zapada v antichnoj kul’ture srednej Azii . Sbornik statej v chest’ Polja Bernara), Tashkent, 2010, p. 234-252.
rapin (Cl.) 2013, « on the way to roxane: the route of alexander the Great in Bactria and sogdiana (328-327 BC) », dans Lindström (G.), Hansen (s.), Wieczorek (a.), Tellenbach (m.) éd., Zwischen Ost und West . Neue Forschungen zum antiken Zentralasien . Wissenschaftliches Kolloquium 30 .9 .-2 .10 .2009 in Mannheim, Darmstadt, 2013 (archäologie in iran und Turan, 14), p. 43-82.
rebuffat (r.) 1969, « maisons à péristyle d’afrique du Nord : répertoire de plans publiés », MEFRA, 81, 1969, p. 659-724.
AK IX.indb 231 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT232
reinsberg (C.) 1980, Studien zur hellenistischen Toreutik, Hildesheim, 1980 (Hildesheimer ägyptologische Beiträge, 9).
reuther (o.) 1938, « Parthian architecture », dans Pope (a.) éd., A Survey of Persian Art, i, oxford-Londres-New York, 1938, p. 411-444.
richter (G. m. a.) 1958, « ancient Plaster Casts of Greek metalware », AJA, 62, 1958, p. 369-372 et pl. 88-95.
robertson (D. s.) 1954, Handbook of Greek and Roman Architecture, 2e éd., Cambridge, 1954.
rotroff (s.) 1982, Hellenistic Pottery . Athenian and Imported Moldmade Bowls, Princeton, 1982 (The athenian agora, xxii).
rotroff (s.) 1997, Hellenistic Pottery . Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, 2 vol., Princeton, 1997 (The athenian agora, xxix).
rotroff (s.) 2006, « The introduction of the moldmade Bowl revisited. Tracking a Hellenistic innovation », Hesperia, 75, 2006, p. 357-378.
rougemont (G.) 2012, Inscriptions grecques d’Iran et d’Asie Centrale, Londres, 2012 (Corpus Inscriptionum Iranicarum, ii. Inscriptions of the Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia, 1. Inscriptions in Non-Iranian Languages).
rougemont (G.) sous presse, « Grecs et non Grecs dans les inscriptions grecques d’iran et d’asie Centrale », Studia Iranica, sous presse.
rubensohn (o.) 1911, Hellenistiches Silbergerät in antiken Gipsabgüssen, Berlin, 1911.
sartre (m.) 2001, D’Alexandre à Zénobie . Histoire du Levant antique, ive siècle av . J .-C .-iiie siècle ap . J .-C ., Paris, 2001.
schlumberger (D.) 1965, « aï Khanoum, une ville hellénistique en afghanistan », CRAI, 1965, p. 36-46.
schlumberger (D.) et Bernard (P.) 1965, « aï Khanoum », BCH, 89, 1965, p. 590-657 et pl. xxV-xxVi.
schmidt (e.) 1953, Persepolis, i. Structures, Reliefs, Inscriptions, Chicago, 1953 (oiP, 68).
siebert (G.) 1978, Recherches sur les ateliers de bols à reliefs du Péloponnèse à l’époque hellénistique, Paris, 1978 (BeFar, 203).
staviskij (B. J. a.) 1986, La Bactriane sous les Kushans, Paris, 1986.
stève (m.-J.), Vallat (F.), Gashe (H.), Jullien (C et F. ) 2005, « suse », dans Dictionnaire de la Bible . Supplément, 13, Paris, 2005, col. 359-652.
sulejmanov (r. x.) 1991, « L’architecture monumentale d’erkurgan. Complexes cultuels et communautaires », dans Bernard et Grenet 1991, p. 167-172 et pl. LxV-xLViii.
sverchkov (L.) 2008, « The Kurganzol Fortress (on the History of Central asia in the Hellenistic era) », Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 14, 2008, p. 123-191.
Thierry (F.) 2005, « Yuezhi et Kouchans. Pièges et dangers des sources chinoises », dans Bopearachchi et Boussac 2005, p. 421-539.
Tissot (Fr.) 2006, Catalogue of the National Museum of Afghanistan, 1931-1985, Paris, UNesCo, 2006.
Thoraval (J.) et Liger (J.-Cl.) 1980, « Le palais : sondages sur la cour sud », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 44-45 et pl. xVii.
Tolstov (s. P.) 1962, Po drevnim del’tam Oxa i Yaksarta, moscou, 1962.
Touchefeu (o.) 1981, « aias ii », dans LIMC, i, 1, munich, 1981, p. 339-344.
AK IX.indb 232 03/06/13 11:19
233BiBLioGraPHie
Turgunov (B. a.) 1973, « K izucheniju ajrtama », dans Pugachenkova (G. a.) dir., Iz Istorii Antichnoj Kul’tury Uzbekistana, Tashkent, 1973, p. 54.
Vallino (F. o.) et marinucci (C.) 1989, « annexe 1. essai de reconstitution du paysage bactrien et de son écodynamique », dans Gardin 1989, p. 161-206.
Van der Plicht (J.) 1989, « Calibration of radiocarbon dates », NAPR, 4, 1989, p. 69.
Van Zeist (W.) 1991, « Lower mesopotamian Plant remains from the Fourth Century BC and the First/second Century aD », NAPR, 5, 1991, p. 61-69.
Veuve (s.) 1987, Fouilles d’Aï Khanoum VI. Le gymnase, Paris, 1987 (mDaFa, xxx).
Veuve (s.) et Liger (J.-Cl.) 1976, « Le gymnase », dans Bernard, Francfort, Gardin, Liger, Lyonnet et Veuve 1976, p. 40-45, pl. Vi et xV-xVii.
Veuve (s.), Liger (J.-Cl.) et Valence (r. de) 1980, « Bâtiment public en bordure de la rue principale », dans Bernard, Garczinski, Guillaume, Grenet, Ghassouli, Leriche, Liger, rapin, rougeulle, Thoraval, Valence et Veuve 1980, p. 46-50, pl. xViii et xxxiV-xxxV.
Vorob’eva (m. G.) 1973, Dingil’dzhe . Usad’ba I tysjacheletija do n . e . v Drevnem Khorezme, moscou, 1973.
White (D.) 1963, « a survey of millstones from morgantina », AJA, 67, 2, 1963, p. 199-206.
Wilson (L. m.) et assar (G. r. F.) 2007, « re-Dating eukratides i relative to mithradates i », Journal of the Oriental Numismatic Society, 191, 2007, p. 24-25.
Wright (G. r. H.) 1991, « abu Qubur. The “Parthian Building” and its affinities », NAPR, 7, 1991, p. 75-91.
AK IX.indb 233 03/06/13 11:19
iNDex GÉNÉraL
NB : Ne figurent dans cet index ni les céramiques du catalogue (chapitre 8) ni les petits objets inventoriés (types, matériaux, provenance) dans les tableaux à la fin des chapitres 1, 2, 3 et 4.
abaque : 112-115abu Qubur : 202, 205.afanasevo (culture) : 159.afghanistan : ix, xi, 1, 2, 10, 17, 180, 182.afrasiab : ix, 171, 177, 182-183.agathocle : 131.agora : 3, 77.agora d’athènes : 182, 185, 186-187, 188-189. aï Khanoum : ix-xii, 1-2, 4-10, 17, 22, 31, 44, 47, 59, 62-63, 68, 71-72, 76, 78, 80, 85, 96-97, 106,
114, 133, 146, 151, 153, 155, 157-161, 163-167, 169-173, 175-184, 186-191, 193, 196, 200-203, 205-207, 209-219. - arsenal : 2, 3, 62-63, 90, 134.- Gymnase : 2-3, 5-6, 32, 82, 180, 196, 198, 210, 212, 218-219.- Hérôon : x, 2-3, 5, 7, 140, 145-147, 149-156, 179, 182-183, 186, 198, 200, 210, 213-214, 219.- Palais : 2-3, 5-8, 10, 13, 17, 32-33, 39, 47, 50, 59, 63-64, 75, 76, 78, 80, 94, 108, 113-114, 127,
131-133, 134, 137, 145-154, 178, 180-181, 193-196, 198-201, 206, 209-212, 218-220.- Propylées : 3, 50, 62-64, 75, 114, 145-155, 198, 200, 210.- maison : x, xi, 4-10, 13-20, 23-27, 29-30, 32-38, 42, 44-56, 58-59, 61-62, 64, 66, 68, 76-78, 80,
85, 93-94, 96-97, 103-107, 109-110, 113-118, 123-125, 127, 129-135, 137-141, 152, 155, 162-163, 165-166, 169-172, 179-181, 183-190, 193-194, 196-197, 199-203, 205-207, 209-211, 213-220.
- mausolée : 2-4, 17, 132, 145, 158-159.- Nécropole : 3, 158, 198.- rue : ix, 1-6, 8-9, 13, 18-19, 32-37, 44-45, 47, 50, 52, 62-63, 66, 67, 75-77, 83, 86, 93-94, 101,
104, 114, 132, 137-139, 141-142, 146, 149-150, 154, 193, 197-198, 210-211, 214, 217. - stade : 75, 77.- Temple principal (anc. à redans ou à niches indentées) : x, 2, 5-7, 9, 63, 71, 75-76, 80, 83, 137, 142,
151, 171, 177, 180-181, 186-187, 197-198, 209-210.- Temple hors les murs : 3-4, 132.- Théâtre : 2-3, 158, 197, 210.- Trésorerie : 63, 97, 133, 178, 180-181, 201, 212, 218-219.- Téménos : 76, 198.- Tombes : 159, 199.
AK IX.indb 235 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT236
aizanoi : 80.ajax : 70-71.ajrtam : 164, 202.alexandre posthume (monnaie) : 131.alexandre le Grand : 181, 183, 212, 214.alexandrias : 5.alexandrie : 5.alexandrie de l’oxus (ou oxienne) : 1.altyn-Dilyar : 176.altin-Tépé : 201.altyn 10 : 209.amou-Darya : 1.anabase : 216.Androne : 196andronovo (culture) : 159.ante : 9, 18, 20-22, 78-79, 81-82, 89, 108, 110-112, 134, 145-146, 203. antéfixe : 10, 108, 146-147, 161, 196, 210.antimaque : 89.antimaque ier : 131.antioche de Perside : 215.antiochos ier : 44, 89, 131, 134, 145, 175, 182, 212, 214-217.antiochos ii : 215-216.antiochos iii : 191, 210, 216-217.apadama : 206.aphrodite : 80.apollodote ier : 131.apollon : 80.apollon sminthien : 80.appareil de tournage : 18.argos : 70-71.aristote : 146.armes
- Javelot : 62-63, 135.- Lance : 69.- Pointe de flèche : 62, 134.
arsinoé de Cilicie : 215.artémision : 80.asclépios : 80.asie centrale : ix, 2, 17, 157, 159, 169, 171, 176, 185-186, 201, 203, 206.asie mineure : 80, 178, 180, 188, 201, 204.assur : 206.athéna : 68-70, 80.athéna Parthénos : 71.athènes : 181-182, 185-188, 190.athribis : 69.attique : 116, 184, 187, 190.
Babich-mulla : 202.Babylone : 209.Bactres : 80, 191, 201-202, 210, 216.
AK IX.indb 236 03/06/13 11:19
237iNDex GÉNÉraL
Bactriane : 1, 64, 146, 151, 153, 157-160, 165, 175-178, 182-183, 201-202, 210, 212, 214-215, 217. Bactriane orientale : 1, 153, 157, 176, 210, 214.Badakhshan : 1.Baignoire : 6, 127, 138, 140, 198.Bandykhan-Tépé : 176.Banquet : 196Base d’ante : 20-22, 78-79, 81-82, 108, 110-112Base de colonne : 2, 11, 18, 21-22, 77-82, 90, 98, 110, 113-114, 116, 130, 142, 150, 176, 204, 209-210. Bégram : 72.Bois : 8-11, 17-18, 21, 26, 30-31, 39, 54-55, 72, 80, 94, 106, 108, 110, 114, 117-119, 121-122, 145-
148, 155, 167, 195, 202.- Charbon de bois : 14, 16, 23-24, 28, 35, 45, 48, 79, 104-105, 115-116, 118, 120, 123, 129-130,
153-154. Bovin : 172.Briques
- Brique crue : 6, 8-10, 15-18, 20, 22-24, 26-33, 35, 37-45, 47-48, 50-51, 53-55, 57, 59, 76, 79, 81-83-89, 93-95, 104-110, 115-126, 128-133, 138-141, 143, 146, 148-150, 152-155, 160-164, 166-169, 183, 199.
- Brique cuite : 8, 20, 57, 59, 79, 83-84, 89, 108, 111, 117, 125, 129, 138, 140, 148-153, 155-156, 164, 198.
Bronze (âge du) : 157-159, 162, 165-166, 168, 172, 176, 200.
Canal : 3, 69, 70, 71-72, 83, 177, 109, 122, 129-130, 133, 158-161, 165, 177, 204.Canalisation : 6, 31-34, 61, 83-84, 89, 93, 130, 140, 155, 162-163. Calcaire : 8-9, 18, 20, 80, 104, 108, 110, 116-177, 134, 145, 147, 155, 199.Caprin : 172.Cassandre : 70-71.Cèdre : 10Céramique
- amphore : 50, 52, 64, 98, 149, 155, 174, 184-185, 189. - Bol « mégarien » : 181-182, 184, 186-187, 211, 215.- Cratère : 98, 167, 174, 184, 188-189.- Jarre : 18, 23, 31-32, 34-35, 39-40, 47-50, 56, 58, 60-61, 63-64, 78, 90, 94-95, 98, 116, 130, 133-
134, 139, 143, 152, 158, 162-164, 166-171, 174-177, 183, 189, 198.- stamnos : 63.
Chaînage : 9, 81, 106.Chambre : 48, 141, 143, 194-195. Chambre de cuisson : 18.Chapiteau : 9, 18, 21, 80, 110, 112, 114-115, 133, 204, 209.
- Chapiteau corinthien : 39, 80, 108, 114, 209-210.- Chapiteau dorique : 209-210.- Chapiteau ionique : 80, 209-210.
Chaux : 8, 21, 37, 134, 148, 150, 154.Cheshme-shafa : 176.Chine : 169.Chorasmie : 165, 169.Claros : 80.Classique (période) : 80, 188.Cléarque : 146.Clou : 61, 83, 97, 134.
AK IX.indb 237 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT238
Colonne : 2, 8-9, 11, 17-22, 70, 76-81, 90, 98, 104-105, 108-116, 130, 132, 142, 145, 161, 176, 193-195, 201-204, 206, 209-210.
Colophon : 201.Cos : 80.Couloir : 4, 14, 16, 18-20, 22-27, 29-31, 34-35, 37-40, 42-49, 52, 54, 58-60, 62, 64, 68, 76, 78, 85,
88-89, 94, 97, 103-109, 111, 115, 117-126, 130-131, 133-135, 155, 193-197, 200-206, 209.Couvre-joint : 108, 149-150, 153, 155.Crapaudine : 16, 28, 41, 56, 168.Cuisine : 6, 18, 35, 41, 43, 49-50, 64, 77, 85-88, 96, 104-105, 107, 123-131, 133, 152, 154, 163-164,
170, 175, 189, 194. Cuisine-chaufferie : 6, 32, 105, 193-195. Cuves plates : 76, 210.
Dahan-i Ghulaman : 201, 209.Dal’verzin (Tépa )p. 169, 202.Dame Lune : 1.Dangara : 64.Darius ier : 209.Darya-i Pandj : 1-3, 10, 13, 103, 198, 202, 210.Pandj : 172, 176.Delphes : 146.Démétrios ier : 131, 137, 216-217.Didyméion : 80.Dil’berdjin : 202.Dingil’dzhe : 165, 169.Diodote : 131, 181, 215-216.Diodote ii : 216.Djarkutan : 158.Djoumboulaq Koum : 159.Doura europos : 201.Douze Dieux : 68-69
Égypte : 69, 71, 178.enduit mural : 25, 48-49, 53, 55, 88.enduit à gravillons : 85-87, 127, 148, 152-153, 156.Éphèse : 80.erkurgan : 202.Étiquette : 185.eucratide ier : x, 131, 133-134, 137-138, 140, 153, 181, 184-186, 195-196, 210-212, 214, 217-219.eucratide ii : 219.eucratidia (eucratidéia) : 1, 217.euphrate : 205.euthydème ier : x, 44-45, 131, 137, 184, 191, 216-217.euthydème ii : 131, 134.exèdre : 9, 76-79, 81-85, 88-91, 217.
Fenêtre : 16.Fer : 9, 62-63, 83, 94, 97-98, 108, 110-112, 119, 134, 150-151, 163, 171. Fer (âge du) : 158-159, 176.Figurine : 62, 164, 167, 171.
AK IX.indb 238 03/06/13 11:19
239iNDex GÉNÉraL
Fondation (mur) : 9, 15-16, 19-20, 22-24, 26-27, 29, 31, 34-35, 44, 46-60, 78-79, 81, 83-84, 89, 95, 97, 105-108, 110, 118, 129, 133, 138-139, 145, 153-154, 162, 166-167, 203-204.
Fondation (ville) : x, 1-2, 145, 181-183, 191, 198-199, 209-212, 214-215, 217.Fosse : 24, 46-47, 60, 62, 68, 93, 111, 148-150, 162, 167-169, 181, 184-185, 199.Foyer : 6, 17-18, 27-30, 32-33, 35, 37-43, 47-49, 51, 53-58, 61, 78, 81, 83, 86-88, 90, 94-97, 104, 111,
115-116, 119-124, 126-130, 132-134, 139-143, 146-147, 152, 154-155, 160, 163-164, 166-169, 193, 198-199, 211.
France : 5, 172.Fût (de colonne) : 9, 18, 21-22, 80, 112-114, 132.
Gandhâra : 159.Genévrier (Juniperus) : 10, 17-18.Goujon : 112, 114, 149.Graffito : 52, 63-64, 184.Grands Kouchans : 165, 199, 202.Gravillon : 6, 10, 15, 19, 31, 33-34, 59, 80, 83, 85-87, 106, 124, 126-128, 148, 152-156, 189.Grèce : 10, 22, 181.Gréco-Bactriens : 1, 47, 71, 160, 167, 172, 175, 204, 217, 219.Grecs : 2, 8, 10, 37, 77, 90, 96, 98, 131, 134, 146-147, 151, 153, 157, 165, 170, 175-177, 185, 196,
201, 203, 207, 210-212, 218.Grès : 98, 166, 171.
Haci Nebi : 164.Halicarnasse : 80.Harappéens : 167, 172.Hatra : 201.Hélioclès : 218.Héliodotos : 217.Héraclès : 44.Hindukush : 10, 219.Huile : 63, 169, 181, 218.
ilion : 70.Ilioupersis : 70.In antis : 18-20, 76, 78-79, 104, 109, 145, inscription : 146, 181, 200, 209, 213, 217-218.iran : 201-203, 205, 207.
Japon : x, 5.Justin : 219.
Kaboul (musée de) : 68, 72.Kalaly-Gyr : 176.Kampyr-Tépé : 185.Keriya : 169.Khorezm : 176.Khurha : 202-204.Kinéas : x, 2-3, 5, 7, 140, 145-146, 150, 153, 158, 179, 198, 200, 213-214, 219.Kizil-su : 10, 64.Kjuzeli-Gyr : 176.
AK IX.indb 239 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT240
Kohna Qala : 2, 176, 183, 214.Kokcha : ix-x, 1, 3, 10, 13-14, 93, 97, 164, 179, 183.Koktepe : 176, 182-183.Kouchan(e) : 1, 6, 63, 157-161, 164-165, 169, 171, 175-177, 199, 202-203, 211.Ksirov : 64.Kuh-i Khwaja : 206.Kuliab : 217.Kurganzol : 182.Kyzyl-Tépé : 176.
Lagides : 215.Lait de chaux : 88, 95.Lampe : 164, 168, 171, 174.Larissa : 201.Leukophryena : 215.Lesbos : 80.Louvre : 71-72.Lysias : 219.
magasin : 26, 50, 63, 90, 96, 146, 149, 155, 170, 185, 195.magnésie du méandre : 80, 215.mansur-depe : 206.mausolée : 80.maximes delphiques : 146.méditerranéen(ne, s) : 50, 52, 64, 68, 179, 184, 216-217.méditerranéen (monde) : 10, 184, 204, 215, 217.méditerranée orientale : 181.méduse : 71, 187-188.ménippos : 80.mésopotamie : 158, 202-203, 205-206.mésopotamien(ne) : 201, 209.mésopotamien (monde) : 209.messa : 80.meule : 43, 98, 123, 125, 129, 134, 140-143, 160, 163-164, 166-168, 170-171, 177.métier à tisser : 123, 134, 170.milet : 80.mit rahina : 72.modèle (plâtre) : 62, 68-69, 184.mongolie : 159.monnaie : 44-45, 61, 131, 133-134, 181, 184, 201, 213, 215-216, 219.
- Tétradrachme : 130.mortaise : 11, 21-22, 76, 80-82, 112-116, 119, 122.mortier : 9-10, 15-16, 18-20, 23-24, 26-27, 31, 33-37, 39, 43, 45, 48-49, 54, 57-60, 79, 85-86, 94, 106,
116, 127, 130, 143, 150, 152-154, 156.mosaïque : 6, 10, 15-17, 31-34, 41, 43, 47-48, 59, 85, 155, 163, 196. moulage (plâtre) : 60-62, 68-73, 184-185.mycène : 201.
Nagidos : 215.Nécropole : 64.
AK IX.indb 240 03/06/13 11:19
241iNDex GÉNÉraL
Néréides : 80.Niches : 6, 17, 28-30, 32, 38, 40, 43, 51, 53-54, 58, 87-88, 94-95, 122, 126, 129, 139, 145, 151, 168-
169, 171.Nippur : 206.Nisa : 80, 202-203, 205-206.Nisa-mithradatkert : 202.Nomade(s) : 1, 8, 63-64, 96, 98, 131, 142, 146-147, 149, 151, 153, 158-159, 183, 212, 218-220Nuristan : 10.
olynthe : 87, 171.orient : 9, 170, 177, 190, 201, 207.os, ossement : 23, 42, 129-130, 158.
- Crâne : 64, 159. - squelette : 158.
ostobara (*oskobara) : 1, 210.ouigours : 169.ouzbékistan : ix, 158, 182.ovin : 170-172.oxèboakès : 201.oxybazos : 201.
Pakistan : 10.Paktiya : 10.Palmette : 184, 186-187.Parnasse (mont) : 10.Parthes : 78, 203, 205, 207.Pasargades : 209.Pergame : 80, 187.Perse(s) : 157-161, 176-177, 211.Persépolis : 206-207, 209.Peson : 90, 123, 134, 138, 141-143, 155, 163-164, 166-170.Philoxénè : 63.Pierre à huile (à affûter) : 163.Pilier : 70, 160.Pisé : 9, 16, 59, 77, 105-107, 110, 115, 118, 120-124, 138-139, 141-142, 148-150, 153, 156, 160, 169,
198-199.Plafond : 9, 23, 108, 111, 115, 121.Platon : 218.Plâtre : 6, 10, 15, 20-21, 27, 31, 34, 43, 56, 59, 60-61, 68-73, 79, 86, 89, 106, 108, 111, 116-117, 127-
128, 138, 147, 152-155, 184-185.Pline l’ancien : 10.Plinthe : 18, 21-22, 79-82, 86, 90, 98, 108, 111, 113, 116, 127-128, 145, 204.Plomb : 9, 11, 98, 108, 110-112, 143, 151.Polybe : 216.Pompéi : 71.Portes de Fer : 182.Poséidon : 68-69.Poteau : 39, 142, 146-148.
- Trou de — : 20, 24, 27, 47, 81, 146.Poutre : 8, 10, 17, 30, 47, 108, 111, 115, 119-121, 123.
AK IX.indb 241 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT242
Priène : 80, 201.Proche-orient : 64, 207.Ptolémée : 217.Ptolémée iii : 182.Pylos : 201.Pyxide : 61-62, 90, 164, 171.
Queue d’aronde : 171.Qum : 203.Qumrud : 203.
réserve : 163, 169, 185.rhodes : 184.roseau : 9-10, 17, 23, 108.rue d’Ulm : x, 5.rustaq : 171.
sakhsanokhur : 202.salle de bain : 16, 33-34, 41, 45, 59, 87, 138-140, 210, 218.salle d’eau : 6, 33, 60, 139, 153, 156, 163.salle de séjour : 124, 195-196. samarcande : ix, 182.sapallitépa : 158.sardes : 80.schiste : 61-62, 90, 97, 164, 171, seistan afghan : 201.séleucide(s) : 89, 131, 146, 178, 183, 191, 204-206, 209, 214-217.séleucie du Tigre : 201.séleucos ier : 89, 131, 134, 145, 212, 214, 216.serrure : 61.seuil : 3, 9, 16, 25, 27-29, 31, 37-38, 52, 54, 86, 89, 118-119, 122, 126, 128, 133, 138, 150, 199.shajdullaev : 176.shortughaï : 6, 157, 162, 164-165, 167, 169, 171-172, 176-177, 180, 200.sibérie du sud : 159.sirkap : 170.sminthien : 80.sogdiane : 176, 202.strabon : 217.strangford : 71.strigile : 90.stuc : 32, 59, 62, 80, 87, 126, 128, 148, 196.surkhan Darya : 158.suse : 206, 209.swat : 159.syr-Darya : 202.syrie : 178, 215.
Tadjikistan : 217.Taklamakan : 159.Talashkan-Tépé : 176.
AK IX.indb 242 03/06/13 11:19
243iNDex GÉNÉraL
Takht-i sangin : 170, 185.Tambour (colonne) : 11, 21-22, 80, 108, 110, 113-115.Tandour (four à pain) : 18, 42-43, 166-167, 169.Taxila : 171.Téhéran-ispahan : 203.Temple : 70, 80, 204, 206.Tenon : 114, 119, 171, 174, 188.Théophraste : 10.Tépé Zargaran : 80.Termez : 1.Terre cuite : 6, 34, 61-62, 69, 80, 83-84, 93, 126-130, 138, 146, 152, 155, 160, 163-164, 171, 198.Thirynthe : 201.Tibet : 159.Tigre : 201, 205.Toit : 10, 16-17, 86, 108, 130, 141-142, 146-147, 155, 196.Toiture : 9, 24, 104, 108, 121, 160.Tombe : 159, 176-177, 199.Torchis : 9-10, 15, 17, 23, 31-32, 34, 36-38, 40, 43, 49, 51, 53, 60, 79, 82, 85, 88, 108, 115, 124-125,
128, 132, 152, 160, 162-164, 166-168.Toreutique : 62, 71.Trésor : 130-131, 133, 219.Troade : 80.Tuile : 10, 41, 108, 130, 132, 143, 149-150, 155, 161, 210, Turkestan chinois : 147.Turkménistan : 202, 206.Turquie : 181.Tuyau : 6, 32, 34, 61, 84, 93, 126-131, 155, 163.
Urbanisme : 3-4, 210.Utique : 206.
Vasque : 28, 121, 130, 134, 152-153, 173.Verre : 69, 97.Vin : 169.Vitruve : 10.
xanthos : 80.xinjiang : 159, 169, 177.
Yaz-1 : 159.Yaz-2/3 : 159.
Zaghunluk : 159.Zeus : 80.Zeus sosipolis : 80.Zulm : 157-159, 176.
AK IX.indb 243 03/06/13 11:19
TaBLe Des FiGUres
IntroductionFig. 1- aï Khanoum. Plan général de la ville.
Chapitre 1. La maison du quartier sud-ouestFig. 2 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Coupe stratigraphique nord-sud dans le couloir 4b
de l’état ii.Fig. 3 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan général restitué, état ii.Fig. 4 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Coupe sur la rue nord.Fig. 5 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan général, état i et ii.Fig. 6 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan corps de logis, état i et ii.Fig. 7 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Porche 2, base d’ante est.Fig. 8 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Porche 2, base d’ante ouest.Fig. 9 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Porche 2, base de colonne.Fig. 10 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Coupe schématique est-ouest sur le vestibule 4a,
à l’aplomb de son mur sud.Fig. 11 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan état iii avec les constructions mitoyennes à
l’ouest et au nord.Fig. 12 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Détail de la porte d’entrée de la maison.Fig. 13 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Foyer de la pièce 7.Fig. 14 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan salle 15, radier en brique crue supportant la
mosaïque de l’état ii.Fig. 15 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan restitué, état iii.Fig. 16 – aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan des constructions mitoyennes à l’ouest.Fig. 17 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan état iV/1.Fig. 18 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan état iV/2.Fig. 19 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan restitué, état iV.Fig. 20 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan état V.Fig. 21 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Plan restitué, état V.Fig. 22 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. Coupelle à piédouche en ivoire.Fig. 23 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. armes.Fig. 24 - aï Khanoum. maison du quartier sud-ouest. moulages en plâtre : 1. Po n° 1041 ; 2. Po n° 1040 ;
3. Po n° 1042 ; 4. Po n° 1043.
Chapitre 2. La résidence en bordure de la rue principaleFig. 25 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Plan général des secteurs fouillés.Fig. 26 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Plan restitué.Fig. 27 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Coupe schématique est-ouest.
AK IX.indb 245 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT246
Fig. 28 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Plan secteur nord.Fig. 29 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. exèdre 2, ante est.Fig. 30 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. exèdre 2, base ouest.Fig. 31 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Plan secteur sud.Fig. 32 - aï Khanoum. résidence en bordure de la rue principale. Plan secteur central.
Chapitre 3. Le bâtiment du quartier sud-estFig. 33 - aï Khanoum. Bâtiment du quartier sud-est. Plan.Fig. 34 - aï Khanoum. Bâtiment du quartier sud-est. Plan restitué, état ii/2.Fig. 35 - aï Khanoum. Bâtiment du quartier sud-est. Plan restitué, état ii/1.Fig. 36 - aï Khanoum. Bâtiment du quartier sud-est. Trouvailles.Fig. 37 - aï Khanoum. Bâtiment du quartier sud-est. Base.
Chapitre 4. La maison hors les mursFig. 38 - aï Khanoum. maison hors les murs. Plan général restitué.Fig. 39 - aï Khanoum. maison hors les murs. Plan du corps de logis.Fig. 40 - aï Khanoum. maison hors les murs. Plan de la colonnade.Fig. 41 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porte entre le porche 2 et la pièce centrale 3.Fig. 42 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, base de l’ante est, plan.Fig. 43 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, détail des moulures de l’ante est.Fig. 44 a - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, pierre d’attente du chapiteau de l’ante est Y35.Fig. 44 b - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, pierre d’attente Y35 du chapiteau de l’ante est.
Profil.Fig. 45 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, base de colonne.Fig. 46 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, tambours de colonne Y 3, Y 4 et Y 5.Fig. 47 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, tambours de colonne Y 7, Y 8 et Y 9.Fig. 48 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, colonne restituée.Fig. 49 - aï Khanoum. maison hors les murs. Porche 2, chapiteau restitué.Fig. 50 - aï Khanoum. maison hors les murs. Pièce centrale 3, base de colonne.Fig. 51 - aï Khanoum. maison hors les murs. Pièce centrale 3, âtre.Fig. 52 - aï Khanoum. maison hors les murs. seuil de la porte sud-est entre 4c et 11.Fig. 53 - aï Khanoum. maison hors les murs. Coupe schématique nord-sud sur la porte sud-est entre 4c et 11.Fig. 54 - aï Khanoum. maison hors les murs. Pièce 7, foyer.Fig. 55 - aï Khanoum. maison hors les murs. Pièce 10, foyer.Fig. 56 - aï Khanoum. maison hors les murs. Plan et coupe de l’ensemble balnéaire.Fig. 57 - aï Khanoum. maison hors les murs. Dessin d’un élément de canalisation en pierre.Fig. 58 - aï Khanoum. maison hors les murs. Plan de la cuisine 18.Fig. 59 - aï Khanoum. maison hors les murs. Dessin d’une pointe de lance en fer.
Chapitre 5. Le quartier du temple principalFig. 60 - sanctuaire du temple principal. Plan restitué du sanctuaire avec le quadrillage correspondant
aux carrés de fouille.Fig. 61 - sanctuaire du temple principal. Plan de la partie nord du sanctuaire avec ses dépendances.Fig. 62 - sanctuaire du temple principal. Plan de la partie sud de la maison située au nord-ouest du
téménos.Fig. 63 - sanctuaire du temple principal. Plan des vestiges situés au sud du téménos.
Chapitre 6. Le quartier d’habitation près de l’hérôon de KinéasFig. 64 - aï Khanoum. secteur de l’hérôon de Kinéas. Plan.Fig. 65 - aï Khanoum. Hérôon de Kinéas. État 4. Plan.
AK IX.indb 246 03/06/13 11:19
247TaBLe Des FiGUres
Chapitre 7. Habitat rural achéménide hellénistique et kouchan dans la plaine d’Aï Khanoum-Shor-tughaï
Fig. 66 - a : carte de la plaine d’aï Khanoum, potentiel agricole, cité, canaux et « tépés » 111, 106, 97, 209 ; B : situation du « tépé » 97 près des canaux et dérivations antiques.
Fig. 67 - site 106. a : plan du niveau « achéménide » ; B : plan du niveau kouchan ; C : section montrant les occupations « P » et « K » ; D : couche de décombres et os de porcs au niveau du sommet de la banquette.
Fig. 68 - site 97. a : plan ; B : section.Fig. 69 - site 209 (shortughaï). Plan.Fig. 70 - site 209 (shortughaï). Plan de répartition des trouvailles.Fig. 71 - a : site 209 (shortughaï), proposition de restitution partielle avec tracé en pointillé du canal ;
B : site 97, restitution.
Chapitre 8. La céramique de la maison du quartier sud-ouest d’Aï KhanoumVoir ci-après, fig. 82 à 122.
Chapitre 9. Les différents types d’habitat à Aï KhanoumFig. 72 - aï Khanoum : 1 maison du quartier sud-ouest état ii ; 2 maison hors les murs ; 3 résidence du
palais.Fig. 73 - aï Khanoum : 1 maison du quartier sud-ouest état ii ; 2 maison hors les murs ; 3 résidence du
palais, bloc médian ; 4 résidence du palais, bloc sud-ouest.Fig. 74 - aï Khanoum : 1 maison du quartier sud-ouest état iii ; 2 résidence en bordure de la rue princi-
pale ; 3 plan restitué du manoir hellénistique de shortughaï.Fig. 75 - aï Khanoum. Détail du plan du palais.Fig. 76 - aï Khanoum. Plan du palais.Fig. 77 - aï Khanoum. Ville haute, maisons grecques.Fig. 78 - Plans de résidences : 1 palais de Pylos ; 2 sakhsanokhur ; 3 Dal’verzin ; 4 Dil’berdjin.Fig. 79 - Plans de résidences : 1 Nisa (Turkménistan) ; 2 Khurha (iran) ; 3 abu Qubur (irak).Fig. 80 - Plans : 1 assur ; 2 Nippur ; 3 mansur-depe.Fig. 81 - Plans : 1 ayadana de suse ; 2 maison de Persépolis ; 3 « temple » de Kuh i Kwaja.
Catalogue de la céramique provenant de la maison du quartier sud-ouest à Aï KhanoumFig. 82 - Grandes jarres.Fig. 83 - Petites jarres.Fig. 84 - Pots à lèvre en bourrelet plus ou moins aplati à l’horizontal et équarri.Fig. 85 - Pots à lèvre décalée à l’intérieur.Fig. 86 - Cruches sans anses : lèvres arrondies.Fig. 87- Cruches sans anses (suite) : lèvres en méplats épais et fonds plats ou en forme de disque.Fig. 88 - Cruches sans anse (suite) ou à une anse : lèvre rabattue.Fig. 89 - amphores.Fig. 90 - Gourdes et vase bouteille.Fig. 91 - Petits pots, cruchons et/ou lagynos, beige-rosé ou à engobe rouge.Fig. 92 - Petits pots, cruchons et/ou lagynos en pâte gris-noir, plus ou moins couverte d’engobe noir.Fig. 93 - Terrines ou bassins : lèvre droite ou triangulaire.Fig. 94 - Terrines ou bassins (suite) : lèvre rabattue, lèvre à extrémité épaissie, lèvre arrondie ou équarrie.Fig. 95 - Terrines ou bassins (suite) : lèvre plate horizontale, montante ou tombante.Fig. 96 - Cratères à paroi sinueuse verticale ou oblique.Fig. 97 - Cratères à paroi convexe : lèvre aplatie plus ou moins tombante.Fig. 98 - Cratères à paroi convexe (suite) : lèvre aplatie plus ou moins à l’horizontal, terminaison effilée
ou épaissie.
AK IX.indb 247 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT248
Fig. 99 - Cratères à paroi verticale et/ou légèrement convexe (suite) : lèvre aplatie peu saillante et lèvre évasée.
Fig. 100 - Décors, pieds et fonds de cratères.Fig. 101 - assiettes à lèvre saillante longue dites « assiettes à poisson » : lèvre pendante à la verticale ou
oblique. Fig. 102 - assiettes à lèvre saillante courte droite et à lèvre à terminaison supérieure épaissie. Fig. 103 - assiettes à lèvre saillante courte convexe ou rabattue.Fig. 104 - assiettes à lèvre épaissie.Fig. 105 - assiettes à lèvre présentant un léger renflement à l’intérieur le long du bord.Fig. 106 - assiettes à lèvre à renflement interne très prononcé, voire rebord.Fig. 107 - assiettes en céramique fine gris-noir, à lèvre saillante ou épaissie. Décors à l’intérieur d’assiettes
et/ou de bols en céramique de table fine gris-noir.Fig. 108 - assiettes en céramique fine gris-noir, à lèvre à renflement interne le long du bord.Fig. 109 - Bols à lèvre droite ou très légèrement épaissie et paroi droite ou convexe.Fig. 110 - Bols à lèvre droite ou très légèrement épaissie et paroi carénée.Fig. 111 - Bols à lèvre droite (ou épaissie ou amincie) et paroi à ressaut (1-8) et bols à lèvre épaissie voire
saillante et paroi convexe ou carénée (9-14).Fig. 112 - Bols en céramique de table fine gris-noir, à lèvre droite, épaissie ou roulottée et paroi carénée
ou convexe.Fig. 113 - Bols plus ou moins hémisphériques à lèvre effilée (1-7) ou soulignée par un bourrelet à l’inté-
rieur (8, 11-15).Fig. 114 - Bols hémisphériques à décor moulé en relief (dits mégariens) (1-8) et fonds de bols à décor de
palmettes estampées (9-11).Fig. 115 - Bols à lèvre rentrante.Fig. 116 - Bols en céramique de table fine gris-noir, à lèvre décalée (1-3) et à lèvre rentrante (4-10).Fig. 117 - Bols à lèvre fortement saillante, horizontale (1-10) ou tombante (11-14), de dimensions
moyennes.Fig. 118 - Bols à lèvre fortement saillante, horizontale ou tombante, de petites dimensions.Fig. 119 - Bols à lèvre peu saillante, horizontale ou tombante.Fig. 120 - Gobelets.Fig. 121 - Lampes et vases miniatures ouverts et fermés.Fig. 122 - Céramique de cuisine.
AK IX.indb 248 03/06/13 11:19
TaBLe Des PLaNCHes
Pl. i1- aï Khanoum. Vue aérienne de la partie sud-ouest de la ville basse avec le quartier d’habitation et le
palais.2 - Le quartier résidentiel sud-ouest vu des premières pentes de la ville haute.
Pl. ii1 - aï Khanoum, vue restituée de la ville à partir du rempart nord (image o. ishizawa, G. Lecuyot
© NHK Taisei).2 - aï Khanoum, vue restituée de la ville à partir du théâtre (image o. ishizawa, G. Lecuyot © NHK
Taisei).
Pl. iiiaï Khanoum. Vues restituées de la maison du quartier résidentiel sud-ouest (image o. ishizawa, G. Le-
cuyot © NHK Taisei).
Pl. iV1 - Vue de la maison du quartier sud-ouest depuis le nord.2 - maison sud-ouest, porche 2 vu de l’est au moment de la découverte.3 - maison sud-ouest, base de l’ante ouest du porche 2.4 - maison sud-ouest, base de colonne est du porche 2.
Pl. V1 - maison sud-ouest, vestibule 4a vu de l’ouest.3 - maison sud-ouest, couloir 4b vu depuis la pièce 13.2 - maison sud-ouest, le bloc central vu du sud.
Pl. Vi1 - maison sud-ouest, pièce 5 vue depuis le nord.2 - maison sud-ouest, entrée principale de la maison dans la pièce 5 et foyer extérieur tardif i/1.3 - maison sud-ouest, pièce 8, portes en enfilade de l’extrémité sud vues de la pièce 20.
Pl. Vii1 - maison sud-ouest, pièces 11, 12 et 13 vues de l’angle extérieur sud-ouest.2 - maison sud-ouest, pièce 11, foyer.
Pl. Viii1 - maison sud-ouest, ensemble balnéaire 14, 15, 16 et 17 vu de l’arrière de la maison.
AK IX.indb 249 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT250
2 - maison sud-ouest, pièce 15, substrat de briques crues en voie de dégagement.3 - maison sud-ouest, pièce 15 vue à partir de la pièce 16.
Pl. ix1 - maison sud-ouest, pièce 15, foyer à niche creusée dans le mur ouest et précédé d’une plaque de
mosaïque.2 - maison sud-ouest, pièce 16, départ nord de la voûte du guichet du mur est vu à partir de la pièce 17.3 - maison sud-ouest, pièce 17 vue depuis le nord.4 - maison sud-ouest, couloir 4c, état tardif, jarre contre le bouchage de la porte vers la pièce 3.5 - maison sud-ouest, vestibule 2a vu depuis l’est.
Pl. x1 - maison sud-ouest, pièce 7, foyer de l’état ii et traces de l’occupation tardive (muret coupe-vent et
fragments de jarre).2 - maison sud-ouest, pièce 18, angle nord-est avec les foyers tandour des états i/1 et i/ii.3 - maison sud-ouest, pièce 18, angle sud-ouest avec trois foyers tardifs de l’état i/1, vue vers le sud.4 - maison sud-ouest, pièce 15, foyer de l’état i/1 contre le mur ouest.
Pl. xi1 - maison sud-ouest, couloir 4c de l’état ii avec couloir 29 et restes arasés du mur sud de la cour 1 de
l’état iii.2 - maison sud-ouest, pièce 3 de l’état ii avec angle nord-ouest arasé de la cour 1 de l’état iii et trous de
poteaux de l’état ii.3 - maison sud-ouest, angle sud-ouest de la pièce 20 avec trouvailles sur le sol.4 - maison sud-ouest, amphore méditerranéenne retrouvée sur le sol de la pièce 21.
Pl. xii1 - maison sud-ouest, fouille en profondeur dans le couloir 4b de l’état ii.2 - maison sud-ouest, pièces 33 et 34 de l’état iii/iV vues du nord-ouest.3 - maison sud-ouest, pièce 35 avec au premier plan la limite sud des pièces 33 et 34 de l’état iii/iV.4 - maison sud-ouest, pièce 7 de l’état ii et 36 de l’état iV/1.
Pl. xiii1 - maison sud-ouest, pièce 38, mur ouest vu de l’est à l’état iV/2.2 - maison sud-ouest, salle de bain 41 de l’état V3 - maison sud-ouest, sondage dans le couloir 4b de l’état ii avec le puisard de l’état V.
Pl. xiVmaison du quartier sud-ouest. moulages en plâtre : Po nos 1041, 1040 et 1042.
Pl. xV1 - résidence de la rue principale, ensemble balnéaire en bordure de la terrasse naturelle, face au palais.2 - résidence de la rue principale, exèdre nord 2 vue de la cour 1.
Pl. xVi1 - résidence de la rue principale, exèdre 2, ante ouest vue du nord-est.2 - résidence de la rue principale, exèdre 2, base est.3 - résidence de la rue principale, exèdre 2bis, ante ouest vue vers le nord. Le bloc nord est cassé en deux
fragments.4 - résidence de la rue principale, exèdre sud 2bis vue de l’ouest.
AK IX.indb 250 03/06/13 11:19
251TaBLe Des PLaNCHes
5 - résidence de la rue principale, exèdre 2bis, base ouest.
Pl. xVii1 - résidence de la rue principale, sondage à l’est de la cour 1, pièces 6, 7 et 8 vues du nord.2 - résidence de la rue principale, sondage 9 vu du nord.3 - résidence de la rue principale, vestiaire 14 vu du nord.4 - résidence de la rue principale, salle d’ablutions 15 vue du sud.
Pl. xViii1 - résidence de la rue principale, porte entre la salle d’ablutions 15 et la salle d’alimentation en eau 16,
vue du sud.2 - résidence de la rue principale, salle d’alimentation en eau 16 vue du nord, et au sud salle d’ablu-
tions 15.3 - résidence de la rue principale, salle d’alimentation en eau 16, foyer dans le mur ouest.4 - résidence de la rue principale, cuisine 17, fragment basculé de foyer à section parabolique.5 - résidence de la rue principale, cuisine 17 vue du nord.
Pl. xix1 - résidence de la rue principale, cuisine 17, niche creusée dans le mur ouest avec son bouchage de
briques crues.2 - résidence de la rue principale, couloir 12 vu du nord avec l’amorce de la branche est-ouest.3 - résidence de la rue principale, passage 10, escalier vu du sud.4 - résidence de la rue principale, pièce 7, vases abandonnés de l’occupation tardive.
Pl. xx1 - Bâtiment sud-est, vue d’ensemble depuis le nord-est.2 - Bâtiment sud-est, rue ouest, canalisation en tuyaux de terre cuite recouverte de galets.3 - Bâtiment sud-est, rue ouest.
Pl. xxi1 - Bâtiment sud-est, angle sud-est de la pièce 4 vu du nord-ouest avec débris de vases de la réoccupation
post-grecque.2 - Bâtiment sud-est, pièce 1, foyer appuyé contre le mur est.3 - Bâtiment sud-est, pièce 4 vue du nord avec vases tardifs et matériels divers de la réoccupation post-
grecque.4 - Bâtiment sud-est, pièce 9 vue du nord-est.
Pl. xxii1 - maison hors les murs vue de la cour 1. Dans le fond, le rempart nord de la ville basse avec l’emplace-
ment d’une tour dégagée.2 - maison hors les murs vue vers le nord. au premier plan, la partie de service avec l’ensemble balnéaire.
Pl. xxiii1 - maison hors les murs, porche 2, maçonnerie de l’angle sud-ouest avec l’assise de pisé.2 - maison hors les murs, porche 2, angle nord-est de la porte sud avec l’emplacement d’un montant du
cadre d’huisserie.3 - maison hors les murs, porche 2, bouchage de l’embrasure nord de la porte vers la pièce 3.4 - maison hors les murs, porche 2 vu de la cour 1 avec les restes de la colonnade.
AK IX.indb 251 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT252
Pl. xxiV1 - maison hors les murs, porche 2, restes de l’ante est.2 - maison hors les murs, porche 2, ante ouest vue de dessus.3 - maison hors les murs, porche 2, face nord de l’ante est remontée.4 - maison hors les murs, porche 2, face nord de l’ante ouest.5 - maison hors les murs, porche 2, détail de l’ante est avec un scellement entre le parement et le noyau
intérieur.6 - maison hors les murs, porche 2, fragments de chapiteau d’ante (Y517 et Y14+169).
Pl. xxV1 - maison hors les murs, porche 2, base de la colonne est.2 - maison hors les murs, porche 2, chapiteau.3 - maison hors les murs, porche 2, lit de pose du chapiteau.4 - maison hors les murs, pièce centrale 3 vue du sud-est.5 - maison hors les murs, pièce 3, base de la colonne ouest.
Pl. xxVi1 - maison hors les murs, pièce 3, vue vers le nord avec le foyer construit devant la porte vers le porche 2.2 - maison hors les murs, couloir 4a, bouchage de la porte nord-ouest vers la cour 1.3 - maison hors les murs, couloir 4b, emplacement d’un montant d’huisserie dans la porte vers la pièce 6.4 - maison hors les murs, embrasure sud de la porte sud-est du couloir 4c vers le couloir 11 avec restes
d’huisserie.5 - maison hors les murs, embrasure sud de la porte sud-est du couloir 4c vers le couloir 11 avec restes
carbonisés du montant d’huisserie sud-est.
Pl. xxVii1 - maison hors les murs, vue des pièces 7 et 6 depuis le sud-est.2 - maison hors les murs, pièce 6, intérieur de la porte vers son annexe 8 avec au milieu de la photo, au-
dessus du parement sud, une entaille pour l’about du linteau.3 - maison hors les murs, pièce 6, poutres carbonisées retrouvées sur le sol.4 - maison hors les murs, pièce 7, bouchage de la porte vers 6.5 - maison hors les murs, pièce 7, foyer.
Pl. xxViii1 - maison hors les murs, annexe 8, bouchage de la porte vers 9.2 - maison hors les murs, pièce 10, foyer contre le mur sud avec dans l’angle sud-ouest deux meules.3 - maison hors les murs, pièce 10, angle sud-ouest, pesons retrouvés sur le sol.4 - maison hors les murs, angle sud-ouest de la pièce 3 avec le foyer tardif.5 - maison hors les murs, angle sud-est du couloir 4c avec le foyer tardif.
Pl. xxix1 - maison hors les murs, couloir 11 et 4c vus de l’ouest.2 - maison hors les murs, couloir 12b, alignement de demi-briques en travers du couloir et fragments de
meules et de gourde de pèlerin.3 - maison hors les murs, couloir 12b, petit réduit en maçonnerie.
Pl. xxx1 - maison hors les murs, les trois locaux de l’ensemble balnéaire 14, 15 et 16 vus du sud.2 - maison hors les murs, pièce 14, foyer.
AK IX.indb 252 03/06/13 11:19
253TaBLe Des PLaNCHes
Pl. xxxi1 - maison hors les murs, enfilade des pièces 15 et 14 vues du nord à partir de la pièce 16.2 - maison hors les murs, salle d’ablutions 15 vue de l’ouest avec les restes du mortiers de plâtre du dallage
pillé.
Pl. xxxii1 - maison hors les murs, pièce 15, angle nord-ouest.2 - maison hors les murs, pièce 16, ouverture du conduit d’évacuation des eaux usées vers la pièce 15.3 - maison hors les murs, pièce 16, mur ouest avec le guichet voûté (a) et l’emplacement pour le conduit
en pierre (b).4 - maison hors les murs, pièce 18, scellement en plâtre du conduit en pierre.5 - maison hors les murs, pièce 16, conduit en pierre.
Pl. xxxiii1 - maison hors les murs, cuisine 18, vue générale depuis l’ouest.2 - maison hors les murs, cuisine 18, débouché dans le mur ouest du conduit d’évacuation en terre cuite
venant de la pièce 15 et traversant la pièce.3 - maison hors les murs, pièce 18 vue de l’est avec les restes d’un foyer tardif (29) et d’une jarre (30)
enfoncés dans la couche grise. Dans le fond, porte vers 19 avec les vestiges d’un bouchage tardif posant sur la couche grise.
Pl. xxxiV1 - sanctuaire du temple principal. Partie nord du téménos. Vue vers l’est avec, au premier plan à gauche,
la pièce 2.16 et au second la pièce 2.17.2 - sanctuaire du temple principal. maison au nord-ouest du téménos. Vue vers l’est des pièces en enfilade
2.14, 2.15 et 2.16.
Pl. xxxV1 - sanctuaire du temple principal. maison au nord-ouest du téménos. Vue vers l’ouest de la pièce 2.16
à partir de la pièce 2 .15.2 - sanctuaire du temple principal. maison au nord-ouest du téménos. Pièce 2.16, détail de la baignoire
de la maison nord-ouest, vue de dessus.3 - sanctuaire du temple principal. maison au nord-ouest du téménos. Pièce 2.16 avec son tuyau pour
l’évacuation des eaux usées.
Pl. xxxVi1 - sanctuaire du temple principal. Foyer de la pièce 1.07.2 - sanctuaire du temple principal. angle nord-est de la cour du téménos avec, en haut à gauche, la pièce
2.13 et, en bas à droite, la pièce 2.03.
Pl. xxxVii1 - site 111 (Zulm) : poterie du niveau achéménide.2 - site 111 (Zulm) : jarre funéraire in situ.3 - site 111 (Zulm) : squelette dans la jarre.
Pl. xxxViii1- site 106 : vue générale.2 - site 106 : brique marquée.3 - site 106 : vue vers le nord des murs m1 et m2, banquette.
AK IX.indb 253 03/06/13 11:19
FoUiLLes D’aï KHaNoUm ix. L’HaBiTaT254
Pl. xxxix1 - site 97 : vue générale.2 - site 97 : pièce 2, silo.3 - site 97 : pièce 4, plate forme, muret et foyer.4 - site 97 : pièce 7, canalisation.
Pl. xL1 - site 209 (shortughaï) : mur nord de la pièce 1 et jarre-foyer.2 - site 209 (shortughaï) : extérieur ouest et niveaux hellénistiques près du canal.3 - site 209 (shortughaï) : pièces 2 et 3 et leurs cheminées.4- site 209 (shortughaï) : foyer F1 de la pièce 2.
Pl. xLi1 - site 209 (shortughaï) : foyer F2 de la pièce 3 avec matériel en place.2 - site 209 (shortughaï) : jarre J4 et briques près de la pièce 4.3 - site 209 (shortughaï) : poterie en place dans la pièce 3.4 - site 209 (shortughaï) : poterie en place carré a5 extérieur sud de la pièce 1.
Pl. xLii1 - site 209 (shortughaï) : pesons en argile crue.2 - sirkap (Taxila) : meule à trémie dans la cour du stupa F (1970).3 - site 209 (shortughaï) : lampe dans le mur est de la pièce 2.
Pl. xLiii1 - Lampe (dans le mur nord de la pièce 1).2 - Couvercle de schiste gravé (décombres, surface de la pièce 1 ; dessin de G. semoun).3 - Figurine de bélier (décombres, surface de la pièce 1).4 - Figurine féminine (couche moyenne, extérieur ouest de la pièce 1).5 - site 209 (shortughaï) : objets de fer (décombres).
Pl. xLiVCéramique de table fine à décor de palmettes estampées.
Pl. xLVCéramique de table fine à décor de palmettes estampées (suite).
Pl. xLViDécors incisés, estampés, appliqués et moulés sur diverses formes de récipients.
Pl. xLViiBol à décor moulé en relief, dit mégarien.
Pl. xLViiiFragments de bols moulés à décor en relief dits mégariens.
Pl. xLixDivers décors en haut relief, graffiti et figurine.
Pl. LVases complets, assiettes et bols.
AK IX.indb 254 03/06/13 11:19