Garreta, J. "Immigration et politiques d’intégration en Catalogne: quelques enjeux"...
Transcript of Garreta, J. "Immigration et politiques d’intégration en Catalogne: quelques enjeux"...
Vol. 23, n° 134-135
mars - juin 2011
Immigration
en Catalogne :
politiques et société
L’influence canadienne
sur les migrations
post-communistes bulgares
DOSSIER
Migrations Société
Immigration en Catalogne : politiques et société
Dossier coordonné par Catherine Wihtol de Wenden et
Ricard Zapata-Barrero
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
139
IMMIGRATION ET POLITIQUES D’INTÉGRATION EN CATALOGNE : QUELQUES ENJEUX
Jordi GARRETA BOCHACA *
En Catalogne, le nombre d’immigrés n’a cessé d’augmenter depuis les années 1960, même s’il s’agissait alors de faibles mouvements de popu-lation, pour s’accroître de façon notoire au cours des années 1990 et surtout dans la décennie suivante.
Immigration et politiques d’intégration Le premier constat que nous pouvons faire concerne donc l’accrois-
sement rapide du flux d’immigration : les étrangers représentaient 2,42 % de la population de la Catalogne en 1998, 4,4 % en 2001, 8,62 % en 2005 et 14,32 % selon les données disponibles au 31 mars 20101.Si la hausse de ce taux est un indicateur important, la diversification des origines2, celle du profil des immigrés (âge, genre3, culture, langue, religion, etc.) et la présence des immigrés sur l’ensemble du territoire catalan (des grandes villes aux zones rurales) le sont tout autant4. Cepen-dant, l’impact sur le territoire est variable : tandis qu’à certains endroits cette présence est faible, à d’autres elle est comparativement élevée. Récente et inégale donc, la présence étrangère en Catalogne a eu des
* Sociologue, Département de géographie et de sociologie, Université de Lleida, Espagne.
Contact : [email protected]
1. Données de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), www.idescat.cat
2. Selon les données de l’IDESCAT, en 2010 les étrangers les plus nombreux étaient les Marocains (246 921), les Roumains (95 502), les Équatoriens (87 216), les Italiens (43 761), les Chinois (47 539), les Colombiens (47 238) et les Péruviens (39 589). Voir www.idescat.cat
3. Au fil du temps, on observe un processus de féminisation de l’immigration, surtout celle en provenance d’Amérique latine, bien que les chiffres globaux indiquent que, en 2009, le pourcentage d’hommes restait supérieur à celui des femmes : 54,63 %, contre 45,37 %.
4. Cf. GARRETA, Jordi, La integración sociocultural de las minorías étnicas (inmigrantes y gitanos),Barcelona : Ed. Anthropos, 2003, 380 p. ; GARRETA, Jordi, Sociedad multicultural e integración de los inmigrantes en Cataluña. Discursos y prácticas, Lleida : Edicions de l’Universitat de Lleida, 2009, 130 p.
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
140
répercussions démographiques, économiques, sociales et culturelles diverses selon les contextes5.
Cette évolution a marqué la réaction du gouvernement catalan en matière de politiques d’intégration. À partir de 1993, la Generalitatde Catalogne amorce une politique globale d’immigration, consolidée en 2000 avec la création d’un Secrétariat à l’immigration (Secretaria per la Immigració)6 et qui aboutit au Plan relatif à la citoyenneté et à l’immigration (2005-2008). Ainsi, en à peine 15 ans, la Communauté autonome de Catalogne a ouvert le chemin aux plans d’intégration des immigrés en Espagne, en même temps qu’elle a construit — et construit encore — une politique d’intégration des immigrés.
L’analyse de la documentation existante nous permet de distinguer trois phases de cette construction7. La première, qui va jusqu’à la création du Secrétariat à l’immigration en vertu du décret 293/2000 du 31 août 2000, peut être définie comme une phase d’observation du phénomène durant laquelle ont lieu les premières interventions des différentes insti-tutions et des différents échelons de l’administration dans le champ migra-toire. Il s’agit d’une période au cours de laquelle l’immigration n’avait pas encore augmenté au même rythme que celui que l’on constatera à partir de 2000.
Depuis lors, une définition du modèle d’intégration, une action plus dé-terminée et une coordination plus étroite entre les différents Departaments8
ainsi qu’entre les différents échelons de l’administration de la Catalogne sont devenues absolument nécessaires et caractérisent cette deuxième phase (2000-2005) comme une phase d’observation et d’organisation.
5. Voir, par exemple, BIRSL, Ursula ; SOLÉ, Carlota (coordinadoras), Migración e interculturalidad
en Gran Bretaña, España y Alemania, Barcelona : Ed. Anthropos, 2004, 383 p. ; SOLÉ, Carlota (coordinadora), El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora,Barcelona : Ed. Anthropos, 2001, 286 p. ; SOLÉ, Carlota ; IZQUIERDO, Antonio (coordinadores), Integraciones diferenciadas : migraciones en Cataluña, Galicia y Andalucía, Barcelona : Ed. Anthropos, 2005, 364 p. ; PAJARES, Miguel, Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2007. Análisis de datos de España y Cataluña, Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008, 148 p., http://www.aytosagunto.es/repositorio/5intercultural_informe2007.pdf ; MÉNDEZ LAGO, Mónica, L’opinió dels catalans sobre la immigració, Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2009, 75 p.
6. Cf. SOLÉ i AUBIA, Montserrat, “Els immigrants estrangers a Catalunya : la il-lusió d’un viatge”, Revista Digital d’Informació i Investigació Social, n° 1, febrer 2002, http://cv.uoc.edu/DBS/a/ materials/portada/forum/articles/immigrants.html
7. Voir GARRETA, Jordi, Sociedad multicultural e integración de los inmigrantes en Cataluña. Dis-cursos y práctica, op. cit. ; GARRETA, Jordi, “La atención a la diversidad cultural en Cataluña : exclusión, segregación e interculturalidad”, Revista de Educación, n° 355, 2011 (à paraître).
8. L’administration de la Generalitat de Catalogne est structurée en Departaments (ou Conselleries)dont les titulaires sont les consellers qui composent le gouvernement dirigé par un président [NDLR].
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
141
La troisième phase, encore en cours, qui a démarré récemment et dont il faudra observer le développement, peut être considérée comme une phase d’observation, d’organisation et d’intervention. Elle commence avec le Plan relatif à la citoyenneté et à l’immigration (2005-2008), qui a mis en évidence, d’une part, la déconnexion entre les programmes et les objectifs politiques et, d’autre part, le besoin de miser davantage sur les interventions au moyen de plans et de programmes spécifiques, ainsi que celui d’allouer des fonds (sans doute plafonnés) pour atteindre les objectifs fixés. Intervenir sur l’ensemble du territoire devient une priorité, bien que l’observation du phénomène et surtout l’organisation de l’admi-nistration ne doivent pas être délaissées pour pouvoir donner des réponses.
Dans ce contexte, des politiques de scolarisation des élèves d’origine étrangère ont été développées, mais naturellement elles ont été condi-tionnées par l’évolution de leur présence dans les établissements scolaires9.À l’instar de l’augmentation de la présence étrangère en Catalogne, celle du nombre d’élèves d’origine étrangère ne se réduit pas à une simple question de chiffres, puisque le nombre des pays de provenance a aug-menté engendrant une plus grande diversité culturelle et linguistique10.
Au milieu des années 1990, le nombre d’élèves d’origine étrangère en Catalogne est faible, se chiffrant à quelque 10 000, concentrés pour une grande partie dans l’enseignement public. À la fin des années 1990, leur nombre commence à augmenter de façon considérable, et à partir de 2000 l’accroissement est ininterrompu, confirmé par la publication des données définitives relatives à l’année scolaire 2009-2010, qui indiquent 14,1 % d’élèves étrangers dans l’enseignement primaire et 17,6 % dans l’enseignement secondaire, y compris les jeunes ayant dé-passé l’âge de la scolarité obligatoire (16 ans). Les données montrent aussi que les élèves originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale sont les plus nombreux, suivis des Maghrébins, notamment des Marocains, les élèves originaires d’Amérique du Nord étant les moins nombreux.
La dynamique qui préside à la répartition des élèves d’origine étran-gère relève notamment du lieu de résidence et de l’existence de places libres dans les différents établissements scolaires11, dynamique qui a eu 9. Cf. GARRETA, Jordi, La integración sociocultural de las minorías étnicas (inmigrantes y gitanos),
op. cit. ; LLEVOT, Núria ; GARRETA, Jordi, “La intervención con el alumnado inmigrante en los centros escolares de Cataluña”, in : MARTÍNEZ USURRALDE, María Jesús (coordinadora), Ypara muestra... Políticas educativas de inmigración y modelos de escuela que practican la inter-culturalidad, Valencia : Universitat de Valencia, 2010, pp. 111-134.
10. À ce sujet, voir dans ce même dossier la contribution de Josep Vallcorba, page 153 [NDLR].
11. La question de la gratuité de l’enseignement est ici secondaire, car la plupart des établissements privés sont sous contrat.
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
142
pour résultat une présence plus forte des élèves étrangers dans le secteur public que dans le secteur privé, une présence plus importante dans certains établissements plutôt que dans d’autres12. On observe, en outre, des différences en fonction de l’origine nationale. Par exemple, quand on se penche sur le groupe des élèves étrangers fréquentant les éta-blissements privés, on constate qu’ils sont majoritairement originaires des pays de l’Union européenne, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. De tels décalages n’ont fait que s’accentuer au fil des années13.
Graphique 1 : Évolution de la distribution des élèves étrangers dans l’ensei-gnement primaire14 et dans l’enseignement secondaire obli-gatoire15 en Catalogne en fonction des secteurs
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
01999-20001998-1999 2000-2001 2001-2002 2003-20042002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Établissements scolaires publics Établissements scolaires privés Total
Source : Departament d’Educació. Servei d’Indicadors i Estadística. Estadistica de l’Educació, Catalunya.
Un autre phénomène dont il faut tenir compte dans le domaine de la scolarité est l’incorporation tardive, c’est-à-dire l’arrivée des élèves étran-gers en cours d’année. Pour l’année scolaire 2007-2008, par exemple, les données du Departament de l’Éducation indiquent que 4 950 élèves ont été incorporés en cours d’année (4 433 dans le secteur public et 517 dans le privé), contre 803 au cours de l’année scolaire 2004-2005.
12. Voir à cet égard SÍNDIC DE GREUGES, La segregació escolar a Catalunya. Informe extraordinari,
Barcelona : Síndic de Greuges, 2008, 229 p., http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2266/ segregacio_escolar_web.pdf
13. www20.gencat.cat/portal/site/Educacio
14. Enfants de 6 à 12 ans ; enseignement obligatoire.
15. Scolarité obligatoire de 12 à 16 ans.
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
143
On constate donc sur une période très courte une hausse considérable de cette catégorie d’élèves. Par ailleurs, ce sont encore les établissements scolaires publics qui accueillent la plupart des élèves d’origine étrangère.
Les agents impliqués dans le développement des poli-tiques migratoires
• Le développement des politiques d’intégration L’évolution que nous venons de décrire et le décalage observé entre
les discours et les pratiques16 nous ont conduit à entreprendre une étude auprès des agents travaillant dans le domaine migratoire à différents échelons de l’administration ainsi qu’auprès de membres des partis politiques représentés au Parlement de la Catalogne, afin d’analyser les discours tenus au sujet de la politique d’intégration des immigrés17.
En général, le personnel politique et les agents des collectivités locales établissent un lien entre la difficulté de prévoir les mouvements migra-toires et la difficulté d’agir sur l’immigration, autrement dit, ils considèrent qu’il est impératif de lier les politiques d’immigration et les politiques d’intégration. Les premières devraient agir sur les flux migratoires, mais elles n’ont pas réussi à les réguler, car ils sont imprévisibles18. La difficulté résulterait du fait que les compétences dans le domaine sont partagées, l’État espagnol étant responsable de la politique d’immigration et les Communautés autonomes ayant dans une large mesure à leur charge la responsabilité de l’intégration des immigrés. Si la communication et la coor-dination entre ces deux niveaux ne sont pas appropriées, il est difficile d’assurer une organisation et des interventions efficaces.
16. Cf. GARRETA, Jordi, La integración sociocultural de las minorías étnicas (inmigrantes y gitanos),
op. cit.
17. Cf. GARRETA, Jordi, Sociedad multicultural e integración de los inmigrantes en Cataluña. Discursos y prácticas, op. cit. Ce travail empirique a été effectué sur l’ensemble du territoire catalan et a compris des entretiens avec 13 représentants des communautés de communes, 10 des munici-palités, trois de la Generalitat de Catalogne et cinq des partis politiques représentés au Parlement de la Catalogne, donc au total 31 entretiens en profondeur, qui ont fait suite à l’ana-lyse de la documentation publiée par la Generalitat.
18. Antonio Izquierdo développe cette idée d’une « immigration imprévisible ». Voir IZQUIERDO, Antonio, La inmigración inesperada. La población extranjera en España (1991-1995), Madrid : Editorial Trotta, 1996, 287 p. Il ressort de nos entretiens que l’idée d’“être submergé” est prédo-minante dans le discours, bien qu’elle ne soit pas exprimée sous cette forme. Nos interviewés considèrent qu’il est nécessaire d’avoir une politique migratoire ferme et claire, un contrôle accru des flux, étant donné que les politiques d’immigration menées jusqu’à présent ne correspondraient pas vraiment aux besoins du marché du travail de la Catalogne.
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
144
Bien que la politique d’intégration ait considérablement évolué, une plus grande cohérence serait nécessaire entre, d’une part, les interventions des différentes institutions, organisations et associations et, d’autre part, les discours officiels, ainsi qu’une meilleure coordination entre tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Au sein de l’administration en particulier, la coordination entre les différents services et à l’intérieur même des ser-vices n’est pas toujours idéale, et il en est de même pour les organisations travaillant dans le domaine de l’immigration ou pour les associations d’immigrés.
Nous avons donc constaté l’existence d’une conviction générale selon laquelle le “modèle catalan” d’intégration devrait être mieux défini, que ce qu’il convient de faire et la manière de le faire devraient être mieux connus, qu’une meilleure coordination entre tous les agents impliqués serait nécessaire, comme il serait nécessaire de disposer de plus de ressources humaines et économiques pour faire face aux enjeux. Or l’augmentation des besoins n’a pas entraîné une hausse correspondante des ressources consacrées à l’aide sociale et éducative. En outre, se ren-force une perception selon laquelle les immigrés accapareraient la plupart des ressources, qu’ils recevraient beaucoup alors qu’ils contribueraient peu. Cela indique que le travail de sensibilisation est une priorité.
Les politiques d’intégration, particulièrement au niveau local19, ont eu tendance à considérer que le mouvement associatif — un nouvel agent dont il faut tenir compte — favoriserait le processus d’incorporation des immigrés à la société20. Dans l’enquête que nous menons actuellement en Catalogne21, nous observons chez les représentants de l’administration et des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour l’amélio-ration des conditions de vie des immigrés un intérêt marqué pour la création d’associations représentatives des immigrés avec lesquelles il soit possible de négocier et qui soient susceptibles, si nécessaire, d’apporter
19. Sur la question des politiques locales, voir MALUQUER, Elisabeth, “Municipios e inmigración”,
in : DIPUTACIÓ DE BARCELONA, II Informe sobre inmigración y trabajo social, Barcelona : Diputació de Barcelona, 1997, pp. 279-319 ; NADAL, Mònica ; OLIVERES, Rosa ; ALEGRE, Miquel Àngel, Les actuacions municipals a Catalunya en l’àmbit de la immigració, Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2002, 198 p.
20. L’accroissement du nombre d’associations majoritairement composées d’immigrés et dirigées par eux est flagrant dans les années 1990 et surtout dans la première décennie du XXIe siècle.
21. Cette enquête s’inscrit dans le projet de recherche Asociacionismo e inmigración africana : funciones latentes y manifiestas financé par le ministère espagnol de Ciencia e Innovación (CSO2008-01122/SOCI), et analyse 70 entretiens approfondis réalisés en Catalogne avec des représentants d’associations d’Africains et avec leurs interlocuteurs habituels au sein des admi-nistrations, des organisations non gouvernementales et d’autres organismes.
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
145
leur soutien à l’action publique22. Le caractère nouveau de ce dévelop-pement du tissu associatif engendre une grande diversité des formes d’organisation, et par conséquent des images. Certaines associations, encore peu nombreuses, peuvent être considérées comme ayant affirmé leur solidité et servent parfois de modèle à celles qui démarrent leurs activités et qui passent par des situations intermédiaires diverses, souvent caractérisées par un fonctionnement fondé sur le bénévolat et marqué par l’instabilité23.
Il arrive fréquemment que les organisations non gouvernementales ou l’administration demandent aux associations d’immigrés des rensei-gnements sur la réalité des conditions de vie de ceux qu’elles sont censées représenter, qu’elles sollicitent ces associations pour faire passer des messages aux immigrés, pour aider à résoudre des conflits ou pour par-ticiper à des programmes qui s’adressent à la population immigrée. Ces associations deviennent également des interlocuteurs lors des débats et discussions auxquels on souhaite voir participer des représentants des immigrés. Cette reconnaissance sociale des associations d’immigrés — qui pour leurs responsables représente aussi une reconnaissance personnelle — implique souvent pour elles de se conformer aux normes et aux façons de faire institutionnelles. Dans certains cas, les repré-sentants des associations d’immigrés expliquent que le prix de leur indépendance est une situation économique précaire et un faible degré de reconnaissance. Généralement, si l’association ne regroupe pas un nombre important de membres, elle ne doit pas sortir des sentiers battus pour se consolider. De la sorte, si les associations participent au développement des politiques publiques, elles sont en même temps déter-minées par ces dernières.
La politique des administrations, des organisations non gouverne-mentales et la réponse des associations d’immigrés sont encore en cours d’élaboration. En général, ce qui semble évident, c’est que l’on considère toujours le mouvement associatif des immigrés comme un atout pour leur intégration dans la société catalane, et de ce fait on l’encourage, en même temps qu’on limite ses possibilités de plein épanouissement. À l’heure actuelle, ce mouvement associatif se compose essentiellement d’un réseau de petites associations isolées, faibles et instables, qui servent les
22. Naturellement, il ne s’agit pas de nier que parfois ce sont les immigrés eux-mêmes qui, face à
un contexte où toute demande doit émaner d’un groupe, jugent nécessaire de s’associer pour se faire entendre ou pour démarrer une activité.
23. Cela n’empêche pas que ces associations se trouvent en situation de concurrence lorsqu’il s’agit de l’attribution de projets et de l’octroi de subventions.
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
146
intérêts des administrations locales. Ces associations coexistent difficile-ment avec quelques autres, peu nombreuses — dont nous avons dit qu’elles ont affirmé leur solidité — qui disposent d’un certain pouvoir et qui obtiennent des fonds importants et qui, dans certains cas, menacent la suprématie des associations locales dans leur “espace naturel”. Elles deviennent un “modèle” pour les associations moins favorisées qui font tout leur possible pour obtenir une “promotion” et se consolider. Cepen-dant, les besoins au quotidien (ressources économiques, locaux, disponi-bilité des militants), les intérêts particuliers des responsables associatifs, les intérêts des administrations locales, entre autres raisons, freinent la conso-lidation des associations d’immigrés, la coordination entre elles et le travail en réseau.
• Le développement des politiques d’éducation La politique d’éducation est une autre des questions-clés du processus
d’incorporation de la population étrangère à la société. La Catalogne a fait des progrès dans la reconnaissance de la présence et de la valorisation de la diversité culturelle dans les établissements scolaires. Si initialement, comme dans toute l’Espagne, le système éducatif ne prenait guère en considération la diversité culturelle, il a cependant évolué jusqu’à reconnaître au plus haut point l’importance de cette diversité.
Au cours des années 1980 et 1990 les enfants immigrés ont été sco-larisés à l’aide de programmes compensatoires, dans le but d’améliorer leurs chances et de faciliter leur processus d’intégration, perçu plutôt comme un processus d’assimilation24. Dans le milieu des années 1990, l’augmentation du nombre d’élèves d’origine étrangère et les orientations du Conseil de l’Europe ont eu une importance décisive dans le choix de trois lignes de travail prioritaires : consolider le rôle du catalan et de l’aranais25, encourager l’éducation interculturelle (fondée sur l’égalité, la solidarité et le respect de la diversité des cultures) et favoriser l’égalité des chances26.
24. Cf. PALAUDÀRIAS, Josep Miguel, “Análisis de la política educativa en la escolarización de las
minorías culturales en Cataluña”, in : BESALÚ, Xavier ; CAMPANI, Giovanna ; PALAUDÀRIAS, Josep Miguel (compiladores), La educación intercultural en Europa, Barcelona : Ed. Pomares-Corredor, 1998, pp. 171-180.
25. Dialecte occitan et langue officielle du Val d’Aran, dans le nord-ouest de la Catalogne.
26. www.xtec.cat/lic/documents1.htm
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
147
Dans le cadre du Plan pour la langue, l’interculturalisme et la cohésion sociale27 (LIC), des équipes professionnelles ont été mises en place, desclasses d’accueil ouvertes dès l’année scolaire 2004-200528, en même temps que des « plans éducatifs de proximité » étaient mis en œuvre.
On peut donc constater que des actions d’envergure visant à favo-riser la scolarisation des élèves d’origine immigrée ont été réalisées, mais d’autres enjeux de taille restent posés. Peut-être le plus important d’entre eux est-il celui de la formation des enseignants et des outils qu’il faut mettre à leur disposition pour faire face à une réalité complexe. Les enseignants en général et ceux qui travaillent dans des établis-sements ayant une forte présence d’élèves d’origine étrangère en particulier considèrent qu’ils portent une surcharge de responsabilités, et souvent ils ne savent pas traduire dans leurs pratiques le discours sur l’interculturalité. En fait, ceux qui prennent des initiatives deviennent des référents (leurs “bonnes pratiques”), les autres essayant de les copier, surtout ceux qui ont “le problème” dans leur établissement ou dans leur classe, puisque, de l’avis général, il ne s’agirait pas là d’un sujet à travailler dans tous les établissements, bien qu’une telle appré-ciation ne corresponde pas à la démarche officielle en la matière.
Au fil du temps, la formation initiale des enseignants dans le domaine de la diversité culturelle, dispensée dans les facultés des sciences de l’éducation — avec des matières obligatoires et des matières en option, visant à renforcer les capacités d’analyse et d’intervention en contexte multiculturel — a été plutôt insuffisante. Cependant, des changements sont intervenus et l’on a introduit la diversité culturelle dans la formation initiale des enseignants, surtout dans les nouveaux cursus de licence (graduat) mis en place récemment. Par ailleurs, la pression de la réalité a encouragé la formation des enseignants dans ce domaine, surtout lorsqu’ils ont des élèves étrangers dans leur établissement ou dans leur classe. Si l’on peut reprocher quelque chose à cette formation, c’est de ne pas être suffisamment pratique.
27. Llengua i Cohesió Social.
28. Sur les classes d’accueil, voir ALEGRE, Miquel Àngel ; BENITO, Ricard ; GONZÁLEZ, Sheila, Del’aula d’acollida a l’aula ordinària : processos d’escolarització de l’alumnat estranger, Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2008, 88 p. ; BENITO, Ricard ; GONZÁLEZ, Sheila, De l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Orientacions per a la transició, Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2010, 86 p.
Voir également, dans le présent dossier, la contribution de Josep Vallcorba, page 153 [NDLR].
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
148
Une étude récente29 montre que l’augmentation de la population immigrée dans les établissements scolaires a requis la mise en place de ressources destinées à prendre en charge des actions spécifiques et a impliqué des changements très importants sur le plan de l’organi-sation, de la composition et du fonctionnement de la classe ou du groupe, sur le plan de la méthodologie de travail et des approches du cursus scolaire. L’existence de classes fort hétérogènes est une des caractéristiques de la situation actuelle, et les différences de niveau font que les en-seignants considèrent nécessaire un renforcement des ressources humaines.
La demande d’un accroissement des moyens de tout type, mais no-tamment humains, est presque unanime, les ressources disponibles actuel-lement étant considérées comme insuffisantes pour aborder efficacement la situation dans certains établissements scolaires. Dans ceux où il existe une forte mobilité, où l’on enregistre des inscriptions et des départs tout au long de l’année, la classe d’accueil ne peut pas remplir ses fonctions avec succès. En effet, l’arrivée continue de nouveaux élèves a pour conséquence le transfert dans les classes ordinaires des élèves arrivés précédemment, même s’ils ne sont pas parvenus au bout du processus d’adaptation. Et même si cela touche un nombre limité d’éta-blissements, ceux qui sont concernés éprouvent de graves difficultés pour accomplir les tâches qui leur ont été assignées en raison de la saturation des classes d’accueil, le surnombre d’élèves empêchant les enseignants de s’occuper de chacun de manière individualisée et suivie tout au long du processus d’adaptation.
Par ailleurs, tous les enseignants interviewés jugent que les classes d’accueil et le travail qui y est fait sont très positifs, aussi bien pour les nouveaux arrivants — car cela facilite leur adaptation et accélère l’acquisition des compétences linguistiques — que pour les tuteurs péda-gogiques des groupes et des établissements en général. Les classes d’accueil et les équipes LIC sont bien appréciées, mais elles sont insuffi-santes pour garantir un bon accueil aux enfants d’origine immigrée et à leurs familles, pour permettre aux enseignants de s’occuper à la fois des élèves suivant le cursus général et faire leur travail d’enseignants.
29. Cf. GARRETA, Jordi, LLEVOT, Núria ; BERNAD, Olga, La relació família d’origen immigrant i
escola primària de Catalunya, Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 2010, 335 p., non publié. Dans le cadre de l’enquête, 25 entretiens approfondis ont été réalisés avec des enseignants travaillant dans des écoles maternelles et primaires (élèves âgés de 3 à 12 ans) de la Catalogne accueillant en nombre variable des enfants immigrés et 25 entretiens avec des parents représentant la diversité des origines et des situations rencontrées dans les établissements scolaires. Les en-tretiens ont été suivis d’une phase ethnographique qui s’est étendue sur trois mois dans huit établissements situés aussi bien dans des zones urbaines que dans des zones rurales de la Catalogne et où la présence immigrée est variable.
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
149
Bien que l’on considère que les moyens sont appropriés, comme nous l’avons déjà signalé, le manque de temps, d’effectifs et de moyens ma-tériels fait que les classes d’accueil ne peuvent pas accomplir la tâche pour laquelle elles ont été créées, les besoins dépassant les ressources disponibles.
En résumé, en raison de la pression exercée par l’accroissement de la diversité culturelle dans les classes d’accueil, par l’arrivée d’élèves tout au long de l’année scolaire et à différents moments de leur parcours scolaire, par la formation insuffisante des enseignants, etc., les équipes qui épaulent le travail de ces derniers ne parviennent pas à dissiper complètement le sentiment de surcharge éprouvé par certains d’entre eux enseignant dans des établissements où l’on enregistre une forte présence de population d’origine immigrée récemment arrivée. Comme le montrent nos propres enquêtes, qui révèlent aussi les progrès importants faits en Catalogne depuis que le nombre d’étrangers dans les classes a com-mencé à augmenter, les lignes de travail prioritaires sont :
* l’adéquation de la pratique quotidienne au discours théorique relatif à la cohésion sociale et à l’interculturalité ; pour ce faire, il semble néces-saire de renforcer le travail des équipes LIC et de favoriser davantage l’innovation en matière d’éducation dans les établissements scolaires en vue de travailler sur la diversité culturelle, indépendamment de la présence ou non d’élèves étrangers, puisque selon le discours interculturel dominant, tous les établissements scolaires doivent se préparer à exister dans une société culturellement diverse ;
* l’adéquation des ressources humaines et matérielles au nombre d’élèves étrangers, particulièrement dans le secteur public. Si au milieu des années 1990 nous avons assisté à une baisse des inscriptions en raison du faible taux de natalité et de la fermeture ou de la réorganisation de certains établissements scolaires, l’arrivée progressive d’immigrés, la hausse du taux de natalité et l’augmentation des heures de cours se sont conjuguées pour engendrer un manque de salles de classe et d’enseignants, ce qui a accrédité l’idée que les problèmes qui se posent aujourd’hui au système éducatif sont dus à l’immigration, à laquelle on attribue la plus grosse partie de la responsabilité des dysfonctionnements, en particulier dans les établissements à forte concentration de population scolaire d’origine étrangère. Pour parvenir à ce second objectif, il semble indispensable de disposer de fonds plus importants pour conduire les processus d’accueil des élèves (et de leurs familles), ainsi que leur incorporation dans les établissements scolaires en cours d’année, avec davantage de garanties ;
Dossier – Immigration en Catalogne : politiques et société
Vol. 23, n° 134-135 mars – juin 2011
150
* l’amélioration de la formation des enseignants, étant donné que la transmission du discours interculturel repose en grande partie sur eux et que leur formation — initiale et continue — a été historiquement insuffisante, bien qu’elle se soit améliorée au cours des dernières années. Cette formation à l’interculturel doit constituer une formation spécifique à tous les enseignants, qu’ils soient ou non concernés dans l’immédiat par la diversité culturelle dans leurs classes, puisque dans le “modèle catalan” l’éducation interculturelle est destinée à préparer l’élève à une vie en commun dans une société multiculturelle, que ce soit aujourd’hui ou à l’avenir.
Conclusions L’immigration a augmenté et s’est diversifiée d’une manière impor-
tante en Catalogne, spécialement au cours des dix dernières années, ce qui a engendré des inquiétudes politiques et sociales, renforcées par le fait que la compétence en matière de politique migratoire appartient au gouvernement central espagnol. Si on a souvent voulu caractériser les politiques des autorités catalanes dans ce domaine comme le ré-sultat d’une improvisation face à une situation qui dépassait leurs capacités de gestion, l’analyse de l’évolution des divers Plans interdepartamentals relatifs à l’immigration et d’autres documents pertinents nous permet de constater à la fois un accroissement et une diversification rapide de l’immigration, mais aussi une réponse de même nature en ce qui concerne la définition des politiques dans le domaine de l’accueil et de l’intégration sociale des immigrés ainsi que les interventions de la Generalitat.
Bien que les progrès soient indéniables, il y a également des points faibles : d’une part, il est communément admis, surtout parmi les agents publics qui travaillent dans le domaine de l’immigration, qu’il est né-cessaire d’affiner la définition du “modèle catalan d’intégration”, d’assurer une plus grande diffusion de l’information sur ce qu’il convient de faire et sur la manière de le faire, d’améliorer la coordination entre l’admi-nistration, les organisations non gouvernementales, les associations d’immigrés et les autres organisations ayant aussi un rôle à jouer, mais aussi d’améliorer la coordination entre les administrations. Pour cela, il est indispensable de dégager davantage de ressources humaines et de financements pour être à la hauteur de l’enjeu.
La sensibilisation de la population est aussi une priorité, pour com-battre la perception déformée qui tendrait à rendre les immigrés responsables des problèmes existants et à les qualifier de “profiteurs”. Il
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne
Migrations Société
151
ne faut pas oublier que lorsque les besoins sociaux augmentent et que les moyens de les satisfaire ne suivent pas, le discours du refus de l’Autre se renforce.
Les politiques d’éducation sont un autre enjeu de taille. De la même manière que nous avons pu constater combien leur définition et leur appli-cation concrète ont été remarquables, notamment si nous tenons compte des brefs délais de mise en œuvre, il est vrai aussi que la réalité du système éducatif catalan présente encore des lacunes qui exigent des actions prioritaires, telles que nous les avons énumérées ci-avant.
En résumé, sans nier les progrès effectués, la Catalogne doit être consciente des impacts sociaux et éducatifs de l’immigration et y donner une réponse politique adéquate si elle prétend définir un discours cohérent sur la cohésion sociale et l’interculturalité.
Impression : Corlet, Imprimeur, S.A.
Z.I. route de Vire - 14110 Condé-sur-Noireau
Dépôt légal : mai 2011 - N° d’ordre : XXXXX
Commission paritaire : n° 0111 G 87447
ISSN : 0995 - 7367
SOMMAIRE
ÉDITORIAL
Révolutions et migrations : faut-il avoir peur des démocraties arabes ?...... Vincent Geisser
ARTICLES
L’influence canadienne sur les migrations postcommunistes bulgares :
un effet direct sur la mobilité des francophones vers l’Hexagone ................ Stéphan Altasserre
Couples mixtes et hybridation transculturelle en Espagne :
réflexions à partir d’une recherche en cours et
perspectives de comparaisons européennes ................................................ Gerhard Steingress
DOSSIER - Immigration en Catalogne : politiques et société
(coordonné par Catherine Wihtol de Wenden et Ricard Zapata-Barrero)
Pourquoi la Catalogne intéresse-t-elle l’Europe ?.......................................... Ricard Zapata-Barrero
Catherine Wihtol de Wenden
I. Politiques d’immigration et citoyenneté
La politique d’immigration du gouvernement de la Catalogne :
approche, orientations et enjeux ..................................................................... Oriol Amorós i March
La gouvernance de l’immigration en Catalogne : d’où venons-nous,
où en sommes-nous et où allons-nous ? ................................................ Ricard Zapata-Barrero
L’immigration en Catalogne dans le contexte espagnol : l’évolution
de la démographie et des politiques publiques.............................................. Núria Franco i Guillén
Immigration dans les Baléares : impacts socioculturels sur la société......... Pere A. Salvà Tomàs
Instruments de participation pour les immigrés en Espagne
et en Catalogne en particulier : droit de vote et alternatives ......................... David Moya
II. Politiques d’éducation et apprentissage linguistique
Immigration et politiques d’intégration en Catalogne : quelques enjeux...... Jordi Garreta Bochaca
Éducation et immigration en Catalogne : le Plan pour la langue,
l’interculturalisme et la cohésion sociale......................................................... Josep Vallcorba
III. Politiques d’insertion sociale
L’exclusion liée au logement et le “sans-abrisme” au sein
de la population immigrée en Catalogne........................................................ Jordi Bosch Meda
L’Office du travail de Catalogne et l’emploi des immigrés............................. Angelina Puig i Valls
Droits des étrangers et politiques en matière de............................................ Elvira Méndez
protection de la santé en Catalogne ............................................................... Eduard Sagarra
Les associations d’immigrés en tant qu’outil d’intégration politique.............. Carol Galais
en Catalogne : les raisons de leur implication politique................................. Laia Jorba
IV. État des recherches sur la Catalogne et l’immigration
La recherche sur l’immigration en Catalogne : bilan 2000-2010 .................. Vicent Climent-Ferrando
Bibliographie sélective...................................................................................... Christine Pelloquin
NOTE DE LECTURE
Migrer au féminin (de Laurence Roulleau-Berger) ........................................ Luca Marin
DOCUMENTATION............................................................................................ Christine Pelloquin



















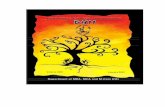


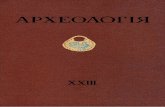





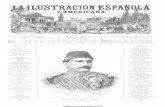
![Cristian Ioan Popa, Pandantive din piatră în cultura Coțofeni [Stone Pendants dated from Coţofeni Culture], în Drobeta, XXIII, 2013, p. 9-27](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63192ff8e9c87e0c09100123/cristian-ioan-popa-pandantive-din-piatra-in-cultura-cotofeni-stone-pendants.jpg)








