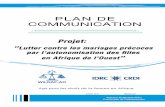Lutte contre la discrimination multiple: pratiques, politiques et ...
Evidentialisme contre volontarisme
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Evidentialisme contre volontarisme
Epistémologie de la croyance religieuse : L’éviden4alisme (et son
ennemi juré, le volontarisme)
Philosophie Contemporaine de la Religion
27 janvier 2014
Éviden4alisme : qu’est-‐ce que c’est ? • La croyance s’appuie sur des mo4fs de
crédibilité, elle est étayée par des raisons de croire (sans se réduire pour autant à ces seuls mo4fs, ni découler de ces seules raisons)
• Affirma4on qu’il y a des preuves ou au moins des données (evidence) sur la base desquelles on est fondé ou jus4fié à croire ce qu’on croit.
• « a wise man propor4ons his belief to the evidence » (Hume, Enquiry concerning human understanding , 1748-‐1758)
Dis4nguer • La ques4on du contenu proposi4onnel des croyances
religieuses • La ques4on des raisons de croire une proposi4on. En effet : • croyance proposi4onnelle (la croyance que p) • croyance objectuelle (croyance dans la propriété d’un objet) • croyance fiduciaire (l’aYtude de confiance envers une
personne, la croyance en quelqu’un) • accepta4on de croyance (belief acceptance) (Robert Audi,
« Belief, Faith and Acceptance », Int J Phil Rel (2008)) L’accepta4on de croyance n’implique pas la croyance à la vérité de la proposi4on
Plusieurs fois foi (R. Audi) • 1°) foi proposi4onnelle (foi que quelque chose est ainsi) ;
• 2°) foi dans un être (ou une ins4tu4on) ; • 3°) foi « créden4elle » (par laquelle on adhère aux ar4cles d’un credo) ;
• 4°) foi globale (par laquelle on caractérise une personne de foi) ;
• 5°)foi doxas4que, qu’on exerce lorsqu’on croit quelque chose « sur la foi » de quelqu’un ;
• 6°) foi d’accepta4on (acceptant faith) qui est en jeu lorsqu’on accueille une personne ou une proposi4on ;
• 7°) foi –allégeance ou foi loyauté, qui est la fidélité, ou la foi gardée envers quelqu’un
Éviden4alisme : la croyance encadrée par la norme du savoir
« le savoir est une croyance correcte accompagnée de sa jus4fica4on (logos) » (Platon, Théétète)
cf. Kant, Canon de la raison pure: croyance = degré suffisant de persuasion subjec4ve, insuffisance de raisons objec4ves (=convic4on). Cf. Lessing : : « La révéla4on n’apporte rien que la raison n’aurait pu découvrir par ses propres forces avec le temps » (Die Erziehung des Menschengeschlechts)
-‐ Circularité ? -‐ Régression à l’infini ? La jus4fica4on doit-‐elle être à son tour
correctement jus4fiée, etc. -‐ Nécessité d’une inspira4on, ou d’un savoir antérieur, ou de
croyances de base (fonda4onalisme) ?
Problème de GeYer (« Is jus4fied True Belief Knowledge? » 1963)
a. Smith a de bonnes raisons de croire que Jones sera embauché et que Jones a dix euros dans sa poche
b. Smith a de bonnes raisons de croire que celui qui sera embauché a dix euros dans sa poche.
c. En fait, c’est Smith qui va être embauché, et il se trouve qu’il a, à son insu, dix euros en poche
La croyance b est correcte et jus4fiée, et pourtant Smith sait-‐il vraiment qui sera embauché ? …
(Double-‐erreur compensatrice, opacité de la référence, …)
-‐Tu dis, Théétète, que savoir, c'est avoir une croyance correcte accompagnée de sa jus;fica;on? -‐ N’est-‐ce pas ce dont nous sommes convenus ? -‐ Si fait, Théétète, mais si la jus;fica;on tombait juste, sans qu'on pût parler d'un véritable savoir ? -‐ Que veux -‐tu dire Socrate ?Tu parles par énigme. -‐ Je vais t'éclairer : tu sais ce qui est arrivé à Lachès? -‐ Assurément Socrate. Il pensait que son ami Nicias serait élu stratège, mais c'est lui, je crois, qui a emporté ceNe charge. -‐ C'est la vérité, mais ce que tu ignores, et que n’ignorait pas Lachès, c'est que Nicias s’est fait une règle de toujours avoir dix drachmes dans sa poche. -‐
-‐Voyons, Socrate, qu'est-‐ce que cela peut faire ? -‐ Cela fait que Lachès, sachant que Nicias avait dix drachmes dans la poche, et persuadé que ce serait Nicias et non lui qui serait choisi comme stratège, Lachès, donc, croyait que celui qui serait désigné stratège avait dix drachmes en poche. -‐ Hé oui, absolument ! Mais il se trompait, n’est-‐ce pas ! -‐ Pas tout à fait, mon bon, car il se trouve que Lachès lui-‐même avait , tout à fait à son insu, dix drachmes dans sa poche. Qu'en dis-‐tu ? -‐ Ma foi, Socrate, j'en dis que tout compte fait, Lachès voyait juste ! -‐ Comment, par Zeus, peux-‐tu dire cela, puisqu'il ignorait parfaitement que ce serait lui qui serait élu stratège ? -‐ Ma foi, Socrate, tu jeNes le trouble dans mon esprit…
Tenta4ves d’émancipa4on de la croyance par rapport à la norme
éviden4aliste • Au diable les jus4fica4ons, je crois ce que je veux !
• Laissez-‐moi croire ce que je veux ! • Ne m’ôtez pas mes illusions ! • Qui êtes-‐vous pour me dire ce que je ne dois pas croire ?
• Je crois si j’en ai envie ! Etc.
« Toute croyance religieuse est irra4onnelle (au sens éviden4aliste)» :
deux lectures • Un fait : tout ce qui s’est présenté jusqu’ici au 4tre de croyance religieuse était irra4onnel…
• Une nécessité : aucune croyance religieuse ne peut, ne pourra, n’aurait pu être ra4onnelle.
Nécessairement , si C est une croyance religieuse, C est irra4onnelle. (« implicaLon stricte »)
(C)(C est une croyance religieuse→ C est irra4onnelle)
Échan4llon de croyances religieuses
• Les kami sont les divinités protectrices du foyer. • Celui qui écoute la Bhagavad Gita avec bienveillance sera affranchi du mal.
• Le Créateur récompense ceux qui suivent ses commandements et punit ceux qui les transgressent.
• Dieu s’est révélé à Moïse dans un buisson ardent. • Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. • Allah est grand et Mahomet est son prophète. • Le Fleuve sacré englou4t celui qui ne le respecte pas.
Rapide analyse des échan4llons • Affirma4on faisant intervenir des agents d’un autre monde ou des puissances surnaturelles
• Affirma4on de faits historiques (souvent controversés)
• Prescrip4ons (morales, rituelles, spirituelles) • Perspec4ves « sotériologiques » : libéra4on du mal et du péché, accomplissement de soi dans le Soi, ex4nc4on de soi, etc.
(réinterpréta4ons, relectures, exégèses)
« C est irra4onnelle » ↔? 1°) C est contraire aux normes de ra4onalité en vigueur (il est ra4onnel de croire que non-‐C)
2°) C échappe aux critères de ra4onalité en vigueur (ceux–ci sont inapplicables à C, il mais il peut être ra4onnel de croire que C)
Cf. « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu’il y a une infinité de choses qui la surpassent » (fr. 188)…. « Il n’y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison » (fr. 182)
• Quels critères ?
Critère de ra4onalité n°1 : éviden4alisme strict
• C est ra4onnelle ↔(Déf.) C est dérivable, par induc4on ou par déduc4on, de prémisses acquises naturellement et publiquement admises.
• Principe de Clifford : « il est mauvais, toujours, partout et pour quiconque de croire quoi que ce soit en l’absence de preuve suffisante (upon unsufficient evidence » (The Ethics of Belief, 1877) .
Un critère trop dras4que ? • Objec4on : Les croyances qui passeraient le test seraient aussitôt déclassifiées et réintégrées dans les croyances scien4fiques, philosophiques, historiques ? L’adepte d’une religion ne réclame –t-‐il pas un droit de croire sans raison ? Cf.« Le cœur a son ordre, l’esprit a le sien qui est par principe et démonstra4on.» (fr.298 )
• Réponse : Le critère n’est pas forcément binaire (reçu/recalé), mais permet une évalua4on progressive. Pas de démarca4on stricte entre pensée magique (non-‐falsifiable), et pensée scien4fique (empiriquement testable) mais polarité raison/supers44on. Pour un éviden4alisme faible.
Critère n°2 : fonda4onalisme Nos croyances sont fondées sur des principes, des jugements, des intui4ons de base, voire des sen4ments, qui ne sont fondés sur rien d’autre.
• Mais alors ou bien on a exclu a priori toute croyance religieuse , par exemple au nom d’un Principe de Clôture Causale du Monde Physique, (impliquant des puissances surnaturelles, un autre monde, etc.)
• Ou bien on les y inclut et alors toute espèce de croyance religieuse n’est ni plus ni moins ra4onnelle qu’une croyance d’origine scien4fique. Croire à la validité de l’a|rac4on newtonienne et croire à la lévita4on de Gautama Bouddha, serait également fondé.
Critère n°3 : la cohérence.
Nos croyances se fondent mutuellement les unes sur les autres, sans point de départ ou d’ancrage privilégié (ni chronologiquement, ni logiquement) .
Cercle : « Il faut croire que Dieu est, parce qu’il est ainsi enseigné dans les Saintes Ecritures. Il faut croire les Saintes Ecritures, parce qu’elles viennent de Dieu »
Critère sans doute nécessaire, mais certainement pas suffisant.
Soumise à ces critères la c. r. est : • ou disqualifiée
• ou requalifiée • ou noyée dans la masse des théories cohérentes (mais possiblement fic4ves ou délirantes)
Rendre jus4ce au caractère spécifiquement religieux de certaines croyances, sans les précipiter d’office dans l’infâme supers44on ?
Cf. « Si on soumet tout à la raison notre religion n’aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison notre religion sera absurde et ridicule »(fr. 173)
L’absurde revendiqué : Credo quia absurdum ?
« Le Fils de Dieu a été crucifié ? je n’ai pas honte puisqu’il y a de quoi avoir honte (non pudet quia pudendum est). Le Fils de Dieu est-‐il mort ? Il faut y croire puisque c’est absurde (credibile est quia ineptum). Enseveli, il est ressuscité : cela est certain puisque c’est impossible (certum est quia impossibile) » (Tertullien, De carne ChrisL, 5)
Difficile à croire (socialement ou psychologiquement) ≠ Impossible à croire (contradictoire).
Eviter l’absurde et le ridicule: le paradoxe de Moore
La dissonance croyance/savoir est acceptable en troisième personne, pas en première.
En troisième personne : « Il pleut mais M. Météo croit qu’il ne pleut pas »
En première personne: « Il pleut mais je crois qu’il ne pleut pas».
Croyances religieuses dissonantes • Dieu n’existe pas mais Woody Allen croit qu’il fait
par4e du peuple élu de Dieu. * Woody Allen dit : « Dieu n’existe pas mais nous sommes son peuple élu »
• Allah n’existe pas mais un tel croit que Mahomet est son prophète.
* Un tel proclame : « Allah n’existe pas mais Mahomet est son prophète »
• « Jésus est mort mais Saul croit que Jésus est vivant »
* Saul dit : « Jésus est mort mais je crois que Jésus est vivant ».
Le défi • Maintenir une composante éviden4aliste (privée ? publique ?) quant au contenu proposi4onnel de la croyance religieuse, pour me|re la croyance à l’abri de l’absurde…
• … sans sacrifier la part sui generis de l’adhésion religieuse (qui pourra rester « ra4onnelle » au sens très large du critère de cohérence)
Une piste Croyance religieuse = croyance proposi4onnelle + croyance fiduciaire, (confiance comportementale, adhésion, acte de foi, décision de s’engager dans une direc4on, composante volontaire) + implica4on d’en4tés ou de processus surnaturels ou spirituels
Croyance religieuse = préambules (au moins implicites) de la foi (exposés à la discussion ra4onnelle) + foi religieuse (cohérente avec les préambules, mais ambulante : va plus loin) + élément « sacré » « numineux » (sinon pas spécifiquement religieuse)
Deux problèmes (entre autres)
Problème 1 : les croyances religieuses risquent d’être condi4onnalisées par le degré de jus4fica4on des préambules. Probabilisme.
Problème 2 : la croyance est involontaire. La croyance religieuse échapperait-‐elle à la règle ? Volontarisme doxas4que ? Auto-‐sugges4on ? Fic4onalisme ?
Problème n°1 : le probabilisme • Risque que le degré d’adhésion de la foi religieuse soit limité par la probabilité subjec4ve des préambules ou des réquisits de la foi : « Louons Celui qui a probablement créé le ciel et la terre !»; « Notre Père qui es peut-‐être aux cieux »; « Ne fais pas cela, au cas où tu devrais être réincarné… »
• Dissocia4on de la perspec4ve éviden4aliste et de l’aYtude proposi4onnelle religieuse. Pseudo-‐Descartes: « l’ac4on de la pensée par laquelle on croit une chose étant différente de celle par laquelle on connaît jus4fie qu’on la croit, elles sont souvent l’une sans l’autre »
Dissocia4on jus4fica4on / engagement • Je ne crois pas sans raisons (même faibles), mais la façon dont je m’implique dans ce que je crois n’est pas nécessairement à la mesure de ces raisons.
• Le degré d’engagement de la croyance religieuse n’est pas directement propor4onnel au degré de jus4fica4on dont dispose le croyant (soit qu’on l’interroge, soit qu’il se demande lui-‐même quels sont les mo4fs de crédibilité de sa croyance)
Différents degrés de « volontarisme doxas;que » 1°) croire ce qu'on veut, c'est possible : il arrive que ce qu'on veut croire, on le croie, ce n’est pas contradictoire
2°) Il suffit de vouloir croire quelque chose pour le croire : la volonté de croire = condi4on suffisante d'un pouvoir de croire (qui est ici une possibilité agen4ve, et pas seulement logique)
(p) je veux croire p → je peux croire p 3°) On ne croit rien sans la volonté de le croire (volonté condi4on nécessaire)
(p) je peux croire p → je veux croire p. No will, no belief 4°) Tout ce que l’on croit, on le croit parce qu’on le veut bien et on ne croit que ce que l’on veut croire ? (volonté de croire condi4on nécessaire et suffisante)
Suffit-‐il de vouloir pour croire ? Contre-‐exemples ?
Argument général contre le volontarisme de la croyance Pascal : Détournement ou manipula4on des « évidences »
Méthode Coué
Effet Placebo
Saut de la foi Contre-‐exemples de croyances irrésis4bles ?
Where is a will (to believe) there is a way ? « ... pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque chose. »
(Descartes, Discours de la méthode)
L’argument de Swinburne
• « Si je décidais à volonté de croire que maintenant je vois [un éléphant], alors je réaliserais que ce|e croyance a sa source dans ma volonté, et qu’elle n’a donc aucune connexion avec le fait qu’il y ait ou non [un éléphant] devant moi. Je saurais donc que je n’ai aucune raison de me fier à ce|e croyance ; dès lors je n’y croirais plus réellement » (Swinburne Faith and reason, Oxford, Clarendon Press 2005 : 25).
L’Argument de Swinburne (2) • Je crois que p, parce que je veux croire que p. Ma seule raison de croire que p, c’est que je veux croire que p.
• Pourquoi ce volontarisme est probléma4que : Je sais que la vérité de p ne dépend pas causalement de ce qui fait que p est le cas, mais seulement du fait que je veux croire que p.
Auquel cas je ne crois pas vraiment que p (au sens où croire que p, c’est croire qu’il y a quelque chose qui fait que p) : je fais comme si je croyais que p.
Croire à volonté ?
« La volonté est un des principaux organes de la créance, non qu’elle forme la créance, mais parce que les choses sont vraies ou fausses selon la face par où on les regarde. La volonté qui se plait à l’une plus qu’à l’autre détourne l’esprit de considérer les qualités de celle qu’elle n’aime pas à voir, et ainsi l’esprit marchant d’une pièce avec la volonté s’arrête à regarder la face qu’elle aime et ainsi il en juge par ce qu’il y voit » (fr. 539)
Faire comme si ? « … je suis fait d’une telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-‐vous donc que je fasse ? -‐ … suivez la manière par où ils ont commencé. C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous fera croire et vous abê4ra. » (fr. 418) Efficacité du procédé ?
La croyance religieuse réduite à l’autosugges4on et au « comme si ». • En ma4ère de religion, on croit ce qu’on veut bien croire, on se condi4onne : méthode Coué.
• Ou bien on prétend transformer la réalité au moyen de la croyance : effet placébo (le croyant « trouve son compte », consciemment ou non, dans ce qu’il croit).
• Autosugges4on : la vérité dépend de la croyance, au lieu que la qualité de la croyance soit indexée sur la vérité de ce qui est crû.
La méthode Coué de la dame rose
« -‐ Pourquoi me parlez-‐vous de Dieu ? On m’a déjà fait
le coup du Père Noël. Une fois ça suffit ! -‐ Oscar, il n’y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël.
-‐ Si ; Pareil. Bourrage de crâne et compagnie […] Alors pourquoi est-‐ce que j’écrirais à Dieu ?
-‐ Tu te sen4rais moins seul. -‐ Moins seul avec quelqu’un qui n’existe pas ? -‐ Fais-‐le exister. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera complètement. Alors il te fera du bien »
Coué par étapes
• Je ne crois pas que Dieu existe plus que le Père Noël. La dame rose me convainc d'essayer :
• A J1 j'écris une le|re à Dieu • A J2, j'écris une deuxième le|re • Pour tout n supérieur à 1, Dieu existe plus à Jn qu'à Jn-‐1
• Il existe un n ,tel qu’à Jn « Dieu existe complètement et me fait du bien ».
Deux interpréta4ons • Oscar 1 : Je fais exister Dieu par l'opéra4on réitérée de faire comme s'il existait (ma constance a raison du caractère totalement et défini4vement fic4f du des4nataire : mes engagements ontologiques résultent de mes comportements). Dieu n’existe pas mais je lui ai beaucoup écrit (Moore / Allen). Je sais que ma croyance religieuse est auto-‐suggérée.
= Oscar du meilleur acteur
L’alterna4ve
• Oscar 2 : Je constate que j'ai créé les condi4ons de récep4vité à une rencontre avec Dieu, j'ai ouvert les bonnes portes, regardé dans la bonne direc4on, fait un travail d'ascèse (j'ai travaillé à diminuer mes passions, à épurer le moi pour le faire coïncider avec le Soi, etc.)
• J'écris à Dieu • J'offre un bélier à l'Eternel • J'offre un coq à Esculape • Je prends de l'eau bénite, je fais dire des messes • Je récite le Veda en sacrifice au Brahman L'interpréta4on fic4onnaliste présuppose la mauvaise foi du croyant. Elle n'est pas valable en première personne, car alors le croyant devrait savoir qu'il joue au croyant, ou pouvoir le reconnaître. Si la croyance religieuse = autosugges4on diachronique, il suffirait pour la défaire d’en remémorer les étapes.
• Croire à volonté -‐ ou au moins croire ce qu’on veut -‐ c'est envisageable diachroniquemen, mais pas synchroniquement : à t, on ne décide pas de ce qu’on croit à t.
• Mais même en différé, est-‐ce possible en première personne ?
A t, je ne crois pas que p, mais je fais en sorte qu’à t’> t, je sois davantage en mesure de croire que p.
Si à t’, je (ou on) me remémore tout ce que j’ai fait pour être en mesure de croire que p (je me suis mis en condi4on…) est-‐ce que je crois vraiment que p ?
La mise à nu du making of d’une croyance religieuse ne fragilise-‐t-‐il pas l’adhésion à ce|e croyance ?
Effet Placébo : • on prescrit le remède m à P.
• m est une substance thérapeu4quement neutre
• Si P croit que m a un effet, P guérit (mais m n’a toujours pas d’effet thérapeu4que) • Effet placébo : P croit qu'en prenant m , il va guérir. P prend m. P va guérir? Ques4on de fait : ça marche ou pas.
Placébo en première personne ? • je sais que m n'a aucune efficacité thérapeu4que • Je décide de croire que si je prends une substance qui ne me guérit que je si je crois qu'elle me guérit, alors je guéris
• je sais donc que c'est le fait de croire qu'elle me guérit qui me guérit.
• J'ai très envie de guérir. Je vais donc vouloir croire que m me guérit.
• Mais est-‐ce que je vais vraiment croire que m me guérit, alors que je sais que m ne me guérit pas ?
• Non mais ! Qu’est-‐ce que vous croyez ?
La réduc4on de la croyance religieuse à la seule auto-‐sugges4on
• Le fic4onnalisme décrit la croyance religieuse en termes de capacité à s’impliquer émo4onnellement dans quelque chose que nous savons être fausse (cf. consentement à l’illusion romanesque, théâtrale, ou cinématographique …)
• Problème : je ne peux faire comme si que si je sais que ce n’est pas comme ça. Donc, même si je me prends au jeu, je ne crois pas ce que je dis croire.
Le saut de la foi (Spielberg Indiana Jones et la dernière croisade, 1989): 1°) Je crois qu’il suffit de croire qu’il y a une passerelle, pour qu’il y ait une passerelle, alors qu’il n’y a pas de passerelle?
Le saut de la foi (suite) : 2°) Je crois qu’il y a une passerelle (invisible, fur;ve)
3°) Je crois que Dieu (ou la médita;on) peut me faire passer un ravin sans passerelle (suspension des effets
gravita;onnels)
Conclusions • Il est possible de rendre compte de la croyance religieuse d'une manière qui ne rende pas fatalement toute croyance religieuse irra4onnelle.
• Croyance religieuse = base proposi4onnelle (involontaire, non-‐contradictoire, suscep4ble d'évalua4on publique)
+ croyance fiduciaire (adhésion, engagement, décision comportementale)
+ rela4on à des agents ou des processus surnaturels
Conclusions (suite) • Pas d’excep4on « cultuelle » pour les croyances religieuses : elles ont comme toute croyance des condi4ons de vérité (par exemple : non clôture causale du monde naturel pour les religions théistes). Elles sont par4ellement falsifiables.
• Les interpréta4ons fic4onnalistes, ou exclusivement volontaristes (auto-‐sugges4on, Coué, comme si, placebo) sont recevables en troisième personne, mais ne sont pas sa4sfaisantes en première personne. Si elles l’étaient, l’adepte d’une croyance religieuse saurait qu’il est de mauvaise foi. Or, il y a des croyants sincères et néanmoins éclairés.
Bonus : adhésion à une révéla4on • Adme|re une croyance (quel que soit son contenu) comme
étant de source révélée n’est pas nécessairement irra4onnel. Mais cela implique l’existence de ce|e source de révéla4on. Et alors, ou bien l’existence de ce|e source est exclue (par un principe de clôture causale du monde). Et on se retrouve dans un cas de Moore/Allen. Ou bien elle est plausible (voire probable). Il peut être alors ra4onnel de croire une révéla4on.
• Une croyance est religieuse si l’une de ses condi4ons de vérité concerne l’existence d’agents ou de processus surnaturels.
• Une croyance est révélée si la manière dont elle est obtenue fait intervenir l’existence d’agents ou de processus surnaturels.
Condi4on nécessaire d’une révéla4on • Nul ne peut croire une révéla4on sans adme|re l’existence du révélateur, et sa capacité à intervenir dans le cours des événements physiques et/ou mentaux. Sinon cas de Moore : Il n’y a pas de révéla4on mais je crois ce qui est révélé.
• Conséquences : certaines croyances qu’on pouvait reléguer du côté du préjugé ou de la supers44on religieuse redeviennent des préambules (discutables) de la croyance religieuse.
• Si je suis en mesure d’affirmer que le monde existe de lui-‐même et qu’aucun agent extérieur au monde ne peut en modifier le cours, alors certes il sera irra4onnel de croire en une révéla4on, quand bien même son contenu proposi4onnel serait recommandable. Je pourrais d’ailleurs croire ce contenu, mais en aucun cas croire qu’il est révélé.