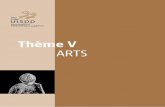direction départementale des territoires - Préfecture de l'Isère
Ecologie et territoires: un construit identitaire
Transcript of Ecologie et territoires: un construit identitaire
191expressions de l’identité dans le monde celtique
Écologie et territoires : un construit identitaire
L’écologie politique est la dernière grande idéologie à s’être développée, ayant connu ses premiers succès dans les années 1970. Pour ce faire, ses théoriciens ont dû la définir par rapport à des réalités pré-existantes, par rapport également aux autres idéologies, et ainsi développer son « identité idéologique » spécifique1. Les études sur l’écologie politique évoquent notamment son rapport particulier aux territoires2, et notamment au niveau régional. Nous nous proposons ici d’approfondir ce rapport de l’écologie aux territoires dans l’objectif de mieux appréhender sa spécificité.
Dans cette perspective, nous avons travaillé sur deux terrains à deux époques différentes : d’une part, les mouvements écologistes, et plus particulièrement antinucléaires, des années soixante-dix en Bretagne et en Écosse, et d’autre part les partis Verts écossais et bretons dans les années 2000, et plus particulièrement au cours des élections régionales de mai 2003 (pour l’Écosse) et de mars 2004 (pour la Bretagne)3. Nous
1 Stavrakakis Y., « Green Ideology : a Discursive Reading », Journal of political ideologies, vol. 2, n°3, 1997, p. 259-279.
2 Boy D. et Rihoux B., « L’offre identitaire des partis écologistes en Allemagne, en Belgique et en France : entre le terroir et la planète », Revue internationale de politique comparée, vol. 5, n°1, 1998 ; Dobson A., Green political thought, Londres-New York, Routledge, 2000 (1ère éd. 1990).
3 Nous attirons néanmoins l’attention sur le fait que la nature de notre étude n’est pas une comparaison. Ce que nous cherchons c’est le deep core territorial du paradigme écologiste, c’est-à-dire son noyau dur idéologique à propos des territoires.
Tudi Kernalegenn
Docteur en science politique, IEP de RennesCRAPE – CRBC
192 expressions de l’identité dans le monde celtique
avons donc ici le mouvement écologiste sous sa forme mouvement social et sous sa forme partidaire dans deux régions à forte identité, à deux moments importants de leur développement.
Nous analyserons dans une première partie la place du territoire dans l’idéologie écologiste et, en dégageant les trois niveaux territoriaux privilégiés des écologistes, confirmerons que le territoire est un des éléments structurant de l’identité écologiste. Puis, dans un second temps, nous nous concentrerons sur l’échelon régional et tenterons de dégager l’interaction entre idéologie écologiste et identité régionale.
1. Les trois territoires de l’écologieDans un article de 1998, Daniel Boy et Benoît Rihoux analysent
l’offre identitaire territoriale des Verts, en mettant en évidence qu’il « s’agit d’une offre identitaire originale, à la fois réarticulation de diffé-rents niveaux d’identité territoriale (du local au global) et redéfinition de chacun d’entre eux4 ». Ils dégagent l’idée que les écologistes structurent leur réflexion autour de trois visions de l’espace : localisme, anti-nationalisme, et universalisme, le niveau intermédiaire étant donc ici un non ou anti-niveau.
Si l’identité territoriale des écologistes se structure autour de trois niveaux, quel est le rôle et la forme que prend chaque niveau ? Nous verrons que dans la pensée écologiste, le global se distingue comme territoire de la réflexion ; et le local comme territoire de l’action. Dans un troisième temps, nous différenciant donc de Boy et Rihoux, nous valoriserons l’échelon intermédiaire, le niveau régional, qui sera vu ici comme le niveau de l’organisation. Cette vision du territoire, développerons-nous, est non seulement un appareil cognitif spatialisé pour les écologistes mais produit aussi une identité politique particulière, distinguant clairement les écologistes dans le champ politique.
4 Boy D. et Rihoux B., « L’offre identitaire des partis écologistes en Allemagne, en Belgique et en France : entre le terroir et la planète », art. cit., p. 165.
193expressions de l’identité dans le monde celtique
1.1. Le global ou le territoire de la réflexionLe territoire qui caractérise le plus la mouvance écologiste est à
l’évidence le global, la Terre, et ceci dès l’origine. Comme le soulignent Boy et Rihoux :
« La référence à l’international est constante mais à l’échelon global, ce n’est pas de mondialisme ou d’internationalisme qu’il faut parler […], mais plutôt de ‘planétarisme’ : c’est le ‘tout’ englobant qui est valorisé, la planète en l’occurrence5. »
Florence Faucher précise que pour les partis Verts :« L’écosystème planétaire est un tout, irréductible à la somme de ses parties. Son équilibre fragile résulte des relations qui s’établissent entre des éléments qui n’ont d’existence qu’en rapport avec la totalité qu’ils constituent6. »
Les problèmes que les écologistes dénoncent ne connaissent de fait pas de frontières politiques (ni sociales ni territoriales7) : la catastrophe de Tchernobyl a concerné toute l’Europe, les pluies acides agressent des territoires autres que ceux où la pollution se crée, à quoi il faut ajouter la dénonciation du réchauffement climatique ou les problèmes de la couche d’ozone, etc.
Cette valorisation du global découle directement de l’écologie scientifique. Dans le Message de Menton déjà, 2 200 scientifiques, se définissant comme « biologistes et écologistes », lancent un premier appel par le biais de l’UNESCO, en mai 1971, soulignant que la technologie bouleverse la complexité de la vie, que les ressources naturelles, limitées, s’épuisent peu à peu, et que tous ces problèmes sont globaux et non nationaux8. Mais c’est le Rapport de Rome, en 1972, qui
5 Ibid., p. 1786 Faucher F., Les Habits verts de la politique, Paris, Presses de la FNSP, 1999,
p. 14.7 Même s’ils précisent que les classes et territoires les plus défavorisés sont aussi
les plus touchés par les problèmes environnementaux.8 Jacob J., Histoire de l’écologie politique, comment la gauche a redécouvert la
194 expressions de l’identité dans le monde celtique
fait véritablement entrer dans le domaine du politique les inquiétudes des écologues en proclamant que la croissance exponentielle — et les pollutions et atteintes à la nature et à la diversité biologique qu’elle engendre — risque à moyen et long terme de menacer jusqu’à la vie sur terre. Ce rapport insiste explicitement sur le fait que tous les pays, sans exception, sont menacés9.
L’écologie politique naît à la même époque et se structure autour de cette idée que l’écologie c’est la prise en compte du global de façon holiste. Ainsi, dès le manifeste de Porsmoguer en 1975, manifeste fondateur du mouvement écologiste en Bretagne, les rédacteurs, la Fédération des CRIN (Comités Locaux et Régionaux d’Information Nucléaire), s’inquiètent de « l’épuisement prochain des réserves de matières premières de la planète10 ». De même, l’analyse de l’évolution idéologique de l’APPSB11 au cours des années soixante-dix, permet de comprendre que ce qui caractérise le passage d’une revendication environnementaliste — centrée sur la rivière puis le bassin versant — à une revendication écologiste, c’est la prise en compte du global, l’affirmation qu’une lutte environnementale conséquente ne peut s’abstraire d’une réflexion sur la société, l’affirmation que tout est lié12. Le Scottish Green Party se revendique d’ailleurs explicitement d’une
nature, Paris, Albin Michel, 1999, p. 204-206.9 Ibid., p. 216-222.10 Reproduit dans kernalegenn T., Luttes écologistes dans le Finistère (1967-
1981). Les chemins bretons de l’écologie, Fouesnant, Yoran embanner, 2006, en annexe, p. IX.
11 Association pour la Protection du Saumon en Bretagne, aujourd’hui Eau et rivières de Bretagne. Cette association, regroupant à l’origine des pêcheurs à la mouche, est rapidement devenue au cours des années 1970 une des principales associations écologistes en Bretagne, politisant et généralisant la question de l’eau et des rivières.
12 kernalegenn T., Luttes écologistes dans le Finistère (1967-1981), op. cit., p. 188-196. Ainsi, dans son éditorial au n°30 d’Eau et rivières (1er trimestre 1979), Jean-Claude Pierre, président de l’APPSB, affirme : « Tout comme le gaspillage de l’énergie conduit au nucléaire, le gaspillage de l’eau conduit aux barrages, l’un et l’autre procèdent de la même démarche de l’esprit, de la même ‘fuite en avant’ savamment entretenue pas des experts imbus de puissance ».
195expressions de l’identité dans le monde celtique
vision holistique du politique, et insiste être le seul parti politique de cette nature en Écosse, ce qui tend à démontrer clairement le caractère identitaire de cette analyse par le global13.
1.2. Le local ou le territoire de l’actionLe second niveau fondamental pour la mouvance écologiste est le
niveau local, comme le suggèrent deux de leurs slogans emblématiques voire fondateurs : « Penser global, agir local » et « Small is beautiful ». Selon Boy et Rihoux, « il y a, potentiellement ou historiquement une affinité de l’idéologie Verte avec la notion de local, qu’il s’agisse du local urbain (le quartier) ou du local rural (la commune voire le ‘pays’)14 ».
Historiquement tout d’abord, l’écologie politique, en tous cas dans sa frange issue de l’environnementalisme, est aussi bien née au niveau local qu’au niveau global. Comme le prouvent aussi bien Guyomard15 que Lecourt16, une très grande majorité des associations environnementales — les ⅔ selon Lecourt17 — sont de niveau communal ou infra-communal. Mais le local peut mener au global. Au niveau organisationnel d’abord : comme le souligne McDowell, la fondation de Friends of the Earth Scotland s’est essentiellement faite à travers des groupes locaux18. Au niveau cognitif voire idéologique ensuite, le local peut être le lieu de l’éveil, le chemin vers le global : en réhabilitant
13 http://www.scottishgreens.org.uk/policy.14 Boy D. et Rihoux B., « L’offre identitaire des partis écologistes en Allemagne,
en Belgique et en France : entre le terroir et la planète », art. cit., p. 176.15 guyomarD G., Les Associations et la transformation du champ politique
local. Fonctions d’agrégation et de médiation des associations de protection de l’environnement du littoral Nord-Finistère, mémoire pour le DEA d’Études politiques, Université de Rennes 1,1978.
16 lecourt A., Les Conflits d’aménagement : analyse théorique et pratique à partir du cas breton, thèse de géographie, Rennes 2, sous la direction de Guy Baudelle, 2003.
17 Ibid., p. 21.18 mcDowell E., Green Politics in Scotland : an Analysis of Historical and
Contemporary Aspects of the Scottish Environmental Movement, PhD, University of Strathclyde, Glasgow, 1993, p. 239.
196 expressions de l’identité dans le monde celtique
quelque peu les mobilisations NIMBY19, Serge Duigou suggère que :« On commence par la défense égoïste de son petit coin de nature et l’on finit par remettre en cause le type d’aménagement de l’espace en vigueur […] On ne sait jamais jusqu’où l’amorce d’une réflexion ‘écologique’ finira par vous mener20. »
Concrètement ensuite, les associations et partis écologistes prônent et mettent en œuvre un activisme au niveau le plus local possible. Ainsi, au cours des années soixante-dix, l’action phare de l’APPSB sont les nettoyages de cours d’eau. Ils réunissent à chaque fois des centaines de personnes qui, outre la remise en état de cours d’eau obstrués par la végétation et la pollution, ont une visée de sensibilisation citoyenne. Le local est aussi le lieu de la défense du patrimoine, c’est-à-dire de ce qui est unique et signifiant. En milieu urbain enfin, le local est le niveau de l’information, du recyclage, des pistes cyclables, de la démocratie locale, etc. L’agir local c’est donc aussi la traduction de l’idée que la révolution écologiste ne viendra pas d’une Révolution au centre du pouvoir, mais d’une multitude de mini-révolutions au quotidien et au local, elles-mêmes résultats d’une multitude d’actes militants très concrets. C’est aussi une vision ascendante, bottom-up, du politique. Cette vision de la révolution et/ou du changement politique est donc antithétique avec, et de fait construite contre, la vision socialiste du changement politique. L’action politique se fait au niveau local, non pas à celui de l’État-nation.
Politiquement enfin, le local prend une place prépondérante dans l’architecture institutionnelle prônée par la mouvance écologiste. Ainsi, dans la page 4 de son Manifeste de 2003, le parti Vert Écossais rappelle :
« Nous croyons que les décisions devraient être prises au niveau le plus local possible, bien que nous reconnaissions que certains
19 Not In My Backyard « Pas Dans Mon Jardin ».20 Duigou S., « Le paradis (l’enfer ?) des écologistes », Bretagnes, les chevaux
d’espoir, Paris, Autrement, 1979, p. 106-107
197expressions de l’identité dans le monde celtique
des défis environnementaux et sociaux les plus urgents requièrent une action de la part d’organisations fonctionnant à une échelle globale. »
Pour conclure, le local est bien le lieu privilégié de l’action (et théorisé explicitement en tant que tel par les écologistes), mais est un niveau subordonné au niveau global, horizon de la réflexion, qui donne sens à l’agir local.
1.3. Le régional ou le territoire de l’organisationComme le soulignent Boy et Rihoux, le niveau de l’État-nation a très
mauvaise presse au sein de la mouvance écologiste21. Celle-ci valorise néanmoins un niveau intermédiaire entre le global et le local, qui peut être appelé le niveau régional. Le titre du manifeste des Verts bretons de juin 2003 appelé « Pour une république européenne et régionaliste » permet d’entrevoir que ce niveau régional semble prendre la forme d’une articulation entre l’Europe et la région, autour du projet de l’Europe des régions.
21 Ainsi expliquent-ils : « L’échelon national est toujours rejeté par les écologistes des trois pays que nous avons étudiés [Belgique, Allemagne et France] au nom d’un refus des valeurs ‘nationalistes’ […] Le rejet de l’État-nation est cohérent avec le pacifisme des Verts, avec leur refus de l’autorité et des grandes structures hiérarchisées, et avec leur antimilitarisme radical » (Boy D. et Rihoux B., « L’offre identitaire des partis écologistes en Allemagne, en Belgique et en France : entre le terroir et la planète », art. cit., p. 177). Nous serions toutefois moins catégoriques que Boy et Rihoux. Il existe une ‘tendance’ chez les écologistes qui s’inscrit dans le cadre de l’État-nation. Ainsi, dans leur texte Pour une république européenne et régionaliste de juin 2003, les écologistes bretons glissent une phrase, probable concession à une minorité ‘jacobine’, qui détonne fortement avec le reste du texte : « Afin d’éviter les dérives libérales ou communautaristes, la régionalisation ne peut se concevoir sans un ancrage fort au pacte républicain issu de notre histoire d’État-nation. Celui-ci définit le respect des droits fondamentaux […] l’État devant en être le garant. » Ceci dit, comme le souligne Dobson A., op. cit., la décentralisation et la promotion des échelles les plus petites (dont la commune et la région) – c’est le principe de subsidiarité – est un idéal commun à toute la mouvance écologiste, même si pour des raisons de pragmatisme politique certaines mouvances et individus mettent l’accent sur la nécessité d’un État fort pour la mise en place de leurs politiques.
198 expressions de l’identité dans le monde celtique
L’attachement particulier au niveau européen est un élément caractéristique de l’identité écologiste, même s’il existe aussi une tendance anti-européenne, notamment chez les Verts scandinaves22. Symboliquement, les Verts européens ont été la première mouvance politique à créer un parti de niveau européen. Le Parti Vert Européen a été créé le 21 février 2004 à Rome et regroupe 38 partis membres23 et 8 partis observateurs en 2013. Ils furent aussi les seuls à mener une campagne au niveau européen pour les élections européennes de juin 2004.
L’attachement à la région (proprement dite) est lui aussi fort et historique dans la mouvance écologiste. Dès le début, aussi bien en Bretagne qu’en Écosse, le niveau régional a été le lieu de structuration des premières grandes associations environnementalistes puis écologistes. Pour la Bretagne, c’est le cas de la SEPNB (Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne) devenue aujourd’hui Bretagne Vivante, de l’APPSB devenue Eau et Rivières de Bretagne ou encore, dans les années 1970, du CRIN (Comité Régional d’Information Nucléaire) qui prend ensuite le nom de Coordination Antinucléaire Bretonne. Toutes ces associations, parmi les plus dynamiques de France par ailleurs dans leurs domaines respectifs, sont des coordinations plus ou moins lâches de groupes locaux qui s’étendent sur les cinq départements bretons. McDowell constate le même phénomène en Écosse, en mettant en évidence l’inclusion du mot « Scotland » dans tous les intitulés des groupes environnementalistes et écologistes écossais. Elle ajoute que, à la fin des années soixante-dix, « toutes ces organisations ont établi une autonomie complète (indépendance) à l’égard de leur affiliation britannique24 ». C’est le cas de Friends of the Earth (FOE) en 1978 qui
22 Mais les Verts distinguent l’attachement à l’Europe en tant que concept et processus, et la méfiance vis-à-vis de la politique de l’Union européenne, dont ils dénoncent régulièrement, entre autres, le caractère bureaucratique et la politique néo-libérale.
23 Dont le Scottish Green Party et les Verts français (Europe écologie – Les Verts).
24 mcDowell E., op. cit., p. 39.
199expressions de l’identité dans le monde celtique
prend son indépendance de FOE-UK et s’affilie directement à FOE International sous le nom de FOE-Scotland.
Radicalement anti-centralistes, les écologistes ne veulent nullement mettre en place un centre d’action régional. Le local reste le lieu de l’action, la région celui de l’organisation. Qu’on en juge à travers les motivations qui président à la création de la Coordination des groupes anti-nucléaires écossais en 1980 :
« Le groupe de travail conçoit la coordination comme un réseau informel pour tous les groupes écossais anti-nucléaires intéressés. Le réseau devra exister comme un forum pour discuter les priorités, partager les informations, esquisser les campagnes d’action et plus généralement pour se soutenir moralement les uns les autres […] Nous voyons la coordination comme un moyen d’aider les groupes à devenir aussi efficaces que possible […] À nos yeux, la coordination ne doit pas aboutir à l’organisation et à la prise générale de responsabilité en lieu et place des initiatives de groupes particuliers. Par exemple, si un groupe appelle à une manif, c’est à ce groupe de prendre en charge l’entière responsabilité de cet événement, même si des coordinateurs peuvent éventuellement procurer de l’aide si besoin. Nous reconnaissons l’importance vitale de liens informels entre des groupes partageant des intérêts communs […] Une coordination centralisée ne pourra jamais être un substitut pour cette sorte de communication25. »
Une même structuration au niveau régional existe aujourd’hui encore chez les Verts. Depuis 1990, le parti Vert écossais est indépendant du parti Vert anglais et gallois, et prône d’ailleurs par la même occasion une politique résolument indépendantiste pour l’Écosse. Les Verts bretons font partie du parti Vert français (Europe écologie – Les Verts aujourd’hui) ; néanmoins en France aussi la région est le lieu fondamental
25 Compte-rendu de la réunion du 27 juin 1980 du Scottish Anti Nuclear Groups Meeting.
200 expressions de l’identité dans le monde celtique
de l’organisation territoriale du parti, comme le garantissent les statuts du parti26 (Villalba, 2001), et comme en témoigne, en Bretagne, l’alliance des Verts avec les autonomistes de l’Union Démocratique Bretonne (UDB) au premier tour des élections régionales (21 mars 2004), alliance réitérée en 2010.
1.4. ConclusionLes écologistes structurent leur vision territoriale autour de trois
niveaux principaux : le local, le régional et le global. Cette structuration les distingue clairement des autres idéologies politiques, participant donc à la clarification d’une identité écologiste. Harmonieusement définis, fonctionnalisés même, ces trois niveaux territoriaux sont perçus comme complémentaires par la mouvance écologiste. Si l’on analyse sous l’angle territorial la mobilisation antinucléaire victorieuse de Plogoff (1975-1981)27 on s’aperçoit que les trois niveaux ont été mobilisés. L’essentiel de la lutte s’est déroulé au niveau local de la commune de Plogoff, mené par le Comité de Défense de Plogoff qui avait le monopole des initiatives à Plogoff même : c’est le niveau NIMBY, mais aussi le niveau de l’action. Cette lutte était soutenue par une coordination antinucléaire bretonne, fédération de groupes locaux (CLIN) structurés au niveau régional, organisant donc le soutien des habitants de la région : c’est le niveau de la solidarité mais aussi de l’organisation (de la mobilisation et de l’information en l’occurrence). Enfin cette lutte s’est inscrite plus largement dans la mouvance antinucléaire globale : c’est le niveau idéologique de la réflexion. Nous suggérons que c’est l’articulation des dimensions NIMBY, solidaire et idéologique autour de trois territoires différents qui a permis de donner une telle dimension à la lutte de Plogoff et finalement de décrocher une victoire28.
26 villalba B., « Les Verts : pour une ‘République girondine’ », Pouvoirs locaux, n°51-4, 2001, p. 59- 64.
27 Cf. kernalegenn T., Luttes écologistes dans le Finistère (1967-1981), op. cit., pour une histoire de la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff (Finistère), une des principales luttes antinucléaires d’Europe.
28 Même si cette variable n’est évidemment pas la seule pour expliquer le succès
201expressions de l’identité dans le monde celtique
2. Mouvement écologiste et régionalismeJane Dawson, en s’intéressant aux mouvements antinucléaires dans
les pays de l’ex-URSS à la fin des années 1980, a démontré que les mouvements les plus puissants et couronnés de succès étaient ceux qui véhiculaient aussi un fort sentiment national, que ce soit en Lithuanie, en Ukraine ou dans le Tatarstan29. Sous une forme plus atténuée, et moins instrumentaliste, un même phénomène semble à l’œuvre dans le monde occidental. Dès 1980, Alexandre Nicolon suggérait que « l’enracinement à un territoire, surtout lorsqu’il demeure un lieu de tradition, devient pour l’individu un moyen d’échapper au mouvement général d’uniformisation, à la dépersonnalisation30 ». Il émettait dès lors l’hypothèse suivante :
« Les mouvements d’opposition qui se produisent dans des régions qui ont gardé une identité culturelle […] sont plus combatifs, plus durables, plus ouverts aux thèmes globalisateurs, moins vulnérables aux divergences idéologiques ou partisanes que ceux qui se déroulent dans des régions sans tradition, sans identité culturelle marquée31. »
S’inscrivant dans une perspective géographique, Arnaud Lecourt et Bruno Charlier ont étayé cette hypothèse, prouvant que plus le sentiment d’appartenance est fort, plus le risque de conflit est élevé, et cela quelle que soit l’échelle32, ce qui signale un lien très sûr entre
de la lutte de Plogoff. L’importance de la temporalité doit ainsi être évoquée, le projet de Plogoff étant arrivé relativement tard au cours de la décennie, et les opposants à ce projet ont donc bénéficié de l’expérience acquise sur les précédentes luttes antinucléaires depuis 1971.
29 Dawson J.I., Eco-nationalism. Anti-nuclear Activism and National Identity in Russia, Lithuania and Ukraina, Durham-Londres, Duke University Press, 1996.
30 nicolon A., « La défense de l’environnement et du cadre de vie dans les oppositions locales à des projets d’équipements », Écologie et politique. Actes de la journée d’études de l’association française de science politique du 26 septembre 1980, Paris, p. 10.
31 Ibid., p. 10.32 lecourt A., op. cit.
202 expressions de l’identité dans le monde celtique
le dynamisme des revendications écologistes et la force du discours identitaire des mouvements régionalistes et nationalistes33. Dans une perspective historique, nous avons nous même dégagé l’importance de l’identité régionale comme catalyseur du mouvement antinucléaire breton34.
L’analyse du travail de Wolfgang Rüdig permet de constater que ce phénomène est général au niveau de l’Europe de l’Ouest35. Une lecture attentive de son recensement des principaux mouvements antinucléaires, permet de se rendre compte que les plus importants et efficients mouvements antinucléaires en Grande-Bretagne, France et Espagne ont respectivement eu lieu en Écosse (avec la lutte de Torness) surtout, et dans une moindre mesure au Pays de Galles (contre les déchets nucléaires) et en Cornouailles (lutte de Luxulyan) pour le premier ; en Bretagne (Plogoff et Le Pellerin) et Alsace (Fessenheim) pour le second36 ; et au Pays-Basque (Lemoniz), surtout, et dans un moindre mesure en Catalogne (Asco) et en Galice (Xove) pour le troisième37 : c’est-à-dire les territoires où existe un régionalisme fort.
Pour mieux comprendre ce lien entre idéologie écologiste et identité territoriale nous nous proposons de l’aborder sous trois formes, en émettant trois hypothèses. La première s’interrogera sur le
33 charlier B., La Défense de l’environnement : entre espace et territoire, thèse de doctorat, Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1999.
34 kernalegenn T., Luttes écologistes dans le Finistère (1967-1981), op. cit., et kernalegenn T., « Bretagne et écologie : approche culturelle d’une dynamique identitaire », N. Dugalès, R. le coaDic et F. Patez, Et la Bretagne ? Héritage, identité, projets, Rennes, PUR, 2004.
35 rüDig W., Anti-Nuclear Movements : a World Survey of Opposition to Nuclear Energy, Harlow, Longman, 1990.
36 Une autre lutte antinucléaire importante en France a été celle contre le Surgénérateur Phénix, à Creys Malville. Celle-ci n’a pas eu de dimension régionaliste, son importance étant due au symbole qu’elle représentait pour la mouvance antinucléaire (c’était le premier Surgénérateur prévu). Il est important de remarquer que cette lutte, qui n’a pas réussi à impliquer la population locale, a été un échec total.
37 Pour nuancer, il faut remarquer qu’un important mouvement antinucléaire a également eu lieu en Estrémadure, mais l’auteur prend soin de souligner là aussi une dimension régionaliste (cf. rüDig W., op. cit., p. 213-215).
203expressions de l’identité dans le monde celtique
côté instrumentaliste et/ou structuraliste de cette relation. En nous interrogeant sur l’assimilation et le cadrage des identités disponibles nous suggérerons que le mouvement écologiste cadre son discours en faisant appel à des identités préexistantes. Puis nous verrons que, au-delà de ce côté utilitariste, les idéologies écologistes et régionalistes sont convergentes, facilitant une émulation mutuelle, une dynamique cumulative. Nous nous interrogerons enfin s’il n’existe pas un intérêt cognitif pour l’écologie à développer cet échelon régional.
2.1. Assimilation et cadrage de l’identité régionaleComme toute mouvance émergente, les écologistes doivent prendre
en compte les identités préexistantes, soit en s’y adaptant de façon passive, soit en les cadrant dans une perspective stratégique38. On peut ainsi poser l’hypothèse que le régionalisme des écologistes pourrait découler de leur intégration dans un jeu de structures et institutions préexistantes. Analyser leur discours permet de fait de déceler une forme de « régionalisme banal »39. Ce concept est particulièrement approprié, semble-t-il, à qualifier certaines facilités et raccourcis du discours politiques, à l’instar d’affirmations retrouvées dans le discours des Verts telles que « Les Bretons sont démocrates » ou de questions rhétoriques comme « Mais que veulent les Bretons40 ? », qui tendent inconsciemment à réifier les Bretons dans un tout indifférencié.
À l’évidence, les écologistes savent réagir aux institutions comme en témoigne l’étude d’Eleanor McDowell sur la régionalisation de FoE en Écosse :
« L’élan initial visant à établir Friends of the Earth Scotland (FoES) vint dans le contexte du débat pour une Assemblée Écossaise41.
38 Ceci n’est pas incompatible avec une adoption sincère de ces identités, mais suggère un travail de recyclage et bricolage de ces identités dans le cadre de l’action.
39 Cf. billig m ., Banal Nationalism, London, Sage, 1995.40 Ces deux citations sont extraites de l’éditorial de Pascale Loget (tête de liste
de la liste « Bretagne, Verte, Unie et Solidaire » lors des élections régionales de mars 2004 en Bretagne) au Journal des Régionales de la liste qu’elle menait.
41 Un débat très important, clôt temporairement par l’échec du référendum mis
204 expressions de l’identité dans le monde celtique
Aussi bien les groupes locaux écossais que l’équipe de FoE Londres percevaient comme hautement désirable l’existence d’un groupe de pression renforcé à Édimbourg concernant les questions environnementales si une Assemblée devait finalement être mise en place42. »
Cet exemple que nous propose McDowell suggère pourtant que les écologistes sont beaucoup plus proactifs que réactifs face aux institutions régionales et face à la régionalisation de leurs propres structures. On constate en effet que toutes les associations écossaises étaient structurées au niveau régional avant la création de l’Assemblée écossaise en 1999. De même, en Bretagne, la SEPNB était structurée au niveau régional avant la mise en place de l’EPR (Établissement Public Régional), et l’échelon départemental des associations écologistes (quand elle existe) a la plupart du temps été plus faible que l’échelon régional.
Une autre forme positive et dynamique d’inclusion dans un système territorial serait l’inscription dans une tradition de luttes sociales. Comme
en place par le Labour en mars 1979, eût lieu dans la seconde moitié des années soixante-dix en Écosse.
42 mcDowell E., op. cit., p. 238. Et elle continuait : « Bien que les choses ne se passèrent pas ainsi, il devint évident qu’il y a avait d’autres irrésistibles raisons pour une base FOES décentralisée en Écosse. FOES serait mieux à même de coordonner et renforcer les efforts des groupes locaux écossais, et de se concentrer sur des questions spécifiques au Nord de la frontière [North of the border – l’Écosse par rapport à l’Angleterre]. Par exemple, il y avait des différences avec lesquelles le personnel basé à Londres ne savait pas toujours s’y prendre : des différences dans les systèmes éducatifs et légaux ; les autorités locales mises en place en Écosse ; de même que des questions telles que l’impact du pétrole écossais ; et des aspects de protection de l’environnement concernant spécifiquement l’Écosse. FOES serait aussi capable ainsi de tisser des liens sur un pied d’égalité avec d’autres groupes nationaux tels que […] la Scottish Wildlife Trust [la Société Écossaise pour la Protection de la Faune Sauvage]. L’objectif d’une organisation séparée en Écosse provenait aussi du désir de porter une voix plus effective au niveau du Scottish Office ou en relation avec certains des influents Conseils Régionaux en Écosse. Enfin, FOES pourrait entretenir des liens plus proches avec les Membres Écossais des Parlements Britanniques et Européens [MPs & MEPs] et plus généralement tout le système politique en Écosse » (mcDowell E., op. cit., p. 238).
205expressions de l’identité dans le monde celtique
le prouvent Friedman et McAdam, « un mouvement naissant émerge de mais reste dépendant d’institutions et organisations préexistantes43». Dans la même perspective, Arnaud Lecourt affirme que « l’histoire du territoire concerné structure la mémoire collective, notamment en ce qui concerne son passé en matière de contestation44 ». Donatella Della Porta suggère à ce propos que c’est l’identité collective qui garantit la continuité des expériences d’action collective dans le temps45. De fait, aussi bien en Écosse qu’en Bretagne, les écologistes se sont inscrits dans une tradition forte de luttes sociales, souvent couronnées de succès d’ailleurs, créant non seulement une mémoire collective mais aussi des réseaux effectifs. Ainsi, pour la Bretagne, les écologistes, et plus particulièrement le mouvement antinucléaire, ont bénéficié de deux décennies de luttes sociales « régionales », dont la lutte emblématique et victorieuse du Joint français en 197246. En outre, ils se sont inscrits dans un contexte de renouveau culturel et identitaire porteur47.
Un troisième élément intéressant est celui du travail identitaire de la part des écologistes. Une première forme de ce travail identitaire serait celui de l’appel au patriotisme régional. Un tract écossais de la fin des années soixante-dix appelant à déduire 20% (la part du nucléaire en Écosse) de la facture d’électricité argumente par exemple :
43 FrieDman D. et mcaDam D., « Collective Identity and Activism. Networks, Choices and the Life of a Social Movement », A.D. morris et C. mcclurg mueller (dir.), Frontiers in Social Movement Theory, New Haven-London, Yale University Press, 1992, p. 162-163.
44 lecourt A., op. cit., p. 60. En mettant l’accent sur les configurations socio-spatiales, il souligne de plus l’importance des éléments patrimonialisés et patrimonialisables comme facteur d’effectivité d’une lutte environnementale (lecourt A., op. cit., cf. notamment p. 307).
45 Della Porta D. et Diani M., Social Movements, an Introduction, Oxford, Blackwell Publishers, 1998, notamment p. 89.
46 Soulignons ainsi l’importance des réseaux du PSU et de la CFDT pour faire le lien à la fois militant et mémoriel entre toutes ces mobilisations dans la région. Cf. kernalegenn T., Drapeau rouge et gwenn-ha-du. L’extrême-gauche et la Bretagne dans les années de soixante-dix, Rennes, Apogée, 2005.
47 kernalegenn T., « Bretagne et écologie : approche culturelle d’une dynamique identitaire », art. cit., p. 237-248.
206 expressions de l’identité dans le monde celtique
« Plus de 1.000 personnes le font déjà en Angleterre et au Pays de Galles, plus de 1.500 en Allemagne de l’Ouest, et plusieurs centaines d’Américains protestent actuellement de cette façon. Essayons d’atteindre de même un joli nombre en Écosse48. »
Une seconde forme de travail identitaire est toutefois plus présente et plus dynamique, c’est le cadrage identitaire49, c’est-à-dire « la formalisation de distinctions interne/externe du groupe (in-group/out-group distinctions) et l’assignation des autres organisations à des ‘territoires’ (turfs) idéologiques, géographiques et tactiques ». Ce travail de cadrage identitaire est particulièrement présent dans le mouvement écologiste de la fin des années soixante-dix, notamment en Bretagne où le mouvement antinucléaire recycle à son profit les cadres du conflit centre-périphérie, du conflit du peuple contre l’État et la bureaucratie et enfin celui de « la trahison des notables ». Ce travail identitaire aboutit à la mise en place d’un « Nous » valorisant les attributs bretons de l’identité du mouvement social et de ses adjuvants face au « Eux » tournant autour des attributs de l’État français50.
Un exemple particulièrement frappant est un avis publié par Oxygène (journal politique de la SEPNB) pour aider la SEPNB, qui fait face à des difficultés financières51. Sous la forme parodique d’un avis à la population — « la protection de la nature en Bretagne est menacée » — la SEPNB oppose deux drapeaux, représentants le « Nous » et le « Eux ». « Eux » sont les deux drapeaux placés en haut de l’appel, des drapeaux tricolores, dont le centre contient le symbole de l’énergie nucléaire. Ces drapeaux représentent l’État français, assimilé à l’« ennemi » nucléaire qui menace la protection de la nature en Bretagne. Le « Nous » est le
48 Cf. AP Sara Barry.49 hunt S.A., benForD R.D. et snow D.A., « Identity Fields : Framing Processes
and the Social Construction of Movement Identities », E. larañ, H. Johnston et J.r. gusFielD (dir.), New Social Movements. From Ideology to Identity, Philadelphia, Temple University Press, 1994.
50 Cf. kernalegenn T., « Bretagne et écologie : approche culturelle d’une dynamique identitaire », art. cit.
51 Oxygène n°17-18, 15 juillet – 15 septembre 1980, p. 36.
207expressions de l’identité dans le monde celtique
drapeau en face de la signature du président de la SEPNB, Jean-Claude Demaure. Il reprend le drapeau breton, les hermines étant remplacées par un oiseau en vol. C’est donc le symbole, positif, de la SEPNB, liant Bretagne et protection de la nature.
2.2. Des idéologies convergentes : préserver et promouvoir la diversitéMais si cette opération de cadrage identitaire est si convaincante et
effective, ne peut-on se demander si, au niveau de l’idéologie, l’écologie et le régionalisme ne partagent pas des valeurs plus fondamentales qu’une aptitude à recycler le discours de l’autre ? Comme l’a prouvé Antoine Denéchère52 en étudiant le développement de l’écologie politique en Bretagne, le mouvement breton a eu une attention précoce et continue pour l’écologie, et le mouvement écologiste en Bretagne a intégré dès le début la région et les problématiques régionalistes dans sa pensée. De fait, ils se sont tous les deux retrouvés derrière le slogan « Vivre et travailler au pays »53 au cours des années 1970.
Un premier élément de jonction idéologique serait une commune lutte contre l’uniformité et pour la diversité, et notamment une commune attention aux minorités. Dès leurs origines, les Verts ont été attentifs à la diversité culturelle comme en témoigne la profession de foi de René Dumont en 1974 (premier candidat écologiste à l’élection présidentielle), qui déplore que, en France, « les cultures régionales sont niées, l’uniformité est la règle ». Une mappemonde publiée par les Verts français en 1992 est particulièrement significative du rapport des Verts à la diversité. Celle-ci, représentant la Terre avec le pôle Sud en haut et le pôle Nord en bas, visualise les peuples (dont les peuples bretons et écossais) et les milieux naturels. Comme l’explique le texte de présentation de Gérard Onesta :
« La vision offerte par cette carte, tout aussi exacte que tant
52 Denéchère A., La Bretagne et l’écologie politique, maîtrise d’histoire, sous la direction de Michel Nicolas, Rennes II, 2001 [lieu de consultation : Crhisco-Rennes 2].
53 Cf. Quéré L. et Dressler-holohan W., « ‘Vivre au pays’ : généalogie d’un slogan », Autrement, n°14, Juin 1978.
208 expressions de l’identité dans le monde celtique
d’autres, permet simplement, par son code, une autre approche de territoires et de peuples trop longtemps ignorés, trop souvent méprisés. Cette carte se veut également un hommage à la diversité. Notre planète a un fragile équilibre […] On sait hélas que certaines d’entre [les principales zones naturelles], comme les forêts, les prairies ou les mangroves, de même que les animaux qui y vivent, sont gravement menacées par les activités humaines. Il est urgent d’agir pour préserver ce patrimoine inestimable qui, au-delà de sa beauté, est également indispensable à la survie et au développement dans la dignité pour toute femme et tout homme.Diversité des paysages, diversité de la famille humaine également. Cette famille ne peut être décrite par le simple découpage, souvent arbitraire, des États-nations actuels ; les frontières des États apparaissent telles des cicatrices héritées du passé, une grille, parfois douloureuse, plaquée sur une réalité humaine beaucoup plus mouvante et subtile. Cette carte insiste donc sur ce que les planisphères géopolitiques ont tendance à vouloir effacer : les peuples […]Le brassage humain qui permet de féconds métissages culturels, rend cette tribu humaine chaque jour plus complexe, mais aussi plus universelle, et nous rappelle qu’à la protection du particularisme de chacun doit s’ajouter la solidarité de tous.Il faut souhaiter que dans l’avenir ce planisphère ne s’appauvrisse pas par la disparition de peuples, de cultures ou de paysages et que de futures éditions de cette carte puissent nous présenter notre fragile planète toujours aussi belle de diversité. »
Un même engagement en faveur de la diversité culturelle (cf. p. 8) et de la diversité naturelle (cf. p. 15) est prôné par les Verts écossais, comme en témoigne le Scottish Green Manifesto de 2003.
Plus largement, l’idéologie écologiste est attentive à tout ce qui est minoritaire. Comme le soulignent Boy et Rihoux à propos des Verts allemands, « Les Grünen se veulent les porte-parole […] de toutes les
209expressions de l’identité dans le monde celtique
communautés périphériques […] du pays. Par là, ils entendent tous les individus qui se situent en marge de la société allemande classique54 » : quart-monde, populations immigrées, populations nomades, femmes, personnes âgées, handicapés, minorités sexuelles et spirituelles. Une même attraction « empathique » pour toutes les minorités se retrouve chez les Verts bretons et écossais.
Cet engagement en faveur de la diversité peut enfin prendre une commune dimension patrimoniale. Penchons-nous sur un tract émis lors de la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Torness et intitulé Stop waste at Torness. Dans son argumentation ce tract affirme :
« Le site choisit pour la centrale et les routes adoptées pour les pylônes défigureraient le paysage d’un coup […] Tout le monde aime la campagne. Mais quelle est sa valeur ? Il n’y a pas de marché financier pour l’air pur, les vues non gâchées, les craquements de la gelée blanche lors d’une ballade dans la brume matinale, le chant d’une alouette […] Torness représente un pas de géant franchissant la ligne qui sépare le Jardin d’Écosse du terrain vague de minables petites boîtes disposées en rangées […] Les pylônes dénatureraient les paysages du Lothian et de la région des Borders, une lame de couteau au travers de sa topographie […] Les touristes et visiteurs ne pourraient plus lire dans les paysages du Lothian ces qualités remarquables capturées par Sir William Genies dans ses tableaux. »
C’est un patrimoine naturel que vise ici à conserver le mouvement antinucléaire écossais, donnant une valeur infinie (car non capitalisable) au monde non marchand. Une même rhétorique de la diversité naturelle « patrimonialisée », et donc culturalisée, humanisée, se retrouve dans tous les mouvements écologistes et même, plus globalement, dans tous les mouvements environnementaux contre des projets d’aménagement55.
54 Boy D. et Rihoux B., « L’offre identitaire des partis écologistes en Allemagne, en Belgique et en France : entre le terroir et la planète », art. cit., p. 167.
55 Cf. lecourt A., op. cit
210 expressions de l’identité dans le monde celtique
À travers cette lutte pour le patrimoine, c’est aussi une lutte pour une société conviviale (cf. Ivan Illitch), à dimension humaine, qui semble s’exprimer chez les écologistes, qui prétendent faire primer la culture et l’être humain sur l’économie. C’est dans cette perspective qu’il est possible de concevoir la vision écologiste de la région, c’est-à-dire un territoire à dimension humaine, avec des bases culturelles et sociales et une capacité à l’autonomie, comme en témoigne l’attachement des Verts bretons à une Bretagne réunifiée, à cinq départements. Territorialement parlant, écologistes et régionalistes nationalitaires prônent donc la même région.
2.3. Territoire et cognition : la région pour penser la société écologique ?Nous allons enfin essayer d’explorer une troisième hypothèse :
l’idée de région, au sein de la mouvance écologiste ne pourrait-elle être considérée comme un cadre cognitif territorial pour concrétiser une idéologie ?
Un premier élément de la démonstration sera que la région sert à prendre en compte les spécificités territoriales, donnant sens à un espace indifférencié, comme nous l’avons vu ci-dessus en soulignant que FOES Scotland a été mise en place pour mieux prendre en compte les spécificités de l’espace écossais. Dans la même perspective, un tract antinucléaire écossais de la fin des années soixante-dix déclarait : « En Angleterre et au Pays de Galles, 11½ % de l’électricité provient du nucléaire, 22 % en proviennent en Écosse — une des proportions d’électricité à base nucléaire les plus élevées du monde56 ». Régionaliser permet ici de renforcer une rhétorique, de soulever des spécificités territoriales, de suggérer une oppression spécifique. C’était aussi le cas dans la mouvance antinucléaire bretonne des années 1970 où les écologistes dénonçaient, après les « vocations » militaires et touristiques de la Bretagne, sa vocation nucléaire. Nous avons aussi déjà vu par ailleurs que le plan Alter breton, rédigé à la fin des années soixante-dix au sein de la mouvance antinucléaire bretonne, a permis de concrétiser,
56 Tract intitulé : « NAG consumer campaign ».
211expressions de l’identité dans le monde celtique
par une territorialisation régionale, un programme global pour une autre société, principalement dans le domaine énergétique. Le projet Alter breton perçoit en effet la région comme l’échelon pertinent pour une démarche autonome et autosuffisante57. Pour les partis écologistes actuels, cette prise en compte des spécificités régionales prend place dans le cadre des programmes pour les élections régionales comme en témoignent les programmes Reach for the future… Scottish Green Party, 2003 Scottish Manifesto et Une Bretagne ouverte sur le monde. Bretagne Verte, Unie et Solidaire – Programme, qui prônent une régionalisation de plus en plus avancée.
De fait, la région est l’échelon privilégié des écologistes (après l’échelon local) pour construire une société démocratique à échelle humaine. Dès l’origine, les écologistes ont lutté contre le gigantisme et la complexité. Ainsi, selon Radcliffe (2002), dans Small is beautiful, Schumacher exprimait l’idée que « parmi les problèmes majeurs de la crise sont la taille et la complexité des sociétés industrielles, des dommages écologiques qui en résultent et des institutions qui l’ont créée ou ont été établies pour y faire face58 ». Il ajoute, en se référant aux écologistes que :
« Le désir des décentralistes était de travailler de façon immédiate vers un système décentralisé, considérant les problèmes de la taille et du contrôle centraliste comme des éléments majeurs de la crise. Ceci signifiait que la structure de la constitution des politiques publiques étaient autant mises en causes que le contenu des politiques publiques elles-mêmes59. »
57 Cf. kernalegenn T., « Bretagne et écologie : approche culturelle d’une dynamique identitaire », art. cit., p. 232-233. Ajoutons en outre, que le projet Alter breton est la contre-proposition, scientifiquement argumentée, du mouvement antinucléaire aux projets du gouvernement basés sur le nucléaire. Or, comme le prouve Arnaud Lecourt, « une contre-proposition renforce la territorialité en assurant la cohésion des populations concernées » (2003, p. 309).
58 raDcliFFe J., Green Politics : Dictatorship or Democracy ?, Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2002, p. 28.
59 Ibid., p. 29.
212 expressions de l’identité dans le monde celtique
Nous pouvons illustrer cela au plan local par le Manifeste de Porsmoguer qui affirmait déjà, en 1975 : « Nous tournons donc le dos au nucléaire car nous refusons cette société hypercentralisée et figée pour des siècles, condamnée à surveiller et à gérer d’une manière policière et militaire les nuisances qu’elle va engendrer. »
Aujourd’hui encore les partis écologistes lient de façon très forte décentralisation, régionalisation et démocratisation radicale. Dans le texte Pour une république européenne et régionaliste (juin 2003), les Verts bretons affirment ainsi que :
« La région est l’espace pertinent d’organisation de la démocratie participative du fait de sa dimension géographique, de ses solidarités sociales et, pour beaucoup d’entre elles, de sa réalité culturelle […] La régionalisation est le pouvoir de décider, la capacité de financer mais aussi une démocratie qui permet aux citoyens de participer directement à la décision et de contrôler les actions. »
Et, dans le même texte, une des justifications de cette régionalisation souligne que :
« La Bretagne n’est pas homogène, l’aménagement équilibré du territoire ou l’organisation de la solidarité entre les Pays seront mieux pensés et organisés par les Bretons que par une administration centrale, même si elle possède quelques bureaux en Bretagne. »
C’est pourquoi, les Verts de Bretagne affirment que : « Les régions doivent être dotées de pouvoirs réglementaires et législatifs dans de larges domaines de compétence (école, aménagement du territoire, culture, énergie, économie…) et des moyens financiers correspondant, de façon à élaborer et mener des politiques de développement adaptées aux besoins et ressources de chaque territoire. La région est le niveau qui se prête le mieux au développement de la citoyenneté. »
213expressions de l’identité dans le monde celtique
Les Verts bretons proposent ici un programme d’autonomie avancée pour la Bretagne, un programme autonomiste. Les Verts écossais, quant à eux, prônent l’indépendance pour l’Écosse.
Les territoires de l’écologie (et la trilogie global, régional, local) caractérisent donc une identité écologiste particulière dans le champ politique, une identité de projet et d’action. Élément de cognition et de création de sens à partir d’un matériau culturel, les identités territoriales, et plus particulièrement régionales, mobilisées par les écologistes participent en outre activement à la définition (cadrage) de leur idéologie, notamment pour ce qui a trait aux processus de l’action politique (institutions, démocratie, etc.) et aux projets de promotion de la diversité. La région s’intègre ainsi résolument dans l’activité des écologistes.
Une première version de ce texte a été présentée le 29 avril 2004 dans le cadre d’une journée consacrée aux « effets identitaires des institutions », au CRAPE (IEP de Rennes). Nous tenons à remercier Sylvie Ollitrault, Érik Neveu et Nathalie Dugalès pour leurs remarques constructives ayant permis d’améliorer l’article.