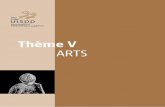La gouvernance, condition de la performance touristique des territoires ? (2013)
Transcript of La gouvernance, condition de la performance touristique des territoires ? (2013)
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 39
LA GOUVERNANCE,
CONDITION DE LA PERFORMANCE
TOURISTIQUE DES TERRITOIRES ? ELEMENTS DE REPONSE PAR LE BIAIS D ’UNE
DEMARCHE EMPIRIQUE
Sandra GUINAND1 et Sylvie JOLLY2
Résumé
L’observation des pratiques spatiales des touristes montre que ces derniers effectuent des choix de lieux qui se concrétisent dans l’espace et qui donnent naissance à des territoires touristiques. Ces territoires vécus ou pratiqués (par les touristes) transcendent la plupart du temps les frontières administratives et mettent en branle les territoires institutionnels. Ce phénomène peut se traduire dans des espaces à échelles variées et aux dynamiques territoriales différentes en termes de stratégies d’acteurs. Partant de l’analyse de l’espace touristique « Paris-Disneyland-La Champagne » et de celui de Porto-Vila Nova de Gaia au nord du Portugal, nous souhaitons aborder ce phénomène en croisant les territoires pratiqués par les touristes avec les territoires institutionnels (politico-administratifs) ou de projet afin de montrer l’intérêt d’une mise en adéquation entre les deux, arguant la nécessité d’une meilleure prise en compte des pratiques spatiales des touristes, non seulement dans l’élaboration et la gestion des politiques de développement touristique, mais également dans toute réalisation de projet urbain ou territorial. Il s’agit de traiter de la gouvernance touristique locale comme une des conditions de la performance touristique des territoires.
Mots-clés : Territoire, pratiques touristiques, gouvernance territoriale, performance territoriale
1 Ph.D, collaboratrice Post-Doc CEAT-EPFL, associée à l’EIREST Paris I Panthéon-
Sorbonne 2 Doctorante, EIREST-Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 40
e territoire et le tourisme constituent « un duo incontournable » en ce sens que le territoire et ses attraits (de
Grandpré, 2007) représentent une ressource pour la destination touristique (Lozato-Giotart et Balfet, 2012). De même, la relation au lieu est indispensable dans la mesure où l’offre touristique en tant que valeur intrinsèque du territoire, n’est pas délocalisable et implique que le visiteur se déplace sur les lieux pour la consommer (Marcelpoil, Bensahel et Vlès, 2007). Selon une approche à partir des pratiques spatiales des touristes, ces derniers effectuent des choix de lieux qui se concrétisent dans l’espace. Cette mise en relation de lieux et d’espaces forme le territoire-destination. La destination touristique est ici entendue comme un « ensemble de projets conçus comme efforts intentionnels et intéressés des acteurs intervenant dans la construction de la destination » (Kadri, 2011, p. 23). Elle se caractérise comme un environnement co-construit par un ensemble d’acteurs qui interagissent au sein de cet environnement que l’on peut qualifier de servicescape (Bitner, 1992). Or, bien souvent, les espaces pratiqués par les touristes transcendent les frontières administratives et mettent en branle les territoires institutionnels qui interviennent également dans la construction du territoire-destination. En effet, la consommation de lieux par des touristes combinant plusieurs territoires politico-administratifs rend le développement et le management du lieu touristique, en tant que produit et marque territoriale, plus difficile (Hankinson, 2010, p.19). Dans une analyse portant sur les stratégies d’organisation territoriale du tourisme en France, Escadafal relève que « la déconnexion partielle du management des territoires-destinations de leur carcan administratif est une piste largement exploitée » (Escadafal, 2007, p. 32). Le recours à la notion de gouvernance s’avère utile dans l’analyse de ce phénomène qui se traduit dans la plupart des cas dans des espaces à échelles et acteurs variés.
Il n’existe pas de définition précise de la gouvernance. Il s’agit d’un terme polysémique qui semble davantage demeurer à l’état de notion à défaut de constituer un véritable concept et qui suscite de nombreux débats (Duran, 1998 ; Leresche, 2001 ; Baron, 2003 ; Boisseaux et Leresche, 2013). Les diverses définitions de la gouvernance varient en fonction des contextes, des terrains et des champs disciplinaires. Face au manque de clarté scientifique et afin d’appliquer cette notion au champ du tourisme, certains auteurs ont cherché à en identifier les principales dimensions (Ruhanan, Scott, Ritchie et Tkaczynski, 2010), voire à en créer une typologie (Hall, 2011). En effet, les recherches portant sur le tourisme, objet d’étude complexe aux échelles et aux acteurs
L
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 41
multiples, ont de plus en plus recours à la notion de gouvernance pour l’étude du management des destinations touristiques (Bruyn et Fernández Alonso, 2012) et notamment des stations de sports d’hiver (Gerbaux et Marcelpoil, 2003). Parmi l’ensemble des acceptations de la notion de gouvernance, nous retiendrons celle de la gouvernance territoriale (Leloup, 2005 ; Boisseaux & Leresche, 2013) et, plus précisément, celle de la gouvernance territoriale du tourisme, mobilisée dans l’étude du management des destinations touristiques. La gouvernance territoriale (ou locale) du tourisme concerne « les acteurs, leurs relations, les structures et les processus de coordination » (Marsat et Bonniot, 2010, p. 102). Nous nous intéresserons plus particulièrement dans cet article à la question de la coordination des collectivités locales, leurs organismes chargés d’appliquer les politiques en matière d’aménagement urbain et de développement touristique dans le cadre de l’émergence d’espaces fonctionnels liés aux pratiques spatiales des touristes.
En confrontant les territoires vécus et pratiqués par les touristes avec les territoires institutionnels (territoires politico-administratifs) ou de projet, il s’agit, dans une perspective pragmatique de la gouvernance (Leresche, 2001), de repérer de manière empirique (analyse croisée de deux études de cas) les enjeux de coordination de politiques publiques et d’acteurs dans le cadre de la performance touristique des territoires. L’intérêt de cette démarche empirique croisée réside dans l’éclairage qu’elle apporte sur les dynamiques et les processus de gouvernance territoriale mis en œuvre ou non, propre aux espaces touristiques. Il ne s’agit pas ici de recourir à la comparaison afin d’observer l’existence de dynamiques communes ou d’identifier des variations. Mais plutôt, par l’intermédiaire de la confrontation, d’affiner notre analyse au regard de notre questionnement de départ. De fait, le choix de nos deux terrains se justifie par l’importance de leurs différences. Il s’agit notamment de la divergence en termes de jeux d’acteurs observés sur chacun d’eux, mais également en termes d’échelles territoriales d’interventions et d’interactions des différents acteurs.
Le premier cas d’étude concerne les villes de Porto et Vila Nova de Gaia (nord du Portugal) séparées par le Douro et reliées par le pont Dom Luis 1er. Porto, très souvent associée au vin éponyme, ne manque pas de souligner l’attrait des caves comme une des dix bonnes raisons de visiter son territoire (Câmara municipal, 2010). Or, ces dernières se situent sur la commune adjacente de Vila Nova de Gaia. A une échelle différente le deuxième cas d’étude se rapporte à la dynamique de coopération d’acteurs touristiques en cours depuis 2010 dans l’est de Paris, au sein d’un vaste espace
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 42
interrégional englobant la région Champagne-Ardenne et le département de Seine-et-Marne. Par le biais d’une approche inductive émanant directement d’observations et d’enquêtes de terrain (questionnaires auprès des touristes et entretiens avec les acteurs locaux), nous traiterons, dans un premier temps et de façon successive, les enjeux et les dynamiques touristiques de nos deux cas d’étude. Nous confronterons ensuite les observations effectuées afin de souligner l’intérêt d’une approche à partir des pratiques spatiales des touristes dans le cadre non seulement de l’élaboration et la gestion des politiques de développement touristique, mais également dans toute réalisation de projet urbain ou territorial.
PORTO ET VILA NOVA DE GAIA : LOGIQUE DE
CONCURRENCE AU SEIN D’UN ESPACE
TOURISTIQUE COMMUN
DES ENJ EU X D E T AIL L E AU TOU R D E L ’ECONO MI E TO URI STIQ U E
Dès les années 1980 et 1990, Porto (Câmara Municipal do Porto, 2003) et Vila Nova de Gaia (Entretien3, 2010), comme l’ensemble des villes portugaises, sont confrontées à ce qu’Alberto Rio Fernandes (2007, p. 130) appelle la « crise des centres ». Au cœur d'une agglomération urbaine de plus d’un million d’habitants, les deux villes subissent une dispersion et une fragmentation de leur tissu urbain, une mobilité croissante, une perte de vitesse et d’attractivité économique ainsi qu’une hémorragie démographique. Il s’en suit une dégradation du bâti de leur centre et, en particulier, de leur centre historique.
Concernant Porto, il faut noter qu’une première détérioration de la zone historique intervient bien plus tôt. Elle correspond à la période industrielle des villes européennes du début du XXe siècle qui ont vu leur cœur de ville se paupériser. Bien que des interventions de réhabilitation aient été entreprises dès le lendemain de la Révolution des œillets (1974)4, c’est seulement à partir du début des années 2000 que les autorités de la ville optent, par l’intermédiaire du Masterplan, pour un projet stratégique
3
Avocat, CidadeGaia SRU. La société de réhabilitation Cidadegaia et GaiaSocial - Entidade Empresarial Municipal de Habitação ont depuis fusionné pour donner lieu à l’entité GAIURB. 4
Il s’agit notamment des interventions de la CRUARB (Commission pour la réhabilitation urbaine de Ribeira et Barredo, à Porto) dans les quartiers de Ribeira et Barredo et qui se sont ensuite élargies à ceux de Miragaia et Sé toujours dans le centre historique.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 43
global de régénération urbaine sur les espaces centraux (Porto Vivo, 2005). L’objectif principal affiché est d’impulser de nouvelles dynamiques au sein de la ville-centre afin notamment d’attirer de nouvelles populations résidantes et d’intensifier les flux de visiteurs. Ces objectifs stratégiques se traduisent notamment par un ensemble de projets de revitalisation conduits par la société de réhabilitation urbaine Porto Vivo SRU. Il s’agit plus particulièrement, dans le cadre de cet article, du projet Frente Ribeirinha. Lancé sous la forme d’un concours d’idée d’urbanisme en 2007, celui-ci consiste en la valorisation des berges le long du Douro. Il se traduit notamment par l’esthétisation du paysage urbain ainsi que la reconquête et la reconversion de certains espaces auparavant liés aux activités maritimes et commerciales. Le concours d’idée insistait, dans son cahier des charges, sur la « promotion du tourisme, de la culture et des loisirs ainsi que d’autres activités compatibles en créant un front du fleuve Douro en lieu permanent de divertissement pour les résidants et les visiteurs » (Porto Vivo, 2007). Trois axes thématiques stratégiques ont donc été définis autour du projet : le Fleuve Douro, les industries créatives et le tourisme (Entretien5, 2009). Porto n’a que récemment rejoint le circuit des destinations touristiques. En 1997, la ville accueillait 87 313 visiteurs. En 2008, ils étaient 194 164266. Ces chiffres n’indiquent pas le nombre exact des personnes visitant la ville7 mais nous apprennent cependant que leur nombre a passablement cru ces dernières années. Si les méthodes de communication de la ville y sont certainement pour quelque chose (inscription au patrimoine mondiale de l’Unesco en 1996, capitale européenne de la culture en 2001, etc.), l’arrivée des vols low cost a certainement amplifié le phénomène et encouragé les visites de courts séjours. De plus, Porto est devenu, par le biais du développement de son aéroport, un lieu de transit ou de premier point de chute pour un séjour dans le reste du pays. Certaines personnes interrogées nous ont en effet expliqué être arrivées à Porto et continuer ensuite sur le reste du pays (Enquêtes, 2010 ; 2011). De fait, l’économie touristique joue véritablement, depuis quelques années, un rôle important dans les stratégies urbaines de la ville.
Vila Nova de Gaia, n’est, a priori, pas une destination touristique, même si son littoral attire en tant que lieu de villégiature. Cependant, l’attrait de ses caves et la vue panoramique sur Porto 5 Architecte, ancien technicien à la CRUARB, ancien administrateur de Porto
Vivo et actuellement directeur à l’IRHU. 6 Chiffres communiqués par l’Office de tourisme de Porto lors de notre
enquête, 2010. 7 Ces chiffres se basent sur la fréquentation (recensement des visiteurs) des
offices de tourisme par les visiteurs.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 44
depuis ses berges en fait un passage obligé pour qui visite cette région et la ville de Porto. La ville tire donc parti du flux de visiteurs installés à Porto. Les autorités de la ville, comme à Porto, souhaitent remédier à la dégradation du tissu bâti du centre historique paupérisé. Il s’agit également de travailler à la captation des populations résidentes et d’attirer nouveaux contribuables et investisseurs privés mais avec des moyens financiers limités (Entretien, 2010). Car, si Vila Nova de Gaia dispose également d’une société de réhabilitation, GAIURB, pour porter et gérer les projets d’urbanisme, cette dernière est détenue à 100 % par la Municipalité au contraire de Porto Vivo SRU qui est détenue majoritairement par l’Etat (IRHU8) à 60% (40% pour la Ville). Elle ne reçoit donc pas de subvention de l’État et demeure entièrement à la charge de la collectivité. Le tourisme apparaît donc comme une « recette » à préserver, entretenir et développer. De fait, tout comme à Porto, cet objectif fait partie intégrante des stratégies de son Masterplan (2007).
UN ESP ACE TO U RISTIQ U E CO M M UN , D ES I NT ERETS Q UI S E
CHEVA U CH EN T M AI S UN E L OGIQ U E QUI D EMEU R E
CON CUR R ENTI EL LE
Bien que voisines et tirant profit l’une de l’autre, Porto et Vila Nova de Gaia (carte 1) constituent toutes deux des pôles touristiques fonctionnant de manière autonome. Le site de l’office du tourisme ainsi que les différentes publications présentent Porto comme une ville de caractère9. La configuration particulière de son centre historique lui confère effectivement une dimension originale. Accrochés sur les pentes de la colline qui descend jusqu’aux berges du Douro, les différents quartiers sont composés d’édifices de plusieurs étages resserrés qui donnent au site un aspect dense et compact (fig. 1). Les rues étroites et sinueuses descendent vers les rives du fleuve ou débouchent sur de petites places, qui, par endroits, rappellent celles des villages. Les rez-de-chaussée sont pour la plupart occupés par de petits commerces vivotant. Bien que les édifices soient partiellement abandonnés ou tombent même en ruine, l’usage de différents matériaux : fer forgé, azuleijos, couleurs vives (jaune, rouge, bleu, vert) etc., confère à l’ensemble de cette colline un aspect esthétique très caractéristique. Ce dernier ainsi que l’ambiance qui s’en dégage, attirent tout particulièrement les visiteurs. Mais ce sont également les populations résidentes qui ajoutent à l’ensemble ce charme si
8 Institut national de l’habitat et de la réhabilitation urbaine.
9 Voir à ce propos le site de l’Office du tourisme ainsi que les nombreuses
publications (Patrimoine mondial, 25 ans de la CRUARB, Porto 2001, etc.) éditées par la Ville de Porto.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 45
particulier (Enquêtes, 2010 ; 2011). On y croise une population majoritairement âgée10, issue des classes laborieuses venues chercher du travail au début du XIXe, mais également des marginaux toxicodépendants et de nouveaux arrivants, immigrants en recherche d’emploi. La ville de Porto est très souvent associée au vin éponyme. Elle ne manque d’ailleurs pas de souligner l’attrait des caves comme une des dix bonnes raisons de visiter son territoire (Gabinete de Turismo, 2010). Certains visiteurs décident de se rendre sur ce territoire dans l’optique d’y retrouver la trace de ce vin doux et d’être au cœur de la fabrication de ce produit. Selon une enquête réalisée en 2005 par l’office de tourisme de la ville, sur les 302 questionnaires distribués, plus des trois quarts des répondants avaient cité la visite des caves comme une des différentes activités réalisées (Gabinete de Turismo, 2005). Cette tendance s’est confirmée lors de notre propre enquête (2010 ; 2011). Or, les caves ne se situent pas sur la commune de Porto, mais sur celle de Vila Nova de Gaia.
10
L’indice de vieillissement de la population (1991-2001) pour le centre historique s’établissait en 2001 à 186 personnes âgées de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 15 ans (INE, 2001).
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 46
Figure 1. Aperçu de l’espace touristique commune Porto-Gaia. Source : Guinand - Fonds de carte : Porto Vivo SRU.
La ligne en trait pointillé est tracée à partir de nos observations de terrain, des itinéraires proposés par l’office du tourisme de Porto ainsi que d’une étude de l’ISCET (Instituto superior de ciências empresariais e do turismo) de 2009.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 47
Figure 2. Vue sur Ribeira, Vieux Porto. Source : Guinand (2010).
Cette dernière est également accrochée à flanc de colline, sa morphologie urbaine est cependant moins impressionnante. Ce qui marque le visiteur, c’est l’alignement successif des caves le long de ses berges. Ce sont ces dernières qui attirent tout particulièrement le visiteur sur son territoire. La ville n’est cependant pas dénuée d’intérêt ni de charme avec ses petits restaurants encore largement fréquentés par les habitants du coin. L’office du tourisme de la Ville a donc développé un ensemble de parcours thématiques afin de capter et faire découvrir son territoire. Cependant, une partie de l’activité touristique de Gaia est tributaire de celle de Porto (nous laisserons ici volontairement de côté les pratiques touristiques à l’échelle de la Région même si ces mobilités se déclinent également très fortement à cette échelle). L’enquête réalisée en 2005 (citée plus haut) montre effectivement qu’une majorité de touristes venus à Porto se rendent à Vila Nova de Gaia (Gabinete de Turismo, 2005). Or, si ces résultats laissent présupposer des mobilités et itinéraires touristiques dépassant les frontières administratives, nous n’avons
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 48
connaissance d’aucune étude, tant du côté de Porto que de Vila Nova de Gaia, faisant état d’un espace fonctionnel touristique commun. Si certaines études existent, elles se concentrent sur le profil, les préférences et les motifs de visites des touristes. Aucune information quant à leurs différents itinéraires et pratiques n’est cependant donnée. Pourtant, à observer les touristes flânant le long des berges de Ribeira (côté Porto) et traversant le pont Dom Luis Ier, cet espace semble fonctionner comme un ensemble géographique touristique cohérent. Pour ces derniers d’ailleurs, une des spécificités de Porto réside dans son vin et ses caves (Enquêtes, 2010 ; 2011). Bien que certains regrettent le manque d’une meilleure accessibilité pour se rendre sur l’autre rive (le pont est principalement dévolu au trafic motorisé et le trottoir qui le longe est très étroit), la logique de leur parcours les amène la plupart du temps sur l’autre rive, du côté de Gaia. Preuve que dans l’imaginaire des visiteurs la question des frontières administratives n’est pas une préoccupation majeure : plus de la moitié des personnes que nous avons interrogées ignoraient que les caves étaient situées sur une autre commune (Enquêtes, 2010 ; 2011).
Cependant, les touristes ou visiteurs ne sont pas les seuls à brouiller les frontières. Les acteurs publics des deux villes tirent chacun avantages des représentations de cet espace commun. Comme nous l’avons indiqué plus haut, Porto joue sur son nom et les traditions de la vinification qui y sont associées (l’institut du vin de Porto se trouve sur sa commune). L’office du tourisme de la Ville ainsi que certaines publications ne manquent pas d’y faire référence. Les plans de ville de l’office du tourisme indiquent d’ailleurs l’emplacement des différentes caves sur la rive de Gaia, sans pour autant explicitement indiquer et citer le nom de cette commune. Ceci a pour effet de donner l’impression d’un prolongement naturel de son espace touristique. Vila Nova de Gaia n’est pas en reste : sur le site de l’office de tourisme aucune mention de Porto. Or, le point de vue donnant sur Ribeira depuis ses berges est un véritable spectacle en soi. Car si les visiteurs se rendent de ce côté des berges pour déguster un verre de Porto, ils y viennent également pour le magnifique coup d’œil sur l’autre rive. La Ville a d’ailleurs récemment inauguré un téléphérique qui longe les berges pour atteindre le Monastère de Serra de Pilar. Comme le faisait remarquer un acteur de la société de réhabilitation de Porto, la logique voudrait que le circuit touristique autour de cet espace commun soit complet (c’est-à-dire que la boucle soit fermée par un autre pont en aval) (Entretien, 2009). Vila Nova de Gaia a bien suivi ce principe dans son Masterplan (2007) puisqu’elle y propose de renforcer l’accès piétonnier du pont Luis Ier et qu’elle propose la création de deux passerelles. Propositions nullement évoquées dans le Masterplan
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 49
de la ville de Porto (2005), mais que nous retrouvons sous l’intitulé de « circuit du vin de porto » dans le cahier des charges du concours d’urbanisme pour la requalification des berges côté Porto (projet Frente Ribeirinha). Nous ajouterons que le maire de Gaia a récemment ouvert un site internet défendant l’idée de la création d’un pont en aval, intitulé « Nouveaux ponts pour une ville nouvelle » (Novas pontes para uma cidade nova) afin de susciter le débat et, laisser un « cadeau généreux » à ses successeurs lors des élections municipales de 201311. Ces deux Villes sont conscientes de leur forte interdépendance touristique et des potentiels projets urbains qui en découlent. Elles ont également toutes deux saisi les enjeux des possibilités de développement qui peuvent être tirées de la manne touristique. La ville de Gaia présente d’ailleurs les caves et l’attrait scénographique comme un axe principal de valorisation touristique de son territoire (masterplan, 2007). Les acteurs institutionnels de Porto font eux aussi le pari du tourisme et des loisirs comme un des axes de développement stratégique, notamment en maximisant l’attrait des rives du Douro (masterplan, 2005). Alors même que certains acteurs du tourisme tendent vers une mise en cohérence des offres touristiques ainsi qu’une articulation des différents acteurs du secteur de l’échelle régionale à l’échelle locale12, aucun réel travail de mise en cohérence de l’action publique autour du tourisme ne semble avoir vu le jour jusqu’à présent du côté des autorités publiques des deux Villes. Cet état de fait laisserait présupposer une concurrence alimentée par une couleur politique différente de chaque côté du Douro, mais il n’en est rien. Les maires des deux villes appartiennent tous deux au parti social démocrate (PSD)13 mais ne collaborent ni entre eux, ni avec certains organismes constitués autour des questions touristiques14. Cet état de fait, n’est pas sans péjorer la mise en place de certains projets urbains à vocation touristique. Si, le concours d’idée Frente Ribeirinha a bien récompensé un projet prenant en compte la réalité d’un circuit touristique dépassant les frontières administratives, ce dernier n’a fait l’objet d’aucun véritable travail concerté. Il pourrait même être
11
Pour plus d’information se référer au site : http://www.pontesportogaia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=501 12
Nous citerons ici l’exemple de PortoTours qui est une association d’entreprises cherchant à promouvoir le développement du tourisme culturel de Porto et sa Région en travaillant à l’offre intégrée de produits touristiques. 13
Il s’agit de Rui Rio à la tête de la Ville Porto depuis 2002 et de Luis Filipe Menese Lopes à la Mairie de Vila Nova de Gaia depuis 1998. 14
Pour l’heure, l’Office du tourisme de la Ville de Vila Nova de Gaia n’est pas mentionné en tant que partenaire de Portotours alors que l’Office de tourisme de la Ville de Porto en fait partie.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 50
interprété comme un rattrapage de la part des autorités publiques de Porto face aux forts investissements dans les aménagements du côté de Gaia (dont le téléphérique représente le point d’orgue). Pour l’heure, les principaux arguments avancés seraient la difficulté technique de réaliser des ouvrages n’entravant pas la navigation fluviale. Cependant, la période de conjoncture économique difficile tend à accentuer la situation de crise qui sévit d’un côté comme de l’autre du Douro, raison pour laquelle il ne semble pas surprenant que chacune des deux communes campent sur ses acquis, doutant, peut-être, d’un échange gagnant-gagnant dans le cadre d’une meilleure intégration de leur politique touristique (et des pratiques touristiques) aux différentes échelles d’action. Il semble donc que la concurrence entre territoires institutionnels ait, pour l’instant, pris le pas sur une gouvernance et une coopération pour un projet de développement autour d’un espace touristique commun et cohérent.
Bien qu’ayant des intérêts communs sur le plan touristique, la logique de concurrence semble perdurer pour les villes de Porto et Vila Nova de Gaia. Or, il est des cas dans lesquels le tourisme favorise la coopération interterritoriale. C’est ce que nous montrons à travers le second cas d’étude qui suit. Il concerne la dynamique d’acteurs touristiques qui s’est développée autour du nouveau positionnement de la plate-forme aéroportuaire Paris-Vatry en tant que porte d’entrée dans l’est francilien, pour le marché du low-cost.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 51
LA DYNAMIQUE DE GOUVERNANCE « PARIS –
DISNEYLAND – LA CHAMPAGNE » :
CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE ET
REALITES TOURISTIQUES
UN CON CEP T « IN STIT U TIONN EL » D E D ES TINA TION G LO BA L E
À 160 km à l’est de Paris, dans le département de la Marne, la commune de Vatry dispose d’une importante plate-forme aéroportuaire. Cette ancienne base de l’OTAN datant des années 1950 est rétrocédée après sa désaffection, près de quinze ans après, à l’armée française comme base d’entrainement militaire. En 1990, elle devient la propriété d’une collectivité territoriale, le Département de la Marne, qui décide de la spécialiser dans le fret aérien et de la reconvertir en un grand centre logistique. Le nouvel aéroport est inauguré en juin 2000. Il est rebaptisé « Aéroport Paris-Vatry » pour des raisons commerciales qui semblent évidentes. Mais le départ en 2009 de son plus gros client (faisant chuter son tonnage de 40 000 à 23 000 tonnes) oblige les élus locaux à repenser la stratégie de développement de l’infrastructure. Ceux-ci décident d’adopter un nouveau positionnement sur le développement du trafic passagers et de miser sur le marché du low cost. La volonté politique est de faire de cet équipement une porte d’entrée du grand bassin parisien, avec pour ambition de devenir le Standed de Paris. Au-delà de cette nouvelle activité passagers15, il s’agit bien d’un véritable projet de développement territorial que souhaitent mettre en place les élus avec comme objectif de tirer un maximum de retombées de l’accueil de nouveaux flux. Ce projet de développement territorial est confié à une association qui sera créé au début de l’année 2010. Dénommée Paris-Vatry Project (PVP), cette association travaille au développement de l’aéroport aux côtés de la Société d’Exploitation Vatry Europort qui gère le fonctionnement de la structure. Elle est financée par des collectivités territoriales, des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)16 et dispose d’un budget de 2 millions d’euros la première année17 pour négocier et accompagner l’installation de nouvelles lignes aériennes. La compagnie irlandaise Ryanair est la première à choisir Paris-Vatry. Elle ouvre en juin de la même année deux lignes ponctuelles entre Paris-Vatry
15
La structure avait été équipée au moment de sa reconversion d’une plateforme passagers. 16
Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil Général de la Marne, Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, CCI de Reims-Epernay, CCI de Châlons-en-Champagne. 17
Ce budget est porté à 4,4 millions d’euros en 2011.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 52
et les aéroports scandinaves de Stockholm-Skavsta en Suède et d’Oslo-Rygge en Norvège. Ces ouvertures de lignes s’inscrivent notamment dans le cadre d’un accord commercial avec la société Euro Disney S.C.A. qui souhaite attirer la clientèle low cost. Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des compagnies aériennes et de développement des territoires situés autour de l’aéroport, l’association PVP assure la promotion de ces premières lignes et engage un plan d’actions de la promotion touristique de ces territoires. En effet, l’enjeu pour les collectivités locales financeurs est de capitaliser sur l’arrivée de Ryanair et l’ouverture des lignes aériennes pour attirer et retenir le flux de voyageurs sur leurs territoires respectifs.
Cette dynamique a généré la création d’un concept de destination globale dénommée « Paris – Disneyland – La Champagne » (Jolly, 2010). Il s’agit d’une fédération de territoires touristiques dont le cadre spatial, en termes d’offres touristiques, s’étend et englobe la région Champagne-Ardenne, le département de Seine-et-Marne et Paris. Elle regroupe un ensemble d’acteurs (fig. 3) au centre duquel se trouve l’association PVP. Celle-ci coordonne et finance, via les subventions qu’elle reçoit des collectivités territoriales et des CCI, les actions de promotion de cette destination globale. Ces actions sont mises en œuvre par les organismes locaux de tourisme chargés de la politique touristique des collectivités territoriales parties prenantes. Il s’agit du Comité Régional de Tourisme (CRT) de Champagne-Ardenne et de ses quatre Comités Départementaux de Tourisme (Marne, Ardennes, Aube et Haute-Marne) et le Comité Départemental de Tourisme (CDT) de Seine-et-Marne. S’il est fait mention dans les supports de communication du CRT d’Île-de-France, il convient de remarquer que celui-ci, à ce jour, n’est pas véritablement engagé dans cette dynamique. Nous notons également l’absence des Villes de Reims et de Paris bien que celles-ci soient fortement attractives sur le plan touristique.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 53
Figure 3. Le schéma d’acteurs touristiques de la destination « Paris – Disneyland – La Champagne ». Source : S. Jolly (2010).
Les élus locaux accompagnent l’émergence de cette nouvelle destination. En effet, chacune des différentes collectivités territoriales parties prenantes ont accordé leur accord politique pour communiquer sur les sites de notoriété touristique plutôt que sur les territoires administratifs. Remarquons que plus généralement, dans le cadre des stratégies de développement touristique local portées par les collectivités territoriales, les élus confondent souvent destination touristique et circonscription électorale. Ainsi, les intitulés des destinations qui sont promues par les collectivités publiques reprennent bien souvent celui de la circonscription administrative. Dans le cas présent, l’intitulé retenu « Paris – Disneyland – La Champagne » s’appuie sur trois sites présentant une grande attractivité sur le plan touristique. Ces sites sont constitutifs d’un nouvel espace touristique au sein
Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Conseil Général de la Marne
SPHERE PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE
Comités Départementaux de Tourisme Marne - Aube - Ardennes et Haute-Marne
Comité Régional de Tourisme de Champagne-Ardenne
Comité Départemental de Tourisme de Seine-et-Marne
Paris Vatry Project
Euro Disney S.C.A.
Ryanair
Société d’Exploitation Vatry Europort
Chambres de Commerce et d’Industrie de la Marne
ACTEURS PRIVES
Comité Régional de Tourisme d’Île-de-France
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 54
duquel les frontières administratives ont été effacées. Une charte graphique globale a été adoptée et l’offre touristique conjointe est accessible à la vente depuis le site internet www.paris-vatry.fr. La destination, qui dispose de sa page Facebook18, propose également une offre commerciale de produits touristiques packagés auprès de guides touristiques19 ou d’agences voyages.
18 https://www.facebook.com/ParisDisneylandLaChampagne 19 Voir notamment depuis : http://www.arrivalguides.com/fr/Travelguides/Europe/France/PARISVATRY
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 55
Figure 4. Eléments de la charte graphique de la destination « Paris – Disneyland – La Champagne ». Sources : logo tiré de la page facebook - 1ère et 4ème de couverture de la brochure promotionnelle et commerciale.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 56
UNE GOU VERN AN CE T ERRITO RI AL E O RIGIN A L E MAI S EN
INA DEQU ATION AV EC L ES R EA LIT ES TO URI STI QU ES
Le fonctionnement de cette destination globale en plein développement présente un cas de gouvernance tout à fait original, tant d’un point de vue scalaire qu’organisationnel. D’une part, nous trouvons au sein de cette dynamique d’acteurs des collectivités et institutions relevant de différents échelons territoriaux : régional, départemental et intercommunal. Nous sommes ici dans le cadre d’une coopération horizontale et verticale suffisamment rare pour le souligner. D’autre part, cette gouvernance multi niveaux se caractérise par un schéma organisationnel complexe. En effet, un véritable acteur collectif s’est constitué autour de la nouvelle stratégie de développement de l’aéroport Paris-Vatry, regroupant divers acteurs relevant de la sphère publique et para-publique20 et de la sphère privée. Aucune structure n’a été créée venant se superposer à l’ensemble des acteurs. Et si le travail de coordination est assuré par l’association PVP, cette dernière ne se substitue pas aux organismes engagés dans la dynamique. L’ensemble des acteurs travaillent de façon concertée et coordonnée dans le cadre d’une stratégie de coopération et d’un plan d’action commun. Aussi, un véritable partage des tâches a été opéré. Le CRT de Champagne-Ardenne assure la mise en œuvre des actions de promotion et le CDT de Seine-et-Marne gère la constitution et la vente de l’offre touristique packagée par l’intermédiaire de sa propre plate-forme de commercialisation.
Rappelons que cette dynamique d’acteurs et de création de destination touristique globale a été impulsée à l’origine par l’installation des lignes aériennes de la compagnie Ryanair. Elle s’adresse par conséquent avant tout aux touristes scandinaves atterrissant à l’aéroport Paris-Vatry. Les actions de communication ont donc été menées en direction de ce marché. Afin de connaître les pratiques des premiers flux de touristes, une enquête a été réalisée sur les deux premiers mois d’ouverture des lignes. Cette enquête, qui a concerné plus de 1 000 passagers, montre que plus du quart d’entre eux séjournent en Champagne-Ardenne, un cinquième déclare aller à Disneyland et plus de la moitié viennent pour se rendre à Paris21 (fig.5). Ces résultats confirment la forte attractivité de la destination Paris puisque celle-ci aspire plus de la moitié des passagers. Or, s’il est fait
20
Les organismes locaux de tourisme que sont les CRT et CDT ont un statut privé mais sont financé presque en totalité par l’argent public de leurs collectivités de tutelles. Nous parlons donc ici de sphère para-publique. 21
L’étude a été réalisée par le CDT de la Marne et les résultats rendus publics dans un communiqué de presse de la CCI de Reims-Epernay.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 57
mention de Paris dans l’intitulé de la destination, aucun partenariat n’a été concrétisé avec les institutionnels du tourisme parisien. En l’occurrence, l’argent public investi par les collectivités locales engagées dans cette dynamique territoriale dans le but de faire la promotion de leurs territoires, profite davantage à Paris, bien qu’elle n'y soit pas partie prenante. De même pour la ville de Reims qui bénéficie de retombées touristiques22 de ces flux mais dont la collectivité locale ne participe pas au financement de PVP. Dans ce cas présent, la non concordance entre l’espace vécu par les touristes et l’espace de gouvernance se traduit par une fuite des retombées économiques vers des territoires qui ne prennent pas part à l’investissement.
Figure 5. Les flux touristiques de l’espace « Paris-Disneyland-La Champagne ». Source : S. Jolly – Fonds de carte : Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région de Reims – AUDRR.
Le cas de Porto et Vila Nova de Gaia et celui de la destination globale « Paris – Disneyland – La Champagne » sont au demeurant très différents tant sur le plan spatial que structurel.
22
Les Maisons de Champagne recensent une augmentation de la fréquentation de leurs caves par des visiteurs scandinaves sur cette période.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 58
Pour autant ils présentent l’avantage, par la mise en miroir de deux dynamiques opposées, de pouvoir questionner la pertinence de la gouvernance territoriale comme une des conditions de la performance touristique des territoires.
GOUVERNANCE ET PERFORMANCE : LA
NECESSITE D’UNE PRISE EN COMPTE DES
PRATIQUES SPATIALES DES TOURISTES Dans les deux cas d’étude observés, l’analyse des pratiques spatiales des touristes nous permet d’affirmer que ces derniers produisent de nouveaux espaces. Ces pratiques apportent une nouvelle dimension territoriale23. Pour pouvoir se développer ces espaces, que nous considérons comme présentant un caractère fonctionnel sur un plan touristique, nécessitent la mise en œuvre de stratégies de gouvernance entre acteurs touristiques et plus particulièrement entre territoires institutionnels. Il s’agit plus particulièrement de venir « combler » les lacunes d’actions publiques désolidarisées, qui seules, n’arrivent pas à réguler les relations entre institutions publiques (ici à l’échelle, départementale et régionale) et les autres acteurs concernés par la production de territoires touristiques (Ruegg, 2012).
Dans le cas des villes de Porto et Vila Nova de Gaia, chacune des deux villes tirent profit d’un espace touristique commun et s’approprient respectivement des aménités touristiques de l’autre. En ce sens, nous pouvons dire qu’elles tiennent compte des logiques touristiques, c'est-à-dire du territoire pratiqué par les touristes. Pour autant, l’analyse de ces pratiques reste assez superficielle et les deux communes peinent à vouloir mettre en place une stratégie coordonnée autour de l’économie touristique, ses acteurs et son espace. Ce défaut de vision opérationnelle, de gouvernance et d’une connaissance plus fine d’un espace commun scinde le territoire en deux. Il pénalise la fluidité des mobilités des visiteurs ainsi que l’élaboration commune de produits ou de manifestations. Nous noterons ici que certaines manifestations, comme la fête de la Saint-Jean (Saint patron de la ville de Porto), de par l’affluence du nombre de visiteurs contraignent, de facto, pour des motifs logistiques et de sécurité, la collaboration entre les deux rives. Enfin, ce manque de gouvernance empêche toute mutualisation de savoir-faire et connaissances pour la construction de projets conjoints.
23
Nous nous référons ici à la conception du territoire donnée par Claude Raffestin (1980) qui le décrit comme le résultat, à un moment donnée, d’un processus d’appropriation.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 59
Dans le cas de l’espace touristique « Paris – Disneyland – La Champagne » le tourisme constitue un vecteur de coopération entre les territoires institutionnels et génère une véritable dynamique de gouvernance territoriale. Mais l’espace de coopération interterritorial, c'est-à-dire celui correspondant aux territoires des acteurs parties prenantes, ne correspond pas à l’espace tel qu’il est pratiqué par la majeure partie des touristes. Autrement dit, l’espace sur lequel s’exerce la gouvernance touristique ne se superpose pas à celui produit par les touristes. Ce défaut de superposition entre espace de gouvernance institutionnelle et territoire touristique constitue un frein au développement en ce sens que, s’il n’entrave pas les flux de touristes qui continuent à circuler en se référant à leur imaginaire, il réduit l’efficacité des politiques publiques locales mises en œuvre. En effet, les montants investis dans cet espace de gouvernance ne génèrent des retombées touristiques que de façon partielle dans la mesure où les flux de touristes convergent en majeure partie vers Paris. Or, comme il a été dit, ni la Ville de Paris et son office de tourisme, ni la Région Île-de-France et son CRT ne sont parties prenantes à cette dynamique d’acteurs. Si ceux-ci ne s’y opposent pas, ils ne perçoivent pas, à l’heure actuelle, de véritable potentiel de développement depuis l’aéroport Paris-Vatry (Entretiens, 2010). Leur intérêt se porte davantage sur l’aéroport de Beauvais, situé au nord de Paris et plus proche géographiquement24. Rappelons encore une fois que cette dynamique s’est construite à partir d’une volonté de « captation » de flux de touristes et non sur des réalités en termes de pratiques spatiales touristiques. Ce sont dans ce cas des logiques institutionnelles qui priment sur les logiques touristiques.
Au-delà des simples retombées financières générées par le tourisme, les mobilités touristiques, nous l’avons vu, produisent des espaces touristiques (ou territoire-destination) et ajoutent une nouvelle dimension au territoire. De cette production de territoire-destination et de sa prise en compte par les différents acteurs publics ou privés dépend la performance touristique du dit territoire et de la pertinence des aménagements qui en découlent. En effet, la venue de visiteurs, leurs itinéraires et pratiques révèlent certains espaces. Ils contribuent également à la réactivation de certains objets, ensembles bâtis, paysages ou du moins permettent d’opérer un changement de regard sur ces derniers. Par le biais de la circulation de l’information et des
24
Notons toutefois que si l’aéroport de Beauvais est effectivement plus proche géographiquement de Paris que Vatry, le temps de trajet est quasiment le même compte tenu de l’encombrement de l’autoroute A16 reliant Paris à Beauvais.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 60
images, les mobilités touristiques concourent à étayer l’offre touristique notamment dans les réponses apportées par les autorités publiques, mais aussi le secteur privé. Enfin, elles contribuent à la modification des espaces tant dans leurs usages que dans leur fonction. Les pratiques touristiques et les usages qui en découlent profitent également à valider et légitimer certaines actions.
L’affluence de visiteurs dans un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco joue, dans le cas de Porto, le rôle de témoins (Câmara Municipal do Porto, 1993). Il justifie également, du côté de Vila Nova de Gaia, des investissements pour le développement d’aménagement le long des berges. En plus de confirmer la légitimité des aménagements et de la conservation de certains éléments bâtis, le visiteur offre par sa venue une nouvelle fonction pour le site. Le bâti valorisé, les espaces aménagés deviennent également support d’expérience. Ces éléments officient également en tant que passeur de valeurs et d’un certain imaginaire, une certaine histoire que la/les ville(s) souhaite(nt) se donner. Nous faisons ici référence à la notion de « mythologie territoriale » développée par Guy Di Méo (1996). Le tourisme et ses visiteurs jouent certainement un rôle non négligeable dans le cadre de la valorisation du bâti et des paysages, notamment parce que ce regard valorisant posé par les visiteurs rend compte et légitime certaines valeurs jusqu’alors ignorées par les résidents, les autorités publiques ou encore les acteurs du secteur privé.
Autre exemple pour Porto, le programme POLIS 200125 a largement contribué à améliorer la qualité du site en réduisant la place de la voiture et en restaurant une visibilité à certains éléments architecturaux constitutifs de cet espace ou en les reconstituant – la muraille médiévale notamment en abaissant la chaussée ou encore les escaliers où les lavandières venaient nettoyer leur linge. Mais, il a également déplacé l’activité commerciale composée d’étals de tous genres, qui officiait le long des berges, au pied du Pont Dom Luis Ier. Or, ce nouvel aménagement n’a que partiellement pris en considération l’impact sur le touriste. Car, si le visiteur passe effectivement à côté du site pour rejoindre l’autre rive, il ne s’y arrête que très rarement car l’endroit est difficilement repérable. De fait, ce site fonctionne mal. Lors de nos différentes visites les stands étaient rarement ouverts (fig.6).
25
Programme de réhabilitation financé par le gouvernement portugais.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 61
Figure 6. Vue du marché d’artisanat sous le Pont Dom Luis Ier. Source : S. Guinand (2010).
Pour le cas de l’espace touristique « Paris – Disneyland – La Champagne », l’afflux de visiteurs via l’aéroport Paris-Vatry vient légitimer la nécessaire modernisation de la desserte ferroviaire qui fait aujourd’hui défaut et venant connecter l’aéroport à la ligne à grande vitesse Est européenne. En effet, l’électrification de la ligne ferroviaire entre Paris et Vatry permettrait de placer l’aéroport à 1h15 de la gare de l’Est. A ce jour, les liaisons entre Vatry et les sites desservis, à savoir Châlons-en-Champagne, Reims (gare TGV), Disneyland et Paris (près de la Tour Eiffel), s’effectuent via des navettes en autocars. Le temps de transport nécessite près de 2 h pour rejoindre la capitale, lorsque la circulation à l’entrée de Paris est fluide. Pour l’heure, les accords partenariaux pour le financement de cette infrastructure ferroviaire s’avèrent difficiles compte tenu du climat de crise économique. Par ailleurs, les subventions de l’association PVP demeure conditionnées au développement de l’aéroport et aux retombées économiques générées sur le territoire. Si d’autres lignes ont été ouvertes (vers Porto, Nice et Marseille notamment) Ryanair ne semble pas vouloir maintenir ses lignes vers la Scandinavie. Quid des financements accordés à PVP ? La dynamique d’acteurs
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 62
repose sur des bases fragiles. Pour autant, les institutionnels du tourisme disent vouloir pérenniser la destination globale « Paris – Disneyland – La Champagne ». À termes, inclura-t-elle les acteurs institutionnels du tourisme parisien ? Au demeurant les acteurs ne semblent pas inquiets pour l’avenir de ce concept institutionnel de destination.
CONCLUSION L’analyse de ces deux cas d’études démontre que si la gouvernance est une des conditions de la performance touristique des territoires, ce n’est qu’à la condition d’une prise en compte des réalités touristiques en termes de mobilités et de pratiques spatiales. D’une part, la gestion non concertée d’un espace touristique commun comme dans le cas de Porto et Vila Nova de Gaia ne permet pas le développement touristique optimal des territoires. D’autre part, une dynamique de gouvernance telle que la destination globale « Paris – Disneyland – La Champagne » s’avère insuffisante si l’espace de coopération des acteurs ne superpose pas à l’espace pratiqués par les touristes. Par conséquent, nous défendons ici l’idée que la gouvernance territoriale est une condition de la performance touristique des territoires. Mais qu’elle ne peut être efficace que si l’espace sur lequel elle s’exerce s’appuie sur des logiques touristiques, c'est-à-dire sur la base des pratiques spatiales des touristes.
Or, l’une des difficultés rencontrées par les acteurs institutionnels dans l’appréhension des rapports que les touristes entretiennent avec l’espace, réside dans la complexité empirique à analyser ce phénomène qui nécessite des enquêtes précises et des analyses fines. Si l’observation des mobilités tendent à évoluer ces dernières années grâce à de nouveaux outils tels que les GPS (Gravari-Barbas et Jacquot, 2012), l’analyse demeure complexe. Pour autant, il nous semble que cette approche par l’espace traversé et vécu par les visiteurs s’avère indispensable dans l’observation tant quantitative que qualitative du tourisme, dans la mesure où l’information territoriale qui en résulte représente un ensemble d’éléments d’aide à la décision dans la gestion des politiques d’aménagement et de développement touristique (Moisy, 2001). Et plus particulièrement sur les espaces de gouvernance à mettre en place.
Il convient, dès lors, de travailler au développement d’outils d’analyse permettant de mieux appréhender la logique de spatialisation des touristes. Ces outils permettront aux acteurs institutionnels d’acquérir une connaissance accrue et affinée des pratiques spatiales des touristes et d’orienter en conséquence leurs
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 63
stratégies en matière de développement touristique et de gouvernance territoriale. L’un des défis à relever par la communauté scientifique réside dans l’apport de cette information territoriale qui permettra une évolution des rapports que les responsables politiques entretiennent aux territoires, notamment dans leurs discontinuités, que ce soit dans la gestion des politiques de développement touristique comme, plus globalement, dans toutes réalisations de projet urbain ou territorial.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 64
RÉFÉRENCES
Agência Municipal de Investimento de Vila Nova de Gaia. (2007). Vila Nova de Gaia : Masterplan, DVD.
Baron, C. (2003). « La gouvernance : débats autour d’un concept polysémique ». Droit et société, 2 -54, 329-349.
Bitner M. J. (1992). «Servicescapes : The Impact of Physical Surroundigs on Customers and Employees». Journal of Marketing, 56, 57-71.
Boisseaux, S., Leresche, JP. (2013). Emergence de la notion de gouvernance en Suisse : approches conceptuelles et historiques. In Vodoz, L., Thévoz, L., Faure P., (dir.). Les horizons de la gouvernance territoriale. Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes.
Bruyn, C. & Fernández Alonso, A. (2012). Tourism Destination Governance. Guidelines for Implementation. Dans Fayos-Sola, E., Jafari, J., Albino Matos de Silva J. (2012). Knowledge Management in Tourism: Policy and Governance Applications. Bridging Tourism Theory and Practice (4). Emerald Group Publishing Limited.
Câmara Municipal do Porto. (1993). Porto A Património mundial. Porto : CMP.
Câmara municipal do Porto. (2003). Porto: a city with character and future. Porto : CMP.
De Grandpré, F. (2007). « Attraits, attractions et produits touristiques : trios concepts distinct dans le context d’un développement touristique regional ». Téoros, 26-2, 12-18.
Di Méo, G. (Éd.). (1996). Les territoires du quotidien. Géographie sociale. Paris: L’Harmattan.
Duran, P. (1998). « Gouvernance ». Politiques et management public, 16-1, 3-4.
Escadafal A. (2007). « Attractivité des destinations touristiques : quelles stratégies d’organisation territoriale en France ? » Téoros, 26-2, 27-32.
Fernandes, J. A. (2007). «As atividades comerciais e a valorização das áreas centrais». Inforgeo, 129-135.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 65
Gabinete de Turismo. (2005). Apresentação Procura Turística, Câmara municipal do Porto.
Gabinete de Turismo. (2010). Porto 10 Razões para visitar uma cidade património mundial. Porto : Câmara Municipal do Porto.
Gerbaux, F. & Marcelpoil, E. (2003). Gouvernance et management local des villes et communes touristiques : le cas français. Contribution aux Rencontres internationales Démocratie et Management local. 20-23 mai 2003. Québec.
Gravari-Barbas, M. & Jacquot, S. (2012). « Tourisme et géographie. Une géographie du tourisme ». Dans Morisset, L. K., Sarrasin, B., Ethier, G. (dir.). Epistémologie des études touristiques. Presses de l’Université du Québec, 171-204.
Hall, M. (2011). «A typology of governance and its implications for tourism policy analysis». Journal of Sustainable Tourism, 19 - 4 et 5), 437-457.
Hankinson, G. (2010). Place branding theory: a cross-domain literature review from a marketing perspective. Dans Ashworth, G. & Kavaratzis, M. (Éd.) Towards Effective Place Brand Management. Branding European Cities and Regions. 15-35.
Jolly, S. (2010). Paris-Champagne, polarisation et rayonnement : enjeux d’une supra-métropolisation touristique. Colloque international Paris, tourisme et métropolisation. Echelles, acteurs et pratiques du tourisme d’une « destination capitale». 24 et 25 juin 2010. Paris Sorbonne.
Kadri B., Reda Khomsi, M. et Bondarenko, M. (2011). « Le concept de destination. Diversité sémantique et réalité organisationnelle ». Téoros, 30-1, 12-24.
Leloup, F., Moyart, L. et Pecqueur, B. (2005). « La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? » Géographie, économie, société, 7- 4, 321-332.
Leresche, JP. (2001). Gouvernance locale, coopération et légitimité. Dans Leresche, JP. (dir.). Gouvernance locale, coopération et légitimité. Le cas de la Suisse dans une perspective comparée. Paris : Editions Pedone.
Lozato-Giotart, J-P. et Balfet, M. (2012). Management du tourisme. Les acteurs, les produits, les marchés et les stratégies. 3e édition. Pearson Education.
Tourisme & Territoires / Tourism & Territories Volume 3 (2013)
Guinand & Jolly Tourter.com 66
Marcelpoil, E., Bensahel, L. et Vlès, V. (2007). Gouvernance des territoires touristiques : l’économie confrontée à l’urgence de la gestion urbaine et sociale. Dans contribution ASRDLF, Les dynamiques territoriales : débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires. Grenoble-Chambéry : 11-12 et 13 juillet.
Marsat, J-B. et Bonniot, A. (2010). Penser un tourisme territorial intégré et sa gouvernance. Modèles et pratiques. Dans Gagnon, C. (dir.). L’écotourisme visité par les acteurs territoriaux. Entre conservation, participation et marché. Presses de l’Université du Québec, 93-120.
Moisy, L. (2001). « L’espace de la ville ludique et touristique : approche à travers les pratiques spatiales des visiteurs (hébergements, itinéraires) ». Géocarrefour, 76 -2, 107-113.
Porto Vivo SRU. (2005). MasterPlan para a revitalização urbana e social da Baixa do Porto. Vol. I. Porto: PortoVivo SRU.
Porto Vivo SRU. (2007). Concurso de Ideias, Frente Ribeirinha do Porto na zona de intervenção prioritária. Porto: Porto Vivo SRU.
Raffestin, C. (1980). Pour une géographie du pouvoir. Paris : Litec.
Ruhanan, L., Scott, N., Ritchie, B. et Tkaczynski, A. (2010). «Governance: a review and synthesis of the literature». Tourism Review, 65-4, 4-16.