« La révolution momifiée », EspacesTemps, n° 38-39, 1988, p. 4-12.
Articles Territoires et révolution tunisienne
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Articles Territoires et révolution tunisienne
Décentralisation, aménagement du territoire et démocratielocale en Tunisie. Défis et enjeux
Amor Belhédi
2 /07/2011
Communication au Colloque International "La décentralisation etla démocratie locale en Tunisie: Enjeux et perspectives".Ministère de l’Intérieur, CFAD. Hôtel Medina, Hammamet, 30juin, 1 et 2 juillet 2011.
Quel est le rapport entre l’aménagement du territoire, ladécentralisation et la démocratie locale ? Comment faire pourque l’aménagement soit au service de la démocratie ? Commentprocéder pour que la démocratie serve l’aménagement ? Ladécentralisation favorise-t-elle la démocratie locale ? Desquestions qui nous renvoient à traiter de trois points : 1–Préciser et rappeler brièvement l’essence de l’aménagement duterritoire, 2– Faire le bilan de la question en Tunisie et 3–Préciser les enjeux.
1 – L’aménagement du territoire
L’aménagement du territoire est l’ « action volontaire et réfléchie d’unecollectivité sur son territoire, quel que soit l’échelle (locale,régionale, nationale) en vue de la reproduction, le développement et leprogrès (cadre et qualité de vie).
C’est l’action politique du groupe sur son territoire pour lare-structuration permanente de l’espace, selon une démarche rationnelle,en exploitant les atouts, en tenant compte des contraintes et en limitant lesgaspillages (économique, humain, spatial) par une utilisation rationnellede l’espace et des ressources, afin d’assurer le bien être dugroupe social et l’équité territoriale. C’est une « action politique ayantpour but d’harmoniser le développement des régions, de lutter contre lesdéséquilibres industriels ou culturels et les inégalités » (Grawitz M, 2000).
Le territoire est un espace approprié, organisé par un groupe social envue de la reproduction. La notion d’appropriation est centralepour en faire de l’aménagement une action de libération et deprogrès ou à l’inverse, une domination et une aliénationsupplémentaire. L’organisation stipule que c’est le groupesocial qui définit cet ordre avec ses priorités et ses choix.Le territoire est un espace auto-produit dans lequel lacollectivité s’y projette.
L’aménagement est une auto-projection géographique de la société dedemain, dans un éclairage long terme permettant les décisions àcourt terme (Belhedi A, 1978). L’aménagement permet ainsi detransformer un espace en un territoire. L’aménagement exprimeune auto-pro-jection de l’avenir, indissociable du projet desociété, il est éminemment politique. On ne s’approprie pas unespace aménagé ou commandé par l’autre, l’extérieur ; on peutle subir, dans la contrainte tout au plus ! Sans pouvoir endogènedes acteurs, sans gouvernance territoriale, le territoire n’existe pas.
L’aménagement se fonde sur deux impératifs antinomiques, ce quinécessite inéluctablement des arbitrages :
- L’efficacité économique : Utiliser les atouts revient à favoriserles points forts, consolider la croissance là où elle existe etne pas casser la dynamique amorcée, ce qui accroît lesdéséquilibres[1].
- L’équité socio-spatiale : Assurer l’équité territoriale reviendraitsouvent à sacrifier la croissance, d’où le gaspillage desressources et des moyens qui sont souvent limités.
L’aménagement du territoire est « une politique spatiale au service d’unprojet de société. Il s’agit d’agir sur le spatial pour transformerle social ». C’est « la dimension sociale des politiques territoriales », aulieu d’être la dimension spatiale des politiques sociales. Ladistribution spatiale de la dépense publique et ladiscrimination positive des territoires en constituent lesoutils classiques.
La société créé son espace à son image, cet espace joue le rôlede ciment social de l’organisation sociale. Tout changement nonintériorisé, introduit dans l’espace, désorganise la société etvice versa. La réorganisation spatiale porte en elle le germede la désorganisation sociale, même momentanée et limitée,lorsqu’elle est imposée et non intériorisée. Les exemples dutransfert de populations sont indicatifs à ce titre dans lesopérations d’aménagement agricole ou de rénovation urbaine.
L’aménagement est l’ensemble des méthodes et outils qui partentd’une situation donnée en vue d’améliorer le cadre de vie etassurer un développement global par un éclairage à long termedes réalisations et programmes CMT en tenant compte desspécificités, des contraintes et des aptitudes de chaqueespace.
L’aménagement du territoire apparaît comme une quadruple exigence :une exigence de justice spatiale : la correction des disparités, uneexigence économique en termes de spécialisation fonctionnelle, decomplémentarité des territoires et une recherche d’efficacité ;une exigence écologique qui assure la durabilité des ressources etune exigence politique : la gouvernance territoriale, ce qu’onappelle de nos jours la géogouvernance. L’aménagement duterritoire, comme le développement, doit être économiquementefficace, socialement équitable, écologiquement soutenable etpolitiquement « gouvernanciable ».
1.1- Les maîtres-mots de l’aménagement
L’analyse des différentes définitions données ci-dessous, citées ici à titre d’exemple, nous permet derelever certains mots-clefs qui reviennent souvent avecun ordre et une articulation différente chaque fois : Lacollectivité, l’action volontaire, l’arbitrage, ladémocratie territoriale, l’action permanente, l’espritcivique, la rationalité et l’éclairage à long terme,…
* « L’aménagement du territoire est l’instrument d’une démocratie moderne (…).C’est l’œuvre de la nation, une œuvre permanente qui déborde les soucis immédiats.C’est l’expression nouvelle de l’esprit civique» (Lamour Ph, 1967).
* « Action volontaire et réfléchie d’une collectivité visant à mieux répartir sur sonterritoire de nouvelles activités économiques et culturelles » (Lacoste Y,2007).
* « L’aménagement est l’ensemble des savoirs et des savoirs-faires dont laconstruction et l’application servent à transformer et adapter volontairement desespaces, d’échelles et de types variés, au bénéfice des sociétés qui les produisent etles occupent » (Lévy J et Lussault M, p61).
Le Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (CATU,Loi 94-122, du 28 novembre 1994), définit l’aménagement dansson article 2 comme « l’ensemble des choix, des orientations et desprocédures fixés à l’échelle nationale ou régionale pour organiser l’utilisation del’espace et même d’assurer notamment la cohérence dans l’implication des grandsprojets d’infrastructures, d’équipements publics et des agglomérations ». Faut-ilnoter ici l’absence de l’allusion au niveau local dans cetarticle ?
1.2- De l’utilisation optimale…à la maîtrise de l’espace
L’espace est devenu une ressource limitée qu’il convient deplanifier et de gérer efficacement. Il se trouve au centre deconflits et de luttes pour l’affectation, l’attribution et l’appropriation.
L’aménagement, vise essentiellement l’utilisation optimale,l’adaptation ou la correction de la structure spatiale au service d’unprojet de société dont le développement. Si ce projet change,l’aménagement change. L’évolution de la société nous écartetoujours de deux idéaux : l’équilibre et l’équité d’où lanécessité permanente de cet aménagement.
Il faut signaler la présence d’une contradiction systémique entrela société, son territoire et l’environnement global qui faitqu’il y a toujours un décalage, voire une contradiction entre
chaque couple et que l’espace ne répond pas aux besoins d’unesociété qui évolue en permanence, d’où l’aménagementincontournable. Comment programmer ce qui est inévitable ?
L’espace représente une matérialité qui pérennise les rapportssociaux : un barrage, une autoroute, un pôle technologique sontfaits pour des décennies et engagent irrémédiablement l’avenir.Le futur prend ses racines dans le présent, voire la passé.L’aménagement de l’espace constitue, à ce titre, un véritable enjeusocial ? N’assure-t-il la reproduction de la formation socialeactuelle ? La majeure partie des traits de la Tunisie de demainsont déjà là ?
La structure spatiale est l’une des composantes les plusrigides. Il est dangereux de laisser l’organisation de l’espace à une évolutionspontanée ou orientée de l’extérieur notamment pendant la phase de transition. Cedanger est d’autant plus grand que le pays est sous-développé,petit, peu diversifié, dépendant ou laisse libres lesmécanismes de marché. L’aménagement exogène conduit toujours àla dépendance durable (M. Santos 1978) à travers une structurespatiale extravertie.
L’espace en transition est un espace encore organisé par le système antérieur quia tendance à se maintenir et contrarier le système naissant.L’organisation de l’espace constitue un instrument fondamental du projet de société,l’élément le plus sûr mais aussi le plus résistant et ne peutêtre laissée au hasard, ni négligée, la destinée du groupe en dépend.
1.3- Les fondements : les difficiles arbitrages
A ce titre, l’aménagement est indissociable du pouvoir dans la mesure oùon aménage pour assurer et la reproduction, permettre ledéveloppement et améliorer la qualité de la vie. Mais lareproduction, le développement de qui ? A qui profite cetaménagement et quelle est la frange exclue ? L’aménagement estcette restructuration permanente de l’espace sur une base de rationalité,d’économie et d’équité en vue du bien être du groupe. Bref qui décide deces paramètres, qui procède aux arbitrages ?
Quatre problèmes se posent à ce titre :
i- L’approche est fondamentalement contradictoire, elle se fonde surl’efficacité qui conduit inéluctablement à favoriser lesespaces nantis, dotés et bien placés. Elle consiste aussi àassurer l’équité entre les hommes et les espaces, d’où legaspillage de ressources, la sous utilisation des compétences ?Qui procède à l’arbitrage ? Est-ce le pouvoir central ? Comments’articulent les différents niveaux de décision ?
ii- La rationalité permet l’arbitrage, les choix et les priorités,bref le pouvoir et son partage… Mais de quelle rationalités’agit-il, celle d’un acteur donné quelque soit sa légitimitéou de la collectivité ? Comment assurer la représentativité decette collectivité ?
iii- Le concept de bien être est flou ; il est, à la fois,quantitatif et qualitatif ; deux aspects qui ne vont passouvent ensemble ! Comment rallier les deux volets ?
iv- L’évolution constante de la société et de ses besoins faitde l’aménagement un processus de restructuration permanente, comme ledéveloppement, d’où la nécessité d’une certaine souplesse, de l’anticipation etl’intérêt que revêtent les outils de gestion et de régulation, de contrôle et de suivipour corriger à temps les trajectoires et moduler les choix.
1.4- Des principes de base
L’aménagement du territoire s’appuie sur l’optimisation dontles principes peuvent être résumés par les plus récurrents :
Le polycentrisme, la régionalisation et la hiérarchisation duterritoire national : le territoire s’organise toujoursautour de plusieurs pôles, centres ou métropoles sousforme de régions et de « pays ». La régionalisation et lapartition de l’espace est incontournable.
L’équité, la réduction des inégalités et l’équilibrespatial constituent un souci constant de tout aménagement
quel que soit l’échelle spatiale. Il ne s’agit pas d’unnivellement des différences ou des spécificités, il s’agitplutôt de ne pas dépasser les lignes rouges pour que lesécarts restent toujours du domaine du supportable et del’acceptable : des inégalités que tout le mondeaccepterait dans le cadre d’un consensus ce qui nécessitel’adhésion. Il s’agit de déséquilibres supportables et delà contrôlables.
L’efficacité, l’efficience technique et économique et larationalité des choix, de l’affectation et del’utilisation des moyens.
La décentralisation, la participation, le partenariat etla gouvernance permettant la démocratie localeparticipative des différents acteurs.
L’amélioration du cadre de vie, l’équipement territorialet le développement durable
La durabilité à la fois globale, spatiale et sectorielle ;l’anticipation et la flexibilité
1.5- L’obligation de résultat
L’aménagement, comme le développement, est régi parl’obligation du résultat. Il ne peut être jugé que sur ses résultatset non sur les intentions (souvent pieuses, rationnelles etbénéfiques) ! C’est selon le rapport de la population lésée,marginalisée ou laissée pour compte à celle qui en bénéficiequ’on peut juger une opération d’aménagement.
En outre, les besoins sociaux évoluent rapidement, leurspriorité change en l’espace d’une décennie. Ce qui apparaîtcomme un avantage à un moment donné peut s’avérer désastreuxune dizaine d’années après si on n’anticipe pas suffisamment eton n’adopte pas une démarche flexible à tout moment qui laisseune marge de liberté aux décideurs pour pouvoir moduler etréguler à temps les trajectoires.
Ne serait-ce que pour ces deux principes seulement,l’aménagement n’a pas de sens sans pouvoir local et régionalreprésentatifs et une collectivité territoriale impliquée dans
le processus depuis l’idée jusqu’au suivi en passant par laconception, les choix, la réalisation, l’évaluation et larévision des schémas, des plans et des projets….
On parle de nos jours, de plus en plus, du développement territorialqui articule l’aménagement du territoire au développementsocio-économique où le territoire, loin d’être un simplesupport matériel neutre, devient à la fois un facteur et une finalitédu développement.
2- Le bilan en Tunisie
L’aménagement du territoire est passé par plusieurs étapesqu’on peut analyser sous trois points : 1- Les études, 2- Latutelle et l’attribution et 3- Le bilan.
2.1- Les études
On s’est acheminé progressivement des études surles villes vers la dimension régionale jusqu’aux schémasd’aménagement avec les années.
a – L’urbain au centre des préoccupations de l’aménagement
Les premières études d’aménagement ont concerné les villes àtravers le plan d’aménagement du Grand Tunis dès 1964 quicristallisait l’espace migratoire tunisien avec des taux decroissance dépassant 5% ce qui a conduit la capitale à déborderson site. D’un autre côté, ce sont les études sectorielles quiont été privilégiées dans la mesure où la planificationéconomique a été prioritaire : les études de transport, lesétudes des zones touristiques de Hammamet-Nabeul, Jerba-Zarzis,Sousse-Monastir et à un certain moment Gabes, l’étude du pôleindustriel de Gabes avec le colloque de Zarzis en 1967, la zoneminière qui est entrée en crise (DAT/G8, 1968 : la région minière).
Dés la fin des années 1960, l’exode rural était tel que la DATamené une étude sur les villes considérées comme le maillon de
base : les unités urbaines en 1969, Villes et Développement en1973 où la maîtrise de la croissance urbaine a été la clef devoûte de l’étude à une période où le taux du croîtdémographique a dépassé toutes les estimations : les tauxavaient dépassé le seuil de 5% /an et on est arrivé à organiserle retour obligé des nouveaux arrivants, . La même année, futcréé le Programme de Développement Rural (PDR) pour fixer lapopulation sur place et améliorer les conditions de vie.
L’étude s’est limitée à une ébauche del’aménagement du territoire national avec trois villeshiérarchisées (Tunis, Sfax, Sousse) appelées à jouer le rôle depolarisation avec des liens privilégiés entre Tunis et lesvilles du Nord, Sousse-Kairouan, Sfax-Gabes. En 1979, un Comitéinterministériel de l’aménagement du territoire s’est réuni eta recommandé plusieurs actions.
Au début des années 1970, plusieurs études ont étémenées sur les principales villes tunisiennes : Tunis 72, Sfax,Sousse, Gabes, Bizerte… A Tunis, plusieurs études sectoriellesont donné lieu à la création d’une institution de planificationurbaine dés 1974 le District de Tunis, devenu par la suitel’Agence Urbaine du Grand Tunis (AUGT).
Avec la promulgation de la loi organique descommunes en 1975[2], l’aménagement se cristallise sur l’espaceurbain essentiellement sous forme de PAU, du PRA (Plan Régionald’Aménagement) de Tunis en 1977, du PDU (Plan Directeurd’Urbanisme) de Sfax en 1978. Ce n’est qu’en 1979 que lepremier Code d’Urbanisme a été promulgué.
b- La décentralisation et l’action régionale
L’action régionale a commencé dés 1976 avecl’étude sur la décentralisation industrielle et la promulgationdu FOPRODI (Fonds de Promotion et de décentralisationindustrielle) en 1977 qui a divisé le pays en trois zones selonles avantages octroyés. On a encouragé la déconcentration
universitaire et sanitaire dés le milieu des années 1970. Audébut des années 1980, il y a la création du CGDR (CommissariatGénéral au développement Régional) qui a procédé àl’élaboration de la carte des priorités régionales qui a étéutilisée comme base de la répartition des crédits du PDR(Programme de Développement Rural), puis du PDRI (Programme deDéveloppement Rural Intégré). Les offices des périmètresirrigués (PPI) crées au début des années 1970 sont remplacéspar la suite par trois Offices de Développement du Sud (ODS),du CO (ODCO) et du Nord-Ouest (ODSPANO). Au niveau industriel,la loi de1981 adivisé le pays en cinq zones, remaniée en 1987et reconduite en 1993 par le CII (Code des InvestissementsIndustriels).
Il reste cependant qu’il s’est agi plutôt d’unedéconcentration (dé-densification du tissu industriel et re-localisation des tâches banales) que d’une véritable dé-centralisation (multiplication des centres de décision) dans lamesure où il y a eu un affinage fonctionnel et une délégationde certaines tâches d’exécution renforçant même la centralité ?
c- Les schémas d’aménagement
Le premier SNAT a été élaboré en 1985 avec lesSRAT pour chacune des régions (NE, NO, CE, CO, Sud) dans uncontexte de l’Etat développeur. Le scénario de l’équilibrerégional, où chaque région retiendrait sa population, a étépréconisé avec des métropoles régionales.
Avec la crise qui s’est déclenché en 1985,laTunisiea été contrainte d’adopter le PAS, de privatiserl’économie et de supprimer les entraves à l’intégration aulibre échange avec en 1996 l’union douanière avec l’Unioneuropéenne dont la préparation a duré 12 ans (1996-2008) avecl’habilitation et la mise au niveau des différentes activités.
Il faut rappeler que le code d’aménagement etd’urbanisme est promulgué seulement en 1994 en pleine crise ?
Le second schéma national élaboré entre 1996-1998 apréconisé le nouvel ordre territorial avec une « Tunisieutile » lieu de la métropolisation, les plateformeslogistiques, l’investissement rentable et les IDE, les pôlestechnologiques… Les zones intérieures sont destinées à l’aideque l’Etat va assurer à travers les mécanismes de laredistribution dans cette « Tunisie inutile ».
2.2 – Une hésitation d’attribution
L’aménagement du territoire est né en Tunisie dans lesinterstices de la planification, sorti de l’économie avec unsimple service à la fin des années 1960 pour être rattaché àplusieurs Départements avec des va et vient entre l’Equipement,l’agriculture, le Plan, l’environnement ce qui n’est pas sansconséquences sur les attributions, le statut et la finalitémême de l’aménagement du territoire. Le développement local relève-il del’Intérieur ? Pourquoi le terme local a disparu après quelques semaines du labelnouveau ministère qui s’occupe du développement régional ?
2.3 – Un bilan mitigé
En dépit des réalisations assurées en Tunisie quiont permis la diffusion des infrastructures, le rééquilibrageterritorial, l’affinage du système urbain, la mobilisation desressources et leur protection, on relève plusieurs faiblessesdont on peut citer : le déséquilibre régional persistant, lesdéséquilibres des systèmes urbains et la carence de lagouvernance (territoriale).
a- Le déséquilibre régional
Il s’exprime à travers la permanence de la carte des niveaux dedéveloppement malgré l’amélioration générale du niveau et desconditions de vie (Belhedi A, 1996, 1999).
Il se manifeste par la forte concentration sur la frange littorale à tousles niveaux : 75% de la valeur ajoutée, 95% de l’économie
industriel et touristique, 68% de la population, 80% du parcinternet, les technopoles, le trafic aérien,… (Belhedi A 2010,2011).
Cette concentration s’est opérée sur la frangelittorale, suite à la nationalisation, à la mise en place despôles de développement dans les années 1960 (AMS de Sousse,Meublatex, textile de Ksar Hellal…), la crise de Bizerte et lareconversion conséquente ; la libéralisation des années 1970 etl’industrie d’exportation de la loi d’avril 1972, les stationstouristiques et les infrastructures liées (routes, aéroports),le pôle industriel de Gabes. Dans les années 1980, on a leszones franches de Bizerte et de Zarzis, la station de YasmineHammamet, enfin le port et l’aéroport d’Enfidha, les nouveauxprojets de Tunis, Hergla, Selloum…
Cette concentration s’est faite au profit d’unespace de plus en plus circonscrit depuis les années 1980 sousla forme d’un triangle dont les sommets sont Bizerte, Kélibia etMahdia (Dlala H, 2011) avec un affinage fonctionnel de la Capitale avecdes bassins d’emploi au niveau du NE et du Sahel. Cet espacereprésente plus de 70% de l’investissement. En dehors de cetriangle, plus de grands projets, le pôle chimique n’est pluspolarisateur tandis que Sfax se maintient dans un équilibrefragile.
b- Le déséquilibre des systèmes urbains caractérise le niveaunational et régional
- Le déséquilibre concerne le système urbain national avec unecarence manifeste des villes moyennes exprimant ainsi la fortecentralisation.
- Le déséquilibre des systèmes urbains régionaux :tous les systèmes urbains, à part celui qui se trouve autour dela capitale, sont touchés par une tare donnée : l’absence d’uncentre régional capable de polariser la région, la défaillancede la hiérarchie avec l’absence de certains niveaux, la
macrocéphalie du système urbain (Tunis, Sfax, Kairouan), lafaiblesse des villes moyennes (Kairouanais…) ou l’absence despetites villes (Kasserine)…
c- Un vie de circulation focalisée sur le littoral etarticulée sur la Capitale tous les réseaux sont basés sur Tunis(le réseau routier, le réseau ferroviaire…) exprimant la fortedépendance du centre. La plupart des réseaux sont basés sur lelittoral : routes, rail, ports et aéroports…
d- La gouvernance locale et régionale est totalement déficienteavec l’absence de la région, la faiblesse du local et lacarence des moyens et des outils, la non représentativité desconseils régionaux et locaux, la non municipalisation de lamajorité du territoire (statut rural) et l’absenced’institutions inter-communales dans les grandes villes,…
3- Les enjeux pour la Tunisie
Le débat sur la question socio-économique etterritoriale reste très limité, voire éludé suite à l’urgencede la question politique et l’absence de programmes des diversacteurs en place (gouvernement de transition, partispolitiques…) et ce malgré l’urgence de la question.
L’ouverture du pays, son insertion dans l’économie-monde et la littoralisation subséquente semblent-ellesacquises ? La proximité de l’Europe et la présence d’un « nearshore » euro-méditerranéen sont des opportunités nonnégligeables même si la place de l’Europe est appelée à reculertandis que la réduction des inégalités régionales apparaîtinéluctable ? Voilà la nouvelle problématique de l’aménagementdu territoire en Tunisie. Le territoire doit être réhabilitépour devenir un facteur de production, l’objet d’une actionvolontaire re-structurante. La question territoriale doit être largementdébattue sur la place publique pour définir les choix stratégiques.
Les enjeux de l’aménagement du territoire sont de taille. Ilen va de la gouvernance territoriale, ce qu’on appelle de nos jours lagéogouvernance, en vogue maintenant notamment dans les paysnordistes. Il s’agit de passer d’un mode de régulation à unegouvernance participative où le territoire devient un lieu del’exercice de la démocratie. Dans une phase transitoire, ilserait difficile de passer d’un rôle de la simple critiqueauquel était assigné la plupart des acteurs et des citoyens aurôle plus actif de conception et de proposition. La questionest très complexe et touche plusieurs sphères mais on selimitera ici aux actions suivantes :
3.1- Une structure spatiale durable
On parle d’industrie durable, d’agriculture durable, detourisme durable, mais on ne doit pas oublier aussi qu’on peutparler de structure spatiale durable. Il s’agit de doter lepays d’une structure territoriale durable, c’est-à-direéconomiquement efficiente, socialement viable et écologiquementvivable ; respectueuse des ressources, valorisante despotentialités et des compétences territoriales et anticipatricetout en assurant une certaine souplesse. Cette durabilités’appuie en fait sur deux piliers :
* L’équilibre territorial entre les différentes régions et milieux,
* L’équité inter-régionale au nom de la citoyenneté et de ladémocratie qui permet à chaque tunisien de vivre en dignité, undes mots d’ordre dela Révolution.
* Un cadre de vie vivable dans toutes les régions et les milieuxcapable de tisser des rapports affectifs avec le milieu, lalocalité ou la région : créer une image positive duterritoire ?
* Un nouveau découpage territorial permettant d’intégrer lesespaces côtiers et les régions intérieures rompant avec leschéma en damier et l’opposition Est-Ouest.
* Favoriser la spécificité au niveau local et la diversité etla complémentarité au niveau régional pour pouvoir articulerles échelles spatiales.
* Encourager l’ancrage territorial entre l’entreprise et son espace,les acteurs et leurs localités ou région, la ville et sesterritoires tout en favorisant la création de réseaux devilles, les économies de proximité et de connexité donnant lieu à lamise en place de filières et rompant le lien ombilical avec lacapitale ou les villes du littoral débouchant sur des économieslocales viables et des économies régionales diversifiées. Ils’agit de mettre en place une nouvelle configurationterritoriale où la géogouvernance l’emporte à la place dudécoupage spatial étatique de type vertical au service del’encadrement et du contrôle partisan et sécuritaire beaucoupplus que du développement et de la liberté.
3.2- Une démarche à revoir totalement
Il s’agit d’inverser totalement la démarche qui a été suiviejusque là à travers les processus suivants :
* L’économie de connexité permet de mettre en place des filières,des réseaux
* L’économie de proximité pour rompre la dépendance vis-à-vis de lacapitale, des villes littorales et intégrer les économiesrégionales.
* Rompre avec le découpage spatial en damier et le clivage littoral-intérieur en articulant les deux types d’espaces dans les mêmesrégions.
* Définir les zones d’action prioritaire et les mesures correspondantesà mettre en oeuvre.
* Le réalisme et l’opérationnalité au niveau des objectifs fixés, desschémas élaborés et des moyens mis en œuvre en fixant des
objectifs de résultats, des contrats par objectifs et desindicateurs de suivi et des feuilles de route.
* Instaurer la forme contractuelle du développement territorial enimpliquant tous les acteurs endogènes : contrat de pays,contrat de région, contrat d’entreprise…
* « Think global, Act Local », il s’agit de penser globalement etd’agir localement, ce qui permet de joindre les deux bouts deéchelle spatiale et de rallier la conception et l’action à lafois, d’éclairer l’action régionale et locale dans un éclairagenational et de garantir une certaine souplesse tenant compte del’interaction inter-scalaire.
3.3- La création des institutions appropriées
Il s’agit de créer des institutions viables et efficaces,capables d’anticipation et adaptées aux problèmes posés :
* Créer la région et ses institutions et lui donner les moyensd’intervenir au niveau institutionnel, financier, études etanticipation. Une région n’est pas un simple découpage spatial,elle est avant tout un pouvoir de décision territoriale qu’ilfaudrait définir, préciser et lui donner les moyens.
* Revisiter les attributions du CGDR et des offices de développement dans lesens d’une meilleure coordination entre les différentsintervenants sous forme d’un Ministère ou d’une Délégationinterministérielle (Aménagement et action territoriale,Aménagement du territoire et développement régional et local,Développement territorial).
* Doter les grandes villes d’institutions de planificationurbaine (agences urbaines) et de gestion urbaine (communautés inter-urbaines).
* Revoir les attributions et le statut de l’aménagement tant au niveaunational que régional dans le sens d’un rôle accru decoordination et de gouvernance territoriale.
* Permettre aux collectivités de se prendre en charge à travers les conseilslocaux et régionaux élus démocratiquement de nature à mettre laquestion de l’aménagement du territoire dans le débat public,les doter des moyens d’action au niveau institutionnel,financier et foncier.
* Revisiter totalement le système fiscal, notamment la fiscalité localepour doter les communautés territoriales des moyens adéquatssur la base de l’équité et de la solidarité territoriales touten incitant les dynamiques locales (industrie, tourisme…). Unepéréquation territoriale doit être établie pour doter lescollectivités territoriales (locales, régionales), l’Etat, enfavorisant la solidarité territoriale à travers les mécanismesde transfert spatial des communes créatrices de richesses versles communes démunies.
* La décentralisation constitue la seule garantie d’undéveloppement régional et local efficaces et opératoirespermettant un développement ascendant « Bottom-Up » et non« Top-Down » qui émane des collectivités territoriales qui leprennent en charge selon un processus participatif assurant lagouvernance territoriale.
3.4- Un découpage territorial souple et évolutif
Il s’agit de mettre en œuvre une découpage spatial stable etévolutif à la fois permettant la comparabilité et le passaged’une échelle à une autre par simple recomposition :
* Municipalisation totale du territoire avec des communes rurales et descommunes urbaines
* Stabilisation du découpage territoire avec des unités spatiales de base(USB), individualisées et indivisibles, fixes dont la
recomposition donne lieu à toutes les autres unités (zone,secteur, délégation, gouvernorat, région).
3.5- Une loi d’orientation générale pour l’aménagement et ledéveloppement territorial
Il s’agit de doter le pays d’une loi d’orientation générale qui fixe lesprincipes généraux, les choix stratégiques et d’intérêt généralen matière d’aménagement :
* Favoriser la solidarité territoriale tout en incitant la compétitivitéinter-régionale et en profitant des incitationsinternationales.
* Etablir une feuille de route pour réduire les inégalités et lesdéséquilibres sans casser la dynamique des espaces en fortecroissance.
* Préserver les ressources et le patrimoine dans une optique dedurabilité : agriculture, industrie, tourisme, espace,paysages, culture….
* L’équilibre territorial n’existe qu’à travers l’équilibre despouvoirs, il s’agit de procéder à une redistribution descompétences, des moyens et des tâches et des moyens entre lesdifférents acteurs. La démocratie locale n’existe pas sans cepartage mais la décentralisation n’a pas de sens sans unenouvelle négociation des pouvoirs (central, régional, local).
* L’aménagement autant la démocratie concernent toutes les échellesspatiales et on peut aisément concevoir des conseils élus auniveau trois niveaux supplémentaires : la délégation, legouvernorat et la région en plus des communes et du niveaunational. Toutes les démocraties du monde s’appuient sur troiséchelons au moins : le communal, le local (délégation), lesous-régional (gouvernorat) et le régional (à créer en Tunisie)parallèlement aux représentants du pouvoir central qui sechargent désormais de l’exécution, du suivi, du contrôle et de
gestion alors que la décision, la conception relèvent plutôtdes instances représentatives
* Elaborer un nouveau Code d’aménagement territorial qui tiendraitcompte de l’évolution de la société tunisienne, de l’émergencedu niveau local et de la démocratie locale à instaurer.
3.6- les deux piliers de la reconstruction territoriale
Les deux piliers de la (re-)construction territoriale sontla coordination des acteurs et les ressources territoriales en termes despécificités-différenciation et d’ancrage (Lamara H 2009) dansle sens où le territoire est auto-produit par une régulationlocale des acteurs, il est cet espace affecté par lesstratégies de développement. Il devient même, aprèsl’entreprise, le support de l’innovation et du développementface au système post-fordiste et à la mondialisation. Pourcela, encore faut-il permettre aux acteurs locaux d’exister, depouvoir agir et de participer à la gouvernance territoriale. Ils’agit de décentrer les pouvoirs pour instituer le territoirecomme un construit collectif institutionnel (densité) et unlieu de production de ressource où la proximité et la connexité(géographique, institutionnelle, sociale, organisationnelle)sont fondamentales.
Le problème de l’aménagement du territoire, estloin d’être un problème technique ou de découpage, il estd’essence politique où il s’agit d’une question du pouvoir(institutions, moyens d’action, gouvernance). Ladécentralisation n’est pas un but en soi, elle est un moyend’atteindre la démocratie qui est avant tout locale, dans lamesure où elle touche le quotidien du citoyen, la sphèrematérielle de l’habitat et du travail, du quartier et de laville. La décentralisation est elle-même un arbitrage entre lepouvoir central, le niveau régional et local. Encore-faut-ilque les différents acteurs soient à un niveau tel qui leurpermet de (re-)négocier leur place, leur rôle et leur statut
alors que négocier exige déjà une légitimité et un minimum depouvoir?
Faut-il rappeler l’adage qui dit que « ce qui est faitpour moi, sans moi, est contre moi ». Ne faut-il pas aller plus loinque la décentralisation et poser la question du partage dupouvoir à un moment critique de l’avenir du pays. Cettequestion si elle ne sera pas inscrite dansla Constitution, ellerisquera de rester un veux pieux comme tant d’autres.
Même dans un contexte de pénurie totale de moyens oud’institutions, la décentralisation permettait toujours auxcollectivités et aux citoyens de s’exprimer et de participer àla chose publique ; de formuler et de revendiquer les requêteset les besoins, enfin d’exiger les droits. C’est déjà un pas !
Enfin,la Tunisieconnait maintenant une étapedécisive et critique de son avenir, c’est actuellement que lesgrandes lignes sont en train de se mettre en place. Il faudraitêtre conscient que si la démocratie territoriale (locale etrégionale) n’est pas inscrite dansla Constitution, il faudraitattendre probablement des siècles ?
Références
Belhedi A – 1978 : Politique et aménagement urbain. Journéed’étude de l’AGT, FLSH, Tunis
Belhedi A – 1992 : L’aménagement du territoire en Tunisie. PUT, FSHS.
Belhedi A – 1995 : « L’aménagement du territoire entre lediscours et la pratique ». Revue Tunisienne de Géographie, 27, p.9-36.
Belhedi A – 1999 : « Les niveaux de développement en Tunisie :analyses comparatives de 3 méthodes classificatoires ». RevueTunisienne de Sciences Sociales, 119. pp. 11-38
Belhedi A – 2010 : « Le mouvement moderniste et la questionspatiale ». Projet de Renouvellement du mouvement moderniste tunisien,ACMACO. A paraître en 2011.
Belhedi A – 2011 : « La dimension spatiale delaRévolutiontunisienne ». Communication dans plusieurs tribunes.
Brunet R et al – 1993 : Les mots de la Géographie. Doc Fr.
DAT – 1968 : La région minière. Groupe Huit
DAT – 1971 : Villes et développement. Groupe Huit
DAT – 1976 : Décentralisation industrielle. Groupe Huit
Dlala H – 2011 : « L’urgence d’une réflexion collective sur ledéveloppement et l’aménagement du territoire tunisien ». LaPresse, Opinions, page 6, 11/04/2011.
Grawitz M – 2000 : Lexique des Sciences sociales. Dalloz Campus, 2000,7° édition
Lacoste Y – 2007 – Dictionnaire de Géographie. A Colin, Coll. U
Lamara H – 2009 : « Les deux piliers de la constructionterritoriale : coordination des acteurs et ressourcesterritoriales ». Développement durable et territoires,
http://developpementdurable.revue.org/8208
Lamour Ph – 1967 : 60 millions de français, Buchet/Chastel, Paris, p.287-288
Langumier J-F, 1974. « Vers la fin du fétichisme de la ville »,in Projet, 83, p.288
Lévy J et Lussault – M 2003 : Dictionnaire de Géographie et des espacesde la société. Belin,
Santos M – 1989 : Espace et méthode. Publisud, 124p ;
[1] La croissance est différentielle, elle se manifeste àcertains points précis de l’espace et se diffuse par la suitepar un mécanisme d’interdépendance technique (sectorielle) etspatiale créant en première phase une aggravation des écarts etdes déséquilibres. Cf. F. Perroux, L’économie du XX° siècle, JBoudeville : 1968 : Polarisation et aménagement du territoire.
[2] Autant cette loi a octroyé à la commune des prérogativesimportantes, autant elle lui a ôté certaines tâches qui ont étéconfiées aux agences et offices et consacré la tutelle duMinistère de tutelle et de l’Equipement en matièred’aménagement de l’espace communal.
WordPress:
Connexe
LA DIMENSION TERRITORIALE DE LA RÉVOLUTION TUNISIENNE
ANDRÉ VERDEIL
29 septembre 2011
Ce carnet s’en est fait plusieurs fois l’écho ces derniers mois (voir ces billets),
la dimension territoriale a constitué un point central de l’analyse de la révolution
tunisienne. A ce titre, elle a attiré les commentaires de plusieurs géographes. Le
dernier en date est celui de Abdelkrim Daoud dans Echogéo, paru ces jours-ci
(rubrique Sur le vif).
Il commence par un rappel de l’évolution des politiques d’aménagement du territoire
qui souligne le tournant libéral adopté depuis les années 1990. Ces politiques se
sont traduites par une métropolisation et une littoralisation marquées, et ont
pénalisé les régions de l’intérieur. L’auteur, géomorphologue, a consacré une bonne
partie de ses recherches à ces régions, soulignant notamment les conflits autour de
la répartition de l’eau. Dans les mois qui viennent de s’écouler, ces questions
deviennent des conflits ouverts, et l’on voit par exemple les habitants de la région
de Sidi Bouzid menacer de couper une conduite d’eau traversant leur territoire vers
la grande agglomération de Sfax si leurs besoins en eau ne sont pas satisfaits.
L’auteur en appelle à une politique d’aménagement du territoire refondée. Pour cela,
il invoque notamment une décentralisation offrant aux municipalités et aux régions
des outils et des moyens pour déterminer leurs propres politiques d’aménagement.
Pour lui, l’Etat devrait continuer d’apporter son soutien financier, sous la forme
d’une péréquation fiscale, et permettant précisément aux collectivités territoriales
refondées de devenir des acteurs. Les investissements privés devraient également
selon lui prendre leur part à ce rééquilibrage. Cet appel rejoint les positions
défendues par l’association des urbanistes tunisiens, dont je rendais compte en
avril dernier. On sait que c’est également l’objet d’un prochain colloque organisé
par l’ISTEUB.
LA CONTESTATION DE L’ETAT DANS LES PÉRIPHÉRIES TUNISIENNES
Cette vision conciliant autonomie locale et rééquilibrage est pourtant bien peu
“politique” et ne donne guère de place à la réalité des revendications des
populations locales. L’actualité des régions intérieures tunisiennes est
bouillonnante. Les institutions gouvernementales, notamment les gouvernorats et la
police, y ont été plusieurs fois prises pour cibles de mécontentement voire
d’émeutes ces derniers mois (ex. à Métlaoui). Les entreprises privées ont été
forcées d’intégrer, sous la contrainte d’un chantage souvent violent, des jeunes,
diplômés ou non, au chômage (voir par exemple quelques articles concernant British
Gas ici et là). Quant aux administrations et entreprises publiques, elles ont
également été priées d’élargir leurs effectifs dans des proportions très
importantes, notamment les régions périphériques (25000 emplois publics et 10000
recrutements dans les entreprises publics, voir cet article de la Presse de Tunisie).
Malgré ces mesures, le mécontentement reste vif. La politique suivie par le
gouvernement de transition, non élu et qui n’a pas clairement rompu avec les
anciennes élites, notamment administratives, est perçue comme contre-révolutionnaire
par certains. Je n’assure pas une veille systématique sur ces questions mais ici et
là, on perçoit ce malaise. Pour en avoir un témoignage direct, on peut par exemple
se référer deux billets récents sur la situation à Kasserine, une de ces villes de
l’intérieur (ici et là). La dimension “tribale” y est notamment mise en avant pour
souligner les faiblesses de la construction nationale tunisienne et le défaut
d’adhésion à l’Etat, voire la contestation ouverte de ce dernier. C’est là un point
que les géographes (notamment tunisiens) n’ont guère étudié dans leurs travaux.
UNE GÉOGRAPHIE ÉLECTORALE À SUIVRE
Il est difficile d’émettre un pronostic sur le résultat des élections constituantes
qui auront lieu le 23 octobre. Les préparatifs de la campagne, qui sera lancée le
1er octobre, vont bon train. A Tunis ou à Sfax, des banderoles signalant les
permanences des partis et des slogans partisans sont affichées aux murs et dans leur
diversité et leur désordre (tout relatif), elles offrent un réjouissant contrepoint
à ce qu’était la triste iconographie du culte de la personnalité à l’époque de Ben
Ali. Pour autant, l’effervescence politique qui prévaut dans le pays s’est traduit
par un émiettement considérable de l’offre politique. Plus de 100 partis ont été
déclarés.
L’aménagement du territoire tunisien : 50 ans de politiques à l’épreuve de la mondialisationNajem Dhaher
Juin 2010
Au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, toute l’attentionest accordée au développement économique et social et à la correction des grands déséquilibres régionaux hérités de la période coloniale. L’aménagement du territoire, thème mineur, amalgamé à la construction et à l’habitat, n’a émergé comme préoccupation majeure que lorsque le tourisme, retenu comme secteur de développement économique (1970), a engendré une démarche de planification spatiale. Depuis, l’Etat tunisien s’est donné plusieurs objectifs en matière d’aménagement du territoire, selon une démarche très centralisée. Le dispositif de planification spatiale qui a basculé d’une doctrine à l’autre, du socialisme à l’économie de marché, du collectivismeau néolibéralisme, a imprimé à l’espace, sous l’effet de différents facteurs historiques et socio-économiques, un développement inégal. Les mécanismes de la décentralisation et de la déconcentration n’ont pas modifié en profondeur les modalités d‘intervention de l‘Etat et n’ont pas contribué à maîtriser les inégalités. Lanouvelle donne de la mondialisation a marqué une évolution économique et sociale en Tunisie. Aujourd’hui, on assiste à un glissement de référentiel et de légitimité des dogmes de l’équilibre spatial et du développement régional recherchés après l’indépendance du pays, vers celui de la compétitivité des villes et des régions. On se retrouve en présence d’une recomposition du territoire obéissant à des logiques nouvelles,celles du libéralisme et de la mondialisation. Le contraste spatial entre le littoral oriental et le reste du territoire s’en trouve renforcé, sur fond d’une logique autoritaire de gestion du territoire.
After Tunisia became independent, there was a focus on the economic and social development, and the project to remove the effects of the regional imbalance inherited from the colonial period. Town and country planning, first seen as minor topics, were linked to the building industry and housing. It is only
when tourism became prominent in the 1970’s with its corollary,spatial planning, that town and country planning were given attention. Since then, the Tunisian state set several goals in the fields of town and country planning, according to a very centralized approach. Spatial planning was conditioned by different doctrines, ie, socialism (a market economy), colonialism, neoliberalism, and by various historic and socioeconomic factors. But as a result, the development was uneven. By reason of decentralized mechanisms and the devolution, the modalities of the state intervention did not change deeply and did not contribute to overcome the disparities.Globalization has brought about an economic and social evolution in Tunisia. Nowadays, we are witnessing the shift from the spatial balance and the regional development, which were inherent to the independence of the country, to the competitiveness of the cities and the regions. We are facing the reorganization of the country, with a new logics, that of liberalism and globalization. It is in a context of an authoritarian logic of management of the territory, that we putthe emphasis on the spatial contrast between the Eastern coast and the rest of the country.
Top of page
INDEX TERMS
Mots-clés :aménagement du territoire, compétitivité, décentralisation, disparités, gouvernance, mondialisation, privatisation, Tunisie
Keyword :competitiveness, decentralization, disparities, globalization, governance, privatization, town and country planning, Tunisia
Top of page
OUTLINE
Introduction
La construction nationale et l’aménagement du territoire
Difficultés de traitement des disparités spatiales (1956-1969)
Le tournant libéral et la transformation de l’organisation spatiale (1970-1986)
Difficultés de la décentralisation, fuite en avant néolibérale et désengagement de l’Etat (depuis 1990)
Les jeux d'acteurs et les grands chantiers actuels sur fond de mondialisation
Un système territorial en pleine mutation
Gouvernance territoriale et développement durable : limites et opportunités
Conclusion
Top of page
FULL TEXT
PDF Send by e-mail
Introduction
1 Dans une situation difficile aux plans politique, économiqueet social, le premier président du pa (...)
2 L’aide a contribué à renforcer les cadres politiques et les fondamentaux institutionnels du pays, (...)
1Depuis son indépendance en 1956, la Tunisie a connu de profondes transformations qui ont rendu indispensable la redéfinition de la politique d'aménagement du territoire. Cettedernière a suivi globalement les grandes étapes que le pays a connues. La planification économique a toujours devancé l’aménagement du territoire, ce dernier se manifestant progressivement dans les années 1960, sans être vraiment établisous forme d’un programme planifié. Durant les trente premièresannées de l’indépendance, l’aménagement du territoire s’est inscrit dans une approche sectorielle de l’action de l’Etat et d’une planification économique plutôt verticale. Les disparitésentre les régions héritées de la période coloniale se perpétuent voire s’amplifient. En effet, les espaces à l’écart des dynamiques métropolitaines connaissent un affaissement de leur tissu productif et dépendent de plus en plus des emplois publics. Il a fallu attendre 1985 pour voir la naissance du
premier schéma national d’aménagement du territoire, et des schémas régionaux. Le changement politique de 19871 a eu des répercussions sur les politiques nationales de développement. Ces dernières se traduisent, au début des années 1990, par une réflexion sur l’aménagement du territoire via des investissements économiques, l’équipement et la promotion administrative des villes moyennes. Les transformations politiques et institutionnelles liées à l'augmentation de l’aide internationale ont introduit des changements significatifs de l’architecture administrative2. Actuellement, le développement des villes tunisiennes, et particulièrement celui des plus dynamiques d’entre elles, est en train de se concevoir dans le cadre des enjeux nés de la globalisation. Les documents officiels (journal officiel de la république tunisienne, plan de développement économique et social) et les schémas d’aménagement actuels, notamment le nouveau schéma directeur d’aménagement du territoire, semblent opter pour des choix renforçant des tendances de développement sélectif et différencié. Cette orientation d’ouverture et d’insertion dans le « mondialibéralisme » a impliqué une politique de réforme et de restructuration dite de « mise à niveau intégrale ». D’ailleurs, le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH-SIDES-URBAPLAN, 1996) reconnaît que « les politiques et actionsurbaines doivent faire une large part à ce qui est reconnu comme étant les facteurs de compétitivité économique ».Comment alors les politiques territoriales et urbaines qui essayent d’instaurer une organisation spatiale et territoriale équilibrée et conforme aux enjeux du développement durable ont-elles été construites pour intégrer les contraintes de la mondialisation ?
2On analysera d’abord les grandes étapes de l’aménagement du territoire depuis l’indépendance, pour aborder ensuite les enjeux de gouvernance territoriale associée à la phase actuellede mondialisation.
La construction nationale et l’aménagement du territoire
DIFFICULTÉS DE TRAITEMENT DES DISPARITÉS SPATIALES (1956-1969)
3Après l’indépendance, les pouvoirs publics tunisiens se sont trouvés devant l’obligation de gérer le contraste entre les différentes régions. La construction nationale a fortement orienté les politiques d’aménagement spatial conduites par l’Etat. Lepremier document de planification économique et sociale, appelé Perspectives décennales de développement, a été élaboréen 1961. Ce document a souligné les fortes disparités régionales, tant au niveau de la répartition des activités que de la population. L’orientation politique qui vise principalement la « tunisification » de l'appareil de production durant cette période oscille entre les impératifs dela construction nationale, tant à l’échelle nationale qu’à celui de la métropole Tunis, et la nécessité de faire face aussi bien aux déséquilibres et aux dysfonctionnements territoriaux qu’à la course à l’urbanisation, qui obligent de plus en plus l’Etat à équiper et à aménager les villes.
3 Le pays était subdivisé en 70 caïdats, chaque caïdat correspond à un territoire tribal. Le Protect (...)
4Cet impératif a amené l’Etat à procéder à un découpage spatialqui réponde aux enjeux de la modernisation. Ainsi, un nouvel échelon territorial intermédiaire a été institué entre le gouvernorat et les petits secteurs appelés jusque là Imadas. Entre 1956 et 1959, le nombre de communes est passé de 75 à 112. Ce découpage administratif a permis, d’après une étude de Belhédi, de dépasser les cadres traditionnels des tribus3 et derenforcer la cohésion sociale (Belhédi, 1992). Cependant, la multiplication des collectivités locales et l’amélioration des services administratifs et d’équipement n’ont pas contribué à réduire sensiblement les disparités régionales. En effet, les péripéties qui ont accompagné ce premier découpage du territoire en disent long : certains dirigeants du pays ont tenu à faire de leurs villes des chefs-lieux de régions administratives (comme le premier président Bourguiba à Monastir). Ces logiques ont produit des découpages spatiaux inégalitaires, soulignés par l’importance relative d’un milieu rural défavorisé et peu peuplé.
5Avec 51% de la population totale du pays en 1956, la frange littorale consommait à cette époque 89% de la production de l’électricité. Elle concentrait la quasi-totalité de la production industrielle, 84% des lits d’hôpitaux, 84% des
médecins et 70% des élèves des écoles primaires selon le recensement général de la population et de l’habitat publié en 1966. Ces disparités caractérisaient déjà le paysage tunisien àla veille de l’indépendance. Les arrangements constitutifs du régime politique issu de l’indépendance, centralisé et imprégnésur le plan technique des logiques modernistes, commencent à semanifester. Les politiques de développement humain n’arrivent pas à réduire les écarts, à cause des dynamiques et des inerties régionales. Les variations dans la répartition spatiale de la population s'expliquent à la lumière d'un héritage territorial colonial : fonctionnement extraverti du système urbain, macrocéphalie de la capitale, prépondérance desvilles ports, sous-équipement de certaines zones demeurées en marge, etc. (Signoles, 1985).
6L’aménagement, jusque là rattaché à la planification économique, s’autonomise en 1961 avec la création d’un service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme au sein du secrétariat aux travaux publics et à l’habitat. Ce changement apermis une relative ouverture sur la Tunisie intérieure. L’effort entrepris dans la période dite d’« économie planifiée » (1962-1969) a permis d’élargir sensiblement l’espace industriel en implantant des usines dans les régions laissées jusqu’alors totalement à l’écart (Kasserine, Kef, Béja, El Ksour, ElHamma). Si les interventions en faveur d’une organisation spatiale des agents et des services ont permis à cette politique d’aménagement du territoire « par le haut » de répartir les emplois sur beaucoup de régions défavorisées, elles n’ont pas pu atteindre un certain équilibre spatial (Belhédi, 1990). En fait, au cours de cette période, la caractéristique principale résidait dans la consolidation de l’armature urbaine, presque exclusivement effectuée à l’initiative de l’Etat. Mais, compte tenu des héritages à assumer et de certains choix d’investissement, c’est davantage le tertiaire public que l’industrie qui a été le moteur de l’urbanisation et le moyen privilégié de réorganisation du système spatial. En 1969, un ministère de l’aménagement du territoire et du tourisme a été institué. L’association entre aménagement du territoire et tourisme traduit l’essor fulgurantde ce secteur et la nécessité d’un aménagement spatial sectoriel spécifique.
LE TOURNANT LIBÉRAL ET LA TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION SPATIALE (1970-1986)
4 Le collectivisme est une orientation socialisante adoptée dans les années 1960, avec une vision re (...)
5 Texte relatif à l’aménagement urbain (décret du 10/09/1943). 6 AFH (Agence Foncière de l’Habitat). ARRU (Agence de
Rénovation et de Réhabilitation Urbaine). AUGT (...) 7 Plusieurs documents juridiques, techniques et
institutionnels ont été mis en place durant la décen (...) 8 Dans les années 1980, devant les difficultés du contrôle des
frontières, on créa trois nouveaux go (...)
7Au début des années 1970, une stratégie d’industrialisation tirée par l’exportation remplace celle qui s’appuyait sur le marché intérieur. Ce changement du moteur principal de croissance a nécessité la mise en place du Code de l’investissement en 1969. La loi d’avril 1972 et celle d’août 1974 traduisent aussi l’option libérale et l’ouverture au capital privé sous forme d’investissement direct. Les migrations rurales des années 1970 expriment la libéralisation économique et le résultat d’une conjonction de facteurs : étatisation des domaines coloniaux, privatisation des terres, forte croissance démographique. Tout cela, dans un contexte de réformes agraires successives, après la brutale expérience collectiviste4des coopératives agricoles, qui a précipité cetteouverture économique.L’essor de l’industrie, le développement du tourisme, le mouvement spontané d’urbanisation consécutif à l’occupation irrégulière des terres publiques et privées, ont créé l’essentiel des villes (Chabbi, 1998). Cette situation a rendu nécessaire l’élaboration d’un cadre de référence, traduisant l’intérêt des pouvoirs publics pour l’aménagement duterritoire. Dans cette optique, la direction de l’aménagement du territoire lança en 1975 une étude sur la décentralisation industrielle. En 1979, une commission ad hoc a été chargée de réfléchir aux problèmes de l’aménagement. Pourtant, c’est un texte de 19435qui a servi de base à l’aménagement de l’espace urbain jusqu’à la fin des années 1970. D’ailleurs, le Code de l’urbanisme de 1979 n’en serait en réalité qu’une simple révision (Belhédi, 1990). Il est vrai que ce code est resté muet quant à l’articulation entre urbanisme, aménagement du territoire et planification socio-économique. La multiplicationdes structures (AFH, ARRU, AUGT, APAL, PDR, etc.)6sans coordination a conduit à des politiques incohérentes. Le mimétisme par rapport à la période coloniale se retrouve aussi dans les textes réglementaires et dans les institutions
concernées par l’aménagement du territoire7. Bugnicourt (1978) évoque à ce sujet l’« idéologie mimétique » à propos de l’invocation des métropoles d’équilibre et de la régionalisation. Certes, l'affinage du découpage administratif depuis 1974 a permis à de nombreux centres de bénéficier de services régionaux ou locaux8. Cependant, malgré l’effort entrepris entre 1970 et 1980 par le desserrement de l’encadrement administratif et par l’organisation des services sanitaires, les disparités régionales persistent (Miossec ; Signoles, 1984). Depuis, on assiste à un passage progressif d'une littoralisation plutôt passive à une littoralisation active (Béthemont, 2001).
Illustration 1 – Evolution de l'urbanisation en Tunisie
Zoom Original (jpeg, 60k)
Source : INS, 2005.
8Cette logique d’organisation de l’espace a créé de nouveaux rapports entre l’armature urbaine et le monde rural et relativisé la place de l’agriculture dans le développement des espaces ruraux. La Tunisie intérieure est demeurée à l’écart
des investissements privés tout en bénéficiant d’un mince effort de l’Etat. Au milieu des années 1980, la crise économique et politique (crise de la dette, suppression des subventions aux produits de première nécessité qui provoquent « la révolte du pain » en janvier 1984) amène l’Etat à opter pour une plus grande ouverture. Cette réalité pousse les pouvoirs publics à établir en 1985 le premier schéma national d’aménagement du territoire. Les préoccupations d’ordre politique stimulent la volonté de promouvoir un développement régional, à travers les sociétés régionales d’investissements et la planification en milieu rural. Cette confirmation de l’aménagement a cheminé lentement dans les interstices de la planification économique.
DIFFICULTÉS DE LA DÉCENTRALISATION, FUITE EN AVANT NÉOLIBÉRALE ET DÉSENGAGEMENTDE L’ETAT (DEPUIS 1990)
9A partir de 1987, de grands changements ont touché le pouvoir.Le nouveau gouvernement a opté pour une politique franche d’ouverture économique et d’intégration mondiale. Les objectifsmajeurs de la décentralisation, devenue un discours dominant, portent sur un développement régional équilibré et sur une miseen valeur des régions peu peuplées de l’intérieur. Cependant, la décentralisation demeure un processus très encadré. La dépendance des collectivités locales vis-à-vis de l’administration centrale n’est pas seulement juridique, elle est aussi financière. La tutelle est d’autant plus lourde que les programmes de développement local doivent être conformes avec le plan national. Au Maroc, autre pays du Maghreb, le processus de décentralisation a pris, à partir de 2002, une nouvelle dimension avec la révision complète du régime juridique des collectivités locales pour réduire la tutelle de l’Etat. Le caractère du système politique tunisien privilégie en revanche une déconcentration très partielle plutôt qu’une véritable décentralisation. Selon Skander Ben Mami (2008), « cette déconcentration a apporté seulement des aménagements cosmétiques à la centralisation ». D’ailleurs, la médiocrité des résultats obtenus a amené les responsables à une réflexion sur l’aménagement du territoire basée sur des investissements économiques via l’équipement et la promotion administrative des villes moyennes. L'objectif était de remédier à la faiblesse deces villes, tout d’abord directement, à travers le maillage et l'encadrement administratif et indirectement, à travers
l'appareil productif touristique et industriel, ainsi qu’avec la décentralisation universitaire. La centralisation persistante du tertiaire de commandement à Tunis n’a pas favorisé le développement industriel régional.
9 Le secteur informel est toléré, il recouvre surtout l’installation des marchands « informels » dan (...)
10 FOPRODI (Fonds de la Promotion de la Décentralisation Industrielle). FONAPRA (Fonds National pour (...)
10Cependant, ces processus de déconcentration et de décentralisation ont posé le problème des échelons de la gouvernance, à plusieurs niveaux (communes, lieux informels9, intercommunalités). La croissance des flux des ruraux a alimenté la prolifération de l’habitat spontané autour des grandes villes et les structures de production déjà faibles desvilles intérieures se sont détériorées (Chabbi, 1998). Cette situation a poussé l’Etat à abandonner progressivement son rôlede créateur d’emplois pour entamer d’autres actions dans des secteurs stratégiques (formations universitaires, nouvelles technologies d’information, etc.). Ces changements se sont répercutés sur la politique d’aménagement du territoire. L’espace se trouve toujours inégalement métropolisé par les services publics de niveau régional et les disparitéspersistent entre milieux urbain et rural. Le fait que certains programmes sociaux comme le FOPRODI, le FONAPRA, le SIVP ou le FIAP10 se soient à leur tour très concentrés sur le littoral explique aussi l'échec relatif des efforts réalisés.
11L'adoption du Plan d'ajustement structurel en 1986, l’adhésion au GATT en 1990, les accords avec l’OMC en 1994 et la création d’une Zone de Libre-échange avec l’Union Européenneen 1996 ont entériné l’entrée de la Tunisie dans un processus d’ouverture aux marchés mondiaux impliquant un démantèlement dudispositif de production étatique, une stimulation de la compétitivité des entreprises tunisiennes et une privatisation des entreprises publiques. Cette nouvelle réalité a rendu nécessaire l’amélioration de la compétitivité des territoires, d’où la refonte en 1994 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et l’élaboration de schémas directeurs d’aménagement dans les grandes agglomérations urbaines et les zones sensibles. Ces transformations politiques et institutionnelles liées au développement de l’aide
internationale ont introduit également des changements significatifs de l’architecture administrative (Miossec, 2002).Le décret du 24 mars 1989 a établi une longue liste des compétences déléguées au gouverneur. Les communes doivent attendre la loi organique du 24 juillet 1995 pour connaître uneévolution timide de leurs fonctions : l’urbanisme réglementaireest « communalisé » ; le débat sur l’intercommunalité est lancé ; le fonctionnement des conseils municipaux est relativement amélioré. En effet, durant cette période, les communes ont été chargées de l'élaboration des plans d'aménagement urbains. Mais du fait de nombreuses distorsions, l'Etat fut contraint de mettre un terme en 2005 à cette expérience.
11 Le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, s’occupait de la planification (...)
12 Comme par exemple lors de l’aménagement de la sebkha de l’Ariana au nord de Tunis (Barthel, 2003). (...)
12En outre, plusieurs agences spécialisées (AUGT, APAL) ou directions ministérielles sectorielles (patrimoine), ont vocation à établir des plans d’aménagement. Le District de Tunis, créé en 1975 pour réaliser les études et assurer la planification et la gestion du développement urbain du Grand Tunis, a été remplacé en 1994 après quelques tâtonnements par une agence urbaine chargée d'assister du point de vue techniqueles communes du Grand Tunis. La politique d’aménagement du territoire continu de connaître des balbutiements. La séparation entre deux ministères de l’aménagement du territoireet de l’urbanisme, de 1994 jusqu’à 2003, en dit long à ce sujet11. Ces chevauchements de compétences entre administrations ont favorisé des conflits12.
13En adoptant une logique fondée sur les idées d’efficacité et de compétitivité des villes, la stratégie tunisienne des années1990 préconise une logique de métropolisation favorisant encoreune fois les grandes villes côtières. Le deuxième schéma directeur d’aménagement du territoire national, réalisé en 1997, qui a été conçu en estimant que « la question est de refondre entièrement la conception de l’espace et par voie de conséquence de son aménagement », annonce la fin de la période où la pensée territoriale était construite autour du concept d’équilibre régional (Ben Letaief, 2008). SDATN tend ainsi à
renforcer la structure spatiale de la Tunisie autour du pivot tunisois et de l’axe littoral oriental. Ce qui laisse penser que la recomposition de l’espace tunisien est envisagée en réponse à l’ouverture mondiale (Miossec, 2002).
13 Le réseau routier a connu une évolution notable durant les vingt dernières années : la longueur to (...)
14Face aux risques associés au creusement des déséquilibres territoriaux, les pouvoirs publics tentent de rapprocher davantage l’administration du citoyen et de stimuler l’effort de développement des régions13. L’affinage progressif du maillage territorial a connu une nouvelle vague de promotion administrative des agglomérations. Le nombre de communes est passé de 212 en 1988 à 264 en 2008 et celui des secteurs (imadas) de 1749 à 2074. En conséquence, le nombre d’habitants des périmètres communaux a bondi de 4.477.000 en 1988 à 6.746.000 en 2008, soit deux tiers de la population du pays. Depuis, le moteur de la croissance urbaine est devenu de plus en plus endogène, alimenté par des redistributions internes et des migrations interurbaines, alors que l’exode rural se tarit.
Les jeux d'acteurs et les grands chantiers actuels surfond de mondialisation
UN SYSTÈME TERRITORIAL EN PLEINE MUTATION
15L’intégration croissante de l’économie tunisienne aux échanges internationaux depuis les années 1990 a engendré de nouveaux défis : recomposition spatiale et sectorielle de l’activité économique, cohérence des politiques, protection del’environnement, etc.La mondialisation actuelle se traduit par l’émergence de nouvelles commandes, de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques d’aménagement et d’urbanisme. Le désengagement de l'Etat, à travers la liquidation du secteur public de production des biens et des services, est l'arrière-plan de ce nouveau contexte.
14 Le gouvernement tunisien a cédé 217 entreprises publiques ou semi-publiques depuis le lancement du (...)
16Les institutions internationales s’imposent de plus en plus comme des acteurs de la commande spatiale et contribuent à une redéfinition des normes et des outils de l’aménagement à travers des directives (questions environnementales, développement durable, bonne gouvernance) (PNUD, 1999). La nouvelle politique d’aménagement du territoire semble entérinercette situation. Les documents officiels et les schémas d’aménagement actuels, notamment les nouveaux schémas directeurs d’aménagement du territoire et l’étude relative à lapolitique de la ville établie par le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat ainsi que le XIe plan de développement économique et social (2007-2011), semblent opter pour des choixrenforçant les tendances de développement sélectif à travers une métropolisation de plus en plus forte. Ceci a aggravé la ségrégation territoriale. En effet, la démarche de privatisation de la gestion des biens publics a connu, ces dernières années, une forte expansion14 via la concession d’un réseau GSM à un groupe égyptien en 2004, l’aménagement du Lac Sud de Tunis en 2007 (pour plus de 25 milliards de dollars) parle groupe émirati Sama Dubaï, l’aménagement du Lac de l’Arianaau Nord de Tunis par le groupe EL Maabar, ou encore en 2008, unprojet de ville sportive et résidentielle baptisée Tunis sport city attribué au groupe Abu Khater. On peut ajouter à cette liste la construction d’un pôle financier confiée à un autre groupe émirati, ainsi qu’une raffinerie de pétrole à la Skhira,au sud de Sfax.Dans ce contexte, l’impératif d’efficacité « tend à supplanter le dogme du développement équilibré du territoire » (BenLetaief, 2008).
17En réalité, face à une situation budgétaire difficile et sousprétexte que certaines fractions du territoire peuvent offrir une attractivité satisfaisante, les projets d’aménagement touchent inégalement les agglomérations. Dans ces conditions, un rééquilibrage est impossible. La tendance à la concentrationdes pouvoirs économiques, politico-administratifs et culturels dans les grandes villes du littoral se confirme.
Illustration 2 – Cinquante ans d'aménagement du territoire entre réduction des déséquilibres et littoralisation
Zoom Original (jpeg, 84k)
Source : annuaire économique, DGAT, INS.
18Ainsi organisé, l’espace géographique de la Tunisie sert-il aujourd’hui à améliorer le bien-être du citoyen tunisien, ou bien est-il simplement voué à satisfaire les demandes des investisseurs privés, nationaux ou extérieurs ? L’orientation du dernier schéma national d’aménagement illustre le difficile compromis entre ces deux logiques (MEAT, 2002). Le document souligne d’une part que « l’intérêt national exigera que l’on mette l’accent sur les lieux les mieux situés pour faire face àla concurrence internationale ». Il ajoute dans le même temps « qu’il faudra veiller à ce que les différenciations économiques ne se transforment pas en distorsions sociales qui deviendraient insupportables ». Le schéma fixe désormais parmi les choix dont la mise en œuvre est prioritaire « la maîtrise de la fixité des habitants des régions de l’Ouest et des régions frontalières ». D’autre part, « il ne faudra pas seulement répartir, mais aussi hiérarchiser et faire des choix », écrivent les auteurs du SNAT.
GOUVERNANCE TERRITORIALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : LIMITES ET OPPORTUNITÉS
19La recomposition de l’espace urbain et la déstructuration d’une grande partie de l’espace rural sont plusque jamais un fait marquant. Les paysages urbains et ruraux affichent des contrastes et des paradoxes de plus en plus prononcés au niveau des infrastructures, des moyens de
communication, de l’accès aux services de l’Etat et au niveau du rapport à la modernité. Certaines villes ont des conditions de vie proches du milieu rural et cumulent de nombreuses insuffisances (pollution atmosphérique ou visuelle, délabrementdes voies de circulation et des trottoirs, état du bâti, etc.).Les grandes villes offrent une mosaïque de morceaux urbains hétéroclites produits selon des logiques conjoncturelles souvent contradictoires (médinas, cités de recasement, quartiers coloniaux, modernes, zones d’habitat non réglementaire, etc.). Les grandes agglomérations, notamment Tunis, Sfax et Sousse, souffrent de l'importance de l'habitat illégal, qui atteint 50% du bâti à Tunis, et de l'asphyxie due à un urbanisme souvent peu conforme aux exigences de la circulation (transport collectif, motorisation).
20Actuellement, la population urbaine représente près des deux tiers de la population totale, contre près d’un tiers en 1956, avec trois types de régions : une région presque entièrement urbanisée, le District de Tunis, des régions moyennement urbanisées, avec des taux proches de la moyenne nationale (le littoral), et des régions plutôt rurales avec des taux inférieurs à 45% (la Tunisie intérieure). Dans la région qui s’étend de Sousse jusqu’à Chatt Mariem et bientôt à Hergla, ainsi que dans la région de Nabeul, sur une bande allant de Korba à Hammamet Sud, le développement de l’urbanisme balnéaire, tel qu’il est pratiqué actuellement sous forme de zoning, fait « table rase » des paysages ruraux. Les politiquesenvironnementales restent encore, dans leur grande majorité, sectorielles et indépendantes les unes des autres. D’après un responsable de l’APAL, « la surexploitation foncière des côtes dans l’urbanisation et à travers l’activité touristique a un impact très lourd sur l’écosystème maritime ». L’analyse de la performance environnementale de la Tunisie, qui a été conduite par la Banque Mondiale en 2003, a souligné notamment que les zones touristiques ne font pas l’objet de réglementation visantla protection du milieu. Certains acteurs nationaux profitent de cette situation. L'étalement spatial cause une pression grandissante sur les zones sensibles telles que les terres agricoles fertiles et les paysages littoraux. Les zones sahariennes avec un fragile équilibre économique et social, ne sont plus épargnées. L’installation touristique dans des villessahariennes comme Tozeur, Douz ou Nefta y a entraîné des
changements perceptibles dans les modes d’utilisation et d’appropriation de l’espace.
Illustration 3 - Découpage foncier en zone touristique dans la ville saharienne de Douz
Zoom Original (jpeg, 88k)
Source : archi-mag 2009.
21La concentration soudaine d’équipements touristiques sur des espaces oasiens restreints a eu des conséquences multiformes (Picouet, 2002), notamment sur le plan environnemental. D’autrepart, l’absence d’un marché foncier transparent favorise un étalement urbain informel et illégal dans et autour des grandesvilles. Selon une étude d’URBACONSULT (2006), « ni les communes, ni les regroupements de communes, ni les agences foncières, ni les départements ministériels ne sont en mesure de constituer des réserves foncières pour satisfaire les besoins présents et les besoins futurs en logements, en équipements, en infrastructures et en zones d’activités ».
22Ainsi, comme l’a déjà noté Ben Letaief (2008), « la démarche des pouvoirs publics reste hésitante et contradictoire, marquéepar la persistance d’une logique centralisatrice et autoritaired’une part, et la recherche forcée compte tenu de besoins de financement, de partenariat notamment avec le secteur privé ».
Ce partenariat obéit souvent « à une logique de simple soulagement de l’Etat et de ses finances sans s’inscrire dans une réelle démarche démocratique de gestion participative ».
23Toutefois, l’approche inédite lancée récemment dans une démarche volontariste d’élaboration de la stratégie de développement du Grand Sfax (projet Taparura de dépollution et d'aménagement du littoral nord de la ville de Sfax) s’est distinguée par l’enclenchement d’un processus participatif, mettant à contribution acteurs publics locaux, élus, professionnels, universitaires, ONG et citoyens.
Illustration 4 - Le projet Taparura à Sfax
Zoom Original (jpeg, 74k)
Source : DGAT 2010
24A travers cette expérience, ne paraît-il pas nécessaire de permettre aux différents acteurs locaux de définir les méthodesde gouvernance qu'ils estiment les plus appropriées dans une démarche bottom-up privilégiée pour l’émergence des projets ? AuMaroc, où le concept de développement auto-centré semble dépassé, la récente réforme du paysage législatif a abouti à l’élaboration d’un schéma national d’aménagement du territoire (2005) basé sur la concertation, avec pour ambition de valoriser les spécificités territoriales, suivant la formule : « à chaque territoire selon ses potentialités économiques, à chaque territoire selon ses besoins sociaux ». En France, depuis les lois de décentralisation de 1982- 3, les décisions sur l’aménagement du territoire sont le résultat d’accords entre les collectivités territoriales, les régions et l’Etat,
où les acteurs locaux ont une influence de premier plan. Reste à savoir comment de tels principes pourraient être promus dans un contexte comme celui de la Tunisie.
Conclusion
25Les politiques de développement et d’aménagement menées depuis l'Indépendance, souvent sans élaboration d’une doctrine d'ensemble, n’ont pas pu atténuer les disparités spatiales héritées de la colonisation et accentuées par l’ouverture à la mondialisation. Le nouvel ordre spatial, qui privilégie les lieux les mieux situés, les activités et les secteurs les plus portés vers l'extérieur, est en train d’accentuer les déséquilibres régionaux, tout en créant denouveaux problèmes environnementaux et territoriaux. La politique de métropolisation est devenue source d’iniquité et d’inefficacité(Davezies et Estèbe, 2007). Par ailleurs, le modèle centralisateur, bureaucratique et autoritaire en matière de gestion du territoire entretient la marginalité du local malgréles transformations des contextes internes et internationaux, qui tendent à délégitimer ces modes de gouvernement.
26Enfin, l'option libérale, dans laquelle s'est engagé le régime tunisien à partir de 1986, ne semble pas être en mesure de sortir la Tunisie de l'impasse du sous-développement, du fait notamment du déficit de gouvernance, qui affaiblit la fourniture de biens publics. Au contraire, le néo-libéralisme, qui ne signifie « en rien [le] retrait de l’Etat et [la] fin de l'interventionnisme, mais [un] redéploiement des modalités d'exercice du pouvoir » (Hibou, 2006), éprouve le territoire tunisien sans en favoriser le développement.
27A l'inverse, une politique de développement basée sur des projets locaux de coopération décentralisée et des stratégies àpetite échelle, inspirée de nouveaux paradigmes comme ceux du développement durable ou de la gouvernance territoriale, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives de développement aux territoires en Tunisie. Des processus de gouvernance territoriale – c'est-à-dire de concertation entre tous les acteurs du territoire - méritent de prendre le dessus sur les diktats des aménagistes ou des seules forces du marché.
Top of page
BIBLIOGRAPHY
Barthel P-A.,2003. Les lacs de Tunis en projets, reflets d'un nouveau gouvernement urbain. Annales de Géographie, volume 112, n° 633 , p. 518-536.
Belhédi A., 1992. Société, espace et développement en Tunisie. Tunis, PUT, FSHS, 262 p.
Belhadj A., 1990. Espace et société en Tunisie. Développement, organisation et aménagement de l'espace en Tunisie depuis l'indépendance. Revue tunisienne de géographie, n° 18, p. 9-54.
Ben Letaief M., 2008. Les politiques urbaines en Tunisie : quelques réflexions sur les mutations d’une action publique postkeynésienne. Métropoles, n°4.
Ben Letaief M., 1999. Le secteur public et la performance. Revue tunisienne de droit, numéro annuel, p. 133-177.
Ben Mami S., 2008. La décentralisation et la déconcentration enTunisie et au Maroc, l’évolution du rôle des collectivités locales, des textes aux pratiques. IRG.
Ben Mami S., Drossler L., Elie M., Gaouane Z., Gavrilov E., Meyer C., Widmeret S., 2007. Regards croisés sur la démocratisation et la gouvernance au Maghreb. Dossier, IRG.
Bethemont J., 2001. Géographie de la Méditerranée. A. Colin.
Bugnicourt J., 1971. Disparités régionales et aménagement du territoire en Afrique. A. Colin, 352 p.
Chabbi M., 1998. L’accès des pauvres au sol urbain en Tunisie – Tunis. Programme de gestion urbaine Tunisie.
Davezies L, Estèbe P., 2007. Mythes et légendes du développement territorial. L’autonomie politique dans l’interdépendance économique ? Pouvoirs Locaux, n° 72.
Hibou B., 2006. Le libéralisme réformiste, ou comment perpétuerl'étatisme tunisien. L’économie politique, n°32, 112 p.
INS, Institut National de la Statistique, Recensements de la population et de l’habitat : 1966, 1984, 1994, 2004, Tunis.
Miossec J-M., 2002. Tunisie, métropolisation, mondialisation : efficience renforcée de l’axe oriental. Cahiers de la Méditerranée, volume 64, p.143-191.
Miossec J-M., Signoles P., 1984. Les Politiques urbaines en Tunisie, in Politiques urbaines dans le Monde Arabe, Métral et Mutin (dir), p. 183-202.
MEAT., Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, 2002. Schéma directeur d’aménagement du territoire national, synthèse, Tunis.
PNUD., 1999. Rapport national sur le développement humain, République Tunisienne.
Picouet M., 2002. Formes de mobilité et dynamique de l’environnement en Tunisie. Revue Européenne des Migrations Internationales, volume 18, n° 2, p. 51-65.
Signoles P., 1985. L'espace tunisien: capitale et Etat-Région. Tours, Urbama, 2 vol., 1041 p.
Urbaconsult., 2006. Evaluation et développement des instruments de l’aménagement du territoire en Tunisie. Rapport d’étude, DGAT, 114 p.
Top of page
NOTES
1 Dans une situation difficile aux plans politique, économiqueet social, le premier président du pays, H. Bourguiba, a été évincé du pouvoir et remplacé par le président actuel Ben Ali.
2 L’aide a contribué à renforcer les cadres politiques et les fondamentaux institutionnels du pays, comme l’ont montré les réformes entreprises dans les années 1990.
3 Le pays était subdivisé en 70 caïdats, chaque caïdat correspond à un territoire tribal. Le Protectorat français a gardé cette structure tout en réduisant le nombre de caïdats à
36 après un processus de sédentarisation, parfois forcée, au sol, (Belhédi, 1990).
4 Le collectivisme est une orientation socialisante adoptée dans les années 1960, avec une vision relative à l’aménagement qui était réduite aux considérations économiques. Elle s’est soldée par un échec, d’où l’engagement vers le libéralisme économique.
5 Texte relatif à l’aménagement urbain (décret du 10/09/1943).
6 AFH (Agence Foncière de l’Habitat). ARRU (Agence de Rénovation et de Réhabilitation Urbaine). AUGT (Agence Urbaine du Grand Tunis). APAL (Agence de Protection et d’Aménagement duLittoral). PDR (Programme de Développement Rural).
7 Plusieurs documents juridiques, techniques et institutionnels ont été mis en place durant la décennie 1970-1980 : Plan national d'aménagement du territoire (1970), Agences foncières (1973), Code de l'urbanisme (1979).
8 Dans les années 1980, devant les difficultés du contrôle desfrontières, on créa trois nouveaux gouvernorats dans le Sud : Kébili, Tozeur et Tataouine qui sont, en fait, des zones frontalières détachées de leurs anciens gouvernorats (Gabès, Gafsa et Médenine).
9 Le secteur informel est toléré, il recouvre surtout l’installation des marchands « informels » dans toutes les villes, l’institutionnalisation des « souks libyens », etc.
10 FOPRODI (Fonds de la Promotion de la Décentralisation Industrielle). FONAPRA (Fonds National pour la Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers). SIVP (Stage d'Initiation à la Vie Professionnelle). FIAP (Fonds d'Insertion et d'Adaptation Professionnelle).
11 Le ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, s’occupait de la planification régionale et territoriale alors que la planification intra-urbaine revenait au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.
12 Comme par exemple lors de l’aménagement de la sebkha de l’Ariana au nord de Tunis (Barthel, 2003).
13 Le réseau routier a connu une évolution notable durant les vingt dernières années : la longueur totale des autoroutes est passée de 51 km en 1987 à 359,3 km en 2009. Les routes ayant une largeur égale ou supérieure à 7 km sont passées de 2 082 kmà 8 662 km.
14 Le gouvernement tunisien a cédé 217 entreprises publiques ou semi-publiques depuis le lancement du programme de privatisation en 1990.
Top of page
LIST OF ILLUSTRATIONS
TitleIllustration 1 – Evolution de l'urbanisation en Tunisie
Credits Source : INS, 2005.
URL http://echogeo.revues.org/docannexe/image/12055/img-1.jpg
File image/jpeg, 60k
TitleIllustration 2 – Cinquante ans d'aménagement du territoire entre réduction des déséquilibres et littoralisation
Credits Source : annuaire économique, DGAT, INS.
URL http://echogeo.revues.org/docannexe/image/12055/img-2.jpg
File image/jpeg, 84k
TitleIllustration 3 - Découpage foncier en zone touristique dans la ville saharienne de Douz
CrediSource : archi-mag 2009.
ts
URL http://echogeo.revues.org/docannexe/image/12055/img-3.jpg
File image/jpeg, 88k
TitleIllustration 4 - Le projet Taparura à Sfax
Credits Source : DGAT 2010
URL http://echogeo.revues.org/docannexe/image/12055/img-4.jpg
File image/jpeg, 74k
Top of page
REFERENCES
Electronic reference
Najem Dhaher, « L’aménagement du territoire tunisien : 50 ans de politiques à l’épreuve de la mondialisation », EchoGéo [Online], 13 | 2010, Online since 20 September 2010, connectionon 31 December 2013. URL : http://echogeo.revues.org/12055 ; DOI : 10.4000/echogeo.12055
Top of page
ABOUT THE AUTHOR
Najem Dhaher
Najem Dhaher est docteur en urbanisme et aménagement et Maître-assistant à l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Tunis. [email protected]
Colloque: Construire l'équité territoriale de la Tunisie A la une
COLLOQUE
Construire
l'équitéterritoriale
de laTunisie
paysage etaménagement
du territoire, lesdimensions
cachées de laRévolution
Cité des Sciences àTunis
17-19 novembre 2011
Jeudi 17 novembre 2011
8 h 00 – 8 h 30 : accueil et inscription
8 h 30 – 9 h 00 : Ouverture du colloque par M. Fathi ENNAÏFER, expert en planification et gestion territoriales, et Valery FRELAND, Directeur de l'Institut Français de Tunisie
Session 1 : Replacer l'arrière-pays dans unprojet de territoire national Président de séance : Pierre SIGNOLES Rapporteur : Imène ZHIOUA
9 h 00 : Conférence de Jean-Marie MIOSSEC : « Tunisie : l'enjeu territorial entre fracture régionale et équité géosociétale ». I. Les trois temps de l’aménagement du territoire et l’évolution des contextes.- Aménager, ménager, manager.- De l’aménagement national du territoire à la gestion internationale des territoires.- En Tunisie : trois schémas (Villes et développement, SNAT, SDATN), peu de ménagement, un déficit de gouvernance
Actualités Un atelier
d’architecture de terre se concrétise en banlieue de Tunis
partagée.- La société dans l’évolution des contextes, précolonial, colonial, national centralisé, national mondialiste.II. Fractures et mutations.- Des disparités territoriales creusées.- Des comportements territoriaux différenciés.- L’absence de régionalisation.- Les doubles découplages géosociétaux et économiques intérieur/littoral et politico-financiers littoral/pouvoir central mondialisé et concessionnaire.III. Les voies difficiles du développement territorial : cautérisation et promotion, cohérence et ouverture.- Centralisation, déconcentration, décentralisation, régionalisation- Les facteurs d’une dynamique économique : l’eau, les infrastructures, la formation de la main d’œuvre- Rejet du zonage, promotion du projet ?- L’importance de l’ingénierie de montage de projets et d’aide à la décision.- Les éléments d’une dynamique géosociétale : vers une dynamique locale-régionale ?- Transferts de compétences, transferts de moyens, esprit d’entreprise et modalité des solidarités.- Les voies difficiles de l’attractivité des régions intérieures et du renforcement de la dynamique des régions littorales.- Intérieur/Littoral/Extérieur.Conclusion
9 h 30 : Mounir AYOUB : « Du discours politique à l'aménagement du territoire, étude du cas de la reconstruction d’après-guerre en Tunisie ». Au lendemain de la révolution, la Tunisie s’est dotée d’un gouvernement de transition comprenant un ministère inédit : Le Ministère du Développement Régional et Local. Dans le contexte révolutionnaire, le symbole est fort : le développement régional est désormais l’objet d’un ministère àpart entière et n'est plus associé au Ministère de l'intérieur, honni. Des annonces d'aides d'urgence pour le développement des régions de "l'arrière-pays" se succèdent. Construire l'équité territoriale devient un axe capital dans le discours politique de la Tunisie révolutionnaire, et rien ne paraît plus légitime pour les décideurs politiques puisquec’est précisément cet "arrière-pays" qui fut le détonateur etle foyer le plus dramatique de la révolution.Les déséquilibres économiques et infrastructurels qui n’ont cessé de se creuser entre la bande côtière et "l'arrière-pays" ont généré des déséquilibres socio-spatiaux de plus en plus aigus. La question de l'aménagement du territoire s’impose désormais avec acuité : Comment penser un aménagement du territoire équilibré, équitable et responsable? Quel modèle de développement ? Autant de questions auxquelles pouvoirs publics, chercheurs et professionnels de l'aménagement du territoire devront trouver des réponses qui tiennent compte des réalités sociales, culturelles et économiques.Bien qu’intrinsèquement impatientes, les ambitions postrévolutionnaires pourraient se nourrir d’un retour sur
des expériences passées. C’est dans cette perspective que s’inscrit notre contribution :S'éloigner, regarder un épisode de l'histoire de notre pays où, comme aujourd'hui, l'actualité et le discours politique se conjuguent pour se poser la question de l'équité territoriale comme préalable à la justice sociale.En 1942 la Tunisie est le théâtre d’affrontements majeurs entre les forces alliées et les forces de l’Axe qui ont laissé le pays exsangue. Les mouvements nationalistes pour lalibération entrent dans leur phase la plus active jusqu’à l'indépendance. Face à la révolte populaire contre les inégalités entre les Européens des villes côtières et les "autochtones" de "l'arrière-pays", le mot d'ordre était "la reconstruction". De nouvelles équipes gouvernementales se mettent en place et des plans de développement sont décidés sur tout le territoire : résonances saisissantes !Nous y étions déjà, il y a 70 ans. La réponse était alors la création du service d'architecture et d'urbanisme de Tunisie.Il aura la mission de dessiner et de diriger les travaux de plusieurs projets de logements, équipements publics et même des villes nouvelles. Ces projets n'auront jamais permis une quelconque équité territoriale. Au bout de 3 ans, la grogne des habitants atteint son comble et le service est dissout.Loin de nous de vouloir faire un parallèle direct entre cet exemple historique et l’actualité. Si nous proposons de le regarder de plus près, c’est que les dynamiques qui sous-tendent la naissance des mouvements sociaux et politiques majeurs d’alors et d’aujourd’hui présentent des résonances qu’on ne peut nier. Et il y a des symboles qui ne peuvent quenous interpeller : les deux lieux majeurs de la révolution d'aujourd'hui : le centre ville de Sidi Bouzid et le siège duMinistère de l'intérieur à Tunis, remontent à cette période. L'histoire, ce bien que nous partageons tous, pourra peut-être nous aider, nous : observateurs, concepteurs, décideurs,tous tunisiens révolutionnaires, à construire notre dignité territoriale.
9 h 50 : Belghith DEROUICHE : « Le territoire tunisien, un territoire à deux vitesses ». Même s’il a fallu manifester au cœur de Tunis, devant le Ministère de l’intérieur, pour que le régime de Ben Ali « dégage », il ne faut pas oublier que c’est à Sidi Bou Zid queMohamed Bouazizi à lancé l’étincelle de la révolution en s’immolant par le feu. La révolution tunisienne s’est faite certes contre la dictature mais sur fond d’injustice sociale et de déséquilibre territorial. Quelles sont les conditions dans lesquels s’est accentuée cette inégalité socio-spatiale ? En quoi se manifeste-t-elle ? Et quelles sont ses conséquences ?Ce texte est destiné à apporter une modeste contribution qui ne vise pas à apporter des réponses mais plutôt à poser quelques questions qui nous semblent utiles pour enrichir le débat sur l’aménagement du territoire en Tunisie.En Tunisie, à partir des années 1950, l’Etat qui vient d’accéder à l’indépendance est l’unique acteur chargé de l’urbanisme. En effet, d’abord la SNIT était l’acteur
principal de la production de la ville. Ensuite, des agences publiques sont venues renforcer le paysage institutionnel de la production urbaine tels que l’AFH, la SPROLS ou encore l’ARRU. Pour le Grand Tunis, le District de Tunis assumait laplanification urbaine de la capitale du pays. M. Chabbi (1997) souligne le rôle important de ces opérateurs publics dans la physionomie de la ville de Tunis.Au milieu des années 1980, les accords signés entre la Tunisie et les intuitions financières mondiales entraînent laréforme du système économique. Il s’agit de passer d’une économie fortement étatique et contrôlée vers une économie complètement libérale et ouverte à l’investissement étranger.C’est dans ce contexte que parallèlement à une production urbaine publique, Tunis connaît depuis une vingtaine d’annéesun nouvel urbanisme qui crée une rupture à tous les niveaux. Plusieurs projets urbains se décident, s’étudient ou se réalisent tels que Bled El Ward, la Porte de la Méditerranée ou encore Tunis Sports City. Ce sont des mégaprojets qui contrastent avec les modestes opérations réalisées au coup par coup par les agences publiques. Il s’agit de projet de Waterfront localisés sur les côtes ou le long des berges de la lagune de Tunis. Le haut standing est le dénominateur commun des ces opération. Tertiaire supérieur et logement haut de gamme sont souvent couplés avec port de plaisance ou golf. L’intérêt des autorités publiques pour ces projets se manifeste dans la création de la Commission supérieure des grands projets. Rattachée directement à la présidence, elle joue le rôle d’interlocuteur unique avec les partenaires privés. Chez ces derniers, la présence des capitaux des pays du Golfe est assez saisissante. Les investisseurs et promoteurs émiratis sont particulièrement présents tels que Al Maabar, Sama Dubaï, El Boukhatir, etc.Avec l’ouverture du pays aux investissements privés et étrangers, les holdings des pays du Golfe s’emparent d’une partie de la production de la ville autrefois dominée par lesétablissements publics. Ce tournant s’accompagne de ce qu’on appelle le tropisme métropolitain. En effet, motivé par la rentabilisation du capital investit, les acteurs privés ne s’intéressent qu’aux grandes villes là où le développement urbain est garant d’un retour sur investissement. Les acteurspublics quant à eux, sont obligés de suivre le mouvement voirmême de l’alimenter par l’octroi aux acteurs privées d’avantages fiscaux les encourageant à investir dans ces projets. Par conséquent, s’opère une polarisation du territoire tunisien. Les grandes villes continuent à se développer au détriment des villes moyennes et petites. D’un côté on a des villes côtières avec Tunis au sommet de la hiérarchie bénéficiant d’une grande vitalité. D’un autre coté, les villes à l’intérieur du pays telles que Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine, etc. se paupérisent et se dégradent. Les mégas projets financés par le pétrodollar semblent faire du territoire tunisien un territoire à deux vitesses.
10 h 10 : Rafaa MRAIHI et Anis ROMDHANI : « Relation entre lamigration interrégionale des individus et les infrastructuresde transport: Une Application de l'approche de l'équité sociale ».
Le présent article a pour objectif d’étudier l’impact d’une répartition inéquitable des infrastructures de transport sur les flux migratoires des individus entre les régions tunisiennes. Au sens large, il évoque la relation entre l’équité territoriale en matière d’infrastructures et l’équité sociale des politiques de transports. Une telle relation est proposée dans un contexte de transport durable. La problématique centrale de l’article tourne autour des effets du déséquilibre territorial en infrastructures de transport sur l’accessibilité aux marchés d’emploi, la disponibilité des réseaux de transport, l’attractivité des régions en matière d’investissements et leurs développements économiques. Un tel déséquilibre touche aux droits sociaux des individus dans les régions dépourvues de telles infrastructures tels que le droit de mobilité, d’éducation, de travail et d’intégration entre les populations. Pour ce faire, l’article propose une modélisation des flux migratoires interrégionaux en fonction de certaines variablesdéterminantes telles que les variables territoriales : infrastructures routières, maritimes et aériennes, nombre d’entreprises, taux de chômage régionaux, etc. Les estimations d’un modèle de gravité, essentiellement d’aspect géographique, ont montré que les investissements déséquilibrés en matière d’infrastructures de transport, essentiellement concentrées dans les zones côtières tunisiennes, au détriment des zones internes, sont à l’origine des échanges déséquilibrés des individus, orientés plutôt vers les territoires richement équipés en routes, ports et aéroports, plus accessibles et accueillant plus d’entreprises. En parallèle, les zones internes souffrent d’une migration importante des individus, des taux élevés de chômage et de pauvreté.Notre contribution met en question les politiques de financement des infrastructures en Tunisie qui favorise des territoires dont les infrastructures de transport sont productives et ne tiennent pas compte des critères sociaux. En outre, il insiste sur le fait que la reconstruction territoriale implique l’intégration de la question de l’équité territoriale en matière d’infrastructures de transport dans la planification et l’aménagement de territoires et la planification des transports. Cela peut équilibrer les échanges des individus entre les régions tout en favorisant leur fixité géographique.
10 h 30 : Pause
11 h 00 : Béchir RIADH, Mongi SGHAIER, Saïd M. DHIFALLAH et Nadia OUNALLI : « La disparité régionale en Tunisie, une analyse sur les réalisations des Objectifs du millénaire pourle développement ». Depuis les années 80, la renaissance de l’intérêt accordé auxproblèmes environnementaux, dans un contexte de dynamique socio-économique et démographique très vive, a suscité l’émergence de nouvelles interrogations tout autant doctrinales, conceptuelles, méthodologiques que décisionnelles. Dans ce contexte, la Tunisie a intégré les principes de durabilité du développement dans ses politiques nationales qui visent principalement l’amélioration des
conditions de vie de la population. En effet, de nos jours, la notion du développement durable et ses objectifs, dont principalement la réduction de la pauvreté, se présente d’unefaçon presque régulière dans les politiques de développement des pays du monde. Pour cela, l’Organisation des Nations Unies a encouragé les projets de coopération internationale qui ont pour objectif d’assurer le développement durable et par conséquent l’amélioration du niveau de vie des populations. Cette coopération s’observe par exemple dans lesObjectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés en 2000. En Tunisie, plusieurs études et travaux de rechercheont été menés dans le cadre d’analyse de la notion des stratégies et indicateurs du développement (Sandron et Sghaier, 2000 ; Picouet et al, 2004 ; ONU, 2004 ; Soussi, 2009 ; Belhédi A., 1992; 1996; 1998; 2005 et Elloumi, 2006). «Chaque pays a besoin de régions compétitives et dynamiques pour atteindre ses objectifs économiques et sociaux. Le développement régional est un complément indispensable aux politiques macroéconomiques», c’est ce que déclare l’Organisation de Coopération et de Développement Economique pour montrer l’importance d’un développement intégré et global. Aujourd’hui, le déséquilibre régional, l’exclusion liée à la ruralité, le partage inégal des richesses ont été la grande révélation de la Révolution tunisienne en Janvier 2011. En effet, le soulèvement populaire qui a abouti à la chute du régime de Ben Ali est parti des villes tunisiennes défavorisées, d'abord celles du Sud entre 2008 et 2010 (région du bassin minier de Sud-ouest Gafsa puis villes frontalières de Sud-est Ben Guerdane et Médenine) et plus récemment, celles du Centre-ouest (Sidi Bouzid, Kasserine, Menzel Bouzaïane, Thala), du Nord-ouest (Kef, Jendouba). Ainsi, depuis des décennies, le développement du littoral en Tunisie a été préféré à celui de l'Ouest du pays. Les infrastructures routières étaient construites prioritairementpour relier la capitale avec les régions de l'Est, en particulier le Centre-Est. Aussi, le Grand Tunis et l'Est de la Tunisie, concentrent les industries à haute valeur ajoutée(tourisme, textile, etc.), génératrices d'emplois. L'activitéde l'Ouest de la Tunisie étant principalement tournée vers l'agriculture, les créations d'emplois dans ce territoire sont donc très réduites, ce qui favorise un exode d'une partie de la population, vers l'Est ou la capitale.Ce papier propose ainsi de faire apparaître en appliquant la méthode d’Analyse en Composantes Principales (ACP) la disparité entre les gouvernorats du pays. Ainsi, une étude comparative de ces régions sera menée, tout en se référant aux Objectifs du Millénaire pour le Développement ratifiés par la Tunisie. Dans ce travail, l’objectif de l’utilisation de l’ACP est de montrer le groupe des gouvernorats les moins développés en Tunisie. Pour cela, ce papier utilise les données de l’Institut national de la statistique pour les deux années 2000 et 2005 relatives à un ensemble d’indicateurs régionaux. Ainsi, et en se basant sur l’articled’Antony et Rao (2007) et Belhedi A. (1998), nous procédons àla construction d’un indice qu’on appellera « indice composite de sous-développement » pour chaque gouvernorat de la Tunisie. Cet indice se base sur la réalisation régionale des objectifs du millénaire pour le développement. Une fois l’indice de sous développement calculé, nous serons capable
de relever les différentes interprétations et implications des résultats, ainsi que de faire les comparaisons entre les gouvernorats, afin de présenter les régions pauvres et sous-développées.
11 h 20 : Chakib ZOUAGHI et Dorothée BOCCANFUSO : « L’expérience contemporaine du développement territorial en Tunisie : Vers la construction d’un modèle de développement durable participatif en faveur de l’équité territoriale ». Le rapport de l’Homme avec son environnement est une questioncruciale pour le développement territorial. Elle est d’autantplus importante que la situation de crise et de pauvreté pousse des populations entières à puiser dans leur environnement afin de subvenir à leurs besoins immédiats et incompressibles. Elle ne peut donc être traitée séparément dela politique de développement territorial.Actuellement, en plus de cette situation structurelle, la Tunisie traverse une crise sans précédent amorcée par les régions intérieures du pays qui ont pourtant bénéficié de nombreux programmes de développement qui prétendaient les développer, mais le constat est fait que les résultats sont mitigés pour ne pas dire maigres. Les raisons sont essentiellement liées au fait que ces politiques ont toujoursété guidées par un rapport de dépendance de l’arrière-pays (Zone de périphérie) face aux zones côtières (pôles). Une autre raison est liée au fait que les politiques de développement régional ont été guidées par une forte centralisation dans la gestion et dans la décision. Dès l’indépendance du pays, le Programme de Développement Régional (PRD) a été mis en place dans les années 60, puis a été remplacé par le Programme de Développement Rural Intégré (PDRI) dans les années 70. La création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement en 1988 puis du Ministère del’Environnement en 1991 a ouvert la voie à une plus grande place de l’environnement et du développement durable en Tunisie. Nous avons vu naître la multiplication de programmestouchant l’esthétique des villes tels que les Boulevards de l’Environnement sans pour autant s’attaquer on fondements du développement local durable. Les Programmes d’Action Nationale de Lutte contre la Désertification (PANLCD) et du Programme National de Développement Durable (Agenda 21 National) ont été érigés par le pouvoir central en réponse aux engagements de la Tunisie lors du Sommet de la Terre à Rio en 92. Plus récemment, vers la fin des années 90, nous avons vu naître en Tunisie un courant de développement local et de la solidarité envers les populations les plus pauvres par l’édification du programme du Fonds National de Solidarité, puis du programme du fonds National pour l’emploi. Dernièrement, la Tunisie a initié timidement quelques expériences de développement durable local participatif au début des années 2000 par la mise en place des premières stratégies locales de développement durable (Agendas 21 Locaux) qui ont eu un succès relatif dans les villes intérieures. La Tunisie s’est dotée d’autres programmes régionaux environnementaux participatifs. Dans la même période, le Ministère de l’Intérieur et du DéveloppementLocal tunisien a porté des réformes superficielles par la création du Centre de Formation et d’Appui à la
Décentralisation en 2005. Ces initiatives montrent que le besoin de décentralisation était criant sans pour autant qu’il prenne la priorité nationale qu’il mérite. La révolution de 2011 a eu raison de cette injustice sociale et économique. Nous sommes en droit de nous questionner aujourd’hui sur le rôle du citoyen dans son environnement immédiat et de son rôle dans la décision et dans la gestion du développement régional. Quelle éthique du développement territorial adopter? Quels paradigmes de l’économie du développement territorial s’imposent? Abandonner les théories«modernistes» au profit de théories «postdéveloppement» ? Quelles pratiques efficaces du développement territorial adopter? existe-t-il des pratiques de développement régional par le passé qui peuvent inspirer l’édification d’un modèle de développement régional propre à la Tunisie? Où est-ce nécessaire de faire une rupture totale avec les expériences antérieures?Ce sont toutes ces questions que nous traiterons dans la perspective de tirer les leçons des expériences tunisiennes depuis l’indépendance dans le domaine de la politique de développement territorial impliquant le rapport de l’Homme avec son environnement pour mieux aborder l’avenir du développement régional dans le futur.
11 h 40 : Mohammed Tlili HAMDI et Ibtissem OMRI : «L'équité territoriale en matière d'investissement public : un vecteur du développement économique de la nouvelle Tunisie ». Ce travail traite le rôle de l’équité territoriale en matièred’investissement public dans le développement économique de la nouvelle Tunisie. Ainsi, une « distinction positive » en matière de répartition de l’investissement public en faveur des régions de l’ouest est bénéfique pour toute l’économie. Par le moyen d’un investissement public, ces régions comblentleur déficit en matière d’infrastructure de base, afin de favoriser l’accumulation du capital humain et d’attirer les investisseurs privés, nationaux et étrangers.L’encouragement de l’investissement dans les régions de l’ouest amène à l’unification de la vitesse économique du territoire tunisien. Cette unification est nécessaire au plein fonctionnement de l’économie pour atteindre un certain seuil de croissance économique qui permet simultanément de développer la Tunisie par l’absorption d’une grande partie duchômage et de résoudre certains problèmes sociaux.
12 h 00 : Yassine Sami TURKI : « Quel devenir des villes et territoires en Tunisie ? Lecture des propositions des partis politiques et des appels de la société civile ». La phase de transition que connaît actuellement la Tunisie est marquée par une remise en cause de l’ensemble des modèlesemployés précédemment dans les divers secteurs, y compris la question des villes et des territoires qui constitue une des dimensions de la révolution tunisienne. On assiste également à une multiplicité des propositions des partis politiques engagés dans la course à la constituante et des appels de la société civile pour de nouveaux modes de planification et de gouvernance des villes et des régions.A travers une grille d’analyse appliquée sur les programmes des partis politiques les plus représentés et des
propositions émanant d’indépendants et d’associations, cette communication retrace les points de rencontre qui semblent orienter l’évolution future des politiques relatives aux villes et territoires ainsi que les éléments de divergence qui formeront l’objet du débat de la période à venir.
12 h 20 : Débat
12 h 50 Déjeuner
Session 2 : Elaborer une politique environnementale partagée par les habitants
Président de séance : Taoufik BELHARETH Rapporteur : Boubaker HOUMAN
14 h 20 : Conférence de Ridha BOUKRAA : « La problématique dumodèle tunisien de gestion des aires protégées. Pour une alternative ». Le modèle actuel se de gestion des aires protégées se caractérise par une démarche technocratique et autoritaire qui s'appuie sur la mise en clôture des territoires communautaire favorisant les comportements de transgression et excluant l'adhésion. Les mesures d'accompagnement sont insignifiantes par rapport aux pertes subies par les communautés dans le fonctionnement de leur système agraire. L'alternative consiste dans la transformation du système agraire pratiquant l'élevage extensif faisant pression sur les aires protégées en un système agraire intensif qui allègent cette pression.
14 h 50 : Hamza AYARI : « Les aspects du développement environnemental au nord du Kef (nord ouest de la Tunisie) ». Comme toute la région du Haut Tell en Tunisie, le nord du gouvernorat du Kef qui englobe Dyr El Kef, la délégation de Nebeur et des secteurs des délégations de Sakiet Sidi Youssefet du Sers, a vu une marginalisation chroniquement prolongée malgré la diversité des interventions pour la promotion de niveau et du cadre de vie de la population, d’une part, et pour le développement des milieux naturels, d’autre part.La combinaison et l’interférence entre les interventions des différents types d’organismes et l’effort de la population riveraine pour le développement de la région ont participé à freiner les processus de dégradation des milieux naturels et à diminuer leur impact sur les campagnes. Les principales interventions sont liées à des programmes internationaux de travaux DRS (défense et restauration des sols), essentiellement constitués par des reboisements d’envergure de la pinède dégradée et par la réalisation de plusieurs aménagements, à savoir des banquettes d’infiltration, qui visent à atténuer la dynamique érosive, et la création de plusieurs pistes qui servent à désenclaver les campagnes. La majorité de ces travaux sont réalisés par les chantiers de lutte contre le sous-développement.Par la suite, c’est l’État qui est intervenu par la législation qui prend en compte la situation matérielle des riverains, par la conservation des forêts et par le
saupoudrage de quelques services de base dans la région, essentiellement la scolarisation. Ces efforts, malgré leur faible importance, sont appuyés par la population rurale qui a mis en valeurs plusieurs produits et plusieurs surfaces quiétaient avant ces interventions en état d’abandon, et par l’intervention de quelques ONG pour atténuer les manifestations de l’intensité de la marginalisation de cette région en crise.La dynamique des milieux naturels après ces interventions pour le développement durable qui prend en compte la durabilité des ressources a abouti à la régénération des forêts de pin d’Alep qui représentent aujourd’hui une richesse naturelle du fait de l’exploitation des fruits de cette espèce végétale. Son exploitation a participé au freinage des vagues d’émigration rurale et au maintien de la population riveraine.Dans cette communication, on essaiera de présenter les principales interventions pour le développement des milieux naturels, leur conservation et les aspects de valorisation deleurs composantes. Pour affiner ce travail, on s’efforcera durant les vacances d’été de collecter des informations récentes quant au comportement des populations vis-à-vis des espaces naturels, ainsi que les informations qui étaient inaccessibles avant la Révolution tunisienne.
15 h 10 : Dhouha BOURAOUI : « Prise de décision et satisfaction des usagers face aux contraintes de l’action collective des parties prenantes dans un projet de reconstruction : cas du projet de reconstruction d’Erroumani suite aux inondations de 2003 dans la ville de Bousalem ». Plusieurs études ont révélé des problèmes récurrents au niveau de la performance et de la gestion des projets de reconstruction à la suite des catastrophes dans les pays en voie de développement (PEVD). Ces projets doivent faire face à des conditions de vulnérabilité des habitants, engendrées par des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels. Les divers participants - contraints par un accès limité à l’information - sont confrontés à travailler dans uncontexte hostile ayant un niveau d’incertitude élevé.Par ailleurs, tel que proposé par Revet (2007), une catastrophe « naturelle » est, en réalité, un évènement social et politique produit par des causes sociales. Cette façon d’aborder le sujet présente un retournement de situation suite auquel les catastrophes seront analysées non pas comme des interruptions de l’ordre social normal, mais comme le produit de ce dernier (Oliver-Smith, 1991; Kenneth Hewitt, 1997).Ce travail vise à mettre en parallèle l’analysede la dynamique de l’action collective des parties prenantes pour la conduite d’un projet de reconstruction et celle du niveau de satisfaction des usagers face aux décisions prises.Il émet l’hypothèse suivante: trois facteurs organisationnelsinfluencent largement le niveau de satisfaction de la part des bénéficiaires d’un projet de reconstruction de logements à la suite d’un désastre: (i) le niveau de centralisation de la prise de décisions (jumelée au manque d’information) au sein de l’Organisation chargée du projet; (ii) la capacité dela structure organisationnelle de cette organisation d’impliquer la participation active des usagers ; et (iii)
les méthodes de communication ainsi que les modes de résolution de conflits mis en place au niveau de la planification, de la gestion et du financement du projet.Afind’atteindre cet objectif, une recherche empirique - basée surune approche systémique - fut menée pour analyser le cas des inondations ayant eu lieu en 2003 dans la ville de Bousalem en Tunisie. Suite à ce désastre, une décision présidentielle consistait à relocaliser les sinistrés dans la localité d’Erroumani : un projet financé par le Fonds de solidarité national 26 26. L’analyse de la situation actuelle montre queces initiatives n’ont pas atteint les objectifs escomptés (problèmes de communication et d’exclusion de la société locale aux moments des grandes décisions politiques, divergence des visions, etc.). D’ailleurs, l’insatisfaction des usagers et la faible occupation de ces logements en sont les indicateurs les plus évidents.Le choix de relocalisation constitue donc un enjeu majeur dans ce projet. En effet, cette opération de relogement, qui présente une ‘promesse’ del’État et « un projet social basé sur la solidarité, la tolérance, la démocratie et les droits de l’homme » (Fonds desolidarité national, 2005) a occasionné des inconvénients majeurs ainsi que l’échec du processus de relogement dont lesconséquences étaient plus graves que les impacts du désastre lui-même.Quelles méthodes de communication adopter entre les différentes parties prenantes d’un projet de relogement suiteaux désastres et quels modes de résolution de conflits adapter au contexte tunisien (médiation, partnering, visionning, etc.) afin d’optimiser l’efficience des interventions de l’État en matière de politiques de relogement? Dans quelle mesure les modèles internationaux pourraient-ils représenter une expérience utile pour la Tunisie?L’originalité de cette recherche réside dans sa démarche qui prend pour origine l’identification et l’analysede la dynamique des parties prenantes du projet afin d’identifier des mécanismes réussis et d’ébaucher de nouvelles politiques participatives et citoyennes adaptées aucontexte tunisien.
15 h 30 : Sami BEN HAJ : « Aires protégées et Développement local »
15 h 50 : Pause
16 h 20 : Awatef BEN LAARADH : « Transferts d’eau et inégalités socio-territoriales. Le cas de la Tunisie ». Dans cette étude on interroge l’existence d’un lien entre transfert d’eau et inégalité socio territoriale. La réflexions’appuie notamment sur les problèmes créés au niveau des zones donatrices d’eau et des zones réceptrices d’eau. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons analysé le projet de transfert d’eau du Barrage Sidi Salem (gouvernorat de Béja, Tunisie) au Périmètre de sauvegarde de Diar El Hojjej dans larégion de Nabeul. Notre analyse révèle que les politiques de gestion de l’eau et les projets de transfert d’eau qui les accompagnent s’inscrivent dans le cadre d’une gestion centralisée des ressources hydrauliques qui vise l’atténuation du déséquilibre régional de la ressource en eauentre intérieur et littoral tunisien.
L’eau étant un bien public, son transfert est considéré commeun instrument de solidarité nationale. Néanmoins ce programmede transfert d’eau a crée des nouveaux problèmes socio-économiques et environnementaux. La réussite du projet de transfert d’eau reste relative, et notre étude de cas souligne la nécessité d’inscrire ce type de programme dans uncadre plus global, prenant en compte leurs implications à la fois pour les zones donatrices et les zones bénéficiaires, etintégrant les besoins des agriculteurs en matière d’encadrement technique et d’organisation de la production etdes marchés.
16 h 40 : Charaf SAIDI et Youssef ALAMI : « Quel modèle de régulation pour une gouvernance équitable des services sociaux : Cas des services publics d’eau potable et d’assainissement au Maroc ». La problématique de la gouvernance des services publics d’eaupotable et d’assainissement se pose avec acuité depuis les années 1980. Les enjeux technico-économiques, sociopolitiqueset environnementaux que représentent ces services leur octroient une place capitale dans le développement durable etexposent leurs modes de gestion à une évolution continue à l’échelle internationale.Toutefois, la conception marchande de ces services couplée à certaines défaillances du marché (monopole naturel, asymétried’information…) ont fait que la question de la régulation économique à travers ses principales fonctions (régulation des tarifs, régulation de la concurrence, régulation de la qualité du service, la protection des consommateurs et la régulation sociale) émerge intensivement quel que soit le mode de gestion adopté.Ainsi trois principaux modèles de régulation économique des services publics d’eau potable et d’assainissement se sont développés à l’échelle internationale, et d’autres à caractère «hybride» s’y sont greffés pour s’adapter aux contextes locaux des pays, notamment ceux en voie de développement:· Le modèle de «régulation par contrat» qui trouve ses origines dans le modèle français de délégation des services publics. Il s’est développé notamment dans les pays ayant un système juridique de tradition française ;· Le modèle de «régulation par agence » qui se base essentiellement sur le modèle anglais de mise en en place d’une agence indépendante de régulation (OFWAT). Il s’est développé dans les pays plutôt anglophones (Zambie, Ghana, Kenya…)· L’autorégulation qui se caractérise par la liberté de l’entreprise à fixer elle-même les tarifs ou les normes de laqualité du service. · D’autres modèles « hybrides » tels que la combinaison entreagence de régulation et contrat, l’externalisation des fonctions de régulation, la régulation participative…Chacun de ces modèles présente des avantages et des inconvénients, ce qui a permis de réfuter l’hypothèse de la perfection d’un modèle et de conclure que la force d’un modèle réside dans sa capacité à s’adapter au contexte économique et sociopolitique de chaque pays.Au Maroc, l’article 39 de la charte communale qui confère la
décision de gestion des services publics aux communes, la loi54/05 relative à la délégation des services publics et le projet de la régionalisation avancée lancée par SM le Roi le 03/01/2010 ont donné un nouvel élan à la question de la régulation des services publics d’eau et d’assainissement.L'objectif de la présente contribution, après une revue de lalittérature sur les grands modèles de régulation à l’échelle internationale, est de présenter une étude du modèle de régulation économique des services d’eau potable et d’assainissement au Maroc tout en intégrant la dimension sociale.A travers cette contribution, on montrera que même si les fonctions de la régulation économique au Maroc sont partagéesentre plusieurs intervenants, en fonction du mode de gestion,on peut déduire que d'une part, la régulation tarifaire favorise les préoccupations sociales au détriment du recouvrement des coûts et que d’autre part, la régulation de la qualité du service varie d’un mode de gestion à un autre et ce en fonction de la qualité de l'opérateurs privé ou public.Quant à la régulation sociale « service universel », elle repose sur un mécanisme satisfaisant de péréquation entre zones avancées et riches et zones précaires et pauvres ou encore entre zones urbaines et zones rurales, une diversification des modes de gestion notamment en milieu rural et dans les petites agglomérations (introduction du privé, sous-traitance, gestion communautaire …) et une recherche d’autres montages financiers de type OBA (Out put Based Aid) soutenus par les instances internationales.
17 h 00 : Alia GANA : « La gouvernance de l'eau potable: ; Quid de l'équité territoriale en Tunisie ? ». L’aggravation des phénomènes d’exclusion sociale et les disparités territoriales croissantes qui ont accompagné les processus de développement en Tunisie figurent parmi les causes profondes de la révolution du 14 janvier. Les inégalités entre régions intérieures et régions littorales etentre zones rurales et zones urbaines sont attestées par tousles indicateurs du développement (emploi, santé, éducation, accès aux infrastructures, accès à l’eau).Alors que l’accès à l’eau et à l’assainissement a été considéré comme un élément essentiel du développement économique et social en Tunisie, force est de constater que la priorité accordée à l’approvisionnement des villes et des zones littorales contribue à des inégalités persistantes dansce domaine entre milieu urbain et milieu rural. Tout d’abord,la mobilisation des ressources hydrauliques, à travers les grands barrages et les ouvrages de transfert, s’est faite largement au détriment des régions pourvoyeuses, situées en grande partie dans les zones rurales du Nord-ouest du pays eta bénéficié principalement aux régions côtières et aux grandscentres urbains (Cap-Bon, Sahel, Sfax). Par ailleurs, et au-delà des indicateurs statistiques attestant de l’améliorationdes taux de desserte des zones rurales en eau potable (90% en2010), l’accès à l’eau des populations rurales reste très largement en deçà des besoins des ménages, aussi bien en quantité qu’en qualité. Alors que les zones desservies par laSonede (urbain et rural aggloméré) peuvent compter sur des
services d’approvisionnement fiable et de qualité, en milieu rural dispersé, l’accès des ménages à cette ressource vitale reste limité et aléatoire, notamment en raison du système de distribution par bornes fontaines et des dysfonctionnements des associations d’usagers (GDA) en charge de la gestion des réseaux. De plus les tarifs de l’eau sont plus élevés dans les zones desservies par les GDA et les ménages ruraux ne bénéficient pas du système de péréquation tarifaire, appliquée l’échelle nationale par la Sonede, qui permet aux ménages à revenus modestes d’accéder à l’eau courante à moindres frais. Enfin les inégalités rural/urbain liées à l’usage de l’eau sont dues à des problèmes de qualité de la ressource disponible (haut degré de salinité, fort taux de calcaire, etc.) et au faible taux de raccordement des ménagesruraux aux réseaux d’assainissement (moins de 10%) qui exposent les populations concernées à des risques environnementaux et sanitaires plus élevés.A partir de recherches de terrain effectuées dans plusieurs régions de Tunisie (Kef, Zaghouan, Siliana, Sidi Bouzid), cette communication propose d’explorer ces différentes dimensions des inégalités rural/urbain liées à l’usage de l’eau et de réinterroger les choix d’aménagement du territoire et les stratégies de développement dont ces disparités découlent fondamentalement.
17 h 20 – 17 h 50 : débat
Vendredi 18 novembre 2011
Session 3 : Repenser la ville dans son territoire pour une meilleure équité économique et environnementale Président de séance : Roland VIDAL Rapporteur : Moez BOURAOUI
8 h 30 : Conférence d’André TORRE : « Du bon usage des conflits. L'importance de la prise de parole, entre silence et exigences démocratiques ». Le maintien des possibilités d'expression des populations et de la discussion entre différentes catégories ou groupes de personnes porteuses d'opinons ou de projets opposés se trouveau cœur de l'exigence démocratique comme des processus de gouvernance des sociétés et des économies contemporaines. On considère souvent que l'obtention d'une bonne gouvernance desterritoires, en particulier entre les périodes de vote, doit passer par les processus de négociation et de concertation, et qu'il faut éviter les conflits, qui seraient nuisibles à la réussite des projets communs. Un examen plus attentif de diverses situations de conflictualité nous révèle que les conflits, quand ils sont non violent, sont un moyen d'expression des populations en désaccord avec certains projets ou encore qui demandent à participer à l'élaboration des scénarios futurs de développement. Ils constituent une prise de parole de ces populations, et représentent en fait l'autres versant des mécanismes de concertation et de négociation car ils permettent la discussion entre les
parties opposées. Les conflits correspondent à un processus d'essais et d'erreurs, qui permet de tester certains projets,de les accepter, de les modifier ou éventuellement de les rejeter s'ils ne sont pas conformes aux désirs et volontés des populations. Concertation et conflits sont les deux versants d'un même processus de gouvernance des territoires, qui correspond aux exigences démocratiques.
9 h 00 : Ali DJERBI : « Pour que la cité redevienne un espacede vie ». L’aménagement du territoire et le développement des villes, en Tunisie, ont connu, ces deux dernières décennies, un important déséquilibre qui a concerné aussi bien les configurations spatiales des établissements humains que la nature et le mode d’articulation des activités qui les déterminent.Nous sommes désormais en présence d’un urbanisme sans urbanité. L’espace physique se déploie et se meuble de conformations plurielles sans rapport avec la réalité socialequi l’habite car les facteurs déterminant sa genèse sont de plus en plus dictés par des exigences exogènes que le systèmeéconomique, amarré à la mondialisation, lui impose. De ce fait l’homme, auquel tout espace aménagé ou construit est destiné, n’est plus considéré en tant que facteur essentiel de l’équation. Au contraire il doit de plus en plus subir lesaléas et adapter son propre mode de vie à ces nouvelles exigences. Les aménageurs ne procèdent que par le zoning et le lotissement pour réaliser l’espace urbanisé et les promoteurs immobiliers n’occupent les parcelles loties qu’avec des blocs architecturés que ce soit pour l’habitat dit collectif ou pour l’habitat individuel. Le processus de la fragmentation tout azimut a remplacé le continuum organique que l’homme avait longuement et savamment élaboré, durant son histoire, pour inscrire sa cité dans l’environnement naturel.Dans cette communication nous tenterons de montrer les caractéristiques de ce processus de la fragmentation spatialepour essayer de comprendre son mécanisme et esquisser les perspectives de son dépassement afin d’aboutir à une reformulation de l’aménagement du territoire et de la cité plus en adéquation avec le vécu et les exigences des citoyensen quête d’urbanité.
9 h 20 : Abderraouf DRIBEK : « L'impact du tourisme sur l'îlede Djerba ». L’étude présentée repose sur la mise en place d’une méthodologie permettant de quantifier de manière fiable et scientifique la place et la contribution du tourisme dans l’économie, avec pour objectif de constituer un outil réutilisable destiné d’abord à éclairer la politique publiquede ce secteur. Il s’agit d’une nouvelle méthode permettant d’apprécier l’impact économique du tourisme sur l’île de Djerba (Tunisie). Cette méthode, appelée « méthode de masses », s’inspire de la théorie de croissance ou de développement.Elle nécessite la détermination des activités directes, indirectes et induites. Les indicateurs mesurés sont : la Valeur ajoutée (VA), l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) et l’Emploi (E). Cette méthode consiste à retenir la totalité de
l’effectif, de la VA et de l’EBE des entreprises situées dansla zone touristique et la part proportionnelle de ces indicateurs pour les entreprises situées hors la zone touristique. En effet, la connaissance de la répartition de la valeur ajoutée permet de déterminer le poids économique des différentes catégories et elle peut devenir un outil d’orientation des choix locaux de développement du tourisme en favorisant les activités les plus créatrices de richesse et génératrice de main d’œuvre (exemple le transport aérien, les guides touristiques…), ensuite, de sensibiliser les populations aux enjeux du tourisme, comme facteur de développement économique.L’étude présentée amène à penser la nécessité d'une nouvelle logique de développement. Mais comment la rendre opérationnelle et efficace dans une région dont l'économie est fortement dépendante des ressources naturelles?Si, aujourd’hui, de nouvelles initiatives laissent entrevoir l'émergence d'une « nouvelle économie », une économie qui cherche à promouvoir les ressources naturelles et humaines dumilieu touristique, la mise en valeur de ces deux ressources se heurte à des obstacles d’organisation et de financement.Ence qui concerne l’organisation : une intervention énergique de l'État en vue de rééquilibrer la distribution spatiale de l'appareil de production et de consommation est devenue nécessaire. Seule une répartition équitable aux niveaux économique, social et politique sera garante d’un nivellementvertueux des localités. Un renouveau de la politique d’aménagement du territoire et la décentralisation sont alorssouhaitables. Ces deux composantes constituent les bases d’undéveloppement local. Cette nouvelle stratégie nécessite une valorisation touristique d’un territoire, qui a pour objectifde transférer les pouvoirs décisionnels auprès des collectivités locales.Concernant le problème financier, il faut tout d’abord que les impôts soient affectés —c’est-à-dire que les recettes générées soient réservées— à des utilisations spécifiques au lieu d’être versés aux fonds publics. C'est pourquoi il doit y avoir concertation entre les différents acteurs impliqués dans le développement socio-économique de l’île. Car on ne peut prétendre faire du développement si l'État et les intervenants locaux ne deviennent pas de véritables partenaires.Enfin, il faut attirer plus de promoteurs étrangers pour résoudre la problématique de compétitivité et de rentabilité associée auxfacteurs de capital. La rénovation et l’aménagement des stations balnéaires pourraient s’appuyer sur une ouverture del’immobilier commercial, ainsi sur un meilleur accès aux capitaux étrangers et au savoir-faire en termes de projets. Encourager l’ouverture de la part des aménageurs et des hôteliers tunisiens aux normes, aux innovations en matière deconception, et aux mécanismes de financement utilisés à l’étranger.
9 h 40 : Ahmed Karim DHAOUADI, Christine AUBRY et Sabine HOUOT : « Valorisation agricole des produits résiduaires organiques dans un territoire : l’exemple de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets ; questions pour une application dans l’agriculture préiurbaine en Tunisie ? ». La valorisation agricole des produits résiduaires organiques
(PRO) peut constituer une alternative agronomiquement et environnementalement intéressante à leur traitement par incinération ou leur élimination par mise en décharge, via lerecyclage des éléments nutritifs qu’ils contiennent. Les déchets, notamment urbains, ne font qu’augmenter de par le monde et se diversifient (emballages biodégradables, déchets verts, tontes de gazon, déchets de cantine, fraction fermentescible des ordures ménagères…). Parallèlement, l’augmentation du prix des engrais chimiques, liée à celle duprix du pétrole, pourrait pénaliser leur utilisation en agriculture, mais favoriser celle des déchets organiques. En France, 330 millions de tonnes de déchets organiques potentiellement valorisables en agriculture sont produits annuellement (Ademe, 2008), et auraient un potentiel équivalent aux engrais de synthèse épandus en France en 2008 (2,4 millions de tonnes d’azote, 632 000 tonnes de P205 et 794 000 tonnes de K).C’est pourquoi une meilleure gestion territoriale des PRO devient nécessaire pour les collectivités locales (réduction du coût d’incinération des déchets) et pour les agriculteurs (économie sur les engrais minéraux).L’objectif général du travail de thèse est d’étudier la substitution partielle de l’utilisation des engrais azotés par les PRO produits sur le territoire de la Plaine de Versailles et le Plateau des Alluets, territoire sur lequel existe un projet agri-urbain, visant précisément à favoriser les liens entre agriculture et ville.Ce territoire fait partie de la ceinture verte de la région parisienne. Il s’étend sur 22 050 ha pour 25 communes et inclut 143 792 habitants (Insee, 2006) La surface agricole utile (SAU) de ce territoire représente environ 45% du total et 80% de la SAU sont en cultures céréalières (DRIAF, 2007). Il y a aujourd’hui 80 agriculteurssur le territoire dont 60 sont à vocation céréalière. La taille moyenne d’une exploitation céréalière est de 130 ha environ. Les cultures les plus cultivées sont le blé tendre, le colza, l’orge d’hiver et de printemps et le maïs.Nous proposons donc, pour cette communication, de présenter la méthodologie mise au point pour valoriser au mieux les PROà l’échelle de l’exploitation agricole sur notre territoire d’étude, en partant d’un inventaire et d’une caractérisation précise des PRO présents sur le territoire, y compris de leurinnocuité en termes chimiques et pathologiques (les PRO sur la PVPA sont conformes aux normes françaises), d’une bonne connaissance des cultures, successions de cultures et itinéraires techniques de fertilisation et enfin d’une méthode d’évaluation des substitutions possibles.Nous discuterons également le cas de l’application de cette méthodologie en Tunisie. A priori, il existe peu de travaux de recensement territorial des PRO. Une question majeure qui se pose est celle de leur innocuité (éléments traces métalliques, pathogènes, résidus médicamenteux). Les agriculteurs utilisent peu de PRO dans leurs systèmes de culture et les teneurs en matières organiques des sols sont peu élevées (= 1.5%).Il serait donc intéressant de considérer les modes d’adaptation de notre projet versaillais pour analyser les PRO produits sur des territoires en Tunisie et leur insertionpossible dans les systèmes agricoles. Une condition préalable
toutefois, en milieu urbain ou périurbain, est que l’agriculture soit un minimum soutenue contre l’urbanisation galopante. Nous donnerons quelques éléments sur l’importance du soutien de la ville à l’agriculture dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant. D’autres interventions dans le séminaire vont précisément traiter, probablement, de ce pointde lien entre la ville et l’agriculture.
10 h 00 : Saïda HAMMAMI et Christine AUBRY : « L’agriculture Périurbaine de la façade orientale du Cap Bon en Tunisie. Lesconflits du passé et les enjeux de l’avenir ? ». La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 mérite aujourd’hui de repenser l’avenir de l’aménagement des espacespériurbains, dont l’espace agricole fait partie. En effet, l’agriculture du littoral tunisien a participé depuis longtemps à l’amélioration de l’économie du pays, ainsi qu’à l’approvisionnement des villes avoisinantes en denrées alimentaires. Cependant, cette activité économique est aujourd’hui incapable de surmonter les méfaits du passé. Danscet contribution, on prendra l’agriculture périurbaine (APU) de la façade orientale du Cap-Bon comme un exemple qui reflète l’état de l’APU du littoral tunisien. La façade orientale du Cap-Bon en Tunisie est un espace de paysages variés, agricoles, urbains, touristiques, environnementaux etruraux. Elle devient aujourd’hui le territoire de nouvelles formes d’occupation spatiale, qui ont créé un déséquilibre entre la ville et son espace agricole périphérique, dans une zone qui a une histoire agricole séculaire et une évolution urbaine très soutenue ces dernières années. En effet, les espaces agricoles périurbains de cette façade, miroirs et reflets d’un choix économique et social privilégiant le développement touristique depuis près de 50 ans, font aujourd’hui l’objet d’un grand débat sur la qualité des paysages urbains et touristiques. Il s’agit aujourd’hui de comprendre, connaître et faire reconnaître les conditions dans lesquelles les paysages agricoles peuvent participer à l’amélioration de la qualité de vie des résidents et à être un produit touristique. Avec les orientations nouvelles vers la création des services touristiques autres que les servicestraditionnels (mer, plage, et soleil), les espaces agricoles peuvent être des facteurs positifs pour l’émergence de nouvelles images identitaires et patrimoniales. De la manièredont le paysage agricole vécu s’intègre dans le tissu urbain et touristique, émerge le paysage perçu autrement. Les perceptions des différents acteurs enquêtés (12 acteurs institutionnels, et 74 agriculteurs) envers cette agriculturedonnent une image floue sur l’avenir d’une activité qui a longtemps nourri ses populations locales et largement contribué à l’alimentation de la Tunisie. Nous avons pu montrer que, de façon souvent spontanée, certaines autres fonctions émergent dans les zones touristiques, comme les fonctions de services aux touristes récréatives et pédagogiques : elles laissent présager que des formes nouvelles d’agrotourisme sont en émergence et mériteraient d’être mieux étudiées et accompagnées.
10 h 20 : Saloua TOUMI : « Territoire en mutation et initiative locale. Un projet pour l’émergence d'une nouvelle
organisation du territoire à La Soukra ». Dans un pays émergent comme la Tunisie, la problématique de l’extension urbaine massive sur les terres agricoles s'est posée depuis les années 1970 et est restée sans solution effective malgré les nombreux documents de planification du territoire. Le phénomène s'est même fortement accentué ces deux dernières décennies avec l'obscurantisme des actions publiques et la montée des inégalités sociales qui a engendréla multiplication des quartiers anarchiques sur les terres agricoles qui jouxtent les villes. Ces terres sont devenues les lieux convoités des populations les plus démunies, mais également des classes aisées à la recherche d’espace loin de la ville et demandeuses de parcelles de grande dimension.Il ne faudrait pourtant pas oublier que la ville et l'agriculture sont dans une relation d'interdépendance dont il importerait de mieux tenir compte, d’autant que, dans le contexte actuel, on observe une certaine confusion entre liberté, appropriation et droit, qui se traduit par une recrudescence des constructions illégales.La plaine de la Soukra représente un prototype des tensions socio-économiqueset des pressions qu'exerce la ville sur l'agriculture. Renommée jadis pour ses orangeraies, elle est aujourd'hui connue comme territoire résidentiel, à la fois populaire et aisé, et industriel. Pourtant, la moitié de son territoire est encore tenue par l’agriculture, même si la logique socio-économique de sa relation avec la ville a évolué au fil des temps.Dès l'époque beylicale, Tunis a stimulé le développement agricole de la Plaine par les débouchés qu'elleoffrait à ses productions, fruits, légumes et lait. Dans le même temps, la Plaine s’affirmait comme lieu d'agrément pour l'aristocratie tunisoise et les citadins aisés.Après l'Indépendance, et avec l'introduction des eaux usées traitées (EUT) pour l'irrigation, la dynamique agricole devient encore plus prospère et la relation avec la Capitale en extension s’enrichit considérablement. En plus des marchésde gros, les produits de La Soukra gagnent progressivement les quartiers via quelques vendeurs locaux et surtout les marchands ambulants. Mais avec l'interdiction d'utilisation des EUT pour le maraîchage et l'apparition de nouveaux noyauxurbains à partir des années 1980, la plaine commence à perdreson identité agricole au profit de la ville.Les inondations, de plus en plus fréquentes, affectent fortement la capitale. La qualité de l'eau et du sol se dégrade, les agriculteurs sont contraints de changer de type de culture et de s’adapteraux conditions techniques et au contexte urbain environnant, ce qui n’est pas toujours possible. Le phénomène d'abandon des terrains agricoles se propage dans la plaine. L'espace agricole restant se recompose, et même si de nombreuses exploitations se maintiennent grâce à une logique économique basée sur l'approvisionnement de proximité, le problème de l'eau constitue un frein majeur.C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet local de recherche-action pour la valorisation des eaux pluviales et grises par l'agriculture urbaine. Ce projet, présenté sous une dimension agro-environnementale, a déjà permis la relance ou le renforcementde l'activité agricole. Il reste à savoir s’il contribuera aux yeux des agriculteurs, à revaloriser l'agriculture de La Soukra qui autrefois était une fierté locale. Sera-t-il aussile moteur d’un renouvellement de la relation des populations
citadines avec le monde agricole, maintenant que les Tunisiens commencent à s'approprier leur territoire et aspirent à une meilleure qualité de vie ? S’affirmera-t-elle comme une expérience porteuse d'une nouvelle organisation du territoire urbain, mieux reconnue par les autorités locales et les planificateurs ?
10 h 40 : Débat
11 h 10 : Pause
Session 4 : Accompagner l'éveil de l'espacepublic tunisien Président de séance : Morched CHABBI Rapporteur : Olfa Mediene
11 h 30 : Conférence de Saïd ALMI : « Du Projet local d'Alberto Magnaghi comme paradigme. Quelles applications en Tunisie et ailleurs ? ». Proprement révolutionnaire est l’ouvrage d’Alberto Magnaghi. Le Projet local (2003, éd. Pierre Mardaga; 123 p. 1ère éd. IlProgetto locale, Turin, Bollati Bolinghieri, 2000, 256 p.) inaugure en effet une nouvelle voie dans le champ de l’aménagement territorial. A rebours des systèmes conventionnels et des idées reçues, l’architecte urbaniste italien se forge de nouvelles notions, telles que patrimoine territorial et auto-développement local durable, et propose une perspective autre que celle admise communément dans le cadre omniprésent du développement durable, en opposant à la mondialisation par le haut une mondialisation par le bas. Ce renversement méthodologique ne tient pas à une simple tournure sémantique. Il se fonde sur de nombreux travaux effectués dans la mouvance de l’altermondialisme, mais aussi sur des expériences pratiques dont l’auteur suit et supervisele déroulement en Italie depuis plusieurs années.Originale, l’idée de Magnaghi l’est incontestablement. Et lesaménageurs ont tout intérêt à la méditer. Mais aussi à la relativiser. L’Italie, partie intégrante de l’Europe et du monde occidental, n’est pas la Tunisie, ni les autres pays duMaghreb, d’Afrique ou d’ailleurs.S’il est toujours utile de découvrir une expérience originale, il est non moins légitime de l’interroger sous tous les angles en se dotant d’un esprit critique constructifpermanent.
12 h 00 : Nader MEDDEB : « Villes de pouvoir, pouvoir des villes : les limites de l’Etat bourguibien dans la fabrique d’une capitale indépendante ».« Ville et démocratie, praxis urbaine et praxis politique ont coïncidé quand la ville fonctionnait comme système sémiologique. La politique ne peut être la dimension ou plutôt le problème majeur de la ville lorsque l’espace urbain est devenu un instrument toujours plus abstrait » (CHOAY. F, 1971) Quel intérêt avons-nous à nous insurger à propos d’une époquerévolue, celle du premier chef d’Etat tunisien, Habib Bourguiba, alors que la Tunisie actuelle se révolte contre lerègne du président déchu, Zine El-Abedine Ben Ali, une dictature vieille de plus de 23 ans ?
Parce que la leçon tirée de l’histoire urbaine de la ville deTunis, une fois mise à l’épreuve épistémologique, ne cesse defaire jaillir de nouvelles lectures historico-urbaines, le retour sur les prémices d’une réflexion aménagiste de Tunis s’est avéré opportun. Ainsi, la compréhension de Tunis aujourd’hui ne peut être faite en dehors de l’assimilation d’une fondation bourguibienne basée sur la tyrannie de pouvoir et le narcissisme d’un président qui, selon H. Ben Ammar, était « le premier urbaniste de la Tunisie » (ABDELKAFI. J, 1989). En outre, il est de l’ordre de l’évidence que tout présent est fruit de son passé. Autrementdit, les politiques de Ben Ali sont, pour plusieurs raisons, indissociables de la structure échafaudée par son prédécesseur H. Bourguiba, qui à son tour fut profondément influencé par les stratégies du protectorat français, d’où lefeedback historique.A la lumière de la discussion tenue en 1977 entre Michel Foucault et P. Rabinow et publiée, plus tard, sous le titre «Space, Knowledge and power » dans « the Foucault reader » (1984), notre contribution se veut, en premier lieu, un positionnement par rapport à la dialectique Pouvoir/Villes etau rôle des politiques gouvernantes dans l’instauration des stratégies urbaines ou encore des « villes-instruments », selon l’expression de Françoise Choay. L’accent est mis sur le concours international pour le réaménagement du grand Tunis connu sous l’intitulé « la tentative de la percée de lamédina » qui fut lancé par le président Bourguiba à l’aube del’Indépendance au près de l’Union internationale des Architectes (UIA) et du Secrétariat aux Travaux publics et à l’Habitat (STPH). De l’histoire de cet évènement est mise en exergue la relation chef d’Etat/Conseil expert et son poids dans la définition du devenir urbain et architectural de la ville. Bien évidemment, la valeur octroyée au paramètre social fait surface de par la nature des liens Gouvernant(s)/Gouvernés.Dans cette entrevue, Michel Foucault nous ramène à un temps où le chef d’Etat se prenait pour le père d’une grande famille ; la société. Cette relation patriarcale, qui lui paraissait naturelle, offrait au leader une main basse sur plusieurs secteurs déterminants dans la structure de l’état, notamment l’aspect architectural et urbain des grandes villes, a fortiori, de la capitale. Bourguiba la voulait moderne à l’image d’un « Jugurtha qui a réussi », une formulequ’il aimait associer à l’adoration de sa gloire. Ainsi, la médina, désormais un ancien quartier dans une grande métropole, lui posait problème pour maintes raisons qui dépassaient certainement la seule inaccessibilité par l’automobile. Malgré le conseil expert du secrétaire général de l’UIA, l’architecte Pierre Vago, sur l’absurdité d’une éventuelle percée de la médina, le concours à tout de même été lancé. Le jury n’a finalement pas attribué de premier prix et l’échec attendu de la compétition fut le sujet en 1962 d’une conférence internationale ayant trait au devenir des villes traditionnelles dans le monde arabe. Des questionsidentitaires et patrimoniales furent abordées conjointement àune opinion publique qui semble être largement écartée de la prise des décisions. A l’époque, le projet urbain participatif est quasi absent du processus réflexif de l’aménagement du territoire. C’est, entre autres, l’une des
explications que nous donnons aux révoltes populaires « vélocement » avortées par les forces militaires. Nonobstant, rien ne peut empêcher la quête incessante de l’Homme pour sonhumanité, ici pour reprendre l’idée que développe Hannah Arendt sur le dépassement de la sphère privée pour une nouvelle définition du domaine public : « l’homme qui n’avaitd’autre vie que privée, celui qui, esclave, n’avait pas droitau domaine public, ou barbare, n’avait pas su fonder ce domaine, cet homme n’était pas pleinement humain » (ARENDT. H, 1961). Ainsi, parce que le droit à l’expression est de l’ordre de l’humain, notre essai se veut, en second lieu, unedémonstration de la portée de l’espace public dans la concrétisation des libertés.
12 h 20 : Anouck BARKA : « L’Infrastructure Verte Urbaine : un nouvel outil pour réinventer les villes en Tunisie ». Le but de cette intervention est d’exposer une nouvelle méthodologie de diagnostic et de projet plus particulièrementappliquée à l’échelle urbaine et périurbaine, telle qu’enseignée à la Washington University à Seattle, EUA.La Tunisie est à la croisée des chemins. Elle peut choisir labonne voie et faire de la rénovation de ses villes à la fois la solution à des problèmes sociaux critiques pour l’avenir du pays et l’opportunité de libérer les potentiels qu’elle porte en elle pour devenir un pays exemplaire en termes de qualité de vie et d’équité sociale. La Tunisie doit réinventer ses villes, maillons clés de l’aménagement du territoire.Le terme d’Infrastructure Verte est souvent assimilé à diverses notions et diverses échelles d’intervention, allant de systèmes de zones vertes connectées entre elles à l’échelle du territoire, à la notion de traitement « vert » des eaux de pluie à l’échelle locale.Quelle que soit l’échelle de projet, le concept d’Infrastructure Verte est basé sur la reconnaissance et la valorisation des services que la nature peut rendre dans de nombreux domaines, allant de la connectivité des habitats écologiques, à la gestion des eaux pluviales et aux loisirs de la population.La présentation s’intéressera plus particulièrement aux villes mais sans oublier leur contexte bio-régional et les systèmes dans lesquels elles s’insèrent, avec une question toujours sous-jacente : « quelles sont les ressources que nous cherchons à protéger ? »La méthode travaille sur toutes les dimensions et fonctions de l’infrastructure verte urbaine, pour décupler ses potentiels et l’insérer dans la vie quotidienne des habitants, tout en la reliant au grand territoire pour obtenir des bénéfices éco-systémiques encore plus importants.Conçue de manière holistique, l’Infrastructure Verte peut devenir une solution pour faire revivre et régénérer nos villes et leur permettre de relever les défis colossaux auxquels elles font face dans divers domaines : gestion des eaux de pluie et eaux usées, mobilité et santé publique, équité sociale, sécurité alimentaire et énergétique, adaptation aux changements climatiques, etc.En outre, la méthodologie inclut une très large concertation avec les parties concernées par chaque projet, et permet de
rendre le citoyen acteur en lui donnant l’envie de construireune ville vivante et vivable.La méthode est fondée sur l’analyse de l’historique et de l’existant selon 6 axes : géologie, hydrologie, biologie, données sociales (toutes les données reliées aux activités humaines), flux de circulation, métabolisme de la ville (entrées et sorties de matières, nourriture et énergies).Cette analyse est matérialisée par un plan masse pour chaque axe d’étude sur lequel les conclusions sont schématisées en éléments graphiques. Les plans masse sont ensuite fusionnés et donnent lieu à un plan général de diagnostic sur lequel apparaissent déjà les opportunités d’intervention.La phase de conception prend appui sur le diagnostic et sur une concertation avec la population locale et les pouvoirs locaux, publics et privés.L’objectif final de la présentation est d’introduire la notion d’Infrastructure Verte en Tunisie comme un nouvel outil à la disposition des professionnels de l’aménagement urbain.
12 h 40 : Déjeuner
14 h 10 : Jilani CHATTI : « Ruptures et continuités du projetde paysage, cas du parc de la Méditerranée à Tunis ». "La dimension paysagère fait partie intégrante du processus d'analyse des territoires et d'aménagement de l'espace parce que le paysage est devenu un atout et un outil de développement local."En Tunisie, cette dimension est loin de faire l'unanimité. Lepaysage semble condamné à une conception esthétique et décorative "d'embellissement du cadre de vie" du moins dans les documents officiels de la commande paysagère, si ce n'estdans le discours officiel et les médias. "Or, c'est dans les paysage vécus au quotidien par des sociétés solidaires que s'exprime l'identité d'un pays. La qualité paysagère des politiques locales doit viser à souligner la singularité d'unpaysage, plutôt que de le banaliser par mimétisme avec les paysages voisins. Mais la qualité sociale d'un territoire ne se vérifie pas seulement par le regard extérieur. C'est de l'intérieur que la validation se fait aussi". Cette validation se traduit par l'appropriation du paysage créé (ourecréé) par les individus ou groupes sociaux qui vont s'y identifier.Mais avant d'aboutir à sa formation (ou transformation), le paysage passe par un processus opératoire lent et complexe qui est le projet de paysage. Ce dernier, comme tout projet, est un mode d'anticipation sur l'espace et le temps et une conduite créative la seule reconnue et légitimée s'imposant dans les pratiques sociales des sociétés modernes.Le paysage s'inscrit dans une série d'activités à projet caractérisant ces sociétés et touchant à l'aménagement spatial. Cette activité implique des acteurs, une création, une réalité spatio-temporelle, un groupe social qui s'interfèrent par une démarche projectuelle de concertation. Cette dernière traduit le processus d'élaboration du projet de paysage qui aboutirait à une "mise en paysage" à laquelle "tout le corps social peut adhérer" dans des conditions d'appropriation et d'identification collectives. "Le paysage
concourt à la définition des identités collectives".Le présent travail cherche à élucider les mécanismes du processus d'élaboration du projet de paysage et à définir sonconcept afin de répondre à sa problématique principale à savoir:Quelle est la contribution du parc de la Méditerranée (dit Z4) à Tunis dans la construction d'un paysage urbain tunisoi?(et par quel processus?) Et dans quelle mesure cette "mise enpaysage" adhère-t-elle aux attentes du corps social? Ou défini-t-elle une nouvelle identité?Le paysage étant considéré "comme projection, c'est-à-dire construction sociale et culturelle d'un lieu-dit" quelle projection constituerait le parc de la Méditerranée? Et par quel parcours?En effet, le parcours d'un projet de paysage est de nature complexe puisqu'il passe d'un projet paysagiste à un projet de paysagiste pour arriver à une expression formelle d'un lieu qui "n'est pas le paysage, mais ce qui permet d'y accéder, de le voir, de le pratiquer", puisque, "pour autant,l'expression formelle de l'interlieu (du lieu) ne semble pas suffire à faire paysage."[vi]Le projet du parc de la Méditerranée a-t-il observé une "mutation" entre la décision de sa création, sa conception etson utilisation ou son appropriation? Quel est le processus d'accomplissement de ce projet? Comment peut-on parler d'une mise en paysage de cet espace?
14 h 30 : Besma LOUKIL : « La face cachée de la politique de création et de gestion des parcs publics en Tunisie ». Nous disposons d’une politique de création de parcs et jardins publics depuis la création du Ministère de l’environnement (1991) en Tunisie. Cependant, cette politiqueest sujette à plusieurs critiques : une inégalité flagrante de répartition géographique des parcs ainsi que des moyens deleur gestion.Un travail d’entretien avec les différents acteurs publics montre une prédominance de l'Etat comme acteur fondateur et précurseur d'espaces ouverts de types parcs et jardins. Mais parallèlement, il montre le revers de la médaille environnementale qui ne se limite pas réellement à des enjeuxsociaux, elle donne à voir des intérêts économiques et fonciers dont bénéficient les dignitaires et les proches de l’ancien régime.
14 h 50 : Débat
15 h 20 : Pause
15 h 50 : Autour du paysage, table ronde animée par CatherineCHOMARAT-RUIZ
17 h 00 : Débats
17 h 30 : Synthèse et clôture du colloque
Posters
Les posters seront exposés dès le début du colloque et serontprésentés par leurs auteurs durant les pauses.
Maha BOUJLIDA : « Nouvelle réflexion sur le périurbain tunisois : le cas de Jedeida ». Le monde est entré depuis quelques décennies dans une nouvelle étape de l’histoire urbaine qui entrain de configurer le territoire-monde, c’est la métropolisation.Notre pays n’échappe pas à ce phénomène, sa capitale Tunis est en pleine phase de la métropolisation. Ce processus entraîne une redéfinition des espaces périurbains des grandesvilles. Dans ce contexte, la zone ouest du Grand Tunis et précisément la ville de Jedeida n’échappent pas à ce phénomène. Ceci se traduit par une dynamique spatiale qui donne la naissance de nouvelles formes d’habitat, d’équipements et de fonctions. Cette nouvelle vocation spatiale se fait essentiellement aux dépens des espaces naturels-agricoles de la zone. De ce fait, les répercussions de cette territorialisation sont de grandes ampleurs.Donc, quelles sont les caractéristiques de la métropolisationà Jedeiada ?Quels sont ses impacts sur le paysage naturel-agricole de la zone ?Et comme la Tunisie s’est intéressée, depuis quelques décennies, de l’approche environnementale, la question qui sepose est : est-il possible d’avoir une nouvelle réflexion surle périurbain tunisois, notamment Jedeida, dans le cadre d’undéveloppement durable en assurant l’équité territoriale entre« terre-sol » ? Si oui, comment ?
Zouhaier KHMAIS : « Repenser le développement des quartiers périurbains des villes de l’intérieur de la Tunisie, pour unemeilleure gestion économique et environnementale équitable des territoires urbains : Le cas des quartiers populaires de la ville de Siliana : entre marginalité et intégration urbaines ». Depuis plusieurs décennies le développement et l’aménagement du territoire tunisien sont une question qui revient de manière récurrente dans les débats notamment dans les milieuxuniversitaires de par les déséquilibres sociaux et régionaux qui persistent malgré les efforts présumés.Il est vrai que la littoralisation du développement est une constante en Tunisie, mais ce n’est pas un phénomène très ancré dans l’histoire tunisienne ; autrement comment expliquer l’existence des villes romaines de Dougga de Télepte, de Tuburbo Majus, de Tysdrus, et d’autres villes de l’intérieur du pays ? La littérature historique et géographique est riche en ce sens. Mis à part les éléments naturels qui représentent de réels facteurs plutôt logiques mais non incontournables de l’inégal développement régional en Tunisie et ailleurs, d’autres facteurs sont à considérer. Il s’agit des choix de développement économique et social, dela politique des Etats. Ainsi la colonisation française a-t-elle inauguré en Tunisie ce phénomène en établissant la division du pays en zones littorales portuaires
exportatrices, munies de toutes les infrastructures et équipements, et dans lesquelles se sont installées les communautés européennes, et des zones intérieures pourvoyeuses de produits agricoles et de matières premières.Avec l’indépendance, la littoralisation du développement s’est poursuivie avec néanmoins un essai de renversement spatial des choix des bases de développement socioéconomique en tirant ces derniers vers l’intérieur avec la création de l’industrie de l’alpha de Kasserine et celle du sucre de Béja, ce au cours de la décade des années 1960 sous le modèlede développement socialisant de Ben Salah. Après l’avortementde cette expérience en 1969 et l’avènement du libéralisme économique de Nouira des années 1970, c’est de nouveau le retour vers l’inégal développement régional à outrance entre un littoral gorgé d’investissements et un intérieur qui s’estprogressivement paupérisé malgré les encouragements à l’investissement institués en faveur des gouvernorats de l’intérieur et qui se sont avérés inefficaces. Avec la mondialisation imposée depuis le début des années 1990, les choix de l’État tunisien se sont fixés du côté de la « vitrine du pays » : Le Nord-Est et notamment Tunis, le littoral Est du Cap-Bon et le Sahel. Le reste du pays, autrement dit l’« arrière-pays », fut délaissé, « lâché », ilest mis hors circuit dans le système économique national, il doit se suffire à lui-même, c’est le cas de Siliana dont tousles chiffres ont montré non seulement son retard mais son recul, ce qui est plus grave.Cette situation de crise de sous-investissement que connaîssent des villes de l’intérieur tunisien, comme Silianapar exemple, depuis au moins cinq décennies, a paupérisé la ville comme le reste des villes de l’intérieur du pays, la ville « privée » de l’entreprenariat, elle a ainsi bloqué sonambition à devenir capitale régionale ou centre urbain de niveau régional, et enfin elle l’a ouverte largement aux activités parallèles dans un fonctionnement illégal et anarchique. Tous ces ingrédients expliquent la ruée des couches sociales démunies du milieu rural des gouvernorats limitrophes et même, parfois, lointains : Sidi Bouzid, Kasserine, Kairouan, El-Kef et d’autres, vers une ville appauvrie et devenue par conséquent suffisamment accessible aux catégories sociales déshéritées.Les villes sont certes ouvertes, et les flux migratoires entrants représentent en fait une richesse démographique, économique et culturelle pour ces villes, mais lorsque ces dernières ne sont pas préparées de point de vue urbain à ces flux et surtout à leur volume, comme c’est le cas de Siliana et de ses quartiers périphériques, des problèmes vont se poser : la sous-intégration de ces quartiers d’exode à la ville, le déséquilibre du fonctionnement urbain entre un centre compact riche et une périphérie très lâche occupée surtout par les pauvres et dans laquelle l’urbanité est absente, la désolation et l’anarchie du paysage urbain, la ruralisation de l’espace urbain, l’étalement non maîtrisé, l’encombrement de couches socialement et économiquement pauvres, etc…Ces déséquilibres sociaux et régionaux sont aujourd’hui deux des causes principales de la récente révolution de Tunisie. Aussi, la question de la politique sociale et économique du gouvernement qui émergera de ce mouvement est essentielle à
étudier, et pour atténuer ces déséquilibres de la Tunisie, une politique de redistribution s’impose. Il importe donc d’apporter quelques éléments d’analyse sur la façon dont les hommes politiques, les sociologues, les géographes et les autres chercheurs en sciences humaines et sociales repensent le futur territoire tunisien, et de recenser les actions sociales « spatialisées » ou « territorialisées » qu’il faudrait mener.Cette injustice spatiale entre les différentes régions de la Tunisie, mais aussi entre les différents espaces urbains, s’est vue fortement exacerbée durant le dernier quart du siècle. L’« arrière-pays » paupérisé, mal-desservi et sous-équipé n’a jamais suscité l’intérêt des acteurs privés mercantiles ni de ceux d’un secteur public tantôt insoucieux et tantôt complice (déclassement de sites protégés, révision des Plans d’Aménagement Urbain pour des objectifs inavouables, etc.). La gestion du territoire fut ainsi placéesous tutelle privée, la notion d’équité territoriale, garantede la cohésion sociale à l’échelle nationale, ne fut plus respectée et la politique de décentralisation fut sans cesse reportée.Voilà que la révolution de la dignité -faisant de la Tunisie un pays qui « s’éclate » au-delà de ses frontières- portée par les habitants de Sidi-Bouzid, de Kasserine, de Thala, de Makthar et de bien d’autres villes isolées de cet « arrière-pays » dénigré, vient ruiner les ambitions cachées des grandsprojets de cette tutelle privée. Et voilà que les Tunisiens se « ré-approprient » enfin leur territoire ! Pourtant, aujourd’hui, les mouvements d’esprit libre naissant de la révolution semblent à leur tour ignorer les questions de gestion du territoire et de son aménagement. Mais, « la fracture territoriale qui a marginalisé l’arrière-pays tunisien concerne également la majeure partie des extensions périurbaines. Si certaines banlieues (dans le cas des grandesvilles tunisiennes) ont vu se concentrer des investissements lourds en matière de commerce, d’industrie ou d’habitat, la plupart d’entre elles (et surtout celles des petites villes et villes moyennes de l’intérieur tunisien) ont été condamnées à une paupérisation qui s’aggravait régulièrement à mesure que les populations fuyant l’arrière-pays s’entassaient dans les seules banlieues où l’habitat leur était accessible ».Dans la mesure où il s’agit d’une question très large, on se contentera, au cours de notre intervention, d’une propositionsur la façon de repenser les territoires périurbains de la ville de Siliana (et ses quartiers populaires périphériques) faisant l’exemple des villes intérieures de la Tunisie, tout en essayant une meilleure compréhension de la problématique du développement régional en Tunisie permettent de rechercherde nouvelles alternatives pour une meilleure équité économique et environnementale. Nous essayerons, donc, au cours de cette intervention de développer une question qui sepose en ce qui concerne le cas de Siliana, et qui est la suivante : « En quoi cette ville est-elle un « exemple » utile dans l’arrière-pays tunisien ? »Lieux de bouleversements et d’antagonismes sociaux, politiques et culturels, par excellence, les espaces périurbains continuent d’être considérés comme un véritable laboratoire pour étudier les effets pervers de ces
transmutations qui permettent de renouveler continuellement le discours sociologique, géographique, économique et politique autour de la façon selon laquelle il faut mener desétudes sur l’espace périurbain.
Hassen NSIRI : « Processus et formes de l’extension urbaine de Sidi Bouzid-ville (Centre-ouest tunisien) ». Le travail proposé s’insère dans la problématique générale duphénomène urbain dans les villes moyennes tunisiennes. A partir de l’étude de l’exemple de la ville de Sidi Bouzid dans les hautes steppes du centre-ouest tunisien (43.000 habitants en 2009), notre objectif est d’étudier le fait urbain en rapport avec l’assiette foncière, et en particulierles dysfonctionnements liés à l’absence de périmètres d’intervention foncière, à l’opacité du marché foncier urbainet aux particularités des régimes de propriétés foncières, aggravés par le site de la ville et sa topographie, qui imposent beaucoup de contraintes quant à la localisation des zones d’extension urbaine.Cependant, la ville est marquée par deux phénomènes majeurs: le premier représenté par la partie Ouest, où s’étend une zone aménagée dotée d’un habitat légal, le second représenté par la partie Est, caractérisée par le manque de contrôle et d’infrastructure et où s’installe un habitat clandestin et illégal.
Youssra REGAYA : « Le paysage composante de performance territoriale : Cas de la ville de Souassi ». Ce travail traite les espaces extérieurs de la ville de Souassi en essayant de réconcilier entre les enjeux et les conflits d’usage et de voisinage de ces espaces en mutation. Cette ville ambitionne de trouver le meilleur compromis entreles aménagements des espaces extérieurs et les potentialités paysagères de la région. Parmi les problèmes majeurs contemporains de la planification urbaine c’est le manque d’analyse intégrée et systémique des zones émergentes.En effet, les transformations des milieux constituent une source d’altération de la diversité et de la richesse du patrimoine naturel. En travaillant précisément dans une approche transversale, par le paysage, dans laquelle se rejoigne le matériel, le symbolique, le culturel et la durabilité des lieux que l’on peut mieux progresser dans l’analyse des milieux et de l’environnement. La ville de Souassi est un site démonstratif, en effet cette recherche a démontré l’existence de sites naturels d’une grande valeur paysagère (qui peuvent être un centre d’intérêt pour l’aménagement d’un circuit éco touristique dans le cadre d’untourisme vert), ainsi qu’une notoire richesse de la flore adaptée à un écosystème fragile. Les résultats de cette recherche ont mis en évidence notamment : la richesse de la zone aux niveaux des capacités patrimoniales de la flore et des ressources naturelles, la richesse des potentialités paysagères et la cohérence entre les potentialités patrimoniales et paysagères par la création d’un cadre de viequi ambitionne une performance territoriale en extension. L’ensemble constitue une approche d’investigation pour traiter dans une logique intégrée le paysage d’une ville émergente en rapport avec ces potentialités naturelles et
socio-économiques.
Samedi 19 novembre 2011
Sortie de terrain dans la région de Sidi Bou Zid / Kasserine.
Organisée avec la collaboration de :
L'Association de Citoyenneté et Culture Numérique ("ACCUN") àMenzel Bouzaiene L'association "Horizon - Coopération sociale anti-chômage", àSidi-Bouzid L'association "Appel de la Terre" à Maknassy
7 h 00 : départ de Tunis
8 h 30 : pause café
10 h 30 : arrivée à Sidi Bou Zid
11 h 00 : Accueil au Centre culturel Aboubaker Gammoudi à Sidi-Bouzid VillePrésentation d'un documentaire de 10' sur la région de Sidi Bou Zid
Paroles aux jeunes : les principales problématiques du développement local et régional et les attentes de la population
Débat
13 h 00 : Déjeuner
14 h 30 : Tournée dans la zone périurbaine
17 h 30 : Retour à Tunis
PRESENTATION GENERALE
Ce colloque propose de rassembler les chercheurs de tous horizons disciplinaires qui travaillent sur des questions touchant à l’aménagement du territoire et qui se sentent concernés par l’avenir de la Tunisie.
Les revendications de la société tunisienne qui s’expriment depuis décembre 2010 revêtent en effet une dimension spatialequi n’aura pas échappé à ces chercheurs et qui appelle aujourd’hui des réponses adaptées. Celles-ci concernent aussibien les déséquilibres régionaux mis en lumière par le rôle majeur qu’ont joué les régions défavorisées du pays, que l’apogée du mouvement qui s’est déroulée dans l’espace publictunisois. Entre ces deux échelles territoriales, elles
concernent aussi la relation entre les habitants et les espaces naturels protégés, ainsi que le déséquilibre entre des centres urbains correctement équipés et aménagés et certaines périphéries paupérisées.
Le colloque s’organise donc selon quatre axes :
Axe 1 : Replacer l'arrière-pays dans un projet de territoire national
Axe 2 : Elaborer une politique environnementale partagée par les habitants
Axe 3 : Repenser les territoires périurbains pour une meilleure équité économique et environnementale
Axe 4 : Accompagner l'éveil de l'espace public tunisien
Colloque organisé par :- La Fédération tunisienne des Clubs UNESCO-ALECSO, Club « Savoir et développement durable » (FTCUA-SDD, Tunis)- Le Laboratoire de recherches de l’Ecole nationale supérieure du paysage (LAREP, ENSP, Versailles)- L’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU, Sidi-Bou-Saïd)- L’Institut supérieur des technologies de l’environnement, de l’urbanisme et du bâtiment (ISTEUB, Université de Carthage)Avec le concours de l’Institut français de coopération (IFC –Tunisie)
Comité d’organisation :Moez Bouraoui (ISTEUB), Roland Vidal (LAREP-ENSP), Boubaker Houman (FTCUA-SDD), Catherine Chomarat-Ruiz (LAREP-ENSP), Taoufik Baya (CUA-SDD), Olfa Ben Medien (ISTEUB), Yassine Marzougui (CUA-SDD), Yassine Turki (ISTEUB), Imène Zhioua (ISTEUB)
Comité scientifique :Saïd Almi, Taoufik Belhareth, Moez Bouraoui, Ridha Boukraa, Morched Chabbi, Catherine Chomarat-Ruiz, Pierre Donadieu, Boubaker Houman, Jean-Marie Miossec, Walid Oueslati, Daniel Pinson, Pierre Signoles, André Torre, Yassine Turki, Roland Vidal
Colloque « Construire l’équité territorialede la Tunisie »
Tunis, 17-19 novembre 2011
Présentation
Nul n’en doute aujourd’hui, l’année 2011 marquera une étape majeure dans l’histoire de la Tunisie. Ce que seront ses conséquences sur le reste du monde reste une inconnue, mais ce qui est certain, c’est que la manière dont la Tunisie
évoluera dans les mois et les années qui viennent aura des répercussions qui s’étendront bien au-delà de ses frontières.L’enjeu de cette évolution est donc, lui aussi, majeur, et les chercheurs de tous horizons ne peuvent rester en marge dece qui se construit aujourd’hui.
Entre le nécessaire recul dont ont besoin les professionnels de la recherche pour analyser sereinement les phénomènes de sociétés qui s’enchaînent aujourd’hui à un rythme effréné, etl’urgence dans laquelle ils se trouvent de prouver leur aptitude à être réactif et à contribuer à répondre aux attentes d’une société en ébullition, des postures intermédiaires sont possibles. Elles peuvent s’appuyer sur cette levée aussi soudaine que radicale d’une censure qui lesfrappait eux aussi et les contraignait à laisser dans l’ombreune bonne partie de leurs travaux. La dernière Lettre de l’IRMC en témoigne : qu’ils soient urbanistes, sociologues, historiens, géographes, politologues ou économistes, et sans doute de bien d’autres disciplines encore, les chercheurssont nombreux à vouloir profiter de « cette belle libération de la parole que vit actuellement la société tunisienne ».
L’objectif de ce colloque n’est pas d’inviter la totalité deschercheurs concernés par la Révolution tunisienne, ce serait une ambition démesurée. Mais il est de rassembler tous ceux qui, quel que soit leur champ disciplinaire, ont une compétence à apporter en matière d’aménagement du territoire.Car pour répondre aux aspirations légitimes du peuple tunisien, les pouvoirs publics devront se doter des institutions qui permettront la formation des figures professionnelles dont la Tunisie va avoir besoin. Au-delà de la publication des actes, moment important de la valorisationd’un colloque, celui-ci voudrait surtout aboutir à un état des lieux des réflexions qui serviront à nourrir cette futureformation.
Les communications attendues ne sont pas tenues de s’inscriredans un cadre disciplinaire prédéfini, mais elles devront contribuer à cette réflexion et s’inscrire dans l’un des axesdécrit cidessous.
Axe 1 : Replacer l'arrière-pays dans un projet de territoire national
Longtemps axées sur les grands centres urbains de la bande littorale, les politiques publiques d’aménagement et de gestion ont généré des ségrégations socio-spatiales manifestes entre ceuxci et l’arrière-pays. Cette ségrégation a engendré une iniquité territoriale fortement ressentie par la population de ces territoires paupérisés, mal desservis etsous-équipés. Et ce sont bien les habitants de Sidi-Bouzid, de Kasserine, de Thala, de Makthar et de biend’autres villes de cet arrière-pays qui ont porté la Révolution tunisienne et remis en cause les stratégies de gestion et les modes de gouvernance du territoire national. L’urgence d’une véritable politique d’aménagement du territoire, participative et équitable, s’impose donc
aujourd’hui commeun objectif incontournable. Quel choix politique en matière d’aménagement du territoire faut-il adopter pour atténuer le déséquilibre régional ? La décentralisation, ou plus généralement les politiques « régionalistes », sont-elles de nature à résoudre ce problème ou risquent-elles, au contraire, d’aboutir à un isolement économique encore plus grand des régions défavorisées ? Quels scénarios d’aménagement peut-on imaginer pour répondre durablement aux aspirations des sociétés locales ? A quelle échelle doivent être pensés ces scénarios, entre les infrastructures de transport susceptibles de désenclaver ces lieux de vie marginalisés, et l’amélioration du cadre de vie susceptible d’en améliorer l’attractivité ?
Axe 2 : Elaborer une politique environnementale partagée par les habitants
Depuis 1991, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable représente l’institution publique chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière de protection de l’environnement, de sauvegarde des espaces naturels et de valorisation du paysage urbain et périurbain. Il a multiplié pour cela les outils d’intervention et les programmes d’actions, notamment dans les domaines de la promotion de l’esthétique urbaine et de laprotection des espaces naturels avec, entre autres, la création d’une vingtaine de parcs urbains, la promulgation denouveaux parcs nationaux et l’accroissement du nombre des réserves naturelles. Pourtant, l’analyse de la situation actuelle montre que ces initiatives et actions n’ont pas atteint les objectifs escomptés et tout particulièrement sur le plan social. La très faible fréquentation des parcs urbains et la privatisation de certains d’entre eux, le changement de vocation de certains sites naturels protégés, la dégradation de certains parcs nationaux et réserves naturelles perpétrée par les habitants voisins pendant la période de trouble post-révolutionnaire en sont les indicateurs les plus évidents.Comment intégrer les populations riveraines des espaces naturels dans la dynamique de leur protection et de leur gestion, afin qu’elles ne se sentent pas dépossédées d’un territoire qu’elles considèrent comme le leur ? Quels modes de compensation équitables envisager pour tous ceux qui, comme les agriculteurs,les éleveurs ou les bergers, sont gênés dans leur fonctionnement économique par les limitations d’accès qui s’avèrent nécessaires, notamment dans les réserves naturelles? Dans quelle mesure les modèles européens, comme les parcs naturels régionaux en France ou en Allemagne, pourraient-ils représenter une expérience utile à la Tunisie ? L’écotourismequi se développe depuis quelques années représente-t-il une solution d’avenir, ou risque-t-il d’aggraver encore le sentiment de dépossession s’il s’affirme trop comme un tourisme de luxe ?
Axe 3 : Repenser les territoires périurbains pour une
meilleure équité économique et environnementale
La fracture territoriale qui a marginalisé l’arrière-pays tunisien concerne également la majeure partie des extensions périurbaines. Si certaines banlieues ont vu se concentrer desinvestissements lourds en matière de commerce, d’industrie oud’habitat, la plupart d’entre elles ont été condamnées à une paupérisation qui s’aggravait régulièrement à mesure que les populations fuyant l’arrière-pays s’entassaient dans les seules banlieues où l’habitat leur était accessible. Essentiellement guidé par des perspectives de plus-value qui profitaient aux tenants du pouvoir depuis des décennies, l’étalement de ces villes, et tout particulièrement celui du Grand Tunis, s’est fait sans véritable réflexion sur ce que pourrait être un développement urbain durable et profitable àl’ensemble de la population. Les espaces publics, et notamment les espaces verts, étaient réservés aux quartiers résidentiels luxueux. Ceux des quartiers défavorisés, rares et bénéficiant de peu d’investissement, étaient le plus souvent conçus et réalisés en dépit des réels besoins des habitants. Dans le même temps, les espaces agricoles périurbains qui avaient durant des siècles approvisionné les villes, subissaient sans pouvoir y résister des pressions foncières qui les condamnaient, à terme, à disparaître faute d’une réelle politique de cohérence territoriale. Libérées des intérêts financiers largement privatisés qui dominaient les politiques publiques, les villes tunisiennes pourront-elles enfin bénéficier d’une planification territoriale capable d’organiser l’étalement urbain dans l’intérêt de toutes les populations ?Quelles orientations politiques en matière de transports, d’équipement ou d’espaces publics, pourraient contribuer à inverser la tendance en réduisant la fracture territoriale aulieu de l’aggraver comme elles l’ont fait jusqu’à présent ? Dans un contexte où le prix des denrées alimentaires reste une préoccupation majeure pour les populations défavorisées, quel rôle pourrait jouer une agriculture de proximité qui occupe encore, en Tunisie, une place importante dans l’économie agro-alimentaire locale ?Pour répondre aux besoins des habitants en termes de cadre devie, quelles places respectives devront occuper les espaces verts gérés par les services municipaux et cette agriculture périurbaine économiquement autonome et qui pourrait constituer aussi une composante paysagère pourvoyeuse d’aménités sociales et de qualité environnementale ?
Axe 4 : Accompagner l'éveil de l'espace public tunisien
Toutes les télévisions du monde l’ont montré, la phase déterminante de la Révolution tunisienne s’est déroulée sur le plus connu des espaces publics de Tunis : l’avenue Habib Bourguiba. De fait, c’est toujours dans l’espace public que se déroulent les révolutions. Pourtant, ces espaces d’inspiration haussmannienne dont l’avenue Bourguiba fait partie –comme la place Tahrir au Caire ou, en d’autres temps,le Boulevard Saint-Michel à Paris–, n’ont pas été conçus pourcela, mais au contraire dans l’idée de mieux contrôler les mouvements de foule. Ce retournement de situation qui a vu
l'appropriation par la population d’un espace dont elle se sentait exclue est aussi la manifestation d’un changement radical des relations entre les habitants et leur lieu de vie. Libérée d’une surveillance policière qui la rendait inapte à toute véritable vie sociale, l’avenue Bourguiba est sortie de sa fonction d’espace de représentation du pouvoir pour devenir enfin l’espace des Tunisiens. Dans le même temps, ce sont tous les quartiers de Tunis et des autres villes tunisiennes qui ont vu les habitants s’organiser dans l’urgence avec une efficacité remarquable, marquant là aussi un phénomène d’appropriation des espaces extérieurs qui traduitl’« éveil » de cet espace public dont les Tunisiens étaient jusqu’ici privés.Cette dimension spatiale de la Révolution, particulièrement visible dans l’espace urbain, sera-t-elle de nature à changeren profondeur la manière dont les Tunisiens vivent leur territoire ? L’espace public moderne, que l’on a longtemps considéré comme culturellement éloigné des villes arabo-musulmanes, est-il en train de s’inventer une forme spécifique ou reprend-il simplement les modèles connus dans les villes européennes ?La Tunisie, et plus particulièrement la principale avenue de sa capitale, sont-elle en train de démontrer que l’existence d’un espace public passe nécessairement par la liberté de l’expression publique ?Quelles conclusions devront en tirer ceux qui auront en charge la conception et l’aménagement des futurs espaces publics tunisiens, entre l’inspiration que pourront fournir les modèles internationaux et la nécessaire invention de nouveaux modèles adaptés aux aspirations profondes de la population ?
Les objectifs du colloque
Deux principales raisons expliquent les problèmes qu’ont posés jusqu’ici les questions d’aménagement du territoire en Tunisie. La première émane de l’exclusion de la société locale dans les grandes décisions politiques, la seconde, structurellement plus préoccupante, est liée à l’absence quasi-totale d’un corps de métier spécifiquement formé à l’étude et la résolution de ce type de question.Initier ou appliquer une politique territoriale tunisienne durable devra passer désormais par la production de compétences professionnelles appropriées autant que par une approche consensuelle à laquelle les populations locales devront participer, et à laquelle ces professionnels devront être initiés.Il s’agira de penser la mise en place d’une formation professionnelle spécialisée dans le domaine de l’aménagement du territoire et du cadre de vie. Une formation au paysage, tel que celui-ci est défini par la Convention de Florence, ettel qu’il est enseigné aujourd’hui dans la plupart des écolesqui en portent le nom. Une formation qui, sans en nier l’importance historique, dépasse la dimension de l’art des jardins pour traiter de l’aménagement de tous les territoires, des sites d’exceptions aux lieux de vie ordinaires et quotidiens.
Une formation qui contribue à répondre à la dimension spatiale des aspirations de la société tunisienne ; qui contribue à construire l’équité territoriale de la Tunisie. Une formation qui, pour assurer sa pertinence et sa durabilité, devra s’appuyer sur une articulation efficace entre la recherche et l’enseignement, entre les approches scientifiques et les savoir-faire professionnels.Ce sont là toutes les ambitions de ce colloque : rassembler les approches des chercheurs de tous horizons disciplinaires concernés par l’aménagement du territoire, pour préfigurer lesocle sur lequel s’appuiera ce qui devra se transformer, à terme, en programme pédagogique.
Ces documents, ou les liens qui y conduisent, sont accessibles en ligne sur le site du colloque(tuniscape.org)
© 2011 Archi Mag. All Rights Reserved
La décentralisation est une nécessité démocratique
Ezzeddine Ben Hamida * écrit – Selon «le principe de subsidiarité» des pouvoirs, ce qui est national revient à l’Etat, ce qui est régional à la région et ce qui est communal à la commune.
Janvier 2012
La Tunisie, sous la présidence de Bourguiba ou la triste parenthèse du déchu, est unexemple type de système politique et administratif centralisé. Le Gouverneur – représentant de l’Etat dans les gouvernorats –, qui est censé tempérer cette centralisation et concentration, servant de courroie de transmission entre l’échelonlocal et le pouvoir central n’est qu’un haut fonctionnaire aux ordres directs de sonsupérieur hiérarchique, à savoir le ministre de l’Intérieur. Ses prérogatives sont non seulement extrêmement limitées mais surtout sans cesse contrôlées et vérifiées. Autant dire, il s’agit d’un poste honorifique vide de toute substance de pouvoir et d’initiative. Encore faut-il que les personnes nommées dans ces postes soient toutesqualifiées pour mener à bien les tâches qui incombent à une telle charge d’Etat !
Le national, le régional et le municipal
Si la déconcentration s’analyse comme étant le transfert de certaines attributions administratives du pouvoir central au plan local, au bénéfice d’un agent de l’Etat, la décentralisation s’analyse comme étant la délégation de certaines attributions administratives du pouvoir central au plan local, au bénéfice d’agents élus par les citoyens.
C’est pourquoi la décentralisation est souvent considérée comme une forme active de la démocratie locale, à titre d’exemple en Tunisie : les élus municipaux, qui sont un peu plus de 3.400 élus pour 264 municipalités, par leur proximité quotidienne avec leurs électeurs sont censés représenter – s’ils étaient élus dans des conditions démocratiques – cette forme active de la démocratie locale.
Pour affermir cette forme de démocratie et renforcer ainsi les liens des citoyens, donc des administrés, avec leurs administrations, particulièrement pendant cette période d’euphorie de la révolution et d’effervescence populaire qui représente une extraordinaire opportunité politique, il conviendrait de développer davantage la décentralisation de certaines attributions et la déconcentration de certaines prérogatives pour limiter un peu l’omnipotence de Tunis. Pour paraphraser le titre de l’ouvrage de Jean-François Gravier, une véritable plaidoirie pour la décentralisation : ‘‘Paris et le Désert français’’, je dirai ‘‘Tunis et le Désert tunisien’’.
La création des entités régionales permet non seulement de lutter contre les dysfonctionnements bureaucratiques et la lourdeur administrative mais surtout elle permet le développement des complémentarités et l’émergence des synergies inter et intra-région.
Ainsi, la régionalisation permet une meilleure efficacité (efficience) des différentes institutions et organisations publiques dans l’exercice de leur fonction(leur pouvoir), ce que les spécialistes appellent «le principe de subsidiarité»: ce
qui est national à l’Etat, ce qui régional à la région, ce qui est communal à la commune, en l’occurrence à la municipalité.
Sans rentrer dans les aspects techniques et juridiques – il faudra une loi organiquepour en définir les contours et au minimum 5 ans d’étude et de préparation – de la décentralisation et de la déconcentration, qui sont extrêmement complexes, quelques illustrations s’imposent pour aider le lecteur à mieux appréhender les difficultés des différents niveaux d’exercice du pouvoir dans un cadre décentralisé:
On peut imaginer en Tunisie la création d’un pouvoir régional qui serait entre le pouvoir central d’Etat et le pouvoir local municipal. Ce pouvoir serait doté d’une autonomie dans certains nombres de domaines (transport, santé, urbanisation, structures des établissements scolaires, etc.) grâce à un transfert des compétences du pouvoir central à ce nouveau pouvoir. En clair, l’Etat se déchargerait, se désengagerait, de certains domaines au profit des régions, nouvellement créées, touten allouant les enveloppes budgétaires nécessaires pour le bon fonctionnement des institutions.
Il faudra donc la refonte totale du système fiscal tunisien ainsi que la création d’une caisse de compensation pour assurer l’égalité entre toutes les régions. Nous verrons plus loin les dangers qui pourraient peser, particulièrement la corruption,voire même parfois sur l’unité du pays:
Exemple de décentralisation dans l’emploi:
Pouvoir de l’Etat: - schéma national de la formation professionnelle;
- schéma national de la formation du supérieur;
- accompagner les mutations économique;
- création des emplois dans la fonction publique d’Etat.
Pouvoir de la région:
- création des activités par le soutien à la création et à l’implantation d’entreprises et au développement des PME (infrastructure d’accueil, garanties bancaires, exportation, innovation…);
- favoriser l’insertion professionnelle des personnes privées d’emploi;
- accompagner les mutations économiques en développant des formations qui soient en adéquation avec les besoins du tissu économique de la région;
- soutenir les secteurs les plus stratégiques de l’économie.
Pouvoir des municipalités:
- création des emplois d’utilité sociale : sport, insertion, développement du territoire.
Exemple de décentralisation dans la santé :
Pouvoir de l’Etat:
- schéma national d’organisation sanitaire;
- système de la sécurité sociale;
- contrôle et surveillance des établissements de santé;
- gestion et rémunération des médecins.
Pouvoir de la région:
- programme régional de santé publique;
- participation aux financements d’équipement sanitaire;
- formation des auxiliaires de la santé;
- gestion et rémunération des infermières.
Pouvoir des municipalités:
- création des établissements sociaux ou médico-sociaux;
- contrôle de l’hygiène et de la santé;
- gestion et rémunération du personnel non médical.
Exemple de décentralisation dans l’enseignement:
Pouvoir de l’Etat:
- définition de la politique éducative et du contenu des programmes;
- construction et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur;
- gestion et rémunération du personnel d’enseignement.
Pouvoir de la région:
- construction et fonctionnement des lycées et collèges (transfert du patrimoine);
- gestion et rémunération du personnel non enseignant.
Pouvoir des municipalités:
- construction et fonctionnement des écoles;
- gestion et rémunération du personnel non enseignant.
Ces exemples sont conçus, en partie, sur le modèle de la décentralisation française;à nous Tunisiens de savoir nous en inspirer pour créer notre propre modèle qui réponde – qui soit en adéquation – à nos critères socioculturels, socioéconomiques et sociopolitiques et à nos caractéristiques géographiques.
Multiplier les niveaux de pouvoir
On peut imaginer de nombreux regroupements possibles de gouvernorats autour de grandes régions. A titre d’exemples: Grand Tunis regroupant: Ariana, Ben Arous, La Manouba et Tunis (2.314.400 habitants), Médenine et Tatouine (1/3 de la superficie de la Tunisie avec 584.200 habitants), ou encore Kasserine, Le Kef et Siliana (910.800 habitants, une très belle région particulièrement connue par la fertilité de ses terres et ses productions agricoles), Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax
(1.832.200 habitants), Mahdia, Monastir, Nabeul, Sousse et Zaghouan (2.307.400 habitants) ainsi que Béja, Bizerte et Jendouba (1.255.600 habitants) et pour finir Gabes, Gafsa, Kébili et Tozeur (921.500 habitants).
L’essentiel est que la constitution des ces régions doit prendre en compte certains paramètres: continuité territoriale, accès, dans la mesure du possible, de toutes les régions à la mer (il s’agit d’une symbolique géopolitique impliquant une cohésion territoriale et socioéconomique), complémentarités en termes de dotations factorielles et donc de spécialisations pour mieux faciliter la mobilité des facteurs de production, etc.
Avant de finir cette esquisse de réflexion, pour la rigueur de l’analyse et sans pour autant prétendre à l’exhaustivité, il convient de souligner, tout de même, les dangers qui pèsent sur une décentralisation poussée. Ces dangers peuvent être de deux natures:
1/ La décentralisation peut aboutir au fédéralisme, c’est-à-dire à un certain morcellement juridique et politique. Ce risque est réel pour les très grands pays (Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine et l’Inde, par exemples) avec des régions ou des Etats fédérés très autonomes, dotés d’une géographie très étendue (vaste) et d’importantes différences ethnoculturelles. Pour aller vite, la Tunisie ne court absolument pas le risque de se désagréger – pour nos amis algériens et marocains, lasituation et plus problématique –.
2/ Multiplier les niveaux de pouvoir, c’est prendre le risque de la corruption des élus locaux. L’exemple de la France en la matière ne fait pas d’envieux. Les magistrats français savent que les dérives sont plus souvent locales que nationales.
Les études en France sur cet épineux sujet ont montré que les exécutifs régionaux etlocaux sont beaucoup moins changeants que ceux de l’Etat et par conséquent, l’alternance y est beaucoup moins fréquente. Dès lors, on peut se demander si la décentralisation pourrait se traduire dans notre pays par des dérives que nous avons, hélas, déjà connues très récemment?
* Docteur et Professeur de sciences économiques et sociales, Grenoble, France.


























































































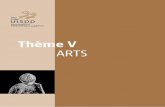





![[Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d5d0bb415a263470afab8/fr-prier-pour-la-revolution-le-role-politique-de-la-priere-dans-le-recit.jpg)










