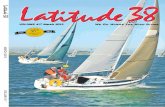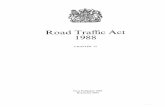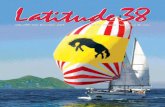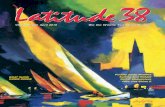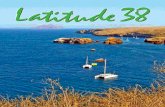« La révolution momifiée », EspacesTemps, n° 38-39, 1988, p. 4-12.
Transcript of « La révolution momifiée », EspacesTemps, n° 38-39, 1988, p. 4-12.
“Entendez-vous dans nos communes ?”
Autour de la signification des pratiques mémorielles :
le Bicentenaire de la Révolution française.
Patrick Garcia
Article publié in EspacesTemps, n°59/60/61, 1995, p. 157-166.
Au cours des vingt dernières années la France a connu un puissant engouement pour la mémoire. Cet
appétit explique le succès local du Bicentenaire de la Révolution en 1989. Pour autant, opérer un tel
constat est insuffisant. Il importe de connaître ce qui s’institue à l’occasion de ces mobilisations du passé
et d’aborder le rôle qu’y jouent les historiens comme l’ensemble des spécialistes des sciences humaines
qu’elles entraînent.
Absente de l’inventaire des chantiers historiens publié en 1971 sous le titre générique Faire de l’histoire1, la
mémoire est devenue, au tournant des années 80, un thème presque obsédant de la recherche historique2.
Les origines de cette passion “mémorielle” dont témoignent tout autant la production historiographique,
que l’activité muséographique, la multiplication des «sons et lumières» ou bien encore les prises de
positions politiques peuvent être en grande partie expliquées. L’avidité contemporaine pour la mémoire se
nourrit de deux attitudes complémentaires. C’est, d’une part, la volonté d’exhumer, de recueillir ou de
préserver les traces d’un passé que le rythme des mutations contemporaines éloigne chaque jour davantage
de nous. C’est, d’autre part, la mise à distance, la déconstruction, des mythes structurants du XIXème
siècle et du premier XXème siècle qui suscite un intérêt nouveau pour l’image, pour la façon dont se
construisent les références d’une société, dont s’élabore le sentiment de faire corps3. Ces deux attitudes ont
en commun d’être les vecteurs d’un deuil, l’indice d’une perte crainte, souhaitée ou simplement
diagnostiquée. Pierre Nora résume cette situation lorsqu’il constate, en introduction des Lieux de mémoire,
“qu’on ne parle tant de mémoire que parce qu’il n’y en a plus. […] Il y a des lieux de mémoire parce qu’il
n’y a plus de milieux de mémoire”4.
1 • Faire de l’histoire, Jacques Le Goff et Pierre Nora (dir.), Paris : Gallimard 1971. 2 L’entrée de l’histoire orale comme source historique reconnue au tournant des années 70 (voir • “La bouche de vérité ? La recherche historique et les sources orales” (dir.) Danièle Voldman, Cahiers de l’IHTP, n° 21, nov. 1992) ; les travaux de • Nathan Wachtel, La mémoire des vaincus, Paris : Gallimard, 1971 ; de • Philippe Joutard, La légende des camisards, Paris : Gallimard, 1985 ou de • Jean Clément Martin, La Vendée de la mémoire (1880-1980), Paris : Seuil, 1989, puis la publication des • Lieux de mémoire sous la direction de Pierre Nora, Paris : Gallimard, 1984-1992, constituent quelques jalons de la montée en puissance du thème de la mémoire au sein de la production historiographique. 3 • Cornélius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris : Le Seuil, 1975. • Bronislaw Baczko, Les imaginaires sociaux, Paris : Payot, 1984. 4 • Pierre Nora, Les lieux de mémoire, Tome 1 « La République »,“Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux”, Paris : Gallimard, 1984, p. XVII.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 2
Si chacun peut s’accorder sur cette analyse de la mobilisation de la mémoire comme symptôme, sinon de
perte, du moins d’une inquiétude face aux changements accélérés qui caractérisent notre époque et qui
affectent les cadres donnés pour les plus immuables5. Le débat, en revanche, est largement ouvert sur le
sens à prêter aux mobilisations mémorielles, sur ce qui s’institue dans ces moments d’évocation du passé.
C’est à ce débat que je souhaiterais apporter une contribution par l’étude des commémorations de la
Révolution française auxquelles le Bicentenaire a donné lieu6.
Pour accéder aux significations plurielles et quelques fois contradictoires de ces pratiques, il convient, en
premier lieu, de ne pas se laisser entièrement captiver par les débats, les polémiques, les projets qui
structurent la scène nationale du Bicentenaire. C’est à cette scène que je m’intéresserais, avant de tenter
d’examiner l’autre commémoration, celle qui a suscité l’enthousiasme du “local”.
Malaises dans la commémoration.
S’il faut caractériser en un mot la façon dont s’est déroulée le Bicentenaire de la Révolution française sur le
plan national, le qualificatif d’embarras s’impose.
Les difficultés à commémorer le Bicentenaire de la Révolution française ont, le plus souvent, été mises au
compte de l’objet commémoré. C’est parce que la Révolution est, à la fois, division et fondation (Régis
Debray7) que l’exercice commémoratif serait aussi délicat
8.
Qu’on me permette, ici, de négliger l’objet lui-même. Certes, la commémoration de la Révolution a
toujours été marquée par des tensions qui tiennent au souvenir et à la réactualisation des luttes politiques
de cette période. De ce fait, la Révolution elle-même n’a jamais été vraiment commémorée. Cette
caractéristique n’a cependant pas empêché le Centenaire de célébrer, dans un couple indissociable, le
progrès et la République, ni le Cent-Cinquantenaire de s’évertuer à promouvoir l’idée d’un consensus
national posé comme d’autant plus impérieux que la nation était confrontée à l’épreuve9.
La configuration du Bicentenaire est toute autre. L’histoire de la Mission du Bicentenaire de la Révolution
française et des Droits de l’Homme et du Citoyen est d’abord celle d’une incertitude sur le contenu du
message commémoratif. Les missions Baroin (1986-1987) et Faure (1987-1988) ont tenté d’esquiver le
problème en proposant une orientation “prospective tournée vers le troisième millénaire, la bio-éthique,
les droits de l’humain” sans pour autant parvenir à donner une dimension concrète à ce discours à
5 Que l’on songe ici à l’incrédulité qu’aurait suscitée, dans les années 80 encore, l’hypothèse d’une subite implosion du bloc socialiste et la disparition pure et simple de l’URSS. 6 Pour un éclairage plus global voir • Patrick Garcia, Les territoires de la commémoration. Une conjoncture de l’identité : le Bicentenaire de la Révolution française (1989), thèse de doctorat, sous la direction de Michel Vovelle, Université Paris I, octobre 1994, dactylographié. 7 • Régis Debray, “Diviser pour rassembler”, EspacesTemps, n° 38-39, 1989, pp. 13-20. 8 Au point que l’un des articles majeurs qui lança le débat autour de la préparation du Bicentenaire s’intitule “Peut-on commémorer la Révolution française ?” (• Mona Ozouf, Le Débat, n° 26, septembre 1983) 9 Pour une analyse comparée des trois commémorations voir • Pascal Ory, Une nation pour mémoire, Paris : Presses FNSP, 1992.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 3
résonance métaphysique
10. Dans ce cadre, l’originalité de la mission Jeanneney, installée aux lendemains de
la réélection de François Mitterrand en 1988, est de rompre de façon très claire avec cette première
orientation pour camper sur l’héritage républicain quitte à transformer le Bicentenaire en “Centenaire–
bis”11
. Mais, comme le montrent les transcriptions des réunions de service qui réunissent les collaborateurs
du Président de la Mission, l’embarras n’est pas moindre12
.
On peut, bien sûr, attribuer ce brouillage à la campagne menée par les adversaires de la commémoration
révolutionnaire ou au contexte de la cohabitation. Il serait, dans cette perspective, l’un des effets de
l’entreprise de discrédit qui frappe l’objet commémoré au travers du thème du “génocide franco-français”,
du rappel de la violence révolutionnaire et des errements de la Révolution face aux normes qu’elle a elle-
même érigées tout autant que celui de la perméabilité des deux premières équipes chargées de
l’organisation du Bicentenaire à ces thèmes. Mais ces données ne peuvent suffire à expliquer, à elles seules,
la difficulté à définir une ligne commémorative. Bien plus que les accusations lancées contre la Révolution
qui, à tout prendre, ne sont guère nouvelles, la contestation, l’attitude dubitative à l’égard du fait
commémoratif sont d’un tout autre poids. Certes, en tant que rituel, la commémoration a toujours été
décriée13
. “On n’empêche pas les siècles d’avoir cent ans” disait Ernest Renan en 188914
. Mais le
scepticisme que manifestent les médias face à la commémoration n’est pas loin, en 1989, de faire
l’unanimité des commentateurs. La commémoration est d’emblée considérée comme un exercice ringard,
du “toc”15
, au mieux une occasion de jouer16
. Cette distanciation ironique affichée par les médias,
largement partagée, n’est pas sans déteindre sur ceux qui ont la charge de préparer le Bicentenaire et qui
redoutent qu’il ne s’inscrive trop en décalage des sensibilités contemporaines. Ainsi, Chritian Dupavillon,
conseiller de Jack Lang, qui a proposé de confier à Jean-Paul Goude le spectacle du 14 juillet, a envisagé
d’appeler les Français à pavoiser mais a dû y renoncer de peur de s’inscrire en porte-à-faux avec l’état des
sensibilités collectives17
. L’attitude des artistes n’est pas moins significative puisque les œuvres majeures
produites à l’occasion du Bicentenaire (La nuit miraculeuse, la Parade-Goude, les œuvres présentées au
10 Voir le texte d’orientation d’Edgar Faure dans La Revue des Deux Mondes en 1987 et les chapitres que Steven Kaplan consacre aux deux premiers présidents de la Mission. • Steven Kaplan, Adieu 89, Paris : Fayard, 1993, pp. 240-294. 11 La publication, dans la presse, par la Mission d’un texte de Victor Hugo “Plus de terres promises que de terrain gagné” (Actes et Paroles, 1875) est très significative de la réorientation imprimée par le nouveau président. La formule de “Centenaire-bis” a été proposée par Odile Rudelle lors d’une des séances du séminaire de l’IHTP consacré au Bicentenaire. 12 Cet embarras est tranché par l’injonction de Jean-Noël Jeanneney qui rappelle les tâches concrètes et met son autorité dans la balance. A ceux qui se plaignent que “la Mission [ressemble] à un panier de perles pour lesquelles il n’y aurait pas de fil”, le président “rappelle, le 20 décembre 1988, les contraintes de temps. Il remarque l’effet somme toute normal de l’accumulation des critiques ainsi que la tonalité d’ensemble de celles-ci. [Il conclut] : cette conversation a été très utile et nourrit une réflexion qui doit aboutir dans les tout prochains jours”. De fait, le débat n’a jamais été réouvert. Réunion de service du 20 décembre 1988, A.N. 900506/103. 13 • Philippe Dujardin, “D’une commémoration l’autre. Un rituel décrié ou la fête profanatrice” in Les usages politiques des fêtes aux XIXe-XXe siècles, Alain Corbin, Noëlle Gérôme et Danielle Tartakowsky (dir.), Paris : Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 399-413. 14 Discours de réception de Jules Clarétie à l’Académie française, 1889. 15 Voir • Cornélius Castoriadis, “L’auto-constituante”, EspacesTemps, n° 38-39, 1989, pp. 51-55. 16 C’est le sens de l’analyse proposée par • William Johnston, Post-modernisme et Bimillénaire, Paris : PUF, 1992. 17 Entretien avec Christian Dupavillon, 11 mars 1992.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 4
concours «Inventer 89» …
18) n’assument guère la dimension nationale de la commémoration et essaient de
trouver une voie de sortie du récit national/révolutionnaire, devenu un véritable carcan. On pourrait ici
objecter l’existence d’un spectacle consacré à Valmy, mais celui-ci traduit, dans sa structure propre et
l’accueil qui lui est fait19
, la difficulté fondamentale à esthétiser la nation. Du côté même de la Mission, un
soin essentiel est mis à se démarquer des commémorations précédentes, accusées rétrospectivement,
d’avoir fait une place trop belle à l’orgueil national20
.
On peut conclure de ces atermoiements, de ces jeux décalés et distanciés que pas plus la nation que la
Révolution ne sont en 1989 des projets capables de susciter l’enthousiasme et de mobiliser les foules.
Les difficultés qui ont marqué la préparation et le déroulement du Bicentenaire méritent-elles de conclure
au relatif échec de la commémoration qui, selon Pierre Nora, ne deviendrait événement qu’au travers du
travail des historiens que la Mission – et son président-historien – se sont d’ailleurs efforcé de lancer21
? Le
Bicentenaire ne serait, dans cette perspective, qu’une pure construction historiographie symbolique de
notre “ère mémorielle”.
Il faut, à cet instant, accorder leur juste place aux deux termes de la contradiction qui définit le champ de
la commémoration du Bicentenaire : les difficultés à promouvoir le Bicentenaire sur la scène nationale et
l’exceptionnelle mobilisation des collectivités territoriales et des réseaux associatifs locaux en faveur de la
commémoration22
.
Il importe, tout d’abord, de ne pas interpréter l’attitude des médias comme le produit d’un quelconque
complot. Leur ironie, que symbolise si bien l’attitude d’Actuel ou de Globe, n’est pas le résultat d’un pacte,
le relais de l’offensive “révisionniste”, que ce soit celle de Pierre Chaunu ou celle de François Furet, elle
est l’expression d’une sensibilité qui, de façon plus ou moins maîtrisée, entend prendre acte du double
épuisement de la Révolution comme matrice de la vie politique française et de la commémoration comme
productrice d’identité nationale. Cela dit, cette première scène qui recouvre l’ensemble du territoire
national ne doit pas dissimuler l’étonnante ruée vers la commémoration de la quasi-totalité des communes
françaises. Analyser le Bicentenaire comme une construction historiographique revient, en définitive, à
18 Faute de pouvoir ici développer cet aspect nous renvoyons à l’article de • Philippe Dujardin “La Marseillaise ou l’invention chimérique de Jean-Paul Goude”, Mots, n° 31, juin 1992, pp. 27-41 et à notre propre article synthétique “Les usages de la commémoration. Un Bicentenaire au cœur des mutations contemporaines”, in • Recherches sur la Révolution française, dir. Michel Vovelle, Paris : La Découverte/IHRF/Société des Études Robespierristes, 1991, pp. 221-233. 19 Voir la communication de Katia Tönnesman lors du colloque organisé par l’IHTP, Paris décembre 1994. 20 Voir les remarques de • Jean-Noël Jeanneney, “Après-coup : réflexions d’un commémorateur”, Le Débat, n° 57, nov-déc 1989, pp. 75-105, et, en contre-point, notre analyse du centenaire : • Patrick Garcia, “Universalisme et raisons d’État. L’État républicain face au Centenaire”, in 1889, Centenaire de la Révolution Française. Réactions et représentations en Europe, dir. Jacques Bariety, Association Internationale d’Histoire Contemporaine, Berne, Peter Lang, 1992, pp. 145-168. 21 “Une vaste équipe est déjà au travail pour ausculter «la France des années quatre-vingt au miroir de la commémoration», et nul doute qu’elle ne finisse par donner, rétrospectivement, [au Bicentenaire] l’épaisseur et la compacité qui lui ont, sur le coup, singulièrement manqué. Curieux destin de ce Bicentenaire dont l’histoire va faire pour l’histoire, l’événement qu’il n’a pas été”. • Pierre Nora, “L’ère de la commémoration”, Les Lieux de mémoire, «Les France», vol. 3, Paris : Gallimard, 1992, pp. 982. 22 Cet aspect, au demeurant, n’échappe pas à l’analyse de Pierre Nora qui évoque au travers des cycles commémoratifs une “recherche généalogique d’individuation” même s’il prend plus en compte cette dimension de l’acte commémoratif pour conduire son analyse du succès de l’année du Patrimoine que pour celle du Bicentenaire de la Révolution française lui-même. • Pierre Nora, “L’ère de la commémoration”, Les Lieux de mémoire, « Les France », vol. 3, op. cit., p. 982 et 996.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 5
faire peu de cas de la plantation de milliers d’arbres de la liberté, des milliers de spectacles en tous genres,
de l’intense production d’une histoire locale.
L’événement a surgi là où on l’attendait pas.
L’impossible mesure.
Avant d’envisager la façon dont la plupart des communes se sont emparées de l’opportunité
commémorative, il convient de lever deux objections.
La première est induite par une tentative de mesure de l’efficacité de la commémoration à produire du lien
social. Elle est notamment développée par Mona Ozouf23
. Elle s’appuie sur deux postulats. D’une part, le
nombre n’est pas mesure de la ferveur. D’autre part, la seule mesure possible de la commémoration est le
renforcement du lien social qui constitue la justification ultime du geste commémoratif. En eux-mêmes
ces deux axiomes, étayés par l’analyse des précédentes commémorations, ne sont guère contestables, à ceci
près qu’un Bicentenaire qui n’aurait suscité aucune mobilisation festive serait depuis longtemps oublié et
que le diagnostic de son échec ne ferait aucun doute. En outre, la mesure du lien social ne peut s’opérer
qu’en fonction d’une définition a priori des formes du lien social et risque d’être captif d’un modèle
historique idéalisé : notre perception de l’efficacité de la troisième République conquérante24
.
La seconde objection consiste, en évoquant l’exemple des deux commémorations précédentes, à
considérer que cette inscription dans le local a toujours été voulue et que l’exceptionnelle mobilisation
locale connue en 1989 n’est que l’écho des lois de décentralisation.
Certes, en 1889, le centenaire lillois est décalé de trois ans pour célébrer la résistance de la ville lors du
siège de 1792. Il est marqué par une grande parade qui représente l’histoire de Lille de ses origines au siège
de 1792, représenté par un char figurant l’église de Saint-Étienne en flammes25
. De même, la circulaire de
Jean Zay en 1939 ainsi que les directives adressées par leur direction aux cercles de la Jeunesse
Communiste insistent sur la nécessité de trouver un ancrage local aux célébrations. Toutefois, il me semble
que l’usage du local est fort différent en ces circonstances. Il s’agit alors, le plus souvent, d’illustrer le grand
récit national. En 1989, le local est, le plus fréquemment, sollicité pour lui-même.
En d’autres termes, ce qui me paraît essentiel dans les commémorations locales du Bicentenaire, c’est le
mode d’appréhension du passé et les bénéfices attendus. C’est cette configuration nouvelle que je vais
tâcher de décrire brièvement.
23 • Mona Ozouf, “Célébrer, savoir et fêter”, Le Débat, n° 57, nov-déc 1989, pp. 17-33 24 Encore faut-il remarquer que la performativité prêtée au Centenaire est largement rétrospective. Elle est essentiellement due à l’échec des boulangistes aux élections générales d’octobre 1889. Pour une appréciation moins téléologique du Centenaire voir • Marc Angenot, 1889, Un état du discours social, Québec : Le Préambule, 1989. 25 Voir • Brigitte Marin et Patrick Garcia, “Lille, Marseille, Toulouse : à chacun sa commémoration” in Politique de la mémoire, dir. Philippe Dujardin, Lyon : PUL, 1993, pp. 71-91.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 6
L’envolée du local.
Tout d’abord, il convient d’insister sur la neutralisation ludique des images les plus traumatisantes de la
violence révolutionnaire. De ce point de vue, l’usage des guillotines, les flots de ketchup allègrement
répandus montrent la distance qui nous sépare désormais des formes paroxystiques prises par le débat
politique pendant la période révolutionnaire. C’est cette configuration qui permet de transporter, sans la
moindre gêne, sur des charrettes fleuries à la fois les enfants des écoles costumés et “le rasoir de l’Égalité”.
Au-delà de cette première remarque qui fait dire à Mona Ozouf que chacun sait, en 1989, qu’il est
déguisé26
, les rituels qui entourent la plantation des arbres de la liberté doivent aussi retenir notre attention.
La plantation des arbres apparaît, en effet, comme un geste général du Bicentenaire qui a touché près des
deux tiers des communes françaises selon un calendrier échelonné sur l’ensemble de l’année avec des
temps forts le 21 mars (date retenue par la Mission), le 14 juillet et le 11 novembre.
La scène de la plantation peut être réduite à un scénario premier susceptible de connaître des
amplifications. Elle réunit autour de l’arbre le maire, les enfants des écoles et les habitants les plus âgés de
la commune. Cette réunion possède deux significations concomitantes largement explicitées par les
discours des édiles municipaux. Elle est une leçon d’éducation civique délivrée par le premier magistrat du
lieu. Elle tend, par la présence des doyens de la commune, à être une manifestation de la pérennité de la
commune qui s’exprime au travers de la métaphore organiciste de l’arbre présentant les doyens comme les
aïeuls communs de la collectivité et les enfants comme son futur. Ce rituel élémentaire, que permet la
polysémie propre de la plantation de l’arbre, peut s’étoffer : la plantation peut être précédée par une
parade, entourée de chants et de danses, s’effectuer dans un lieu du territoire communal à forte charge
symbolique (devant le monument aux morts, sur le parvis de l’église, devant la mairie…), prendre la forme
d’une campagne de reboisement… Il est, souvent, l’occasion de retrouver les gestes des anciennes
plantations en plaçant la sauvegarde de l’arbre sous le parrainage d’enfants de la commune, ou encore en
adressant un témoignage aux générations futures par enfouissement, au pied de l’arbre, d’une bouteille
contenant un message ou, plus simplement, la délibération du Conseil municipal. Au-delà de ces formes
nombreuses qui peuvent aller jusqu’à la monumentalisation de l’arbre soit par construction d’un site pour
l’accueillir ou par l’érection d’un arbre de pierre, c’est le caractère de “fête de famille” de la plupart des
plantations qui est le plus frappant. Certes, l’occasion n’est pas forcément oubliée. La Révolution, les
principes universels de 1789 sont largement évoqués par les maires qui, souvent, n’hésitent pas à se faire
les historiens de la Révolution. Pour autant, plus que l’inscription dans une collectivité nationale, les
discours aux arbres appellent de leur vœux l’enracinement dans un territoire local qui semble être le seul
territoire disponible au regard de l’horizon universel.
Cette impression est confirmée par les attendus des programmes et par les entretiens avec les acteurs des
nombreux spectacles qui fleurissent pendant la commémoration : la fonction avouée est d’abord de
26 • Mona Ozouf, “Célébrer, savoir et fêter”, Le Débat, op. cit., n. 22.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 7
(re)créer une sociabilité locale, de permettre l’échange et le contact au sein de la commune, de promouvoir
une identité collective redimensionnée. Cette caractéristique n’est pas l’apanage des petites communes.
Elle traverse les délibérations de l’ensemble des assemblées territoriales jusqu’au Conseil régional d’Île-de-
France dont le spectacle porte ce titre emblématique et programmatique : “Citoyens franciliens !”.
D’ailleurs, en dépit des nombreux spectacles promus par les assemblées territoriales et dont la fonction est
de créer l’événement et de drainer les touristes, beaucoup de spectacles sont, d’abord, à usage interne,
voire placés judicieusement au moment où se croisent les deux vagues d’estivants.
Une recherche de territoires.
Dans cette perspective, il faut d’abord lire la ruée vers le Bicentenaire comme une suite de la ruée vers le
patrimoine qui a marqué les années 80. Elle exprime un besoin de reterritorialisation par requalification du
local, une volonté de définir des espaces civiques pertinents dès lors que la nation cesse d’être le cadre
naturel et évident du politique. Elle s’efforce de répondre à un besoin de définition identitaire. En quelque
sorte, faute de savoir encore produire du Français, ou s’il faut même en produire, l’acte commémoratif
local se propose de fabriquer du Balbynien, du Vendéen…
Cette redéfinition de l’espace civique n’est sans rencontrer une réarticulation de la grammaire des temps.
En effet, ce qui marque le Bicentenaire et, au-delà, le rapport entre les temps depuis le début des années
80, c’est le poids sans cesse croissant du présent. Pour reprendre les travaux de Reinhart Koselleck27
, le
rapport entre les temps a été marqué par deux grandes configurations : celle qui précède la modernité dans
laquelle le passé n’est jamais dépassé et constitue un trésor d’exemples toujours pertinents et disponibles,
puis celle qui s’installe avec l’humanisme et les Lumières dans laquelle le passé est conçu comme un
anticipation du futur et le présent comme un futur à l’œuvre. Le Bicentenaire enregistre la dictature d’un
présent dépourvu de tout “horizon d’attente”. Le passé est alors accaparé sans être organisé par une grille
de lecture forte, au seul titre qu’il est le passé et dans l’objectif d’atténuer la perception et les effets de
l’accélération des mutations contemporaines. Il n’annonce rien. Il exprime la permanence de l’occupation
d’un lieu avec le sentiment que la seule présence sur un territoire chargé d’histoire inscrit les habitants
d’aujourd’hui dans une filiation avec ceux qui reposent sous terre. Comme dans le régime d’historicité
précédent, l’évocation du passé a pour fonction d’enraciner les individus au sein d’une collectivité ; mais,
désormais, cette collectivité est territorialement restreinte et la production de lien social est conçue en
dehors de tout projet collectif hormis la manifestation de la pérennité de cette collectivité. C’est pourquoi
il me semble que l’on peut, à bon droit, parler d’une véritable “présentification”.
27 • Reinhart Koselleck, Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Ed. EHESS, Paris, 1990. Voir aussi : • François Hartog, “Comment écrire l’histoire de France?” Le magazine littéraire, n° 307, février 1993, pp. 28-32 et • Bernard Lepetit, “Le présent de l’histoire”, in • Bernard Lepetit (dir.) Les formes de l’expérience, Paris : Albin Michel, 1995, pp. 273-298.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 8
Une géographie des constructions identitaires.
On pourrait objecter à ce scénario la géographie commémorative contrastée qui est celle du Bicentenaire
dans laquelle se dessinent des régions récalcitrantes (voir cartes infra) ou encore les nombreuses
mutilations d’arbres de la liberté qui ont affecté les plantations de 1989. La violence des passions soulevées
localement par le Bicentenaire témoignerait a contrario de la permanence d’un cadre national, travaillé par
des conflits séculaires, encore structurant. Ces objections, qu’il importe de prendre en considération,
n’altèrent pourtant que très partiellement le schéma global que je me suis efforcé de décrire. D’une part, il
s’agit de rapporter la fréquence de ces incidents à la massivité des commémorations locales quel que soit le
désir de l’historien de retrouver ses marques et de rencontrer le poids des héritages. D’autre part, cette
géographie contrastée exprime l’existence de voies différentes pour tâcher de rebâtir des identités
collectives adaptées aux changements d’échelles contemporains qu’ils soient perçus comme le brouillage
d’un cadre “naturel” et nécessaire ou comme l’expression de la multiplicité des échelles d’appartenance et
d’intervention de l’individu contemporain28
. La comparaison entre la géographie des pratiques
commémoratives et celle des pratiques religieuses ou du vote en faveur de Maastricht (1992) n’est pas sans
apporter quelques indications importantes.
28 Voir à ce sujet la définition de la “surmodernité” comme “accélération de l’histoire, rétrécissement de l’espace et individuation des références” proposée par Marc Augé. • Marc Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris : Aubier, 1994, p. 157.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 9
Ces trois cartes sont construites à partir du dépouillement d’une enquête quantitative par questionnaire conduite par le Groupe de Recherches sur les Mutations
des Sociétés Européennes (Laboratoire de Marcel Jollivet, CNRS) auprès des maires des communes de moins de 15 000 habitants à laquelle un tiers d’entre elles
ont répondu. Compte tenu que ce tiers peut être considéré comme représentatif de la physionomie de ces communes, la carte 1 met en évidence l’existence de
zones récalcitrantes par rapport à l’attitude la plus fréquente du corpus (“Non” > 31% des réponses). Les cartes 2 et 3 montrent que les départements où
l’attitude des communes répondantes est la plus unanime (+ de 80% de communes déclarant avoir commémoré) s’inscrivent, presque parfaitement, en creux de
la géographie des pratiques religieuses fortes et de celle du vote en faveur du traité de Maastricht.
Une approche comparée de la géographie de la commémoration du Bicentenaire de la
Révolution.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 10
D’une part il semble bien que l’on commémore – si le vote en faveur du traité de Maastricht peut être
interprété comme un pari sur l’avenir – en proportion de l’inquiétude que l’on ressent sur la pérennité de
l’identité collective. Pour être plus précis, on commémore d’autant plus que la Révolution est un élément
essentiel de la construction de ces identités et que la redéfinition d’une identité collective redimensionnée
passe par son évocation. Dans les régions qui ont construit leur identité dans une relation conflictuelle soit
à la Révolution, soit au thème national, l’étape du Bicentenaire n’est pas aussi nécessaire. À l’opposé c’est
l’évocation d’une histoire spécifique en marge ou réactive au grand récit national qui est convoquée.
À partir de cette analyse, la question qui nous intéresse doit être redéfinie. Une fois admise la similarité du
geste du Puy-du-Fou29
, du mémorial des Lucs-sur-Boulogne avec le très républicain spectacle de
Montsecret-Clairefougère30
, l’attention doit porter sur le type de constructions identitaires qui se
développent dans la France contemporaine sur la base d’une disqualification relative du roman national.
Or ces constructions ne sont en rien équivalentes. Les unes, comme le Puy-du-Fou et comme nombre de
cérémonies au pied de l’arbre, s’inscrivent dans une vision communautariste qui propose comme avenir la
(re)création d’une communauté rêvée. D’autres, au contraire, se proposent de revivifier des liens collectifs
ou de les inventer pour créer un espace sociétal, espace de citoyenneté conçu comme l’une des unités
pertinentes d’une Europe en construction. Il importe donc de discerner, au-delà d’une commune référence
à l’histoire, les types d’instrumentalisations, les fonctions que l’histoire joue effectivement. Dans cette
perspective une attention toute particulière doit être portée aux groupes sociaux qui s’attachent à
promouvoir ces mises en scène du passé au sein desquels on peut, d’ores et déjà, noter la part importante
jouée par les rurbains et les militants politiques en déshérence de parti.
Usages de l’histoire et responsabilités civiques des historiens.
Cette dernière question excède très largement le champ spécifique du Bicentenaire pour être généralisable
aux usages de l’histoire. Il est certes loisible aux historiens de s’arc-bouter sur la fonction d’élaboration de
la dimension nationale qui fut longtemps la leur, quitte à proposer au terme d’une mise en abîme du
discours national, un “nationalisme amoureux”31
. Il me semble cependant que le passage de l’analyse des
conditions et des modes de production du national à son entretien ne peut être tu. Mais surtout, au-delà de
l’explicitation nécessaire de cette opération, la place prise par les historiens comme par les ethnologues
dans la production de nouvelles identités territoriales mérite l’attention de leurs opérateurs. On ne peut se
contenter d’enregistrer un “retour à l’histoire locale” sans utiliser à son égard l’héritage de déconstruction
du mythe qui est l’un des acquis majeurs de la recherche historique des trente dernières années. Il y a là
29 • Jean-Clément Martin et Charles Suaud, Le Puy du fou. Histoire en revue et politique de la mémoire, Nantes : LERSCO-CNRS, dactylographié, 1991. 30 Petit village du Calvados qui, à partir de 1987, a mis en scène son histoire pendant la période révolutionnaire. Ce spectacle a retenu l’attention de la Mission du Bicentenaire qui l’a jugé exemplaire. 31 • Pierre Nora, “La loi et la mémoire”, Le Débat, n° 78, Janvier-février 1994, p. 190.
Patrick Garcia, “Entendez-vous dans nos communes ?” 11
une confrontation nécessaire entre la volonté de répondre à une demande sociale et un nécessaire souci
civique. Cette démarche est impérieuse pour ne pas risquer d’être amené à formuler le même regret que
Marc Bloch aux lendemains de la défaite : “Nous avons, pour la plupart, le droit de dire que nous fûmes
de bons ouvriers. Avons-nous été toujours de bons citoyens ?32
”.
En d’autres termes, les spécialistes des sciences humaines convoqués lors des cycles commémoratifs, qu’ils
soient intervenants de tables rondes, conseillers “scientifiques” de spectacles ou de festivités, garants de
l’exactitude historique de telle ou telle exposition ne peuvent se contenter de capitaliser, avec bonheur, le
flot montant de la demande sociale. Ils doivent s’interroger sur les motifs de cette demande, historiciser
leur propre action et penser leur rôle dans l’éclosion de nouvelles échelles politiques et de nouvelles façons
de penser l’être-ensemble.
32 • Marc Bloch, L’étrange défaite, Paris : Gallimard, Folio, 1992, p 205.














![[Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d5d0bb415a263470afab8/fr-prier-pour-la-revolution-le-role-politique-de-la-priere-dans-le-recit.jpg)