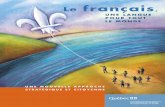Le français, une langue pour tout le monde - Ministère de la ...
[Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution...
Transcript of [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution...
1
Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la
révolution de janvier 2011 en Egypte
flickr.com/photos/ramyraoof
Dima Saber est Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication, elle a enseigné la Communication Politique à l’Université Américaine de Beyrouth (AUB) et à l’Université Libano-Américaine (LAU). Elle est actuellement chercheuse au Birmingham Centre for Media and Cultural Research à Birmingham City University. Sa recherche porte sur les récits médiatiques arabes depuis l’établissement de la radio panarabe La Voix des Arabes au Caire, jusqu’à l’émergence de l’Islam politique, notamment dans son expression shiite au Liban avec l’organisation du Hezbollah (travaux sur la couverture médiatique de la guerre de juillet 2006, les opérations militaires, les jeux vidéos et les clips vidéos du Hezbollah). Walid el-Houri a obtenu son Doctorat en Media Studies à l’Université d’Amsterdam avec une thèse portant sur les stratégies médiatiques du Hezbollah et la construction de leur identité politique. Sa recherche porte sur les stratégies médiatiques et la politique de l’espace surtout en ce qui concerne les mouvements de protestation dans le monde Arabe. Il a enseigné la Communication Politique à l'Université Américaine de Beyrouth (AUB) et est chercheur postdoctorant au Forum Transregionale Studien à Berlin.
2
Nous appellerons ce qui s'est passé, et se passe toujours, en Egypte une révolution dans la mesure où un bouleversement majeur de la structure du pouvoir a eu lieu, par une force populaire, mettant fin au règne de Hosni Moubarak. La révolution est ainsi un processus, et non plus seulement un moment. Bien que le régime Egyptien n'ait pas été complètement déconstruit1, un changement révolutionnaire a bien eu lieu, faisant émerger un nouvel agent politique, et offrant de nouvelles possibilités d'imaginer des identités politiques nouvelles. Ainsi, les mouvements populaires de masse qui ont eu lieu d’abord en Tunisie, puis en Egypte et dans plusieurs autres pays arabes, ont permis l’émergence d’un nouvel acteur dans la balance de pouvoir, le peuple, dont la meilleure expression se lit dans le slogan « el cha’eb yourid iskat el nizam » (le peuple veut renverser le régime). L'émergence de cet agent politique devient elle-même un acte révolutionnaire qui, non seulement perturbe la structure du pouvoir et ses mécanismes de gouvernance, mais offre de nouvelles possibilités d’envisager le pouvoir politique et la structure même de l’Etat.
Cette notion de peuple et sa définition (qu'est ce que le peuple Egyptien ? Qu'est-ce qu’être Egyptien?) sera au cœur même de la communication politique des divers groupes qui émergent au moment révolutionnaire (islamistes, libéraux, gauchistes, et autres). La scène politique égyptienne devient ainsi, et pour reprendre les termes d’Eric Macé, “un espace de conflictualité entre les mouvements culturels”2, et dont l’analyse permettrait de mieux saisir les dimensions politiques des imaginaires collectifs alors en jeu. Le peuple est ainsi introduit comme un “nouvel agent qui veut”, et diverses conceptions de ce que ce peuple est sont proposées par les courants et idéologies politiques. Définir un peuple et délimiter ses frontières d'exclusion et d'inclusion sont après tout, selon les termes d’Ernesto Laclau, la fonction essentielle de la politique ; la construction d'un peuple apparaît ainsi comme l'acte politique par excellence3. Nous interrogerons donc dans cet article la façon dont cette
1 Au lendemain de l’élection présidentielle de 2012 en Egypte, et l’ascension au pouvoir de Mohamed Morsi, candidat des Frères Musulmans, les manifestations ont envahi de nouveau les places publiques égyptiennes, voyant dans la politique sociale et économique de Morsi une continuation du dispositif militaire, social et économique de son prédécesseur. 2 Eric Macé.- Mouvements et contre-mouvements culturels dans la sphère publique et les médiacultures.- In Eric Maigret et Eric Macé.- Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde.- Armand Collin, 2005. 3 Ernesto Laclau.- On populist reasons.- Verso, 2007. Pour Laclau, le populisme est défini comme l'acte de construction d'une identité politique populaire autour d'une notion vague qui définira le sens d'un peuple, loin de la connotation généralement péjorative du terme populisme. Étant donné que pour Laclau l'unité de la politique n'est pas l'individu mais la demande (dans le sens de revendication et dans le sens de demande adressée à un pouvoir donné), le récit du populisme peut donc s'expliquer dans les étapes suivantes : dans un système donné qui subit une crise, un nombre de demandes individuelles (qu'il nommera demandes démocratiques) émergent. Ces demandes sont spécifiques à des groupes bien définis et adressées à des institutions de pouvoir qui peuvent les satisfaire (par exemple un groupe d’employés publiques qui demandent une hausse de leur salaire, un autre groupe d'habitants d'un quartier qui demandent de leur municipalité plus d'espace de stationnement etc.). Lorsque nombreuses demandes de ce genre se trouvent insatisfaites, la frustration augmente et transforme celles-ci en une seule demande populaire, symbolique et représentative de plusieurs autres demandes. Cette demande populaire s'articule autour d’un signifiant vide dans le vocabulaire psychanalytique de Laclau, par un processus hégémonique qui transforme un signifiant tel que « liberté », « réforme », « démocratie » etc. en une demande homogène, soulevée par des groupes qui de part leur nature sont hétérogènes, mais qui, à un moment donné, se sont joints par une « chaîne d'équivalence » pour devenir momentanément homogènes et définis comme un peuple.
3
notion de peuple se construit autour du thème de la prière comme acte publique, politique, et spatial, qui transcende les simples frontières du religieux.
Nous dérogeons dans ce contexte, à la manière d’Eric Macé dans Mouvements et contre-mouvements culturels dans la sphère publique et les médiacultures4, à l’usage du terme d’“espace public” Habermasien, et lui préférons celui de “sphère publique”, réservant le premier aux espaces urbains concrets. “Cette distinction permet notamment, selon les termes de Macé, de mieux montrer en quoi les espaces publiques sont une arène spécifique d’expression des normes et des tensions d’une sphère publique plus large.”5
Un consensus populaire s’établit assez rapidement dans cette sphère publique : un “nous”
populaire contre un ennemi commun (le régime et son Président). Au lendemain de la chute de Moubarak, d’autres antagonismes entre les groupes révolutionnaires émergeront, notamment autour de cette même notion de “peuple égyptien”, donnant lieu à des conflits de définition entre légitimation et déligitimation des pouvoirs en place. “La sphère publique est ainsi moins, écrit Eric Macé, un tribunal ou un théâtre qu’une arène symbolique constituée par les luttes de légitimation et de disqualification que se livrent via les mouvements et contre-mouvements culturels, les acteurs inscrits au sein de rapports sociaux assymétriques.”
Du moment où elle sort des mosquées et des églises, pour envahir la Place Tahrir et nombreux autres lieux publics, la prière égyptienne devient un acte politique. Elle devient aussi un outil d’appropriation et de transformation de l’espace public, permettant l’émergence d’une nouvelle identité égyptienne commune. Relayées par les médias du monde entier, et reprises sur pratiquement tous les sites et réseaux sociaux, les prières des musulmans et des coptes d’Egypte deviennent ainsi des objets médiatiques qui transcendent les limites traditionnellement cérémonielles du rituel, participant ainsi à l’élargissement du “public” de la révolution, et à la formation de nouvelles solidarités vis à vis du mouvement. Dès lors, il n’y a plus un seul récit de la révolution, mais une multitude de lectures et de narrations possibles pour dire ce soulèvement populaire. Raconter la révolution devient donc un sujet de contestation, et l’objet d’une guerre médiatique entre deux antagonismes : le récit “officiel” du régime d’une part, et celui des révolutionnaires et de tous ceux qui soutiennent leur mouvement, de l’autre.
Quasiment absentes dans le récit du premier, pour le rôle qu’elles jouent dans la représentation du peuple comme un agent politique uni contre le régime de Moubarak, les prières publiques sont au cœur des récits que constituent les activistes, les révolutionnaires et les médias internationaux qui soutiennent la révolution.
Ce travail se penche essentiellement sur trois vidéos partagées sur le réseau social YouTube,
et correspondant à trois prières publiques pendant la révolution de 2011 en Egypte. D’abord celle du pont de Qasr el-Nil6 le 28 janvier, deux jours après le début du mouvement révolutionnaire, puis les prières inter-sectaires7 entre coptes et musulmans dans la place Tahrir le 6 février, et enfin la prière8 du soir, le 11 février 2011, à Tahrir, au moment de l’annonce de la chute du régime de Moubarak. 4 Eric Macé.- Mouvements et contre-mouvements culturels dans la sphère publique et les médiacultures.- In Eric Maigret et Eric Macé.- Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde.- Armand Collin, 2005. 5 Ibid., 6 http://bit.ly/fzlr2s 7 http://bit.ly/fD5luk
4
Chacune de ces trois vidéos correspond à un temps du récit de la révolution égyptienne.
Mais bien que ces vidéos respectent entre elles un certain ordre temporel et constituent un « tout » narratif (elles correspondent donc au début, au milieu, et à la fin du récit – ou encore à un début, à un milieu, et à une fin du récit), nous ne saurons nous limiter à cette lecture purement chronologique du récit de la révolution égyptienne.
Nous prônons en ce sens une approche à la lumière des travaux de Paul Ricœur dans Temps
et récit qui consiste à faire rejoindre deux conceptualisations, l’une concernant le récit, et l’autre concernant le temps. Pour Daniel Frey dans L’Interprétation de la lecture chez Ricœur et Gadamer, la grande originalité de cette approche réside dans “l’invention d’un point exemplaire d’intersection entre l’expérience aporique du temps, telle qu’Augustin l’a conçue, et la poétique d’Aristote”9.
Deux dimensions temporelles sont donc inhérentes à notre récit, l’une chronologique et
l’autre non chronologique ; “la première constitue la dimension épisodique du récit : elle caractérise l’histoire en tant que faite d’événements. Et la seconde est la dimension configurante proprement dite, grâce à laquelle l’intrigue transforme les événements en histoire.”10
Ainsi, après une brève description du rapport qui s’est très rapidement établi entre les
prières successives du Vendredi et le mouvement révolutionnaire en Egypte, nous proposons une analyse de ce rituel collectif et médiatisé, d’abord comme l’expression d’une action politique de protestation contre l’ordre établi, puis comme un outil de transformation de l’espace public égyptien en une sorte de temple géant où se négocie une nouvelle identité égyptienne.
Cette intervention s’articule ainsi autour de l’une des facettes de cet “être égyptien” : le révolutionnaire qui prie. Rituel collectif d’abord, puis acte de contestation politique, la prière publique égyptienne devient vite performative. D’une part, elle établit une forte rhétorique visuelle entre les manifestants non-armés et la violence des forces de l’ordre, puis opère comme une force de légitimation d’un peuple révolutionnaire, pacifique et pieux.
I- La prière comme outil de contestation sociale : le rituel et l’action politique Du tout premier “Vendredi de la colère”, le 28 janvier 2011, quelques jours seulement après
le début des manifestations, et jusqu’au “Vendredi du départ” le 11 févier 2011, jour de l’annonce de la démission de Moubarak, le mouvement révolutionnaire égyptien battait au rythme des temps de la prière. Ce fut d’ailleurs le cas dans la majorité des pays arabes où des révoltes populaires ont eu lieu ; en plus des marches et des sit-ins quotidiens, les révolutionnaires appelaient une fois par semaine, depuis plusieurs capitales arabes, à des manifestations massives toujours après la prière du Vendredi. En effet, il serait intéressant de reconstituer le récit de ces révoltes à partir des différents noms que les révolutionnaires donnaient aux manifestations du vendredi, mais ceci n’est pas le propos de cet article.
8 http://bit.ly/eVkkBy 9 Daniel Frey.- L’interprétation de la lecture chez Ricœur et Gadamer.- Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 198. 10 Paul Ricœur.- Temps et récit I, L’intrigue et le récit historique.- Seuil, Paris, 1983, p. 128.
5
La prière du Vendredi a toujours eu dans l’imaginaire et la culture arabes une importance politique et sociale particulière. Cette importance de la Salât al-jumu’a est d’ailleurs soulignée dans le texte du Coran, Sourate 62, versets 9 et 10 : “Ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! 10. Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce de Dieu, et invoquez beaucoup Dieu afin que vous réussissiez.”
Mais à la différence des autres Salât el-jumu’a auxquelles avait pris part le peuple égyptien, celles qui commencent avec le “Vendredi de la colère” le 28 janvier, déborderont les murs des lieux traditionnels de prière pour envahir l’espace public. Battant au rythme de la prière, la révolution devient presque une continuation de celle-ci. L’acte de manifester devient, tout comme l’acte de prier, une “invocation de Dieu”, à laquelle le peuple est appelé à “accourir”, parce que “cela est bien meilleur pour tous”! Ainsi, dès les premières heures de la révolution égyptienne, la prière acquiert une place importante au cœur de ce soulèvement populaire, mettant en relief la religiosité du peuple égyptien et le rôle politique de la religion.
La prière transcendera ensuite son caractère de rituel religieux et social, et son cadre
temporel habituel tous les vendredis à la mi-journée, pour acquérir une fonction politique dans le récit de la révolution en Egypte. Tous les jours, et à différentes heures de la journée, les prières publiques des musulmans et des coptes d’Egypte transformeront la Place Tahrir et nombreux autres lieux publics du Caire, en des temples géants où le sit-in des manifestants ne s’interrompaient que pour implorer Dieu de mettre fin au règne du “despote”. La prière sort ainsi de son contexte habituel, la mosquée ou l’église, et envahit les places, les ponts et les rues publiques. Elle devient une forme d’activisme qui permet de légitimer davantage le mouvement révolutionnaire. Le religieux se frotte ainsi au politique, dissipant les limites traditionnelles entre les deux, et transformant la Place Tahrir en une sorte de lieu de communion - et non plus seulement de contestation - populaire et publique, auquel sont invités musulmans et coptes d’Egypte.
Ainsi, dans les images de la bataille de Qasr el-Nil, le Vendredi 28 janvier, la prière
publique des manifestants sur le pont devant les caméras du monde entier, crée une forte rhétorique visuelle entre le peuple qui prie et les forces de l’ordre11. Chacun d’eux occupe un côté de l’écran ; des véhicules de l’armée qui s’opposent aux corps humains. Des hommes non-armés prient face à des policiers armés de leurs outils d’oppression. La révolte pacifique face à la répression violente. La prière face au despote.
Vers la fin de la vidéo, et au moment où les manifestants traversent le pont et célèbrent une victoire réelle (ils réussissent à faire face aux forces de l’ordre) et symbolique (c’est la victoire du peuple qui a Dieu à ses côtés), la prière réapparaît comme pour remercier une agence externe et divine. Bien qu’ils se prosternent, qu’ils soient à genoux face à des forces de l’ordre qui se tiennent bien droites devant eux, les manifestants restent, dans leur geste, fiers et victorieux. Cette soumission à une force externe, plus haute et plus forte que tous les agents du régime, se manifeste paradoxalement comme un acte de défiance. Même à genoux, leur prière les rend plus forts, une forme “d’agencement” ou empowerment du peuple qui se soulève, et ne se prosterne en réalité que devant Dieu.
11 D’une certaine manière, la prière se substitue à la fleur que tient l’activiste pacifiste de Marc Riboud dans Pentagon March 1967 http://tomfarmerphotography.blogspot.com/2010/04/marc-riboud-pentagon-march-1967.html
6
Rituel collectif, la prière dénote un sens de communion entre les priants, elle constitue ainsi un acte social. Bien que la perception générale veuille que les rituels servent à légitimer le discours dominant12, la prière égyptienne est articulée différemment et constitue un acte d'opposition aux forces dominantes. Elle est donc aussi un outil de protestation qui permet de cultiver un sens de solidarité entre les priants, et devient un justificatif moral de la cause de ceux qui prient. Cette prière publique transcende ainsi le rituel purement religieux, l’exercice de foi, pour devenir une forme de désobéissance civile, un acte de protestation qui institue de nouvelles relations entre le rituel et l’action politique.
Le temps, le lieu et le sens de la prière se transforment, et la prière acquiert avec eux un sens nouveau et une valeur politique autre. Lorsque les manifestants de Qasr el-Nil font face à la brutalité des forces de l'ordre par un geste de prière publique, cette dernière devient une source de légitimation des révolutionnaires ; une légitimation civique, politique, sociale et religieuse.
La prière fait donc partie du récit de la révolution. Elle participe à la construction d’une
identité égyptienne, un être égyptien, à un moment donné, ainsi qu’à l’écriture du récit de la révolution elle-même. Et lorsque cette prière est saisie par les caméras du monde entier et devient un objet médiatique, elle constituera un des thèmes principaux du dit révolutionnaire, et de sa représentation médiatique en Egypte et dans le monde entier. Ces images d’Egyptiens qui prient ensemble, devant la brutalité des forces de l’ordre reflètent une tolérance et une ouverture de la société égyptienne jusque là largement méconnue. Non seulement les coptes et les musulmans d’Egypte prient ensemble, mais ils se protègent les uns les autres lors de leurs prières publiques : alors que les musulmans se prosternent pour prier, ce sont les coptes qui créent autour d’eux un cercle de protection, une sorte de première ligne de défense face aux armes des policiers.
II- La prière comme outil de transformation et de réappropriation de l’espace public Dans un second temps, la prière publique dans la place Tahrir, transforme cette place et se
l'approprie comme un espace de communion religieuse et nationale. Cette relation entre le religieux et le politique est centrale pour qualifier la révolution égyptienne et comprendre le sujet politique hégémonique qui en émerge. Nous faisons ici référence aux travaux d’Ernesto Laclau sur l’hégémonie13, la construction des identités politiques14, et plus récemment la notion de populisme définie comme une forme et non un contenu de discours politiques15. Durant la révolution égyptienne, les revendications sociales, économiques et politiques du peuple égyptien se sont toutes jointes autour d'une demande populaire, éphémère certes mais unifiée, dont la meilleure expression se lit dans le slogan : « le peuple veut renverser le régime ». 12 Voir Jean-Pierre et Lorraine Bayard de Volo.- Introduction: Cultural Practices in the Making of Oppositional Politics.- Critical Sociology, 2007. Et Cottle, S.- Mediatized Rituals: Beyond Manufacturing Consent.- Media, Culture & Society, 2006. 13 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe.- Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic politics.- Verso, 2000. 14 Ernesto Laclau.- The making of political identities.- Verso, 1994. 15 Ernesto Laclau.- On populist reason.- Verso, 2007.
7
Mais cette demande possède aussi un caractère religieux : le peuple égyptien qui s’unit face
à son despote est tout d’abord un peuple qui croit, et qui rend public son exercice de foi. La prière publique est donc au cœur des nouvelles identités politiques qui se construisent lors du moment révolutionnaire. Les prières inter-religieuses de la place Tahrir, en tant qu’action sociale, en tant qu’événement et en tant que spectacle médiatisé ont ainsi servi à l'émergence d'un peuple égyptien qui s'articule principalement autour de deux identités religieuses. Un Égyptien est un musulman ou un copte, qui se révolte contre son despote, mais qui croit et prie. Les Égyptiens sont des musulmans et des coptes unis autour d'une nouvelle identité égyptienne révolutionnaire. Et cet acte même de prière publique ne sert pas uniquement à dire la religiosité du peuple égyptien mais constitue également un acte de transformation de l'espace publique lui même.
« Il y a politique de l'espace, parce que l'espace est politique », écrit Henri Lefebvre16,
suggérant que l'espace est à la fois le lieu et le moyen de lutte, ce qui fait de lui un produit politique et social par définition. Ainsi, les relations de pouvoir ont toujours lieu quelque part, et donc sont par définition spatiaux.
Le fait que les prières aient eu lieu dans les rues, ou dans la place Tahrir, espace symbolique
de la révolution, dénote à la fois une transformation du sens de l'espace publique et de la prière en tant qu’acte social. Henri Lefebvre suggère dans ce cadre que les relations sociales sont inséparables de l'espace dans lequel on vit. « L’espace (social) est un produit (social)”17, écrit-il ; il est le produit des forces sociales et politiques qui existent, et constitue en ce sens un lieu de conflits de pouvoir. L'espace est donc à la fois un produit et un moyen de domination, donc de résistance. Lefebvre reprendra d’ailleurs la notion marxiste de l'appropriation pour l'appliquer à l'espace urbain et à la vie quotidienne dans une logique du droit à la ville18. Dans ce sens, l'appropriation de l'espace est le droit des habitants à physiquement exister, accéder, et utiliser l'espace urbain tout en ayant le droit et le pouvoir de reproduire de nouveau cet espace dans l'intérêt et selon les besoins de ses habitants19.
Dans le cas Egyptien, ce droit à la ville, se manifeste par une appropriation d'un espace
urbain et public par des manifestants qui, à travers leur communion, leurs actes politiques et leurs paroles publiques, expriment une nouvelle identité politique comme citoyens (ou citadins ?). La prière dans ce sens est un acte qui transforme l'espace et se l'approprie. La balance de force dans l'espace urbain se transforme, et avec elle se transforme le sens même de cet espace.
Dans le premier exemple de la prière sur le pont de Qasr el-nil, les manifestants démontrent
leur pacifisme face à la violence des forces de l'ordre. La prière devient ainsi un acte de désobéissance civile, et le pont qui, par définition sert à joindre deux rives, devient lui même un espace de protestation, de communion et de confrontation. Les prières inter-sectaires du “Dimanche des Martyres” transforment la place Tahrir d’un espace central et symbolique de l’Etat où se tiennent les bâtiments des ministères et le quartier central du parti du Président, en un espace symbolique de la révolution contre ce même régime. L'occupation de la place par les manifestants et par leurs rituels civils et religieux constitue donc une appropriation physique et symbolique de cet espace public qui 16 Henri Lefebvre.- Le droit à la ville suivi de Espace et politique.- Paris, Éditions Anthropos, 1974, p. 192. 17 Henri Lefebvre.- La production de l’espace.- Paris, Anthropos, 2000, p. xxi. 18 Henri Lefebvre .- Writings on Cities.- Oxford, Blackwell, 1996, p. 158. 19 Ibid., p. 179.
8
devient le lieu où de nouveaux principes de citoyenneté, de communion et de résistance peuvent émerger. Cette transformation du sens et de la fonction d'un espace par son appropriation et son utilisation comme lieu de prière sert à bouleverser la balance de pouvoir, dénotant ainsi le rôle politique de la prière pendant la révolution.
flickr.com/photos/ramyraoof
C’est ainsi que nous résumons, en guise de conclusion le rôle de la prière publique dans le récit de la révolution égyptienne : elle constitue une source de légitimation du mouvement révolutionnaire, elle permets la transformation et la réappropriation de l’espace public, et participe à la construction d’une nouvelle identité égyptienne inter-sectaire, temporaire certes, mais qui a réussi à mettre en avant la “religiosité” de la société égyptienne et la valeur politique de la prière.
Alors qu’en France les prières de rue sont vues comme une menace au principe de laïcité, et
inspirent peur, méfiance et stigmatisation de la communauté musulmane de France, elles ont eu en Egypte une fonction de délivrance et de libération d’un peuple de son despote. De toutes les prières publiques de Tahrir, les Egyptiens se rappelleront surtout celle du soir le Vendredi 11 février, dit le Vendredi de Départ, jour de démission de Hosni Moubarak. Ils ont longtemps prié Dieu et voici leur vœu enfin exaucé ! La place Tahrir témoignera ainsi la dernière prière avant la chute tant attendue du
9
dictateur. La prière conçue comme acte politique de protestation, de légitimation et de transformation devient aussi un acte de célébration faisant de la place Tahrir le lieu de triomphe de la révolution.
Au lendemain de la chute de Moubarak de nouveaux acteurs politiques émergent dans la
même sphère publique égyptienne. De nouveaux antagonismes se créent et de nouvelles alliances mettent fin à la « chaîne d’équivalence » qui s'était construite pendant la révolution. Avec l’ascension des Frères Musulmans au pouvoir, la prière acquiert elle aussi un sens nouveau dans une nouvelle Egypte désormais divisée au sujet du rôle de la religion dans la vie politique, et de la religiosité de cette même société égyptienne.
Références bibliographiques
Frey Daniel.- L’Interprétation de la lecture chez Ricœur et Gadamer.- Paris, Presses Universitaires de France, 2008
Laclau, Ernesto et Chantal Mouffe.- Hegemony and socialist strategy : towards a radical democratic politics.- London, Verso, 2000
Laclau, Ernesto.- The Making of political identities.- London, Verso, 1994 Laclau, Ernesto.- Populism: What’s in a name? In Francisco Panizza.- Populism and the mirror of democracy.- London, Verso, 1994 Laclau, Ernesto.- On populist reason.- London, Verso, 2007
Lefebvre Henri.- La production de l’espace.- Paris, Anthropos, 1974 Lefebvre, Henri.- La production de l’espace.- Paris, Éditions Anthropos, 1974
Lefebvre Henri.- Le droit à la ville suivi de Espace et politique.- Paris, Éditions Anthropos, 1974
Lefebvre Henri.- Writings on Cities.- Oxford: Blackwell, 1996 Macé Eric et Maigret Eric (Dir).- Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde.- Paris, Armand Colin, 2005 Ricœur Paul.- Temps et récit 1, L’intrigue et le récit historique.- Seuil, Paris, 1983
![Page 1: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Fr] Prier pour la révolution : le rôle politique de la prière dans le récit de la révolution de janvier 2011 en Egypte](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023020223/631d5d0bb415a263470afab8/html5/thumbnails/9.jpg)