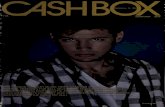« Le Congrès juif canadien face au Québec issu de la Révolution tranquille, 1969-1990 » (p....
Transcript of « Le Congrès juif canadien face au Québec issu de la Révolution tranquille, 1969-1990 » (p....
1
Le Congrès juif canadien face au Québec issu de la
Révolution tranquille (1969-1990)
Pierre Anctil
Département d’histoire
Université d’Ottawa
Publié dans Stéphane Savard et Jérôme Boivin (dir.) De la représentation à la
manifestation; groupes de pression et enjeux politiques au Québec, XIXe et XX
e siècles,
Québec, Septentrion, 2014, (p. 314-340).
Le Congrès juif canadien (CJC) a été fondé à Montréal en mars 1919. À ce moment, plus
de 200 délégués de partout au Canada se sont réunis pour élire un conseil
d’administration et fixer les grandes orientations de l’organisme1. Aux yeux de ces
activistes, le CJC se devait de représenter l’ensemble des composantes du judaïsme
canadien et, pour cette raison, l’aspect strictement religieux fut dès le départ mis en
veilleuse au profit d’une approche plus culturelle. Cette année-là, il y avait environ
122 000 Juifs dans tout le pays et près de 45 000 à Montréal seulement, dont la plupart
étaient des immigrants yiddishophones récemment arrivés d’Europe de l’Est. Une série
de circonstances exceptionnelles avait poussé la population juive canadienne à vouloir
créer en 1919, juste après la fin de la Première Guerre mondiale, un organisme fédérateur
de tout le judaïsme canadien2. Plusieurs enjeux préoccupaient alors les Juifs installés au
pays, dont la nécessité de structurer la représentation politique juive à Ottawa et auprès
des gouvernements provinciaux. La promotion du sionisme, la question de l’éducation
1 Fait intéressant dans le cadre de cet article, le CJC a tenu sa réunion de fondation au Monument National,
qui était alors propriété de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le Monument National était aussi
couramment utilisé à cette époque par les troupes de théâtre yiddish. 2 À ce sujet, voir le témoignage d’Israël Medresh, Le Montréal juif d’autrefois, Sillery, Les Éditions du
Septentrion, 1997 (1947), p. 238-241 et celui de Simon Belkin, Le mouvement ouvrier juif au Canada,
1904-1920, Sillery, Les Éditions du Septentrion, 1999 (1956), p. 261-300.
2
juive, de l’immigration et de la consolidation de la structure communautaire figuraient
aussi en première ligne parmi les préoccupations du CJC. [photo de groupe de 1919 et
photo de H. M. Caiserman en 1919] L’arrivée de jours meilleurs et une période
d’accalmie dans les relations internationales avaient toutefois diminué les ardeurs des
fondateurs, et l’organisme était tombé jusqu’en 1934 dans une phase de léthargie, soit en
gros jusqu’à l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler en Allemagne. Réanimé par H.-M.
Caiserman et par un groupe de militants communautaires inquiets de la montée de
l’antisémitisme au Canada, et ailleurs dans le monde, le CJC prit véritablement son envol
en 1939 quand le philanthrope Sam Bronfman fut élu à la présidence. Fort de ressources
nouvelles et d’un esprit plus interventionniste, le CJC s’engagea résolument dans l’effort
de guerre, contribua à l’accueil au Canada des survivants de l’Holocauste et fit à partir de
1948 une défense passionnée de l’État d’Israël.
Il est important de noter qu’à cette époque les Juifs montréalais souhaitaient
généralement s’intégrer au volet anglophone de la société québécoise. Ils s’étaient donc
dirigés massivement vers l’école publique protestante, choix que la loi provinciale de
1903 sur l’éducation des enfants juifs n’avait fait qu’entériner3. Malgré ce penchant
linguistique bien affirmé, la population juive était restée un groupe distinct au sein de
l’anglophonie montréalaise, bénéficiant de son propre réseau institutionnel et décidé à
faire la promotion de valeurs judaïques à l’intérieur de son espace communautaire. À
partir de 1960, la majorité des Juifs canadiens sont dorénavant nés au Canada, pays où ils
connaissent une forte mobilité sociale grâce à un accès élargi aux professions libérales et
au milieu des affaires. Au cours de cette décennie, un nouveau contexte vient cependant
rompre l’équilibre social et politique auquel les Juifs montréalais se sont acclimatés
depuis près d’un demi-siècle. Des phénomènes socio-économiques inédits et des
mouvements politiques jusque-là inconnus ou restés marginaux apparaissent au sein de la
population francophone, qui remettent en question les certitudes héritées des périodes
précédentes, dont le fait qu’il était possible jusque-là de vivre et de gagner sa vie
3 Voir à ce sujet Jean-Philippe Croteau, «La communauté juive et l’éducation à Montréal : l’aménagement
d’un nouvel espace scolaire, 1874-1973», dans Pierre Anctil et Ira Robinson, dir, Les communautés juives
de Montréal, histoire et enjeux contemporains, les Éditions du Septentrion, 2010, p. 64-91.
3
uniquement en anglais à Montréal. Alors qu’autrefois les francophones se contentaient de
jouer un rôle mineur dans la société québécoise et s’exprimaient à travers un nationalisme
surtout défensif, inspiré par les valeurs traditionnelles de l’Église, ils aspirent désormais à
exercer plus de pouvoir au sein de leur propre société et à s’inscrire de plein pied dans la
modernité. Ce courant met entre autres de l’avant la notion d’un État interventionniste,
chargé de refléter les aspirations politiques de la majorité francophone et apte à orienter
l’évolution économique du Québec. Surtout, le Canada, qui était perçu par les membres
de la communauté juive comme un ensemble politique éminemment stable, à l’abri des
violences et des tensions intercommunautaires, donne au cours des années soixante des
signes troublants d’éclatement.
Le Congrès juif canadien et la société québécoise
Le CJC, dont le siège social était à l’époque à Montréal, se trouva aux premières loges
quand se firent entendre les échos annonciateurs de la Révolution tranquille et
qu’apparurent des signes de changements majeurs au sein de la société québécoise.
Résolument engagé dans un effort de dialogue avec la population francophone, ce dont
témoigne la fondation du Cercle juif de langue française4 vers 1949 et la publication de
poèmes rédigés par A.-M. Klein sur Montréal5, l’organisme prit conscience au cours des
années cinquante et soixante que les balises identitaires du Canada français étaient
désormais en forte redéfinition. Ce constat suscita auprès du leadership juif canadien à la
fois un sentiment de satisfaction face à la modernisation des structures sociales héritées
de l’Église catholique, et une inquiétude profonde quant au sens véritable à donner au
nouveau nationalisme québécois. À partir de la venue au pouvoir de Jean Lesage, le CJC
entre dans une période de questionnements aigus qui culmine avec l’élection de René
Lévesque en 1976 et la promulgation de la Charte de la langue française en 1977. Face à
4 À ce sujet voir : Jean-Philippe Croteau : Les relations entre les Juifs de langue française et le Cercle juif
de langue française selon le Bulletin du Cercle juif (1954-1968), Montréal, Université de Montréal, 2000. 5 Voir, Pierre Anctil, «A. M. Klein: du poète et de ses rapports avec le Québec français», dans Journal of
Canadian Studies / Revue d'études canadiennes, Peterborough, Ont., 1984, vol. 19, no. 2, p. 114-131.
4
cette situation nouvelle, les Juifs canadiens – et en particulier ceux qui résident à
Montréal – ne savent plus très bien à quoi s’en tenir ni comment se positionner. Dans ce
contexte, le CJC va agir comme groupe de pression auprès du gouvernement du Québec,
à la fois pour transmettre aux autorités le point de vue de la communauté juive et si
possible pour modifier le cours des événements. À n’en pas douter, le leadership juif
appuie sans réserve les acquis de la Révolution tranquille et il applaudit au courant
d’idées nouvelles qui mène les Québécois à abandonner le référent identitaire religieux.
Au même moment, les dirigeants de l’organisme craignent les dérives que pourrait
occasionner un nationalisme québécois reposant sur des bases politiques en apparences
radicales, et son intention avouée d’agir sur la situation linguistique à Montréal.
En somme, au lendemain de la Révolution tranquille, le CJC s’interroge de manière
intense sur le sens qu’il convient de donner aux transformations soudaines qui agitent le
Québec francophone. Ses dirigeant montréalais, qui sont élus au suffrage universel par les
membres déclarés de la communauté juive, veulent surtout préserver l’équilibre politique
en place au Canada, qui permettrait aux citoyens d’origine juive de se sentir à l’aise et
confiants au sein d’une société québécoise érigée sur des fondements nouveaux. En
agissant ainsi, le CJC cherche à comprendre la portée des grandes transformations qui
secouent le Québec et il tente du même coup de s’adapter au discours des nouvelles élites
nationalistes francophones. Surtout, ses dirigeants veulent mesurer les conséquences à
long terme des événements qu’ils voient se dérouler sous leurs yeux. Ils tentent de plaider
en faveur de leur communauté au milieu d’un courant de changement qui semble tout
emporter sur son passage. Car en ces années de Révolution tranquille et au cours des
deux décennies suivantes, les Juifs ressentent une insécurité profonde qui se manifeste
sur plusieurs fronts. Ils craignent d’abord que leur réseau institutionnel cesse d’être
financé en partie par l’État québécois, et qu’il soit même délégitimée par un nouveau
nationalisme où l’identité culturelle des francophones tiendrait le haut du pavé. Les
ambitions des souverainistes leurs inspirent aussi des doutes sur le traitement que
recevront les minorités dans un Québec détaché politiquement du Canada. Ils redoutent
enfin que les droits fondamentaux soit relégués à l’arrière plan à l’occasion des grands
5
bouleversements sociaux encore à venir. Chargé par le leadership communautaire juif de
faire le suivi de toutes ces questions, le CJC s’engage sur le terrain de la discussion
politique et décide d’intervenir dans certains forums précis lorsque les circonstances
l’exigeront. Tiraillé à l’époque entre deux interprétations irréconciliables de la
Révolution tranquille, l’une positive et l’autre catastrophique, le CJC oscille entre
plusieurs stratégies et cherche pendant longtemps une voie de compromis qui soit
honorable pour toutes les parties en cause.
Le CJC prend vers 1969 un certain nombre de décisions stratégiques face à une question
québécoise qui ne cesse de prendre de l’ampleur et qui vient d’être l’objet, au surplus,
d’une importante commission d’enquête pancanadienne présidée par André Laurendeau
et Davidson Dunton. L’organisme fait alors le choix d’intervenir surtout en coulisse et de
tenter de rejoindre privément les leaders d’opinion francophone pour tenter de les
sensibiliser aux inquiétudes grandissantes des Juifs. Au cours de ces années qui vont de
1969 à 1990, le CJC évitera aussi de s’exprimer via les grands organes de presse, à
l’occasion d’assemblées patronnées par des partis politiques ou à l’intérieur de
mouvements de masse. Les animateurs du CJC font plutôt le pari de prendre la parole
d’une manière structurée et non partisane lors de commissions d’enquêtes de
responsabilité provinciale, lorsque se réunissent des comités parlementaires à Québec ou
alors que se discutent des documents d’orientation gouvernementaux soumis à l’attention
du public. Le CJC6 soumet dans ce contexte des documents «officiels»
qui expliquent ses
prises de position et mettent de l’avant ses impressions quant à l’évolution de la société
québécoise, souvent rédigés en français et visant un auditoire composé surtout d’élus et
de hauts fonctionnaires. À partir de la création de la Commission Gendron en 1968, en
passant par de nombreux forums de réflexion parlementaires sur la législation
linguistique (loi 22 et loi 101) et jusqu’à la Commission Bélanger-Campeau de 1990, le
CJC prépare ainsi des mémoires détaillés sur son interprétation des événements et de la
6 Le Congrès juif canadien, région du Québec, est dirigé au cours de cette période par les personnes
suivantes : Nathan Gaisin (1968-1971), Murray Speigel (1971-1974), Leon Teitelbaum (1974-1977), Mel
Shwartzben (1977-1978), Edward Wolkove (1978-1980), Frank Schlesinger (1980-1983), Bernard J.
Finestone (1983-1986) et Morton Bessner (1986-1989). Toutes ont été élues au sein des instances
démocratiques de l’organisme.
6
politique québécoise de l’époque7. Il en va de même quand le leadership juif rencontre
privément Robert Bourassa le 24 janvier 1972 et le 2 avril 1973, ainsi que René Lévesque
le 31 janvier 1977. [René Lévesque autour d’une table avec les représentants du CJC –
peu après son élection en 1976] Ces textes révèlent un positionnement cohérent et
systématique portant sur des questions de fond, et qui sera maintenu sur une longue
période, malgré les soubresauts de la vie politique et les aléas de la scène électorale. Ils
font aussi ressortir une pensée authentique et réfléchie, qui fait l’objet d’un certain
consensus au sein de la population juive et auquel la communauté est arrivée après de
nombreuses consultations. Ce sont ces mémoires8 qui forment la base des réflexions que
l’on retrouve dans cet article, et qui sont de plus très précieux pour comprendre le
cheminement de la population juive du Québec sur le long terme. Dans ce discours on ne
retrouve pas par exemple trace de préoccupations liées à la classe sociale, comme le
niveau de revenu ou l’accès à la richesse, ni d’inquiétudes liées à la santé publique, à
l’éducation en général ou à de grands enjeux qui seraient partagés par tous les Québécois.
Dans ces dossiers plus généraux, les Juifs agissent comme tous les autres citoyens et sont
libres d’avoir recours à des mécanismes démocratiques reconnus.
Certes il y a aussi eu au cours de cette période plusieurs prises de position «non-
officielles» de la part de personnalités associées à la communauté juive montréalaise,
notamment dans les journaux anglophones et sur les ondes. Ces déclarations ont été le
fait soit d’individus en particulier, qui n’étaient pas investis d’une responsabilité
quelconque face à leur communauté et ne s’étaient pas présentés devant ses instances
principales avant de prendre la parole9; soit de regroupements qui poursuivaient d’autres
7 Il est important de noter que le CJC avait réagi par écrit aux travaux de la Commission Parent, mais sans
aborder les thèmes plus vastes du nationalisme québécois ou de la question linguistique. Voir : «Mémoire
soumis par le Congrès juif canadien au Conseil supérieur de l’éducation du Québec sur les
recommandations de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec», 25
octobre 1966, 12 p, archives du Congrès juif canadien, Montréal. 8 Même s’ils ont été entérinés par l’instance centrale du CJC, les mémoires cités dans cette étude ont été
rédigés sous la responsabilité de la section québécoise du CJC, d’où l’appellation «région de l’Est» ou
«région du Québec» que l’on retrouve dans ces textes. 9 Mordecai Richler représente un cas parmi d’autres de cette enflure verbale, que l’on retrouve notamment
dans son ouvrage intitulé : Oh Canada ! Oh Quebec !: Requiem for a Divided Country, New York, A. A.
Knopf, 1992, 277 p.
7
finalités que le CJC, comme celle de défendre la population anglophone du Québec ou de
représenter des opinions favorables au fédéralisme canadien. En général, ces affirmations
ont eu tendance à revêtir un caractère négatif face aux attentes et aux projets de la
collectivité francophone, parfois d’une manière prononcée, et qui ont été répercutées
bruyamment à l’extérieur du Québec par des médias avides de formules à l’emporte-
pièce. On ne retrouve pas ce ton ni ces propos dans les mémoires du CJC, où tous les
mots sont pesés et où perce une volonté sincère d’équilibre et de respect attentif face aux
Québécois d’expression française. Ce discours modéré, au sein de la communauté juive,
contraste aussi fortement avec l’idée que les francophones se sont fait en général du point
de vue des Juifs montréalais au sujet des lois linguistiques ou du mouvement
souverainiste. Dans l’agitation de la place publique et au moment des grands choix
électoraux, le CJC a plutôt eu tendance à se faire discret pour laisser les citoyens de
toutes origines exprimer par les voies démocratiques normales leurs choix politiques
fondamentaux, parfois selon des paramètres qui n’avaient rien à voir avec les attentes
principales de leur communauté d’appartenance ou avec leur origine culturelle. Dans le
cas des Juifs en particulier, le vote électoral ou référendaire de chaque individu pouvait
très bien refléter des prises de position parfaitement détachées des questions identitaires
principales reliées au judaïsme et à la judéité. Il pouvait aussi mettre de l’avant des
aspects plus associés à une idéologie politique touchant de vastes couches de la
population québécoise, ce que le CJC a voulu respecter pleinement.
Il y a aussi que le CJC avait déjà refusé à deux reprises, en septembre 196310
et en mai
196911
, de participer aux audiences de la Commission Laurendeau-Dunton, alléguant que
l’organisme exigeait prioritairement l’amendement de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique aux fins d’y inclure une charte des droits fondamentaux. Le CJC s’opposait
aussi à toute tentative de réduire la culture canadienne aux seules communautés dites
10
Lettre de Michael Garber, président du CJC (niveau national), J. Irving Oelbaum, chairman, National
Executive Committee du CJC et Saul Hayes, Executive vice-president du CJC, au premier ministre Lester
B. Pearson, 5 septembre 1963, archives du Congrès juif canadien, Montréal. 11
Lettre de Monroe Abbey, président du CJC (niveau national), au premier ministre Pierre-Elliott Trudeau,
26 mai 1969, archives du Congrès juif canadien, Montréal.
8
fondatrices du pays, ce qui risquait de reléguer à l’arrière plan les populations d’autres
origines :
The reference to the Royal Commissioners on the development of Canadian
Confederation is, with due respect, too restrictive in limiting the position of the
community of non-French, non Anglo-Saxon origin to cultural contributions.
There are two planes of thought in such a concept – one dealing with fundamental
relations of French and English and the other on cultural contributions. It is
submitted that one cannot restrict the position and rights of the upwards of 25 %
of the populations to cultural contributions while studying something much more
basic in respect to the 75 %12
.
Tandis qu’aucun sentiment d’urgence ou aucune inquiétude précise ne semblaient dicter
la conduite du CJC au niveau fédéral, il en alla tout autrement en décembre 1968 quand
le gouvernement du Québec mit sur pied la Commission d’enquête sur la situation de la
langue française ainsi que sur les droits linguistiques au Québec, mieux connue sous le
nom de Commission Gendron. Après avoir déposé, en janvier 1969, devant le Comité de
l’éducation de l’Assemble nationale du Québec portant sur le Bill 8513
, un mémoire14
surtout technique, le CJC y allait en août 1969 d’un texte très étoffé destiné à la
Commission Gendron15
, qui proposait une argumentation bien articulée concernant la
question des droits linguistiques. Il faut comprendre d’une part que la politique du
gouvernement Bertrand était très contestée dans les différents milieux francophones
intéressés à l’éducation, et qu’elle avait donné lieu d’autre part à des manifestations de
rue assez imposantes. Clairement, le leadership du CJC ressentait que les questions
12
Lettre de Michael Garber, op. cit. 13
Le projet de loi no. 85 était la première version du projet de loi no. 63, ou Loi pour promouvoir la langue
française, adoptée le 20 novembre 1969, et qui consacrait le libre choix des parents en matière d’éducation. 14
«Mémoire soumis par le Congrès juif canadien, région de l’Est, au Comité d’éducation de l’Assemblée
nationale du Québec sur le bill 85», 14 janvier 1969, 14 p, archives du Congrès juif canadien, Montréal. 15
«Mémoire soumis par le Congrès juif canadien, région du Québec, à la Commission d’enquête sur la
situation de la langue française ainsi que sur les droits linguistiques au Québec», août 1969, 16 p, archives
du Congrès juif canadien, Montréal. Il existe aussi une version anglaise du même texte.
9
soulevées au moment de cette conjoncture étaient d’une importance primordiale non
seulement pour le Québec, mais aussi pour l’ensemble du Canada, et qu’elles auraient un
grand retentissement sur la vie individuelle et collective de tous les citoyens. Pour cette
raison, l’organisme prit son mandat très au sérieux et consulta un grand nombre
d’instances au sein de la communauté, au point de déclarer dans son mémoire : «Nous
pensons que ces questions sont tellement importantes pour le futur de notre province
qu’un consensus sur la plus vaste échelle doit être obtenu avant qu’une action soit
entreprise. C’est en partant de ce point de vue que sont émises nos recommandations16
».
Le CJC inaugure ainsi une façon de se positionner qui restera sienne pour l’ensemble de
la période étudiée. Dans ce contexte, l’organisme déposera plusieurs mémoires fouillés
lors des discussions entourant un certain nombre de projets de loi portant sur l’éducation,
sur l’organisation des services de santé et des services sociaux, sur la gestion linguistique
et la langue d’enseignement, puis sur les droits et libertés de la personne. Le CJC fera de
même en 1990, lors de la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec,
mieux connue sous le nom de Commission Bélanger-Campeau17
. À chaque fois, le CJC
refuse de s’engager sur la voie d’une discussion à caractère partisan, ou qui tendrait à
s’aligner sur les choix politiques effectués par la majorité des électeurs d’origine juive,
qui sont bien connus de tous à l’époque.
Une intervention à trois volets
Bien que les documents déposés par le CJC entre 1969 et 1990 touchent un ensemble de
thèmes assez disparates, il est néanmoins possible de regrouper les réflexions et les
recommandations de l’organisme autour de trois idées principales, lesquelles sous-
tendent toutes ses interventions sur la place publique et lors de commissions
parlementaires. Premier élément, et non des moindres, le CJC souligne inlassablement
pendant plus de vingt ans que le projet de valorisation et d’avancement de la langue
16
Ibid, p. 4. 17
Les projets de loi touchés sont ceux sur l’éducation (loi 85, 1969 et loi 63, 1969), sur l’organisation des
services de santé et des services sociaux (loi 65, 1971-72), sur la langue officielle (loi 22, 1974-75), sur les
droits et libertés de la personne (loi 50, 1975), sur la langue française (loi 101, 1978), sur la santé et les
services sociaux (loi 27, 1981), sur les amendements à la Charte de la langue française (1983) et sur
l’enseignement primaire et secondaire (loi 3, 1984).
10
française, présenté sous des formes variables par les différents gouvernements au
Québec, est légitime et qu’il mérite l’appui de la communauté juive. Par contre, prévient
l’organisme, toute recherche d’amélioration de la situation linguistique des francophones
ou toute démarche visant la pérennité de la culture française, doit être menée dans un
cadre législatif où les droits fondamentaux sont respectés intégralement. Pour le CJC, ces
deux aspects de la problématique en cours sont indissolublement liés et ne sauraient se
concevoir de manière séparée, peu importe le régime politique en place. Finalement, la
communauté juive réclame le droit de préserver dans ce nouveau contexte son réseau
d’institutions communautaires, jugé essentiel au maintien d’une identité juive au Québec,
ce qui inclut le versement de subventions publiques pour son entretien et son
épanouissement. Sans l’apport systématique et constant de l’État québécois sur le plan
financier, le leadership juif s’estime en effet incapable d’offrir aux membres de la
communauté des services de qualité sur le plan scolaire, culturel et hospitalier, et qui
assurent au judaïsme québécois des assises stables. Nul doute que ce dernier élément a eu
beaucoup de poids pour convaincre le CJC de développer un positionnement stratégique
face aux revendications, parfois contradictoires et incomplètes, qui sont apparues dans
l’arène politique québécoise au cours des années soixante-dix et quatre-vingt.
Le parti pris du CJC en faveur d’une protection accrue de la langue et de la culture
française au Québec se manifeste de façon éclatante dès le mémoire déposé en 1969 à la
Commission Gendron, et se maintien tout au long de la période étudiée. Le leadership juif
n’y va pas d’ailleurs à demi-mots sur cette question : «Nous déclarons sans hésitation, ni
équivoques, que toutes les aspirations du peuple français de la province de Québec, visant
à maintenir son intégrité linguistique et culturelle trouvent compréhension dans le cœur et
l’esprit du peuple juif. Nous savons, en effet, ce que cela signifie que préserver les
institutions, les héritages culturels, les coutumes et la langue18
». Pour surprenante qu’elle
puisse paraître à première vue, cette sensibilité face à la protection du français tient à
deux composantes historiques que le CJC reconnaît d’emblée lors de sa rencontre de
janvier 1972 avec le premier ministre Bourassa. Non seulement les francophones ont-ils
été victimes d’injustices flagrantes dans le contexte historique canadien, qu’il convient de
18
«Mémoire soumis par le Congrès juif canadien», 1969, op. cit, p. 6.
11
corriger, mais les Juifs déclarent très bien comprendre la situation des minoritaires et
sympathisent avec les peuples qui subissent un sort difficile : «We are sensitive to French
Canadian concerns and aspirations. We are a people that has been forced by
circumstances to struggle for centuries to retain our identity, our heritage and our culture
in the face of seemingly insurmountable obstacles19
». Sur la foi de cette déclaration, le
CJC accepte dès 1974 que le français puisse être la langue dominante du Québec, même
si la communauté juive se sent en règle générale plus à l’aise avec le concept fédéral de
bilinguisme20
. Le projet de loi déposé en 1977 et intitulé : «la Charte de la langue
française», pourtant décrié par une partie de la presse anglophone de Montréal et par des
personnes appartenant à la communauté juive, ne modifie en rien l’attitude du CJC en
une heure où les tensions linguistiques apparaissent à leur paroxysme. Dans le mémoire
soumis en juin 1977 à la fois par le B’nai Brith21
et par le CJC, on retrouve le passage
suivant : «The thrust of Bill 1 is of crucial importance to the citizenry of Québec. The
Jewish community believes that every encouragement must be given to the
épanouissement of the French language and culture, because this reflects the legitimate
aspirations of the majority of our fellow citizens in the province22
». Le CJC se rend aussi
à la fin de la période étudiée à l’argument que les immigrants allophones admis au
Québec doivent être sensibilisés à la prépondérance de la langue française sur la place
publique, et qu’ils ont tout intérêt à se franciser pour mieux participer à la vie
démocratique de leur province d’accueil23
. [René Lévesque à la tribune de la 18e session
du Congrès juif canadien, mai 1977 et rencontre avec Charles Bronfman]
19
«Aide Memoire for Conference of Canadian Jewish Congress, Eastern Region, with the Hon. Robert
Bourassa, Prime Minister of Québec», 24 janvier 1972, p. 1, archives du Congrès juif canadien, Montréal.
Il existe aussi une version française de ce document. 20
À ce sujet voir : «Mémoire soumis par le Congrès juif canadien, région du Québec, à la Commission de
l’éducation, des affaires culturelles et des communications, sur le projet de loi no. 22 «Loi sur la langue
officielle», 11 juin 1974, p. 3, archives du Congrès juif canadien, Montréal. 21
Le B’nai Brith est un organisme communautaire dont le mandat est de soutenir les personnes juives dans
le besoin, de lutter contre l’antisémitisme et de faire la promotion des droits humains. 22
«Brief Submitted by the Canadian Jewish Congress, Quebec Region, to the Commission on Education,
Cultural Affairs and Communications on Bill 1, Charter of the French Language in Québec», 2 juin 1977,
p. 1, archives du Congrès juif canadien, Montréal. Il existe aussi une version française de ce document. 23
«Brief Presented to the Parliamentary Commission Looking into the Political and Constitutional Future
of Québec by Canadian Jewish Congress (Québec Region), in Collaboration with Allied Jewish
Community Services of Montreal and the Communauté sépharade du Québec», 2 novembre, 1990, 15 p,
archives du Congrès juif canadien, Montréal.
12
Une telle compréhension des aspirations de la majorité francophone du Québec n’est pas
l’apanage que du CJC. Cette perspective est partagée à l’époque par plusieurs courants
d’opinion au sein de la communauté juive organisée de Montréal. On la retrouve en
particulier au sein de l’aile plus radicale et plus engagée politiquement de la population
juive, qu’une longue expérience du socialisme et du militantisme syndical dans
l’industrie de la confection a rapprochée des couches laborieuses francophones. Cette
sympathie pour la langue française se manifeste aussi dans certains milieux de gauche
attachés aux langues juives, notamment chez les yiddishistes montréalais qui sont
sensibilisés depuis le début du XXe siècle à la présence d’une collectivité francophone
dans la ville. On en veut pour preuve le mémoire déposé en juillet 1964 par le Jewish
Labour Committee of Canada devant la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme, et qui soulignait au nom de la liberté d’expression et des droits
culturels fondamentaux l’importance de la contribution des francophones dans le cadre
canadien :
The Jewish Labour Committee was founded on the ideals of individual and group
liberty. Many of its founders were men who had suffered hardships and
oppression, and were the victims of racial, religious and cultural discrimination,
from which they fled. For that reason, its members have an understanding of and
are especially sensitive to the positive aspirations of our French-Canadian
compatriots [...] Furthermore, we cherish a deep respect for the very survival of
French-Canadian culture in an overwhelmingly Anglo-Saxon surrounding24
.
On peut facilement imaginer que ces points de vue ont été entendus lors des consultations
internes menées par le CJC à la veille de sa comparution à la Commission Gendron, et
qu’ils formaient une part non-négligeable de l’opinion au sein de la communauté juive
montréalaise. Il y a aussi que l’organisme fédérateur avait une longue expérience du
dialogue intercommunautaire avec les Québécois d’origine catholique. Au moment
d’entreprendre la rédaction de ses premiers mémoires, ses principaux animateurs
24
«Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism Brief Submitted by the Jewish Labour
Committee of Canada», 30 juillet 1964, p. 2, archives du Congrès juif canadien, Montréal. Ce texte existe
aussi en traduction française.
13
connaissaient depuis au moins une vingtaine d’années le sentiment de la majorité
francophone sur ces questions et, contrairement à d’autres intervenants d’origine juive sur
la place publique, entretenaient des liens avec les principaux porte-parole politiques du
Québec. Ces consultations étalées sur plusieurs années, entre autres par le biais du Cercle
juif de langue française, avaient alerté le CJC pour ce qui est de la montée du
nationalisme francophone à Montréal et les avait tenu au courant de l’évolution des
esprits au moment de la Révolution tranquille. Le CJC possédait aussi au sein de son
bureau de direction des représentants de la communauté sépharade marocaine, qui avaient
des rapports d’un autre ordre avec les francophones et circulaient plus librement que les
Ashkénazes dans les différents milieux sociaux québécois.
Cette ouverture d’esprit face à la situation de la langue française à Montréal n’en cachait
pas moins une inquiétude sourde de la part d’un leadership juif qui observait l’évolution
de la scène politique avec une certaine appréhension. Si les revendications des
francophones étaient connues et avaient été formulées avec force au moment de la
Révolution tranquille, il en allait tout autrement des moyens qui seraient utilisés
éventuellement par les pouvoirs publics pour renverser la marginalisation de la langue
française dans la sphère économique. Qui pouvait prédire comment réagirait le nouveau
courant nationaliste pour ce qui est du respect des minorités linguistiques et religieuses ?
Qu’arriverait-il si des moyens radicaux étaient employés ou si des politiques limitatives
étaient promues face à la langue anglaise ? Ces doutes furent exprimés de manière très
nette dès 1972 lors de la rencontre avec le premier ministre Bourassa :
The concerns of French Canada have not left us unmoved, but, nevertheless, have
created in us ambivalent feelings. On the one hand, while we are fully
understanding of, and sympathetic to, the stated concerns and aspirations of
French Canada, for we can identify with these concerns, on the other hand, we are
fearful that in redressing one series of wrongs and injustices, a new series of
wrongs and injustices will be created25
.
25
«Aide Memoire for Conference of Canadian Jewish Congress, Eastern Region, with the Hon. Robert
Bourassa», 1972, op. cit, p. 1-2.
14
Puisque la réaction des francophones à leur asservissement historique comportait encore
une certaine part d’incertitude à l’aube des années soixante-dix, et que la communauté
juive se sentait vulnérable face à un courant d’opinion qui se serait porté vers des formes
d’intervention trop radicales, le CJC fut prompt à exiger des garanties quant à la façon
dont serait entreprise la promotion de la langue française. Dans un premier temps, le
leadership juif se rendit réclamer aux travaux de la Commission Gendron l’abandon de
toute forme de mesure contraignante sur le plan légal, ou comportant des éléments
susceptible de réduire la liberté d’expression des citoyens. En août 1969, quand le CJC
dépose son mémoire, il n’existe pas encore de Charte des droits fondamentaux de la
personne, ni au niveau fédéral ni au niveau provincial, et la loi canadienne sur les langues
officielles vient à peine d’être promulguée par le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau.
Dans ce contexte, le CJC plaide plutôt pour des mesures incitatives et le maintien du libre
choix au niveau scolaire :
While strongly supporting the idea and practice of maximal diffusion of the
French language in Quebec and Canada in all areas of cultural, social and
economic endeavour, we are opposed to any program of coercion, social or
legislative, which would infringe on the fundamental rights of individuals. The
recognition of two languages and linguistic and cultural communities, ought to go
hand in hand with the goal of assuring language equality and reasonable usage in
practice throughout Canada, and optimal diffusion of French among all Québec
residents26
.
Il existe toutefois une forte évolution du leadership juif sur cette question tout au long des
années soixante-dix et quatre-vingt, qui aboutit finalement à une acceptation pleine et
entière du cadre législatif de responsabilité provinciale régissant l’usage de la langue
française au Québec, notamment de la Charte de la langue française promulguée en 1977.
Les rencontres des représentants du CJC avec le premier ministre Bourassa en 1972 et
26
«Brief submitted by the Canadian Jewish Congress, Québec Region, to Commission of Inquiry on the
Position of the French Language and on Language Rights in Québec», août 1969, p. 12, archives du
Congrès juif canadien, Montréal.
15
1973 recommandent toutes deux avec insistance l’établissement d’une législation relative
aux droits fondamentaux de la personne, afin de baliser les interventions
gouvernementales dans le domaine linguistique. Sur ce point, le CJC se retrouve en
accord avec les recommandations de la Commission Gendron qui penche du côté des
interventions modérées et des mécanismes conciliatoires. La même position se retrouve
dans le mémoire déposé par le CJC en 1974 lors de l’étude du projet de loi 22 visant à
faire du français la seule langue officielle du Québec :
En termes généraux, nous voulons réitérer notre foi en le Québec et notre ferme
conviction que le progrès et le développement du Québec peuvent seulement être
atteints par une connaissance appropriée des deux langues et que la préservation et
la dissémination du français peuvent être atteintes grâce à la persuasion et non par
la coercition, ni en restreignant les droits de n’importe quel résident du Québec
qui devraient à tous moments être protégés27
.
Le discours du CJC se modifie considérablement après l’adoption en juin 1975, par le
gouvernement Bourassa, de la Charte québécois des droits et libertés de la personne,
laquelle offre des garanties substantielles aux minorités linguistiques, culturelles et
religieuses, en plus de condamner fermement diverses formes de discrimination. Lors de
la rencontre avec le premier ministre René Lévesque, en janvier 1977, le CJC se contente
tout simplement de réclamer la pleine application de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne, ce qui amène l’organisme à reprendre dans sa défense des droits
fondamentaux les termes même de la loi :
We urge that while pursuing the legitimate objectives of promoting and
preserving the use of the French language in Québec, the Government not adopt
any policy, legislation or regulations that would categorize population by race,
colour, creed, ethnic origin or mother tongue, or which could use any of these
27
«Mémoire soumis par le Congrès juif canadien», 1974, op. cit, p. 12-13.
16
criteria to create advantages for one group of citizens to the detriment of the
other28
.
En termes clairs, cela signifiait que le CJC ne s’objecterait pas quelques moins plus tard à
la promulgation de la loi 101, tant que le législateur n’outrepasserait pas le cadre avancé
par la Charte des droits, c’est-à-dire tant que le sens du mot «Québécois» conserverait un
sens assez vaste pour inclure tous les citoyens du Québec et que les droits des
anglophones ne seraient pas réduits d’une manière déraisonnable. À ce titre, le CJC
empruntait face à la Charte de la langue française une attitude plus attentiste et plus
conciliante que face à la loi 63 de 1969 ou face à la loi 22 de 1974, toutes deux votées
dans un contexte où les droits fondamentaux n’avaient pas encore trouvé au Canada une
forme légale explicite et nettement affirmée. En janvier 1977, les leaders juifs ont pensé
qu’il était préférable de s’en tenir à un simple avertissement à l’endroit du gouvernement
nouvellement élu du Parti québécois, à savoir qu’un esprit de modération et de tolérance
devaient présider à la mise en place d’une nouvelle législation linguistique, peu importe
l’urgence ressentie par rapport à cet enjeu dans les milieux nationalistes : «Whatever the
injustices of the past, of which the Jewish community has also been the victim, as so
often in our history, these cannot be corrected by discriminatory or coercive measures.
Rather, the linguistic and cultural problems of Québec must be solved by the closest co-
operation and understanding of all citizens, irrespective of origins29
».
La publication en 1988 du jugement Ford de la Cour suprême du Canada acheva de
convaincre le CJC que cet enjeu des droits fondamentaux n’était plus d’actualité dans le
cadre linguistique québécois, d’autant plus que le fait d’interdire la langue anglaise dans
l’affichage était maintenant invalidé par le plus haut tribunal du pays30
. Du même coup,
cela signifiait aussi que toutes les autres dispositions de la loi 101 qui avaient pu paraître
contestables jusque-là étaient maintenant avalisées, de même que l’esprit général dans
28
«Brief Submitted by the Canadian Jewish Congress, Eastern Region and B’nai Brith – District 22 to the
Honourable René Lévesque», 1977, op. cit, p. 3. 29
«Brief Submitted by the Canadian Jewish Congress», 1977, op. cit, p. 3. 30
La loi 101 fut modifiée deux fois au cours de cette période, soit immédiatement après le jugement Ford
de 1988 (loi 178) et cinq ans plus tard en 1993 (loi 86), soit pour éviter le recours à la clause nonobstant
inscrite dans la Constitution canadienne de 1982.
17
lequel la Charte de la langue français avait été rédigée en 1977. Après cette date, le
leadership juif ne remit plus en question ni le cadre législatif, ni les motivations
profondes des gouvernements québécois successifs à protéger le français. Le CJC se
présenta même en 1990 à la Commission Bélanger-Campeau sans soulever cette question
des lois linguistiques, convaincu que l’enjeu avait été réglé une fois pour toutes deux ans
plus tôt : «We recognize and support the role of Québec in defending and promoting the
French language and culture, a concern described by the Supreme Court of Canada as
«serious and legitimate31
». Le leadership juif se montra même prêt dans ces conditions à
ouvrir la porte à une modification du régime fédéral, mais pas au point d’éliminer tout
lien entre le Québec et le Canada, et à condition que le processus menant à une telle
décision respecte pleinement les principes démocratiques et les droits fondamentaux de la
personne : «Details of future constitutional arrangements should be worked out in
negotiations involving Québec and the rest of Canada. We underscore our respect for the
democratic process whatever the eventual outcome32
». Sur le front de l’éducation, le CJC
était même favorable en 1990 à une déconfessionnalisation du système scolaire public et
à un engagement plus soutenu du gouvernement québécois dans le processus de
francisation des immigrants, tant que des efforts seraient consentis en vue de promouvoir
les échanges interculturels et de contrer les préjugés raciaux.
Le troisième volet du positionnement institutionnel défendu par le CJC, soit le droit pour
la population juive de préserver et d’enrichir son réseau communautaire, notamment
grâce au financement de l’État québécois, se retrouve dans presque tous les mémoires
soumis entre 1969 et 1990. Le leadership juif ne manqua donc pas, aussi souvent que
possible, de rappeler à ses interlocuteurs politiques que la perpétuation de l’identité juive
au Québec exigeait le maintien de services spécialisés dans le domaine de la santé, des
services sociaux, de l’éducation et de la culture, soit autant de responsabilités qui
relevaient des pouvoirs publics provinciaux. C’était sans compter toute une gamme
d’organisations privées, dont les coûts d’opération étaient défrayés entièrement par la
communauté, et qui soutenaient l’identité juive dans les secteurs clés de la pratique
31
«Brief Presented to the Parliamentary Commission Looking into the Political and Constitutional Future
of Québec», 1990, op. cit, p. 6. 32
Ibid, p. 2.
18
religieuse, de la nourriture cachère et de l’appui aux personnes démunies. L’enjeu
apparaît particulièrement important en 1971 lors de la réorganisation des services de
santé et des services sociaux entrepris par le gouvernement Bourassa dans le cadre de la
loi 65. À cette occasion, le CJC demande la création d’une catégorie administrative
appelée «institution communautaire», placée sous la responsabilité d’une corporation
bénévole à composante ethnique ou religieuse. Le leadership juif accepte par contre dans
ce contexte que les intérêts publics priment sur les objectifs particularistes, et convient
que toute organisation desservant une population spécifique soit placée sous le contrôle
d’un plan général coordonné par l’État : «It is our view that government has the
responsibility to set standards, to regulate, to supervise and to coordinate. This principle
suggests that government has to be sufficiently flexible so that others may offer services
as long as they fulfill the standards and deliver a service deemed to be in the public
interest. The Jewish community has always functioned in this manner33
». Le CJC évoque
alors le précédent de la loi sur l’Éducation privée adoptée en décembre 1968, et qui
garantissait aux institutions scolaires privées juives un financement s’élevant à 60% du
coût moyen de l’éducation dispensée dans des établissements publics de même niveau.
Le thème est repris en 1973 lors des discussions tenues avec le premier ministre
Bourassa, entre autres pour ce qui concerne un réseau d’écoles juives très développé,
auquel adhèrent près de 5,000 enfants répartis en une vingtaine d’institutions distinctes.
Sans le soutien partiel de l’État québécois, plaide le CJC, ces maisons d’éducation sont
vouées à péricliter, ce qui entraînerait des conséquences graves pour le maintien de
l’identité juive à Montréal :
The Jews are and always will be a small minority group of persons individually
integrated into the social, economic and political life of the society in which they
live and at the same time, as a group, striving to retain their religious and cultural
identity. Our survival as Jews necessitates the maintenance of this religious and
33
«Brief submitted by the Canadian Jewish Congress, Eastern Region, and the Allied Jewish Community
Services of Montreal to the Standing Parliamentary Committee on Social Affairs of the National Assembly
of Québec on Bill 65, an Act to Organize Health Services and Social Services», octobre 1971, p. 4, archives
du Congrès juif canadien, Montréal.
19
cultural identity in an active and vital form, while faced with powerful, attractive
and highly developed surrounding dominant cultures [...] We strongly plead for
the continuation of grants to all Jewish schools. Without these grants, Jewish Day
Schools could not be maintained and their disappearance would constitute a
staggering blow to the Jewish community in Montreal34
.
Une fois le Parti québécois arrivé au pouvoir, le CJC accentue ses pressions pour
convaincre René Lévesque35
de préserver l’équilibre institutionnel établi et les droits
acquis de la communauté juive dans la sphère de l’éducation et de la santé, d’autant plus
que les projets de loi et les ententes existants étaient encore récents et semblaient fragiles.
[René Lévesque et deux membres du CJC commémorent à l’Assemblée nationale la loi
de 1832] La rencontre privée de janvier 1977 porte d’ailleurs presque entièrement sur ce
thème plutôt que sur la question des droits fondamentaux ou de la langue, qui servent
plutôt d’arrière-fond. Le CJC en profite pour rappeler au premier ministre nouvellement
élu que le soutien aux démunis et la forte hausse de la population âgée constituent un
problème sérieux pour la communauté, puis souligne que les écoles juives dépendent du
financement de l’État pour poursuivre leur mission, essentielle à la transmission de
l’héritage judaïque : «A secured existence will allow our schools to preserve their goals
and to better plan their future development and adaptation to the reality of Quebec. We,
therefore, request the understanding, co-operation and support of your Government in our
approach to the proper functioning of the Jewish Day Schools36
». Il en va de même des
hôpitaux et des centres de services sociaux administrés par des entités à vocation juive, et
qui offrent un environnement culturel et religieux jugé primordial pour les clientèles qui
les fréquentent. Le même discours réapparaît dans le mémoire du CJC à la Commission
Bélanger-Campeau, où le leadership juif consent à appuyer la déconfessionnalisation
scolaire en faveur de critères linguistiques, tout en prônant le maintien d’un système
34
«Aide memoire for conference of Canadian Jewish Congress, Quebec Region, with the Hon. Robert
Bourassa, Prime Minister of Québec», 2 avril 1973, p. 5-6, archives du Congrès juif canadien, Montréal. 35
Au sujet des rapports de René Lévesque avec la communauté juive montréalaise, voir Pierre Anctil,
«René Lévesque et les communauté culturelles», Trajectoires juives au Québec, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2010, p. 179-201. Voir aussi Victor Teboul : René Lévesque et la communauté juive :
entretiens, Montréal, Les Intouchables, 2001, 64 p. 36
«Brief Submitted by the Canadian Jewish Congress, Eastern Region and B’nai Brith – District 22 to the
Honourable René Lévesque», 1977, op cit, p. 9.
20
d’écoles confessionnelles privées juives qui continuerait de fonctionner dans un cadre où
est pris en compte l’intérêt général. C’est l’occasion pour la communauté de réaffirmer
une fois de plus son engagement envers une laïcité ouverte, qui permet aux citoyens
attachés sous une forme ou une autre à leur héritage religieux de conserver des
institutions séparées, tout en participant pleinement à l’ensemble de la mouvance
québécoise.
Conclusion
De 1969 à 1990, le CJC revient inlassablement à la charge auprès des différents
gouvernements québécois pour les sensibiliser quant aux craintes et appréhensions de la
communauté juive de Montréal face à la question nationale. Au même moment, le
discours des francophones ne cesse de se radicaliser pour culminer avec la promulgation
en 1977 de la Charte de la langue française, loi qui impose des contraintes légales aux
anglophones et aux allophones dans plusieurs domaines clé, dont l’éducation. Sur cette
question en particulier, le CJC doit battre en retraite et ses dirigeants réalisent rapidement
qu’ils ne peuvent renverser un courant d’opinion très puissant au sein de la population
francophone. Au contraire, après avoir longtemps défendu le bilinguisme et le statu quo
linguistique à Montréal, ce sont les Juifs qui entreprennent au cours de ces années un long
processus d’évolution qui les mène à une meilleure compréhension des aspirations de la
majorité démographique. Par contre, le CJC marque des points sur le front des droits
fondamentaux et pour ce qui est de la préservation de la structure communautaire juive
déjà en place depuis plusieurs décennies. Soucieux de ne pas paraître oppresser les
minorités, autant Robert Bourassa que René Lévesque se rangent du côté de leurs
interlocuteurs juifs et déclarent vouloir préserver autant les libertés civiles que le réseau
institutionnel juif, qu’ils n’hésitent d’ailleurs pas à financer avec des deniers publics.
Après 1990, le discours du CJC se stabilise et reste à peu près inchangé pour ce qui est de
ces trois enjeux perçus comme cruciaux par le leadership communautaire juif. De fait,
21
rien de vraiment nouveau ne vient entamer la confiance du CJC envers le processus
démocratique en place au Québec ou envers la capacité des citoyens québécois
d’entreprendre une démarche de changement politique graduel : «We Quebecers are
engaged now, as we have been periodically over the years, in collective reflection about
the political and constitutional future. We are pleased to participate in this democratic
process of reflection and know that the discussion of our collective memory will continue
to be carried out in a spirit of moderation and civility37
». Après un processus d’adaptation
étalé sur plus de vingt ans, au cours duquel les résistances du leadership juif avaient fini
par s’effacer peu à peu, le CJC se retrouvait finalement en phase avec les aspirations de la
société québécoise toute entière. Ce cheminement permit aussi au CJC de découvrir au
cours des années quatre-vingt un nouveau positionnement qui reflétait en réalité celui des
jeunes générations juives, mieux adaptées au contexte linguistique mis en place par la
Charte de la langue française. Ces ajustements parfois douloureux, parfois mutuellement
consentis, se firent au prix d’un contact beaucoup plus structuré et permanent avec la vie
politique québécoise et avec le personnel politique en place, comme en font foi les
mémoires que nous venons de parcourir. Cela signifiait aussi de la part du leadership
communautaire juif une maîtrise accrue de la langue française et une participation de tous
les instants aux débats parlementaires, sans pour autant céder sur la profondeur et la
qualité de l’engagement du CJC face à un judaïsme défini de manière souple. En
filigrane, il faut lire également dans cette évolution une prise de conscience de la part de
l’organisme que la trajectoire de revendication des francophones à l’intérieur du Canada,
en tant que minorité d’importance stratégique, préfigurait celle des Juifs dans le cadre
plus étroit de la société québécoise et répondait aux mêmes interrogations insistantes.
En cours de route, le mode de négociation de la communauté juive fut finalement perçu
comme relevant des mêmes paradigmes identitaires que celui des Québécois face au
fédéralisme canadien, soit le maintien d’une pleine égalité et d’une autonomie culturelle à
l’intérieur d’une juridiction politique plus vaste. À mesure que le Québec balisait son
rapport au Canada, de même le CJC découvrait qu’il était possible de réaliser des
37
«Brief Presented to the Parliamentary Commission Looking into the Political and Constitutional Future
of Québec», 1990, op. cit, p. 2.
22
ajustements à son propre discours, sans compromettre la finalité ultime de l’organisme.
Le CJC n’hésita d’ailleurs pas après 1990 à mettre en valeur le caractère complexe de
l’identité juive en contexte québécois, qui reste un phénomène tout à fait unique à
l’intérieur du judaïsme canadien38
. Ces propos se trouvent résumés par une phrase
lapidaire tirée du mémoire du CJC soumis à la Commission Bélanger-Campeau : «We
can be good Jews, good Quebecers and good Canadians without contradiction39
». Du
coup, un déplacement identitaire majeur s’effectuait au cours de ces deux décennies, qui
allait éventuellement mener le CJC à modifier en avril 2009 sa raison sociale en y
incorporant l’élément sans doute le plus fondamental de sa démarche d’ajustement :
Congrès juif québécois40
. Même après quarante ans d’avancées, le processus d’adaptation
politique et linguistique auquel le leadership juif avait consenti à partir de 1969 conserve
toujours une haute valeur symbolique dans la société québécoise contemporaine. Les
Juifs forment la plus ancienne communauté culturelle et religieuse du Québec et, pour
cette raison, ils gardent un pouvoir d’entraînement considérable auprès des autres
populations minoritaires plus récemment arrivées de l’étranger. Il n’y a aucun doute que
les orientations auxquelles les Juifs sont arrivés après 1990 préfigurent à plus long terme
le cheminement qu’emprunteront éventuellement d’autres minorités religieuses non-
chrétiennes, bientôt confrontées elles aussi, lorsqu’elles atteindront une certaine masse
démographique et une plus grande maturité politique, à des choix à longue portée
historique.
Cette étude montre aussi qu’un organisme de pression représentatif et démocratique, basé
sur des valeurs identitaires bien balisées, a pu jouer un rôle non négligeable dans
l’évolution politique du Québec des années soixante-dix et quatre-vingt. Parce qu’il était
le porte-parole organisé d’une population compacte, le CJC a su développer et
transmettre de manière cohérente aux pouvoirs publics une vision divergente de l’avenir
du Québec, mais qui n’en était pas moins réconciliable, à certaines conditions, avec les
38
Sur ce thème, consulter l’ouvrage dirigé par Pierre Anctil et Ira Robinson, Les communautés juives de
Montréal, histoire et enjeux contemporains, Sillery, les Éditions du Septentrion, 2010, 278 p. 39
«Brief Presented to the Parliamentary Commission Looking into the Political and Constitutional Future
of Québec», 1990, op. cit, p. 3. 40
À ce sujet voir l’entrevue d’Adam Atlas dans Le Devoir, 7 avril 2009 : «Congrès juif québécois : un
nouveau nom, un nouveau président».
23
aspirations de la majorité démographique. L’exercice que nous avons décrit, montre la
valeur hautement symbolique du discours juif dans l’arène politique québécoise, à un
moment où différents courants politiques s’affrontaient autour de notions comme la
modernité, le nationalisme et le rôle de l’État. La contribution du CJC demeure aussi
unique parce qu’elle était la seule à l’époque qui ait émergé d’une communauté d’origine
immigrante identifiable, différente de celle des Anglo-Protestants, et très bien adaptée
aux exigences de la vie montréalaise. Cela tend à montrer qu’en démocratie, même lors
de périodes politiquement tendues, une minorité bien identifiée, fortement organisée et
très articulée sur le plan du discours, peut être entendue sur la place publique et modifier
le rapport de force à son avantage. L’évolution que vous venons de décrire de la part des
Juifs montréalais confirme aussi l’idée qu’en entrant dans l’arène politique, ses
représentants ont modifié subtilement leur point de vue au fil des ans et ont appris à
mieux comprendre les aspirations de la majorité francophone. Il y avait donc dans ce
dialogue politique réussi un gain important à réaliser, autant pour les Juifs que pour la
société québécoise dans son ensemble.