L’efficacité des mots dans les miracles, les maléfices et les incantations
«Mourir dans le monde juif », Maurice Godelier (ed) La mort et ses au-delà selon les sociétés...
Transcript of «Mourir dans le monde juif », Maurice Godelier (ed) La mort et ses au-delà selon les sociétés...
La mort dans le monde juif
Sylvie ANNE Goldberg
« La mort est sinistre, brutale, cruelle, source d’infini chagrin.Face a elle, notre premiere reaction est la consternation. Ellenous stupefie et nous desempare. Lentement, cette consterna-tion se mue en un sentiment de mystere. Soudainement, unevie entiere s’est voilee dans le secret. Notre parole cesse, notrefaculte de comprendre se fige. En presence de la mort, iln’est que silence, et sentiment de crainte (...). Notre maniered’apprehender la vie joue sur notre vision de la mort. Car sila vie est percue comme une surprise, comme un cadeaudefiant toute explication, alors la mort cesse d’etre cette nega-tion radicale, absolue de ce qu’est la vie. Car la vie et la mortsont les deux aspects d’un mystere bien plus vaste, le mysterede l’etre, le mystere de la creation. Des lors, la mort n’est plusseulement l’arrivee de l’homme a sa fin. Elle est egalementl’entree dans un commencement [...]. Le plus grand problemen’est pas comment continuer, mais comment faire pour exalternotre existence [...]. L’eternite n’est pas un perpetuel futur,mais une perpetuelle presence. Il a plante en nous la semencede vie eternelle. Le monde a venir n’est pas seulement un au-dela, il est aussi un ici et maintenant ».
Bien perspicace serait celui qui pourrait discerner dans cespropos, une representation singuliere de la mort. Redigeespar le penseur et theologien Abraham Joshua Heschel dans
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 117
un essai intitule « La mort, comme un retour a la maison »1, ceslignes ne contiennent probablement rien qu’un fidele a uneautre obedience monotheiste ne puisse tenir. Et il pourraitsembler qu’a l’image de la vision apaisee de la mort que pre-sentent les grands cimetieres urbains d’aujourd’hui, lesconceptualisations dont elle a fait l’objet ont connu un pro-cessus d’uniformisation. Nul ne songerait, d’ailleurs, as’etonner de decouvrir que les vastes necropoles parsemeesde croix reservent aux juifs un carre. Aisement identifiable,il est encombre de tombes et de monuments surmontesd’etoiles de David : steles individuelles, caveaux collectifs demembres des associations de secours mutuels, ou memoriauxrappelant les noms des communautes decimees lors de laSeconde Guerre mondiale. Mais, au-dela de ces signes appa-rents, somme toute superficiels, les juifs detiendraient-ils desapproches ou des pratiques differentes de celles de leurs voisinsde cimetiere ?
Entre passe et present, reposer parmi les siens
A l’heure de la mort d’un proche, et en dehors des milieux destricte observance, il n’est pas rare que des juifs integres dansle monde social, et souvent fort eloignes de toute pratiquereligieuse, fassent appel aux rituels ancestraux, meme, etc’est souvent, s’ils en ignorent le sens ou les modalites. Ilss’adressent alors a une entreprise qui, en se chargeant de pour-voir aux obseques, mandatera laHevra kaddisha (lit. ConfrerieSainte) afin d’accomplir les derniers devoirs et d’effectuer lesinhumations selon les lois et les usages en vigueur dans latradition juive. Nombre de personnes confrontees a cetteecheance, qui ne songeraient nullement a observer les com-
118 La mort et ses au-dela
1. Abraham Joshua HESCHEL, «Death as homecoming », Jack Riemer (ed.),Jewish Reflections on Death, New York, Shoken Books, 1976, p. 58-59.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 118
mandements seculaires dans leur vie quotidienne, n’hesitentpas a s’en remettre a laHevra kaddisha, qui emane de nos joursdes institutions orthodoxes. Le recours a celle-ci jette ainsi unpont invisible entre les usages de la modernite et ceux dessiecles passes. Dans le monde d’aujourd’hui ou toutes lesfonctions sociales sont professionnalisees, l’entreprise depompes funebres a repris le flambeau de l’ancienne Confreriedu dernier devoir. Pour certains juifs la rencontre avec la mortmarque parfois la derniere, si ce n’est la seule, experienced’une forme de judaısme traditionnel. Lorsque survient lamort, l’appel au rituel – quel qu’en soit le degre – attestel’ancrage de l’individu dans son groupe, son inscription dansune memoire collective. Et, quand bien meme le defunt auraitrejete, sa vie durant, tout signe de religiosite, son inhumationdans un « carre juif » est l’expression d’une fidelite.
La coexistence funeraire dans l’espace public redit la victoirede la secularisation sur les contraintes religieuses d’antan quirequeraient que les defunts reposent dans des cimetieres aussisepares que l’etaient leurs quartiers de leur vivant. Cette divi-sion spatiale marquait egalement la distance installee dans lespratiques mortuaires qui avaient contribue a demarquer lechristianisme du judaısme depuis les premiers siecles. La rela-tion de ces deux religions au corps, puis a sa depouille, cristal-lisait ainsi des differences paraissant a jamais irremissibles.Car, au sein de cultures faisant peu de cas du sort des cadavres,depuis l’Antiquite et durant le Moyen Age, l’une des grandessingularites des juifs, probablement la plus ostensible, tenait aleurs etranges pratiques funeraires : « reglees tout autrementque chez les autres peuples »2, comme le remarquait Hecateed’Abdere au IIIe siecle avant l’ere chretienne, et dont se gaus-sait l’historien Tacite [ca 55-120] : « Ils regardent comme un
119La mort dans le monde juif
2. HECATEE D’ABDERE, Theodore REINACH, Textes d’auteurs grecs et romainsrelatifs au Judaısme, Paris, Ernest Leroux, 1895 [Georg Olms, Hildesheim,Zurich, New York, 1983], 14-20.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 119
crime de tuer un seul des enfants qui naissent ; ils croientimmortelles les ames de ceux qui meurent dans les combatsou les supplices ; [...] ils ont [...] l’usage d’ensevelir les corps aulieu de les bruler ; ils prennent aussi desmorts le meme souci »3.Ultime destinee commune a tous les etres, il est cependant unemaniere singuliere de s’en approcher, de s’y preparer et de larencontrer a l’aide des rituels juifs. Bien que l’on ne sache pasgrand-chose des rites funeraires pratiques pendant l’Antiquite,la Bible hebraıque apporte quelques informations. On sait ainsiqu’Abraham enterra Sarah, prononca une elegie puis la pleura(Genese 23,3) ; et que les ossements de Joseph furent ramenesd’Egypte apres l’exode pour etre inhumes a Sichem dans unterrain que son pere, Jacob, avait jadis acquis (Josue 24,33).Paisible, a l’image de celle d’Abraham, qui rejoignit ses peres aun age avance, « rassasie de jours » (Gn 25,8), la mort peut aussietre violente, comme dans le cas des fils du roi David. Elle est,quoi qu’il en soit, suivie de lamentations (Samuel 18,33) etd’une periode de deuil. Joseph le prit durant sept jours pourson pere ; le peuple pleura Moıse pendant trente (Deutero-nome 34,8), tandis que Daniel, plonge dans un deuil de troissemaines, ne consomma alors ni pain ni viande (Dn 10,3). Cesindications bibliques ont servi a faconner les rituels qui serontdeveloppes au long des siecles dans la litterature rabbinique.
Rediges du IIIe au VIe siecle, les Talmuds de Jerusalem et deBabylone sont la source canonique de pratiques qui perdurent,parfois, jusqu’a nos jours. Un traite talmudique releve ainsi903 sortes de manieres de mourir, qui forment une typologiedes morts « ordinaires ». La mort peut etre « subite » (hatufa) – amoins de mourir soudainement dans sa quatre-vingtiemeannee. Elle peut etre « hative » (dehufa) apres une seule journeede maladie ou lorsqu’elle provient d’une epidemie. Lorsque lamort survient apres deux jours de maladie elle est « retardee »
120 La mort et ses au-dela
3. TACITE, Histoire, IV-V, REINACH, Textes d’auteurs grecs et romains, op. cit.,p. 305-309.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 120
(dehuya).Mais apres trois jours, c’est une reprimande (ge’ara).Survient-elle apres quatre jours de maladie, elle est alors unblame (nezifa). La mort est « normale » apres cinq jours. Lesixieme jour, c’est la mort evoquee par la Bible, et le septieme,un acte d’amour divin. Mais au-dela de sept jours d’agonie,c’est mourir dans les douleurs (yesurin)4. Apparue avec laconsommation du fruit de l’arbre de la connaissance et l’ex-pulsion du jardin d’Eden (Gn 3), la mort est fatalement liee al’humain, qui « issu de la poussiere », devra retourner a lapoussiere.
L’au-dela
Percu comme un corridor ouvrant sur l’autre monde5, le pas-sage terrestre ne serait qu’un cheminement vers l’ineluctablefinitude. Il est cependant destine a inciter l’individu a accu-muler les merites dont il pourra beneficier dans le mondeceleste. Indissociable de l’attente d’une redemption collective,l’esperance juive s’est edifiee dans l’entrelacement de deuxprincipes : l’affirmation de l’existence d’un au-dela transcen-dant la finitude et le retour supreme des juifs sur la terre dontils ont ete exiles. Ce dernier principe ayant trait aux represen-tations juives des temps messianiques (ba-olam ha-ba / be-atidlavo), ne sera qu’evoque ici. Quant au premier, il emerge dulivre de Daniel : « Beaucoup de ceux qui dorment dans lapoussiere du sol se reveilleront, les uns pour une vie eternelle,les autres pour etre l’objet d’ignominie et d’horreur eternelle.Les sages resplendiront comme l’eclat du firmament, et ceuxqui auront dirige la multitude dans le droit chemin comme lesetoiles, a tout jamais » (12, 2-3). C’est au cours des deux siecles
121La mort dans le monde juif
4. Berakot 8a, Talmud de Babylone, Moed katan 28a ; Evel Rabbati, 3,9.
5. Mishna Avot, 4,16 ; en francais voir Eric SMILEVITCH, Commentaires duTraite des Peres, Pirqe Avot, Lagrasse, Verdier, 1990, p. 200.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 121
qui precedent la destruction du Temple et la redaction de laMishna que l’idee de la resurrection va s’imposer avec la vic-toire des Pharisiens sur les Sadduceens qui, si l’on en croit ladescription qu’en a faite Flavius Josephe, voyaient «mourir lesames en meme temps que les corps »6. L’attente de la resur-rection est explicitement enoncee a de multiples reprises dansle second livre desMaccabees7. Se dessine ainsi un territoire del’entre-deux : le monde qui vient (olam ha-ba). Ses contoursseront traces a partir des discussions que les docteurs del’epoque talmudique meneront autour d’une question : quese passe-t-il apres la mort ?
«Dieu possede trois clefs : celle de la pluie, celle de la naissance,celle de la resurrection des morts »8. Tout en affirmant lacroyance dans la resurrection, ce dit talmudique l’etend audomaine des mysteres inherents a l’univers auquel nul nesaurait acceder et qu’aucun dogme ne vient donc appuyer.Ainsi la croyance en une resurrection, pour faire partie despiliers de la foi juive, demeure-t-elle dans l’inconnaissable.Pour autant, sans proposer une vision precise ou meme uni-voque de ce qui advient du corps et de l’ame apres la mort, lessages erigerent cependant l’esperance en doctrine9. Partant duverset d’Isaıe, cet autre dit talmudique l’enonce sans ambi-guıte : « Tout Israel a une part dans le monde a venir, comme ilest dit (Is 60, 21) ‘‘Et le peuple y a droit, a la fin, ils heriterontde la terre’’. Et celui qui dit qu’il n’y a pas de resurrection des
122 La mort et ses au-dela
6. FLAVIUS JOSEPHE, Les Antiquites judaıques, trad. par Julien Weill, dansŒuvres completes, trad. fr. sous la dir. de Theodore Reinach, Paris,E. Leroux, 1900-1911, t. XVIII, 1, 2.
7. 2M 7,9 ; 7,23. Voir S. A. GOLDBERG, La Clepsydre. Essai sur la pluralite destemps dans le judaısme, Paris, Albin Michel, 2000, p. 273-274.
8. Ta’anit 2a.
9. S. A. GOLDBERG, «Na’asse ve-nishma – nous ferons et nous entendrons –,De la croyance dans le judaısme », P. GISEL, S. MARGEL (eds), Le Croire aucœur des societes et des cultures, Bibliotheque des Sciences Religieuses, Turnhout,Brepols, 2011, p. 43-63.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 122
morts n’aura pas sa part dans le monde a venir »10. Affirmantl’inexorabilite du monde a venir pour tous, les docteurs eta-blirent simultanement une distinction permettant d’identifierceux qui en seront exclus, pour avoir incite autrui a pecher, niel’affirmation de la resurrection, ou transgresse les prohibitionsfondamentales11. Parmi les nombreux enjeux theologiques liesa cette distinction entre croyants ordinaires et impies irreduc-tibles, le sort de l’ame apres sa sortie du corps qu’elle animaitoccupe une place incertaine. En depit de la diversite des opi-nions des sages concernant le devenir de l’ame12, quelquesidees se sont neanmoins imposees, approfondies par les com-mentateurs, philosophes et kabbalistes qui les ont endossees.L’une des plus etablies tient qu’il existe une sorte d’espaceceleste, un « tresor », sorte de « faisceau des vivants » ou les amesse tiennent aupres de Dieu : celles des justes trepasses rejoi-gnant celles qui ne se sont pas encore incarnees. Quant auxames des pecheurs, elles demeurent emprisonnees sur terresans pouvoir s’echapper13 et sont pourchassees par les angesdestructeurs14. Une autre opinion affirme la persistance de laconscience, par-dela le trepas : « R. Isaac dit aussi : les vers sontaussi douloureux au mort que l’aiguille qui transperce la chaird’un vivant. R. Hisda dit : [apres sa mort] l’ame d’un hommeprend son deuil durant sept jours. Car il est dit : ‘‘Et son ameprit le deuil sur lui’’ (Job 14, 22) ; et il est ecrit, il prit un deuilde sept jours pour son pere (Genese 50, 10)’ »15. L’idee de lapermanence de la conscience permet ainsi d’etablir un dia-logue avec les defunts. C’est au cours de la nuit qu’ils peuventdescendre de la Yeshivah [l’Academie] des cieux pour visiter
123La mort dans le monde juif
10. Sanhedrin, 10,1.
11. Rosh Ha-shanah, 16b-17a.
12. Jose COSTA, L’Au-dela et la resurrection dans la litterature rabbinique ancienne,Paris-Louvain, Peeters, 2004.
13. Shabbat 152b.
14. Ecclesiaste Rabba, 3,1 ; Avot de rabbi Natan, 12,50 ; Shabbat 152b.
15. Shabbat 152a.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 123
les vivants dans leurs reves. Ils peuvent ainsi se plaindre de ladisparition de leur linceul, du non-remboursement d’unedette, comme les prevenir d’un danger, les aider a arrangerleurs affaires terrestres, voire leur divulguer un enseignement.
Les differentes approches de la mort qui se superposent dansles acceptions juives debouchent sur une aporie qui montreque vie et mort peuvent etre des termes interchangeables,comme l’indique Maımonide : « Les hommes pieux, memeapres leur mort sont appeles ‘‘vivants’’ et les impies, memependant leur vie, sont appeles ‘‘morts’’ »16. Inities a toutes lesconceptions de l’ame, qu’il s’agisse des multiples variantes duplatonisme, du Kalam, ou de l’aristotelisme, les philosophesjuifs medievaux tenterent de concilier aspirations theoriques ettradition juive. En effet, la notion d’immortalite de l’ame,qu’elle soit concue comme substance, ou comme pur intellect,ne s’ajuste guere a une tradition juive affirmant la resurrectiondu corps et de l’ame lors de leur reunion finale dans le mondea venir. Si le Pentateuque utilise indifferemment les termesneshamah et rouah, au sens de « souffle », et nefesh au sens de« personne » ou d’etre vivant, la litterature juive ulterieure a fixel’usage de leur faire traduire des niveaux distincts de l’ame. Del’ame du corps a l’ame divine, en passant par l’ame spirituelle,les penseurs et mystiques juifs ont construit une sorte decosmologie de l’ame, qui, reduisant la dialectique classiquecorps versus ame, pose que les juifs ont des corps en cemonde, et des ames dans l’autre17. Partenaires indefectiblesdurant la vie, corps et ames sont desunis par la mort : tandisque le corps se decharne et se decompose, l’ame, selon qu’elle
124 La mort et ses au-dela
16. Moıse ben, MAIMONIDE, se fondant sur Berakhot, 18a-b, MorehNevoukhim, trad. francaise de Salomon MUNK, Guide des egares, Paris,[1856], Lagrasse, Verdier, 1979, § 42, p. 96.
17. Je me permets d’emprunter la formule a Michael FISHBANE, The Kiss ofGod : Spiritual and Mystical Death in Judaism, p. 45, Seattle, University ofWashington Press, 1994.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 124
appartenait a un juste ou a un pecheur, s’elevera vers lesspheres divines ou stagnera dans les limbes terrestres, en atten-dant d’etre rachetee, par ses descendants ou par quelquemerite obtenu grace au repentir.
En parallele a l’idee des mondes superieurs et inferieurs, unterritoire de l’au-dela d’En Haut est reserve aux justes, et unespace de l’au-dela d’En Bas accueille les pecheurs et lesimpies : la Gehenne (gehinnom). Alors que le terme sheol desi-gnait dans la Bible hebraıque l’espace indifferencie ou gisaientles morts et dont rien n’emane, le judaısme plus tardif a des-sine, en elaborant les conceptions de l’autre monde, lescontours de ses deux versants distincts : l’un destine a ceuxqui vont vers la vie eternelle et l’autre a ceux qui n’y vont pasdirectement ou n’y accederont jamais. S’il existe une categorieparticuliere de « justes » qui parviennent directement, tel Moıseet Aaron, au jardin d’Eden dans le « faisceau des vivants », etqui sont emportes par « la mort dans un baiser »18, le commundes mortels se retrouve en gehenne. Garde par des geoliers, cenon-lieu, incommensurable, ou l’on prodigue quantite detourments aux impies, allant de la pendaison a la rotissoireest traverse par une riviere de feu19. Sachant qu’il ne sauraitetre d’humain qui n’ait d’une maniere ou d’une autre trans-gresse les commandements divins20, c’est la que parviennentdes le trepas tous les pecheurs ordinaires pour y subir leschatiments jauges a l’aune de leurs actes. Ils y passent douzemois a s’y purifier21, a l’exception des jours du shabbat, ou ilsse reposent22. Echappant alors a la gehenne, ils retournent errer
125La mort dans le monde juif
18. Dt 34,5 ; Dt Rabba 11,10. Sur l’aspiration spirituelle a la mort, voir FISH-
BANE, The Kiss of God, op. cit.
19. Hagigah 13b, la tradition a transmis l’idee qu’il s’agissait du gue du Jabbok,ou Jacob avait combattu l’Ange, devenant de la sorte Israel (Gn 32,23).
20. Shabbat, 55a, d’apres 1Rois, 8, 46 ; Ecclesiaste, 7,20.
21. La duree de ce sejour et ses conditions est neanmoins aprement discutee enRosh Ha-shana 16b-17a.
22. Genese Rabba, 11, 5.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 125
autour de leurs anciens domiciles terrestres. C’est la raison pourlaquelle l’usage s’est instaure de retarder autant que possible leretour a la vie profane suivant la sortie du shabbat, afin de leurlaisser le temps de reintegrer leur penible villegiature et lesempecher de nuire aux vivants23. Estimant que ce sejour nesaurait etre epargne a quiconque, les docteurs ont defini lesvoies permettant non pas de l’esquiver mais d’acceder nean-moins, par les rituels et le repentir, a la sphere superieure.
A la source du rituel
Lentement edifiee, la relation des juifs a la mort est orientee parl’idee de la resurrection des corps dans le monde a venir.Decrite dans la vision d’Ezechiel24, elle a donne lieu a l’emer-gence d’un ensemble de preceptes et d’attitudes qui s’enracine,on l’a vu, dans la Bible. Pour autant, l’histoire atteste qu’atti-tudes et preceptes n’ont cesse d’evoluer au gre des differentesepoques et des cultures traversees par le judaısme. Alors quel’iconographie juive, tres lacunaire, est quasi inexistante en lamatiere, les sources textuelles qui temoignent de ces passagesabondent. Le corpus princeps est fonde par les textes clas-siques de la tradition juive : la Bible et le Talmud, qui formentle socle sur lequel viendront s’ajuster les accommodements dessiecles. Ainsi l’origine de l’ensevelissement renvoie-t-il al’epoque des Patriarches de la Bible, tandis que la mentionla plus ancienne d’une priere recitee pour les morts apparaıtdans le second livre des Maccabees, lorsque Juda prie pour lerachat de l’ame des pecheurs25. Quant au recueil des lois et desrituels lies a la mort, a l’enterrement, et au deuil, il semble avoirete compile pour la premiere fois dans le traite de la mishna
126 La mort et ses au-dela
23. Midrash Tanhuma, Ha’azinu ; Sefer hasidim, § 1170.
24. Ezechiel, 37, 1-14.
25. 2M 12, 39-46.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 126
Evel Rabbati (Grand deuil) surnomme Semahot (Rejouis-sances), probablement a la fin du IIIe siecle de l’ere courante26.C’est a partir de ce corpus de codifications qu’ont ete deter-mines certains elements fondamentaux concernant la mort,l’enterrement et les rituels du deuil transmis dans le judaısme.
Le contexte historique tres particulier de la Palestine duIIIe siecle, dresse la toile de fond sur laquelle le traite Semahota ete redige. Province vassale de l’Empire romain, la Palestinedu IIIe siecle subissait encore les consequences de la repressiondraconienne imposee apres la Grande Revolte de 135. Les juifsqui restaient alors en Palestine etaient, en quelque sorte, dessurvivants. Ils avaient echappe auxmassacres, a la vente en tantqu’esclaves et aux deportations vers les autres provincesromaines, et l’acces a Jerusalem, la ville sainte, leur etait tou-jours interdit. Il ne fait pas doute que ce contexte penible acontribue a placer la mort au cœur des debats rabbiniques,puisque les prescriptions a mettre en œuvre lors de l’enterre-ment et du deuil avaient une resonance immediatement per-ceptible dans la vie quotidienne.
Organise en quatorze chapitres thematiques, ce traite de lamort et du deuil examine chaque cas de deces ou de deuilau regard des prescriptions de la loi juive (la halakha), depuis lestatut dumourant jusqu’a la question de l’heritage des tombes.Sont ainsi passees en revue les questions relatives aux defuntspour lesquels on doit ou non prendre le deuil, aux mortsconsiderees comme « normales » et a celles qui ne le sont pas,comme celle des enfants, des mort-nes, ou des suicides. Quelssont les cas dans lesquels les rituels funeraires peuvent etresuivis ou pas : que faire lorsque, par exemple, le defunt est uncondamne a mort ? Comment doit-on se comporter avec undefunt qui aurait rompu tous les liens avec son peuple ? Com-
127La mort dans le monde juif
26. En texte bilingue, anglais-hebreu : Dov ZLOTNICK, The Tractate Mourning(Semahot), New Haven & Londres, Yale University Press, 1966.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 127
ment faut-il proceder avec les restes de ceux qui ont ete assas-sines, devores par une bete sauvage, noyes, ou crucifies ? Lamort des enfants occupe une place considerable dans le traite,car les rituels sont strictement codifies en fonction de l’age etde la condition sociale du defunt. Et il en va de meme del’organisation du cortege funeraire et de la recitation des ele-gies funebres. Une grande attention est portee au travail dudeuil, car entre le moment ou il commence et celui ou il doits’achever, une serie de prescriptions et d’interdits scanderontprecisement chacune des etapes de l’annee de sa duree.
Certes, nombre de pratiques mentionnees dans ce traite tellesla dramaturgie usuelle a l’epoque romaine des pleureuses etde la laceration, le double enterrement, d’abord par la deposeen ossuaire puis par le ramassage des ossements, sont tom-bees en desuetude. Car le contexte et les mœurs de la Pales-tine du IIIe siecle ont peu a voir avec ceux dans lesquels lesjudaısmes orientaux et occidentaux ont evolue dans lesespaces musulmans ou dans l’Occident chretien medieval,et a fortiorimoins encore avec ceux qui regnent dans le mondecontemporain. Mais on peut constater que les prescriptionsenjointes par ce traite, une fois transposees dans le temps, ontfixe nombre d’aspects d’une relation specifique des juifs a lamort. Au cours du Moyen Age et de l’epoque moderne, desouvrages doctrinaux, comme la Torat ha-Adam (lit. : la doc-trine de l’homme) redige par le rabbin de Gerone, MoıseNahmanide au XIIIe siecle, ou le Shulhan Aroukh (lit. : latable dressee), recueil de codifications generales redigees auXVIe siecle par le kabbaliste et legislateur Joseph Caro, ontmodele puis fixe des rituels qui perdurent encore actuelle-ment dans les milieux orthodoxes et ont ete simplifies ouattenues dans les milieux de moindre observance. Outre lespratiques rituelles, la relation singuliere des juifs a l’au-dela sedecouvre dans la litterature du lit de mort, qui apaise salugubre familiarite. Tres populaire a partir du XVIIe siecle,beneficiant de la diffusion de l’imprimerie, elle se repand dans
128 La mort et ses au-dela
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 128
le sillage de l’ouvrage fortement impregne de kabbale, leMa’avar Yabbok [le Passage du Jabbok], qui se disseminedans les communautes juives jusqu’a penetrer les structuressociales instituees par la creation de la Hevra Kaddisha dansles communautes juives europeennes a partir du XVIe siecle.Ayant transpose le traite du deuil en «Rejouissances »(semahot), la litterature mortuaire en « arbre de vie » (ets ha-hayim), le cimetiere en «maison des vivants » (bet hayim) ouen «maison d’eternite » (bet olam) voire, en yiddish, en « bonendroit » (gutn ort), ces locutions d’evitement attestent lesmanieres de son apprivoisement. Et, tandis que les ArtesMoriendi se propageaient dans le monde chretien, c’est leSefer ha-Hayim (lit. : livre de la vie), qui, transformant l’artde mourir en art de vivre, s’est enseigne en monde juif27.
Le dernier voyage. Se respecter entre morts et vivants
Le fil tendu au-dela des siecles par la perennite de certainsusages des juifs, entre l’antique traite du Talmud et lespratiques modernes, revele la transmission de quelques atti-tudes caracteristiques. La premiere, qui determine l’en-semble des comportements et des rites, tient au respect dua la vie humaine autant qu’a l’integrite de son enveloppe : lecorps. Tout en considerant l’etre vivant comme une creationde Dieu, faite a son image, telle que la decrit le premierchapitre du livre de la Genese, le judaısme ne percoit danssa depouille qu’un cadavre dont le contact induit, pour lesvivants, une souillure. Mais c’est autant pour eviter laconfrontation des vivants a la corruption d’un etre cher quepar respect de la dignite du defunt, qu’il convient de l’in-
129La mort dans le monde juif
27. Le Sefer ha-hayim fut l’un des livres de coutumes mortuaires et funerairesles plus populaires dans les communautes juives. Voir Sylvie Anne GOLDBERG,Les Deux Rives du Yabbok. La maladie et la mort dans le Judaısme ashkenaze.Prague XVIe-XVIIIe siecles, Paris, Cerf, 1989.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 129
humer rapidement28. Car les corps, une fois recomposes apartir de leurs restes, regagneront leur plenitude dans l’eter-nite du monde a venir. De cette dualite conceptuelle decouleune ambivalence qui implique de traiter l’individu tant qu’ildetient un souffle de vie, et fut-il malade ou agonisant, avectous les egards que l’on doit aux vivants. Quant au cadavre,aussi impur soit-il, il doit neanmoins recevoir les derniersdevoirs qui lui permettront d’atteindre le temps de la resur-rection. L’agonisant doit donc etre traite en toute chose,comme un etre vivant jusqu’a ce qu’il expire et que sa mortait ete dument verifiee. Le rabbin de Gerone, Nahmanide
130 La mort et ses au-dela
Cimetiere juif medieval de Francfort
28. Sanhedrin, 6, 4, 46a, sur Deuteronome, 21, 23.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 130
[1194 – 1270] rappelait : « on ne l’attache pas, on ne le poussepas, on ne bouche pas ses orifices et on ne le depose pas aterre », pas plus qu’on ne lui ferme les yeux avant qu’il n’aitexhale son dernier souffle, car « toute action de ce genres’apparente a un veritable assassinat »29. On s’abstiendradonc egalement de lancer l’organisation des funerailles pro-prement dites, ce qui n’empeche pas de faire appel aux mem-bres de la Confrerie du dernier devoir afin qu’ils viennentassister le mourant et les siens, dans la recitation des prieresd’usages et pour le bon deroulement des derniers instants.
Une fois son dernier souffle exhale, la depouille doit etrepreparee pour son dernier voyage. Elle est d’abord deposeesur le sol – en rappel de la poussiere dont elle a ete faconnee –,des bougies posees pres de son visage – car l’ame est unflambeau divin. On procedera ensuite a la purification rituelle,la tahara. Un soin particulier est devolu a preserver la dignitedu corps et la decence pour les vivants. Ainsi, alors que lesdisciples peuvent rendre ce dernier devoir a leur maıtre, unenfant ne doit pas le faire pour ses parents, et la separation desgenres – les femmes s’occupant des femmes et les hommes deshommes –, est strictement respectee. Sans jamais etre denude,le cadavre sera minutieusement lave selon un ordre precisallant du haut – siege de la shehina (emanation divine) – versle bas – siege de l’impurete. Aucune malproprete ni le moindregrain de poussiere ne doivent rester sur la peau ou dans lescheveux. Enfin la depouille sera revetue de ses vetementsmortuaires, un assemblage de lin blanc emmaillotant. Avantde recouvrir le visage, un peu de poussiere est repandue dansles yeux que l’on refermera. Un homme sera ensuite recouvertde son chale de priere. Depuis l’epoque talmudique, unegrande importance est accordee au vetement du mort « car levetement dans lequel on enterre, sera porte lors de la Resur-
131La mort dans le monde juif
29. Moıse NAHMANIDE,Torat Adam, « inyan petirah », [Naples 1490] Varsovie,1876.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 131
rection »30. Il pourra meme lui servir de « reserve pour la route »qu’il suivra au cours de son periple dans l’au-dela31. Suaire etchale de priere enveloppent ainsi les deux facettes de l’ame, lacorporelle et la divine, qui seront reunies lors de la resurrec-tion. C’est aussi la raison pour laquelle dans les communautestraditionnelles l’usage voulait que l’on enterre les savants avecla table sur laquelle ils avaient etudie. Afin de faciliter le voyagevers la terre d’Israel au moment voulu, les communautes ontinstaure au fil du temps des usages divers. Le Talmud deJerusalem recommandait ainsi d’enterrer pres d’une routepour raccourcir le trajet vers Jerusalem. Plus tard, au MoyenAge, en Europe du Nord, on enterrait les defunts avec deschaussures32. En d’autres communautes, on releve encore audebut du XXe siecle la coutume d’inhumer le cadavre munid’un gepelekh, sorte de pelle placee entre ses doigts qui devaitlui permettre de frayer son chemin hors de la tombe33. Cou-tumes et raison ne cohabitent cependant pas aisement. AinsiMaımonide [1138-1204] ironisait-il en son temps sur le soinque l’on mettait a revetir les defunts des plus belles parures :« Tout le monde, gens du peuple comme lettres, se demandecomment la resurrection s’effectuera, si les gens reviendrontnus ou habilles, et si tel sera le cas, s’ils seront vraiment revetusdes atours dans lesquels ils sont enterres, ou si les vetements neserviront qu’a couvrir les corps »34.
132 La mort et ses au-dela
30. TJ Kilayim, 9,4 ; TJ Ketubot 12,3 ; 34d-53a ; TB Shabbat 114a.
31. Selon le commentaire de Rashi sur Gn 52,25.
32. TJ Kilayim 9,4, 32b. Rashi, commentaire sur Yebamot 104a ; Eleazar benJudah de Worms, Sefer ha-rokeah ha-Gadol, Barukh S. Schneurson (ed.), Jeru-salem, 1967, p. 194.
33. Dos Yiddishe etnographishe program, question no 1909, dans NathanielDeutsch, The Jewish Dark Continent, Harvard University Press, 2011, 291.Egalement Paul Isaac Hershon, Otsrot ha-Talmud, Londres, Ames Nisbet &co., 1882, 285 ; Ganzfried, Code of Jewish Law, vol., 4, 99.
34. Maımonide, Commentaire sur la Mishna, Nezikim, J. Kaffah (trad.), Jeru-salem, 1965, p. 134.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 132
Si le respect de l’integrite du corps vivant est un principe qui aaisement traverse les siecles et les mœurs, celui de celle ducorps post-mortem a regagne une actualite inattendue. Entemoigne la sorte de brigade d’hommes en noir (anesheizakah35) qui, arborant papillotes et gilet fluorescent jaune,s’est donne pour tache en Israel de recueillir et de rassemblerles fragments corporels humains eparpilles sur les lieux ou sesont deroules des accidents ou des attentats meurtriers. Leursavoir faire les conduit egalement a se rendre dans tous les lieuxdumonde ou se produisent tremblements de terre, tsunamis etautres catastrophes humanitaires, qui necessitent l’identifica-tion des restes. Ce faisant, ils executent le commandement quiprescrit depuis l’epoque de la Mishna de prendre soin de tout«mort abandonne » (met mitsva)36.
133La mort dans le monde juif
Realisation du linceul. Peinture realisee au debut du XIXe sieclepour la confrerie funeraire (Hevra Kadisha) de Prague
35. Acronyme des termes Zihui Korbanot Ha-son : identification de victimes decatastrophes.
36. Semahot, 4, 29 ; Babba Kama, 81a. Cette pratique est attestee par FLAVIUS
JOSEPHE, Contre Apion, II, 29, 211, T. Reinach & Leon Blum (eds.), Paris, Les
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 133
Ceux qui restent
Le passage de la vie au trepas marque un second aspect d’unerelation a la mort qui s’etend aux survivants durant la periodeou la mort et le deuil les environnent. La tradition juive tientque l’inhumation du defunt doit etre effectuee au plus vite paregard pour la dignite des defunts et pour eviter a ses prochesune epreuve supplementaire. Les codifications se concentrentsur les interdits qui frappent la famille dumort afin d’empecherqu’elle se comporte comme s’il ne s’etait rien passe d’inhabi-tuel. Apres avoir dechire un pan de son vetement, le survivantdoit veiller a ce que les rites mortuaires soient accomplis,toilette rituelle et veille de la depouille incluse. Jusqu’a lamise en terre, une atmosphere de bouleversement doit regner :prieres et commandements quotidiens suspendus, repas fru-gaux et pris debout, abstention de la chambre a coucher et de latoilette, affirment que l’ordre des vivants est rompu. Dans lescommunautes traditionnelles, tous doivent assister a la leveedu corps et former le cortege qui l’accompagnera a sa dernieredemeure. Nul ne marchera devant la civiere, la proche familleimmediatement derriere elle. Strictement separes, hommes etfemmes forment des corteges distincts, hommes devant,femmes ensuite. La biere est deposee devant la fosse beante,ou commence la ceremonie funeraire. On recitera le tisdduk ha-din (l’accomplissement du jugement), puis le kaddish et l’onprocedera ensuite a nouveau a la dechirure du vetement par lesproches. Depose par les fossoyeurs dans sa tombe « commeentre les bras de l’univers », le defunt sera recouvert de terre,puis chacun viendra deposer trois pelletees de terre, accompa-gnees d’une aumone car « la charite sauve de la mort ». La fossecomblee, le rituel funeraire proprement dit est termine. L’im-portance accordee a la participation collective de la commu-
134 La mort et ses au-dela
Belles Lettres, 1972 ; et PHILON D’ALEXANDRIE, Hypothetica, VII,7, RogerArnaldez, Jean Pouilloux, Claude Mondesert (eds.), Les œuvres de Philon d’Ale-xandrie, Paris, Le Cerf, 1961-1992.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 134
naute est accentuee par la formule de condoleances que l’onpresente aux endeuilles : « Que Dieu vous console parmi tousles endeuilles d’Israel », qui rappelle le destin commun du klalYisrael (la communaute d’Israel)37.
Debute alors ce que nos contemporains nomment le travail dudeuil. Les commandements qui reglent formellement laperiode de deuil ne sont applicables que pour le deces del’un des sept proches suivants : pere, mere, fils, fille, frere ousœur, epoux et epouse. Etale sur une annee, le deuil se repartiten trois etapes a l’issue desquelles l’endeuille doit reintegrer lederoulement d’une vie sociale interrompue par la mort. Sui-vant la periode de desordre et de hate qui precede l’enterre-ment, la premiere semaine (shivah), puis l’etape des trentejours (sheloshim) qui lui succede, peuvent etre comparees aune mise entre parentheses de la vie publique. Brutale etcomplete pendant les sept premiers jours, graduellementmoins stricte durant les trente suivants, et en pointilles, pour
135La mort dans le monde juif
Sortie du corps vers le cimetiere. Peinture realisee au debut du XIXe sieclepour la confrerie funeraire (Hevra Kadisha) de Prague
37. Pour une descriptionminutieuse de ces etapes : Goldberg, Les Deux rives duYabbok, op. cit.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 135
inciter a l’integration du deuil dans l’espace prive, durant lesonze mois qui s’acheveront par la commemoration de la dateanniversaire du deces, le yahrzeit, et, dans les communautesashkenazes par la pose de la pierre tombale.
La procedure des etapes du deuil, pour surprenante quesa codification minutieuse puisse sembler, n’en poursuitpas moins une logique dont la raison est limpide dans lesapproches contemporaines. Codifiee dans ses grandes lignesdes l’epoque du Talmud, elle repondait deja a un imperatifsocial clairement enonce : « Trois jours pour se lamenter, septpour les elegies, trente pour les vetements et les cheveux »38.Car il serait tout aussi inconvenant de ne pas exprimer sondeuil que de le faire trop ostensiblement. Ainsi, au long de laperiode de la shivah, la famille est-elle recluse, dans la maisondu defunt ou chez l’un de ses membres. Toute activite leuretant interdite, c’est a l’entourage de leur prodiguer la nourri-ture, surtout lors du premier repas, dit de condoleances : « carl’avel (l’endeuille) etant perturbe par son mort, il ne penseguere a manger puisque son desir est demourir ; c’est pourquoiil doit etre nourri par d’autres »39. Une bougie allumee pourl’ame du defunt, les miroirs, chaises et lits renverses et recou-verts de draps ou d’etoffe, les endeuilles restent assis a meme lesol ou sur un siege bas, sans chaussures, arborant la semainedurant le meme vetement dechire : ils sont a l’image de Job,auquel nul n’osait adresser la parole tant « sa douleur etaitaccablante »40. Tenus de nourrir les endeuilles, les visiteurs-consolateurs, doivent cependant s’abstenir de leur adresser laparole, sans y avoir ete invite durant les trois premiers joursreserves aux larmes. La progression de ce processus est d’au-
136 La mort et ses au-dela
38. Talmud de Babylone, Mo’ed Katan, 27b.
39. ASHER BEN YEHIEL [ca 1250-1327],Orehot hayim (Fano 1503), « halakhotavel », 13, 5 ; Rabeinu Yeroham ben Meshullam de Provence [1290-1350],Toledot Adam ve-Hava (Constantinople, 1516), «Nativ koah », II, 203.
40. Job 2, 13
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 136
tant plus perceptible qu’apres la levee du deuil, qui s’effectuedevant une assistance composee de proches, famille et amis,l’endeuille doit remettre ses chaussures, oter son vetementdechire et, surtout, renouer doucement avec les exigences desociabilite de la vie quotidienne. Il a encore trente jours pourinterioriser son chagrin, qu’il ne manifestera qu’en arborantcheveux non coupes et barbe non rasee, en changeant de placea la synagogue et en ne participant a aucune ceremoniejoyeuse. Les trente jours ecoules (ou suspendus par une fetereligieuse), l’annee de deuil se poursuit uniquement dans lasphere privee : en evitant tout achat non indispensable, enfuyant les rejouissances, et en recitant quotidiennement labenediction appropriee.
Le devoir de vivre
Fixes depuis l’epoque du Talmud, les grands principes desrituels associes a la mort pourraient paraıtre inchanges sil’on ne tenait compte des mutations considerables qui enont transforme les representations, par les manieres de faireet, surtout de les entendre. La notion de « preservation d’unevie humaine », pikuah nefesh, illustre ce phenomene. A partir duverset du livre du Levitique enjoignant de ne pas rester impas-sible devant le sang verse41, les rabbins du Talmud, placant lavaleur de la vie humaine au-dessus de toute autre considera-tion, ont pose en termes axiomatiques qu’il etait possible d’en-freindre un commandement si cela devait permettre de sauverquelqu’un se trouvant en danger de mourir42. Pour saisir lesens de l’implication concrete de cet axiome, un exemple,aisement accessible, est fourni par les interdits qui s’appliquentau respect du repos sabbatique : c’est aux jours de shabbat et
137La mort dans le monde juif
41. Levitique 19, 16.
42. Yoma 85a
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 137
de fetes religieuses que les plus severes defaites furent infligeesaux populations juives desarmees, notamment pendant lesguerres. Invoquant le principe du pikuah nefesh, le devoir depreserver la vie, le pretreMattathias en tira les consequences etleva l’interdit du port d’armes lors des guerres hasmoneennes(165 av. J.-C.), creant ainsi un precedent juridique permettantde se defendre43. Cette regle s’impose surtout dans le domainede la sante et de la maladie, car elle permet de circonvenirla plupart des embuches posees par l’extreme observance : ilest donc tout aussi normal d’appeler les pompiers ou uneambulance, que de conduire une femme en couches a l’hopitalen cas d’urgence, meme si l’usage d’un telephone ou d’unmoyen de transport n’est en principe pas autorise. Ainsi,la consommation d’aliments prohibes ou sous forme de medi-caments peut etre admise s’il n’existe pas d’autre recours. Etil en va de meme quant aux greffes d’organes, autorisees endepit de la contrainte de la preservation indispensable de l’in-tegrite des corps, puisqu’il s’agit la de le faire afin de sauverd’autres vies.
Il n’empeche. Au cours de l’histoire, la formule axiomatiqueconnut un developpement capital. Entrelacant le sort de la vieen ce monde-ci au devenir de la vie eternelle dans l’autremonde elle put etre utilisee a d’autres fins. Passant du corpsa l’ame, le terme hebraıque nefesh pouvant renvoyer a l’uncomme a l’autre, la notion en vint, au nom de la preservationde l’ame, a servir de justification au sacrifice du corps « Pour laSanctification du Nom » (kiddush ha-Shem). Par un retourne-ment tout aussi semantique que symbolique, l’idee de la pre-servation de la vie (eternelle) permit d’inciter a sonrenoncement terrestre, d’autant qu’« eloignee de Dieu la vien’est que mort » comme l’avait clame Judah Halevi [1085-1141] dans un poeme insere dans la liturgie de Yom kippur
138 La mort et ses au-dela
43. 1M, 2,41.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 138
(Jour duGrand Pardon)44. Cette extension se justifie par le faitque le Talmud avait etabli au concile de Lod que plutot qued’enfreindre sous la menace l’une ou l’autre des trois prohibi-tions que sont l’idolatrie, la morale sexuelle (inceste, adultere)et le meurtre45, qui ferment l’acces au monde a venir, il valaitmieux opter pour le martyre en ce bas monde. Et de fait, le casdu suicide collectif des defenseurs de la forteresse de Massada,rapporte par Flavius Josephe46, illustre cette exigence demourir pour Dieu, alors meme que l’un des dix commande-ments bibliques est de ne pas commettre de meurtre. Aiguiseepar les persecutions visant a les convertir, la notion fut raviveeau Moyen Age, et les rabbins durent debattre des attitudes atenir face a ces deux facettes que sont, d’un cote le droit detransgresser les commandements pour sauver une vie et, del’autre, le devoir de la sacrifier pour eviter de le faire. Lesrabbins de la sphere orientale, dont Maımonide fut le repre-sentant le plus notoire, opterent pour le sacrifice a minima :preserver sa vie en acceptant la conversion, lorsque cela est faitsans ostentation, est un devoir qui permet ensuite le retour aujudaısme, et ce, d’autant plus que la loi juive l’autorise47.A l’inverse, les codificateurs de la sphere chretienne, dont lescoreligionnaires contemporains avaient massivement pratiqueles suicides et meurtres collectifs lors du passage des croises48,pronaient la mort en martyr sans restriction49.
139La mort dans le monde juif
44. En version bilingue, hebreu-anglais, T. CARMI,The Penguin Book of HebrewVerse, New York, 1981, 336-337.
45. Sanhedrin 74a.
46. FLAVIUS JOSEPHE, La guerre des Juifs, VII, 9, trad. Pierre SAVINEL, Paris,les editions de Minuit, p. 549-550.
47. Moıse MAIMONIDE, Yad, Yesodei ha-Torah, 5, 1-3, « Epıtre sur la perse-cution », Epıtres, Lagrasse, Verdier, 1983.
48. Une edition recente des chroniques hebraıques des croisades : Eva HAVER-
KAMP, Hebraische Berichte uber die Judenverfolgungen wahrend des ersten Kreuz-zugs Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2005.
49. Tos. Avodah Zara 27b ; 54a.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 139
Se souvenir des disparus
Les pratiques et les representations du judaısme evoluerentconsiderablement durant le premier millenaire de l’ere chre-tienne, et nombre d’innovations furent introduites apres lapremiere croisade. Devenues indissociables des coutumesjuives associees a la mort, elles relevent, pour la plupart d’entreelles, d’une attention particuliere centree en ce monde-ci surle monde a venir. L’un des developpements remarquables dela culture juive durant le Moyen Age est l’espace devolu a lamemoire dans les rituels, la liturgie et les compositions litte-raires. C’est dans ce cadre que la place octroyee a la mort dansles attitudes juives se revele preponderante. Se parant d’unedouble expression, elle s’inscrit dans les rituels, collectifs etindividuels, etablissant ainsi une forme de theologie memo-rielle, s’appuyant sur la commemoration des tragedies quiparsement la vie juive50. La benediction Av ha-rahamim(Pere misericordieux) inseree dans la liturgie de la fete deShavuot (Pentecote) et du 9 Av (qui commemore la destruc-tion des deux Temples et toutes les catastrophes survenuesdepuis), rappelle les evenements en ces termes : « Veuille lepere misericordieux, qui reside en haut, se souvenir dans samisericorde des hommes pieux, droits et integres, des saintescommunautes qui ont offert leurs vies pour la sanctification dunom divin : aimables et agreables de leurs vivants, ils n’ont pasete separes dans la mort. Ils furent plus legers que les aigles,plus puissants que les lions pour accomplir la volonte de leurCreateur et le desir de leur Rocher. Veuille notre Dieu sesouvenir d’eux avec faveur ainsi que de tous les autres justesdu monde et venger le sang repandu de ses serviteurs »51.
140 La mort et ses au-dela
50. Yosef Hayim YERUSHALMI, Zakhor. Histoire juive memoire juive, Paris, LaDecouverte, 1984 ; David MYERS, « ‘‘Mehabevin et ha-tsarot’’ : Crusade Memo-ries and Modern Jewish Martyrologies », Jewish History, 13, Fall 1999, p. 49-64.
51. Simon SCHWARZFUCHS, Les Juifs au temps des croisades, Paris, AlbinMichel, 2005, p. 178.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 140
Renforcant la liturgie, emergerent les livres de memoires,Memorbucher ou Yizkerbikher, comportant un martyrologecommunautaire remontant aux massacres qui se deroulerentdans la region rhenane, et auxquels furent systematiquementajoutees les tragedies successives.
L’entrelacement de la memoire et de la mort se decouvredans l’introduction de prieres singulieres : le rappel des ames,la hazkarat neshamot, dans le rituel des offices des grandesfetes, la recitation du Kaddish des endeuilles, et la priere desmorts proprement dite, le El Male rahamim (Dieu est plein demisericorde). Ces trois innovations liturgiques, qui irriguentl’ensemble de la relation juive a la mort, signalent incidem-ment une transformation d’un autre ordre. Accompagnantl’idee qu’il etait possible d’agir en ce monde-ci sur le devenirdans le monde futur, en rappelant le souvenir des ames desdisparus lors du jour anniversaire de leur deces et a l’occasiondes grandes fetes, on prie pour leur salut, mais on tentesimultanement de les apaiser pour se preserver de leur vin-dicte52. La recitation de la « sanctification », le kaddish, partintegrante des offices journaliers, n’a ete associee au rituelfuneraire qu’a partir, semble-t-il des XIIe-XIIIe siecles. Carac-terise par ses nombreuses glorifications du nom de Dieu, sontexte mentionne explicitement la resurrection. Prononce desl’enterrement, inclus dans le rituel quotidien du deuil, ou ildoit etre recite l’annee durant, puis chaque annee au jouranniversaire du deces, la sanctification affirme la foi desvivants dans le jugement divin. On lui prete cependant lepouvoir de parvenir a racheter l’ame du defunt, et d’assurer,en quelque sorte, sa resurrection dans le monde a venir. Dansl’imaginaire ashkenaze, l’association du fils au kaddish n’estpas exclusivement symbolique : puisque c’est au fils querevient la tache de le reciter pour ses parents defunts, lalangue yiddish a popularise l’expression courante disant de
141La mort dans le monde juif
52. Midrach Tanhumah, Ha’azinu.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 141
quelque decede sans enfant male, « qu’il n’a pas meme laisseun kaddish ».
Le monde d’a cote.
« Comme on le sait, le sens du kaddish est d’annuler la Gehenneet d’envoyer des forces benefiques. Ainsi le fils, en recitant lekaddish, sort son pere des abımes pour l’envoyer au Gan Eden(le paradis)53 ». Ce transfert de responsabilite, le fils devenantle garant du passage de son pere dans le monde a venir, signalela forte accentuation de l’interdependance entre les mondesd’ici et d’en haut introduite par la kabbale dans les approchesjuives. Mouvement de pensee mystique reserve, jadis, auxlettres, la kabbale de Safed s’est repandue dans les commu-nautes juives en s’enchassant dans l’ensemble des pratiques.Penetrant les domaines de l’ethique, des prieres et des cou-tumes, les motifs kabbalistiques ont recompose les expressionsde la religiosite juive autant sous ses formes verbales que dansses aspects rituels. L’immense popularite rencontree par leMa’avar Yabbok, redige par le rabbin italien Aaron Berachiade Modene en 1626, signale la metamorphose operee par lalitterature mortuaire : loin de se cantonner au lit de mort, elleinforme la piete ordinaire. Car sachant qu’il est a chaqueinstant soumis a la volonte divine qui fait vivre et mourir,l’individu doit penser a sa mort « comme s’il etait couche eten danger mortel »54. Renvoyant chaque soir son ame au Crea-teur, en recitant le « Ecoute Israel », le Shema Yisrael, qui seraegalement son ultime affirmation de foi, le juif se retrouvechaque nuit, en s’enfoncant dans le sommeil, dans un universou « comme dans la mort, les ames montent et naviguent
142 La mort et ses au-dela
53. Aron BERACHIA DE MODENE, Ma’avar Yabbok, [Mantoue 1626], ed.Vilna 1860 – fac-simile Jerusalem 1989 Sefat Emet, 2, 29, p. 234.
54. Isaıe HOROWITZ [c. 1565-1630], Shnei Luhot ha-berit, « ner mitsvah »,[Amsterdam, 1649] Jerusalem, 1970.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 142
dans l’univers »55. Il faut neanmoins distinguer la « grande »mort – la reelle – de la « petite » – le sommeil – car lorsquel’individu dort, son ame se repose en inspirant un peu de la vied’En Haut56.
Lamort d’un proche engage une brisure cosmique : elle ouvreune breche entre les univers ordinairement compartimentesentre les vivants et les morts. Car s’etant introduit au seind’une famille pour s’emparer de sa proie, l’Ange de la mortplane autour d’elle, guettant l’occasion d’en happer d’autres.On se hatera donc de jeter au dehors toute eau qui seraitencore a la maison, de crainte qu’elle ait ete empoisonnee parl’Ange de la mort (malakh ha-mavet) qui a pu laver son epeedans les recipients qui la contiennent57. En outre, celui qui estrecemment passe de vie a trepas n’a pas immediatement accesau monde des morts. A nouvelles conceptions, nouvellesinterpretations : les etapes du deuil sont comprises commeles differentes etapes que le defunt devra franchir avant deconnaıtre le repos. Tandis que les trois elements de l’ameforment la plenitude de l’individu tant qu’il est en vie, la mortles separe douloureusement en entites distinctes : ame ducorps, ame du souffle, ame de l’essence, ont chacune leurpropre fonction. Apres la cessation de la vie humaine, ellesdevront patienter jusqu’a ce que la resurrection les reunisse ajamais. Ainsi, avec l’exhalaison du dernier souffle, et jus-qu’aux trois premiers jours, consacres par ses proches auxpleurs, l’ame endure les infinis tourments de la separation.Ecartee de son receptacle corporel, elle rode autour de lui,assiste a la toilette funeraire, a l’inhumation, puis va-et-viententre maison et cimetiere jusqu’a la fin de la premiere
143La mort dans le monde juif
55. Isaıe HOROWITZ, Shnei Luhot ha-berit, op. cit., «Massekhet Hullin », a com-parer avec midrash Tehilim, 11,6, edition S. Buber, Vilna, 1891, p. 51b.
56. Ma’avar Yabbok, op. cit., Sefat Emet, 2, 17.
57. L’Ange est debout entre terre et cieux, une epee degainee a la main, en1 Chroniques, 21,16.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 143
semaine58. La shivah, l’etape des sept jours, correspond doncau moment ou l’ame porte son propre deuil, avant d’echouer,a l’instar de tous les pecheurs ordinaires, en Gehenne ou ellesejournera en purgatoire durant l’annee suivante.
La Kabbale de Safed deploie l’espace cosmique. Amenuisantles cloisonnements entre les mondes, elle fait se rencontrer lesmorts et les vivants. En transformant l’interpretation des termestransmis par la tradition, elle en modifie considerablement lesperceptions. L’Au-dela (olam ha-ba’ah) bascule ainsi del’avenir vers « l’a cote ». Le terme gilgul decrivait dans la littera-ture rabbinique classique, le « roulement » par lequel les mortsrejoindront la Terre Sainte lors de la resurrection59. Revisite parl’Ecole d’Isaac Luria [1534-1572], il se mue en transmigrationdes ames60. Surgi a partir du XIIIe siecle dans la litterature duZohar, l’Etre primordial, Adam Kadmon, vient constituer unesorte de reservoir des ames (nitsutsot ha-neshamot), qui issues dela brisure originelle des vases, vont migrer d’un etre a l’autre,tout en s’enracinant a la meme source : l’ame d’Adam. Apparaıtainsi l’idee qu’une ame viendrait « reparer » dans une vie cequ’elle a manque dans une autre, et ce jusqu’a ce qu’elle yparvienne. Indifferente au genre comme a la religion, cettemigration peut s’effectuer d’un juif a un gentil, d’un hommea une femme voire meme a un animal, pour peu que la repa-ration s’accomplisse. Simultanement au gilgul, le ibbur (impre-gnation) est egalement deploye dans une autre dimension. Uneame peut ainsi s’accoler a une autre afin de lui faire realiser
144 La mort et ses au-dela
58. Shabbat, 152a-b ; Genese Rabba, 100,7 va jusqu’a indiquer que durant lestrois premiers jours, l’ame pense pouvoir ‘‘revenir‘‘.
59. COSTA, L’Au-dela et la resurrection dans la litterature rabbinique ancienne,op. cit., p. 183-192.
60. Notamment avec l’ouvrage de Hayim VITAL, Sefer ha-Gilgulim, Frankfortsur le Main, 1684, reed. Torat ha-gilgul, Jerusalem, 1982. Un survol de cesdeveloppements : Gershom SCHOLEM, Les Grands courants de la mystique juive,Paris, Payot, 1977 ; Charles MOPSIK, Les Grands textes de la cabale. Les rites quifont Dieu, Lagrasse, Verdier, 1993.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 144
quelque action precise ou effectuer un precepte. L’ame d’un« juste » qui aurait manque l’un des 613 commandements peutainsi se reincarner chez quelqu’un d’une autre generation pourl’executer. Toutefois, dans le sillage de cette migration bene-fique, se repand egalement son revers : l’ame d’un pecheur peutelle aussi s’introduire subrepticement chez quelqu’un. Car lepecheur, ne pouvant trouver de repos dans l’au-dela cherche ase refugier en ce monde-ci. C’est alors le dybbuk qui s’installe etqui, si les exorcismes ne parviennent a l’extirper a temps,entraıne souvent sa possession dans les limbes61. De sorteque la plupart des ames qui habitent les corps ont deja connunombre de vies anterieures, et que peu d’entre elles sont verita-blement « neuves ».
Ce regain d’attention portee sur la mort par la pensee kabba-listique, liee a de nouvelles conceptualisations du destin col-lectif d’Israel accompagne l’epanouissement de la Hevrakaddisha. Inauguree dans l’espace ashkenaze a Prague en1564, elle ne tardera pas a essaimer dans tous les centres dumonde juif, ou elle deviendra, progressivement, l’institutioncentrale, incarnant l’autorite communautaire. Tout en prenantsoin d’ancrer la vocation de la Confrerie du Dernier Devoirdans les traditions transmises par la Mishna, ses initiateurs nes’en inspirent pas moins des methodes eprouvees par leurscoreligionnaires espagnols, des les XIIIe et XIVe siecles, et decelles des guildes qui les environnent. Hierarchie fondee sur laselection, banquet annuel, cotisations obligatoires, mise al’amende, exclusion en cas de rebellion, maintien du cimetiere,organisation des enterrements, administration des rites, maisaussi formation et education de ses membres62, en sont lesprerogatives et les taches significatives. La creation de cetteconfrerie, s’instituant garant du devenir spirituel des commu-
145La mort dans le monde juif
61. J. H. CHAYES, Between Worlds. Dybbuks, Exorcists, and Early ModernJudaism, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2003.
62. Joseph Yuspa HAHN, Yosef Omets, Francfort, 1723, introduction, p. 4-5.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 145
nautes, marque une evolution decisive de la relation des com-munautes juives a la mort et a tout ce qui la precede et l’en-toure : charite, cimetiere mais aussi assistance medicale, etudeet enseignement.
Destine a l’edification desmembres des confreries saintes, utiliseen tant quememento pratique de la mort, mais aussi vehicule dela pensee d’un ordre transcendant, le Ma’avar Yabbok, replacela fonction des coutumes et des rituels dans l’interdependancequi se joue entre l’ici-bas et l’au-dela. L’importance accordee auxsoins medicaux, a l’exercice des rites et au renforcement d’uneethique mystique, appuie l’idee qu’il existe une imperieusenecessite a prendre en charge la responsabilite collective dudestin d’Israel. Les pratiques sociales qui en decoulent refletentces innovations. Si lors de leur fondation les confreries limitaientleur vocation aux devoirs funebres et a l’entretien du cimetiere,on observe, a partir du XVIIe siecle, une demultiplication de leursattributions. Sans plus se limiter a l’accomplissement des der-niers devoirs, les confreries etendront progressivement leur mis-sion au cadre global des commandements de « bonnes actions »a effectuer pour les vivants. Les soins des malades, la prise encharge des pauvres et des vagabonds, en nourriture, vetements ethebergement, l’organisation de l’etude et de l’education, la dota-tion et le mariage des orphelins, les prets occasionnels, en pene-trant les œuvres de charite et les exercices spirituels vont signifierle pouvoir de laHevra kaddisha dans le systeme communautaire,avec pour corollaire l’instauration d’une armada de mesuresde retorsion telles que l’exclusion, le refus d’enterrement, oul’excommunication applicables aux recalcitrants a se plier a sesexigences en matiere de cotisations ou de discipline. Cumulantles instances d’autorite, la Hevra kaddisha se deploiera graduel-lement jusqu’a devenir l’organisation interne la plus prestigieuseet la plus puissante des communautes.
146 La mort et ses au-dela
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 146
L’irruption de l’histoire
Penetrant le monde juif, les idees des Lumieres metamor-phosent les mœurs, avivent le desir d’emancipation, et desa-gregent subtilement le pouvoir centralise de la communaute.Simultanement, l’ascendant de la Confrerie sainte est conteste.L’irruption des idees rationalistes lamine son role de vecteur dela mystique et place les rituels mortuaires au cœur des debatsqui visent a rompre avec les jougs anciens. Saisis par l’actualitedes polemiques autour des morts apparentes qui agitent lemilieu medical europeen au XVIIIe siecle en accusant l’Eglised’incurie et de desinvolture a l’egard des vivants63, les mede-cins et penseurs juifs menent bataille contre la tradition secu-laire de l’enterrement immediat. Utilisee par les herauts del’emancipation afin de reduire l’influence de l’autorite reli-gieuse, la question de l’ensevelissement des morts se muerasimultanement en argument pour les tenants de la tradition enlutte contre les reformes imposees par les Etats. Appeles atrancher, en 1772, en tant qu’experts dans un conflit localou les autorites ducales souhaitaient imposer aux juifs de res-pecter un delai de trois jours avant toute inhumation, le phi-losophe Moıse Mendelssohn et le rabbin Jacob Emdenillustrent nettement les deux positions du conflit. Au secondqui defend le poids de la coutume et l’intransigeance de latradition, le premier repond que du point de vue strict de la loi,aucune injonction biblique ou talmudique n’exige une mise enterre immediatement apres le trepas. De fait, le traite Semahotrequerait que l’on surveille les defunts durant les trente jourssuivant leur deces : « car il est arrive qu’un homme soit inspecteapres trente jours, et il revint a la vie pour vingt-cinq annees, etun autre eut des fils et mourut ensuite »64. Provisoirementeteint, le conflit resurgissait cependant chaque fois que les
147La mort dans le monde juif
63. Philippe ARIES, L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977, p. 389-399.
64. Evel Rabbati (Semahot), op. cit., 8, 1, (hebreu) p. 216 (anglais) p. 57.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 147
militants de l’emancipation prenaient la plume pour defendreleurs idees, accusant les rabbins d’etre des fourbes et desfanatiques ne visant qu’a maintenir leurs coreligionnairessous le boisseau de l’obscurantisme. Cette accusation seretrouve encore en 1805, lancee par l’un des chantres juifsde la Revolution Francaise, qui ecrira au ministre des Cultespour prier instamment : « que l’on punıt severement ceux denos devots qui, par un cruel prejuge emprunte au paganisme,se font un devoir d’enterrer leurs morts le plus tot possible »65.
Ce debat virulent engage dans les communautes juives autourdu delai de l’enterrement revele que la conviction selonlaquelle retarder l’inhumation d’un defunt portait atteinte asa dignite et au repos de son ame, avait fait son temps. Il attestede surcroıt que les representations de la depouille et de l’ameavaient cesse d’etre intelligibles si ce n’est acceptables de tous.Ainsi, au-dela des apparences fortuites, c’etait surtout l’in-fluence de la kabbale – desormais consideree comme la sourcede superstitions surannees – sur les pratiques qui etait com-battue. Avec sa relegation, c’etaient les demons (shedim), lesesprits (ruhot), les nuisibles (mezikkim) et leur cohorte demalefices qui, apres avoir accompagne le quotidien des juifsdurant pres d’un millenaire, devaient desormais quitter lemonde tangible des vivants66. Assignee dans la sphere speci-fiquement concedee au bastion de l’orthodoxie, la Confreriene disparut cependant pas, et le Ma’avar Yabbok continuaa etre le manuel pratique reserve a ses membres67. Revisemaintes fois, ses interpretations et ses commentaires sur les
148 La mort et ses au-dela
65. Zalkind HOURWITZ, Lettre a Jean Etienne Portalis du 20 Ventose, an 13,ANF, 19/11030. Sur le personnage : Frances MALINO, Un Juif rebelle dans laRevolution, la vie de Zalkind Hourwitz (1751-1812), Paris, Berg, 2000.
66. Quelques cas de possession se produisent cependant encore regulierement,et sont exorcises par des rabbins et kabbalistes en Israel. Un recent dybbuk adefraye la chronique en 2010. Les deux tentatives d’exorcisme, la premiereayant ete effectuee par Skype, s’etant apparemment soldees par un echec.
67. Moıse Wolf JEITELESS, Zikkaron le-yom aharon, Prague 1828.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 148
rites furent toutefois soigneusement expurges jusqu’a ce qu’ilapparaisse sous forme d’un recueil de rituels funeraires denuede tout sens esoterique68.
Mourir dans la modernite
Demaniere plus pragmatique, la philanthropie se juxtaposantau devoir religieux, les membres des communautes juivesetablirent des institutions seculieres destinees a ameliorer lesort de leurs coreligionnaires. Fleurissent alors des ecoles, deshopitaux et de l’assistanat independants. Lorsque le pro-cessus d’emancipation abolit l’autonomie de la communaute,la Hevra kaddisha, n’est deja plus, dans l’espace ashkenaze,que l’ombre d’elle-meme : une resurgence d’un ancienmodele communautaire, dont la mission est desormais res-treinte a prodiguer les rituels mortuaires et funeraires selon lesregles de l’orthodoxie. En parallele aux Pompes funebresmunicipales du monde environnant, elle ne fonctionne plusen tant que confrerie et ne procurera dorenavant ni privilegesni honneurs – autres que symboliques – a ses agents. Para-doxalement, c’est par l’intermediaire des associations d’ori-ginaires, recrutant surtout parmi les juifs secularises, queresurgira, transformee, la vocation de l’ancienne confreriesainte. Les migrations massives que connaıtront les juifs apartir de la fin du XIXe siecle, et jusqu’apres la SecondeGuerre mondiale raviveront la necessite d’un acces au cime-tiere et aux premiers secours pour les plus demunis. Repro-duisant alors les anciens modeles traditionnellementeprouves d’assistance et d’entraide, les migrants creentdans leurs pays d’accueil des Landsmenshaften, societes desecours mutuel, qui se destineront, comme jadis la Hevra
149La mort dans le monde juif
68. Jacob B. BRANDEIS, Maawar Jabok. Sefer Maavar Yabbok. Gebete beikranken, Sterbenden und im Trauerhause, Prague, 1884.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 149
kaddisha, a acheter des caveaux collectifs dans les necropolesurbaines, ainsi qu’a fournir assistance aux immigres sansressource. Apres la Seconde Guerre mondiale, elevant dansleurs nouveaux lieux de vie des steles communautaires a lamemoire de leurs villes d’origine, les survivants de ces asso-ciations redessineront dans les cimetieres la carte d’une geo-graphie juive effacee par le XXe siecle69.
Au-dela de l’inscription de l’individu dans le cadre d’unehistoire collective, le champ de repos, sous sa forme purementspatiale, en est aussi un revelateur important. En effet, par uneforme d’ironie de l’histoire, c’est grace au maintien au long dessiecles de la pratique juive de l’enterrement au cimetiere qu’ilsubsiste quelques vestiges de leur ancienne presence. Expulsesau Moyen Age de toutes les grandes capitales europeennes,
150 La mort et ses au-dela
Tombes du debut du XXe siecle, cimetiere juif de Lodz (Pologne)
69. Jonathan BOYARIN & Jack KUGELMASS, From a Ruined Garden, the Memo-rial Book of Polish Jewry, Bloomington, Indiana University Press, [1983] 1998.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 150
leurs cimetieres furent vendus, et les steles, reutilisees en mate-riaux de construction, continuent a etre exhumees au hasardde grands travaux ou de fouilles archeologiques70. La ou ilsfurent recemment extermines, seuls les champs funeraires,laisses a l’abandon ou rehabilites par des associations, te-moignent des siecles de leur sejour en ces lieux. Cependant,a l’enterrement en carre juif comme signe de fidelite a l’histoireou aux siens, repond un autre phenomene. Alors que l’incine-ration represente un tabou encore largement partage chez lesjuifs, il n’est pas rare que des enfants de deportes morts dansles camps, demandent a partir en fumee afin de rejoindre avecles leurs et par-dela la mort, le sort auquel ils ont echappe.
L’emiettement des affiliations religieuses favorise, dans lemonded’aujourd’hui, les initiatives individuelles ou issues de groupesindependants. Que la majeure partie des juifs d’aujourd’hui aitrelegue aux oubliettes la plupart des croyances seculaires n’em-peche pas qu’elles se soientmuees en systeme de valeurs, au nomde l’ethique et de l’humanite. Nombres d’associations, plus oumoins communautaires, veillent ainsi a l’accompagnement desmalades et de leurs familles jusqu’en soins palliatifs. Certainsvisitent les hopitaux afin de porter nourriture casher et reconfortaux patients. D’autres se concentrent sur la prestation d’activitesjuives (celebration des fetes, cours divers) dans les maisons deretraite, qui ont succede aux hopitaux, hospices et dispensairescrees a la fin du XIXe siecle et au debut du XXe par les organismesphilanthropiques.
La repartition des juifs sur les differents continents induit,cependant, des usages diversifies. Si, en France, le Consistoiredetient la haute main sur le fonctionnement de la Hevra Kad-disha, veillant a l’orthodoxie de ses fonctionnaires ou benevoles
151La mort dans le monde juif
70. L’un des exemples le plus connu est celui des steles juives du Moyen Ageexhumees a Paris au XIXe siecle, actuellement concedees par leMusee de Clunyau Musee d’Art et d’Histoire du Judaısme.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 151
et au strict ordonnancement des derniers devoirs, ce sontsouvent les entreprises de pompes funebres qui gerent, a lacarte, l’organisation de l’inhumation comme l’acquisition del’emplacement a la demande des familles71. En fonction dudegre d’observance souhaite, il sera alors fait appel a la HevraKaddisha, a l’office d’un rabbin, ou a un service resolumentlaıc. En depit de la diminution des pratiques, qu’elles soient ounon orthodoxes, et de l’augmentation de rituels improvises al’initiative de chacun, les vœux d’inhumation en carre juif sontencore coutumiers.
En Israel, a l’inverse de ce qui se passe dans les pays occiden-taux qui ont separe l’Eglise de l’Etat, laHevra Kaddisha regne,comme jadis, en souveraine absolue sur tout ce qui concerne lamort. A ceux qui souhaitent echapper a l’emprise de l’esta-blishment orthodoxe, et recevoir une ceremonie laıque, il n’estd’autre echappatoire que d’exiger un enterrement dans uncimetiere non-juif ou dans l’un des cimetieres prives maintenuspar quelques kibboutzim.
En Amerique du Nord, parmi la multiplicite des options com-munautaires, une association, Kavod v’Nichum (Respect etconsolation) creee dans la derniere decennie, tente de fairerevivre la vocation charitable originelle de l’ancienne confrerie,en offrant formation pratique et spirituelle a ceux qui le sou-haitent. Son site internet de presentation precise : «Notre mis-sion est de restituer a la mort juive, les pratiques du deuil, lestraditions et les valeurs du respect du aux morts (kavod hamet)et de reconforter les familles endeuillees (nichum avelim). Nousencourageons les communautes et les synagogues a reprendrele controle des funerailles et des inhumations, conformement aleur propre orientation juive. Les salons funeraires devraient
152 La mort et ses au-dela
71. Une approche ethnographique des pratiques contemporaines : PatriciaHIDIROGLOU, Rites funeraires et pratiques du deuil chez les juifs en France,XIXe-XXe siecle, Paris, Les Belles Lettres, 1999.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 152
etre soumis a leur direction.Kavod v’Nichum aidera a reinsererles rituels mortuaires dans la communaute synagogale. Nousvoulons sensibiliser toute la communaute juive a la valeur descommandements d’honorer les morts, de reconforter lesaffliges, et proteger les familles endeuillees de l’exploitation »72.
Cette declaration, qui ne va pas sans rappeler le preambule auxpremiers reglements de la confrerie de Prague73, laisse entre-voir combien la relation juive a la mort, aussi transformee soit-elle par la modernite, n’a en rien perdu de son intensite. On nesaurait s’en etonner : les mutations qui affectent la relation desjuifs a la mort escortent toutes les evolutions du judaısme.Situee au cœur des croyances, enjeu de tous les combatspour maintenir – ou amenuiser – l’unite du groupe, elle refletetoutes les facettes des attitudes mouvantes au fil des siecles quisignalent, certes, les evolutions du judaısme, mais aussi lestransformations qui affectent, plus prosaıquement, la situationdes juifs dans la Cite. On observe toutefois, avec la modernite,que cette relation a la mort s’exerce bien au-dela d’une inser-tion dans le cadre religieux. En temoigne le renouveau destransferts post mortem des depouilles vers les cimetieres israe-liens, qui sont loin d’etre le seul fait des juifs de stricte obser-vance et affirment le desir de reposer parmi les siens ou de« rentrer a la maison », selon la formule de Abraham JoshuaHeschel74.
Le tribut paye par les juifs a l’histoire a pese lourdement dansla place accordee a la mort, les persecutions ayant jalonnel’histoire juive au cours d’epoques tragiques s’etant repercuteesdans des rituels forgeant une forme singuliere d’identite qui,
153La mort dans le monde juif
72. http://jewish-funerals.org/about-kavod-vnichum
73. GOLDBERG, Les deux rives, op. cit., p. 104-105.
74. L’enterrement en Terre d’Israel, deja mentionne a l’epoque talmudique atoujours ete pratique au long des ages. Jadis, et jusqu’a la creation de l’Etat, iln’etait pas rare que l’on decide de finir sa vie en Palestine afin d’y etre inhume lemoment venu.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 153
aujourd’hui encore se marque dans les cimetieres. Or, l’une desparticularites juives, remarquable en terres chretiennes, estd’avoir evite toute representation macabre. Omnipresente,comme elle le fut au Moyen Age, la mort peut neanmoinsetre apprivoisee par l’affirmation de la foi en la resurrection :«Que vienne le jour benit, le jour de la redemption, car avec sonarrivee, la mort disparaıtra a jamais. En ce jour tout Israel serarachete, Dieu [sera proclame] un et indivisible au sein del’union celeste, et Son nom, un et indivisible dans l’unioninferieure »75. Invisible, comme on voudrait qu’elle le soit denos jours, elle porte neanmoins sur les sepultures le souvenirgrave des communautes assassinees et la trace indelebile d’uneforme aussi perenne qu’imperceptible de judeite.
154 La mort et ses au-dela
Cimetiere Trumpeldor, Tel Aviv, ouvert dans les annees 1920
75. Ma’avar Yabbok, op. cit., introduction de l’Auteur, p. 11.
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 154
References bibliographiques
ARIES, Philippe, L’Homme devant la mort, Paris, Seuil, 1977 ; Essais sur l’histoire dela mort en Occident du Moyen Age a nos jours, Paris, Seuil, 1975.
BOYARIN Jonathan &KUGELMASS Jack, From a Ruined Garden, theMemorial Bookof Polish Jewry, Bloomington, Indiana University Press, [1983] 1998.
CHAYES, J. H., Between Worlds. Dybbuks, Exorcists, and Early Modern Judaism,Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2003.
COSTA Jose, L’Au-dela et la resurrection dans la litterature rabbinique ancienne, Paris-Louvain, Peeters, 2004.
FISHBANE Michael, The Kiss of God : Spiritual andMystical Death in Judaism, p. 45,Seattle, University of Washington Press, 1994.
GOLDBERG, Sylvie Anne, Les Deux Rives du Yabbok. La maladie et la mort dans leJudaısme ashkenaze. Prague XVIe-XVIIIe siecles, Paris, Cerf, 1989.
HAVERKAMP, Eva,Hebraische Berichte uber die Judenverfolgungen wahrend des erstenKreuzzugs Hanovre, Hahnsche Buchhandlung, 2005.
HESCHEL, Abraham Joshua, «Death as homecoming », Jack Riemer (ed.), JewishReflections on Death, New York, Shoken Books, 1976.
HIDIROGLOU, Patricia, Rites funeraires et pratiques du deuil chez les juifs en France,XIXe-XXe siecle, Paris, Les Belles Lettres, 1999.
Moıse MAIMONIDE, Guide des egares, trad. par Salomon MUNK, Paris, [1856],Lagrasse, Verdier, 1979.
– « Epıtre sur la persecution », Epıtres, Lagrasse, Verdier, 1983.MOPSIK, Charles, Les Grands textes de la cabale. Les rites qui font Dieu, Lagrasse,
Verdier, 1993.SCHOLEM, Gershom Les Grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, 1977.SCHWARZFUCHS, Simon, Les juifs au temps des croisades, Paris, AlbinMichel, 2005.YERUSHALMI, Yosef Hayim, Zakhor. Histoire juive memoire juive, Paris,
La Decouverte, 1984.ZLOTNICK, Dov, The Tractate Mourning (Semahot), New Haven & Londres, Yale
University Press, 1966.
155La mort dans le monde juif
mort_au_dela_14053 - 6.3.2014 - 11:33 - page 155











































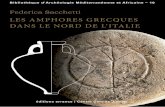




![Courtois, Paul (18..-18..? ; compositeur). [Les yeux noirs !]Les ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324c645cedd78c2b50c444e/courtois-paul-18-18-compositeur-les-yeux-noirs-les-.jpg)











