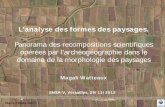"A la croisée des savoirs et des époques : le compoix de Saint-Germain-de-Calberte de 1579"
-
Upload
univ-montpellier -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of "A la croisée des savoirs et des époques : le compoix de Saint-Germain-de-Calberte de 1579"
À LA CROISÉE DES SAVOIRS ET DES ÉPOQUES :
LE COMPOIX DE SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
(CÉVENNES) DE 1579
Bruno JAUDON
(Université Paul Valéry-Montpellier III, EA 4424)
Au cœur des Cévennes, en Lozère mais limitrophe du Gard, à cheval sur
la Vallée Longue et la Vallée Française, au fond desquelles coulent
respectivement les Gardons d’Alès et de Mialet, Saint-Germain-de-
Calberte forme une commune qui, en 1852, couvrait un peu plus de trois
mille huit cents hectares et rassemblait cent vingt-neuf hameaux et
villages. Une épaisse châtaigneraie occupait alors près des deux tiers
de l’espace1. Sous l’Ancien Régime, cette communauté d’habitants se
trouvait au diocèse civil de Mende, autrement appelé Gévaudan.
Aujourd’hui connu par les investigations historiques et archéologiques
d’Isabelle Darnas, Saint-Germain présente la particularité, pour le
moderniste, de disposer d’un splendide compoix de 1579. Il est lui-même
suivi d’une importante série cadastrale, intégrée à un beau fond
d’archives communales déposées aux archives départementales de la
Lozère.
Le Languedoc formait, en effet, une province dans laquelle la taille
royale était réelle, c’est-à-dire qu’elle pesait sur la terre et non
sur les hommes et partant, que les sujets étaient contribuables parce
qu’ils possédaient des biens fonciers, qu’il s’agisse de terres ou de
1 Jean BOURET, Dictionnaire géographique de la Lozère précédé d’une notice générale sur ledépartement, Mende-Florac, 1852, p. 159-161.
1
bâtiments. Au principe régional de réalité de l’impôt s’ajoutait sa
nature à l’échelle du royaume : un impôt de répartition. Ainsi, savait-
on, à la fin du XVIIIe siècle par exemple, que le Languedoc acquittait
1,6 % de la taille du pays, contre 10 % environ pour la Normandie2. De
même était-il notoire que le diocèse civil de Mende s’acquittait de un
dix-neuvième (moins un soixante-quinzième !) de la taille due par le
Languedoc3. De même était-il acquis, depuis les années 1470 en
Gévaudan, que Saint-Germain-de-Calberte devait 1,14 % de la taille du
Gévaudan, comme ce fut le cas en 17814. À chaque étape de la
répartition s’ajoutait au montant initial de la taille un certain
nombre de charges provinciales, diocésaines et municipales encadrées
par la loi et qui, pour gonfler la « mande », donnaient à cet impôt à
gestion décentralisée une efficacité et un rendement exceptionnels en
temps de paix.
Où l’on en revient au compoix de Saint-Germain mis en service en
1579. Comme la taille était réelle, la logique de répartition frappait
à la porte du contribuable, imposé à proportion de sa fortune foncière.
Il fallait donc identifier assurément les propriétaires, puis calculer
leur revenu imposable de la manière la plus équitable possible. Il
fallait aussi refaire les cadastres à intervalle régulier, attendu
« que la face d’une province change tous les 100 ans et que dans ce
long espace de temps ses batimens presque neufs deviennent des mazures
2 Archives Nationales (désormais A.N.), K 887-2, papiers Moreau de Beaumont,Brevet des impositions accessoires de la taille de 1779, 1778, 56 f° ou K 887-3, papiersMoreau de Beaumont, Brevet des impositions accessoires de la taille de 1780, 1779, 51 f°.3 A.N., H1 9442, Notes et mémoires relatifs au Languedoc : États, impôts,travaux publics, consulat de Montpellier, administration, commerce, etc.,Proportion de ce chaque diocèze du Languedoc doit payer ou paye pour sa part des impositions, v.1750, non folioté (désormais nf).4 Archives départementales de la Lozère (désormais A.D.L.), C 936, assiettediocésaine de Mende, 1781, nf.
2
[…] et que d’autres deviennent bons par l’opulence des possesseurs ou
par leurs soins »5. Ainsi s’explique, pour Saint-Germain-de-Calberte,
l’existence de trois compoix successifs de 1579, 1599 et 16476. Après
1647 furent tenus au moins deux livres de mutations foncières,
commencés en 1673 et 17447. Communauté scrupuleuse quant à la gestion
locale de la taille royale, Saint-Germain constitue, grâce à son
compoix de 1579, un excellent objet d’étude pour évoquer la question
des savoir-faire dans les campagnes. Élaborer un cadastre, c’était
évidemment savoir mesurer les superficies de parcelles aux formes
parfois complexes dans un finage accidenté, savoir estimer la qualité
des terres et savoir les décrire précisément, savoir calculer des
revenus imposables, etc : voici pour la croisée des savoirs. Mais le
registre de Saint-Germain-de-Calberte de 1579 ne s’en tient pas là : il
s’avère annonciateur de progrès décisifs, formels notamment, dans
l’évolution historique de l’ensemble documentaire formé par les
compoix. Il est certes aisé de comprendre que les Languedociens,
utilisant des compoix depuis 1320 au moins et jusqu’en 1789 au moins,
ne les réalisèrent pas continûment de la même façon à travers le temps
et la province : voilà pour la croisée des époques8.
Comment se manifeste ce double chevauchement culturel et
chronologique ? L’étude formelle du compoix lui-même, l’analyse du
travail mené par les experts, puis celle du contenu du cadastre5 A.N., H1 849, Lettres de MF : correspondance entre Fages, sous-doyen de la Courdes Comptes de Montpellier et Machault, contrôleur général, lettre du 4octobre 1750, p. 9.6 Compoix successifs de Saint-Germain-de-Calberte, A.D.L., EDT 155 CC 4, 1579,617 f° ; EDT 155 CC 2, 1579, 788 f° ; EDT 155 CC 1 bis, 1647, 471 f°.7 Livres de muances de Saint-Germain-de-Calberte, A.D.L., EDT 155 CC 5, 1673 ;EDT 155 CC 6, 1744, 633 p.8 Plus ancien compoix connu et conservé : Archives municipales (désormaisA.M.) Agde, CC 1, compoix d’Agde (val d’Hérault), v. 1320, 60 f° ; parmi lestous derniers réalisés mais non mis en service : A.D.H., 1 B 11033-11034,compoix de Mudaison (Montpelliérais), 1788-1790, 18 cahiers, nf.
3
permettent de répondre de manière très précise. Cela est d’autant plus
intéressant qu’on réalisa, en effet, peu de cadastres au cours des
guerres de religion, en Languedoc comme en Rouergue, alors qu’un très
fort pic de production se dessina dès la fin de celles-ci9. Cette année
1579 aurait pu prolonger la période de répit née de la paix de
Bergerac, signée au mois de mai 1577, mais la septième guerre de
religion commença en août : ce fut précisément dans ce minuscule
interstice, le 16 juillet, que les agents cadastraux remirent leur
compoix flambant neuf aux consuls de Saint-Germain10.
Un document irréprochable
Notre matrice forme un épais registre de six cent dix-sept folios,
index et pièces annexes non comprises, de 20 27,8 cm, c’est-à-dire au
format « raisin ». Le volume est constitué d’un assemblage de cahiers
in-folio, brochés sur la tranche et reliés dans une couverture
cartonnée recouverte de cuir. Le premier savoir-faire employé, très
répandu alors, relève donc de la codicologie, l’art du relieur capable
de fabriquer un codex11.
In texto, le compoix s’avère double : la première partie de la
matrice, celle dite de « la Viguerie », compte quatre cent quatre
folios et la seconde, séparée de la précédente par une dizaine de pages9 Gilbert LARGUIER, « Normes, production et évolution des compoix terriens enLanguedoc, XVIe-XVIIIe siècles », dans De l’estime au cadastre en Europe. L’époque moderne,Actes du colloque de Paris (4-5 décembre 2003), Mireille TOUZERY (dir.), Paris, 2007, p.343-346, 368, 370-372 ; Marc VAISSIÈRE, Histoire du Cadastre. Les compés-cadastres duRouergue (XVIe-XVIIIe s.), Millau, 2007, p. 189-197.10 Sur la Paix de Bergerac consulter, André STEGMANN, Édits des guerres de religion,Paris, 1979, p. 131-153 ; A.D.L., EDT 155 CC 4, compoix de Saint-Germain-de-Calberte, 1579, préambule, nf.11 Denis MUZERELLE, Vocabulaire codicologique : répertoire méthodique des termes français relatifsaux manuscrits, Paris, 1985, 265 p.-59 pl., sans oublier la très complète versionhypertextuellle, enrichie, sur :http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/pages/vocab1.htm ; Jacques LEMAIRE, Introduction àla codicologie, Louvain-la-Neuve, 1989, XI-265 p.
4
laissées blanches, est appelée du « Carton », deux subdivisions dont on
reparlera. Compoix de la Viguerie et compoix du Carton, l’ensemble
encadastre l’entier finage de Saint-Germain, finage alors dénommé,
comme dans tous les compoix du temps, « terroir et taillable », parfois
même « paroisse ». Côté Viguerie ou côté Carton, l’économie de chaque
demi-compoix est identique. La matrice s’ouvre sur la « table », c’est-
à-dire le procès-verbal des experts qui résume et explique les
modalités exactes de leur travail. S’ensuivent deux « rubriques », des
index des propriétaires classés dans leur ordre d’apparition au
compoix. Le premier index signale évidemment à quel folio se reporter
pour consulter les articles d’un contribuable. Le second rappelle les
« présages », ici les revenus imposables de chaque propriétaire, afin
de calculer chaque année le montant de la taille. L’aspect pratique de
cet index n’échappera à personne : le greffier consulaire n’avait qu’à
le recopier, puis à l’actualiser annuellement, afin de bien répartir
l’impôt entre les villageois. Cette opération, fondamentale, consistait
à diviser le montant nominal de la taille due par la communauté par son
revenu imposable total : on savait de la sorte par combien multiplier
l’« allivrement » (revenu imposable) de chacun pour obtenir sa quote-
part sonnante et trébuchante à la taille royale. Nos experts
connaissaient donc la finalité du compoix, son utilité fiscale, et
n’ont pas hésité à proposer à la population un outil commode résumant
l’essence et l’ensemble de leur travail.
Vient ensuite le corps de la matrice, folioté quant à lui, qui
présente, propriétaire par propriétaire, l’ensemble des parcelles
possédées, ainsi que l’allivrement de chacune. Ce « tail », selon la
terminologie de l’époque, se décompose en un nombre variable
d’« articles » ou « items », qui correspondent à la description des
parcelles arpentées. En fin de tail, le compoix de Saint-Germain
5
présente la particularité, là aussi fort pratique, de calculer le
« somme le présage » ou revenu imposable du contribuable. Toute la
place nécessaire à une lecture aérée et agréable a été ménagée par le
scribe : marges de cinq à six centimètres, deux ou trois articles
recopiés par page, allivrement de l’article et allivrement total
exprimés en toutes lettres, ainsi qu’en chiffres romains, blancs d’une
ou deux pages entre deux tails, etc.
À ces pratiques qu’on peut qualifier de basiques s’ajoutent les
capacités « d’adaptation » des agents cadastraux – et pas du scribe
seulement. La rédaction du compoix vient satisfaire le besoin d’une
population pour un document qui, non content de clarifier l’identité
civile des terres et des contribuables, peut et doit aussi établir
fermement le statut des biens, pour déterminer s’ils sont nobles,
« ruraux » ou autres. Aussi le double compoix de Saint-Germain
encadastre-t-il essentiellement les terres soumises à la taille ou
« rurales », mais établit-il aussi la liste des terres nobles du
finage, bien qu’exemptes de taille. Parmi les terres roturières, il
distingue donc deux sous-ensembles spécifiquement locaux : les terres
de la Viguerie et celles du Carton. Le procès-verbal d’expertise
précise que les premières relèvent de la directe du baron de Portes et
les secondes de celle du comte d’Alès. L’utilité purement seigneuriale
de cette distinction ne devrait pas l’autoriser à apparaître dans un
compoix, mais peut-être les habitants ont-ils simplement profité de
l’occasion pour recenser les tenures et les emphytéotes des deux
seigneurs, faisant ainsi d’une pierre deux coups. D’autres cas
apparaissent, non loin de là, de la même vision pragmatique du
document : les compoix de Saint-Alban (Margeride) de 1600 et d’Allenc
6
(haute vallée du Lot) de 1605 servaient en même temps de terriers12. En
l’espèce toutefois, les terres de la Viguerie et du Carton sont
soumises au même tarif cadastral et de nombreux propriétaires sont
possessionnés dans les deux quartiers. Les compoix de 1599 et 1647 ne
perpétuent plus cet usage et les rôles de taille des XVIIe et XVIIIe
siècles recensent à leur tour cinq quartiers différents, mais ce sont
tout bonnement des circonscriptions de collecte, chaque borde disposant
de son propre collecteur13. N’oublions pas que ce vaste territoire
« communal » couvrait près de quarante kilomètres carrés et englobait
plus d’une centaine de lieux habités : il fallait, en quelque sorte,
introduire des éléments de rationalisation de l’espace14.
Une des nouveautés du compoix de Saint-Germain ne réside pas
forcément dans les savoirs mis en œuvre pour le réaliser. Il s’agit
plutôt de son préambule, la « table » introductive placée en tête de
chacun des deux « demi-compoix », qui est similaire dans les deux cas
(voir annexe et fig. 1) [insérer ici l’illustration n°1]. Les agents
cadastraux ont eu le souci d’expliquer noir sur blanc les modalités de
l’enquête cadastrale qu’ils ont menée. Il apparaît, on le verra, que
ces techniques ne sont pas différentes de celles employées quelques
décennies plus tôt, mais la volonté d’exposer les faits, de dire les
choses telles qu’elles se sont passées, constituent en soi une démarche
12 A.D.L., EDT 132 CC 1, compoix et terrier de Saint-Alban, v. 1600 ; A.D.L., 3E 7852, compoix et terrier d’Allenc, 1605.13 A.D.L., EDT 155 CC 2, compoix de Saint-Germain-de-Calberte, 1599, 788 f° ;A.D.L., EDT 155 CC 1, compoix de Saint-Germain-de-Calberte, 1647, 471 f° ; surles rôles de taille de la communauté d’habitants : collections complètes dedoubles et collections fragmentaires d’originaux, A.D.L., C 1047, C 1057, C1094, EDT 155 CC 24, EDT 155 CC 73 pour les documents consultés.14 Jean BOURET, Dictionnaire géographique de la Lozère…, op. cit. en note 1, p. 159-161 ;Natacha COQUERY, François MENANT, Florence WEBER (dir.), Écrire, compter, mesurer : versune histoire des rationalités pratiques, Paris, 2006, 277 p.
7
relativement nouvelle. Employer une table d’allivrement ou estimer des
terres accidentées à vue d’œil restent autant de techniques en usage
depuis longtemps mais exposer cette table d’allivrement, admettre le
caractère approximatif de certaines levées topographiques, c’est faire
un pas en avant vers davantage de clarté15. Sortir de l’opacité de
l’enquête cadastrale telle que menée aux XIVe et XVe siècles en
Languedoc pour aboutir à sa plus totale transparence aux XVIIe et XVIIIe
siècles appelle une phase de transition : le XVIe siècle, et plus
particulièrement les années 1520-157016. En ce sens, le compoix de
Saint-Germain de 1579, au préambule plus étoffé que la plupart de ses
devanciers, annonce ceux plus longs encore très souvent placés en tête
des registres des années 1590-1610.
Si l’expertise reste un travail… d’experts inaccessible à une masse
peu alphabétisée, ces derniers fournissent désormais et néanmoins
l’effort de rendre soigneusement compte de leur savante besogne, afin
d’attester la validité de leur calculs17.
Un travail d’experts
Cette approche procède de l’expérience des agents cadastraux, connus
ici grâce à la conservation du préambule dont on a parlé. Le compoix de
Saint-Germain-de-Calberte est ainsi présenté comme « faict et calculé
par nous Louys Fabre, Fermin Pages et Jaques de Moillerat, commis au
fait de la recherche particuliere » ou encadastrement du finage. Des
15 Progrès précisément exposés dans Bruno JAUDON, Les compoix de Languedoc (XIVe-XVIIIe
siècle). Pour une autre histoire de l’État, du territoire et de la société, thèse d’histoire (ÉliePÉLAQUIER dir., Montpellier III, Paul Valéry, 2011, 2 vol., 869 p.16 Gilbert LARGUIER, « Du compoix/estime au compoix/cadastre. L’exemple duLanguedoc (XIVe-XVIe siècle) », dans De l’estime au cadastre en Europe. Le Moyen Âge, Actes ducolloque de Paris (11-12 juin 2003), Albert RIGAUDIÈRE (dir.), Paris, 2006, p. 221-244.17 Patrick FOURNIER, « Un nouveau regard sur l’espace : le rôle de l’expertise(milieu du XVIIIe-début du XIXe siècle) », L’historien en quête d’espaces, Jean-Luc FRAYet Céline PEROL (dir.), Clermont-Ferrand, 2004, p. 251-271.
8
investigations rapides montrent que Firmin Pagès et Jacques de
Moillerat n’étaient ni des novices ni de parfaits inconnus. D’emblée se
pose toute l’ambiguïté de la répartition des tâches et partant, des
compétences dont chacun d’entre eux était le dépositaire. La table ne
précise rien quant aux fonctions occupées par chacun.
Cela dit, on sait que Firmin Pagès fit aussi partie de l’équipe
cadastrale qui réalisa les compoix cévenols de Saint-Étienne-Vallée-
Française et de Saint-Julien-des-Points de 1590 et 159218. Dans ces deux
registres, il est signalé comme simple prudhomme, résidant dans un
village de Barre-des-Cévennes : l’Arboux. Jacques de Moillerat est
davantage connu. Il succède peut-être à Antoine Leroux comme notaire
royal de Barre, mais il réside à Vébron, paroisse proche : sa très
grosse étude fonctionne à plein régime entre 1578 et 159319. En 1579 par
exemple, notre homme ouvre solennellement la première page de son
nouveau registre : « au nom de nostre seigneur dieu tout puissant soit
a toutz présentz et advenir chose manifeste que cest le segond registre
& protocolle des roles et escritures retenues par moy »20. Louis Fabre,dont on ne sait rien, n’apparaît qu’un seule fois dans nos sources,
pour cette seule opération. On ne peut donc qu’imaginer la répartition
des tâches au sein de l’équipe et sans doute faut-il admettre une
certaine polyvalence des trois agents cadastraux nommés par la
communauté d’habitants. L’écriture posée du compoix prouve que le
notaire, Jacques de Moillerat, fit bel et bien fonction de scribe mais
18 A.D.L., E 929, compoix de Saint-Étienne-Vallée-Française, 1590, 767 f° :préambule, nf ; A.D.L., 1 J 387, Saint-Julien-des-Points, 1592, 98 f° :préambule, nf.19 A.D.L., 3 E 2225-2239, minutes de Jacques de Moillerat, notaire royal deBarre-des-Cévennes, 1579-1593, 15 vol. (un par an).20 A.D.L., 3 E 2226, minutes de Jacques de Moillerat, notaire royal de Barre-des-Cévennes, 1579, 672 f°.
9
aussi et peut-être d’estimateur, par sa connaissance de la valeur des
bâtiments et des terres de la région. Peut-être Firmin Pagès fit-il
office d’arpenteur. Peut-être Louis Fabre assista-t-il enfin ses deux
collègues, à moins qu’il ne fut un simple « indicateur », c’est-à-dire
un habitant de la communauté nommé pour désigner les noms des lieux-
dits parcourus par les agents cadastraux, ainsi que pour décliner
l’identité des propriétaires des parcelles. Par la suite on l’a dit,
Firmin Pagès participa à l’élaboration de deux autres compoix dans la
même région21. Quant à Jacques de Moillerat, il réalisa à son tour les
cadastres de Saint-Julien-d’Arpaon de 1580 et de Saint-Étienne-Vallée-
Française de 159022. C’est autour de la réalisation de ce registre que
travaillèrent ensemble, une nouvelle fois, Jacques de Moillerat et
Firmin Pagès. On comprend donc qu’un réseau professionnel a été tissé
autour de ces deux personnages, réseau dont les ramifications posent la
question de la transmission des compétences.
Le personnage central, à tout prendre, reste Barre-des-Cévennes,
qu’on hésite à qualifier de ville en raison de sa petite taille, 800
habitants encore en 1900. Mais le lieu est ceint de murailles sous
l’Ancien Régime et constitue un important point de passage entre les
Causses et les Cévennes. C’est aussi le siège de nombreuses activités
« de commandement » : siège d’une baronnie et de sa justice
seigneuriale, ainsi que de deux études notariales par exemple. S’y
concentrent aussi des activités économiques importantes : un artisanat
développé, ainsi que la tenue de douze foires annuelles qui ont un fort
rayonnement local, et dont les prix sont assez bien conservés23. Tous
ces éléments rentrent ainsi dans la définition de la ville selon21 Cf. supra note n° 18.22 A.D.L., E 929, doc. cit. en note 16 ; A.D.L., E 945, compoix de Saint-Julien-des-Points, v. 1580, 366 f° : préambule, nf.
10
Furetière. Peut-on pour autant réduire la diffusion des techniques
employées lors de la rédaction d’un compoix à une simple transposition
rurale de techniques d’extraction urbaine ? Il semble bien que non et
savoir faire un cadastre reste avant tout une compétence rurale : la
difficulté des grandes villes languedociennes à refaire leurs compoix
après les années 1590-1600, comme Montpellier, montre bien que
l’encadastrement pose de graves problèmes politiques et
socioéconomiques une fois franchi un certain seuil de population24. Dans
le cas de la concentration barroise d’experts travaillant au compoix de
Saint-Germain-de-Calberte, il y a plutôt coïncidence : le notaire
résidant (Jacques Moillerat) fait équipe avec l’arpenteur (Firmin
Pagès) qui habite la même communauté. Eut-il résidé dans la commune
voisine, que les deux auraient sans doute travaillé ensemble.
Il existe plutôt une transmission familiale du savoir-faire, dans le
cas de Firmin Pagès par exemple, puisqu’un certain David Pagès, pour le
coup intitulé arpenteur, travaille au cadastre de Saint-Hilaire-de-
Lavit de 1598, toujours dans un court rayon autour de Barre25. Quel
était leur lien de parenté ? Il reste encore difficile d’y répondre,
mais l’explication homonymique ne semble pas tenir. Il existe aussi une
transmission socioprofessionnelle, puisque Jacques de Moillerat réalise
son dernier compoix en 1590 probablement, tandis qu’un notaire de
23 Félix BUFFIÈRE, « Ce tant rude » Gévaudan, Mende, 1985, T. I, p. 270-272 ; A.D.L.,EDT 019 AA 4, cahier des doléances du tiers-état de Barre, 17 mars 1789, 6f° ; A.D.L., EDT 019 HH 5, mercuriales de Barre, 1691-an XI, nf.24 A.M. Montpellier, CC, Joffre 299, 302, 305, 308, 311, 314, compoix deMontpellier, 1599-1600, 6 vol., 2136 f° ; plus aucun arpentage et partant,plus aucune authentique nouvelle matrice après cette date et jusqu’à laRévolution, consulter Henri MICHEL, « Note sur les compoix montpelliérains del’Ancien Régime », dans Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique,Actes de la table ronde (Saint-Cloud, 31 janvier-2 février 1985), Jean-Louis BIGET, Jean-ClaudeHERVÉ et Yvon THÉBERT (éd.), Rome, 1989, p. 189-208.25 A.D.L., EDT 158 CC 2, compoix de Saint-Hilaire-de-Lavit, 1598, 142 f° :préambule, nf.
11
Barre-des-Cévennes, François Deleuze, prend le relais au plus tard en
1601 : de 1601 à 1637, il intervient dans la réalisation de huit
cadastres au moins26. Si la transmission est une chose, la question de
la formation initiale, irrésolue, en est une autre. Arpenter, c’est-à-
dire découper des parcelles en figures géométriques simples et
appliquer les formules permettant d’en calculer les superficies,
nécessite donc une bonne connaissance des mathématique et – un jour
sans doute – la lecture d’un ouvrage spécialisé.
On peut penser que l’élaboration de compoix constituait un commerce
suffisamment rentable pour s’en charger en sus d’une intense activité
notariale. Le métier de notaire permettait, en effet, d’endosser de
manière vraisemblablement assez naturelle la fonction d’estimateur. On
ne dira cependant jamais assez qu’il ne faut pas se représenter les
fonctions d’estimateur et d’arpenteur comme cloisonnées et réservées à
une figure unique de l’équipe d’agents cadastraux. L’expertise, si
connotée par la figure de l’ingénieur depuis le XIXe siècle, reste
encore, au XVIe siècle, une compétence assez partagée, notamment par
des gens habitués à travailler ensemble depuis longtemps27. Ainsi
François Deleuze est alternativement désigné entre 1601 et 1637 –
parfois dans le même procès-verbal d’expertise – comme expert, estimateur,
arpenteur, arpenteur ordinaire du pays des Cévennes28… Dans notre cadastre, nos26 François Deleuze, notaire royal de Barre-des-Cévennes : A.D.L., 3 E 3636-3654, minutes de l’étude, 1601-1639, 19 vol. (un par an) et faiseur de compoixcévenols : A.D.L., E 824, compoix de Bassurels, 1601 ; A.D.L., EDT 019 CC 44,copie du compoix de Barre-des-Cévennes de 1604 ; Archives départementales duGard (désormais A.D.G.), Hôpital Alès H 109, copie du compoix de Saint-Martin-de-Corconac de 1610 ; A.D.L., E 962, compoix de la Salle-Prunet, 1625 ;A.D.L., EDT 166 CC 1, compoix de Saint-Laurent-de-Trèves, 1631 ; A.D.G., Edépôt Générargues CC 3, compoix de Générargues, 1635 ; A.D.L., E 866, compoixde Fraissinet-de-Lozère, 1637 ; A.D.L., E 963, compoix de la Salle-Prunet,1637.27 Patrick FOURNIER, « Un nouveau regard sur l’espace : le rôle del’expertise… », dans L’historien…, art. cit. en note 17, p. 251-271.28 Cf. les copies ou les originaux des préambules de ces cadastres.
12
trois experts sont désignés sous le terme générique de prudhommes,
c’est-à-dire comme ayant prêté serment…
Dans le cas de Saint-Germain-de-Calberte en 1579, on voit donc à
l’œuvre des spécialistes à la fin ou à l’aube de leur carrière
cadastrale, comme on en trouve un peu partout dans la province. On
évoquera le seul exemple de la famille Revel, venue du Minervois
réaliser des compoix dans la vallée de l’Hérault et le Lodévois dans
les années 1590-… 1670 : « Pierre et Martin Revel pere & filz, du lieu
de Peyriac, dioceze de Narbonne, que sont gens cogneus pour arpenter
et dresser lesdits compoix », est-il dit en 159629. Ces petites
dynasties de compésiateurs du troisième quart du XVIe siècle, au
recrutement socioprofessionnel marqué, à forte reproduction sociale si
on veut, annoncent celles plus nombreuses et actives du XVIIe siècle
languedocien, ce grand siècle des compoix. Firmin Pagès et Jacques de
Moillerat incarnent donc dans la société cévenole une nouvelle figure,
celle de l’expert rural et partant, une certaine modernité, qui ne
manque pas de se retrouver dans le contenu même du cadastre.
Un cadastre très moderne
Les techniques d’arpentage employées ici n’ont sans doute que peu
varié depuis le Moyen Âge, même si le procès-verbal d’expertise, comme
c’est presque toujours le cas, reste peu loquace sur le sujet, pourtant
essentiel. Tout juste sait-on qu’il a été « procede a la mensuration
des maisons, courtilz et places […] et reduictes […] en canes
29 Émile APPOLIS, « Les compoix diocésains en Languedoc », Cahiers d’histoire etd’archéologie, 9e année, 2e trim. (1946), p. 82 ; citation extraite des Archivesdépartementales de l’Hérault (désormais A.D.H.), 114 EDT 87-88, compoix deGignac, 1597, 2 vol., 1034 f°, T. I, introduction, nf ; un Jean Revel estmaître arpenteur, A.D.H., 36 EDT CC 1, compoix du Bosc (Lodévois), 1670, 473f°, introduction, nf.
13
carrees », de même que les « autres terres fertiles », mesurées et
converties « en cesterees, cartes & boisseaux ». Il y a donc eu
arpentage au moyen d’une unité de mesure commune, ensuite convertie en
mesures locales, dont la connaissance est indispensable pour le travail
en cabinet du scribe, afin de passer des cottets30 à la transcription
définitive du compoix.
Mais on ne sait pas quels instruments furent concrètement utilisés
par Firmin Pagès : perche, compas, chaîne d’arpenteur, corde à nœuds,
outils plus techniques et complexes ? En se fiant aux traités
d’arpentage italiens de l’époque ou à leurs épigones français plus
tardifs, souvent placés à la suite de traités de géométrie, on sait que
chaque parcelle était conçue comme une addition de figures géométriques
simples, pour lesquelles la formulation des calculs de superficie était
connue31. Cela dit, dans les Recherches diocésaines de Nîmes et d’Uzès –
validées en 1552 –, on s’en tint à des techniques bien plus grossières.
Il s’agissait dans ces deux cas en effet d’arpenter rapidement des
finages, afin de calculer le revenu imposable de toutes les communautés
30 Cottets : dans le cadre de la réalisation de compoix, petits cahiers allongésoù sont relevées sur le terrain les informations de la levée topographique, dela description et de l’estimation des parcelles.31 Quelques exemples seulement, un pour l’Italie : Girolamo CATANEO, Del misurare lemuraglie, imbottare grani, vini, fieni et strami col livellare dell’acque & altre cose necessarie a gliagrimensori, Brescia, Di Marchetti fratelli, 1557, rééd. Brescia, Di Marchettifratelli, 1584, in-4°, IV-55 f° et deux pour la France : Jean ABRAHAM,Arithmetique et arpentage universel, geometrie inaccessible, toisé des bastimens, la fabrique & usage desquadrans solaires, & autre geometrie par la regle & compas, Lyon, Rigaud & Obert, 1531,rééd. Lyon, Rigaud & Obert, 1616, in-8°, VIII-309 p, ainsi que Jacques CHAUVET,La Pratique universelle de l’arpenterie de Jacques Chauvet contenant l’explication de parfaictementmesurer, arpenter, toiser, aulner et prendre le plant de la superficie de tous corps et figures..., Paris,H. Thierry, 1585, in-4°, II-26 f°. On ne peut pas omettre de mentionner OronceFINE, La Composition et usage du quarre Geometrique par lequel on peut mesurer fidelement touteslongueurs, hauteurs, & profunditez, tant accessibles, comme inaccessibles, que l’on peut appercevoir àl’œil le tout réduit nouvellement en François, escrit & pourtraict, par Oronce Fine lecteur mathematiciendu Roy en l’Université de Paris, Paris, G. Gourbin, 1556, in-4°, II-29 p.
14
d’habitants de chaque diocèse civil (arrondissement fiscal) puis, en
dernier lieu, de calculer une nouvelle répartition de la charge fiscale
entre elles32. Il semble néanmoins qu’à Saint-Germain en 1579,
l’arpenteur travailla avec la plus grande précision possible, puisque
les articles de compoix donnent des superficies d’une grande
« exactitude ». Ainsi, des biens bâtis : maisons ou remises sont
mesurées séparément les unes des autres, ce qui, en Gévaudan, reste
très novateur, et de surcroît, si nécessaire, au demi-pan carré près,
soit un seizième de canne carré, soit… 0,25 mètre carré33. De même des
biens champêtres : les terres sont mesurées, pour certaines parcelles
de petite taille comme les jardins potagers, au neuvième de boisseau
carré près, soit 3,6 mètres carrés. Ne doutons pas un instant que toute
cela relève d’une culture plus générale de la fausse précision en
l’absence d’un recours systématique à la triangulation.
On en tient pour preuve la grande fréquence, dans les articles du
compoix et pour les biens non bâtis, de mesures exprimées avec
l’indication « ou environ », qu’il faudrait prendre le temps de
quantifier. Celle-ci trahit sans doute, pour un finage au relief
accidenté, l’arpentage des versants cultivés au moyen de la technique
de la cultellation34. L’approximation tient ici au fait que l’arpenteur
32 A.D.G., C 1313-1335, Recherche diocésaine de Nîmes, 1547-1552 ; A.D.G., C773-794, Recherche diocésaine d’Uzès, 1547-1552 : Gérard CAILLAT, « Larecherche diocésaine, un compoix ? », dans Contribution à la journée d’étudedu 3 juin 2009 à Perpignan, Jean-Loup ABBÉ et Florent HAUTEFEUILLE (dir.),article en ligne sur :http://w3.terrae.univ-tlse2.fr/spip/IMG/pdf/CR_reunion_compoix_Perpignan_03.06.pdf, p. 4-6.33 Bien souvent, jusque très avant dans le XVIIe siècle, les compoix gévaudanaisne s’encombrent pas de détails et les arpenteurs mesurent des « blocs bâtis »,une maison et ses dépendances par exemple, dont la superficie est exprimée« tout joignant ».34 Très belle illustration de cette méthode de calcul des superficies desterrains à forte déclivité dans Salvatori SETTIS (coord.), Misurare la terra :centuriazione e coloni nel mondo romano, Catalogue de l’exposition du Museo Civico
15
calcule des superficies pour des figures géométriques planes qui
excluent les déformations liées à la topographie : il anamorphose
inévitablement la réalité. Quant aux biens les plus éloignés des lieux
habités et situés dans les terroirs les plus accidentés du finage, en
général des châtaigneraies ou des bois, ils n’ont pas été arpentés du
tout : « touchant les heuzieres35 et terres hermes36 a cause que la
plupart dicelles conciste en rocher et pays bossu la mensuration ny
pouvant servir que de longeur de procedure, ont este par nous extimees
a veue de œil ». Pour certaines autres parcelles, l’arpentage est
mixte : une partie cultivée réellement mesurée, l’autre partie inculte
estimée à vue d’œil. Dans le village des Vernets par exemple, Anthoine
Couchon possède « une piece de terre […] contenant castanet une
cesterée demy carte ou environ oultre terre herme » (fig. 2)[insérer
ici l’illustration 2]. Ici, le castanet a été mesuré grossièrement –
quatre mille sept cent cinquante m² « ou environ » –, sans que l’herme
soit seulement arpenté – « outre la terre herme ». Retenons donc que si
les agents cadastraux ayant travaillé à Saint-Germain-de-Calberte en
1579 savaient être précis, ils ne se sentaient pas obligés de le faire
constamment. L’arpentage constitue donc, dans notre étude de cas, un
savoir-faire à géométrie variable car, au fond, la rédaction d’un
compoix n’appelle pas davantage. L’approximation ne pose pas problème
aux contribuables : elle revêt ici un caractère acceptable, puisqu’elle
est partagée par tous d’une même manière, selon les mêmes règles,
clairement posées. Ce qui est nécessaire, c’est la clarté de l’enquête,
qui fonde son équité ; ce qui est acceptable, c’est le caractère
Archeologico-Etnologico de la Commune de Modène (décembre 1983-février 1984),Modène, 1983, p. 134.35 Bois de chênes verts.36 Terres en friche ou en cours d’embroussaillement.
16
approchant de « la mesure de la réalité »37. D’autres compoix ou
d’autres textes, postérieurs il est vrai, le disent clairement :
arpenter n’est pas une œuvre divine, c’est donc un art entaché
d’erreurs humaines, erreurs équitablement réparties entre les
propriétaires portés au cadastre de la communauté d’habitants. On
n’oubliera pas que la municipalité réclamait passivement un arpentage
d’une précision très fluctuante, afin de limiter la durée des
opérations de levée et partant, du coût des travaux : « la mensuration
ny pouvant servir que de longeur de procedure » disent nos experts.
Outre l’arpentage, ces derniers livrent pour Saint-Germain un
cadastre d’une certaine modernité, puisqu’ils établissent le revenu
imposable des propriétés au moyen d’une « table d’allivrement ». Celle-
ci est une simple grille de calcul : telle catégorie de biens – une
vigne, un castanet, un champ céréalier… – se voit affecter tel revenu
imposable à l’hectare. Cela permet de fiscaliser les cultures et les
bâtiments de façon différenciée et nuancée en fonction de leur nature :
un hectare de terre inculte porte en général dans un compoix un revenu
imposable plus faible qu’un hectare de bois, lui-même plus chichement
allivré qu’un hectare de terre à blé38. Cette méthodologie commence
nettement à se diffuser dans les campagnes languedociennes des années
149039. En 1579 à Saint-Germain, la table d’allivrement semble encore
rudimentaire, puisque les biens sont ventilés « aux degres de bon,
37 Alfred W. CROSBY, La mesure de la réalité. La quantification dans la société occidentale (1250-1600), Paris, 2003, 265 p.38 Bruno JAUDON, « Entre devoir et nécessité : l’élaboration du revenu cadastralen Languedoc au dernier siècle de l’Ancien Régime », dans Florence BOURILLON,Mireille TOUZERY, Nadine VIVIER, éd., L’élaboration de l’évaluation cadastrale », colloque del’université Paris XII, 12-13 décembre 2008), Rennes, Presses universitaires de Rennes,2012, sous presse.39 Par exemple, dans le compoix de Castillon (Gard rhodanien) de 1480 : A.D.G.,E Dépôt Castillon du Gard CC 2, f° 176 r°-177 r°.
17
moyen et feble ». On ne sait pas si ces subdivisions forment un tarif
décliné quelle que soit la nature de la mise en valeur de la parcelle,
ou si ces trois classes cadastrales servent à graduer chaque type de
mise en valeur. Autrement dit, existe-t-il un tarif cadastral en bon,
moyen et faible pour l’ensemble des terres ou existe-t-il un bon, moyen
et faible des champs, un bon, moyen et faible des vignes, un autre des
bois, etc. ? Les compoix de la toute fin du XVIe siècle et plus encore
du XVIIe siècle usent parfois de tables d’allivrement bien plus subtiles
et qui savent entrer dans d’impénétrables délices de nuances dont on ne
parlera pas dans ces lignes par souci d’économie. Comparée à ses
devanciers et à ses suivants, la table d’allivrement du cadastre de
Saint-Germain s’inscrit donc entre deux époques.
Il n’en va pas de même quant à la description des parcelles :
l’espace fiscal y est dit avec un réel souci de justesse qui le
rapproche beaucoup de ce qu’on appelle le paysage et qui préfigure la
rigueur textuelle des cadastres de la province à partir des années 1590
(fig. 3) [insérer ici l’illustration 3]. La description du bâti se fait
ainsi au moyen d’un champ lexical approfondi, pour un cadastre de
l’époque s’entend. Dans les villages de Saint-Germain, les bâtisses
qu’on rencontre au long des pages du compoix sont diverses : maison,
maison d’habitation, « cazal » (maison ruinée), « alapen » (appentis).
Elles sont associées à des espaces libres (« courtils, salvestres,
coudercs ») ou à des équipements indispensables (« yeres, fourns ») et
voisines de « plassages » et de « rues publicques » qui les
desservent40. À proximité des lieux habités se pressent les petites
40 « Courtil » : cour ; « salvestre » : « ciel ouvert », terrasse ;« couderc » : espace clos réservé à la déambulation des porcs ; « yere » :aire à dépiquer le blé ; « fourn » : four à pain ; « plassage » : passage ;sur tout ceci : Paul CAYLA, Dictionnaire des institutions, des coutumes et de la langue en usage
18
parcelles soignées vouées à l’hortillonage : jardins, jardins
« arrouzables », chénevières (« canabieres »). Aux confins des
terroirs se retrouvent les bâtisses dont la présence s’explique par une
activité agropastorale spécialisée : « clèdes » (séchoirs à châtaignes)
au milieu de la châtaigneraie, ruchers (« apiés ») un peu partout,
moulins (« a bled ou drappiers ») au bord des ruisseaux avec leurs
biefs (« gourgues »), ainsi que leurs appartenances
(« apprehendemens »). Le parent pauvre de cette description de l’espace
bâti et de ses abords reste, on le constate, le bâti pastoral :
bergeries, étables, écuries n’apparaissent pas, peut-être parce
qu’elles occupent un volume de la maison, le rez-de-chaussée par
exemple, peut-être parce que les experts n’ont pas jugé utile de les
fiscaliser spécifiquement41. La description du reste du finage répond,
elle aussi, au même souci de précision. C’est le cas des espaces
cultivés des fonds de vallée, assez intensément mis en valeur. Les
parcelles emblavées sont désignées sous le terme générique de « terre
labourative », sans égard à la variété céréalière produite, des
distinctions pouvant sans doute être opérées par les agents, entre
froment et seigle par exemple, grâce aux classes cadastrales (bon,
moyen et faible)42. On trouve aussi des prés, ainsi que des vignes,
cultivées de façon classique ou sous forme de treilles (« treilhatz »).
Ce que dépeint le compoix dans le parcellaire de thalweg, ce sont
surtout des items qui associent plusieurs cultures, où les arbres sont
plantés un peu partout : « fruictiers » en général mais aussi
dans quelques pays de Languedoc de 1535 à 1648, Montpellier, 1964, 727 p.41 Bruno JAUDON, Sylvain OLIVIER, « Du buron d’Aubrac au village urbanisé de laplaine : le bâti rural languedocien (XVIe-XIXe siècle) », Bâtir dans les campagnes. Lesenjeux de la construction de la Protohistoire au XXIe siècle (éd. Philippe MADELINE, Jean-MarcMORICEAU), Bibliothèque du Pôle rural, n° 1, 2007, p. 227-231.42 Voir le très tardif mais très éclairant A.N., H1* 748271, Minutte de la verifficationdans le taillable de Montpellier faitte par nous controlleur du Vingtieme soussigné terminé au mois dejuillet 1756, 1756, 351 f°.
19
« amoriers » ou « nogiers », « amouriers » ou noyers. Sur les versants
ou dans les terroirs les plus tourmentés, les agents cadastraux, bien
qu’ils arpentent très sommairement ne négligent pas de bien décrire ce
qu’ils voient, les châtaigneraies (« castanets ») comme les
châtaigniers isolés (« castaniers ») bien sûr, mais aussi la chênaie :
« chesnes » esseulés, « rouvyere » (chênaie rouvre) ou « euziere »
(chênaie verte), comme les terrains qui s’embroussaillent (« hermes »).
Les parcelles couvertes de rochers (« rancarèdes ») et à peu près
stériles ne sont pas oubliées, même s’il ne s’agit que de quelques gros
rochers (« rancs ») encombrant un bien par ailleurs inculte. Le souci
de précision descriptive va jusqu’à tenter d’individualiser certains
articles par des caractères remarquables. L’un de ceux-ci concerne la
taille de la parcelle, surtout si elle est petite : « petit, un peu
de… ». La microtopographie permet aussi de désigner assurément le
bien : « soubz, faisant caisso ou diverses caissos, joignant, au
milieu… ». D’autres mots ou expressions viennent dire un particularisme
qui permet de reconnaître telle parcelle par rapport à telle autre
voisine : « ruyné(e), complanté(e) de…, de petite valleur, en plusieurs
endroictz, qua esté de » un tel…
Au final, la description de l’espace fiscal est extrêmement fine pour
l’époque, si on compare les champs lexicaux de deux compoix cévenols,
représentatifs l’un de l’époque précédente et l’autre, de la suivante.
nombre de motsemployés dans lesitems pour dire :
Les Rousses(1558)
A.D.L., EDT 130CC 1
Saint-Germain(1579)
A.D.L., EDT 155CC 4
Villefort(1601)
A.D.L., 1 J488
le bâti 8 15 22le non bâti 10 18 13des précisionsd’ordre divers
8 15 10
20
Total 26 48 45Dire l’espace dans trois compoix cévenols des années 1550-1600
Dire l’espace à Saint-Germain constitue donc, pour nos agents
cadastraux, un exercice à la fois maîtrisé et adapté, plus développé
que par les experts ayant réalisé le compoix des Rousses et aussi bien
que par ceux venus à Villefort. L’adaptation à la ruralité se retrouve
par comparaison : le champ lexical décrivant le non bâti est plus
développé à Saint-Germain et celui évoquant le bâti plus développé à
Villefort, grosse communauté qui, à l’image de Barre, concentre des
activités artisanales et commerciales. Les bouticques recensées dans le
cadastre de Villefort sont ainsi absentes de celui de Saint-Germain…
Techniques éprouvées d’arpentage, mesure fluctuante des superficies
des parcelles en fonction des besoins locaux, emploi d’une table
rudimentaire d’allivrement, capacité à décrire très précisément le
paysage, le compoix de Saint-Germain-de-Calberte systématise donc les
savoirs acquis au cours des périodes précédentes qui, en 1590-1610, se
généralisent à l’ensemble du Bas-Languedoc, des Cévennes au littoral
méditerranéen.
Comment se manifeste, dans le compoix de Saint-Germain-de-Calberte de
1579, la transition entre les cadastres languedociens de la première
modernité et ceux de l’Ancien Régime ? Cette transition prend forme
autour de deux évolutions dans le travail d’expertise. Premier
changement par rapport aux compoix des années 1490-1560 : la plupart
des techniques cadastrales mises en œuvre demeurent inchangées mais
elles sont clairement exprimées, noir sur blanc, soit dans le
préambule, soit dans le contenu même du registre. On arpente ainsi de
manière variable les parcelles mais on prend la peine d’en avertir
21
explicitement les contribuables recensés lors de l’enquête. Les experts
savent aussi s’adapter aux conditions locales de leur besogne : estimer
« à vue d’œil », « couper » le compoix en deux quartiers seigneuriaux
alors que cela n’est pas indispensable… Cette volonté de rendre
davantage publiques les modalités de la réalisation d’un compoix
souligne une nouveauté dans le souci de mesurer la réalité : la volonté
d’une grande transparence. Seconde évolution : à Saint-Germain sont
introduites des nouveautés techniques internes au compoix dans
l’expression même de cette réalité. Pour résumer, les agents cadastraux
décrivent les parcelles avec un important effort de précision, malgré
l’absence de plans, ce qui détonne par rapport à un passé relativement
proche et qui annonce aussi l’immense qualité descriptive des compoix
des XVIIe et XVIIIe siècles, tellement plus riches que les matrices
dites « napoléoniennes ». Jamais peut-être des registres fonciers
n’ont-ils aussi bien décrit ni été plus proches des paysages anciens,
jamais peut-être l’espace fiscal ne fut-il si proche d’une photographie
de l’espace tout court. Et cet instantané du paysage, le compoix de
Saint-Germain-de-Calberte le révèle déjà à merveille dès 1579, comme le
cadastre de Campagnan (Val d’Hérault) de 157743.
Il fallait des devanciers aux splendides compoix languedociens des
années 1590-1610 et celui de Saint-Germain fut de ceux-là. Il se trouve
là, à la croisée entre deux époques et des savoir-faire d’horizons
techniques certes différents mais profondément ruraux. Il se trouve là,
finalement, pour incarner, à sa manière, la transition culturelle entre
deux époques de l’histoire des compoix, la nouvelle mettant en service
des registres ressemblant davantage à chaque génération à de véritables
matrices cadastrales.
43 A.D.H., 47 EDT 4, compoix de Campagnan, 1577, 205 f°.
22
AnnexePréambule du compoix de Saint-Germain-de-Calberte (1579)
pour le quartier dit de « la Viguerie »(A.D.L., EDT 155 CC 4, nf)
Nota : la ponctuation, l’accentuation, quelques apostrophes, ainsi que les majuscules sontrétablies sous les normes familières au lecteur de notre temps ; les nombreuses abréviations ontété développées. Quelques mots ont été ajoutés entre parenthèses pas nos soins, afin derendre plus fluide la lecture du texte.
Livre du compoix et cadastre des terres et propriéttés queanciennement estoint appelées de la Viguerie, en le lieu et parroissede Sanct Germain. Faict et calculé par nous Louys Fabre, Fermin Pagèset Jaques de Moillerat, commis au fait de la recherche particulièred’icelles (terres), soubzsignés cy apprès, (terres) mentionnées etconfrontées suyvant la monstre et déclaration que nous en a esté faictepar les tenentiers et possesseurs d’icelles. Sans préjudiciertouteffois du droit que le seigneur baron de Portes et autres pourrointavoir en autres terres et propriétés d’icelle parroisse couchées aulivre appellé du Carton, comme de mesmes aussy sans préjudicier dudroit que les seigneur comte d’Alès et autres seigneurs ou préthandeusavoir èz terres et propriéttés couchées au présent livre.
Aussy, ne préjudiciant en rien au droit des propriétteres etpossesseurs d’icelles, lesqueles (terres) particulièrement par nousditscommis ont esté veues, palpées et extimées, heu esgard à la commoditéet incommodité, fertilité ou infertilité et aux degrés de bon, moyen etfeble d’icelles. En quoy faisant, a esté par nous procédé à lamensuration des maisons, courtilz et places, jardins, vignes, pretz,(arbres) fruictiers, codercz, terres labourives, castanetz et terresfertilles. Et reduictes les maisons, courtilz et places en canescarrées et les autres terres fertiles en cesterées, cartes & boisseaux,la cesterée en quatre cartes et la carte en six boisseaux, la cesteréecontenent cens dextres, la carte vingt cinq et le boisseau quatre et lasixieme partie de ung dextre, le dextre ayant de longeur deux canes etung tiers de pan et la cane huict palmes. Et touchant les heuzières etterres hermes, à cause que la plupart d’icelles conciste en rocher etpays bossu, la mensuration n’y pouvant servir que de longeur deprocédure, ont esté par nous extimées a veue de œil (et) à proportionde la commodité, proffit et revenu que le maistre propriétere d’icelleen peult percevoir. Et à toutes et chescune d’icelles particulièrement,soubz escript les pris auquels par nous a esté extimé, et icelluy prisréduit en somme universelle sur la fin du présaige de chescuntenentier. Comme de mesurer toutes ces sommes universelles avec celles
23
des terres et propriéttés couchées au livre appelle du Carton,adjoustées ensemble, généralement réduittes à vingt solz trois denierstournois, et iceulx divisés en deux cens quarante trois denierstournois, le denier en deux malhes, la malhe en deux pougèzes, lapougèze en deux pictes, la demy picte en deux cartz (de) picte, le cart(de) picte en deux demy quartz (de) picte, le demy quart (de) picte endeux quartz de ung quart (de) picte et finallement, pour le plus basdegré, le quart de ung quart (de) picte en deux demy quartz de ungquart (de) picte ou a ung quart de demy quart (de) picte. Auditsdeniers comprinses les maisons, terres & propriéttés préthanduesnobles, descriptes et couchées à part sur la fin du présent livre (dela Viguerie) et du livre appelle du Carton cy attaché en tout, saulf ledroit des parties et sans préjudicier d’icelluy, avec les pris &reductions d’iceulx ausquelz sont par nous extimées. Lesquelles(propriétés), au cas (où elles) seront décelées nobles et exemptes àcontribution, en tout ou partie d’icelles, suyvant le bon plaisir duRoy et de la Court, pourront estre desmembrées et advortées duditdenier, à proportion de leurdit présage, à mesme tariffe que dit aesté. Et finallement, à chacun tenantier & propriétere escript sur lafin de la réduction particulière deldit présatge par tariffe, laportion que leur conviendra payer pour livre envoyée en taille de parle Roy notre sire sur ladite parroisse, suyvant laquelle tariffe, vaultle denier en présatge comme sensuit :
vault le denier trois livres quatre solz tournoisla maille une livre doutze solz tournoisla pogèse setze solz tournoisla picte huict solz tournoisla demy picte quatre solz tournoisle quart picte deux solz tournoisle demy quart picte ung sol tournoisla moitié de demy quart picte six deniers tournoisle quart de demy quart picte trois deniers tournoisdespartis par telz caractères.Ainsi que dessus a esté par nous Louys Fabre, Firmin Pagès, et Jaques
de Moillerat soubzsignés.
Pour mémoire, liste des illustrations à insérer in texto :Illustration n° 1Préambule du compoix de Saint-Germain-de-Calberte(A.D.L., EDT 155 CC 4, nf : transcription en annexe)Illustration n° 2Le « tail » d’Antoine Couchon et de sa femme, habitants du hameau desVernets
24