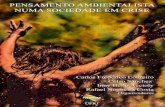ECHO 18 2014 - CRISE K T - C GUERNET
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of ECHO 18 2014 - CRISE K T - C GUERNET
Fig. 1. Répartition stratigraphique des familles de dinosaures rangées prioritairement selon leur ordre de disparition et secondairement selon leur ordre d’apparition (d’après Benton, 1993).
Fig. 1. Stratigraphic distributions of the dinosaur families arranged first according to their disappearance and secondly to their appearance (after Benton, 1993). présente l'historique anomalie en Iridium… Les foraminifères benthiques (abyssaux) arénacés qui sont rares de
part et d'autres de la limite y sont abondants et bien diversifiés » (Le Rousseau et al. 1996). D’ailleurs, dans une publication fâcheusement oubliée, F. Wezel et al. (1981) décrivent dans la « Scaglia rossa » et la « Scaglia bianca » des Apennins d’Ombrie-Marche plusieurs niveaux à hautes teneurs en iridium, aussi bien au-dessous qu’au-dessus de la limite K/T, niveaux également riches en « autres éléments sidérophiles ». Ainsi, dans le niveau « Bonarelli », d’âge turonien et à nombreux éléments volcano-clastiques (Vanucci et al. 1981, in Wezel et al. 1981), la concentration en iridium est presque deux fois plus forte que dans celle de l’argile K-T ! De même, bien loin de l’Italie, dans le Deccan, une « lacustrine intertrappean sedimentary sequence (…) has revealed a profuse occurrence of theropod eggshell fragments (ornithoid type) in beds overlying the iridium-enriched levels. Associated late Cretaceous ostracods, lack of evidence of reworking, and the absence of any exclusively Palaeocene taxa above the iridium levels, (…) indicate that the extinction of dinosaurs in the Indian subcontinent occurred after the deposition of Ir layers (...) and that these Ir anomalies may significantly predate the K-boundary. » (Bajpai & Prasad 2000).
En fait, la partie profonde du manteau terrestre est riche en iridium et les éruptions basaltiques du Dekkan (Courtillot 1995) ou des zones d’expansion océanique peuvent expliquer l'enrichissement en iridium des argiles. W. Zoller et al. (1983) ont ainsi découvert de hautes teneurs en iridium dans les produits d'une
éruption du Kilauea. G. Meyer et J.-P. Toutain (1990) font une observation semblable dans les projections du Piton de la Fournaise à la Réunion. Enfin, l'iridium est (faiblement) soluble (Colodner et al. in Rocchia & Robin 1998): lentement entraîné par les eaux d'infiltration, il se concentre au niveau des couches argileuses.
Toujours à propos de l'iridium, voici un exemple du parti pris des partisans de l'hypothèse cosmique: au nord du Guatemala, deux niveaux bréchiques du Danien non basal présentent une teneur élevée en iridium (Fourcade et al. 1998; Keller & Stinnesbeck 2000). Pour E. Fourcade et al. (1998), ces brèches « ont été déclenchées par la forte secousse séismique produite par l'impact du bolide de la limite K/T sur le Yucatán », la brèche, les sphérules et les anomalies étant remaniées! La possibilité d'un remaniement de l'iridium ou des sphérules sans dispersion considérable est pourtant invraisemblable. Ainsi, non seulement les partisans de l'hypothèse météoritique ne recherchent généralement l'iridium que là où ils veulent le trouver mais lorsqu’ils le trouvent ailleurs, ils le considèrent remanié!
Fig. 2. Répartition stratigraphique des familles de Mammifères rangées prioritairement selon leur ordre de disparition et secondairement selon leur ordre d’apparition (d’après Benton, 1993). Fig. 2. Stratigraphic distributions of the mammal families arranged first according to their disappearance and secondly to their appearance (after Benton, 1993).
La couche argileuse ou pélitique au passage K/T
Pour L. Alvarez et ses collaborateurs, cette couche d’argile provient de la décomposition de cendres projetées lors de la chute de la météorite. Cependant, de telles cendres, répandues sur toute la surface du globe, devraient être conservées, non ou peu altérées, en de nombreuses régions. Or, ce n’est pas le cas et il est invraisemblable qu’elles se soient partout altérées en argile. Une autre explication avancée pour expliquer l’existence des argiles serait le tsunami que n’aurait pas manqué de provoquer la chute d’une météorite, surtout en milieu marin littoral. Naturellement, un tel tsunami aurait laissé dans des régions voisines de l’impact des dépôts grossiers effectivement présents à Haïti, dans l’Alabama et au Guatemala et même dans le