Dissert ellipses la guerre PLAN
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Dissert ellipses la guerre PLAN
Dissertation la guerre
Sujet : « On ne fait pas la guerre pourse débarrasser de la guerre » (JeanJaurès)
Attention pour Le Feu les numéros de pages sont
différents de celles de votre édition : vous corrigerez et
ferez ainsi un travail de manipulation de l’œuvre.
Pbks possibles (mais attention vous n’en mettezqu’une dans votre devoir)Est-ce que la guerre ne sert vraiment à rien ? Est-ce que la guerre ne peut pas conduire à lapaix ?Faut-il se résoudre à combattre pour parvenir àdélivrer durablement les états de toute tentationbelliqueuse ? La guerre peut-elle mener à une paixpérenne ?
Plan détaillé :
I) On ne fait pas la guerre pour se débarrasserde la guerre. La guerre ne sert à rien. Thèse
II) Mais ….. Faire la guerre permet de délivrerdurablement de la guerre
III) On peut ainsi se demander si vouloir se
1
débarrasser de la guerre n'est pas un projetutopique.
Assassiné en juillet 1914 par un étudiantnationaliste, Jean Jaurès n’aura eu de cesse, dansles dernières années de sa vie, de témoigner de son« horreur de la guerre », y voyant « un jeu dehasard barbare » qui irait « contre la démocratie ».Représentant d’un socialisme qu’on qualifievolontiers d’humaniste et de pacifiste, il envisage« la paix assurée, la paix durable, la paixconfiante » comme un élément nécessaire au progrèshumain, et tente par tous les moyens, y compris lamenace d’une grève générale, d’engager legouvernement français à trouver des alternatives audéclenchement d’un conflit. Il argue alors qu’ « onne fait pas la guerre pour se débarrasser de laguerre. » Cette phrase semble venir contrer ceuxqui, pour justifier la guerre, affirment qu’elle estun moyen nécessaire, voire l’unique moyen, pourmettre un terme définitif à des désaccords. Elles’oppose à une idée selon laquelle on n’auraitd’autre choix, pour se libérer d’une situationconflictuelle, que de mener ce conflit jusqu’auchamp de bataille pour faire en sorte de déterminerun vainqueur définitif, sous les lois duquel levaincu serait forcé de se soumettre. Le verbe « sedébarrasser » sous-entend qu’on souhaite se soulager
2
définitivement d’un élément accablant et oppressif.Une guerre ponctuelle serait alors une solution pourne plus jamais voir revenir la guerre. Elleconstituerait un genre de vaccin contre une maladieplus grave qui pourrait se pérenniser. Or, JeanJaurès remet en cause l’utilisation de ce moyen dontil souligne la nature paradoxale par la répétitiondu mot « guerre » dans les deux membres de sonassertion : il s’agirait, pour se défaire d’unconflit (un complément de but est formulé), demettre un conflit en place, solution contradictoirequi consisterait à instaurer ce dont on veut sedéfaire. Il semblerait en effet plus logique, sil’on souhaite éviter le combat, de chercher dessolutions pacifiques. La question qui se pose iciest donc de savoir s’il faut se résoudre à combattrepour parvenir à se délivrer durablement de toutetentation belliqueuse entre les états, en d’autrestermes si le fait de combattre peut mener à une paixpérenne.
À la lumière des Perses d’Eschyle, du livrepremier de l’essai de Carl von Clausewitz : De La
Guerre, et du roman de Barbusse intitulé Le Feu, nousverrons que si effectivement, la guerre peut semblerconstituer une solution pour obtenir une paix fondéesur des bases solides, cette façon de procéder estcontradictoire et risque d’exacerber les tensions aulieu de les supprimer. On pourra alors s’interrogersur le caractère illusoire d’un objectif démesuré :
3
« se débarrasser de la guerre ».
I) On ne fait pas la guerre pour se débarrasserde la guerre. La guerre ne sert à rien. Thèse
Il peut néanmoins sembler contradictoire voireabsurde, et c’est la position de Jean Jaurès,d’engager une guerre en affirmant concomitamment quec’est pour s’en débarrasser.
1. La guerre est violente et ne peut qu’être fatale
Premièrement, la guerre repose sur une violenceentre les ennemis qui ne peut être qu'exponentielleet sans limites. Cette absence de mesure estexprimée clairement par le messager dans
- Les Perses, alors qu'il vient de raconter lacuisante défaite de Xerxès et ses alliés,concluant la première partie de son récit surle fait que « jamais en un seul jour n'aura péri une aussi
grande foule d'hommes » (v.431-32). Il ajoutealors : « Et pourtant, sache bien que ce n'est pas encore
la moitié même des malheurs : car la souffrance sur eux s'est
appesantie d'un poids redoublé » (v.436-37). Leconstat d'une montée vers les « extrêmes »(terme employé constamment dans le chapitre 1de l’essai) est le même
- chez Clausewitz, qui définit la violence comme
4
« l’orientation naturelle de l’élément militaire ». Tout,dans l’action militaire est soigneusementagencé selon « une structure, une subdivision et une
combinaison complexes » afin de détruire la forcearmée ennemie ou de contribuer à cettedestruction (p.60). L’observation estidentique
- dans Le Feu (p.114-116). Le combat fait l’objetde toutes les attentions et d’une gestionrigoureuse : « C'est bien organisé tout d'même, tout ça,
y'a pas à dire ! ». - Dans sa note 6 de la p.96 des Perses, Danielle
Sonnier indique que les Perses étaient réputéspour leur maîtrise de la poliorcétique, c'est-à-dire l’art d’assiéger les villes. Cetteorganisation poursuit une visée trèsdestructrice. Pendant le conflit, l’autrefaisant peser sur moi une menace perpétuelle,la logique de la guerre repose sur lacertitude que l’un des deux adversaires doitêtre terrassé : si ce n’est pas moi qui leterrasse, je crains que ce ne soit lui qui lefasse (haut de la p.24 point n°4). Les limitesque se fixe le combat dans l’emploi de laviolence, « sous le nom de lois du droit naturel »,sont, selon Clausewitz, « des restrictions
imperceptibles, à peine notables » et seules « les âmes
philanthropiques », jugées bien naïves, peuventimaginer que l’on puisse « désarmer ou terrasser
5
l’adversaire sans causer trop de blessures » (p.20). Labonté en temps de guerre est une erreur, etl’intelligence nous indique qu’il faut aucontraire se servir de la violence « avec brutalité,
sans épargner le sang » pour parvenir à dicter saloi (chap. 1, section 3). La seule limite àcette violence est la résistance que nousopposera notre adversaire. Se produit donc uneescalade de la violence, que Clausewitzappelle « surenchère mutuelle» (chap. 1, section5), nécessaire pour l’emporter, qui génère uneprolongation du conflit dans la volonté derendre à l’ennemi ce qu’il nous a infligé. LesAllemands utilisent des gaz asphyxiants,considérés comme « des moyens déloyaux […] pas
propres », preuve de l'absence de limite sur lechamp de bataille.
- Les Perses détruisent et pillent les templesgrecs (v.809-12), sans respect pour « les lois de
la guerre » (v.860). Dans l’optique de cettesurenchère,
- Clausewitz signale que chacun ménaged’ailleurs ses forces lors du premier assautpour ne pas que tout se décide sur un seulacte militaire, qui, s’il avait une issuedéfavorable, ferait tout perdre (p.27). Commel’indique le point numéro 8 du chapitre 1 :« La guerre ne consiste pas en une frappe unique et sans
durée ».
6
- Le conflit amplifie donc le conflit dans un« acharnement » qui « excède les forces et la volonté »,tel qu'on a l'impression que « ce n'est donc jamais
fini, jamais! » (Le Feu p.315). Les soldats dans lestranchées s'habituent à la violencecontinuelle. Dès le chapitre 2, on nousindique qu’ils ont fini, depuis quinze moisqu'ils la subissent, par assimiler lafusillade incessante à laquelle ils sontsoumis « au tic-tac des horloges de [leurs] maisons »(p.15).
- L’ « aguerrissement » envisagé par Clausewitzdans ses « conclusions du premier livre »permet de s’acclimater aux horreurs de laguerre, comme l’œil s’habitue à l’obscurité.
- Au milieu du chapitre XX du Feu, alors que lesAllemands n'opposent plus de résistance, et sesont en grande partie repliés, une « frénésie »agite les compagnons du narrateur. Certainsveulent « continuer », « débordants et enivrés d'eux-
mêmes », « heureux et glorieux d'avoir survécu »(p.293). Le caporal Bertrand se demandecomment les hommes de demain verront « ces tueries
et ces exploits » dont eux-mêmes ne savent pass'ils sont œuvres de héros ou de sauvages.L'avenir devra, selon lui, effacer ce présenthonteux et pourtant nécessaire. La gloiremilitaire, l'armée, le métier de soldatchangent les hommes en victimes ou en « ignobles
7
bourreaux » (p.298) qui n’ont aucune limite pourbattre l’ennemi.
2. Les gens sont marqués à tout jamais par la guerre
Ceci est d'autant plus vrai qu’un traité de paixn'effacera pas ces comportements inhumainsqu'autorise la guerre. Comment penser que ce traité,souvent imposé à l'une des parties, va entraînerimmédiatement une disparition totale des tensionsentre des camps qui se sont fait tant de mal ? Laguerre met rarement définitivement fin auxdissensions qui lui ont donné naissance.
- Clausewitz explique que, dans la « réalité », laguerre n’est pas un acte isolé, surgissant denulle part, et qu’elle ne contient pas « un
résultat fini en lui-même » (p.26). Tout y est faitpour que les hommes ne puissent pas serapprocher les uns des autres, on interditnotamment « d’entrer en conversation avec l’ennemi » (Le
Feu p.182) : « Et même on nous a lu qu’il fallait causer
avec eux qu’à coups de flingue ». « On […] travaille » lessoldats « de propagande » pour que la colère lespousse à massacrer ceux qu'on présente commedes objets de détestation.
- Tout comme les Perses sont « barbares » (Ils senomment ainsi eux-mêmes d'ailleurs, et mettentl'accent sur les coutumes qui les opposent auxGrecs : s'agenouiller devant les rois, comme
8
le fait le coryphée v.152, combattre avec desarmes de jet, comme l'arc ou le javelot, etnon à l'épée v.239-40) aux yeux des Grecs(v.187) et Athènes « odieuse » de l'avis desPerses (v.286),
- les hommes de Bertrand stigmatisent lesofficiers allemands, « la salle race boche », « des
monstres », « une sale vermine spéciale » (p.44-45).Ils ne croient pas « à la finition de la guerre »(p.56). C'est sans grande « conviction » qu’ilsprononcent « ces mots démesurés » : « On n'sait
jamais », la guerre pourrait finir un jour.(p.107-108). Certains resteront marqués à toutjamais comme la famille de Mesnil André etMesnil Joseph, qui comptait six frères, dontcinq seront morts à la fin du roman. De même,les femmes perses seront restées mariées bienpeu de temps à leurs époux qui ne reviendrontpas, la jeunesse de Suse étant décimée. Dans Le
Feu, les cauchemars que font les hommes, mêmelorsqu'ils sont à l'abri, témoignent de lamanière dont les bombardements les heurtentirrémédiablement (cette obsession est sansdoute à rapprocher du songe de la reine dansLes Perses, même s’il s’agit là d’uneprémonition, venant d’une femme qui n’a pasvécu les combats) : « Comme si cela avait une rapport
avec son rêve », Marthereau, qui « se réveille dans un
vague gémissement » « évoque la vision de la nuit où l'on est
9
montés aux tranchées » (p.276). - De plus, selon Clausewitz, la signature d’un
armistice est loin d’être garante d’apaisementdurable entre les parties. Tout combat reposesur une « intention hostile » (chapitre 1, section3). Même les plus civilisés des peuples sontsusceptibles de se voir « enflammés par la haine »(p.21). Il y a parfois entre deux peuples de« telles tensions, une telle somme d’éléments hostiles » quela situation est explosive. Tant que la paixn’est pas conclue, le principe d’hostilitéperdure (point n°13 du chapitre 1 p.33) et ilest difficile de considérer alors que lesimple fait de signer la paix entraînerait ladisparition soudaine de toute hostilité entreles soldats des deux camps. Clausewitz metd’ailleurs en évidence des tactiques possiblespour aggraver le coût de la guerre chezl’adversaire, tactiques qui relèvent d’unevolonté de dévaster son territoire sans autreintention. La violence contre l’ennemi peutdonc être gratuite, ce qui amplifie son impactpsychologique (les forces morales doiventd’ailleurs être absolument prises en comptedans la destruction qu’on inflige à l’ennemip.63) : « Le but immédiat ici n’est ni de conquérir le pays
de l’ennemi ni d’écraser ses forces armées, mais simplement de
lui infliger un dommage général » (chap. 2, p.54). - Dans Le Feu, la « disparition » totale du village
10
de Souchez, où vivait Poterloo plus jeune, nes'explique pas raisonnablement : « Pourquoi
bombardent-ils Souchez ? On ne sait pas, car il n'y a plus
personne ni plus rien dans le village pris et repris » (p.170-71). Elle fait partie des destructionsgratuites opérées pour déstabiliser et briserles hommes. Au chapitre XX, alors que lenarrateur accompagne Joseph au poste desecours, un homme qui passe se vante d'avoirmassacré des Allemands désarmés, qui seprésentaient avec un drapeau blanc (p.313).
- Ces actes de barbarie génèrent un désirlégitime de revanche qui fait qu’on ne metjamais un point final à la guerre. La solutionn’est pas durable : on ne se débarrasse de laguerre que très ponctuellement, tant quel’ennemi n’a pas reconstitué ses forces pouropposer à nouveau une résistance à notreattaque (c’est le principe de « polarité »envisagé dans De La Guerre chap. 1, section 15,p.35). La cessation ponctuelle de l’actionmilitaire permet que chacun s’organise pour« rétablir un équilibre perdu » (p.38). Il se peutmême, selon l’auteur, que le combat reprenne« après que la paix a été conclue, ce qui prouve seulement
qu’une guerre ne comporte pas toujours une issue et un
règlement parfaits. » (p.49). - Dans Les Perses, le chœur explique la haine des
siens à l'égard d'Athènes par leur défaite
11
contre ces mêmes Grecs à Marathon, dix ansauparavant : « Il faut se ressouvenir comme elle a pour
tant de femmes perses ravi des enfants, un mari ! » (v.287-89). Les tensions et les haines générées parun conflit armé ne font donc qu’exacerber lesdivisions initiales et constituent le terreaude futures guerres.
3. La guerre crée des dissensions au sein même des clans constitués
En dernier lieu, la guerre crée des dissensionsau sein même des clans constitués. La fin de laguerre signifie alors souvent l'explosion derancœurs internes.
- Dès le chapitre 2 du Feu, les corps de métiers'opposent, chacun jalousant l'autre : les« hommes de corvée » sont enviés par les soldatsparce qu'ils restent à l'arrière, et ilssouhaiteraient de leur côté « être avec la
compagnie dans les tranchées » (p.33). Tirette etBarque se moquent gratuitement de ceux quiviennent accomplir des travaux de terrassementdans leurs tranchées, « de ces vieux frères d'armes qui
peinent nuit et jour, au bord de la grande guerre, pour réparer
les champs de bataille » (p.57). Au chapitre V, lefils des voisins, Charlot, explique que sonpère n'a pas envie que la guerre finisse car« on devient riche » (p.92). Le chapitre IX,
12
intitulé « La grande colère » est tout entierconsacré à la fureur de Volpatte qui revientaprès deux mois de convalescence et déploreque certains embusqués profitent à l'arrière« des avantages de la richesse et de la paix » (p.132), enjouant des comédies au moment de passer leursvisites médicales, et en prétendant ensuiteque le médecin a dû « le[s] retenir de force » alorsqu'ils souhaitaient ardemment participer àl'effort de guerre. Les soldats qui risquentleurs vies éprouvent une véritable haineenvers ceux qui restent à l'abri, à tel pointqu'on en vient à fusiller pour faire unexemple, un soldat du 204, Cajard, car « il avait
voulu couper aux tranchées » (chapitre X,« Argoval »). La majuscule placée au mot« Différence » à la fin du chapitre XXII insistesur le décalage ignoble et « irrémissible » dansun même pays « entre ceux qui profitent et ceux qui
peinent... ceux à qui on a demandé de tout sacrifier, tout, […] et
sur lesquels marchent, avancent, sourient et réussissent les
autres » (p.348). - La guerre génère donc des tensions entre les
partisans d’une même cause : Clausewitz faitétat de la difficulté pour un général de gérerune résistance interne de la part de sessoldats, qui peut être « le fait de l’insubordination et
de la contestation » auxquelles s’ajoute unesensation d’épuisement et de découragement
13
devant l’horreur du « spectacle déchirant des victimes
ensanglantées » (p.79). L’auteur soulignequ’ « un abîme profond sépare le chef suprême – le général
placé à la tête d’une guerre entière ou d’un théâtre de guerre -
du commandant situé immédiatement sous ses ordres »(p.93).
- Dans Les Perses, Xerxès menace de trancher latête de ses propres hommes si les Grecsparviennent à s'échapper vers le large, alorsque l'île de Salamine est cernée (v.369-71).La guerre crée donc des fossés entre lesgroupes, notamment entre ceux à qui elleprofite, qui en tirent des richesses, ou de lagloire personnelle, et ceux qui se sententsacrifiés, entre les chefs et les simplesexécutants laissés à l’écart de toutedécision, mais à qui on demande de donner leurvie.
Ainsi, la thèse de Jaurès se trouve justifiée parles crimes chaque jour plus atroces qu’on autorisesur le champ de bataille, lesquels génèrent deshaines séculaires entre les peuples, et par lesdissensions que la guerre crée même entre lesparticipants d’un même camp.
Mais l’idée de faire la guerre peut se justifiercar elle peut mener à une paix durable.
14
II) Mais idée de faire la guerre peut sejustifier : mener à une paix durable
Il semble qu’on puisse en effet penser aupremier abord que le fait d’entrer dans un conflitsoit susceptible d’avoir une vertu paradoxale :celle de délivrer durablement le monde de ce fléauqu’est la guerre.
1. Tout d’abord, la guerre aboutit à la paix. Cette dernière étant soit sa finalité suprême, soitau minimum, son résultat. Selon Aristote, « laguerre a pour objet la paix ». Elle a pour rôle derégler un différend entre deux parties qu'undésaccord oppose. Le combat est donc une nécessitépour apaiser les tensions et désigner un vainqueur,qui sera décisionnaire, selon la loi du plus fort.Il aura gain de cause et par voie de conséquence, onsignera la paix.
- Selon Clausewitz, penser que la guerre entredeux états, même civilisés, peut se résoudre àune froide « algèbre de l’action » qui nenécessiterait pas sa mise en pratique etpourrait être réglée de façon théorique, estabsurde (haut de la p.22). Il est obligatoirede vider le conflit par les armes.
- Si les hommes tuent, ont des comportementsbestiaux, c’est parce que cela estindispensable pour parvenir à un apaisement
15
dans le futur, comme le confirme le sagecaporal Bertrand : « Il le fallait – pour l'avenir »(p.297). Il explique au chapitre 2 du Feu que« les Boches sont chez [eux] [en France], enracinés, et qu'il ne
faut pas qu'ils passent » (p.39). Les Français nefont donc que défendre leur territoire et laguerre s'arrêtera quand cette mission aura étéaccomplie. Quand on est sur le champ debataille, on envisage d’ailleurs la fin de laguerre, la reconstruction : « Tout ça finira […]
Faudra tout r’faire. Eh bien, on refera. » L'espoir dessoldats est tout entier focalisé sur cetachèvement : « Vitement, la fin, et qu'ça » (p.297).
- De même, Clausewitz conclut le chapitre 2 dulivre I de l’œuvre portée à notre étude surl’idée qu’ « avec la paix, la fin est atteinte et que la
guerre a achevé sa tâche. » L’office assigné à laguerre est donc clairement exprimé ici : c’estbien la paix qu’elle poursuit. Même si cegenre d’affirmation est assez rare dans lepassage porté à notre étude, puisque selonnotre auteur, « le mobile initial » de la guerre tientavant tout dans sa « fin politique » (p.30), on peutde toute façon admettre que la paix est lerésultat de la guerre (à bien distinguer parailleurs d’une noble finalité… Lorsqu’ilaffirme que la guerre est « un moyen sérieuxau service d’une fin sérieuse », Clausewitz neconsidère pas que cette fin puisse être la
16
paix…), puisque le combat va rendre l’ennemiincapable de toute résistance. De facto, lecombat s’arrête : c’est là « le véritable objectif de
l’action militaire » (p.19), ôter tout moyen dedéfense à l’ennemi. On va alors mettre enplace des « négociations de paix » (p.32). La paixest même une obligation : s’il y a équilibredes forces que rien ne semble devoir modifier,Clausewitz signale que « les deux parties seraient
obligées de faire la paix » (p.34 point numéro 13).Ce vocabulaire de la contrainte est à nouveauemployé à la page 50 : « […] que l’adversaire soit
contraint à faire la paix. » En termes de stratégiemilitaire, la paix n’est par ailleurs jamaisenvisagée comme une vertu mais comme ce à quoion a intérêt ou non, comme le montre le pointnuméro 17. L’auteur explique qu’en certainescirconstances, « il peut se révéler préférable » decombattre défensivement dans l’avenir plutôtque d’attaquer dans l’immédiat ou « de conclure la
paix ». La paix apparaît donc dans cette œuvrecomme une solution parmi d’autres pourdominer, jamais comme un objectif à valeurmorale (d’ailleurs, si l’auteur affirme unesupériorité de la défense dans l’actionmilitaire, c’est parce qu’elle présente desavantages pratiques, non parce qu’elle seraitéthiquement plus acceptable. De même, on nepeut « faire grief » à un général habile de
17
chercher tous les moyens pour « éviter une
résolution sanglante » de la crise, néanmoinsClausewitz souligne qu’ « il emprunte là une voie
hasardeuse »), mais elle est a minima ce à quoiaboutit la guerre.
- Dans Le Feu, elle est son objectif affirmé : « […] il est grand et important de faire ce métier-là [le métier de
bourreaux] pour punir la guerre et l'étouffer » (Le Feu
p.398). « […] il faut en finir avec la guerre [.] Si on doit
remettre ça un jour, tout c'qui a été fait ne sert à rien. […] C'est
deux ou trois ans, ou plus, de catastrophes gâchées » (Le Feu
p.388). - Dans Les Perses, le fantôme de Darios engage les
hommes à tirer une leçon du désastre face auxcadavres amoncelés : « Il ne faut plus mener
d’expédition en Grèce » (v.790), et il valorise leschefs qui ont dirigé la Perse de façonmodérée, avec « raison » (v.767), « sage[sse] »(v.772), à l’image de « l’heureux Cyrus » qui« instaura la paix pour tous les siens » (v.768-69). Onpeut donc considérer que la guerre a pourrésultat et parfois même pour finalitél’obtention d’une paix durable.
2. Faire la guerre, c’est dissuasif D’autre part, si chaque camp peut croire avant le
combat être dans son bon droit et anticiper unevictoire, la réalité de la guerre, les pertes qu'ony subit, mènent à revoir ses prétentions, voire à
18
envisager la guerre elle-même différemment. Lecombat suppose un calcul continuellement revu selonles résultats obtenus sur le terrain. Le conflitarmé engage les états à recalculer leurs exigences,à envisager à nouveau ce qui les a poussés à entrerdans la bataille, et à comparer ces motifs, cesespoirs de gain, aux dépenses humaines etmatérielles qu’ils nécessitent. Cela peutéventuellement mener à souhaiter la fin de laguerre.
- L'armée de Xerxès est supposée invincible àson départ de Suse : « Ce grand flot d'hommes, qui
pourrait l'endiguer [?] » (v.86). Les vaisseauxperses sont beaucoup plus nombreux que lesvaisseaux grecs, à tel point qu'il estlégitime de se demander initialement commentces derniers pouvaient se croire « capables
d'engager le combat contre l'armée des Perses » (v.334-35). Mais cette supériorité numérique devientun défaut plus qu'un avantage, dans la mesureoù, durant l'attaque, les vaisseaux persess'entrechoquent et s'éventrent les uns lesautres (v.415). Ce sont donc, contre touteattente, les Perses qui tentent de fuir etd'échapper au combat. L'incise placée entreparenthèse « (pensait-il) » (v.450) et le jugementémis par le messager : « C'était bien mal prévoir ce qui
arriverait ! » (v.454) traduisent explicitement ledécalage entre ce qu'on a supposé avant le
19
combat et ce qui se passe durant celui-ci.Xerxès admet qu’il « aurai[t] dû voir ce désastre
imprévu » (v.1027), attribué à l’action néfastedes dieux (selon son père, « simple mortel, il s’est
imaginé qu’il vaincrait tous les dieux » v.749) qui « sans
équivoque ont renversé le cours des choses » (v.903-4),des « daïmons » qui ont fait tomber sur eux, « à
l’imprévu, un mal fulgurant » (v.1007, strophe 4 del’exodos). Il se lamente finalement de sondestin « funeste, imprévisible » (v.910).
- Clausewitz explique que le vécu de la guerremène à une révision continuelle de ce qu’onavait anticipé, ce dont on avait rêvé. Leprincipe de réalité engage à une certainelucidité : il faut tenir compte du coût de lavictoire, de la « dépense d’énergie » (p.52)qu’exige le succès. Le simple fait de mesurerles risques de la poursuite du combat pourraitmener à désirer la paix, puisqu’il s’agit defaire des calculs de probabilité et que lapossibilité que les opérations tournent ennotre défaveur existe. Nombre de traités depaix se sont d’ailleurs conclus avant quel’une des deux parties se trouve anéantie(p.50). On peut donc décider de conclure lapaix parce que la victoire sembleinvraisemblable ou parce qu’elle aurait uncoût trop élevé (p.52). Ceci explique lapossibilité de se fixer pour unique objectif
20
de faire sentir sa supériorité à l’ennemi, et,en ébranlant sa confiance, de générer sacapitulation et l’arrêt des combats. Lesadversaires peuvent alors trouver un moyen de« se rencontrer à mi-chemin de leurs différends politiques »,et « la paix sera conclue » (p.52).
- Dans Le Feu, les journaux écrivent que lesAllemands « ne peuvent plus tenir, d'après les calculs les
plus autorisés, que jusqu'à la fin de la semaine » (p.49), cequi laisse espérer que la fin de la guerre estproche. Il faut donc expérimenter la guerrepour constater qu’on ne peut la mener plusloin, et s’en libérer. De même, seule laréalité de la guerre peut engendrer une remiseen question des belles idées illusoires qu'onse fait à son sujet. Il y a un énorme décalageentre ce qui se décide calmement « en chambre, en
dehors de la sphère de la guerre proprement dite » et cequi a lieu « dans la mêlée de la guerre elle-même »(p.104-105). C’est ce que Clausewitz appellela « friction» (titre du chapitre 7), c’est-à-dire la différence entre la guerre prévue surle papier et la guerre dans sa réalité. Ainsi,ceux qui décident de ce qui se passe sur lechamp de bataille ne s’y trouvent pas et onttendance à ignorer la détresse du soldat sousle feu. Au début du chapitre IV intitulé « Du
Danger à la guerre », Clausewitz explique que del’extérieur, on imagine le champ de bataille
21
comme un endroit attirant. Poussé par le désirde vaincre, on envisage avec enthousiasme decharger l’ennemi, de se précipiter vers unemort éventuelle. Mais un novice y cesse trèsvite d’éprouver cette exaltation, lorsqu’ilentend les balles siffler et voit ses amiss’écrouler. « La gravité de la vie transperce alors l’image
formée dans les rêves de la jeunesse » (p.99). Ainsi, sila guerre est susceptible de générer un désirde s’éloigner de la guerre, c’est parcequ’elle est terrifiante sur le terrain et queceux qui l’ont vécue ne peuvent avoir que cecri à l’esprit : « Plus de guerre, plus de guerre ! Oui,
assez !» (Le Feu p.383). A la guerre, « on meurt de
chaleur et de soif, abattu par les privations et la fatigue » (De
La Guerre p.101). - « La plupart sont morts et de soif et de faim : les deux maux
tout ensemble ! » (Les Perses v.490-91). - Seule l'expérience de la guerre en dégoûte à
jamais celui qui la fait, lequel pouvait lui-même a priori être tenté d’admirer les valeursmartiales : la division marocaine qui part enpremière ligne (ceux qu’on appelle les« tabors » p.57) est considérée par les hommesde Bertrand comme constituée de vrais soldats,« faits pour l'assaut » admirables par « leur
acharnement à l'assaut, leur ivresse d'aller à la fourchette »(p.58). Cette admiration est encore plus naïvechez le couple de civils rencontrés dans un
22
café lors de la « virée », au chapitre XXII.Ils présentent une vision esthétique dufront : « Superbe une charge, hein ? ». La femmecompare les combats à une « fête » au cours delaquelle de « petits soldats qu'on ne peut pas retenir […]
meurent en riant. » (p.345), le mari déplore ne paspouvoir être à l'honneur comme le narrateur etses amis. Il faut donc vivre la guerre pourdéfaire définitivement un peuple de sonenthousiasme guerrier. C'est dans « la tragédie des
événements » que « ces hommes en débris […] ont un
commencement de révélation » (Le Feu p.329). - Le même décalage peut être observé dans la
pièce d'Eschyle : le Coryphée, qui décrit ledépart de Xerxès et de ses alliés, y voit,dans la parodos, un « spectacle formidable » (v.48).Finalement, Xerxès qui s'était « établi sur un tertre
élevé », pour jouir d'un point de vue global surle combat, « déchire sa robe, et pousse un cri perçant […]
puis se lance en une fuite désordonnée » (v.468-70). Ilne reste plus qu’à gémir, crier, hurler,pleurer, se frapper, déchirer ses vêtements,s’arracher les poils de la barbe et lescheveux, en signe de deuil (v.1054 à 1064). Ilfaut donc faire la guerre pour prendreconscience qu’elle n’aura pas les effetspositifs escomptés, pour cesser de l’enjoliveret donc y renoncer.
23
3. Faire la guerre donne envie de faire la paix Enfin, la guerre produit paradoxalement un désir
profond d’être en paix avec son prochain. - Au début du chapitre 2 de son essai,
Clausewitz explique que les cœurs tournés versla paix étant « très nombreux, quels que soient le peuple
et les circonstances », la signature de la paix enelle-même éteint des braises qui auraient purester allumées. La dureté des combats suscitedes comportements fraternels dans les équipesformées, et au-delà. Elle finit par produiredes rapprochements, au sein des clansd'abord :
- Barbusse explique dès le chapitre 2 de sonroman que les hommes qui appartiennent à l'« escouade de Bertrand » sont différentsphysiquement, intellectuellement, socialement,à l'image de « la collection multicolore et multiforme »de leurs jambes (p.28) : leurs « âges »
s'étalent (p.31), leurs « races », autant queleurs « métiers » ne sont pas comparables (p.31-
32), ce qui fait faire cette remarque àBarque : « Tout de même, c'qu'on ne se ressemble pas ! ».La différence, déjà très marquée à l'intérieurdes groupes, est encore plus prégnante entreles parties opposées. L'œuvre de Barbusse meten évidence deux camps bien identifiés : lesFrançais et les « Boches » dont chacun possèdeses lignes, ses tranchées. Le Boyau
24
international est découpé de façon à ce queles rencontres soient limitées (ce qui arrive àPépin, Volpatte, Blaire et Poupardin auchapitre XVIII : se trouver dans la zoneallemande de ce boyau, est raconté comme unévénement). Les rapprochements entre les êtresappartenant à ces camps opposés sont rares.Néanmoins, cette foule hétérogène va setrouver uniformisée par la guerre. Barbussenote ce paradoxe : « Oui, c'est vrai, on diffère
profondément. Mais pourtant, on se ressemble. […] Attachés
ensemble par un destin irrémédiable […] on est bien forcé, avec
les semaines et les nuits d'aller se ressemblant. L'étroitesse
terrible de la vie commune nous serre, nous adapte, nous
efface les uns dans les autres. » (p.34-35). L'aviateurrencontré au poste de secours (chapitre XXI)raconte qu'il a cru voir « double » enconstatant à quel point les deux messes,allemande et française, étaient identiques,« une prière », « un seul bruit de cantique » (p.327).Au chapitre XXIV, lorsque l’aube se lève surle champ de bataille, le narrateur et Paradisobservent les corps méconnaissables, et sedemandent s’ils sont Allemands ou Français,mais se révèlent incapables de répondre (p.458-459). On ne peut déterminer leur identité,et ces hommes « chargés de terre […] se ressemblent
comme s’ils étaient nus […] revêtus exactement du même
uniforme de misère et d’ordure.» Des Allemands
25
s'affalent alors près d'eux et Paradis lesautorise à « reste[r] là », « s'ils veulent » (p.377).Ils finissent par s'endormir ensemble « pêle-
mêle dans la fosse commune » (p.378). On oubliefinalement les motifs qui ont poussé à laguerre. Alors que Marthereau interroge :« Pourquoi ? », Lamuse répond : « Y a pas d'raison »(p.39). Au chapitre XII, Poterloo raconte quelors de sa dernière mission, un Allemand apris des risques pour qu'il puisse passerdevant chez lui et voir sa femme et sa fille,« un chic type […] Il écopait salement si je m’faisais poisser,
hé ? » (p.183). Au chapitre XXIV, les hommes quidiscutent conviennent du fait que ce n'est pasl'élimination de l'Allemagne qui permettra dese délivrer de la guerre. S'il « faut se battre »,c'est pour « tuer l'esprit de la guerre ». « - Il n'y aura
plus de guerre, gronde un soldat, quand il n'y aura plus
d'Allemagne. - C'est pas ça qu'il faut dire ! crie un autre. C'est
pas assez ! Y aura plus de guerre quand l'esprit de la guerre
sera vaincu ! » (p.385). On se bat alors « contre
une erreur, non contre un pays » (p.386). Le« résultat » escompté n'est pas d' « être vainqueurs
dans cette guerre » (p.387). La guerre produit doncdes rapprochements inattendus : les soldats lajugent dépourvue de sens et s’assimilentspontanément à ceux qui combattent dans lecamp adverse : « [...] ce que tu appelles les autres,
c'est justement pas les autres, c'est les mêmes » (p.390).
26
L’idée selon laquelle la guerre permettrait demettre fin à des hostilités incessantes se justifiedonc, puisqu’elle vise une paix durable, mène àrevoir ses prétentions et l’idée même qu’on se faitd’une bataille, et finit par créer des liensinattendus entre les combattants qui se découvrentfrères dans leur détresse commune.
Mais on peut se demander si vouloir « sedébarrasser de la guerre » n’est pas un projetutopique. Est-il réaliste de songer à se libérerdéfinitivement de la guerre ?
III) On peut ainsi se demander si vouloir « se débarrasser de la guerre » n'est pas un projet utopique. Est-il réaliste de songer à se libérerdéfinitivement de la guerre ?
1. Egoïsme de l’homme Se débarrasser de la guerre supposerait tout
d’abord une capacité de l'homme à renoncerdéfinitivement à ses prétentions égocentriques et àconsidérer autrui comme un semblable, en adoptantune posture objective.
- Le chapitre 1 de l'œuvre de Barbusse voitd'emblée les hommes reconnaître laresponsabilité de leur camp : l'Autrichienadmet que son pays commet « un crime »,
27
l'Allemand « espère que l'Allemagne sera vaincue »(p.12). La structure circulaire de l’œuvrepermet d'insister sur la foi du narrateur en« une volonté » commune des soldats martyrisésdevenus « esclaves », au-delà des campsennemis : « On voit bien que le vieux monde sera changé
par l'alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le
nombre et la misère sont infinis » (p.16). La guerreentre deux pays n'est que le suicide del'humanité (idée exprimée p.14 et p.384), selonles malades du sanatorium qui commententl'horrible nouvelle. Mais, ils retournentensuite, comme dans un mouvement naturel, àleurs petits soucis personnels, « rentrent un à un,
en eux-mêmes, préoccupés du mystère de leurs poumons, du
salut de leurs corps » (p.14). Plus loin, les soldatstrahissent le même égoïsme. « Chacun pour soi à la
guerre » affirme Tulacque (p.40) et Lamuseconfirme : « J'pense à bibi. » Le narrateur admetque la guerre accentue les « instincts
primordiaux » : « l'égoïsme », la « joie de manger, de
boire et de dormir » (p.59). Elle développe « tous les
mauvais instincts sans en excepter un seul : […] l'égoïsme
jusqu'à la férocité, le besoin de jouir jusqu'à la folie »(p.385). À l'arrivée à Gauchin-l'abbé, auchapitre V, chacun cherche à louer chezl'habitant avant l'autre, sachant qu'il n'yaura pas de place pour tout le monde, à telpoint que le narrateur a « l'impression d'une sorte de
28
combat désespéré entre tous les soldats ». « Quels fumiers
que les autres ! » (p.81-82). Au poste de secours,le narrateur voit les hommes qui attendentd'être vaccinés contre le tétanos, tenter deprendre la place des autres : « Moi ! Moi ! Moi ! »(p.324).
- L’objectif étant, par le « moyen » de laviolence, de parvenir à une « fin » qui estd’ « imposer notre volonté » (ceci est posé dès ledébut de l’œuvre de Clausewitz et répété audébut du chapitre 2), quiconque veut obtenirla satisfaction de ses désirs pourra (devra) yrecourir à nouveau (p.20). Le motif de laguerre réside dans des « intérêts antagonistes »(p.22) : il y a donc risque de guerre sitôtque l’une des parties refuse de renoncer à sonintérêt (l’auteur donnera des exemples de cesfinalités, comme « la conquête d’une provincedéterminée p.31). Ainsi, comme l’indique lepoint 9 du chapitre 1 : « Le résultat de la guerre n’est
jamais quelque chose d’absolu » (p.29). L’état vaincune voit pas l’issue d’une guerre comme unesituation pérenne, mais comme un mal momentanéauquel on pourra par la suite trouver remède(par une autre guerre ? On peut l’envisager,même si Clausewitz ne le prévoit pas ici, maisla suite de l’argumentaire le laissesupposer.) Le point n°13 nous indiquenotamment que lorsque l’un des adversaires est
29
parvenu à son objectif, « vient le temps du repos »si et seulement si l’ « adversaire veut lui aussi
s’apaiser en reconnaissant ce succès » et donc signe lapaix. Mais il peut aussi ne pas reconnaître lesuccès en question, et agir, se préparer àriposter, s’organiser. À ce moment-là, levainqueur peut d’ailleurs lui-même déciderd’agir à nouveau, « afin de ne pas laisser au vaincu le
temps de s’armer pour repasser à l’action » (p.34).S’établit ici une continuité de l’activité quipousse « tout de nouveau à l’extrême » (point n°14)et amplifie « le degré de fureur » du combat(p.35). Ajoutons que les motifs d’une guerrerelèvent aussi de l’ambition personnelle deceux qui la décident et la dirigent. « La soif de
gloire et d’honneur », injustement traitée par lelangage selon Clausewitz, qui déplore que lesmots que nous employons pour désigner cettesoif la dévalorisent, sont des sentiments quidoivent, être comptés parmi les plus noblesdes sentiments humains (p.80). Ils donnent auchef le désir de surpasser ses compagnons, etde mener ses troupes au succès. Aucun grandgénéral n’a manqué d’ambition (p.81). L’auteuradmet cependant que l’abus de ces qualités apu engendrer en temps de guerre, « les plus
révoltantes injustices à l’encontre de l’humanité » (p.80). - Dans Les Perses, c’est l’ hybris de Xerxès, son
désir (sur de mauvais conseils, selon sa mère)
30
d’amplifier les richesses de son pays, quisont considérés comme responsables dudésastre. Le fils n’a malheureusement pas tenucompte des indications du père, selon Dariosqui stigmatise l’impétuosité liée à son âge :« Mon fils est jeune : en ses jeunes pensées, il ne se souvient
pas de mes conseils » (v.782-83). Chacun voulantdominer, vaincre, se mettre en valeur, obtenirplus que l’autre, la possibilité de supprimerdéfinitivement tout conflit semble illusoire.
2. Tempérament belliqueux de l’homme De plus, le tempérament belliqueux de l'homme
semble rendre les guerres inévitables. - La reine s'étonne, dans la pièce d'Eschyle,
que son fils ait pu avoir pour projet desoumettre les Grecs dont l'armée est réputéede grande qualité (v.233-36), mais on ne cesseparallèlement de valoriser l’esprit deconquête de Darios, la seule différence,marquée dans le deuxième stasimon notamment,résidant dans le fait que l’armée revenaitauparavant victorieuse des batailles menées :« Les retours des combats, sans souffrance ni peine, rendaient
les hommes à leurs maisons heureuses » (v.861-63). - Selon Barbusse, certains « ne veulent pas faire la paix
sur la terre » (p.397), « la volonté d'en finir n'y est pas »
pour ces gens qui doivent être considéréscomme nos véritables ennemis, bien davantage
31
que les Allemands, « pauvres dupes odieusement
trompées et abruties ». Les tuberculeux quiapprennent au sanatorium que la guerre estdéclarée au début de l'œuvre formulent à leurfaçon la thèse de Marx sur la répétitionhistorique : « C'est la Révolution française qui
recommence ! ». « Arrêter les guerres ! Est-ce possible ! »
Cela reviendrait à vouloir « arrêter les orages »(p.14). La guerre est assimilée à une maladiecontagieuse et « inguérissable » (ce lexique de lacontagion est repris au chapitre XXIV :« maladie dévoratrice », «cancer » p.397). « Les
hommes sont fous », selon un soldat chez Barbusse,tout comme Darios affirme : « Il faut que la démence
ait possédé mon fils » (v.751). « L'important pour eux, c'est
la question nationale, pas aut'chose, et la guerre une affaire de
patries : chacun fait reluire la sienne, voilà tout » (p.386-87). L'opinion générale argue que les racesse haïssent, à tel point que certainsdisent que « les enfants viennent au monde avec une
culotte rouge ou bleue sur le derrière. » (p.395). Ledésir de gloire est constamment évoqué dansnos œuvres : la guerre en donne l'occasion,certains « parmi les gradés, essaient d'imiter Napoléon »(p.231), les soldats combattent « pour qu'une
caste galonnée d'or écrive ses noms de princes dans l'histoire »(p.393). Un soldat qui a pourtant perdu unfils au combat, raconte avec fierté commentil a « jou[é] au soldat » avec son deuxième fils de
32
cinq ans, un « sacré p'tit mec », qui fera un« fameux poilu plus tard », à qui « il a fabriqué un petit
flingot », « expliqué les tranchées ». - Selon Clausewitz, il faut s’exercer en temps
de paix à faire la guerre, faire venir dansnos troupes des officiers qui se sontdistingués dans les conflits étrangers oudétacher nos propres officiers dans les arméesétrangères en plein combat « pour qu’ils s’initient à la
guerre » (p.113). L’homme a donc un tempéramentguerrier qui empêche de songer à se libérer dela guerre à tout jamais.
3. Au fond, on ne peut se débarrasser des guerres qu’en oubliant la guerre
Finalement, on ne peut se débarrasser de laguerre qu'en oubliant ses motifs et sa réalité, maisle statut de l'oubli est ambigu : si on laissel'oubli s'installer pour rendre la paix possible etdurable, on trahit la réalité de la guerre, seulecapable de générer la répulsion à son encontre.
- Déjà, pendant le conflit, il semble parfoisque « le passé de souffrance n'existe plus » sitôt que lesoleil s'est montré, provoquant un semblant deconfort. Biquet rit lorsqu'il lit la lettre desa mère qui l'imagine dans la boue et lefroid, privé de tout : « On a eu des misères, mais on
est bien maintenant » (p.102). Au chapitre XII,après s'être insurgé contre le fait que dix-
33
huit mois après la mort de son époux,Madeleine Vandaërt, « rigolait, […] riait carrément »,ou que sa femme et sa fille puissent passerune soirée agréable avec « des sous-offs boches »(p.184-85), Poterloo se ravise, et accepte que« c'est la vie. Eh oui, elle vit voilà tout. […] On oublie, on est
forcé d'oublier. C'est pas les autres qui font ça ; c'est même pas
nous-mêmes ; c'est l'oubli, voilà. » (p.187-88). Leshommes se définissent comme « des machines à
oublier » (p.382) au chapitre XXIV, maisdéplorent cet état de fait car si l'on oublie,« tant de malheur est perdu ! ». Il faut absolument« se rappel[er] » : « Si on s'rappelait, la guerre serait
moins inutile qu'elle ne l'est » (p.383). L'œuvre estd'ailleurs présentée comme écrite par un dessoldats participant au combat, qu'on voitprendre des notes au chapitre XIII, et quirevendique la véracité de son écrit. Ilaffirme notamment que, par souci d’exactitude,il y laissera les gros mots, « parce que c'est la
vérité » (p.197). L'attitude du narrateur, savolonté de témoigner sans modifier les choses,même si « ça s'fait pas » de mettre des motsgrossiers dans un livre, montrent un désir dene pas oublier, désir affirmé aussi
- dans Les Perses : « Souvenez-vous bien d’Athènes, de la
Grèce » (v.824). - Malgré tout, dans la réalité, témoigner de ce
qui a été vécu au front est difficile : au
34
chapitre XXII (« La Virée »), la « construction
puérile » intitulée « Kamerad » confectionnéepar un marchand, qui met en scène deuxmannequins de cire et de bois, représentant unsoldat allemand agenouillé, tendant les mainsvers un officier français, offusquent lenarrateur et ses amis mais ils n'osentcependant pas protester lorsqu'une dameélégante vient leur demander si c'est lareproduction fidèle de ce qu'ils voient dansles tranchées. Leur commentaire : « C'est à peu
près ça, quoi », est leur « première parole de
reniement. » (p.343). Même mensonge lorsqu'ilsminimisent ensuite la dureté de la vie enpremière ligne, par honte de leur misère :« On n'est pas malheureux... C'est pas si terrible que ça,
allez ! » La mémoire des soldats est comparableaux paysages qui garderont en leur sein lamarque des combats puisque des hommes ontordre de combler les trous creusés par lesobus, et de « boucher tout, pour enterrer les corps sur
place », mais qui extérieurement, semblerontintacts. Ils garderont leur blessure enfouieen eux.
- D’ailleurs, l'extériorisation pourrait aussiêtre contre-productive si l'on souhaite qu’iln’y ait plus de conflits : selon Clausewitz,la mention des écueils rencontrés pendant labataille, « les dangers, la détresse et l’effort »,
35
servirait à rehausser la victoire (p.103) etpourrait donc générer chez ceux qui écoutentces récits un désir de combattre à leur tour.Oublier pour ne pas raviver les haines passéesse révèle donc incompatible avec la nécessitéde se souvenir pour ne plus laisser la guerrese réinstaller, et cette contradictionconfirme sans doute que vouloir « sedébarrasser de la guerre » est impossible.
Le projet de libérer définitivement les peuplesde la guerre relève donc de l’utopie, si l’onconsidère l’égoïsme foncier de l’être humain, soncaractère belliqueux et la nécessité contradictoirede concilier l’oubli du mal qui a été fait et ledevoir de mémoire.
Pour conclure, nous pouvons considérer que latentation est grande de faire de la guerre unrepoussoir qui permettrait d’éviter tout conflit àvenir, puisqu’elle mène invariablement à la paix,engage à détester la guerre elle-même, qui n’apportepas toujours les victoires escomptées, et contraste,sur le terrain, par les tableaux violents etsanglants qu’elle impose, avec la beauté imaginairedes champs de bataille, qu’on ne voit plus ensuitecomme le lieu de sentiments nobles et de sacrificesvertueux. En outre, les rapprochements que toutconflit opère entre les malheureux qui doivent y
36
risquer leur vie, tendraient à justifier la thèseselon laquelle les hommes qui ont pris part aucombat ne veulent pour rien au monde réitérer cettesombre expérience. Néanmoins, Jaurès nous alerte surl’absurdité de cette théorie, la guerre éloignantdéfinitivement les peuples les uns des autres, dansle mal infini qu’elle produit et le désir devengeance qu’elle génère, créant même des clans dansles clans, et provoquant des scissions intra-nationales. Nos œuvres laissent plutôt entendrequ’il sera difficile de « se débarrasser de laguerre », car chacun est préoccupé par ses intérêtspersonnels, n’hésitant pas à envisager de se battrepour les voir triompher, et finissant par oublier lelourd tribut que ses ancêtres ont payé à la défensede la patrie. Si guerre et paix pouvaient avoir unlien de cause à conséquence, il serait plutôt àtrouver dans la seule menace de provoquer un conflitpour que la crainte de tout perdre engage les étatsà trouver des solutions pacifiques. Il faudrait doncpréparer la guerre pour obtenir la paix : « Si vis
pacem, para bellum ».
37







































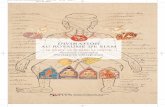


![Pierre-Ernest de Mansfeld: l’homme de guerre [2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332561c83bb92fe98045d0d/pierre-ernest-de-mansfeld-lhomme-de-guerre-2007.jpg)















