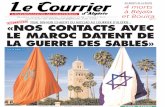Enseignement et formation des officiers des marines de guerre néerlandaise (flotte de guerre et...
-
Upload
univ-paris5 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Enseignement et formation des officiers des marines de guerre néerlandaise (flotte de guerre et...
1
Colloque du Hâvre du 28 au 29 octobre 2011 « La formation des Marins … au grée des marées »
« Enseignement et formation des officiers des marines de guerre néerlandaise (flotte de
guerre et celles des compagnies commerciales), aux XVIIe et XVIII
e siècles, comparés à la
France et la Grande Bretagne1 ».
Roberto Barazzutti
Administrateur à la Société Française d’Histoire Maritime
Texte en cour de parution.
A la suite de la guerre qui débute en 1568, les Provinces-Unies deviennent une nation, un
état indépendant et puissant. Puissance maritime tant militaire que commerciale, l’histoire
économique et maritime de ce succès a fait l’objet de nombreux travaux2. Depuis une
bonne vingtaine d’années, les historiens s’intéressent de plus en plus aux navigants.
Plusieurs travaux ont eu comme thème la formation des marins, notamment des officiers.
Dans le cadre du colloque, il nous a semble intéressant d’offrir à un public non
néerlandophone des informations sur cette enseignement et la formation de ces officiers
servant sur les marines de guerre surtout, mais aussi à bord des navires de la compagnie des
Indes Orientales, la VOC. Ce choix s’explique par le fait que cette compagnie commerciale
ainsi que sa consoeur occidentale, la WIC, servent, notamment au XVIIe siècle, de forces
auxiliaires » à la marine militaire néerlandaise. Par ailleurs, de nombreuses études existent
sur la VOC que l’on peut utiliser pour connaître les enseignements et formations dispensés.
Notre point de vue ne sera pas que néerlandophone mais nous tenterons de relier cela aux
évolutions et pratiques de deux autres puissances maritimes : la France et la Grande-
Bretagne3. La césure chronologique entre le XVIIe et le XVIII
e se prête à merveille dans le cas
1 Une petite comparaison entre la France et la Grande-Bretagne existe dans le livre de Gérard Le Bouedec,
Activités Maritimes et sociétés littorale de l’Europe Atlantique 1690-1790, Paris, Armand Colin, 1997, p. 194-
198. 2 La bibliographie sur ces thèmes est vaste. Voici quelques ouvrages de référence : Jonathan Irvine Israel, The
Dutch Republic. It’s rise, greatness and fall 1477-1806 ; Oxford, Oxford University Press, 1998; Jan de Vries et
Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei ; Amsterdam,
Uitgeverij Balans, édition de 2005. 3 L’approche choisie consiste à fournir quelques éléments à partir de travaux d’historiens néerlandais notamment
Carel A Davids et Marc van Alphen, complétés par mes recherches sur les officiers de marine. Voir Roberto
Barazzutti, « Etude comparative des officiers généraux aux Provinces-unies, en France et en Angleterre à
l’époque de Louis XIV, Revue d’histoire maritime, n°12, 2010, p. 119-152 ; id. Colloque de Brest du 18 au 20
novembre 2010 « Ecritures de l’officier de Marine » voir ma communication «Les officiers de marine
néerlandais : sujet et acteur de la littérature au XVIIe siècle».
2
présent pour évoquer les évolutions de cet enseignement et de la formation des officiers,
vers une professionalisation de ceux-ci.
Quelques préalables sur la marine néerlandaise et ses officiers
La République Néerlandaise est une confédération de 7 provinces souveraines qui partagent
des finances communes, une armée, une marine et une politique étrangère. Elles délèguent
leurs pouvoirs aux Etats Généraux de La Haye. Après quelques dissensions initiales
provoquée par une tentative de centralisation plus grande, la décision est prise le 13 août
1597 de créer cinq Amirautés séparées, une décision considérée alors comme provisoire qui
restera en vigueur jusqu’en… 1795 ! Ces cinq Amirautés sont établies dans les provinces de
Zeeland (Middelbourg), de Hollande (amirauté de la Meuse la première et plus ancienne à
Rotterdam et celle d’Amsterdam), West-Friesland het Norderkwartier (Hoorn et Enkhuizen4)
et Frise (Dokkum puis Harlingen en 1645)5.
Chaque amirauté est composée de plusieurs conseillers nommés par les Etats Généraux sur
proposition des Etats Provinciaux6, ainsi que d’un réprésentant du stathouder dans le cas de
la Zélande. Une des particularités réside dans le fait que ces conseillers peuvent provenir de
villes de la même province ou extérieures7. L’amirauté a en charge l’armement d’une flotte
selon les besoins. Elle a un pouvoir décisionnel qui parait plus important que celui du
stathouder. Ce dernier exerce une fonction d’amiral suprême toute symbolique ; son
pouvoir se limitant à la nomination des capitaines de vaisseau permanents, dits ordinaires,
entre les deux candidats qui lui sont présentés par les amirautés. Quant aux états des
provinces maritimes, ils désignent les officiers généraux8. Cette organisation se rencontre
aussi parmi les compagnies des commerces (à la VOC ce sont 6 chambres avec à la tête de la
compagnie un comité de direction restreint appellé les Heeren XVII). Ce « fédéralisme
maritime » aboutit à ce qu’on ne retrouve pas ici de centralisation des affaires maritimes
4 Pour éviter toute jalousie entre les villes de Hoorn et d’Enkhuizen, les Etats-Généraux décident en 1593 de fixer
le siège de l’Amirauté dans ces deux villes avec une alternance trimestrielle. 5 Pour plus de détail, voir J.R Bruijn, “ Les Etats et leurs marines de la fin du XVI
e à la fin du XVIII
e siècle ”
dans Philippe Contamine (dir.), Guerre et concurrence entre les Etats européens du XIVe au XVIII
e siècle, Paris,
Presses Universitaires de France, 1998, p. 83-121. 6 9 à 12 selon les amirautés.
7 Par exemple, pour l’Amirauté de West-Friesland en het Noorderkwartier, les 11 conseillers proviennent des
villes d’Hoorn, Enkhuizen, Amsterdam, Alkmaar, Monnickedam, Medemblick et des provinces de Zeeland,
Frise, Utrecht, Gelderland et Overijssel. 8 Il en existe trois jusqu’en 1653, puis dix en 1653, et seize en 1665, régulièrement soldés, auxquels il faut
ajouter les chefs d’escadres temporaires, ainsi que les commandeurs. Voir Roberto Barazzutti,
3
comme il existe en France et dans une moindre mesure la Grande-Bretagne, cela ne sera pas
sans influence sur l’organisation de la formation des officiers.
L’origine sociale des officiers de marine subit une évolution au cour du XVIIe et XVIII
e siècle.
Tout comme en France, mais avec quelques différences, le constat est celui d’une
« aristocratisation » à partir de 1670-1690. De plus en plus d’officiers proviennent de
catégories sociales de la bonne bourgeoisie, pour ne pas dire la haute bourgeoisie. Selon J.R
Bruijn, parmi les capitaines et officiers-généraux de l’amirauté d’Amsterdam entre 1690 et
1751 ; 38% proviennent du milieu des régents et des gentilhommes, 10% sont fils de
marchands ou d’artisans, 7% sont fils de pasteur ou d’avocat, 11% sont fils d’un conseiller
de la ville et plus de 20% sont fils d’un officier de marine. En France, la part de la noblesse
reste conséquente dans le corps des officiers des vaisseaux et des galères9. Elle n’est pas
négligeable non plus en Angleterre.
La population néerlandaise est une population cultivée10, fortement alphabétisée11. A titre
d’exemple, en 1583 à Amsterdam, 55% des époux et 38% des épouses savent signer leur
nom sur les actes de mariage. Vers 1680, le ratio atteint 70%. Entre 1601-1625, le taux
d’analphabétisme à Delft et Rotterdam tourne aux alentours de 30-35% chez les époux et
40-50% chez les épouses12. L’une des raisons est le rôle joué par la religion protestante en
favorisant l’établissement d’école et l’installation de maître13. Il n’est pas surprenant alors
que le niveau des marins et plus particulièrement des officiers néerlandais soit plus elevés
que celui existants dans d’autres pays comme le montre le tableau établi à partir de
l’interrogatoire de prisonniers faits par les Anglais entre 1756 et 1783. Globalement,
9 En France, en dehors des études que sur les capitaines de vaisseaux, on ne dispose pas d’étude globale de tous
les officiers quel que soit le grade. Néanmoins, les travaux de Michel Vergé-Franceschi et de quelques uns de ces
élèves (R Barazzutti, Marie Helene Peltier, François Riou Perennes) confirme la domination de cette noblesse
même si elle a fluctué dans le temps. 10
Sur ce point, et ce qui suit voir notre communication faisant suite au colloque de Brest sur l’Ecriture des
Officiers de marine. 11
En 1567, Ludovico Guicciardini, un marchand florentin installé à Anvers depuis 1542, publie une description
des Provinces-Unies à la veille de la guerre dite de 80 ans, dans laquelle il dit : La plus grande partie de la
population détient quelques connaissances en grammaire ; presque tout le monde, même les paysans, savent ici
lire et écrire. Par-dessus tout, ce qui est admirable c’est la connaissance que les Néerlandais ont des langues
étrangères. On ne compte pas les gens qui ne sont jamais allé à l’étranger mais qui parlent quand même des
langues étrangères. Ici les gens sont habitués avec le français ; beaucoup de néerlandais connaissent
l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol ; d’autres parlent des langues des pays lointains. Cette citation
traduite par mes soins est issue du livre de Roelof van Gelder, Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17de en
18de eeuw, Olympus, Amstel Uitgever, 2010, p. 22. 12
Sur ces données voir A.M. van der Woude dans Jan de Vries et Ad. Van der Woude, op.cit. p. 210-211. 13
En 1574, le synode de Dordrecht prévoit l’ouverture d’école dans les villages et de pouvoir y envoyer les
enfants des pauvres aussi. Dans la province de Drenthe, un « plakkat » (ordonnance) de 1630 prévoit que pour
tout enfant de 7 ans une somme sera versée jusqu’à temps qu’il sache lire et écrire.
4
l’instruction de ces hommes reste élémentaire et rares sont ceux comme Piet Hein à se
demarquer par la qualité de leur graphie ou de leur grammaire. Maerten Tromp, même si
ses lettres montrent malgré tout une recherche juste des mots et une certaine éloquence,
se sentira coupable « de ne pas être verser dans les lettres, mais qu’il est élevé, nourrit dans
cet élément variable de la mer14 ». Barry Coward dans son ouvrage sur l’Angleterre sous les
Stuart rappele que les fils de bonnes familles pouvaient recevoir une éducation privée à la
maison ou dans la maisonnée d’un seigneur, alors que le réseau scolaire ne cesse par
ailleurs de s’accroître. Les notices biographiques permettent entre autre de constater que
quelques officiers anglais et français ont fréquenté une école secondaire (Duguay-Trouin,
Edward Vernon, Rodney15).
Dans l’édition d’un livre de 1558 destiné aux pilotes (stuurman)16, l’auteur écrit qu’il est
impératif qu’un pilote sache lire et écrire afin de tenir les comptes mais aussi de déchiffrer
les cartes et de savoir y lire ce qui est marqué dessus ! À partir de 1618, l’officier était dans
l’obligation de tenir un journal de bord dans l’amirauté de Zélande17. Dans les autres
amirautés, on retrouve aussi de nombreux journaux sans toutefois déceler une obligation
comme dans celle de Zélande18. La tenue des journaux ne sera standardisée en 1787 alors
qu’elle l’est depuis 1659 pour la VOC. Cette demande peut être vue comme la volonté des
instances de garder les secrets du voyage (dans le cas de la VOC19), d’exercer une
14
« in de letteren niet geverseert, maer in dat ongestadige element van de zee is opgevoet ». Le 26 novembre
1626, Isaac de Razilly remet un mémoire au cardinal s’excusant “de ne pouvoir écrire un discours poli”… “pour
n’avoir estudié sinon dans les mœurs et coutumes des vivants”. Cit. Michel Vergé-Franceschi, Marine et
Education, p. 15. 15
Vernon a fréquenté la Westminster school de 1692 à 1700 ou il y acquis un bon niveau en mathématique et en
français, tandis que Rodney a été à Harrow. 16
C’est la première édition du traité de Philips van Kleef en français qui ne paraîtra qu’en 1579 en néerlandais. 17
Il reste 36 journaux de bord tenus par Michiel de Ruyter allant de 1633 à 1676, faisant quelques pages à plus
de 200. 18
L’inventaire des résolutions et documents des Etats-Généraux de 1576 à 1796, référencé 1.01.05.ead, permet
de réaliser que ce fond d’archives qui n’est pas un fond proprement maritime ou de l’amirauté comporte plusieurs
journaux de bord. Le plus ancien date de 1602 et il est tenu par le secrétaire Henrick Hoevenaar dans la flotte de
Jacob van Duivenvoorde. Il est suivi par un examinatieboek tenu par le secrétaire de Jacob van Heemskerck en
1607. Suivent ensuite un journal du lieutenant amiral Guillaume de Zoete seigneur de Haulthain consacré à la
campagne contre les pirates en 1611-1612 ; le journal de Jan Cornelissen May de son voyage vers le Japon et la
Chine en 1611-1613. À partir de 1616, le nombre de journaux s’accroît : plusieurs d’Hillebrandt Gerbrandtsz
Quast, le premier journal de Witte de With de 1626… Certains journaux sont des copies des originaux. Jusqu’en
1667 les journaux sont nombreux, ensuite dans ce fonds ont ne retrouve de relations qu’en 1702. Il faut alors
consulter les autres fonds notamment comme celui des collèges de l’amirauté aux archives nationales de 1586 à
1795 suivant l’inventaire 1.01.46. Celui-ci montre que le fonds est riche en journaux concernant la période
postérieur à 1689. Un seul concerne la campagne de 1620 de Swartenhondt. Ce ne serait qu’aux environs de
1735 que les capitaines et lieutenants de la marine tiennent un journal de bord. Bruijn J.R., « De admiraliteit van
Amsterdam in de rustige jaren (1713-1751) ». Amsterdam, 1970, p. 137. 19
En 1654, une résolution oblige après chaque voyage que l’on restitue à la compagnie les cartes par exemple.
5
surveillance sur le déroulement de la campagne, mais aussi de contrôler les compétences et
aptitudes des officiers et sous-officiers employés. D’où la mise en place d’examens qui
progressivement s’étendront à l’ensemble des officiers de la marine de guerre et de la VOC
dont le rôle précurseur est à souligner.
En 1601, l’amirauté de Zélande demande aux pilotes quelques connaissances20. Des
examens ponctuels de pilotes existent tels ceux de l’expédition en 1603 de Van Caerden par
Petrus Plancius, ou ceux en 1611 de la flotte de May. Un changement d’époque débute avec
la décision le 11 décembre 1619 par la chambre d’Amsterdam qui nomme un examinateur
pour les stuurlieden (ceux qui pilotent) en la personne de Cornelisz Jansz Lastman suivit en
1633 par Willem Jansz Blaeu. Cette même année, il est décidé aussi d’examiner les
opperstuurman. Après la chambre d’Amsterdam, c’est vers 1670 la chambre de Zeeland,
puis vers 1704 la chambre de Delft, celle de Hoorn crée en 1694 un poste pour examiner les
pilotes, en 1727 c’est Enkhuizen et en 1737 Rotterdam. En 1658 et 1681 la chambre
d’Amsterdam étend l’examen aux aspirants et onderstuurman mais pas pour les schipper
(patrons), mais les Heeren XVII mettent tant de restrictions que c’est tout comme: les textes
de 1661 et 1700 prévoient que seul peut être schipper celui qui a été opperstuurman. En
1718, on ne peut être oppersturman sans avoir été onderstuurman. En 1728, une résolution
fixe un examen pour les stuurman et en 1751 c’est enfin pour les schipper. La WIC suit la
VOC: le 16 avril 1663 la chambre d’Amsterdam nomme un examinateur, Claes Hendricksz
Gietermaker qui l’avait été durant 2 ans à la VOC. Elle sera suivi par la chambre de Zeeland
en 1680.
Dans la marine de guerre, il faut attendre le 26 janvier 1672, pour que l’amirauté
d’Amsterdam nomme comme examinateur Dirk Makreel21. Celui ci doit interroger et juger
les pilotes (stuurman) sur leurs connaissances nautiques. Les officiernes ne sont toujours pas
concernés. En 1687, l’amirauté de Zeeland suit ce mouvement en recrutant Dirk de Neeve22.
Le 12 novembre 1698, l’amirauté de la Meuse décide du premier examen des officiers
(commandeurs et 1er lieutenant) qui portera sur le pilotage, l’art de la navigation et du
gouvernement d’un navire (“stuurmanschap, scheepsgoverno et zeemanschap”). Il n’existait
pas d’examen avant, l’officier doit servir, être un bon soldat et un excellent marin (“een
20
Davids p. 294 21
Makreel est l’auteur d’ouvrage et possède sa propre école à Amsterdam. 22
Il occupe ce poste d’examinateur jusqu’en 1709. Tout comme Makreel, il donne aussi des leçons.
6
goet soldaet en een ervaren seeman”). Ce contrôle fait par les officiers généraux ou tout
officier supérieur, est étendu en 1701 à tous les lieutenants. Par la suite, il faudra attendre
le milieu du XVIIIe siècle pour que cette procédure soit appliquée par les autres amirautés. Le
18 septembre 1749, l’amirauté d’Amsterdam créee un examen pour les officiers.
Dorénavant, il ne sera plus employé de commandeur ou de lieutenant qui n’ait réussi les
tests, dont un de mathématique auprès de Cornelis Douwes23. En 1750 dans l’amirauté de la
Meuse, les officiers suivent un examen théorique devant un examinateur et sur la pratique
devant les officiers généraux et capitaines. Les examens ne feront leur entrée qu’en 1761
dans l’amirauté de Zeeland (pour les lieutenants et les commandeurs) et en 1784 et 1785 en
Frise. En 1795, il est nommé un examinateur général qui se charge des officiers alors que les
2 examinateurs sous ses ordres se chargent des pilotes. Un règlement sur le déroulement
des examens en 1797 des pilotes et en 1798 des officiers constitue un début
d’harmonisation des questions et matières contrôlées par ces examens. En Grande
Bretagne, Samuel Pepys instaure en décembre 1677 un examen pour la promotion au grade
de lieutenant: les tests prévoient que les candidats aient servis 3 ans en mer au minimum et
qu’ils démontrent des compétences dans la navigation et le gouvernement du navire
(seamanship). En France, dans les années 1680, des contrôles existent par ailleurs à la suite
de l’initiative de Seignelay concernant les officiers des galères (enseignes, sous-lieutenant et
lieutenant de galère) qui suivent depuis 1681-1682 des conférences à Marseille24.
Ce contrôle des connaissances et des compétences participe à la professionalisation du
corps des officiers qui prend du mouvement à partir de 1650-1660 en Europe, voir anticipe
la formation publique, étatique de ceux ci25.
D’un enseignement privé vers un enseignement et une formation publique
En juin 1665, l’ambassadeur français aux Pays-Bas disait : « Ce n’est point, somme toute, le
métier des marchands que de faire la guerre ; il y faut de bons chefs, de bons officiers, de
23
Au printemps 1747, Douwes est requis par l’amirauté pour donner des cours de navigation, d’astronomie, mais
aussi d’artillerie et de fortifications. Le 1er
février 1748, il est nommé mathématicien auprès de l’amirauté. 24
En 1683, en Suède, il est instauré un examen pour être officier mais il n’existe pas d’école spécifique. 25
Voici ce que dit H W Dickinson dans sa notice Naval Training dans le Oxford Encyclopedia of Maritime
History p. 625 : « The origins of formal naval education and traning date from the last quarter of the seventeenth
century and were coincidental withe the first notions of organizing naval personnel on a permanent basis and in
substantive grades ».
7
braves soldats et des marins de valeur. De tous ceux-ci, les Hollandais manquent. »26
. Aurait
il dit la même chose en 1667?
En ce sens, l’ambassadeur français commet une erreur de jugement sur la qualité des
officiers de marine néerlandaise et leur formation ; car à cette date elle est identique à celle
d’autres marines européennes. A savoir qu’il n’existe pas de formation ou d’enseignement
spéciaux pour devenir officier de marine. Les candidats doivent posséder des qualités pour
pouvoir faire partie des capitaines de marine, savoir donner des ordres et des instructions
aux sous officiers. Mais pas seulement. Même s’il est secondé par des écrivains et autres
spécialistes, le capitaine néerlandais doit posséder des bases en comptabilité, en commerce,
dans la pratique des langues27, qui lui permettent d’appliquer les missions qui lui sont
dévolues.
L’expérience et la pratique, le ouïe dire et le voir faire, jouent un rôle important. Différents
canaux permettent cet apprentissage. Il y a d’abord la formation familiale ou auprès d’un
membre de sa parentèle où de la clientèle de sa famille (le fameux patronage en anglais).
Marteen Tromp navigue avec son père dès 9 ans, tout comme David Vlugh qui embarque
avec son père et son frère. Apprendre son métier auprès d’autres officiers en s’embarquant
sur des navires pour une campagne est “institutionnalisé” en quelque sorte en Angleterre
avec “les volunteers by kings orders” appelé aussi “Kings letter boy” crée en 1661 afin
d’attirer des jeunes gens bien nés dans la marine tels que George Byng en 1678, George
Rooke ou Edward Vernon. Cette disposition est supprimée en 1737. A côté de ces jeunes
gens, dans la marine anglaise, on trouve aussi ceux qui ont embarqué comme “servant boy”,
ou “cabin boy”serviteur ou garçon de cabine d’un capitaine qui le prend sous sa coupe tel
Cloudisley Shovell. Parmi les navires de la flotte royale française, on retrouve aussi des
volontaires.
Certains officiers de par leur expérience et leur renommée font l’objet d’attention de
familles qui veulent placer auprès d’eux leurs fils afin qu’ils servent comme volontaire ou
aspirant (adelborst): dans les années 1665-1676 la célébrité de De Ruyter attirent de jeune
26
Lettre citée par Simon Schama, L’Embarras de la Richesse, 1991, p. 362. 27
Quelques officiers connaissent l’espagnol ou le portugais suite à une capture ou un service dans ce pays tel
Isaac Sweers et Piet Hein. Cornelis Tromp est le seul dont on a la certitude qu’il ait effectué des études. Son père
Maerten l’envoie auprès d’un pasteur en 1642 à Harfleur durant un an avec son cousin Jan Ooms suivre des
cours. Quant à Michiel De Ruyter, il a été agent des Lampsins à Dublin où il a appris l’irlandais, en plus de
l’anglais, du français, de l’espagnol et du portugais.
8
étranger comme Jan Adelaer fils de l’amiral danois Kort Adelear venu apprendre le combat
en mer28!
L’apprentissage provient aussi de l’exercice de la fonction de capitaine dans d’autres
branches maritimes. Michiel De Ruyter, qui navigue dès 11 ans, avant de devenir le grand
amiral qu’il a été, a exercé plusieurs emplois comme capitaine d’un baleinier, d’un corsaire
et d’un navire de commerce. De nombreux officiers néerlandais ont un servis dans la marine
marchande tels que Pieter Florisz, David Vlugh et Adriaan Dircks Houttuin. En Angleterre,
c’est le cas aussi de nombreux officiers de ce XVIIe siècle comme, les amiraux John Lawson et
Jeremiah Smith. En France, citons Abraham Duquesne qui embarque, avec son frère aîné,
comme mousse à destination des Indes Orientales dans la flotte d’Augustin Beaulieu en
1619-1621. Mathurin Gabaret apparaît comme maître d’équipage en 1631 avant d’entrer
dans la marine en 1635.
L’enseignement à bord du navire fait l’objet d’attentions particulières. Le capitaine joue un
rôle moteur mais il n’est pas le seul. Les Anglais accordent une grande place à la pratique
par l’apprentissage. Plusieurs critiques ont été formulé sur la formation des officiers de la fin
du XVIIe, leurs reprochants leurs formations trop théorique. En avril 1702, l’amirauté décide
de palier à cela en versant 20 £ au schoolmaster (litt maître d’école) pour les midshipman29.
Des places sont créées sur des navires de 3ème, 4ème et 5ème rang. Pour être schoolmaster, il
faut présenter une certificat de la Trinity House de Deptford. Cette institution juge des
compétences et de la bonne moralité de ce dernier (sobriété), mais il n’est pas un gage de
qualité toutefois. Le règlement de 1731 “Regulations and Instruction relating to his
Majesties services at sea” rappelle cela tout en indiquant les fonctions de ce “civil”: il doit
enseigner l’arithmétique, l’écriture et la navigation aux aspirants et à ceux que le capitaine
lui indiquera, donc aussi les autres jeunes qui sont volontaires ou servants de ces officiers.
28
Kort Adelaer écrit en 1671 à De Ruyter pour lui demander s’il accepte un de ses fils comme volontaire. Jan
avait servi sous De Ruyter mais il meurt noyé en 1666. Ronald Prud’homme van Reine, De Rechterhand van de
Staat. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Amsterdam, Uitgeverij Arbeidpers, 4ème
édition, 2002,
p. 222. Il faut signaler la présence dans la flotte néerlandaise lors de la seconde guerre anglo-hollandaise
néerlandais de nombreux français tel Armand de Guiche, Henri François Charles de Foix duc de Foix, comte de
Sennecey ainsi que le marquis de Ragny et le comte de Sault, tous les trois seront embastillés du 7 au 28
septembre 1666 pour le motif suivant : avoir servi sur la flotte hollandaise contre les Anglais. Frantz Funck
Brentano, Les lettres de cachets à Paris étude suivie d’une liste des prisonniers de la Bastille 1659-1789, Paris,
Imprimerie Nationale, 1903, p. 34. Remarquez qu’aucun de ces hommes ne servira dans la marine française. Il
reste le cas particulier de Jean Bart qui constituerait ainsi l’unique cas connu de français ayant servis sur la flotte
de De Ruyter. 29
Pour tout ce qui concerne les schoolmaster, à défaut d’avoir pu consulter son ouvrage paru en 2007, nous
avons employé la notice de H. W Dickinson.
9
Le nombre de schoolmaster est estimé sur la période 1702-1837 à 5 ou 600 personnes,
certains ne faisant qu’une campagnes, d’autres plusieurs. Ce nombre ne suffit pas à ce qu’il
en existe un sur chaque navire en même temps. On ne connaît que quelques schoolmaster,
il est donc difficile de généraliser leur cursus et leur vie à l’ensemble. Certains ont exercé
des fonctions maritimes comme Thomas Dunkerley qui sera aussi artilleur ou Mungo
Murray constructeur de navire. On les connaît par des faits divers ou leurs élèves. Le
premier schoolmaster William Jones est né en 1680 dans une famille de fermier d’Anglesey.
Ses aptitudes pour les mathématiques lui permette de travailler dans le milieu marchand de
Londres. En 1702, il se retrouve sur le navire de George Rooke à Vigo. Cette même année, il
publie “New Compendium of the Whole Art of Navigation”. Il deviendra vice président de la
Royal Society, fréquentant des personnalités tels que Newton, Halley, Mead ou Samuel
Johnson.
La qualité des schoolmaster est variable: certains sont dangereux comme William Mears qui
en 1786 tenta de tuer le futur roi William IV alors capitaine de vaisseau, ou bon comme
Thomas Pascoe qui accompagna l’amiral Anson dans son fameux périple. Ce schoolmaster
eu comme élèves John Campbell et Hyde Parker futurs vices amiraux ainsi que Augustus van
Keppel qui terminera amiral30. Cette pratique anglaise existe par ailleurs aux Pays-Bas. Le 18
avril 1720, l’amirauté d’Amsterdam décide de soutenir la formation des aspirants
(adelborst) à la navigation en obligeant les pilotes de leurs faire partager leur savoirs sur les
voiles, les ancres et la navigation; en contrepartie ils recevront une hausse du salaire
mensuelle de 6 florins. Cette mesure vise à soutenir une pratique qui existait sur certains
navires et commandement: Johan Willem baron van Rechteren indique dans son journal de
1690-1697 tout ce qu’il a appris et vu à bord des navires s’agissant de la navigation, des
mâts, cordes et des signaux. Le capitaine établit un rapport au retour du voyage sur les
compétences et les aptitudes de l’adelborst sur la navigation. En 1728, l’amirauté de la
Meuse exige que les pilotes de sa circonscription fassent comme ceux d’Amsterdam. En
1733, elle prend une résolution par laquelle tout ceux qui veulent devenir lieutenant
ordinaire (c’est à dire employé à temps complet) doivent apporter une garantie de la part
du où des officiers sous lesquels ils ont navigué, avoir 20 ans et servis 18 mois sur les navires
30
Plusieurs informations sur les schoolmaster, leurs comportements ainsi que les informations existent dans la
thèse de Samantha Cavell, Playing at Command : midshipmen and quarterdeckboys in the Royal Navy 1793-
1815, Louisiana State University, 2006, 115 p.
10
de guerre. En 1735, l’amirauté d’Amsterdam prévoit que celui qui veut être lieutenant doit
avoir 18 ans et 2 ans de navigation31.
Cet apprentissage de la mer s’effectue aussi à terre. Dans les ports et dans plusieurs villes de
l’intérieur du pays, il existe des maîtres d’école (schoolmeester) ou des professeurs
(leermeester) susceptibles de donner des cours. La différence entre les deux est subtile: le
premier apprend à lire, écrire, compter, donne des cours de religion et de navigation. Le
second donne des leçons en navigation combinée à l’astronomie, la comptabilité, la
fortification ou poliorcetique ainsi que la géometrie ou la trigonométrie32. A la fin du 16ème
ce sont des personnages tels Lucas Jansz Waghenaer un vieux pilote d’Enkhuizen, Aelbert
Hayen (vers 1600) à Amsterdam ou Jan van den Brouck à Flessingue (jusqu’en 1609) puis
Rotterdam jusqu’en 1612. Petrus Plancius, un mathématicien et géographe renommé,
délivre quelques cours. Robbert Robbertsz dit Le Canu dirige de 1586 à 1611 une école à
Amsterdam (puis ce sera Rotterdam et Hoorn33) par laquelle passeront Gerrit van
Heemskerck, Van Neck, Cornelis de Houtman et Gerrit de Veer. Bien d’autres enseignants ou
maîtres d’écoles ont dû donner des cours dans d’autres villes, mais il n’est pas possible de
les connaître en l’absence notamment de publications d’ouvrages de leur part34. Il en a été
de même en France et en Angleterre, même si sur ce point les informations sont rares.
S’agissant de l’Angleterre, il l’amiral Robert Fairfax a suivi à Wapping en 1680 des leçons
données par des pilotes ou maîtres d’écoles. Pour la France, on sait que Jean Doublet suivit
des cours d’hydrographie.
Ces enseignants disposaient de plusieurs manuels et ouvrages traitant de la géographie, de
mathématique, de la navigation35. En 1532 paraît Kaert van der Zee de Jan Severszoon, la
première carte de lecture. En 1545 c’est l’Arte de Navegar du portugais Pedro de Medina
traduit en 1580 en néerlandais. E 1558 Traité de Philipps van Kleef en français traduit qu’en
1579 en néerlandais, suivi en 1584-1585: Spieghel der Zeevaert (Miroir de la navigation en
mer) de Lucas Jansz Waghenaer d’Enkhuizen vieux pilote et en 1585 de l’Amstelredamsche
zee-vaert d’Aelbert Hayen.
31
mais cette mesure ne serait pas appliquée strictement voir la note 8 article de Alphen dans Mars et Historia. 32
Davids page 322. 33
Il reçoit des fonds jusqu’en 1619 année à laquelle ils lui seront supprimés suite à un pamphlet dans la querelle
religieuse entre Arminiens et Remontrants. 34
Davids aux pages 314-316 donne une liste non exhaustive de ces maîtres d’écoles. 35
Voir le livre de Davids aux pages 317-318. Vers 1650, il existait ainsi une cinquantaine d’ouvrages abordant la
navigation et les techniques pour se reperer.
11
En France en 1643 paraît l’Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les
parties de la navigation du père Fournier. Ce livre est une véritable bible des connaissances
maritimes à l'époque du cardinal de Richelieu.
En Angleterre, on trouve à la fin du XVIIe siècle les ouvrages suivants : 1679 Marinor’s
Magazine de Samuel Surmy, 1682 le Seaman’s Tutor de Peter Perkins un enseignant, ou en
1685 le System’s of Navigation de Mathew Norwood fils de Richard auteur d’un ouvrage de
trigonométrie en 1631, d’un Seaman’s practice en 1637 et en 1639 d’un ouvrage sur la
fortification et l’architecture militaire. Mathew qui est né vers 1625 quitta les Bermudes ou
la famille s’était installé pour le Norfolk. Il semble avoir eu une expérience dans la marine
marchande mais il fut surtout un professeur de mathématique publiant en 1678 un ouvrage
intitulé Seaman’s Companion.
Les officiers possèdent certains de ces ouvrages comme le laissent apparaître plusieurs
sources, notamment les inventaires après décès36.
A côté des enseignants, une formation à la navigation existait dans des universités ou
hautes écoles. Par exemple en 1632, l’Athenaeum Illustre d’Amsterdam offrait la possibilité
de suivre des cours sur la navigation et l’astronomie excepté durant certaines périodes
comme entre 1690 et 1711. Cette discontinuité existe aussi à l’université d’Amsterdam
entre 1635-183837. Les jeunes gens peuvent suivre aussi les cours d’Adriaen Metius à
Franeker entre 1600 et 163538. En 1756, est fondée sur des fonds privés la fondation
Renswoude implantée à Delft, Utrech et La Haye. Le but est de donner aux enfants pauvres
ou défavorisés une instruction dans la construction navale, la construction de moulins et de
digues, l’architecture civile et militaire, la navigation et l’art du pilotage, la construction
d’engins mécaniques, astronomiques et d’horloges, de chirurgie et de toutes matières que
les régents de ces fondations décideront. Elle existera jusqu’en 1795. Sur les 170 élèves, 18
36
Un événement particulier nous a permis de constater que des officiers français possédaient par exemple le livre
du père Fournier. En effet, Nicolas Gargot l’utilisa en 1651 pour se défendre contre des mutins. Voir Charles
Millon, Les Aventures du Rochellais Nicolas Gargot dit Jambes de Bois, Rupella 1928. Un autre exemple est
relevé par Sam Willis dans son livre The Admiral Benbow, the life and times of a naval legend ; London,
Quercus, 2010, p. xxxi-xxxiii. Edmund Gunter professeur d’astronomie au Gresham College de Londres publie
en 1636 un ouvrage d’astronomie, de navigation et contenant des éléments de fortifications. Il est auteur aussi
d’une échelle de calcul qui restera en vigueur jusqu’en 1877. Le livre aurait été en la possession de plusieurs
officiers anglais : John Benbow père, l’amiral John Benbow, le vice amiral Thomas Hardy, le vice amiral James
Mighells, l’amiral Edward Hawke, Horatio Nelson, le capitaine Thomas Hardy puis Salisbury Pryce Humphrey et
enfin en 1821 à Edward William Lloyd ! 37
Il existe ainsi des cours de navigation à l’université de Leiden en 1793. 38
L’un de ses élèves ne sera rien d’autres que René Descartes.
12
serviront la VOC ou la marine de guerre39
. Il existera par ailleurs une autre fondation privée
en 1798 à Groningen et celle en 1806 d’Elburg qui est une extension d’une école de latin et
de français. En Angleterre, la première école de navigation est fondée en 1675, c’est la
Christ Church Hospital à Londres. Elle sera suivie en 1705 par une autre école à Fleet Street
à Londres puis en 1716 de la Royal Hospital School de Greenwich.
Les véritables institutions et écoles purement maritimes font une apparition tardive aux
Pays-Bas. L’invention est française. La marine militaire française du XVIIe siècle dispose
d’officiers qui ont une expérience dans la marine marchande, la course aux côtés de leurs
familles, dans un ordre religieux40, l’armée, ou qui ont pu suivre, sans que l’on ait la
certitude, un enseignement dans des écoles d’hydrographies ou délivrant un enseignement
39
Annet Verbout-Wamsteeker, « Navigatieopleiding aan de Fundaties van Renswoude 1756-1795 », Tijdschrift
voor Zeegeschiedenis, n°1, 1998, p. 37-56. 40
De nombreux officiers sont des chevaliers de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, ordre militaro-religieu établit
à Malte. Selon Claire-Eliane Engel dans son livre Les Chevaliers de Malte, « Malte sert d'école navale aux cadets
de la noblesse de France, soit qu'ils restent au service de l'ordre, soit qu'ils entrent dans la marine royale ». Le
service sur les navires est très dur pour ces jeunes chevaliers. Mais selon le même auteur, « dans la plupart des
cas, les caravanistes (jeune chevalier effectuant ses caravanes) s'intéressent à leur métier de marins, avec passion,
et accomplissent leurs caravanes dans l'enthousiasme ». Cette opinion n'est pas partagée par Michel Fontenay,
colloque « Quand voguaient les galères », 1990, p. 270-273. Selon cet auteur, le commandement est le principal
point faible de l'escadre des galères de Malte. Pour les chevaliers, l'office de capitaine n’est pas à proprement
parler une fonction navale, mais une charge onéreuse dans la carrière des honneurs qui conduisait aux diverses
dignités de l'Ordre. En tant que religieux, ils sont tenus par l'habit et la profession qu'aux trois voeux de chasteté,
obéissance et pauvreté. Aucun ne sera jamais respecté. En revanche, pour prétendre à une commanderie, il fallait
cinq ans de « résidence au couvent » (ce qui voulait dire à Malte) et quatre « caravanes » de six mois chacune sur
les galères de la Religion. L'attribution des commanderies et des autres « bénéfices » se faisait en fonction de
l'ancienneté, mais on pouvait s'assurer une promotion plus rapide et plus avantageuse en sollicitant le
commandement d'une unité, « ce que le Grand-Maître accorde ordinairement, note un voyageur de passage en
1673, parce qu'un capitaine, en deux ans qu'il tient galère, mange 25.000 livres pour sa table où se trouvent les
trente chevaliers qui sont de caravane avec lui ». Commander une galère de Malte n'exigeait donc aucune
compétence navale, c'était un service rendu à la Religion, service non pas militaire ou maritime, mais financier.
Bien des chevaliers, observe le sieur Du Viviers, « prennent cet emploi sans en être capable et sans autre mérite
que celui de pouvoir soutenir cette dépense ». Comme le faisait remarquer amèrement le Grand-Maître Pinto,
« quelque intéressement qu'affectent les prétendants, on sait bien que sans la certitude de la récompense, ils ne
s'empresseraient pas tant à servir notre Ordre: l'objet principal est la commanderie »... D'ailleurs chacun savait à
Malte que les galères de la Religion étaient « plutôt sous la conduite et le commandement de leurs pilotes et
comites que sous ceux des capitaines et du général ».
Les jeunes gens braves et batailleurs, les caravanistes constituent un renfort précieux au moment des combats et
contribuaient fortement à l'efficacité militaire de l'escadre. En revanche, très peu se forment au métier de marin.
La plupart n’effectuent leur service que pour satisfaire aux obligations statutaires de l'Ordre et afin de pouvoir
postuler une commanderie. Or, qu'est ce qu'une commanderie sinon un domaine seigneurial procurant des
revenus fonciers? Leur présence à bord a donc une finalité terrienne bien éloignée de toute vocation maritime!
« Ils n'ont aucune envie de s'attacher à la mer, note Du Viviers, et ne s'appliquent en aucune façon au métier ».
D'ailleurs, « dans le mauvais temps, où il y a le plus à apprendre pour la navigation, comites et pilotes préféraient
se débarrasser de leur encombrante présence en les reléguant sous la couverte ». Dans ces conditions, nous
resterons très réservé sur l’idée reçue présentant Malte comme l'école navale des officiers de la marine royale de
l'ancienne monarchie. A la rigueur école pour les galères, mais les galères sont elles écoles de marins? Que des
cadets de la noblesse ayant la fibre maritime aient pu trouver une occasion de la conforter au service de la
Religion dans des moments où la France se désintéressait de la mer, soit. Mais que les galères de Malte aient été,
pour la noblesse française des XVIe et XVII
e siècles, un lieu d'éveil et de formation maritime paraît plus douteux.
13
sur la navigation. C’est en 1662 qu’est fondée la première école d’hydrographie au Hâvre,
suivit en 1666 d’une autre à Dieppe ou enseigne le père Denis, en 1669 à St Malo,
instauration en 1671 d’une chaire d’hydrographie à Nantes et en 1673 à Rennes ; en 1672
ouverture d’un cours public et gratuit d’hydrographie chez les jésuites dans l’Hôtel de Briord
au Hâvre etc. Les officiers des galères à partir de 1681-1682 suivent des conférences à
Marseilles, qui mêlent théorie (cours de mathématique, d’hydrographie et de géographie)
et pratique (construction et manœuvres des galères avec des études de cas sur les accidents
et comment y remédier)41.
Cependant, la France se distingue avec l’instauration des gardes de la marine. Le 28 janvier
1627, le cardinal de Richelieu créé les « Seize jeunes Gentilshommes ». Ce nom témoigne de
la volonté de l'Etat d’ennoblir la marine initialement roturière. Les marins doivent « être
instruits à la marine et à la navigation ». Le cardinal décide alors de les confier à trois
maîtres entretenus, rémunérés par le roi. Mais du fait des conditions de vie contraignantes
qu'impose le service en mer, la marine n'attire que des cadets de familles, des
gentilshommes pauvres et des roturiers. A côté de ces Seize jeunes Gentilshommes,
Richelieu créé les Gardes de Cardinal dès le mois d’octobre 1626. Ils sont appelés plus
communément les Gardes du Grand-Maître. Ils seront 53 de 1626 à 1646, 100 de 1646 à
1660. Cette augmentation s’explique par le fait que la Reine est Grand-Maître de 1646 à
1650 et que de 1650 à 1660, elle traite avec Vendôme pour garder cette troupe qui lui sert
de gardes du corps. Ils sont ensuite 54 de 1661 à 1664, de 56 à 70 entre 1665 et 1669. Ces
troupes doivent fournir les futurs cadres de la marine, or il n'en fut rien. Les gardes du
Grand-Maître constituent une troupe d'appoint, que l'on peut utiliser lors d'un abordage ou
d’un débarquement, comme à Gigery et à Candie. Il existait par ailleurs des gardes du
général des galères dont la création date de 1669. Ils sont 33 en 1669 et 40 en 1670 dont
plusieurs proviennent des gardes du duc de Beaufort. L’effectif est de 50 en 169142. On les
appele aussi gardes de l’étendard.
41
André Zysberg, Les Galériens … p. 225-227. 42
Jusqu’au 14 septembre 1689, les gardes de l’étendard réal des galères n’embarquaient que lorsque le général
allait en mer ce qui était le cas notamment avec le duc de Vivonne qui mena plusieurs campagnes. A cette date,
ils sont assimilés aux gardes de la marine, l’ordonnance du 20 septembre 1712 calquant leur organisation sur
celles des gardes marines, et deviennent la pépinière du corps des galères suivant les cours de mathématique,
hydrographie, construction et canonnage dispensés aux enseignes, sous-lieutenants et lieutenants de galère.
Notice de Michel Vergé-Franceschi, officier et personnel des galères in Dictionnaire du Grand Siècle sous la
direction de François Bluche. Toutefois, Frédéric d’Agay dans son ouvrage La Provence au Servie cu Roi (1637-
14
On peut s’interroger sur les raisons de cette création par le cardinal. En effet, former 16
jeunes hommes ne suffit pas à combler les besoins de la marine d’autant que peu d’entre
eux y feront carrière, et que si on respecte le schéma d’évolution comme celle des gardes de
la marine sous Louis XV (un garde-marine âgé de 16 ans, devient enseigne de vaisseau vers
25 ans, lieutenant vers 35 ans, et capitaine vers 45/50 ans) le cardinal n’aurait pas disposé
d’éléments opérationnels. A cause des troubles sociaux, politiques et financiers mais aussi
d’un manque de volonté de la part des Grands-Maîtres, la France se trouve dénuée de toute
école navale. L'idée resurgit alors avec l'arrivée du duc de Beaufort et de Colbert. Le premier
en 1662 veut doter la marine de gens de qualité. Le 2 mars 1666, Colbert désire que les
capitaines soient issus de bonne famille. Il songe à établir des écoles dans des villes comme
Saint-Malo, Bordeaux, Montpellier ou même Paris. Ils ont la même idée que Richelieu :
« recruter des gentilshommes est préférable que de recruter des roturiers ». Mais il existe
d'autres opinions notamment celles des marins. En 1667, Guillaume d'Alméras, chef
d’escadre, écrit que tirer les enseignes des collèges et des académies serait vain. Il préconise
un apprentissage par la mer, avec des leçons d'escrime et de mousquet. Quant à Arnoul, il
propose un recrutement analogue à celui pratiqué en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, où
les capitaines sont choisis, d'après lui, « sur la réputation qu'ils s'acquièrent dans les
vaisseaux marchands où il se trouve des occasions aussi chaudes que dans la guerre »43.
A la suite de la mort du Grand Maître de la Navigation le 24-25 juin 1669, les gardes du
Grand-Maître sont remplacés par les gardes de l’amiral, en décembre 1669, qui seront
dissous en 1671. Cette expérience sera un échec44. De 1671 à 1686, ils sont remplacés par
des gardes appelés anciens, en même temps qu’en 1683 est fondé 3 compagnies de
nouveaux gardes. Par ailleurs de 1681 à 1686, il est instauré pour les protestants une
académie à Indret. En 1686, toutes ces structures sont supprimés et fusionnés dans les 3
compagnies des gardes de la marine. Ceux-ci subsisteront jusqu’en 1786. L’institution sera
réformé en 1764, 1772, 1775. A partir de 1682 les cours ne sont plus facultatifs, le garde est
obligé de les suivre sinon il subit un retrait sur sa solde. Le matin, le garde suit la messe; puis
de 8 à 10 heures cours de dessin, de mathématique, danse, escrime, écriture, de
1831) Officiers des vaisseaux et des galères, Paris, Editions Honoré Champion, 2011, indique que quelques
officiers des galères provençaux du XVIIIe siècle avaient débuté comme volontaire ou dans un autre corps.
43 Vergé-Franceschi, Marine et éducation, op cit p. 120
44 Michel Vergé-Franceschi, Marine et Education, p. 129-135. Sur 335 candidats, seuls 54 demeurent en service
après 1671.
15
fortification et d’hydrographie et de 13 à 16-17 heures: maniement mousquet, pique,
construction navale et canonnage. Jusqu’en 1715, les officiers généraux ne viennent pas des
gardes de la marine, si l’on excepte Court de la Bruyère nommé en 1715 chef d’escadre45: ils
n’ont pas eu une formation par l’état mais par la course (Bart), commerce (Ducasse), ou
apprentissage souvent auprès de membres de la famille (Valbelle, les Gabaret, Forant etc).
Malgré la mise en place des gardes de la marine, une expérience ou formation initiale
existent pour un certains nombres de ceux qui font partie des gardes de la marine de 1723 à
1749. Ainsi, sur cette période 13% ont servis comme volontaire dans la marine de guerre ou
de commerce, 6% sont chevalier de Malte, 5% ont servis dans l’armée de terre, 4% sont des
anciens pages, 2% ont servis dans les colonies. Sous Louis XIV, 4888 gardes ont été recrutés
entre 1669 et 1715 mais seul 10% seront capitaine de vaisseaux, ce chiffre baisse à 4% pour
ceux passés par ces compagnies entre 1723 et 1749. A la mort de Louis XIV, la marine
entraine dans une longue période de paix. Les gardes sont trop nombreux d’où un
ralentissement de l’avancement, un départ pour d’autres corps. La Marine ne devient plus
aussi prometteuse qu’avant 1715. Il s’en suit une désaffection, suivi de départ des meilleurs
éléments, qui peuvent expliquer les bourdes lors des conflits de 7 ans: La Clue Sabran fera
tirer le canon chargé à la fin d’une messe ce qui provoque plusieurs morts; à la bataille des
Cardinaux des navires sont perdus car on a laissé ouvert les sabords de la batterie basse. Ces
gardes sont de jeunes dissipés: 1689 ébats avec des prostitués dans la cathédrale de Toulon
(en 1764 ce sera derrière des églises) etc. A partir de 1764, les 3 compagnies deviennent un
pôle de résistance à toute innovation. Choiseul charge en 1763 Bezout d’établir un cours de
mathématique ainsi que d’inspecter chaque année les compagnies qui sont divisées en 3
classes. Après l’expulsion des Jésuites en 1762-1763, les gardes occupent leurs locaux qui
deviennent en 1764 des Hôtels des gardes la marine. Le garde devient un élève que l’on doit
protéger. Bezout constate peu d’évolution: négligence, laissez faire des supérieurs...Pour lui
cela vient des vices de l’organisation: 1) peu de connaissance pratique, 2) hérédité dans
l’emplois, 3) nombre de garde supérieur au nombre d’emplois donc pas d’avancement, 4)
subsistance dans un même grade pendant longtemps et lassitude des mêmes exercices.
Au cour des années 1760-1770, les gardes sont discrédités car les grands hommes de la
marine de l’époque n’en sont pas issues: Marion-Dufresne, Bougainville...Boynes prépare
45
Un seul garde de l’étendard sera officier général de la marine de Louis XIV, ce sera Claude Forbin, Mémoires
du comte de Forbin, présentation par Micheline Cuénin, éditions Mercure de France, p. 33-34
16
une réforme avec l’escadre d’évolution et l’école du Hâvre 1773-1775 à l’enseignement
révolutionnaire car il y fait une part plus grande à la pratique.
Après 1783, les tensions ne cessent de croître: le corps des officiers attend des récompenses
mais il n’y a pas de nomination au maréchalat d’ou vexation. Par ailleurs Bézout meurt et
est remplacé par Monge qui n’a pas le même aura. Les tensions se cristallisent sur la
naissance: noblesse-roture. Le Siècle des Lumières veut remplacer le népotisme et la
naissance par les concours et les examens. On multiplie les critiques envers les nobles mais
Sartine et Louis XVI jusqu’en 1784 favorisent la noblesse, il change après en nommant dès
1784 Thévénard un roturier chef d’escadre (ancien capitaine de commerce), favorise la
pratique. L’ordonnance du 1er Janvier 1786 déclare que les élèves ne peuvent passer en
année supérieure sans avoir accompli un temps de navigation (8, 28 et 36 mois); on ne
pourra être lieutenant de vaisseau dorénavant qu’après avoir naviguer 6 ans; ouverture des
écoles aux enfants de non nobles: recrutement de 680 volontaires roturiers, hausse du
nombre de gardes pour faire jeux égal avec la Navy: on veut porter ce chiffre à 1040 dont
680 volontaires et sur 360 élèves, 100 viendront des 2 collèges de Vannes et Alais
(pratiquement réservé qu’aux enfants et neveu d’officiers mort au combat). A la suite de ces
textes, La Pérouse et Suffren se réjouissent mais ils ne verront pas la suite donnée à cela car
ils meurent tout deux en 1788. Or le 29 juin 1788 La Luzerne accorde des exemptions sur les
temps de navigation: si on est bon en mathématique on obtient réduction du temps de mer
comme cela fut le cas pour Las Cases (auteur du mémorial de St-Hélène). On assiste à une
perversion du système: La Luzerne augmente le nombre des élèves à 600 or un élève est
obligatoirement un noble. Il réduit le nombre de sous-lieutenant à recruter: 400 au lieu de
840 parmi les volontaires. Ainsi au lieu d’avoir 680 roturiers et 360 nobles, on a 400 et 600.
C’est dans ce contexte d’opposition qu’éclatent les premiers troubles révolutionnaires à
Toulon en mars 1789.
L’origne de la création de cette institution d’une école pour former des officiers de marine
se trouve dans ces écoles d’arme, les ritterakademie qui florissent à la fin du 16ème siècle en
Allemagne et au Danemark. L’armée a été dans certains cas un modèle pour la marine, les
relations entre les deux étant que chacune a fourni des cadres à l’autre et ce quel que soit le
pays : France, Grande Bretagne, Pays-Bas, Suède, Russie46. Une expérience particulière se
46
Sur ce point voir mes travaux en cours ou sinon mes articles sur les officiers de marine…. Rappelons
l’existence des General at Sea à l’époque de Cromwell comme Monck, Blake ou Montagu. Ce dernier se fit faire
17
déroule même en France : l’embarquement de mousquetaire pour en faire des officiers de
marine de 1662 à 166647.
Le modèle d’école naval français sera suivi par le Danemark (1701 Création de l’école navale
à Bremerholm à Copenhague), la Russie (14 janvier 1701 création de la 1ère école de
navigation à Moscou transferé à St-Petersbourg en 1715 et qui donnera le corps des cadets
de la Marine en 1752) ; l’Espagne (5 avril 1717 création de la Compagnie royale des gardes
de la marine, 12 juin 1717 fondation de l’académie des gardes-marines de Cadiz suivit en
1777 par la création des compagnies de gardes marines de Carthagène & d’El Ferrol)48.
L’Angleterre suivra le mouvement. Par un “Order of council” de février 1729, un Naval
Academy est établi mais l’école n’ouvre ses portes qu’en 1733 car il faut du temps pour la
construire. Elle accueille 40 jeunes nobles et gentlemen qui suivent un enseignement sur 2-3
ans comportant de l’arithmetique, de la trigonometrie, la navigation, la fortification, les
mathématiques, le français, l’escrime, l’artillerie. Le coût est de 70/80£ par an. C’est une
école peu populaire mais qui offre un enseignement de qualité. En 1773, il y est crée 15
places pour les fils d’officier. En 1806 elle devient le Royal Naval College et ferme en 1837.
Le nombre de personnes passé par cette école est faible par rapport aux besoins de la Navy
qui continuent l’apprentissage sur les navires. La Navy continuera d’attirer de très jeunes
gens: en 1793 sur 100 qui passent les examens pour devenir lieutenant, 38 avaient 12 ans
quand ils sont allés la première fois en mer; 4 ont 8 ans et 1 à même 5 ans!
Les Pays-Bas suivront ce mouvement précédant de peu la Suède49. La VOC joue de nouveau
un rôle dans cette forme de formation. En 1743, le gouverneur général des Indes Gustaaf
construire un modèle réduit pour apprendre les manœuvres d’un navire et suivit des cours donnés par un
mathématicien. 47
Depuis 1662, plusieurs compagnies de mousquetaires du roi sont embarquées. En 1666, il y en a 800 qui
doivent embarquer sur l'escadre de Beaufort. Cette idée d'utiliser de jeunes militaires pour les amariner et en faire
des officiers de marine n’est pas récente. Francois Vignerot de Pontcourlay est démis par son oncle, le cardinal
de Richelieu en 1636, car il remplace les capitaines de galères par des officiers provenant du régiment des
galères. Du Plessis de La Brossardière, futur chef d'escadre des galères, et Montade, futur chef d'escadre des
vaisseaux, sont tous les deux capitaines au régiment des galères lors de la prise des îles de Lérins ou lors du
combat de Vado. Nous verrons plus loin que des officiers ont été soldats avant d'être marins. En ce qui concerne
les mousquetaires, l'expérience semble être un échec. Seulement 4 sont devenus capitaines. Un seigneur de La
Roquefontiez devient capitaine de vaisseau en 1669 et est cassé en 1675. Cohornes, de Carpentras, est capitaine
de brûlot de 1666 à 1675, puis capitaine de vaisseau jusqu’à 1678, date où il meurt. Il y a aussi Beaulieu de Tivas
mort au combat de Schooneveldt en 1673, et Gravier mort en 1690. Roberto Barazzutti, Mémoire de Maitrise,
1995, Paris IV Sorbonne. 48
A Venise, le projet d’une école est longuement discuté en 1702. 49
En 1748, le prince heritier Adolphe Fréderic de Holstein-Gottorp contribue à l’établissement d’un corps de
cadets pour la marine reservé aux gentilshommes; en réaction à ce privilège est crée en 1756 l’Académie Navale
de Karlskrona.
18
Willem baron van Imhoff instaure une académie de marine à Batavia: y sont admis comme
cadets les enfants légitimes de bonnes familles protestantes, âgés de 12 à 14 ans, ayant 6
mois de navigation. Les cours portent sur la navigation, la construction navale, la théologie,
l’artillerie, le commerce des armes, le malais, le perse, la danse, l’escrime et l’équitation. La
durée est de 4 ans dont une de pratique. Elle ferme le 11 novembre 1755. La VOC par la
suite créera une autre école à Sémarang en 1782 active jusqu’en 1812 qui forme des
artilleurs et des spécialistes de la navigation.
A la suite de l’académie de Batavia, deux institutions aux objectifs identiques voient le jour
mais en métropole.
Le 1 février 1748; l’Algemeen Zeemanscollege à Amsterdam est fondé à l’initiative de la ville
d’Amsterdam, de la VOC et de l’amirauté. L’enseignement ne sera pas que pour les officiers
et les stuurlieden de la marine ou de la VOC, mais aussi pour ceux de la marine marchande
où des orphelins. En 1750, sur les 74 étudiants présents: 26% sont des officiers de marine,
13% des officiers de la VOC, 19% des pilotes, 12% des comptables (?) de la flotte et 30% des
marins de la marine marchande et des orphelins. En 1751 ouvre le Rotterdams
Zeemaanscollege avec comme enseignant le mathématicien Laurens Praalder qui est
examinateur des officiers de l’amirauté de la Meuse.
La seconde institution est la Kweekschool der Zeevart qui ouvre le 24 octobre 1785 à
Amsterdam. Ici encore, on retrouve la VOC. Guglielmus Titsingh l’un des comptables de la
VOC publie en 1780 un livre sur la pauvreté et la rareté des marins et comment y remedier
afin de faire moin appel aux étrangers. A la suite de la défaite du 5 août 1781 du Doggers
Bank; des comités sont mis en place pour recueillir de l’argent pour soigner les blessés et
prendre en charge les veuves et leurs enfants. Le 1er décembre 1781 les membres du comité
d’Amsterdam et d’Haarlem, dont fait partie Titsingh, créent un fonds pour s’occuper de ces
personnes et le 4 décembre 1781 décident qu’une partie des fonds sont destinés à former
de jeunes marins. La recherche et la construction de l’établissement font que cette école,
n’ouvre qu’en 1785 et que sa particularité et qu’on y apprends tous les métiers de la mer.
On admet des jeunes de 10-16 ans à qui sont délivrés des cours d’écriture, de lecture, de
théologie, de fabrique des voiles, de construction navale, le français et l’anglais sont
enseignés en 1793 et en 1814 s’ajoutent la géographie et l’histoire etc. pour former du
personnel à tous les niveaux dont ont besoin les marines néerlandaises. Entre 1785 et
19
182950
, 1664 jeunes sont passés par cette école dont 141 au moins seront aspirants
(adelborst) plus 22 qui seront officiers sans avoir été adelborst entre 1785 et 1814.
Avec l’instauration de la République Batave en 1795, l’organisation de 1597 disparaît pour
une structure centralisée de la marine. Il s’en suit une homogéneisation qui débute avec les
examens puis sur la formation. Le 15 juin 1798, 2 brigs sont destinés à la formation des
aspirants. Chaque brig porte 6 canons, 1 commandant, 2 lieutenants, 1 schipper, 1 stuurman
avec un assistant, 1 chirurgien, 1 cuisinier et 27 cadets. Certains adelborst ont 12 ans
d’autres 30 avec une expérience de quelques années de service.
Du 26 avril 1803 au 23 mai 1805, à Hellevoetsluis, création d’un “Cadetten instituut voor de
Marine der Bataafsche Republiek” école à bord de la frégate Euridice. C’est la première
academie militaire maritime d’état dont l’enseignement est donné par des maitres d’écoles
et des sous-officiers; et comporte des cours de sciences, histoire, sciences et vie de la terre,
artillerie, comptabilité, navigation, dessin, musique, apprentissage de 3 langues: français,
anglais et néerlandais. 82 cadets âgés en moyenne de 14 ans et demi passent par cette
école. Le 23 mai 1805, la frégate part pour les Indes Orientales. Les cadets sont mis en
congés et l’école est déplacée sur la presqu’île de Feijenoord. L’institut dispose de 2 bricks
nouveaux et les règles sont mieux organisées et strictes: examens d’entrée dans la pratique
des langues et de droit par exemple; séparation en plusieurs classes. En tout 57 cadets
suivent les cours, âgés de 13 ans et demi. Ils suivent le même programme qu’avant avec plus
de sport (natation l’été). De nouveau l’institut déménage en 1809 à Enkhuizen ou il reste
jusqu’en 1811. Là ce sont 26 nouveaux cadets âgés de 14 ans en moyenne qui seront
formés. En 1812 l’école est fermée à la suite de l’intégration du royaume des Pays-Bas à la
France. Les cadets suivent alors leur formation à Brest ou à Toulon.
Le 5 juillet 1816, la décision est prise que l’école d’artillerie et de génie de Delft accueille des
aspirants pour les former. Trois mois plus tard le ministre de la Marine obtient qu’une
formation d’aspirant de la marine puisse y avoir lieu. Ils seront 5 à leurs débuts, l’école ne
peut en accueillir plus de 20. Ces cadets sont destinés soit à la marine, soit la construction
navale soit le corps des mariniers (infanterie de marine). En 1826 l’institut devient
l’académie militaire royale à Breda et le 29 août 1829 est ouvert enfin l’académie militaire
maritime soit le KIM à Medemblick.
50
L’école est fermée de 1811 à 1815.
20
Le recrutement de 1785 à 1829 s’est fortement concentré autour de quelques provinces
comme le montre le tableau qui suit.
L’origine géographique de 384 cadets entre 1785 et 1829 est la suivante:
Nombre Région
86 Hollande du Nord
88 Hollande du Sud
20 Frise
17 Zeeland
5 Colonies
22 Etrangers
23 Inconnus
A partir de cette fin du XVIIIe siècle, la majorité des cadets sont originaires de la province de
Hollande et la Zélande est dépassée par la Frise. Par ailleurs, le passage par ces écoles, que
ce soit aux Pays-Bas où en France, ne veut pas dire que l’élève ou garde se destine
forcément à servir dans la marine. On sait que parmi les cadets qui suivent les cours de 1798
à 1829, plusieurs n’achèveront pas leur formation à cause de décès (30% des aspirants en
moyenne sur la période), des licenciements, des démissions, d’autres servents dans les
colonies ou l’armée…mais quelques uns atteindront par la suite des fonctions d’officiers-
généraux de la marine néerlandaise51.
Conclusion :
La création en 1829 de la Koninklijke Instituut der Marine à Medemblik constitue la fin
d’une période particulière dans la formation et l’enseignement des officiers de marine aux
Pays-Bas. Ce cycle a vu le passage progressif d’un enseignement privé par des enseignants,
d’autres marins ou des parents officiers de marine vers un enseignement qui s’est
institutionnalisé. La VOC a joué un rôle non négligeable dans ce mouvement qui permet à ce
pays de suivre et de joindre, une évolution entamée dans d’autres pays. C’est avec un
certain retard que les Provinces-Unies ont mis en place un système unique d’enseignement
et de formation de ses officiers de marine concluant la professionnalisation de ce corps. Le
débat sur les qualités de l’enseignement par la pratique et ou la théorie n’a pas lieu, à notre
avis, car les deux ont fournis des officiers de qualité ; et par ailleurs ces écoles « publiques »
51
Voir sur ce point les articles de Marc Van Alphen, qui malheureusement ne donne pas d’éléments chiffrés de
ces cadets terminant leurs carrières comme officiers généraux de la marine.
21
ont su mêler les deux en employant des navires écoles, ou en obligeant les aspirants à
participer à des campagnes. On le constate avec le retour des navires écoles aux Pays-Bas à
la fin du XVIIIe, comme en France ou en Espagne en 1778 avec le San Juan Bautista devient le
navire école pour les gardes de la marine52… et que par la suite au XIXe siècle ce type de
navire deviendra incontournable pour plusieurs puissances maritimes.
Terminons enfin sur trois points relatifs à la formation des officiers de marine néerlandaise,
mais aussi des autres puissances européennes :
- le premier point concerne les « échanges » entre puissances lors d’alliance ou de
période de paix d’officiers afin de parfaire leur instruction, de profiter de leurs
expériences ou de répondre à un besoin ne disposant pas alors des ressources humaines
qualifiées. A la suite de la création de son école en 1702, Pierre le Grand cherchera à
professionaliser ses officiers en envoyant de jeunes officiers aux Pays-Bas et Angleterre
apprendre la navigation, l’architecture et la langue, sans oublier la présence parmi les
gardes de la marine française entre 1717 et 1723 d’une quarantaine de russes. Cet
échange est complété par le recrutement d’officiers néerlandais (65 officiers néerlandais
recrutés par les Russes en 1703) ou anglais. L’après guerre de 1713 à 1719 est une
période difficile pour les officiers néerlandais: beaucoup, notamment des lieutenants et
des commandeur, sont licenciés et incités à servir dans d’autres secteurs maritimes
(VOC, WIC) ou marines étrangères (Russie, Venise, Portugal). La Russie recrutera aussi de
nombreux officiers anglais comme Peter Graydon. En 1749, l’espagnol Antonio de Ulloa
effectue une mission d’étude dans divers pays européens.
- le second c’est la participation des officiers aux sociétés savantes, à des expéditions
scientifiques où le développement d’un intérêt scientifiques pour les instruments et les
problèmes de la navigation. Vers 1668-1670, Huygens laisse une horloge à van Ghent qui
se proposer de l’essayer mais comme il n’a pas de commandement cela ne sera pas
possible. Beaucoup d’officiers prennent au sérieux leur métier et approfondissent leur
connaissance de la navigation et de ce qui l’entourent notamment de la situation en mer
et de l’usage du compas. Ouverture vers de nouvelles méthodes et les sciences. Certains
sont intéressés par les cartes tels Martinus Lambrechts (1696-1744) de Gouda auteur en
1731 d’un ouvrage de 200 feuilles Handboekje voor den zeeleerling. Hendrik Lijnslager
52
Au sujet de la France, voir le livre de Michel Vergé-Franceschi, Marine et Education, ainsi que la
communication dans le colloque de Liliane Alfonsi.
22
(1693-1768) qui s’interesse à la construction navale et importera d’Angleterre la
méthode de construction “op gang”. Il entretient d’excellentes relations en Angleterre
avec des hommes tels que l’Amiral Anson. En 1722 il ramène de Porstmouth les plans de
nouveaux navires anglais. Il ne faut pas oublier Cornelis Schrijver mort en 1768 fils d’un
capitaine de marine, connaisseur et capable de discuter d’artillerie, de vie à bord des
navires, d’hydrographie, de construction navale et d’enseignement et formation
maritime. Autres officiers: Joris de Visscher (1710-1740) utilise l’octant de Hadley
inventé en 1731, qui coute très cher, dès 1737, Gaspar Bost (1721-1753) dispose aussi
de cet instrument et en 1746 un compas amélioré. De son retour de sa campagne vers
l’Ouest en 1737-1738, Visscher réalise une description des côtes des îles Caraïbes avec
les indications sur les courants et les vents. Willem baron van Wassenaer sera l’un des
officiers généraux des plus écoutés dans les années 1750-1780 et conseille Guillaume V.
Né en 1713, famille noble, il devient en 1736 capitaine. Il se fera expliquer des ouvrages
anglais et français sur les cartes de navigation et de l’utilisation de l’octant, dont il sera
fait un ouvrage paru en 1745 De waare wegwijzer voor de stuurlieden en lootzen in de
Middelandsche Zee. Il s’interesse aussi à la construction navale et ses avis conduiront à la
construction de la frégate Thetis dont il fera le premier voyage en 1769. Il meurt en
1783. Le fait que les officiers soient de plus en plus obligé d’utiliser de nouvelles
méthodes, explique la fascination par ailleurs de ceux ci pour les sciences et leur
appartenance à l’élite intélectuelle de l’époque. Parmi ces hommes, il y a Van
Kinsbergen, Melvill, Willem May, Zoutman, Van Byland, son neveu Frederik Sigismund
graaf van Bylandt (1749-1828); Jacob Andries van den Velden, Johan Splinter Stavorinus
(1739-1788). Frederik Byland et Jan Olphert Vaillant (1751-1800) achetent eux même
leur propre chonometre (de poche) afin de l’utiliser au cour de leur voyage pour
déterminer la longitude. Van Byland et Melvill emploient les nouveaux compas et
délivrent leurs résultats à l’amirauté. Ils constatent par ailleurs que les cartes nautiques
des pays étrangers sont meilleurs que celles néerlandaises… Ces hommes, tels Van
Byland, Van Kinsbergen ou Vaillant ne délivrent pas seulement leurs connaissances à
leurs subordonnées à bord mais aussi ils publient. En 1767 van Byland publie son Zee
Tactick of grondregulen der krijsgkunde ter zee, le premier ouvrage néerlandais sur ce
sujet, qui est une étude d’un ouvrage français de 1763 avec ses propres observations.
Plus de 750 exemplaires seront publiés et achetés. Van Kinsbergen sera aussi productif
23
et on lui doit plusieurs ouvrages sur la navigations ou l’artillerie, mais en 1782 il publie
son ouvrage sur la tactique (Grondebeginselen der zeetacticq) qui comporte quelques
idées nouvelles au sujet de la ligne de file. Le livre sera publié qu’en Russie.
- Le troisième est que quel que soit le type de formation suivi cela n’a pas empêché
certaines catastrophes : l’exemples anglais le plus flagrant, la perte de la flotte de
Shovell en 1707 sur les Sorlingues. Un officier anglais, le commandeur May, a étudié les
rapports et journaux de l’époque. Il montre que s’agissant le calcul de la latitude, selon
les méthodes employés, il a constaté des écarts entre les observations des officiers en
moyenne de 25 ou 72 miles ; tandis que concernant la longitude, l’erreur est faible. Les
sources et le matériel sont aussi en causes. Dans 9 navires de la flotte, seul 4 compas sur
112 fonctionnent correctement53. Les officiers et pilotes utilisent aussi des almanachs.
Or ceux ci réservent quelques surprises : en 1697 le Seaman’s New Kalender de Colson
indiquent comme position pour les Sorlingues 50’12s N et pour Lizard 50’10s N, alors
que c’est 49’52s et 49’58s soit une séparation d’une vingtaine de miles entre les deux.
Bibliographie :
Pays-Bas:
Ph.M.Bosscher, « Van Plancius tot Ijzerman. Iets over de geschiedenis van de opleiding tot
marine-officier in Nederland, » papier du Koninklijke Instituut voor de Marine, juli 1979, 17
p.
Jaap Ruud Bruijn, Varend Verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw,
Amsterdam, Uitgeverij Balans, 1998.
Carel A Davids, Zeewezen en Wetenschap. De Wetenschap en de ontwikkeling van de
navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815; Amsterdam, de Bataafsche Leeuw,
1985, 518 p.
Roelof van Gelder, Nederlandse brieven in het archief van het High Court of Admiralty in The
National Archives in Kew, Groot-Brittanië, inventaire établi en 2006.
53
Cette information est intéressante. Elle montre, en dehors de la prise de conscience à l’époque des risques des
perturbations magnétiques du fait des conditions de navigation et de fabrication du compas, de la diffusion de cet
outil. On obtient une moyenne d’une douzaine de compas par navire. Sur les compas et les soucis liés à sa
fabrication, voir le livre de Davids.
24
Roelof van Gelder, Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw, Amsterdam,
uitgeverij Olympu, 3ème édition, 2010.
Herman Ketting, Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (1595-1650),
Amterdam, Het Spinhuis, 2002.
G.J.A Raven, “ Blijven of weggaan ? De Perspectieven voor marineofficieren tijdens de
nadagen van de Republiek 1751-1795 ” Mededelingen Nederlandse Vereniging
Zeegeschiedenis, n° 40-41, 1980, p. 23-50.
Marc A Van Alphen, « Voorlopers van het Koninklijke Instituut voor de Marine. De opleiding
van adelborsten tot 1829 »; Mars et Historia, juillet-septembre 1996, n°3, p. 11-39.
Marc A Van Alphen, « Schoolships for midshipsman on the Dutch, Bristish and US navies in
the 19th and beginning of the 20th century »; Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, n°19, 2000-2,
p. 153-174.
France:
Roberto Barazzutti, “ Les officiers de la marine de guerre française au milieu du XVIIe siècle
(1643-1669) ”, Chronique d'Histoire Maritime, I-1999, n°39, p. 13-20.
Françoise Riou-Perennes, Les chevaliers de Malte dans la Marine royale sous l'Ancien
Régime, thèse, Université de Tours, multigr., 2004 ; Id., “ Les chevaliers de Malte dans la
marine de Richelieu: 1626-1642 ”, Neptunia, Paris 1995, no197, p. 9-16
Michel Vergé-Franceschi, Marine et Education, Paris, CNRS edition, 1991.
Grande-Bretagne:
Norbert Elias, The Genesis of the Naval Profession, édité et annoté par René Moelker et
Stephen Mennell, University College Dublin Press, Dublin, 2007, 172 p.
N.A.M Rodger, The Safeguard of the sea : a naval history of Britain, vol. 1, 660-1649, London,
Harper et Collins Publication, 1997; Id., The Command of the Ocean. A Naval History of
Britain, vol. 2 1649-1815, London, Penguin Books, 2004.
N.A.M Rodger, The Wooden World,
Bernard Capp, Cromwell’s Navy : The Fleet and the English Revolution 1648-1660, Oxford,
Clarendon Press, 1989.
John Davies, Gentlemen and Tarpaulins : the officers and men of the Restoration navy,
Oxford, Clarendon Press, 1991.
25
John Davies autre livre ….
H.W Dickinson, notice Education and Training,
Le livre sur les vies des amiraux ….
Général et autres pays:
Jan Lucassen, “ The International Maritime Labour Market (Sixteenth -Nineteenh Century) ”
dans Paul C. van Royen, Jaap R. Bruijn et Jan Lucassen (dir.), Those Emblem’s of hell ?
European sailor and the maritime labour market 1570-1870, Research in Maritime History
n°13, St John’s (Newfoundland), International Maritime Economic History Association, 1997,
p. 11-23 ; Jaap R. Bruijn “ Career Patterns ”, dans Those Emblem’s of hell ? … , op.cit., p. 25-
34 ; Carel Davids “ Maritime Labour in the Netherlands 1570-1870 ” dans, Those Emblem’s
of hell ?...,op.cit. , p. 41-71.
Johan Zielstra, “Een publiek geheim. Russische wervingsactie in de Republiek 1715-1716”,
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, n°23, 2004-2, p. 158-167.
P.A Krotov, “Russische navigators in Nederland tussen 1708 en 1715”, Tijdschrift voor
Zeegeschiedenis, n°21, 2002-1, p. 15-23.
Annexe
Tableau mesurant l’illettrisme et l’aptitude au calcul des matelots de différentes nationalités
1756-1783 selon les documents provenant des interrogatoires à la suite d’une capture par
des Anglais.
Aire d'origines Patron Marins Tout l'équipage
Nb Whipple Index % Illettré Nb Whipple Index % Illettré Nb Whipple Index % Illettré
Allemagne 27 0 41 29 115 126 18
Danemark 19 5 30 10 93 106 6
Pays-Bas 100 100 1 64 156 13 250 126 6
France 68 92 7 72 163 31 216 116 19
Espagne 44 5 60 171 25 140 140 14
Total 291 112 4 346 137 25 129 129 15
Source : « Sailors, National and International Labour Markets and National Identity 1600-
1850 », Lex Heerma van Voss, Jelle van Lottum, Jan Lucassen et Matthias van Rossum.
Présentation à la session ‘Maritime History as Global History’ du World Economic History
Conference, Universite d’Utrecht, 5 aôut 2009, consultable à l’adresse suivante
http://www.wehc2009.org/programme.asp?day=3&time=6
26
Généralement, il est considéré une relation entre l’habilité de signer son nom de famille et
le degré d’alphabétisation. Dans le même sens, l’indication de l’âge fournit par la personne
est un indicateur de son habilité au calcul et au chiffre. Ceux qui ne sont pas très habitués
donne un âge qui se termine généralement par 0 ou 5, un phénomène appelé « age
heaping » (Brian A’Hearn, Jog Baten et Dorothy Crayen « Quantifying Quantitative Literacy :
Age Heaping and the History of Human Capital », Version 19, novembre 2006,
www.recercat.net/handle/2072/3790). Le Whipple Index mesure le degré à laquelle les âges
se finissant par 0 ou 5 sont surreprésentés dans les âges reportés sur une population. Le
Whipple Index donne un score allant de 0 (si les âges se finissant par 0 ou 5 ne sont pas
représentés dans le groupe) jusqu’à 500 (tous les âges mentionnés se terminent par 0 ou 5).
Ainsi si le score du Whipple Index est de 100 ou en dessous, il n’y a aucun signe de age
heaping. Les scores au dessus de 100 montrent un accroissement du age heaping.